DÉTENTION ET ACTE INHUMAIN OU DÉGRADANT
ARTICLE 3 DE LA CEDH
Pour plus de sécurité, fbls détention est sur : https://www.fbls.net/3detention.htm
Aucun cookie garanti = liberté préservée pour chacun !
"La détention est la perte de liberté, rien
d'autre"
Frédéric Fabre docteur en droit.
ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"
Cliquez sur un bouton ou un lien bleu pour accéder gratuitement à la JURISPRUDENCE DE LA CEDH :
- LA DÉTENTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE D'UN FAIT GRAVE POUR VIOLER L'ARTICLE 3
- LA VIOLENCE CONTRE LES DÉTENUS
- LA DÉTENTION EN CELLULE DISCIPLINAIRE
- LA SURPOPULATION CARCÉRALE, LA VÉTUSTÉ ET LE MANQUE D'HYGIÈNE
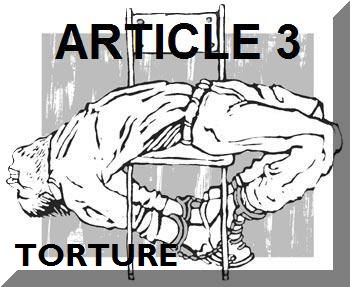 - LA
DÉTENTION ILLÉGALE EST UN ACTE INHUMAIN ET DÉGRADANT
- LA
DÉTENTION ILLÉGALE EST UN ACTE INHUMAIN ET DÉGRADANT
- LA DÉTENTION D'UN INDIVIDU MALADE OU HANDICAPÉ
- LAISSER UN INDIVIDU SANS RESSOURCES FINANCIÈRES APRÈS UNE DÉTENTION EST UNE VIOLATION
- LA COMPARUTION DU PRÉVENU DÉTENU
- LE DÉLAI POUR SAISIR LA CEDH EST FORCLOS QUATRE MOIS APRÈS LA LIBÉRATION
- LES DÉTENUS DOIVENT FAIRE CHACUN, UNE REQUÊTE INDIVIDUELLE ET NON COLLECTIVE
- LES RECOURS INTERNES DOIVENT ÊTRE ÉPUISÉS QUAND ILS EXISTENT
MOTIVATIONS REMARQUABLES
M.D. ET A.D. c. FRANCE du 22 juillet 2021 requête n° 57035/18
FAITS
1. Les requérantes, une mère et sa fille alors âgée de quatre mois, furent placées au centre de rétention administrative no 2 du Mesnil-Amelot dans le cadre d’une procédure de transfert en Italie pendant onze jours.
2. Les requérantes soutiennent que leur placement et leur maintien en rétention administrative est contraire aux articles 3 et 5 § 1 f) de la Convention. Elles font également valoir l’inefficacité du recours pour contester la légalité de la rétention de l’enfant mineur sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. Les requérantes soutiennent enfin que leur placement en rétention a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
CEDH
71. Compte tenu du très jeune âge de la seconde requérante, des conditions d’accueil dans le centre de rétention no 2 du Mesnil-Amelot et de la durée du placement en rétention, la Cour estime que les autorités compétentes l’ont soumise, à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Eu égard aux liens inséparables qui unissent une mère et son bébé de quatre mois, aux interactions qui résultent de l’allaitement ainsi qu’aux émotions qu’ils partagent, la Cour estime qu’il en va de même, dans les circonstances particulières de l’espèce, s’agissant de la première requérante. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à leur égard.
89. S’il ne lui appartient pas en principe, dans le cadre du contrôle du respect de l’article 5 § 1, de substituer son appréciation à celle des autorités nationales, ainsi qu’il ressort de sa jurisprudence (voir paragraphe 86 ci-dessus), la Cour doit vérifier, dès lors qu’un enfant mineur est ici en cause, si la mesure litigieuse était nécessaire pour atteindre le but qu’elle poursuit. Au cas d’espèce, elle estime disposer d’éléments suffisants, lesquels ont conduit, compte tenu des conditions de rétention, au constat d’une violation de l’article 3 de la Convention (voir ci-dessus), pour établir que les autorités internes n’ont pas effectivement vérifié, dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique désormais applicable en France, que le placement initial en rétention administrative de la première requérante accompagnée de son enfant mineur puis sa prolongation constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre moins restrictive ne pouvait être substituée. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à l’égard de la seconde requérante.>
103. La Cour a constaté ci-dessus une violation de l’article 5 § 1 au motif que les autorités internes n’avaient pas effectivement vérifié, dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique désormais applicable en France, que le placement initial en rétention administrative de la première requérante accompagnée de son enfant mineur puis sa prolongation constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre moins restrictive ne pouvait être substituée (voir paragraphe 89 ci-dessus). Cette absence de vérification effective des conditions qui concernent tant la légalité de la mesure de rétention en droit interne que le principe de légalité au sens de la Convention est particulièrement imputable aux juridictions internes auxquelles il incombait de s’assurer effectivement de la légalité du placement initial puis du maintien en rétention de l’enfant mineur. Il s’ensuit que la requérante mineure n’a pas bénéficié d’un contrôle portant sur l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la rétention au regard du paragraphe 1 de l’article 5. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention à son égard.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
LA DÉTENTION DOIT ÊTRE COMPLETÉE
D'UN FAIT GRAVE POUR VIOLER L'ARTICLE 3
Il n'est donc pas possible de présenter une requête pour contester les conditions normales de détention après un jugement équitable sur le fondement d'un acte inhumain et dégradant.
Bayram c. Turquie du 4 février 2020 requête n° 7087/12
Article 3 : Conditions de détention dégradantes pour un détenu handicapé en fauteuil roulant.
L’affaire concerne les conditions de détention du requérant, paraplégique, ne pouvant se déplacer par ses propres moyens. Affecté d’un taux d’incapacité physique de 92%, le requérant n’a reçu aucune assistance entre le 11 avril 2011 et le 27 avril 2011 à la prison de Batman. A partir du 27 avril 2011, l’administration pénitentiaire lui a délégué deux de ses codétenus comme aides-soignants. La période durant laquelle le requérant, ne pouvant se déplacer par ses propres moyens, a dû être porté entre les étages s’est étendue jusqu’au 25 septembre 2012, soit quelque dix-sept mois.
FAITS
Le requérant, M. Fikret Bayram, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Batman (Turquie). Entre 1990 et 1992, M. Bayram prit part à plusieurs actes terroristes, dont trois homicides, au nom de l’organisation illégale Hezbollah. Au cours d’un de ces actes, il fut blessé par balles par l’une de ses victimes et devint paraplégique. En 1995, il fut reconnu coupable et se vit infliger une peine de prison de 26 ans, avant de bénéficier d’une grâce présidentielle. En 2000, après avoir découvert qu’il avait participé à d’autres actes, les autorités le replacèrent en détention provisoire puis le remirent en liberté en 2004, en cours de procédure. En 2006, la justice le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Des dizaines de rapports médicaux furent établis entre 2007 et 2009, et 2011 et 2013. Les premiers exposèrent que le handicap du requérant était permanent, qu’il était contraint d’utiliser un fauteuil roulant et que son taux d’incapacité physique était de 92 %. Les expertises plus récentes firent état de problèmes rénaux et de surpoids, ainsi que de dépression. À la suite du jugement de 2006 et malgré son état médical, M. Bayram fut incarcéré dans la prison de Batman en 2009, où il occupa des unités de vie à étage avec plusieurs autres détenus. Son frère, qui faisait partie de ses codétenus, s’occupa de lui jusqu’à sa propre libération. Cette fonction fut ensuite attribuée à deux codétenus moyennant rémunération. L’aide consistait à porter le requérant entre les étages de l’unité de vie et à l’assister pour ses besoins d’hygiène personnelle, étant luimême incapable d’accomplir les actes de la vie quotidienne à cause de son handicap. En 2012, à sa demande, M. Bayram fut transféré à la prison de Diyarbakır qui disposait d’unités de vie à un seul niveau, d’un ascenseur et de deux fauteuils roulants disponibles. Un codétenu fut désigné comme aide-soignant.
Le 14 juin 2013, le procureur de la République de Diyarbakır décida de surseoir à l’exécution de la peine du requérant au vu de l’état de santé de ce dernier. Le requérant fut libéré le jour-même
ARTICLE 3 POUR CAUSE DE DETENTION
51. Le requérant expose qu’il était humiliant pour lui, lorsqu’il séjournait à la prison de Batman, de devoir être porté par des inconnus sur une vingtaine de marches d’escalier afin de pouvoir accéder aux équipements sanitaires. Sans détailler son grief, il se plaint également de ne pas avoir pu sortir dans la cour de promenade autant que les autres détenus. Il considère ainsi qu’eu égard à son grave handicap son emprisonnement était incompatible avec l’article 3 de la Convention, que sa place était auprès de sa famille et qu’il aurait dû pouvoir exécuter sa peine à son domicile.
52. Le Gouvernement rétorque que des détenus furent désignés comme aides-soignants aux frais de l’administration pénitentiaire, que des fauteuils roulants furent mis à la disposition du requérant, dont un pour une utilisation spécifique à son hygiène personnelle dans la prison de Diyarbakır, et que dans cet établissement la porte de la pièce renfermant les équipements sanitaires fut élargie de manière à permettre une plus grande autonomie de l’intéressé.
Principes généraux
53. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime, etc. (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 88, CEDH 2010, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 86, CEDH 2015). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
54. L’article 3 de la Convention impose aussi à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (pour un détenu handicapé, voir Vincent c. France, no 6253/03, § 98, 24 octobre 2006 ; voir également l’arrêt Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, CEDH 2001-VII, où la Cour a jugé que le fait d’avoir maintenu la requérante, handicapée des quatre membres, en détention dans des conditions inadaptées à son état de santé s’analysait en un traitement dégradant ; pour les conditions de détention en général, voir, Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 93, 22 mai 2012 et Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 99, 20 octobre 2016).
Application en l’espèce
55. La Cour observe que le requérant, dont le taux d’incapacité physique est de 92%, n’a reçu officiellement aucune assistance entre le 11 avril 2011, date de la libération de son frère, qui s’occupait de lui, et le 27 avril 2011, date à laquelle l’administration pénitentiaire de Batman décida que deux des codétenus de l’intéressé seraient rémunérés pour officier comme aides-soignants à son égard. Le rôle de ces personnes était de porter le requérant entre les deux étages de son unité de vie et de l’assister dans ses besoins d’hygiène personnelle. Les parties ne donnent aucun détail sur ce dernier point. Le requérant avait un fauteuil roulant à sa disposition, et il a selon toute vraisemblance participé à des activités socioculturelles dans cet établissement. Il avait aussi accès à la cour de promenade, située au rez-de-chaussée, à condition d’être porté à ce niveau.
56. Par la suite, le 25 septembre 2012, le requérant fut transféré à la prison de type D de Diyarbakır, où il fut placé dans un dortoir aménagé sur un seul niveau. Les équipements sanitaires se trouvaient dans une pièce dont la porte fut élargie pour permettre le passage des fauteuils roulants. Le requérant avait à sa disposition deux fauteuils roulants, dont un pour une utilisation spécifique à la pièce renfermant les équipements sanitaires. Les parties ne donnent aucun détail sur ce dernier point non plus. Le 29 avril 2013, le comité administratif de la prison de Diyarbakır désigna un codétenu du requérant pour l’assister en tant qu’aide-soignant rémunéré. Les parties ne donnent pas davantage de détails sur la situation qui fut concrètement celle de l’intéressé entre ces deux dernières dates. Le requérant ne se plaint pas non plus, par exemple, de l’impossibilité de passer avec son fauteuil roulant les portes séparant les autres pièces de l’unité de vie ou bien la porte d’entrée principale de celle-ci.
57. La Cour note que le requérant ne formule pas non plus, relativement à l’une ou l’autre des périodes passées par lui dans les prisons de Batman et de Diyarbakır, de griefs spécifiques concernant la compatibilité des équipements sanitaires avec son handicap ou la nature de l’aide qui lui était nécessaire pour son hygiène personnelle. Elle relève également que l’intéressé ne conteste pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il a participé à des activités socioculturelles à la prison de Batman.
58. D’une manière générale, la Cour observe que les autorités ont montré une certaine diligence pour prendre en charge le requérant et pour améliorer ses conditions de détention (paragraphes 21-32 ci-dessus). Elle relève par ailleurs que rien ne permet de dire qu’il y ait eu intention d’humilier ou de rabaisser l’intéressé durant sa détention. Des procédures tendant à son admission au bénéfice d’une grâce présidentielle furent également engagées à deux reprises (paragraphes 15 et 20 ci-dessus). En définitive, il fut sursis à l’exécution de la peine du requérant et celui-ci fut libéré le 14 juin 2013 (paragraphe 11 ci-dessus).
59. La Cour rappelle toutefois avoir déjà dit que la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut pas se déplacer par ses propres moyens constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention (Vincent, précité, § 103). En l’espèce, il est évident que pour ce qui est de la période du 11 au 27 avril 2011, que le requérant s’est trouvé dans l’incapacité de se déplacer de manière autonome dans la prison de Batman, où l’unité de vie était aménagée sur deux niveaux : son lit se trouvait à l’étage supérieur, tandis que les équipements sanitaires et la sortie vers la cour de promenade se situaient au rez-de-chaussée. Bien qu’il s’agisse là d’une durée relativement courte, il n’en reste pas moins que le requérant a été obligé de demander l’assistance bienveillante de ses codétenus pour se rendre aux toilettes. Le 27 avril 2011, deux de ses codétenus furent chargés, contre rémunération, de lui servir d’aides-soignants. Assez pragmatique dans les cas où l’assistance ne requiert pas les connaissances d’un infirmier, cette solution semble également exister dans d’autres pays (Vincent, précité, § 31). Cela dit, la période au cours de laquelle le requérant a eu besoin d’être porté entre les étages a perduré jusqu’au 25 septembre 2012. Elle s’est donc étendue sur quelque dix-sept mois. Aux yeux de la Cour, cette durée est beaucoup trop longue pour que la solution en question puisse être validée en l’espèce, et elle emporte par là même dépassement du seuil de gravité nécessaire pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention. Pour les mêmes motifs, l’argument du Gouvernement relatif à la qualité de victime du requérant doit être rejeté.
60. Par ailleurs, le Gouvernement n’explique pas pourquoi le requérant n’a, pendant cette période, pas été transféré à la prison de type R de Metris, qui était adaptée aux personnes à mobilité réduite (paragraphe 34 ci-dessus), ou bien, après un délai raisonnable – et sous réserve que l’intéressé n’eût pas opposé un refus pour des motifs valables, liés par exemple à la proximité géographique de ses proches – dans un établissement pénitentiaire disposant d’unités de vie aménagées sur un seul niveau et plus facilement adaptables à sa situation.
61. C’était le cas de la prison de Diyarbakır, où le requérant fut transféré le 25 septembre 2012 : l’unité de vie se situait sur un seul niveau, un fauteuil roulant supplémentaire spécifiquement conçu pour pouvoir être utilisé dans la pièce renfermant les équipements sanitaires fut mis à la disposition de l’intéressé et la porte de la pièce donnant accès à ces équipements fut élargie pour permettre le passage des fauteuils roulants.
62. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions dans lesquelles le requérant a dû séjourner dans la prison de Batman du 11 avril 2011 au 25 septembre 2012.
63. Pour les motifs indiqués au paragraphe 61 ci-dessus quant à la prison de Diyarbakır, elle conclut en revanche qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition relativement à la période du 25 septembre 2012 au 14 juin 2013, durant laquelle le requérant a séjourné dans cette dernière prison.
ÖCALAN c. TURQUIE Requêtes nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07 du 18 mars 2014
LA CEDH EXAMINE AVEC BEAUCOUP DE MINUTIE LES CONDITIONS DE DETENTION DU REQUERANT POUR CONSTATER UNE VIOLATION DE LA CONVENTION JUSQU'AU 17 NOVEMBRE 2009 ET UNE NON VIOLATION SUR LA PERIODE LA PLUS RECENTE.
97. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et quels que soient les agissements de la personne concernée, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (El Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » [GC], no 39630/09, § 195, CEDH 2012, Ramirez Sanchez, précité, § 115, et Chahal, précité, § 79).
98. Les difficultés que rencontrent les États à notre époque pour protéger leurs populations de la violence terroriste sont réelles. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 93, Recueil 1998-VIII). La nature de l’infraction reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 (Ramirez Sanchez, précité, § 116, et Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 30, 18 octobre 2001).
99. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c. Royaume‑Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (ibidem, § 161).
100. La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation durant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a, ou non, atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997‑VIII). Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (V. c. Royaume‑Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Van der Ven c. Pays‑Bas, no 50901/99, § 48, CEDH 2003‑II).
101. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni, précité, § 71, Indelicato, précité, § 32, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004-VII, et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).
102. À ce propos, il y a lieu d’observer que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Néanmoins, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła, précité, §§ 92-94, et Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI). La Cour ajoute que les mesures prises doivent en outre être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Ramirez Sanchez, précité, § 119).
103. Par ailleurs, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑II).
104. La prolongation dans le temps de son isolement social relatif constitue l’un des éléments essentiels des allégations du requérant dans la présente affaire. Sur ce point spécifique, la Cour rappelle que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux États parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression, de perturbation de la collectivité des détenus ou de contact avec les milieux du crime organisé, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (Ramirez Sanchez, précité, § 138).
105. Il demeure que les décisions de prolongation d’un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante.
106. Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte d’« emprisonnement dans la prison », qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des règles pénitentiaires adoptées par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006. Un contrôle régulier de l’état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s’assurer de sa compatibilité avec le maintien à l’isolement, devrait également être instauré (Ramirez Sanchez, précité, § 139).
107. La Cour a déjà établi quelles étaient les conditions dans lesquelles l’isolement d’un détenu – fût-il considéré comme dangereux – constituait un traitement inhumain ou dégradant (voire dans certaines circonstances une torture). Elle a ainsi rappelé ce qui suit :
« L’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains. »
(voir, entre autres, Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999‑V, et Öcalan, précité, § 191, les deux affaires dans lesquelles la Cour a conclu à l’absence de traitements contraires à l’article 3).
De même, la Cour a constaté la violation de l’article 3 de la Convention dans les conditions de détention suivantes :
« En ce qui concerne les conditions de détention du requérant dans le couloir de la mort, la Cour note que M. Ilaşcu a été détenu pendant huit ans, depuis 1993 et jusqu’à sa libération en mai 2001, en régime d’isolement sévère : sans contact avec d’autres détenus, sans aucune nouvelle de l’extérieur, puisqu’il n’avait pas la permission d’envoyer ou de recevoir du courrier, et privé du droit de prendre contact avec son avocat ou de recevoir régulièrement la visite de sa famille ; sa cellule non chauffée, même dans les rudes conditions d’hiver, était dépourvue d’éclairage naturel et d’aération. Il ressort du dossier que M. Ilaşcu a aussi été privé de nourriture en guise de punition et qu’en tout état de cause, compte tenu des restrictions à la réception de colis, même la nourriture qu’il recevait de l’extérieur était souvent impropre à la consommation. Le requérant ne pouvait prendre une douche que très rarement, parfois à plusieurs mois d’intervalle. A ce sujet, la Cour renvoie aux conclusions figurant dans le rapport rédigé par le CPT à la suite de sa visite en Transnistrie en 2000 (...), qualifiant d’indéfendable un isolement prolongé pendant de nombreuses années.
Les conditions de détention du requérant ont eu des effets préjudiciables sur sa santé, qui s’est détériorée tout au long de ces nombreuses années de détention. Ainsi, le requérant n’a pas été correctement soigné, en l’absence de visites et de traitements médicaux réguliers (...) et de repas diététiques. Par ailleurs, compte tenu des restrictions imposées à la réception de colis, il n’a pas pu recevoir des médicaments et de la nourriture bénéfiques pour sa santé. »
(Ilaşcu et autres, précité, § 438 ; voir, pour une conclusion de non violation de l’article 3 pour des conditions de détention différentes, Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 97, 21 juillet 2005).
c) Application de ces principes au cas d’espèce
i. La spécificité de l’affaire
108. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a constaté, dans son arrêt du 12 mai 2005, que la détention du requérant posait d’extraordinaires difficultés aux autorités turques. Chef d’un mouvement armé séparatiste de grande ampleur, l’intéressé était considéré par une large part de la population en Turquie comme le terroriste le plus dangereux du pays. S’ajoutaient à cela les divergences qui s’étaient faites jour au sein de sa propre organisation. Ces faits démontraient qu’il existait des risques réels pour sa vie. On pouvait aussi raisonnablement prévoir que ses partisans ne manqueraient pas de tenter de le faire évader de son lieu de détention.
109. La Cour observe que ces conditions n’ont pas radicalement changé depuis mai 2005 : le requérant est resté actif dans sa participation au débat politique en Turquie concernant le mouvement armé séparatiste que représente le PKK, et ses instructions transmises par le biais de ses avocats (voir supra § 43) ont été suivies par le public et ont fait l’objet de diverses réactions, même les plus extrêmes (voir supra § 45). La Cour comprend donc que les autorités turques aient estimé nécessaire de prendre des mesures de sécurité extraordinaires dans le cadre de la détention du requérant.
ii. Les conditions matérielles de détention
110. Les conditions matérielles de détention du requérant doivent être prises en compte dans l’examen de la nature et de la durée de l’isolement.
111. La Cour observe qu’avant le 17 novembre 2009 la cellule qu’occupait seul le requérant mesurait 13 m² environ, disposait d’un lit, d’une table, d’un fauteuil et d’une bibliothèque. Elle était climatisée et dotée d’un coin toilette. Elle possédait une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure et bénéficiait d’un éclairage naturel et artificiel suffisant. En février 2004, les murs avaient été renforcés par des panneaux en aggloméré permettant de réduire l’humidité.
112. La Cour observe aussi que, depuis le 17 novembre 2009, le requérant occupe seul une cellule dans le nouveau bâtiment de la prison d’İmralı qui a été construit pour accueillir également d’autres détenus. Sa nouvelle cellule a une superficie de 9,8 m² (espace de vie) auxquels s’ajoutent 2 m² (salle d’eau et toilettes), et possède un lit, une petite table, deux chaises, une armoire métallique et un coin cuisine doté d’un lavabo. Le bâtiment où se trouvent les cellules est bien protégé contre l’humidité. La cellule du requérant dispose d’une fenêtre de 1 m x 0,5 m et d’une porte en partie vitrée, les deux donnant sur une cour intérieure. Selon le CPT, la cellule est privée d’un ensoleillement direct suffisant par le mur de 6 m de haut qui entoure cette cour. Le Gouvernement, sur la base d’une expertise indiquant que la cellule recevait assez de soleil, et par crainte pour la sécurité du requérant, n’aurait pas accepté la proposition du CPT tendant à l’abaissement du mur en question.
113. Dans le nouveau bâtiment ont été mises à la disposition du requérant et des autres détenus une salle de sport équipée d’une table de ping-pong et deux autres salles dotées de chaises et de tables, pièces recevant toutes une abondante lumière naturelle. Jusqu’à la fin de 2009 et au début de 2010, le requérant bénéficiait, dans le nouveau bâtiment, de deux heures d’activités en plein air par jour, en restant seul dans la cour intérieure réservée à sa cellule. En outre, il pouvait passer une heure par semaine, seul, dans la salle de loisirs (où aucune activité spécifique n’était proposée) et deux heures par mois, seul, dans la bibliothèque de la prison (paragraphe 26 ci‑dessus).
114. Donnant suite aux observations formulées par le CPT après sa visite de janvier 2010, les autorités responsables de la prison d’İmralı ont assoupli le régime en question. Le requérant a ainsi été autorisé à mener, seul, des activités à l’extérieur de sa cellule à raison de quatre heures par jour.
115. La Cour constate que les conditions de détention matérielles du requérant sont conformes aux règles pénitentiaires européennes qui ont été adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres. Elles ont par ailleurs été considérées comme « globalement acceptables » par le CPT. Dès lors, aucune atteinte à l’article 3 ne saurait être relevée de ce chef.
iii. La nature de l’isolement du requérant
– L’accès à l’information
116. Avant le 17 novembre 2009, le requérant disposait dans sa cellule de livres et d’un poste de radio pouvant capter uniquement des émissions étatiques. Il n’était pas autorisé à avoir un poste de télévision dans sa cellule, au motif qu’il était un détenu dangereux et était membre d’une organisation illégale. Pour les mêmes raisons, il n’avait pas non plus accès au téléphone. Ces restrictions contribuaient à l’isolement social relatif de l’intéressé.
117. Pendant la même période, le requérant était soumis à un accès restreint à la presse quotidienne et hebdomadaire. En fait, il recevait des journaux une fois par semaine, les numéros fournis par sa famille ou par ses avocats. En l’absence de visites de membres de sa famille et de ses avocats, il lui arrivait de rester des semaines sans accès à la presse. Les journaux remis à l’intéressé étaient largement censurés.
118. Après le 17 novembre 2009, ces conditions ont été marquées par quelques améliorations. A partir de 2010, le requérant, comme les autres détenus de la prison d’İmralı, a pu recevoir des journaux deux fois par semaine au lieu d’une seule fois. Depuis mars 2010, il dispose aussi de dix minutes de conversation téléphonique avec l’extérieur tous les quinze jours.
119. Dans l’ensemble, la Cour observe que le requérant a bénéficié d’un accès modéré à l’information, ne disposant pas à tout moment de tous les moyens de communication. La censure des quotidiens remis à l’intéressé semble compensée par un accès non censuré aux livres. L’accès aux moyens audiovisuels (télévision) restant un moyen de réduire les effets néfastes de l’isolement social, et les détenus dans les autres prisons de haute sécurité bénéficiant sans restrictions importantes de cette possibilité, la Cour estime que la limitation imposée jusqu’à récemment au requérant sur ce point sans justification convaincante pouvait contribuer à long terme à son isolement social relatif.
– La communication avec le personnel de la prison
120. À la lumière des rapports que le CPT a préparés à l’issue de ses visites de 2007 et de 2010 (voir les links au paragraphe 72 ci‑dessus, (CPT/Inf (2008)13 pour la visite de mai 2007, §§ 25-30, et CPT/Inf (2010) 20 pour celle de janvier 2010, §§ 30-35), la Cour observe que le requérant a reçu, pendant pratiquement les onze premières années de sa détention, la visite quotidienne de médecins généralistes. Ces médecins changeaient à chaque fois, ce qui selon le CPT rendait impossible toute relation constructive entre le médecin et le patient.
121. À partir de mai 2010, à la suite des recommandations du CPT, le requérant a bénéficié de visites médicales soit régulièrement et mensuellement, soit à sa demande ou en cas de nécessité. Un médecin spécifique a été chargé de recueillir toutes les données médicales sur la santé de l’intéressé, de les évaluer et de leur appliquer le secret médical.
122. La Cour note également qu’aucun des certificats médicaux établis par les médecins du ministère de la Santé ni aucun des rapports sur les visites du CPT n’ont indiqué que l’isolement social relatif pourrait avoir des conséquences néfastes permanentes et importantes pour la santé du requérant. Il est vrai qu’à l’issue de leur visite de 2007 les délégués du CPT ont signalé une détérioration de l’état psychique de l’intéressé par rapport aux années 2001 et 2003. Selon les délégués du CPT, cette dégradation résultait d’un état de stress chronique et d’un isolement social et émotionnel, combinés à un sentiment d’abandon et de déception, sans oublier un problème ORL durable. A la suite de leur visite à İmralı en 2010, après la construction d’un nouveau bâtiment et le transfert d’autres détenus dans l’établissement, les délégués du CPT ont pu constater que l’état psychique du requérant s’était nettement amélioré, même s’il restait une légère vulnérabilité, qui était à surveiller.
123. La Cour observe en outre que les membres du personnel de la prison sont autorisés à communiquer avec le requérant mais qu’ils doivent limiter leur conversation au strict minimum exigé par leur travail. Un tel contact n’est pas susceptible en soi d’amoindrir l’isolement social d’un détenu.
– La communication avec les autres détenus
124. Avant le 17 novembre 2009, le requérant, qui était le seul détenu de l’établissement pénitentiaire d’İmralı, ne pouvait avoir de contacts qu’avec les membres du personnel qui y travaillaient, et ce dans les limites strictes de leurs fonctions.
125. Après le 17 novembre 2009, date à laquelle le requérant et cinq autres détenus venus d’autres prisons et transférés à İmralı ont été installés dans le bâtiment nouvellement construit, l’intéressé a été autorisé à passer une heure par semaine avec les autres détenus pour la conversation.
126. En réponse aux observations formulées par le CPT à la suite de sa visite de janvier 2010, les autorités responsables de la prison d’İmralı ont assoupli les possibilités de communication entre le requérant et les autres détenus. Depuis, l’intéressé peut passer trois heures – et non plus une heure – par semaine avec les autres détenus pour la conversation. Par ailleurs, comme tous les détenus d’İmralı, il peut pratiquer, à sa demande, les cinq activités collectives suivantes, à raison d’une heure par semaine pour chacune : peinture et arts plastiques, ping-pong, échecs, volleyball et basketball. Au total, il peut ainsi disposer de cinq heures hebdomadaires d’activités collectives. L’examen des registres de la prison montre qu’en pratique le requérant fait uniquement du volleyball et du basketball. En 2010, il était envisagé d’offrir au requérant et aux autres détenus deux heures hebdomadaires supplémentaires par semaine pour pratiquer d’autres activités collectives.
– La communication avec les membres de la famille
127. La Cour observe que le requérant a reçu la visite des membres de sa famille, notamment de ses sœurs et de son frère.
128. Même si le règlement de la prison autorise une heure de visite des proches (frères et sœurs dans le cas du requérant) tous les quinze jours, ces visites n’ont pu avoir lieu suivant la fréquence souhaitée par le requérant et sa famille. Le fait que l’intéressé soit détenu dans une prison située sur une île lointaine a inévitablement entraîné d’importantes difficultés d’accès à l’établissement pour les membres de la famille, par comparaison avec les centres pénitentiaires de haute sécurité qui se trouvent sur le continent. Les raisons principalement invoquées par les autorités gouvernementales pour justifier les fréquentes interruptions des services de navettes entre la prison et la côte la plus proche en témoignent : les « mauvaises conditions météorologiques », l’« entretien des bateaux assurant la navette entre l’île et le continent » et l’« impossibilité pour les bateaux navettes de faire face aux mauvaises conditions météorologiques ».
129. L’examen des dates et de la fréquence des visites rendues par des proches et de celles refusées montre qu’en 2006 et début 2007 il y a eu plus de visites refusées qu’effectuées. En revanche, fin 2007, ainsi qu’en 2008, en 2009 et en 2010, la fréquence des visites s’est accrue. Par contre, en 2011 et en 2012, le requérant n’a pu recevoir que quelques visites des membres de sa famille. A cet égard, la Cour note avec préoccupation qu’un grand nombre de visites ont été rendues impossibles en raison de mauvaises conditions météorologiques et de pannes techniques des bateaux nécessitant parfois des travaux de plusieurs semaines, malgré le fait que le Gouvernement avait plaidé devant la Cour, dans le cadre de l’affaire Öcalan c. Turquie aboutissant à l’arrêt de la Grande Chambre du 12 mai 2005, que de telles difficultés allaient être supprimées avec la mise en service des moyens de transport plus appropriés (Öcalan précité, § 194).
130. Quant aux conditions dans lesquelles se déroulent ces visites, la Cour observe qu’avant 2010, le requérant ne pouvait communiquer avec ses sœurs ou son frère que dans des parloirs dotés d’un dispositif de séparation (vitres et combinés téléphoniques), car le règlement de la prison réservait les parloirs sans séparation aux visites des proches du premier degré. Cette partie du règlement ayant été invalidée par les juridictions administratives en décembre 2009, le requérant et les membres de sa famille qui lui rendent visite peuvent depuis 2010 s’installer autour d’une table.
– La communication avec les avocats ou d’autres personnes
131. La Cour observe que le requérant a reçu la visite de ses avocats, parfois à intervalles réguliers, parfois de façon rare et occasionnelle. Alors que l’intéressé avait le droit de voir ses avocats une fois par semaine (le mercredi étant le jour des visites), il s’est vu priver de la plupart de ces visites. Les autorités pénitentiaires ont motivé le rejet des demandes de visite en invoquant les mauvaises conditions météorologiques ou une panne de bateau.
132. La Cour note à cet égard que les périodes durant lesquelles les visites d’avocats ont été refusées au requérant ont précédé le déclenchement de procédures contre certains conseils de l’intéressé, auxquels il était reproché d’avoir servi de messagers entre lui et le PKK. Elle constate que les interruptions des visites ont davantage été dues au souci des autorités nationales d’empêcher la communication entre le requérant et son ex‑organisation armée qu’aux conditions météorologiques ou aux pannes de bateau.
133. La Cour observe en outre que le requérant avait le droit de correspondre avec l’extérieur, sous le contrôle des autorités pénitentiaires, et que le courrier reçu par lui était contrôlé et censuré.
134. Elle note aussi que le requérant n’a pas été autorisé à avoir des entretiens confidentiels avec ses avocats. Les comptes rendus de ces entretiens étaient en effet soumis au contrôle du juge de l’exécution des peines.
135. La Cour constate sur ces points que la communication entre le requérant et ses avocats et la correspondance de l’intéressé, détenu pour activités terroristes, ont fait l’objet de restrictions plus importantes que celles touchant les détenus d’autres prisons. Néanmoins, alors que les personnes privées de leur liberté pour activités terroristes ne sauraient être soustraites au champ des dispositions de la Convention et qu’on ne peut porter atteinte à la substance de leurs droits et libertés ainsi reconnus, les autorités nationales peuvent leur imposer des « restrictions légitimes » dans la mesure où ces restrictions sont strictement nécessaires pour protéger la société contre la violence.
– Conclusion quant à la nature de l’isolement imposé au requérant
136. La Cour en conclut que, pour la période antérieure à la date du 17 novembre 2009, on ne saurait estimer que le requérant a été détenu dans un isolement sensoriel ou social total. Son isolement social à cette époque était partiel et relatif. Depuis cette date (pour le restant de la période examinée, voir supra § 96), l’intéressé ne saurait pas non plus être considéré comme ayant été maintenu dans un isolement social grave, en dépit des importantes restrictions de facto appliquées à sa communication avec ses avocats.
iv. La durée du maintien en isolement social du requérant
137. La Cour constate que le requérant a été maintenu dans un isolement social relatif entre le 12 mai 2005 et le 17 novembre 2009, soit pendant quatre ans et six mois environ. Il est à rappeler que le 12 mai 2005, date à laquelle la Cour a rendu son arrêt dans la précédente requête introduite par le requérant, ce dernier, appréhendé le 15 février 1999, était déjà détenu dans un isolement social relatif depuis six ans et trois mois environ. La durée totale de la détention en isolément social relatif s’est donc élevée à dix ans et neuf mois.
138. La longueur de cette période appelle de la part de la Cour un examen rigoureux en ce qui concerne sa justification, la nécessité des mesures prises et leur proportionnalité par rapport aux autres restrictions possibles, les garanties offertes au requérant pour éviter l’arbitraire et les mesures prises par les autorités pour s’assurer que l’état physique et psychologique du requérant permettait son maintien à l’isolement (Ramirez Sanchez, précité, § 136).
139. Pour la période antérieure au 17 novembre 2009, on peut comparer les restrictions subies par le requérant à celles imposées à Ramirez Sanchez, dont l’affaire a fait l’objet d’un arrêt de la Grande Chambre ayant conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention (Ramirez Sanchez, précité, voir, notamment, §§ 125-150). Alors que Ramirez Sanchez fut placé pour un certain temps dans un quartier de la prison dont les occupants n’avaient aucune possibilité de se croiser ou d’être regroupés en un même lieu, le requérant était l’unique détenu de la prison et de ce fait il ne pouvait au quotidien côtoyer que les médecins et les membres du personnel. Il recevait les visites des membres de sa famille et de ses avocats lorsque les conditions de transport maritime le permettaient.
140. La Cour admet que le placement et le maintien du requérant dans de telles conditions de détention étaient motivés par le risque d’évasion hors d’une prison normale, le souci de protéger la vie de l’intéressé contre ceux qui le jugent responsable de la mort d’un grand nombre de personnes, et la volonté de l’empêcher de transmettre des instructions à son organisation armée, le PKK, qui le considérait toujours comme son chef.
141. Cependant, la Cour a déjà estimé dans l’arrêt Ramirez Sanchez qu’il serait souhaitable que des solutions autres que la mise à l’isolement soient recherchées pour les individus tenus pour dangereux et pour lesquels la détention dans une prison ordinaire et dans des conditions normales est jugée inappropriée (Ramirez Sanchez, précité, § 146).
142. La Cour observe que, dans son rapport sur sa visite effectuée du 19 au 22 mai 2007, le CPT a exprimé des préoccupations semblables sur les effets néfastes du prolongement de conditions se résumant à un isolement social relatif. Finalement, en mars 2008, en l’absence d’avancées réelles de la part du Gouvernement sur ce point, le CPT a mis en route la procédure visant à la formulation d’une déclaration publique, telle que prévue à l’article 10 § 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
143. La Cour relève avec intérêt la réaction positive du Gouvernement. En effet, ce dernier a décidé en juin 2008 de construire un nouveau bâtiment dans l’enceinte de la prison d’İmralı afin de se conformer aux normes exigées par le CPT relativement à la détention du requérant et a mené en octobre 2008 des négociations de haut niveau sur ce point avec les représentants du CPT. La construction a été achevée en été 2009 et, en novembre 2009, le requérant ainsi que d’autres détenus transférés d’autres établissements pénitentiaires y ont été installés.
144. La Cour constate que le régime appliqué au requérant à partir de novembre 2009 s’est peu à peu éloigné de l’isolement social. Très limitée au début, sa communication avec les autres détenus a progressé dans la mesure où le Gouvernement a accueilli favorablement la plupart des indications du CPT en la matière. Face à ces développements, le CPT a mis fin en mars 2010 à la procédure qu’il avait décidé de lancer deux ans auparavant en vertu de l’article 10 § 2 de la Convention pour la prévention de la torture.
145. La Cour note les inquiétudes du CPT concernant les éventuels effets à long terme de l’absence prolongée de téléviseur dans la cellule du requérant (jusqu’à la date du 12 janvier 2012) et des fréquentes interruptions de sa communication avec ses avocats et les membres de sa famille. Tous ces moyens permettent d’éviter l’isolement social d’un détenu, donc du requérant. Le manque à long terme de ces moyens, combiné avec le facteur « temps », soit plus de treize ans de détention dans le cas du requérant si l’on part du début de sa captivité, risque de provoquer chez lui un sentiment justifié d’isolement social.
En particulier, la Cour estime que même si le choix d’une ile isolée comme lieu de détention du requérant incombe au Gouvernement, il est de devoir de ce dernier de doter, dans ce cas, l’établissement pénitencier en question des moyens de transport appropriés afin de permettre le déroulement normal du régime sur les visites des détenues.
v. Conclusions
- Avant le 17 novembre 2009
146. La Cour rappelle avoir pris note, dans son arrêt du 12 mai 2005, des recommandations du CPT selon lesquelles l’isolement social relatif du requérant ne devait pas durer trop longtemps et les effets de cet isolement devaient être atténués par l’accès de l’intéressé à la télévision et aux communications téléphoniques avec ses avocats et ses proches parents (Öcalan precité, § 195). Elle rappelle aussi avoir estimé dans le même arrêt que les conditions générales de la détention du requérant à la prison d’İmralı n’avaient pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention « pour le moment » (Öcalan precité, § 196). Or la Cour constate à présent que l’isolement social du requérant a continué, jusqu’au 17 novembre 2009, dans des conditions plus ou moins identiques à celles observées dans son arrêt du 12 mai 2005.
Dans son appréciation quant à la détention du requérant antérieure au 17 novembre 2009, la Cour tient compte des conclusions formulées par le CPT dans son rapport sur sa visite de mai 2007 (voir supra § 72) ainsi que de ses propres constats, notamment du prolongement à dix ans et neuf mois de la période pendant laquelle le requérant a été le seul détenu de l’établissement pénitentiaire (voir supra § 137), de l’absence de moyens de communication permettant d’éviter l’isolement social du requérant (absence prolongée de téléviseur dans la cellule et d’appels téléphoniques, voir supra § 116 et § 119), des limitations excessives de l’accès à l’information (voir supra §§ 116, 117 et 119), de la persistance des importantes difficultés d’accès à l’établissement pénitentiaire pour les visiteurs (membres de la famille ou avocats) et de l’insuffisance des moyens de transport maritimes face aux conditions météorologiques (voir supra § 129), de la limitation de la communication du personnel avec le requérant au strict minimum exigé par le travail (voir supra § 123 et 124), de l’absence de relation constructive entre le médecin et le requérant patient (voir supra § 120), de la détérioration de l’état psychique de l’intéressé en 2007 résultant d’un état de stress chronique et d’un isolement social et émotionnel, combinés à un sentiment d’abandon et de déception (voir supra § 122), ainsi que de l’absence de recherche de solutions autres que la mise à l’isolément du requérant, jusqu’en juin 2008, en dépit du fait que le CPT avait signalé dans son rapport sur sa visite de mai 2007 les effets néfastes du prolongement de conditions se résumant à un isolement social (voir supra § 122). La Cour en conclut que les conditions de détention imposées au requérant pendant cette période ont atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.
147. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux conditions de détention du requérant qui se sont prolongées jusqu’à la date du 17 novembre 2009.
- Après le 17 novembre 2009
148. Dans son appréciation quant à la période postérieure au 17 novembre 2009, la Cour tient compte principalement des conditions matérielles de détention du requérant, de la réaction positive du Gouvernement face à la procédure lancée par le CPT en vertu de l’article 10 § 2 de la Convention pour la prévention de la torture et ayant abouti à l’installation d’autres détenus à la prison d’Imrali (voir supra § 143), de l’amélioration de l’accès du requérant à l’information pendant cette période (voir supra § 118), de l’important renforcement de la communication et des activités communes du requérant avec les autres détenus en réponse aux observations du CPT formulées à la suite de sa visite de janvier 2010 (voir supra § 126), de l’augmentation des fréquences des visites autorisées et de la qualité des entretiens du requérant avec sa famille sans dispositif de séparation (voir supra §§ 129 et 130) et de la mise à disposition de moyens atténuant les effets de l’isolement social relatif (contacts téléphoniques depuis mars 2010, téléviseur dans sa cellule depuis janvier 2012). La Cour en conclut que les conditions de détention imposées au requérant pendant cette période n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.
149. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention imposées au requérant pendant la période postérieure à la date du 17 novembre 2009.
La Cour tient à souligner que le constat de non-violation de l’article 3 de la Convention ne saurait s’interpréter comme une excuse pour les autorités nationales pour ne pas fournir au requérant plus de facilités de communication avec l’extérieur ou alléger ses conditions de détention, puisqu’avec la prolongation de la durée passée par celui-ci en détention, lui accorder de telles facilités peut être nécessaire pour que ses conditions de détention restent en conformité avec les exigences de l’article 3 de la Convention.
G.B. et autres c. Turquie du 17 octobre 2019 requête n° 4633/15
Violation des articles 3, 5-1, 5-4 et 13 : Violations multiples des droits d’une mère et de ses jeunes enfants placés en rétention en Turquie
L’affaire concernait la rétention d’une mère et de ses trois jeunes enfants dans l’attente de leur expulsion de Turquie. Ils furent libérés près de quatre mois après avoir été privés de liberté, à la suite d’une série de recours qu’ils avaient engagés devant les juridictions internes pour contester la légalité de leur détention. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas réussi à réfuter les allégations des requérants selon lesquelles ils ont été détenus dans des dortoirs surpeuplés, ne pouvaient que rarement sortir à l’air frais, étaient constamment exposés à la fumée de cigarette des autres détenus et n’ont pu obtenir de nourriture adaptée aux enfants. Elle juge que pareilles conditions étaient manifestement néfastes, même pour des adultes, et qu’elles l’ont été d’autant plus pour les trois requérants qui étaient des enfants vulnérables. Elle dit également que même si une nouvelle loi, entrée en vigueur en 2014, a totalement remanié le cadre juridique de la migration et de l’asile en Turquie, celui-ci s’est révélé totalement ineffectif pour les requérants qui n’ont pas eu la possibilité de se plaindre des conditions de leur détention ni de contester la légalité de celle-ci.
FAITS
Les requérants, G.B. et ses trois enfants, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1986, en 2008, en 2012 et en 2013. Selon les informations les plus récentes figurant au dossier, ils résident actuellement à Bakou (Azerbaïdjan). Ils entrèrent en Turquie le 17 octobre 2014. Selon les registres officiels, ils furent arrêtés le lendemain alors qu’ils essayaient de franchir illégalement la frontière avec la Syrie. La préfecture locale ordonna le placement en rétention de G.B. dans l’attente de son expulsion, et toute la famille fut transférée au centre de rétention de Kumkapı à Istanbul.
Le 23 octobre 2014, la préfecture d’Istanbul confirma l’expulsion et le placement en détention de G.B. Toute la famille fut retenue au centre de rétention de Kumkapı pendant les trois mois qui suivirent, avant d’être transférée le 23 janvier 2015 au centre de rétention de Gaziantep. La préfecture de Gaziantep délivra alors un arrêté d’expulsion et une ordonnance de placement en détention contre les quatre requérants. Les intéressés contestèrent la légalité de leur détention dans les deux centres de rétention et demandèrent leur remise en liberté. Ils soulignèrent que les conditions de vie dans les centres en question étaient particulièrement inappropriées pour de jeunes enfants et que les autorités n’avaient envisagé aucune alternative à la détention, malgré l’état de vulnérabilité des intéressés. Le juge de paix d’Istanbul examina leurs demandes concernant leur rétention à Kumkapı.
Dans la décision initiale qu’il rendit en novembre 2014, il jugea qu’il ne pouvait statuer sur la légalité de la rétention des requérants mineurs dans ce centre au motif qu’aucune décision n’avait en réalité ordonné qu’ils y fussent placés. Il considéra par ailleurs que la rétention de leur mère était légale en ce que l’intéressée présentait un danger pour l’ordre public et avait tenté de quitter illégalement la Turquie. Dans quatre décisions ultérieures, il confirma que la rétention de G.B. était légale au vu des dispositions pertinentes en droit interne.
Dans une décision du 5 février 2015, le juge de paix de Gaziantep conclut en revanche que la rétention des requérants à Gaziantep n’était pas conforme au droit et ordonna leur remise en liberté. Il jugea en particulier qu’aucune explication n’avait été donnée quant à la nécessité de ladite rétention et qu’une demande d’asile était encore pendante devant les juridictions administratives. Les requérants furent libérés cinq jours plus tard.
Le 15 décembre 2014, alors qu’ils étaient encore retenus à Kumkapı, les requérants saisirent également la Cour constitutionnelle d’un recours individuel concernant les conditions de leur détention et la légalité de leur privation de liberté, ainsi que l’impossibilité qui était la leur de faire examiner leurs griefs en vertu du droit national.
Le 9 janvier 2015, la Cour constitutionnelle rejeta leur demande de mesures d’urgence au motif que les conditions de leur détention ne s’analysaient pas en un risque sérieux et immédiat pour leur vie ou pour leur intégrité physique ou mentale. En mai 2018, elle déclara la requête irrecevable au motif que les requérants avaient dans l’intervalle été libérés par décision du juge de paix de Gaziantep, et qu’ils pouvaient saisir les juridictions administratives d’une action en réparation concernant à la fois les conditions et l’illégalité de leur détention.
Article 3 (conditions de détention)
La Cour observe que les rapports du CPT (le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et de l’institution nationale des droits de l’homme de Turquie corroborent les allégations des requérants concernant les conditions de détention au centre de rétention de Kumkapı. Au contraire, le Gouvernement n’a soumis aucun élément permettant de réfuter les allégations des requérants. Il n’a pas prouvé son allégation selon laquelle les requérants avaient été logés dans un espace séparé réservé aux familles avec accès à une aire de jeu et n’a pas non plus réfuté les allégations des requérants selon lesquelles la famille avait rarement l’occasion de sortir à l’air frais, avait été exposée à la fumée de cigarette des autres détenus et n’avait pu obtenir de nourriture adaptée aux enfants. Les quelques informations qu’il a fournies, telles que la taille des dortoirs et le nombre de lits superposés dans chaque dortoir, sont plutôt de nature à inciter la Cour à tirer des conclusions alarmantes quant au manque sévère d’espace personnel à Kumkapı. La Cour considère que les conditions de détention des requérants à Kumkapı pendant trois mois, dans l’ignorance de la date exacte de leur libération, les a soumis à une détresse d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Elle souligne qu’il a déjà été jugé que pareilles conditions sont manifestement néfastes, même pour des adultes. Cette situation était donc particulièrement inadaptée aux enfants requérants, extrêmement vulnérables, et elle était totalement incompatible avec les principes largement reconnus au niveau international concernant la protection des enfants. Le Gouvernement n’a pas non plus fourni d’éléments suffisants pour réfuter les allégations des requérants concernant le centre de rétention de Gaziantep. Les éléments produits, à savoir des photographies de certaines des chambres dudit centre, ne permettent pas de savoir clairement si les requérants ont réellement été placés dans ces chambres et, le cas échéant, avec combien de personnes. Les photographies laissent même à penser que les enfants requérants dormaient dans des lits superposés en fer aux bords tranchants, qui pouvaient présenter des dangers pour des enfants de cet âge, et qu’ils ne disposaient d’aucune aire de jeu à l’intérieur ou en plein air. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 3 pour ce qui est des conditions de détention dans les deux centres de rétention de Kumkapı et de Gaziantep.
Article 13 combiné avec l’article 3 (voies de recours ouvertes pour se plaindre des conditions de détention)
La Cour note en particulier que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné la recevabilité et le fond du grief soulevé devant elle par les requérants alors qu’ils étaient encore détenus. Un recours purement indemnitaire qui ne peut être exercé qu’après la libération de l’intéressé, devant la Cour constitutionnelle ou autre, ne saurait donc être considéré comme effectif au regard des griefs des requérants. En outre, une voie de droit de nature à apporter une réponse plus rapide est requise lorsque des enfants sont détenus dans des conditions néfastes. La Cour conclut donc que même si la procédure de recours individuel devant la Cour constitutionnelle est en principe de nature à offrir la possibilité d’un redressement, elle n’a pas fonctionné de manière effective en l’espèce. Le Gouvernement n’a pas non plus indiqué d’autres voies de recours ouvertes aux intéressés à l’époque des faits, qui auraient permis de mettre rapidement un terme à la violation continue des droits des requérants découlant de l’article 3. La Cour souligne également que même si une nouvelle loi (loi n o 6548), entrée en vigueur en 2014, a totalement remanié le cadre juridique de la migration et de l’asile en Turquie, ni cette loi ni ses règlements d’application n’ont prévu de voies de recours spécifiques aux griefs portant sur les conditions de détention. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 en ce qui concerne l’absence de voies de recours effectives qui auraient pu permettre aux requérants de se plaindre de leurs conditions de détention au centre de rétention de Kumkapı. Compte tenu de cette constatation, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des requérants sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 3 concernant les conditions de leur détention au centre de rétention de Gaziantep.
Article 5 §§ 1 et 4 (légalité de la détention et mécanisme de contrôle juridictionnel)
Il n’est pas contesté que les enfants requérants ont été privés de leur liberté du 18 octobre 2014 au 10 février 2015. La seule ordonnance de placement en détention à leur égard n’a toutefois été délivrée que le 23 janvier 2015, après leur transfert d’Istanbul à Gaziantep. Les autres ordonnances de placement en détention ne concernaient que leur mère et ne mentionnaient aucun d’entre eux. La Cour conclut donc que les enfants requérants n’ont pas été détenus conformément à la procédure prescrite par la loi n o 6458, tout au moins entre le 18 octobre 2014 et le 23 janvier 2015, ce qui a emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle juge également arbitraire la détention des requérants du 5 au 10 février 2015, alors que leur libération avait déjà été ordonnée. Le Gouvernement n’ayant fourni aucune explication justifiant ce retard, elle conclut à une autre violation de l’article 5 § 1. La Cour a ensuite examiné le mécanisme judiciaire ouvert aux requérants pour faire contrôler la légalité de leur détention. Elle rappelle que pareille procédure de contrôle juridictionnel était particulièrement urgente dans le cas des requérants, une mère et ses trois très jeunes enfants. Les requérants ont pu contester leur détention devant des juges de paix à six reprises et introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Ils ont finalement obtenu leur libération. Les enfants requérants ont toutefois été laissés dans une incertitude juridique pendant trois mois puisque, dans sa première décision, le juge de paix d’Istanbul n’a pas statué sur la légalité de leur détention et que, dans ses décisions ultérieures, il n’a examiné que la légalité de la détention de leur mère. En outre, les décisions concernant la mère n’ont en aucune manière consisté en un réexamen puisqu’elles se sont bornées à déclarer à plusieurs reprises sa détention régulière en utilisant la même formule brève, sans prendre en considération les arguments de l’intéressée. En pareilles circonstances, c’est-à-dire en l’absence de réexamen, ou tout au moins de réexamen suivi d’effet, il incombait à la Cour constitutionnelle de procéder très rapidement à un contrôle. La Cour observe toutefois que les requérants sont restés en rétention une cinquantaine de jours après avoir introduit leur recours devant la Cour constitutionnelle, période au cours de laquelle cette juridiction n’a pris aucune mesure quant aux griefs que les intéressés avaient formulés. Eu égard à la vigilance particulière qui était requise à raison de la situation spécifique des requérants, la Cour conclut que tant le juge de paix d’Istanbul que la Cour constitutionnelle ont manqué à leur obligation de procéder à un contrôle rapide et efficace de la légalité de la détention des requérants, ce qui a emporté violation de l’article 5 § 4. Même si le mécanisme de contrôle établi par la loi n o 6458 s’est révélé ineffectif en l’espèce, la Cour estime que cela ne devrait pas faire douter de l’effectivité générale du mécanisme de contrôle juridictionnel prévu par cette loi, ni de la procédure de recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
Z.A. et autres c. Russie du 28 avril 2017 requêtes nos 61411/15, 61420/15, 61427/15 et 3028/16
Violation de l'article 5 et 3 de la Convention : La rétention de demandeurs d’asile dans la zone de transit aéroportuaire de Moscou était irrégulière, inhumaine et dégradante
Article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)
Considérant tout d’abord qu’eu égard à leur rétention dans la zone internationale de l’aéroport de Sheremetyevo les requérants relevaient du droit russe, la Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel ils n’étaient pas sur le territoire russe. De plus, les intéressés, qui se trouvaient dans la situation de demandeurs d’asile dont les dossiers n’avaient pas encore été examinés, n’avaient pas choisi de rester dans la zone de transit puisqu’ils ne pouvaient entrer ni sur le territoire russe ni dans aucun État autre que celui qu’ils venaient de quitter. Ils n’ont donc pas consenti valablement à leur privation de liberté. En conséquence, la Cour conclut que leur rétention dans la zone de transit s’analyse en une privation de liberté de facto. De plus, le Gouvernement n’a évoqué aucune disposition juridique qui régirait cette privation de liberté, hormis un traité international sur l’aviation civile (le chapitre 5 de l’annexe 9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale). Or ce traité ne comporte aucune règle sur la rétention de passagers dont les titres de voyage présentent des irrégularités, ce qui signifie que l’on a laissé aux États contractants le soin de régler cette question dans le droit interne. Le Gouvernement ne s’étant référé à aucune disposition du droit russe susceptible de justifier la privation de liberté des requérants, la Cour estime que leur longue rétention dans la zone de transit n’avait aucune base légale en droit interne, et qu’il y a dès lors eu violation de l’article 5 § 1.
Article 3 (conditions de détention)
Le Gouvernement n’ayant pas apporté de preuve contraire, la Cour juge établi que les requérants n’ont pas eu accès à des aménagements de base tels que lits, douches ou équipements de cuisine dans la zone de transit. Elle estime inacceptable que quiconque puisse être détenu dans des conditions dans lesquelles il n’est nullement tenu compte de besoins aussi essentiels. Les conditions endurées par les requérants pendant de longues périodes ont donc dû leur causer une grande souffrance psychique, porter atteinte à leur dignité et leur inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. La Cour considère qu’un tel traitement a été inhumain et dégradant, et qu’il y a eu violation de l’article 3.
Sakir C. Grèce du 24 mars 2015 requête 48475/09
Violation de l'article 3 de la Convention : un étranger sans papier subit une attaque à caractère raciste. Blessé, il est emmené au commissariat de police. Au lieu d'être envoyé à l'hôpital, il est jeté en prison en sa qualité de migrant clandestin. Il y a violation sur ses conditions de détention et violation pour défaut d'enquête sur les conditions de son agression.
a) Sur les conditions matérielles de détention
i. Rappel des principes généraux
50. En ce qui concerne les principes généraux concernant l’application de l’article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 90-94, CEDH 2000-XI ; Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 67-68, CEDH 2001‑III ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI ; Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 97, 24 janvier 2008 ; Tabesh, précité, §§ 34-37 ; Rahimi, précité, §§ 59‑62 ; R.U. c. Grèce, précité, §§ 54-56 ; A.F. c. Grèce, précité, §§ 68‑70 ; De los Santos et de la Cruz, précité, § 43).
51. Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 3 ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier. Néanmoins, cet article impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła, précité, § 94).
52. La Cour rappelle aussi que les autorités nationales doivent s’assurer que les diagnostics et les soins dans les prisons, y compris les hôpitaux des prisons, interviennent rapidement et soient appropriés. Elles doivent aussi s’assurer que lorsqu’il est rendu nécessaire par l’état de santé du détenu, le suivi intervienne à des intervalles réguliers et inclut une stratégie thérapeutique complète tendant à obtenir le rétablissement du détenu ou, du moins, éviter que son état ne s’aggrave (Pitalev c. Russie, no 34393/03, § 54, 30 juillet 2009). Tout en étant consciente des exigences pratiques de la détention, la Cour se reconnait suffisamment de flexibilité pour décider, au cas par cas, si les carences dans les soins médicaux ont été compatibles avec la dignité humaine du détenu (Aleksanyan c. Russie, no 46468/06, § 140, 22 décembre 2008). Ces soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c’est-à-dire d’un niveau comparable à celui que les autorités de l’Etat se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population (Cara‑Damiani c. Italie, no 2447/05, § 66, 7 février 2012).
53. Enfin, la Cour réitère que les informations concernant les conditions de détention, y compris les questions de soins médicaux, sont plus facilement accessibles aux autorités nationales qu’aux personnes intéressées. En effet, les requérants peuvent rencontrer des difficultés à produire des éléments de preuve de nature à étayer leurs griefs à cet égard. Ce qui est attendu des requérants en général dans ces cas est de soumettre au moins un compte rendu détaillé des faits dont ils se plaignent. Il incombera alors au Gouvernement de fournir des explications et des documents à l’appui de celles-ci (voir Salakhov et Islyamova c. Ukraine, no 28005/08, § 132, 14 mars 2013).
ii. Application au cas d’espèce
54. La Cour note que, lors de sa visite au commissariat d’Aghios Panteleïmon, le 10 septembre 2009, où se trouvait alors détenu le requérant, le médiateur de la République a fait un constat de surpeuplement. En particulier, il a relevé que l’espace de la détention avait une capacité totale de douze personnes et qu’à la date de la visite il y en avait vingt-et-un. Le médiateur a également souligné le manque d’aération, l’insuffisance de l’éclairage, le manque de propreté et l’impossibilité pour les détenus de sortir dans une cour. Il a en outre noté que, en dépit du transfert relativement récent du commissariat dans ce bâtiment (sept ans auparavant), celui-ci présentait des signes manifestes d’usure.
55. De même, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, en visite en Grèce du 10 au 20 octobre 2010, soit un an après la détention du requérant, a constaté, s’agissant des conditions de détention dans les commissariats de police qu’il avait visités (parmi eux, celui d’Aghios Panteleïmon), que ces commissariats semblaient servir de lieux de détention d’immigrés irréguliers pour des périodes pouvant aller jusqu’à six mois. Le Rapporteur a notamment indiqué que les détenus devaient obtenir l’autorisation des policiers pour utiliser les toilettes, qu’ils ne pouvaient pas se doucher, qu’ils étaient obligés de dormir pour des périodes de deux semaines sur des bancs ou par terre et que, au commissariat d’Aghios Panteleïmon, les cellules étaient sombres et étouffantes (voir, aussi, Ahmade c. Grèce, no 50520/09, § 99, 25 septembre 2012).
56. En outre, en ce qui concerne la situation spécifique du requérant, la Cour note que suite à l’attaque subie le 27 août 2009, il a été transféré à l’hôpital « Evangelismos » où il est resté quatre jours. À sa sortie, il a été directement mis en détention dans le commissariat d’Aghios Panteleïmon faute de posséder un titre de séjour en Grèce. La Cour rappelle que l’article 3 n’établit pas une obligation générale de libérer un détenu pour des motifs de santé (voir paragraphe 51 ci-dessus). Il s’ensuit donc a fortiori que la mise en détention d’une personne ayant des problèmes de santé ne contredit pas en soi la disposition précitée. Il n’en reste pas moins que les autorités doivent assurer à la personne concernée des conditions de détention compatibles avec son état de santé et le respect de la dignité humaine. En l’espèce, les autorités policières n’ont pas cherché au préalable à savoir auprès des autorités de l’hôpital « Evangelismos » si l’état de santé du requérant permettait sa mise en détention juste après sa sortie de l’hôpital.
57. De surcroît, certaines carences peuvent être constatées quant à la prise suffisante en compte par les autorités policières de la situation médicale du requérant et de son état de vulnérabilité pendant sa détention dans le commissariat d’Aghios Panteleïmon. Ainsi, le requérant soutient, sans qu’il soit contredit par le Gouvernement, que lors de sa mise en détention, il portait toujours les mêmes vêtements tachés de sang et que les autorités policières ne lui ont pas offert des habits propres pendant sa détention. À cela, s’ajoute l’impossibilité pour le requérant de prendre une douche et de soigner ses blessures tout au long de sa détention. La Cour note sur ce point que malgré les instructions spécifiques contenues dans le certificat médical daté du 31 août 2009 par l’hôpital « Evangelismos », à savoir que le requérant devait y être amené les 1er et 8 septembre 2009 pour être soumis à des nouveaux examens, celui-ci n’y fut transféré que le 9 septembre 2009, c’est-à-dire un jour avant sa remise en liberté. Le Gouvernement ne fournit pas d’explications à cet égard.
58. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités compétentes n’ont pas garanti au requérant des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention ni assuré sa santé et son bien-être de manière adéquate. Partant, il y a eu violation de la disposition précitée.
59. Enfin, étant donné ses considérations ci-dessus quant à la question de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour conclut que l’État a également manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention (voir Ahmade, précité, § 104).
b) Sur l’effectivité de la procédure suivie concernant l’agression du requérant
i. Rappel des principes généraux
60. La Cour rappelle d’emblée que des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. Cette appréciation est relative : elle dépend de l’ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime (voir Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001‑VII). En l’espèce, la Cour estime que les sévices subis par le requérant lors de son agression le 27 août 2009 dans la rue sont suffisamment graves pour s’analyser en un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la Convention.
61. Combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre, sous certaines conditions, des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers (voir M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003‑XII ; C.A.S. et C.S. c. Roumanie, no 26692/05, § 68, 20 mars 2012). L’article 3 de la Convention peut aussi faire naître dans le chef des autorités une obligation positive de mener une enquête officielle. Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’État (voir M.C. c. Bulgarie, précité, § 151 ; Šečić c. Croatie, no 40116/02, § 53, 31 mai 2007).
62. S’agissant de la situation d’un individu qui se plaint de mauvais traitements infligés par des particuliers, comme en l’espèce, et non pas par des fonctionnaires de l’État défendeur lui-même, la Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence, notamment dans les affaires Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie (no 71156/01, §§ 96-97, 3 mai 2007), Šečić, (précité, § 52), Denis Vasilyev c. Russie (no 32704/04, §§ 98-99, 17 décembre 2009), T.M. et C.M. c. République de Moldova (no 26608/11, §§ 35-39, 28 janvier 2014), et İbrahim Demirtaş c. Turquie (no 25018/10, §§ 25-29, 28 octobre 2014).
63. La Cour relève en particulier que les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir, entre autres, Krastanov, c. Bulgarie, no 50222/99, § 48, 30 septembre 2004 ; Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, §§ 28-29, 17 juillet 2008 ; Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, §§ 79 et 81, 24 juillet 2008). Cet aspect de l’obligation positive ne requiert pas nécessairement une condamnation mais l’application effective des lois, notamment pénales, pour assurer la protection des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Beganović c. Croatie, no 46423/06, §§ 69 et suivants, CEDH 2009 (extraits), et Ebcin c. Turquie, no 19506/05, § 39, 1er février 2011 et les références qui y figurent). De plus, les autorités doivent avoir pris toutes les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits litigieux (Šečić, précité, § 54).
64. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est aussi implicite dans l’obligation d’enquêter (voir, mutatis mutandis, McKerr c. Royaume‑Uni, no 28883/95, §§ 113-114 ; Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 223-224, CEDH 2004‑III). Les mécanismes de protection prévus en droit interne doivent fonctionner en pratique dans des délais raisonnables permettant de conclure l’examen au fond des affaires concrètes qui leur sont soumises (voir, mutatis mutandis, G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, §§ 96-102, 1er décembre 2009, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, §§ 150-151, CEDH 2009). En effet, l’obligation de l’État au regard de l’article 3 de la Convention ne peut être réputée satisfaite si les mécanismes de protection prévus en droit interne n’existent qu’en théorie : il faut surtout qu’ils fonctionnent effectivement en pratique, ce qui suppose un examen de l’affaire prompt et sans retard inutile (İbrahim Demirtaş, précité, § 30). Enfin, lorsque l’on soupçonne que des attitudes racistes sont à l’origine d’un acte de violence, il importe particulièrement que l’enquête officielle soit menée avec diligence et impartialité, eu égard à la nécessité de réaffirmer en permanence la condamnation, par la société, du racisme et de la haine ethnique et de préserver la confiance des minorités dans la capacité des autorités à les protéger de la menace de violences racistes (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005‑VII ; Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003‑V).
ii. Application au cas d’espèce
65. La Cour a des doutes quant à l’existence d’une enquête approfondie et effective dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les auteurs de l’agression du requérant. Elle relève tout d’abord des déficiences quant à l’obtention des preuves. En premier lieu, aucune déposition n’a été recueillie du requérant lui-même sur les circonstances de son agression et sur l’identité des auteurs de cet acte. Il est à noter que les autorités compétentes disposaient de tout le temps nécessaire pour procéder à l’audition du requérant, puisqu’après son hospitalisation celui-ci est resté en détention au commissariat d’Aghios Panteleïmon pour une période de dix jours environ. Les autorités policières ne l’ont pas même invité à identifier A.P. et T.P., initialement dénoncés par A.S. comme faisant partie du groupe d’agresseurs. Aucune procédure d’identification d’autres personnes ayant un historique d’appartenance à des groupes d’extrémistes s’étant déjà livrés à des violences racistes au centre d’Athènes n’a non plus eu lieu.
66. En deuxième lieu, il n’est pas contesté par les parties que les blessures du requérant étaient le résultat d’une agression physique ; comme il était mentionné dans les deux certificats médicaux délivrés par l’hôpital « Evangelismos », les lésions avaient été effectuées par un objet tranchant et pointu. Or, ni les autorités policières ni le procureur n’ont cherché à établir en détail la nature et la cause des lésions infligées au requérant en commandant, par exemple, une expertise médico-légale dont les conclusions auraient pu élucider des aspects techniques de l’agression et contribuer à l’identification des auteurs.
67. En outre, des manquements sont constatés quant à l’audition des témoins par les autorités policières. Il ressort ainsi du dossier que la police n’a entendu comme témoins que le policier P.P., présent lors de incident en cause, et A.S., la personne qui avait averti la police de l’agression du requérant. Or, il ressort du témoignage de P.P. qu’il y avait au moins un autre témoin oculaire, A.K., qui n’a jamais été cité à comparaître devant les autorités compétentes. En particulier, P.P. avait affirmé dans son témoignage qu’A.K. lui avait confirmé l’attaque lancée sur un groupe d’étrangers par quinze à vingt personnes vêtues de noir et casquées. Or, malgré sa qualité de témoin oculaire, A.K. n’a jamais été convoqué par la police pour donner sa déposition.
68. De plus, la manière dont s’est déroulée l’audition d’A.S. ne peut que soulever des questions quant à l’effectivité de l’enquête policière. La Cour note qu’A.S. ne possédait pas de titre de séjour lorsqu’il a déposé en tant que témoin oculaire sur l’incident en cause. Se trouvant en même temps en situation irrégulière aux mains de la police, il était sans doute dans un état de vulnérabilité. La police devait donc lui réserver des conditions d’audition pouvant garantir la fiabilité et l’exactitude des informations fournies sur l’agression du requérant. Or, tandis qu’A.S. avait explicitement désigné dans sa déposition initiale, faite vers 21 heures, A.P. et T.P. comme auteurs principaux de l’agression, il est revenu sur celle-ci vers 3 heures du matin. Par la suite, vers 4h20 des poursuites pénales ont été engagées contre lui, entre autres pour parjure, fausse déclaration devant les autorités publiques et diffamation. Néanmoins, il ne ressort pas du dossier que les autorités policières aient questionné A.S. sur cette volte-face qui, de plus, a entraîné par la suite l’engagement d’une procédure pénale contre lui des chefs d’accusation précités.
69. Suite à l’engagement de la procédure pénale contre A.S. pour parjure, diffamation et fausse déclaration devant une autorité publique, le dossier de l’affaire a été transmis au procureur. Celui-ci n’a cependant pas institué de poursuites pénales pour les deux premiers chefs d’accusation. Quant à la dernière, A.S. fut acquitté par le tribunal correctionnel le 1er septembre 2015. Néanmoins, bien que les accusations contre A.S. se soient avérées infondées, aucune initiative n’a été ensuite prise par les autorités judiciaires compétentes afin d’élucider la question de la véracité du témoignage initial d’A.S. Ainsi, il ne ressort pas du dossier qu’elles aient convoqué A.P. et T.P. afin d’examiner à nouveau leur rôle dans l’incident litigieux, éventuellement en les confrontant avec A.S.
70. En dernier lieu, la Cour considère que le contexte général dans lequel s’inscrit la présente affaire revêt une importance particulière. En particulier, il n’est pas contesté par les parties que le requérant, ressortissant étranger, a été victime d’une agression effectuée par un groupe de personnes armées dans le centre d’Athènes, à savoir dans le quartier d’Aghios Panteleïmon. Sur ce point, des rapports provenant de plusieurs organisations non gouvernementales internationales, telles que Human Rights Watch et Amnesty International ainsi que des instances nationales, telles que le médiateur de la République et le Réseau d’enregistrement d’agressions à caractère raciste, ont mis l’accent sur le phénomène de violence à caractère raciste au centre d’Athènes. Les conclusions de ces rapports convergent sur deux points principaux : d’une part, ils soulignent la nette augmentation d’incidents violents à caractère raciste au centre d’Athènes depuis 2009, à savoir l’année durant laquelle les faits litigieux se sont produits. Ils relèvent l’existence d’un schéma récurrent d’assauts contre des étrangers, perpétués par des groupes d’extrémistes, entretenant souvent des liens avec le parti politique « néo-fasciste » l’Aube dorée. De plus, il est noté que la plupart de ces incidents ont eu lieu dans des quartiers spécifiques, notamment celui d’Aghios Panteleïmon et de la place d’Attiki. Ainsi, le médiateur de la République a relevé dans son rapport spécial de 2013 sur les assauts à caractère raciste au centre d’Athènes que trois sur quatre de ces incidents avaient eu lieu dans le quartier d’Aghios Panteleïmon.
71. D’autre part, ces rapports font état d’omissions sérieuses de la part de la police en ce qui concerne tant ses interventions au moment des agressions au centre d’Athènes que l’effectivité des enquêtes policières subséquentes. À ce titre, le rapport dressé par le médiateur de la République relate des incidents où les organes de la police, malgré leur présence sur le lieu du crime, ont omis d’intervenir, n’ont pas enregistré l’agression ou même ont arrêté la victime de l’agression au lieu de son auteur.
72. La Cour note que, bien que l’incident dans le cas présent ait eu lieu à Aghios Panteleïmon et que la nature de l’agression présentait les caractéristiques d’une attaque à caractère raciste, la police a complètement omis de placer cette affaire dans le contexte décrit par les rapports précités et l’a traitée comme un cas isolé. Il ne ressort pas ainsi du dossier qu’après le classement de l’affaire aux archives des auteurs d’infraction non identifiés, la police ou les instances judiciaires compétentes aient pris des initiatives pour repérer des liens éventuels entre les incidents violents à caractère raciste relatés dans les rapports précités et l’attaque subie par le requérant. Il n’en reste pas moins qu’une réponse adéquate des autorités compétentes, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement avec motif éventuellement raciste, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. En effet, la tolérance des autorités envers de tels actes ne peut que miner la confiance du public dans le principe de la légalité et son adhésion à l’État de droit (voir, mutatis mutandis, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV (extraits), Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres, précité, § 97).
73. Eu égard à l’ensemble des circonstances ci-dessus, la Cour conclut que les autorités compétentes n’ont pas traité la cause du requérant avec le niveau de diligence et d’efficacité requis par l’article 3 de la Convention. En conséquence, la Cour conclut à la violation de cette disposition sous son volet procédural.
TABESH C. GRECE DU 26 NOVEMBRE 2009 REQUÊTE 8256/07
UNE DÉTENTION DE TROIS MOIS DANS LES LOCAUX DU COMMISSARIAT DE POLICE NON ÉQUIPÉ POUR UNE DÉTENTION SI LONGUE
36. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudla, précité, §§ 92-94, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006-...).
37. Si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III), ce droit doit s'exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu'elle est amenée à contrôler les modalités d'exécution de la mesure de détention à l'aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008-...
41. Mis à part les problèmes de promiscuité et d'hygiène, tels qu'ils sont relevés par les rapports précités, la Cour estime que le régime afférent à la possibilité de loisirs et à la restauration dans les locaux de police où le requérant a été détenu pose en soi problème par rapport à l'article 3 de la Convention. En particulier, l'impossibilité même de se promener ou de pratiquer une activité en plein air pourrait faire naître chez le requérant des sentiments d'isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur son bien-être physique et moral.
43. En général, la Cour considère que les insuffisances quant aux activités récréatives et à la restauration appropriée du requérant résultent du fait que les locaux de police de Thessalonique n'étaient pas des lieux appropriés pour la détention que le requérant a dû y subir. De par leur nature même, il s'agit de lieux destinés à accueillir des personnes pour de très courtes durées. Par conséquent, ils n'étaient en rien adaptés aux besoins d'une détention de trois mois et imposée, de plus, à une personne qui ne purgeait pas une peine pénale mais se trouvait en attente de l'application d'une mesure administrative (voir en ce sens, Riad et Idiab c. Belgique, précité, § 104, CEDH 2008-... (extraits), et Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).
44. En somme, la Cour estime que le fait de maintenir le requérant en détention pendant trois mois dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique s'analyse en un traitement dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention. Au vu de cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur les conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Kordelio, où le requérant a séjourné les sept premiers jours de sa détention.
Arrêt Ibram C. Grèce du 25 octobre 2011 requête 39606/09
Un détenu soumis à des conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les locaux d'un commissariat de police durant plus de 4 mois.
La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation et que l’Etat a une obligation de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excessive et que sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate.
La Cour note que les conditions de détention dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique ont déjà fait l’objet d’arrêts dans lesquels la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention.
Elle relève que la véracité des allégations de M. Ibram quant aux conditions de sa détention n’a pas été contestée. Elle rappelle que ces allégations étaient d’ailleurs corroborées par les rapports du médiateur de la République hellénique qui auparavant, en mai 2007, avait effectué une visite à la Direction générale de police de Thessalonique pour le transfert des détenus, afin d’examiner, entre autres, les conditions de détention.
La Cour relève que M. Ibram a séjourné plus de quatre mois dans un lieu destiné à accueillir des prévenus pour une courte durée et qui n’était pas adapté aux besoins d’une incarcération prolongée. Lors des deux premiers mois de sa détention, s’ajoutait également le problème de restauration. Si le système de restauration des détenus s’est amélioré peu après l’arrivée de M. Ibram, il n’en demeure pas moins que le reste des problèmes a persisté, à savoir l’insalubrité des espaces de détention, l’absence d’un espace pour se promener et le manque de tout moyen de distraction.
La Cour estime que les conditions de détention de M. Ibram dans lesdits locaux, combinées à la durée de sa détention de quatre mois et cinq jours, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.
MD c. GRÈCE du 13 novembre 2014 requête 60622/11
41. Le Gouvernement reproche au requérant, dans la présentation de son grief, d’employer des formulations générales et de ne pas citer d’éléments concrets pour décrire les conditions de détention qu’il dit avoir subies dans le dortoir et pour la période en cause. Le Gouvernement estime que la référence à des rapports rédigés d’après lui longtemps avant les faits, tel le rapport du médiateur de la République, et à des arrêts de la Cour ayant trait selon lui à d’autres circonstances ne permet pas d’individualiser le cas de l’intéressé et ne suffit pas à démontrer la véracité de ses allégations. Il présente sa version concernant les conditions de détention dans les locaux de la police des étrangers de Thessalonique (paragraphes 21-23 ci-dessus).
42. Le requérant réitère sa version des conditions de détention.
43. En ce qui concerne les principes généraux régnant l’application de l’article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 90-94, CEDH 2000-XI ; Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 67-68, CEDH 2001‑III ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI ; Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 97, 24 janvier 2008 ; Tabesh, précité, §§ 34-37 ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, §§ 59-62, 5 avril 2011 ; R.U. c. Grèce, no 2237/08, §§ 54-56, 7 juin 2011 ; A.F. c. Grèce, précité, §§ 68-70 ; de los Santos et de la Cruz c. Grèce, nos 2134/12 et 2161/12, § 43, 26 juin 2014).
44. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été détenu du 4 janvier au 15 mars 2011, soit soixante et onze jours, dans des conditions de grande promiscuité, sans aucune possibilité de se promener et avec peu de ressources pour s’alimenter (voir Tabesh, précité, et le paragraphe 28 du présent arrêt).
45. Dès lors, aux yeux de la Cour, rien ne permet d’aboutir à une conclusion différente, dans la présente cause, de celle à laquelle elle est parvenue dans les affaires précitées. Ces éléments suffisent donc à la Cour pour conclure que la détention du requérant dans les locaux de la police des étrangers de Thessalonique s’analyse en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention et qu’il y a donc eu en l’espèce violation de cette disposition.
RAHIMI c. GRECE du 5 AVRIL 2011 REQUÊTE N° 8687/08
Incarcérer un mineur avec des adultes est un acte inhumain et dégradant
Principaux faits
Le requérant, Eivas Rahimi, est un ressortissant afghan, né en 1992 et résidant actuellement à Athènes. Suite au décès de ses parents lors des conflits armés en Afghanistan, il quitta ce pays et arriva sur le territoire grec par l’île de Lesbos. Il y fut arrêté le 19 juillet 2007 et placé au centre de rétention de Pagani, dans l’attente de la décision d’expulsion à son encontre.
La version des faits diffère entre les parties. Les autorités soutiennent que Eivas a été informé, par une note en langue arabe, de son droit de saisir le chef hiérarchique de la police de ses griefs éventuels ainsi que le président du tribunal administratif concernant sa mise en détention. Le requérant allègue qu’il n’a reçu aucune information sur la possibilité de demander l’asile politique et que l’absence de traducteur certifié a entravé sa communication avec les autorités, puisque le compatriote qui faisait office d’interprète n’était tenu par aucune obligation de confidentialité. Selon Eivas, il n’a pas été informé dans une langue compréhensible de ses droits et du régime juridique auquel il était soumis.
Le requérant fut détenu jusqu’au 21 juillet 2007 au centre de Pagani où il allègue avoir été détenu avec des adultes, dormi sur un matelas insalubre, pris ses repas à même le sol et avoir été privé de contacts extérieurs – il n’a pu rencontrer qu’un représentant de l’organisation non gouvernementale (ONG) allemande « Pro Asyl » se trouvant en mission sur l’île de Lesbos). Selon le gouvernement grec, Eivas a été détenu dans une cellule spécialement aménagée pour des mineurs et ne s’est jamais plaint auprès des autorités locales des conditions de sa détention.
L’expulsion du requérant fut décidée par une ordonnance du 20 juillet, qui mentionnait que N.M., le cousin de Eivas, né en 1987, l’accompagnait. La phrase « il accompagne son cousin mineur (...) » apparaissait comme un texte standard. Le requérant allègue qu’il n’a jamais connu N.M. et qu’il n’a jamais déclaré le contraire aux autorités. Selon le gouvernement grec, le requérant ne s’est jamais plaint du fait que la personne qui l’accompagnait n’était pas son cousin et qu’il ne souhaitait pas partir avec lui.
Après sa remise en liberté, aucun hébergement ou moyen de transport n’a été proposé, à Eivas qui n’aurait reçu d’assistance que de la part de « Prosfygi », une ONG secourant les migrants. Sans abris pendant plusieurs jours à son arrivée à Athènes, Eivas fut ensuite hébergé par l’ONG « Arsis », dans un centre à Athènes où il se trouve toujours. Selon une attestation de 2009 de cet organisme, le requérant serait arrivé à Athènes seul avec d’autres mineurs non accompagnés et présentait des difficultés à s’intégrer, à dormir dans l’obscurité et à parler ainsi qu’un fort amaigrissement. Selon l’attestation, aucun tuteur n’avait été désigné bien que le parquet des mineurs eût été informé de la situation. L’attestation mentionne encore que Eivas aurait fui l’Afghanistan par crainte d’être contraint de s’enrôler dans l’armée des Talibans.
Le procès verbal établi lors de l’enregistrement de sa demande d’asile politique le 27 juillet 2007 ne fait pas état de membres de la famille du requérant l’accompagnant. Il mentionne par ailleurs que l’entretien avec les autorités a eu lieu en langue farsi. En septembre 2007, la demande d’asile politique du requérant fut rejetée et son recours à cet égard est toujours pendant.
Sur la question de savoir si le requérant était accompagné
Dans son appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », et compare les éléments fournis par les autorités et ceux provenant d’autres sources fiables. Elle adopterait en effet une approche trop étroite dans les affaires d’expulsion ou d’extradition si elle se limitait aux éléments fournis par les autorités.
La question de savoir si Eivas était accompagné, sur laquelle les parties sont en désaccord, détermine quelles étaient les obligations de l’Etat à son égard. Se basant sur l’enregistrement de sa demande d’asile politique et sur le rapport d’ « Arsis », la Cour considère que depuis le 27 juillet 2007 le requérant n’est pas accompagné d’un proche.
Concernant la période du 19 au 27 juillet 2007, les allégations du requérant sur la situation des mineurs migrants, en particulier sur l’île de Lesbos, sont corroborées par plusieurs rapports qui relèvent notamment la persistance de graves lacunes en matière de tutelle des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés2 , des problèmes de statistiques et de mineurs non accompagnés enregistrés par les autorités de Lesbos comme accompagnés3 et l’attribution arbitraire de mineurs à des adultes afghans avec les mentions « frère » ou « cousin »).
Aucune information sur le lien de parenté entre le requérant et N.M. ne ressort des documents officiels. La Cour accorde une importance particulière au fait que la mention « il accompagne son cousin mineur » apparaît comme un texte standard sur l’ordonnance d’expulsion. De plus, les autorités se seraient fondées uniquement sur les déclarations du requérant alors que, ne parlant pas anglais, il communiquait avec les autorités avec un compatriote. Ainsi le lien de parenté entre N.M. et le requérant a été établi par les autorités compétentes au travers d’une procédure aléatoire et sans garantie qu’il était de fait un mineur accompagné, ce qui avait des conséquences importantes puisque l’adulte désigné était censé assumer les fonctions de tuteur. La Cour note que le gouvernement grec n’a fourni aucune information concernant N.M. après sa remise en liberté.
Enfin, la conclusion de la Cour concernant la période du 27 juillet jusqu’à ce jour, établissant l’absence de tuteur pour une longue période, ne fait que conforter la version de la Cour pour la période antérieure au 27 juillet 2007. Ainsi, la Cour estime que la thèse du Gouvernement, à savoir que le requérant était un mineur accompagné, n’est pas établie pour la période allant du 19 au 27 juillet 2007.
Sur la question de l’épuisement des voies de recours
La brochure d’information fournie au requérant n’indiquait pas la procédure à suivre concernant la saisine du chef hiérarchique de la police évoquée par le Gouvernement, qui n’a pas non plus précisé si le chef de la police était tenu de répondre à une plainte et, dans l’affirmative, dans quel délai. La Cour rappelle qu’en 2008 le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fait état de l’inexistence en Grèce d’une véritable autorité indépendante chargée d’inspecter les locaux de détention des forces de l’ordre. Par ailleurs, la Cour se pose également la question de savoir si le chef de la police représente une autorité qui remplit les conditions d’impartialité et d’objectivité nécessaires à l’efficacité du recours. Concernant la loi numéro 3386/2005 à laquelle le Gouvernement se réfère, la Cour note que les tribunaux ne sont pas habilités à examiner les conditions de vie dans les centres de détention pour étrangers clandestins et à ordonner la libération d’un détenu sous cet angle. Enfin, la Cour ne peut considérer que la brochure d’information rédigée en arabe, faisant référence à des recours disponibles, était compréhensible du requérant dont la langue est le farsi. Ainsi, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Sur les conditions de détention au sein du centre de rétention de Pagani
La Cour ne peut pas se prononcer avec certitude sur la question de savoir si le requérant a été placé en détention avec des adultes, mais les allégations de ce dernier sur l’état général du centre de Pagani sont corroborées par plusieurs rapports concordants de l’Ombudsman grec, du CPT5 – qui qualifie le centre d’ «insalubre au delà de toute description» et constituant un «danger pour la santé des détenus et du personnel» –, ainsi que de plusieurs organisations internationales et d’ONG grecques. Un problème de surpopulation carcérale a en effet mis en évidence, ainsi qu’une situation sanitaire déplorable : détenus dormant à même le sol, une latrine et une douche pour 150 personnes en période de surpeuplement, inondation partielle des sols due à l’engorgement des toilettes... La Cour accorde également une importance particulière aux incidents violents (émeutes, grève de la faim) qui ont eu lieu au sein du centre en 2009, en raison des piètres conditions de détention. Le centre de Pagani aurait été fermé en 2009.
Au vu de la non-prise en compte de la situation particulière d’extrême vulnérabilité du requérant et des conditions de détention dans le centre de Pagani, si graves qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine, la Cour dit que Eivas a subi un traitement dégradant, même si sa détention a duré deux jours.
Arrêt MAHMUNDI et autres c. GRÈCE du 31 juillet 2012 requête 14902/10
En Grèce, les centres de rétention des étrangers pour entasser hommes, femmes et enfants, ne sont pas des palaces !
59. Le Gouvernement soutient que dans la présente affaire, en raison d’un flux continu de migrants clandestins, des conditions de surpopulation se sont créées dans le centre de Pagani. Parmi les requérants, quatre sont restés dans ce centre pendant vingt jours. La deuxième requérante y a séjourné quinze jours, et cinq jours à l’hôpital de Lesbos. Pendant leur séjour, ils recevaient une alimentation et des soins médicaux et pharmaceutiques suffisants. Compte tenu de cet élément et de la durée de leur détention, on ne saurait affirmer que le seuil de gravité exigé par l’article 3 pour qu’un traitement soit considéré comme inhumain ou dégradant a été dépassé.
60. Les requérants soulignent que la version du Gouvernement concernant les conditions de vie à Pagani, telles qu’exposées aux paragraphes 33 et suivants ci-dessus, est en contradiction totale avec les constats et les critiques exprimés par le CPT et les différentes organisations non-gouvernementales qui ont établi des rapports à cet égard. Ils fournissent à l’appui de leurs allégations plusieurs photos de l’intérieur du centre et des vidéos prises pendant leur détention.
61. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003‑II). La Cour a ainsi jugé un traitement «inhumain» au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI).
62. La Cour observe que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur impose de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir, mutatis mutandis, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V, et A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 22, Recueil 1998-VI). Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3. Cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne, précité, §§ 92-94 ; Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006‑IX).
63. Si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996‑III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, CEDH 2005-XIII). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008).
64. En l’espèce, la Cour renvoie aux circonstances de fait (paragraphes 14-32 ci-dessus) pour plus de détails concernant les conditions dans lesquelles les requérants affirment avoir été hébergés pendant la durée de leur rétention. Outre la reconnaissance par le Gouvernement de la surpopulation créée dans le centre de Pagani en cette période là, les requérants ont fourni, à l’appui de leurs allégations photos et vidéos.
65. La Cour a encore à sa disposition dans la présente affaire divers rapports établis à des dates concomitantes aux faits de l’espèce qui démontrent que la situation au centre de Pagani ont au fil du temps empiré plutôt que s’améliorer comme semble le soutenir le Gouvernement.
66. Ainsi la Cour relève la situation décrite dans le rapport, publié en juin 2010, par Médecins sans frontières : en se référant à la période allant d’août à octobre 2009, soit précisément la période durant laquelle les requérants y furent détenus, le rapport constatait que le nombre de détenus dépassait 1 200, et était quatre fois supérieur à la capacité d’hébergement du centre et que l’engorgement des toilettes et des douches provoquait l’inondation partielle du sol sur lequel des matelas étaient empilés. Selon le rapport, les détenus, à l’exception des femmes et des enfants, n’étaient pas autorisés à sortir dans la cour extérieure du centre, et ce pendant des semaines. Le rapport affirmait que le centre de Pagani consistait en des entrepôts qui n’étaient pas à même de servir de lieux de détention pour des êtres humains.
67. Suite à sa visite en Grèce, du 17 au 29 septembre 2009, soit moins de trois semaines après que les requérants aient quitté Pagani, le CPT notait dans son rapport publié le 17 novembre 2010 que le centre était insalubre au-delà de toute description et que les conditions de détention pour certains, sinon pour l’ensemble des migrants en situation irrégulière présents, pourraient sans conteste être qualifiées d’inhumaines et dégradantes. Le CPT soulignait qu’en dépit du fait que dans son rapport de 2008 il avait qualifié les conditions de détention à Pagani d’ « abominables » et avait fait appel à la nécessité de prendre des mesures d’urgence, il constatait avec regret lors de sa visite en 2009 qu’aucune mesure n’avait été appliquée pour améliorer la situation.
68. Or, tous ces éléments suffisent amplement pour donner une idée exhaustive des conditions régnant à Pagani. La Cour note d’ailleurs que suite au tollé général suscité par les conditions de vie dans ce centre, les autorités grecques ont informé le CPT, par lettre datée du 26 février 2010, que le centre de Pagani avait été fermé et qu’il serait remplacé par un centre de rétention plus approprié.
69. Reste à examiner le laps de temps pendant lequel les requérants y ont séjourné. La Cour note que les requérants et le Gouvernement ne sont pas d’accord sur la date à laquelle ceux-ci furent mis en liberté : le 25 août selon le Gouvernement, le 27 août selon les requérants, qui soutiennent que l’ordre d’élargissement était antidaté.
70. La Cour constate que les durées de séjour diffèrent selon les requérants. Il y a d’abord un séjour d’une durée de dix-huit ou vingt jours pour les premier, troisième, quatrième et cinquième requérants. Même une durée de dix-huit jours, dans des conditions décrites aux paragraphes précédents, suffit à conclure que le seuil minimum de gravité exigé par l’article 3 pour qualifier le traitement d’inhumain et dégradant a été atteint. Il y a ensuite le séjour de la seconde requérante (qui a dû être hospitalisée pendant quelques jours en raison de son accouchement) qui a duré treize ou quinze jours. Compte tenu de la situation particulière de cette requérante, un séjour limité à treize jours suffit également à conclure que le seuil minimum de gravité exigé par l’article 3 pour qualifier le traitement d’inhumain et dégradant a été atteint. Selon le rapport de l’organisation Médecins sans frontières de 2010 rapportant la situation d’août à octobre 2009, plusieurs femmes enceintes, aux derniers mois de leur grossesse, étaient détenues dans des conditions inhumaines dans des cellules surpeuplées. Ce rapport constatait qu’en plus de la souffrance provoquée par l’impact émotionnel et psychologique de la détention, les femmes n’étaient pas examinées souvent par un médecin. Le fait de ne pas savoir où elles allaient accoucher et ce qui leur arriverait, à elles et à leurs enfants, augmentait leur anxiété (voir aussi paragraphe 50 ci-dessus).
71. La Cour constate que la souffrance du premier requérant et des seconde et quatrième requérantes était aggravée du fait de la présence dans le camp de leurs enfants mineurs.
72. S’agissant des deux enfants détenus séparément, la Cour rappelle le constat auquel elle est parvenue dans l’affaire Rahimi précitée en se fondant sur les rapports établis par de nombreuses organisations non-gouvernementales ainsi que par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT). En l’espèce, la Cour note que, d’après les requérants, les enfants de la quatrième requérante furent placés dans une pièce destinée aux mineurs, mais dans laquelle il y aurait eu néanmoins d’après les requérants aussi des adultes. Ces mineurs âgés respectivement de quatorze ans ne faisaient l’objet d’aucune attention et leur cellule contenait seulement quelques lits et matelas sales. Pendant la durée de leur détention, les enfants se sont promenés dans la cour trois fois en tout pour une durée allant de quinze à trente minutes. En outre, les conditions de détention des enfants des deux premières requérants, telles que ceux-ci les ont décrites, sont corroborées par les constats de différentes organisations non-gouvernementales concernant la situation des enfants dans le centre.
73. La Cour observe que les autorités n’étaient pas totalement ignorantes de la situation familiale des requérants, puisque des mesures ont été prises pour assurer une présence familiale aux deux enfants de la seconde requérante lorsque celle-ci a été hospitalisée en vue de son accouchement (paragraphe 21 ci-dessus).
74. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les conditions de détention auxquelles les requérants ont été soumis au sein du centre de Pagani équivalent à un traitement inhumain et dégradant. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
L'ASSIGNATION A RESIDENCE DOIT ÊTRE PREFEREE A LA RETENTION ADMINISTRATIVE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 29 FEVRIER 2012 N° Pourvoi 11-30085 REJET
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Lyon, 7 février 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et d’une décision de placement en rétention administrative, pris, le 19 janvier 2011, par le préfet du Puy de Dôme ; que, cette mesure ayant été prolongée une première fois le 21 janvier 2011, le préfet a sollicité une seconde prolongation de la rétention ; que, le 5 février 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Lyon fait grief à l’ordonnance d’infirmer cette décision et prononcer l’assignation à résidence de M. X..., alors, selon le moyen, que l’assignation à résidence n’est pas expressément prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas d’une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention
Mais attendu qu’aucune disposition n’interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d’assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé
LE JUGE JUDICIAIRE NE CONTRÔLE LA RETENTION ADMINISTRATIVE DES ETRANGERS QU'AU BOUT DE CINQ JOURS
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2012 N° Pourvoi 11-30548 Cassation sans renvoi
Vu la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 552 1 et R. 552 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité russe, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 23 août 2011 en exécution d’une décision prise par le préfet du Maine et Loire ; que, le lendemain, il a formé une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ; que, par décision du 25 août 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande
Attendu que, pour confirmer cette décision et ordonner la remise en liberté de M. X..., l’ordonnance retient qu’il se déduit de l’article R. 552 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention peut être saisi par l’étranger pour qu’il soit mis fin à sa rétention administrative avant de l’être par le préfet aux fins de prolongation de celle ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu’à l’issue du délai de cinq jours prévu par l’article L. 552 1 dudit code, le premier président a violé les textes susvisés
Vu l’article L. 411 3 du code de l’organisation judiciaire
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger
L'ETRANGER A DROIT A UN AVOCAT DES LE PREMIER JOUR DE SON ARRIVEE EN CENTRE DE RETENTION
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 15 mai 2013 N° Pourvoi 12-14566 Cassation sans renvoi
Vu l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n̊ 2011-672 du 16 juin 2011, et l’article R. 551-4 du même code
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité turque, qui faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellée le 20 décembre 2011 et placée en garde à vue pour vol et infraction à la législation sur les étrangers ; qu’elle a ensuite été placée en rétention administrative en exécution de la décision prise, le jour même, par le préfet de la Nièvre; qu’un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance retient que la décision du préfet mentionne que Mme&X... pourrait exercer ses droits à tout moment à compter de son arrivée au centre de rétention administrative et qu’il est constant qu’elle n’a pas été en mesure de le faire pendant la durée de son transfèrement
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 551-2, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, et de l’article R. 551-4 du même code que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention que l’étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix, le premier président a violé les textes susvisés
LE DELAI TOTAL DE RETENTION EST DE SEPT JOURS GARDE A VUE COMPRISE
SOIT 2 JOURS DE GARDE A VUE + 5 JOURS DE RETENTION AVANT L'ACCES AU JUGE JUDICIAIRE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 15 mai 2013 N° Pourvoi 12-16082 Cassation sans renvoi
Vu les articles L. 551-1, L. 552-1 et R. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2011-631 DC du 9 juin 2011 déclarant conforme à la Constitution les articles L. 551-1 et L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous la réserve du considérant 73, aux termes duquel ces articles ne sauraient permettre que l’étranger privé de sa liberté soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l’expiration d’un délai de sept jours à compter du début de la garde à vue
Attendu qu’il résulte des textes et de la décision susvisés que, pour demander au juge des libertés et de la détention la prolongation de la décision de placement en rétention de l’étranger, le préfet dispose d’un délai de cinq jours à compter de la décision de placement, lequel ne peut excéder sept jours en cas de placement en garde à vue;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en séjour irrégulier en France, a été placé en garde à vue le 19 janvier 2012 à 15H10; qu’à l’issue de cette mesure il a été mis en rétention administrative , le 20 janvier 2012, en exécution de la décision prise, le jour même, par le préfet de la Gironde; que, par requête reçue le 25 janvier 2012 à 13 heures 34, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
Attendu que, pour refuser de prolonger la rétention administrative, l’ordonnance retient qu’il se déduit de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011 que la durée de la garde à vue, qui peut être de 48 heures maximum, doit être incluse dans le délai de cinq jours accordé au préfet pour saisir le juge des libertés et de la détention et que la requête du préfet, présentée le 25 janvier 2012, à 13 heures 34, est tardive
Qu’en statuant ainsi le premier président a violé, par fausse application, les textes applicables tels qu’interprétés par la décision susvisée
DÉTENTION A PERPÉTUITÉ PRÉVUE PAR UN TRIBUNAL
Horion c. Belgique du 9 mai 2023 requête no 37928/20
Art 3 : Violation des droits d’un détenu en prison depuis 44 ans et ne disposant pas de perspective réaliste d’élargissement
L’affaire concerne un requérant – détenu depuis 1979 et condamné à une peine de réclusion à perpétuité en 1981 pour un quintuple meurtre aux fins de vol – qui se plaint de subir une peine d’emprisonnement à vie incompressible de facto. La Cour relève que, depuis janvier 2018, les experts psychiatres et les juridictions internes s’accordent pour estimer que la prolongation du séjour du requérant en prison n’est plus indiquée, tant au regard de la sûreté publique qu’aux fins de sa resocialisation et sa réintégration dans la société. Ils préconisent dès lors son admission dans une unité de psychiatrie légale comme étape intermédiaire avant une éventuelle mise en liberté. De ce fait, les juridictions internes refusent toute autre modalité d’exécution de la peine, telle la détention limitée ou la surveillance électronique, insistant sur le fait qu’une admission dans une unité de psychiatrie légale est une étape indispensable à la réinsertion du requérant dans la société. Or, selon ces mêmes juridictions, l’admission dans une unité de psychiatrie légale « semblait en pratique impossible pour des raisons de financement » dans la mesure où ces unités ne sont subventionnées par l’État que pour accueillir des personnes ayant le statut d’interné et non pas condamné comme le cas du requérant. Dans ces circonstances, la Cour juge que l’impasse dans laquelle se trouve le requérant depuis plusieurs années résultant de l’impossibilité pratique d’être placé dans une unité de psychiatrie légale, alors que sa détention en prison n’est plus indiquée selon les autorités internes, a pour conséquence qu’il n’a actuellement pas de perspective réaliste d’élargissement, ce qui est prohibé par l’article 3 de la Convention.
Art 3 (matériel) • Peine inhumaine et dégradante • Impossibilité pour le requérant, depuis janvier 2018, d’être placé dans une unité de psychiatrie légale, alors que sa détention en prison n’est plus indiquée par les autorités internes • Admission jugée par les juridictions internes être une étape indispensable à la réinsertion dans la société de ce détenu de très longue durée depuis 1979 et exigée pour le mettre en liberté • Unique admission des personnes « internées » et non de celles « condamnées » jugées pénalement responsable des faits commis • Absence de perspective réaliste d’élargissement
CEDH
a) Principes généraux applicables
60. Les principes généraux relatifs aux peines perpétuelles ont été exposés dans les arrêts Vinter et autres c. Royaume-Uni ([GC], nos 66069/09 et 2 autres, §§ 102, 104-118 et 122, CEDH 2013 (extraits)), et Murray c. Pays‑Bas ([GC], no 10511/10, §§ 99-104, 26 avril 2016). Dans la mesure où ils s’avèrent pertinents pour la présente affaire, ces principes peuvent être résumés comme suit.
61. Le prononcé d’une peine d’emprisonnement à vie contre un délinquant adulte ne peut demeurer compatible avec l’article 3 qu’à la condition d’offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen, les deux devant exister dès le prononcé de la peine (Murray, précité, § 99).
62. Le réexamen exigé pour qu’une peine perpétuelle puisse être réputée compressible doit permettre aux autorités nationales d’apprécier toute évolution du détenu et tout progrès sur la voie de l’amendement accompli par lui. La Cour a estimé que la dignité humaine, qui se trouve au cœur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté (ibidem, § 101).
63. Bien que la Convention ne garantisse pas, en tant que tel, un droit à la réinsertion, la jurisprudence de la Cour part du principe que les personnes condamnées, y compris celles qui se sont vu infliger une peine d’emprisonnement à vie, doivent pouvoir travailler à leur réinsertion. Cet objectif peut être atteint, par exemple, par la mise en place et le réexamen périodique d’un programme individualisé, propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime (ibidem, § 103).
64. Les détenus à vie doivent dès lors se voir offrir la possibilité de s’amender. En ce qui concerne l’étendue des obligations qui pèsent sur les États à cet égard, la Cour considère que même si les États ne sont pas tenus de garantir que les détenus à vie réussissent à s’amender, ils ont néanmoins l’obligation de leur donner la possibilité de s’y employer. L’obligation d’offrir au détenu une possibilité de s’amender doit être considérée comme une obligation de moyens et non de résultat. Cela étant, elle implique une obligation positive de garantir pour les détenus à vie l’existence de régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l’objectif d’amendement et qui permettent aux détenus en question de progresser sur cette voie (ibidem, § 104).
b) Application au cas d’espèce
65. Il n’est pas contesté par les parties qu’il existe en Belgique un mécanisme permettant le réexamen d’une peine perpétuelle et que le requérant a pu demander à intervalles réguliers un tel réexamen. La Cour ne voit donc pas de raison de douter que la peine de réclusion à perpétuité à laquelle le requérant a été condamné est compressible de jure.
66. Cependant, pour être compatible avec l’article 3 de la Convention, une peine perpétuelle doit également être compressible de facto, c’est-à-dire qu’elle doit offrir à l’intéressé une perspective réaliste d’élargissement (paragraphe 62 ci-dessus, et Marcello Viola c. Italie (no 2), no 77633/16, § 127, 13 juin 2019 ; voir aussi les conclusions du CPT au paragraphe 52 ci‑dessus).
67. En l’espèce, la Cour note que le requérant et l’équipe psychosociale de la prison de Hasselt ont effectué de nombreuses démarches visant à la réinsertion du premier dans la société depuis qu’il est admissible au bénéfice d’une modalité d’exécution de sa peine (paragraphe 7 ci-dessus). Le requérant a ainsi soumis au TAP plusieurs plans de réinsertion, qui impliquaient un séjour au sein d’institutions extérieures qui avaient accepté de l’accueillir (voir notamment paragraphes 12, 14, 15, 20, 22 et 23 ci‑dessus). Toutes les demandes du requérant visant à pouvoir bénéficier d’une modalité d’exécution de la peine ont été rejetées par le TAP au motif que les plans de réinsertion proposés ne permettaient pas de pallier le risque de perpétration par le requérant de nouvelles infractions graves (paragraphes 10, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 32 et 44 ci-dessus).
68. Sur ce point, la Cour ne peut perdre de vue que la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter en veillant à l’harmonie et à la cohérence interne de ses différentes dispositions (voir, parmi d’autres, Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, § 92, 8 juillet 2019). Elle a déjà jugé que libérer un individu est susceptible d’engager la responsabilité de l’État, notamment au regard de l’article 2 de la Convention, en cas de manquement au devoir de protéger la vie si celui-ci commet un acte attentatoire à la vie au cours de sa période de mise en liberté (voir, dans ce sens, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 71, CEDH 2002‑VIII).
69. Cela étant, la Cour relève que, depuis janvier 2018, les experts psychiatres et le TAP s’accordent pour estimer que la prolongation du séjour du requérant en prison n’est plus indiquée, tant au regard de la sûreté publique qu’aux fins de sa resocialisation et sa réintégration dans la société. Ils préconisent dès lors l’admission du requérant dans une unité de psychiatrie légale comme étape intermédiaire avant une éventuelle mise en liberté (paragraphes 27, 28, 37 et 44 ci-dessus). De ce fait, le TAP refuse toute autre modalité d’exécution de la peine, telle la détention limitée ou la surveillance électronique (paragraphes 28, 37 et 44 ci‑dessus), insistant sur le fait qu’une admission dans une unité de psychiatrie légale est une étape indispensable à la réinsertion du requérant dans la société (paragraphes 37 et 44 ci-dessus).
70. Or, il ressort du dossier que toutes les unités de psychiatrie légale de moyenne sécurité de la Communauté flamande, contactées par le requérant et le service psychosocial de la prison de Hasselt, ont indiqué que le requérant ne peut pas être admis dans une telle unité en raison de son statut de « condamné », c’est-à-dire de personne jugée pénalement responsable des faits qu’elle a commis, ces unités étant réservées aux seuls personnes « internées » (paragraphes 30 et 42 ci-dessus ; voir, pour les conditions de l’internement, paragraphe 49 ci-dessus). La Cour note que, dans ses observations, le Gouvernement admet que les places dans ces unités sont actuellement réservées aux seules personnes ayant le statut d’interné, et que le placement d’une personne condamnée dans une telle unité n’est dès lors pas possible (paragraphe 59 ci-dessus).
71. Le TAP a également reconnu, sans que cela n’ait été contesté par le Gouvernement, que l’admission dans une unité de psychiatrie légale « semblait en pratique impossible pour des raisons de financement » dans la mesure où ces unités ne sont subventionnées par l’État que pour accueillir des personnes ayant le statut d’interné (paragraphe 37 ci-dessus).
72. Il ressort de ce qui précède que le requérant se trouve dans une impasse : d’un côté, les autorités internes compétentes estiment que sa place n’est plus en prison, au moins depuis janvier 2018 ; de l’autre côté, aucune possibilité d’élargissement ne semble envisageable en pratique, du fait de l’exigence qu’il soit admis dans une unité de psychiatrie légale. Il apparaît ainsi qu’actuellement aucune voie intermédiaire n’est possible pour le requérant, en raison de la particularité de sa situation de détenu de très longue durée n’ayant pas le statut d’interné.
73. La Cour ne minimise pas la particularité, soulignée par le Gouvernement (paragraphe 64 ci-dessus), de la situation dans laquelle se trouve le requérant, qui est détenu depuis 1979 et a passé la majeure partie de sa vie en prison. Il n’en demeure pas moins que la situation que le requérant dénonce perdure depuis plus de cinq ans sans qu’une solution n’ait pu être mise en œuvre par les autorités, malgré les nombreuses démarches effectuées par le requérant. La Cour relève de surcroît que le Gouvernement n’indique aucune démarche que le requérant pourrait ou devrait entamer pour sortir efficacement de cette impasse.
74. À la suite du CPT (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour considère que bénéficier d’une possibilité purement formelle de demander une remise en liberté après un certain temps n’est pas suffisant au regard des exigences de l’article 3 de la Convention, qui garantit un droit absolu. Si, comme le rappelle le Gouvernement (paragraphe 57 ci-dessus), l’obligation d’offrir au détenu une possibilité de s’amender participe d’une obligation de moyens et non de résultat, les États doivent cependant garantir que cette possibilité soit réaliste (Marcello Viola, précité, § 127 ; voir aussi paragraphe 62 ci-dessus).
75. Dans les circonstances concrètes de l’espèce, la Cour estime que l’impasse dans laquelle se trouve le requérant depuis plusieurs années résultant de l’impossibilité pratique d’être placé dans une unité de psychiatrie légale alors que sa détention en prison n’est plus indiquée selon les autorités internes, a pour conséquence qu’il n’a actuellement pas de perspective réaliste d’élargissement, ce qui est prohibé par l’article 3 de la Convention (paragraphe 66 ci-dessus ; voir également, dans le même sens, Murray, précité, § 125, et Marcello Viola, précité, § 137).
76. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
Bancsók et László Magyar (no 2) c. Hongrie du 28 octobre 2021 requêtes n os 52374/15 et 53364/15
Art 3 : Les peines d'emprisonnement à vie, avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 40 ans d'emprisonnement, sont incompatibles avec la Convention
Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme L'affaire concerne l'imposition de peines d'emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 40 ans d'emprisonnement. La Cour considère que de telles peines n'offrent pas, en fait, de réelles perspectives de libération et ne sont donc pas compatibles avec la Convention.
FAITS
Les requérants, József Bancsók et László Magyar, sont des ressortissants hongrois, nés respectivement en 1979 et 1960. Ils purgent une peine de prison à vie en Hongrie. M. Bancsók (requête n° 52374/15) a été condamné à la prison à vie pour meurtre en juin 2013, avec la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'il aurait purgé 40 ans de prison. Après que sa peine a été confirmée en appel en 2015, M. Bancsók a déposé une plainte constitutionnelle. Il a fait valoir que la fixation de la date la plus proche de sa libération, une fois une peine de 40 ans purgée, était contraire à la jurisprudence de la Cour et constituait un traitement inhumain. La procédure est toujours en cours. M. Magyar (requête n° 53364/15) a été condamné à la prison à vie en septembre 2010, sans possibilité de libération conditionnelle, en vertu des articles du code pénal en vigueur à l'époque. Toutefois, à la suite de l'arrêt de la Cour dans l'affaire László Magyar c. Hongrie (no 73593/10, 20 mai 2014), dans lequel une violation de l'article 3 a été constatée, sa peine a été révisée pour inclure l'éligibilité à une libération conditionnelle après 40 ans d'emprisonnement. M. Magyar a ensuite déposé une plainte constitutionnelle en 2015, arguant que la fixation de la date la plus proche de la libération, une fois une peine de 40 ans purgée, était contraire aux obligations de la Hongrie au titre de la Convention. La procédure est toujours en cours.
Article 3
Article 3 La Cour rejette l'exception du Gouvernement concernant le non-épuisement des voies de recours internes, notant que les deux séries de procédures devant la Cour constitutionnelle sont pendantes depuis 2015, ce qui compromet l'efficacité potentielle de ce recours dans leurs cas. Elle réaffirme qu'une condamnation à perpétuité ne peut être compatible avec la Convention que s'il existe à la fois une perspective de libération et une possibilité de réexamen dès le départ. La Cour a déjà jugé que lorsque le droit interne ne prévoit pas la possibilité d'un tel réexamen, la condamnation à perpétuité n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la Convention. En outre, les éléments de droit comparé et de droit international montrent qu'il existe un soutien clair en faveur de l'institution d'un mécanisme spécifique garantissant un réexamen au plus tard 25 ans après l'imposition d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, avec d'autres réexamens périodiques par la suite. Elle a noté que les 40 ans que les requérants devraient attendre avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle étaient nettement plus longs que le délai maximal recommandé. Elle conclut donc que leurs peines n'offraient pas, en fait, de réelle perspective de libération, et n'étaient donc pas compatibles avec la Convention. Il y a donc eu violation de l'article 3.
Dardanskis c. Lituanie requête n° 74452/13 et 15 autres
Non violation article 3 : Les modifications apportées à la législation lituanienne sur l’emprisonnement à vie sont conformes à la jurisprudence de la Cour
Dans cette affaire, les requérants soutenaient que leur peine d’emprisonnement à vie s’analysait en un traitement inhumain et dégradant en ce qu’ils n’avaient aucun espoir d’être libérés un jour. La Cour juge en particulier que la nouvelle procédure lituanienne de commutation des peines d’emprisonnement à vie constitue une voie de droit adéquate et effective relativement au grief des requérants.
FAITS
Les requérants sont 16 ressortissants lituaniens nés entre 1960 et 1980. Ils ont tous été condamnés à des peines d’emprisonnement à vie, qu’ils purgent soit à la prison de Lukiškės soit au pénitencier de Pravieniškės, en Lituanie. En mars 2019, des modifications ont été apportées à la législation lituanienne relative aux détenus à vie : une peine de perpétuité peut désormais être commuée en peine à durée déterminée et le détenu concerné bénéficier d’une libération conditionnelle. La législation expose aussi la procédure à suivre pour la commutation des peines, ainsi que les critères auxquels doit répondre le détenu à vie pour pouvoir bénéficier de cette mesure. Le rapport explicatif indique que les critères à remplir sont stricts et que seules les personnes qui se sont « considérablement améliorées », eu égard à l’ensemble de ces critères, sont susceptibles de voir leur peine d’emprisonnement à vie commuée en peine à durée déterminée.
Article 3
En ce qui concerne les modifications apportées à la législation lituanienne en mars 2019, la Cour relève tout d’abord que la commutation d’une peine d’emprisonnement à vie passe par une décision judiciaire, ce qu’elle estime satisfaisant. Deuxièmement, elle observe que la situation d’un détenu à vie peut être examinée au plus tôt vingt ans après qu’il a été placé en détention ou qu’il a commencé à purger sa peine d’emprisonnement à perpétuité. Cette période est plus courte que la durée maximale indicative de 25 ans que la Cour a jugée acceptable. Troisièmement, un condamné à perpétuité peut participer activement à la procédure de réexamen de sa peine, procédure dans le cadre de laquelle un tribunal doit rendre une décision motivée, susceptible d’appel. Ce réexamen offre des garanties procédurales suffisantes, car le détenu à vie lui-même et son avocat peuvent comparaître et plaider que l’intéressé s’est amendé. Quatrièmement, la Cour se penche sur les critères que les tribunaux doivent prendre en compte pour commuer une peine d’emprisonnement à vie. Ces critères englobent en particulier le risque de récidive, les buts de la peine d’emprisonnement à vie, l’effet qu’a eu sur la personne condamnée le fait de purger une partie de la peine d’emprisonnement à vie et le niveau de mise en œuvre des mesures d’amendement. La Cour considère que ces critères sont suffisamment objectifs pour permettre d’apprécier de façon effective si l’intéressé s’est amendé et mérite une commutation de sa peine. Par ailleurs, les motifs du rejet d’une demande de commutation formée par un détenu à vie doivent désormais être exposés dans une décision judiciaire. Une défaillance spécifique que la Cour avait relevée dans le précédent régime résidait dans le fait que les détenus à vie ne pouvaient pas être informés des motifs de rejet de leurs demandes de grâce. Il a désormais été remédié à cette défaillance. Enfin, la Cour observe que l’État n’a pas négligé les besoins constants des détenus à vie en matière de réinsertion, y compris une fois leur peine d’emprisonnement à vie commuée en peine d’emprisonnement à durée déterminée, et ce dans l’optique d’une éventuelle libération conditionnelle et, en définitive, de leur retour dans la société. La Cour considère que cette mesure est elle aussi en conformité avec les exigences de l’article 3. La Cour constate dès lors que la procédure de commutation des peines d’emprisonnement à vie et les exigences qui l’accompagnent, telles qu’adoptées tout récemment par les autorités lituaniennes, offrent une voie de droit adéquate et suffisante relativement au grief des requérants. Elle conclut que le problème à l’origine du grief peut donc à présent être tenu pour « résolu » au sens de l’article 37 § 1 b). Enfin, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme n’exige la poursuite par la Cour de son examen de la requête sur le fondement de l’article 37 § 1 in fine. En conséquence, les requêtes sont rayées du rôle de la Cour.
MARCELLO VIOLA c. ITALIE du 13 juin 2019 requête n° 77633/16
Violation de l'article 3 : L'Italie doit réformer son système de contrôle des peines de perpétuité réelle et incompressible. Un chef mafieux se plaint d'une condamnation à perpétuité pour quelques petits meurtres et séquestrations. La CEDH rappelle que la détention a pour but de réinsérer une personne et qu'une perspective de fin doit exister. Toutefois, la CEDH précise que son arrêt de condamnation ne signifie pas que le chef mafieux doit être libéré rapidement.
La Cour rappelle que la dignité humaine se trouve au cœur du système mis en place par la Convention. On ne peut priver une personne de sa liberté sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté. Ainsi, la Cour considère que la réclusion à perpétuité infligée à M. Viola, en application de l’article 4 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (ergastolo ostativo) restreint excessivement la perspective d’élargissement de l’intéressé et la possibilité de réexamen de sa peine. Dès lors, cette peine perpétuelle ne peut pas être qualifiée de compressible aux fins de l’article 3 de la Convention. Toutefois, les Etats contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour décider de la durée adéquate des peines d’emprisonnement. Le fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Par conséquent, la possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité implique pour le condamné la possibilité de demander un élargissement mais pas forcément d’obtenir sa libération si ce dernier constitue toujours un danger pour la société
(a) Principes applicables
92. Les principes pertinents en matière de peines de réclusion à perpétuité, de réinsertion et de libération conditionnelle ont été exposés en détail dans l’arrêt Vinter (précité, § 103–122, avec les références à l’arrêt Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, CEDH 2008), et récemment résumés dans les arrêts Murray (précité, §§ 99-100) et Hutchinson c. Royaume-Uni [GC] (no 57592/08, §§ 42-45, 17 janvier 2017).
b) Application de ces principes à la présente espèce
93. La Cour observe d’emblée que, dans la présente affaire, le requérant ne se plaint pas d’une nette disproportion de la peine de réclusion à perpétuité à laquelle il a été condamné (voir, parmi d’autres, Matiošaitis et autres c. Lituanie, nos 22662/13 et 7 autres, § 157, 23 mai 2017, et Vinter, précité, § 102), mais de l’incompressibilité de jure et de facto alléguée de cette peine.
94. La Cour note ensuite que la présente cause se distingue des affaires portant sur la peine perpétuelle introduites auparavant contre l’Italie, dans lesquelles elle a été amenée à se pencher sur la peine de perpétuité régie par l’article 22 du CP. Dans la décision Garagin c. Italie ((déc.) no 33290/07, 29 avril 2008 ; voir aussi Scoppola c. Italie (déc.), no 10249/03, 8 septembre 2005), elle a jugé que la réclusion à perpétuité demeure compatible avec l’article 3 de la Convention, en s’exprimant comme suit :
« (...) le condamné à perpétuité peut être libéré, et par le libellé de l’article 176 du CP. Aux termes de cette disposition, le condamné à perpétuité ayant eu un comportement de nature à démontrer un repenti sincère peut être libéré après avoir purgé vingt-six ans d’emprisonnement. Il peut en outre être admis au régime de semi-liberté après avoir purgé vingt ans d’emprisonnement (article 50 § 5 de la loi no 354 de 1975 (...), en Italie les peines perpétuelles sont (...) de jure et de facto compressibles. Dès lors, on ne peut dire que le requérant n’a aucune perspective de libération ni que son maintien en détention, fût-ce pour une longue durée, est en soi constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. »
Par ailleurs, dans l’arrêt Vinter (précité, § 117), la Cour s’est appuyée entre autres sur le droit interne italien – législation et jurisprudence de la Cour constitutionnelle – pour affirmer que la pratique des États contractants reflète la volonté à la fois d’œuvrer à la réinsertion des condamnés à perpétuité et de leur offrir une perspective de libération.
95. La Cour observe que, en l’espèce, le régime applicable à la réclusion à perpétuité est le résultat de l’application combinée de l’article 22 du CP précité avec les articles 4 bis et 58 ter de la loi sur l’administration pénitentiaire. Cette catégorie spécifique de peine perpétuelle est qualifiée, au niveau interne, d’« ergastolo ostativo ».
96. Elle relève que lesdites dispositions prévoient un traitement pénitentiaire différencié qui a pour effet d’empêcher l’octroi de la libération conditionnelle ainsi que l’accès aux autres bénéfices pénitentiaires et aux mesures alternatives à la détention (à l’exception de la « libération anticipée ») si la condition nécessaire de collaboration avec la justice n’est pas remplie. En effet, si pour l’ensemble des mesures favorisant la réinsertion progressive du condamné à la perpétuité, régie par l’article 22 du CP, le législateur a prévu certaines conditions d’accès (bonne conduite, participation au projet de réadaptation, progression du parcours de traitement, preuve positive de l’amendement) en fonction de la mesure demandée, il a instauré à l’article 4 bis une condition spécifique (paragraphe 32 ci‑dessus) faisant obstacle à l’octroi par le juge national des mesures d’aménagement.
97. La Cour note que le contenu de cette collaboration est régi par l’article 58 ter (paragraphe 33 ci-dessus) : le condamné doit fournir aux autorités des éléments décisifs permettant de prévenir les conséquences ultérieures du délit ou de faciliter l’établissement des faits et l’identification des responsables d’infractions criminelles. Le condamné est dispensé de cette obligation si ladite collaboration peut être qualifiée d’« impossible » ou d’« inexigible » (paragraphe 46 ci-dessus) et s’il prouve la rupture de tout lien actuel avec le groupe mafieux (paragraphe 32 ci-dessus).
Sur la perspective d’élargissement et la possibilité de demander la libération conditionnelle
98. La Cour observe, à l’instar du requérant et du Gouvernement (paragraphes 68 et 77 ci-dessus), que, en raison de l’existence de la circonstance aggravante liée à l’assomption du rôle de chef au sein du groupe mafieux d’appartenance retenue à son encontre, l’intéressé ne saurait voir son éventuelle collaboration être qualifiée d’« impossible » ou d’« inexigible » au sens de la législation en vigueur et de la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphes 33 et 46 ci-dessus).
99. Ainsi, afin de déterminer en l’espèce si la peine perpétuelle dite « ergastolo ostativo » est de jure et de facto compressible, c’est-à-dire si elle offre une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen (voir, parmi beaucoup d’autres, Hutchinson, précité, § 42), la Cour se concentrera sur la seule option ouverte au requérant : coopérer dans le cadre des activités d’investigation et de poursuite menées par les autorités judiciaires (paragraphe 77 ci-dessus), afin d’avoir une possibilité de demander et d’obtenir son élargissement.
100. La Cour note que les circonstances relatives à la situation en cause en l’espèce semblent se distinguer des faits à l’origine de l’affaire Öcalan c. Turquie (no 2) (nos 24069/03 et 3 autres, §§ 200-202, 18 mars 2014). En effet, dans cette affaire, le contraste entre l’ordre juridique turc et l’article 3 de la Convention découlait du dispositif législatif alors en vigueur. Ceci interdisait au requérant, en raison de sa condition de condamné à la peine de réclusion à la perpétuité aggravée pour avoir commis un crime contre la sécurité de l’État, de demander, à un moment donné au cours de l’accomplissement de sa peine, son élargissement pour des motifs légitimes d’ordre pénologique. Il s’agissait là d’un effet automatique de la loi en question, qui excluait toute possibilité d’obtenir le réexamen de la peine et qui était lié à la nature de l’infraction pénale reprochée au requérant.
101. La Cour observe que, dans la présente affaire, la législation interne n’interdit pas, de manière absolue et avec un effet automatique, l’accès à la libération conditionnelle et aux autres bénéfices propres au système pénitentiaire, mais qu’elle le subordonne à la « collaboration avec la justice ».
102. En effet, la situation propre au requérant, découlant de l’article 4bis, se situe ainsi entre celle du condamné à la perpétuité ordinaire, prévue à l’article 22 du CP, dont la peine est compressible de jure et de facto, et celle du détenu qui se voit interdire par le système, en raison d’un obstacle juridique ou pratique, toute possibilité d’élargissement, en violation de l’article 3 de la Convention.
103. La Cour prend note des affirmations du Gouvernement (paragraphe 75 ci-dessus) selon lesquelles l’article 4bis a pour finalité de demander aux condamnés la démonstration tangible de leur « dissociation » d’avec le milieu criminel et de la réussite du parcours de resocialisation, au moyen d’une collaboration utile avec la justice qui vise à la « désintégration » de l’association mafieuse et au rétablissement de la légalité( voir aussi la Cour constitutionnelle, paragraphe 40 ci-dessus). Pour lui, l’objectif de politique criminelle sous-jacent à la discipline du 4 bis est donc clairement défini, comme d’ailleurs mis en avant dans l’arrêt no 306/1993 de la Cour constitutionnelle (paragraphe 39 ci-dessus) : le législateur a explicitement privilégié les finalités de prévention générale et de protection de la collectivité, en demandant aux condamnés pour les délits en cause de faire preuve de coopération avec les autorités, un outil considéré comme capital dans la lutte contre le phénomène mafieux. D’après le Gouvernement, c’est cette spécificité du phénomène qui conduit à l’exigence de prévoir un régime de la réclusion à perpétuité différent du régime ordinaire prévu à l’article 22 du CP.
104. à propos du phénomène mafieux, la Cour estime utile de se référer aux observations du Gouvernement (paragraphe 75 ci-dessus) et à l’arrêt de la cour d’assises de Palmi (paragraphe 9 ci-dessus) faisant état de la spécificité de l’association criminelle de type mafieux et du pacte conclu entre ses membres, qui se caractérise pour être particulièrement solide et s’inscrivant dans la continuité.
105. Elle renvoie également à l’arrêt de la Cour de cassation no 46103 du 7 novembre 2014 (paragraphe 47 ci-dessus), dans lequel cette juridiction a rappelé que le délit d’association de malfaiteurs de type mafieux, un délit de nature permanente (reato permanente), présuppose l’existence d’un vaste programme criminel, projeté vers le futur et sans aucune limitation temporelle. Selon la Haute juridiction, l’état de réclusion d’un membre d’une association mafieuse n’implique pas la cessation automatique de sa participation à ladite association. La conclusion qu’en tire la Cour de cassation est que la « permanence » du délit visé à l’article 416 bis est compatible avec l’inactivité de l’associé ou l’état de veille de l’association, de sorte que le rapport d’association cesse seulement dans le cas objectif de rupture de l’accord d’association ou dans les cas subjectifs de décès, de rupture du lien individuel ou d’exclusion de la part des autres associés (paragraphe 47 ci-dessus).
106. L’article 4 bis prévoit donc une présomption de dangerosité du condamné liée au type de délit qui lui est reproché. Cette dangerosité et le lien avec le milieu criminel d’origine ne disparaîtraient pas par le seul fait de la réclusion. La Cour note que, d’après le Gouvernement, c’est pour cette raison que la norme en question demande au condamné de prouver concrètement, par sa collaboration, qu’il a rompu avec le milieu criminel d’appartenance, ce qui indiquerait également la réussite du procès de resocialisation.
107. La Cour rappelle avoir affirmé que le choix que fait l’État d’un régime de justice pénale, y compris le réexamen de la peine et les modalités de libération, échappe en principe au contrôle européen exercé par elle pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (Vinter, précité, § 104).
108. Elle a également jugé que, si le châtiment demeure l’un des objectifs de la détention, les politiques pénales européennes mettent désormais l’accent sur l’objectif de resocialisation poursuivi par la détention, y compris dans le cas de détenus condamnés à la perpétuité (ibidem, §§ 115-118), et en particulier vers la fin d’une longue peine d’emprisonnement (Dickson, précité, § 75, avec la référence aux paragraphes 28-36). Le principe de resocialisation se trouve reflété dans les normes internationales et est aujourd’hui reconnu dans la jurisprudence de la Cour (Murray, précité, § 102, avec la jurisprudence qui y est citée).
109. Au niveau interne, la Cour relève que, depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 313 de 1990 (paragraphe 38 ci‑dessus), la jurisprudence de cette haute juridiction sur la fonction de la peine témoigne du rôle central de la resocialisation, qui doit accompagner la peine de sa formulation normative abstraite à son exécution concrète : la Cour constitutionnelle a affirmé que celle-ci doit orienter l’action du législateur, du juge judiciaire, du juge d’application des peines et des autorités pénitentiaires.
110. Ces premières considérations amènent la Cour à se pencher sur la question centrale qui se pose dans le cas du requérant, à savoir si l’équilibre entre les finalités de politique criminelle et la fonction de resocialisation de la peine ne finit pas, dans son application pratique, par restreindre excessivement la perspective d’élargissement de l’intéressé et la possibilité pour ce dernier de demander le réexamen de sa peine.
111. La Cour observe que le système pénitentiaire italien se fonde sur le principe de la progression du traitement carcéral (progressione trattamentale) du détenu, selon lequel la participation active au programme individuel de rééducation et l’écoulement du temps peuvent produire des effets positifs sur le condamné et promouvoir sa pleine réinsertion dans la société. Au fur et à mesure qu’il évolue en prison, si tant est qu’il évolue, le condamné se voit offrir par le système la possibilité de bénéficier de mesures progressives (allant du travail à l’extérieur à la libération conditionnelle) censées l’accompagner dans son « chemin vers la sortie ».
112. Il s’agit là d’une déclinaison de la fonction d’amendement de l’incarcération évoquée dans l’arrêt Murray (précité, § 101).
113. La Cour rappelle en outre avoir affirmé que le principe de la « dignité humaine » empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté. Elle a précisé qu’« un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir (...) ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables » (Vinter, précité, § 122).
Elle a aussi jugé que les autorités nationales doivent donner aux détenus condamnés à la prison à vie une chance réelle de se réinsérer (Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, § 264, CEDH 2014 (extraits)). Il s’agit clairement d’une obligation positive de moyens, et non pas de résultat, impliquant de garantir pour ces détenus l’existence de régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l’objectif d’amendement et qui leur permettent de progresser sur cette voie (Murray, précité, § 104). À cet égard, la Cour a précédemment conclu à la méconnaissance de pareille obligation dans des cas où c’était le régime ou les conditions de détention qui faisaient obstacle à l’amendement des détenus (Harakchiev et Tolumov, précité, § 266).
114. La Cour prend note de la position, en l’espèce, du Gouvernement, qui soutient que l’obstacle que représente l’absence de « collaboration avec la justice » n’est pas le résultat d’un automatisme législatif, qui ôterait de manière absolue toute perspective d’élargissement au requérant, mais plutôt la conséquence d’un choix individuel. Le rôle central assigné à la volonté du condamné, qui serait le seul artisan de son destin, constitue l’un des arguments principaux du Gouvernement (paragraphe 79 ci-dessus), qui s’appuie par ailleurs sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (paragraphe 41 ci-dessus).
115. La Cour prend également note de la thèse du requérant, qui, de son côté, affirme que le fait de coopérer avec les autorités entraînerait pour lui ou pour ses proches un risque d’exposition à des représailles de la part de l’organisation mafieuse et irait à l’encontre de son intime conviction selon laquelle il est innocent (paragraphe 70 ci‑dessus). Il critique également la logique instrumentale du système qui fait dépendre sa possibilité de sortie au fait d’offrir sa collaboration totale (paragraphe 71 ci-dessus).
116. Or, s’il est vrai que le régime interne offre au condamné le choix de collaborer ou pas avec la justice, la Cour doute de la liberté de ce choix tout comme de l’opportunité d’établir une équivalence entre le défaut de collaboration et la dangerosité sociale du condamné.
117. Sans vouloir analyser le bien-fondé de l’expression d’innocence du requérant – ce qui d’ailleurs échappe à sa compétence –, la Cour constate que ce dernier ne fait qu’affirmer que, pour ne pas aller à l’encontre de son intime conviction et pour ne pas avoir à subir de réactions violentes de la part de ses anciens associés, il a décidé de ne pas collaborer avec la justice paragraphe 70 ci-dessus). Sur cet aspect, il convient de rappeler les déclarations de la tierce partie « L’altro diritto onlus » relatives à son activité d’observation directe de détenus condamnés à la perpétuité régie par l’article 4 bis. Selon ce tiers intervenant, la raison principale du refus de collaborer avec la justice résiderait dans la crainte pour les détenus condamnés pour des délits de type mafieux de mettre en danger leur vie ou celle de leurs proches (paragraphe 89 ci-dessus).
118. La Cour en déduit que le défaut de collaboration ne saurait être toujours lié à un choix libre et volontaire, ni uniquement justifié par la persistance de l’adhésion aux « valeurs criminelles » et le maintien de liens avec le groupe d’appartenance. Cela a été d’ailleurs reconnu par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 306 du 11 juin 1993, lorsqu’elle a affirmé que l’absence de collaboration n’indiquait pas forcément le maintien de liens avec l’organisation mafieuse (paragraphe 39 ci-dessus).
119. En outre, la Cour relève, à l’instar de la Cour constitutionnelle dans ce même arrêt, que l’on pourrait raisonnablement être confronté à la situation où le condamné collabore avec les autorités sans pour autant que son comportement ne reflète un amendement de sa part ou sa « dissociation » effective d’avec le milieu criminel, l’intéressé agissant de la sorte dans le seul but d’obtenir les avantages prévus par la loi.
120. Elle constate que, si d’autres circonstances ou d’autres considérations peuvent pousser le condamné à refuser de coopérer, ou si la collaboration peut éventuellement être proposée dans un but purement opportuniste, l’immédiate équivalence entre l’absence de collaboration et la présomption irréfragable de dangerosité sociale finit par ne pas correspondre au parcours réel de rééducation du requérant.
121. Elle observe, en effet, que, en considérant la coopération avec les autorités comme la seule démonstration possible de la « dissociation » du condamné et de son amendement, il n’est pas tenu compte des autres indices permettant d’évaluer les progrès accomplis par le détenu. En effet, il n’est pas exclu que la « dissociation » d’avec le milieu mafieux puisse s’exprimer autrement qu’avec la collaboration avec la justice.
122. La Cour rappelle, comme exposé plus haut (paragraphe 111 ci‑dessus), que le système pénitentiaire italien offre un éventail d’occasions progressives de contact avec la société – allant du travail à l’extérieur à la libération conditionnelle, en passant par les permissions de sortie et la semi‑liberté, qui ont pour finalité de favoriser le processus de resocialisation du détenu. Or, le requérant n’a pas bénéficié de ces occasions progressives de réinsertion sociale.
123. La Cour relève que ce constat est avéré alors même que les rapports d’observation du requérant en milieu carcéral, présentés à l’appui de la demande de libération conditionnelle (paragraphe 24 ci-dessus), ont fait état d’une évolution de la personnalité de l’intéressé jugée positivement. De même, elle note que, bien qu’ayant été rendue dans un cadre juridique différent, l’ordonnance du TAP de l’Aquila ayant mis fin au régime du « 41 bis » indiquait les résultats positifs du parcours de resocialisation du requérant (paragraphe 16 ci-dessus).
124. La Cour constate, de surcroît, que le requérant a déclaré n’avoir jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires et avoir accumulé depuis sa condamnation, en raison de sa participation au programme de réinsertion, environ cinq ans de libération anticipée (paragraphe 73 ci-dessus), mais que, du fait de l’absence de collaboration de sa part, il ne peut pas bénéficier en pratique de la déduction de peine obtenue.
125. La Cour estime que la personnalité d’un condamné ne reste pas figée au moment où l’infraction a été commise. Celle-ci peut évoluer pendant la phase d’exécution de la peine, comme le veut la fonction de resocialisation, qui permet à l’individu de revoir de manière critique son parcours criminel et de reconstruire sa personnalité (Murray, précité, § 102).
126. La Cour rappelle que, pour cela, le condamné doit savoir ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions (Vinter et autres, précité, § 122, et Trabelsi, précité, §§ 115 et 137).
127. En l’occurrence, la Cour estime que l’absence de « collaboration avec la justice » détermine une présomption irréfragable de dangerosité, qui a pour effet de priver le requérant de toute perspective réaliste d’élargissement (voir, parmi d’autres, Harakchiev et Tolumov, précité, § 264, et Matiošaitis et autres, précité, § 177). Celui-ci risque de ne jamais pouvoir se racheter : quoi qu’il fasse en prison, son châtiment demeure immuable, insusceptible de contrôle et risque aussi de s’alourdir avec le temps (Vinter, précité, § 112).
128. La Cour relève en effet que le requérant est dans l’impossibilité de pouvoir démontrer qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie plus son maintien en détention et que celui-ci est donc contraire à l’article 3 de la Convention (ibidem, § 129), puisque, en maintenant l’équivalence entre l’absence de collaboration et la présomption irréfragable de dangerosité sociale (paragraphes 116 et 120 ci-dessus), le régime en vigueur rattache en réalité la dangerosité de l’intéressé au moment où les délits ont été commis, au lieu de tenir compte du parcours de réinsertion et des éventuels progrès accomplis depuis la condamnation.
129. En outre, la Cour souligne que ladite présomption irréfragable empêche de facto le juge compétent d’examiner la demande de libération conditionnelle et de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le requérant a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement que le maintien en détention ne se justifie plus pour des motifs d’ordre pénologique (Murray, précité, § 100, avec la jurisprudence qui y est citée). L’intervention du juge est limitée au constat du non-respect de la condition de collaboration, sans pouvoir mener une appréciation du parcours individuel du détenu et de son évolution sur le chemin de la resocialisation. Ce qui est d’ailleurs l’étendue de l’appréciation du TAP de L’Aquila dans la présente affaire. Ce dernier a en effet rejeté la demande de libération conditionnelle du requérant en relevant l’absence de collaboration avec la justice (paragraphe 25 ci-dessus), sans se livrer à une appréciation des éventuels progrès que l’intéressé disait avoir faits depuis sa condamnation.
130. Certes, la Cour reconnaît que les délits pour lesquels le requérant a été condamné portent sur un phénomène particulièrement dangereux pour la société. Elle note aussi que l’introduction de l’article 4 bis est le résultat de la réforme du régime pénitentiaire de 1992, laquelle réforme s’est inscrite dans un contexte d’urgence où le législateur a été amené à intervenir, à la suite d’un épisode extrêmement marquant pour l’Italie (paragraphe 85 ci‑dessus), dans une situation particulièrement critique. Cela étant, la lutte contre ce fléau ne saurait justifier de dérogations aux dispositions de l’article 3 de la Convention, qui prohibent en termes absolus les peines inhumaines ou dégradantes. Ainsi, la nature des infractions reprochées au requérant est dépourvue de pertinence pour l’examen de la présente requête sous l’angle de l’article 3 susmentionné (Öcalan, précit駧 98 et 205, avec la jurisprudence qui y est citée). Par ailleurs, la Cour a affirmé que la fonction de resocialisation vise, en dernier ressort, à empêcher la récidive et à protéger la société (Murray, précité, § 102).
131. Il échet de rappeler que la Cour, dans une affaire portant sur la durée de la détention provisoire, et donc sur le terrain de l’article 5 de la Convention, a rappelé le principe selon lequel « une présomption légale de dangerosité peut se justifier, en particulier lorsqu’elle n’est pas absolue, mais se prête à être contredite par la preuve du contraire » (Pantano c. Italie, no 60851/00, § 69, 6 novembre 2003). Cette affirmation vaut encore plus sur le terrain de l’article 3 de la Convention, étant donné le caractère absolu de cette disposition, qui ne souffre aucune exception (voir, parmi beaucoup d’autres, Trabelsi, précité, § 118).
132. La Cour remarque, à titre surabondant, qu’au niveau interne semble se développer une tendance récente en faveur d’une remise en question de la présomption irréfragable de dangerosité sociale, comme le prouvent l’arrêt no 149 du 11 juillet 2018 de la Cour constitutionnelle (paragraphe 43 ci‑dessus), l’ordonnance de renvoi de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle relativement à la constitutionnalité de l’article 4 bis (paragraphe 48 ci-dessus), ainsi que deux projets récents de réforme de l’article 4 bis d’origine gouvernementale (paragraphes 49 et 50 ci-dessus).
Sur les autres remèdes internes visant au réexamen de la peine
133. Pour ce qui est enfin des affirmations du Gouvernement, selon lesquelles le système interne prévoit deux autres remèdes pour obtenir le réexamen de la peine, à savoir la demande de grâce présidentielle et la demande de suspension de la peine pour raisons de santé (paragraphe 81 ci‑dessus), la Cour rappelle sa jurisprudence pertinente en l’espèce selon laquelle la possibilité pour un détenu purgeant une peine perpétuelle de bénéficier d’une grâce ou d’une remise en liberté, pour des motifs d’humanité tenant à un mauvais état de santé, à une invalidité physique ou à un âge avancé, ne correspond pas à ce que recouvre l’expression « perspective d’élargissement » employée depuis l’arrêt Kafkaris (précité, § 127 ; voir aussi Öcalan, précité, § 203, et László Magyar c. Hongrie, no 73593/10, §§ 57 et 58, 20 mai 2014).
134. En particulier, la Cour observe que, dans son arrêt no 200 du 18 mai 2006 (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour constitutionnelle a jugé que le pouvoir de grâce présidentielle répond à des finalités purement humanitaires et sert à tempérer la rigidité de la loi pénale. Quant aux demandes de suspension de la peine pour raisons de santé, elles correspondent à ce que la Cour a défini comme « un réexamen limité à des motifs d’humanité » (Hutchinson, précité, § 43, Vinter, précité, § 127, et Matiošaitis et autres, précité, § 173).
135. Par ailleurs, la Cour prend note de l’assertion du requérant selon laquelle aucun détenu condamné à la perpétuité disciplinée par l’article 4 bis n’a jamais bénéficié d’une décision de grâce présidentielle (paragraphe 74 ci‑dessus). À cet égard, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple d’un condamné à la peine de réclusion à perpétuité de ce type qui ait obtenu un aménagement de sa peine en vertu d’une grâce présidentielle (voir Bodein c. France, no 40014/10, § 59, 13 novembre 2014, et, a contrario, Kafkaris, précité, § 103).
Conclusion
136. La Cour tient à rappeler que la dignité humaine, qui se trouve au cœur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté (Vinter, précité, § 113).
137. Eu égard aux principes susmentionnés, et pour les raisons avancées ci-dessus, la Cour considère que la réclusion à perpétuité infligée au requérant, en application de l’article 4 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, dite « ergastolo ostativo », restreint excessivement la perspective d’élargissement de l’intéressé et la possibilité de réexamen de sa peine. Dès lors, cette peine perpétuelle ne peut pas être qualifiée de compressible aux fins de l’article 3 de la Convention. La Cour rejette ainsi l’exception du Gouvernement relative à la qualité de victime du requérant et conclut que les exigences de l’article 3 en la matière n’ont pas été respectées.
138. Cela étant, elle estime que le constat de violation prononcé dans la présente affaire ne saurait être compris comme donnant au requérant une perspective d’élargissement imminent (voir, parmi d’autres, Harakchiev et Tolumov, précité, § 268, et László Magyar, précité, § 59).
Petukhov c. Ukraine (no 2) du 12 mars 2019 requête n° 41216/13
Violation de l'article 3 : L’Ukraine doit réformer son système de contrôle des peines de perpétuité réelle.
L'arrêt concerne principalement le grief d’un détenu selon lequel le droit ukrainien ne prévoit pas de libération conditionnelle pour les condamnés à perpétuité. Le requérant, M. Petukhov, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité depuis 2004.
La Cour relève en particulier que les règles sur la grâce présidentielle, seule procédure permettant d’alléger une peine d’emprisonnement à vie en Ukraine, ne sont pas claires et ne prévoient pas de garanties procédurales adéquates contre les abus. En outre, les conditions de détention des condamnés à perpétuité en Ukraine sont telles qu’il est impossible à ceux-ci de progresser sur la voie de l’amendement, et donc impossible aux autorités d’effectuer un véritable réexamen de leur peine. Eu égard au caractère systémique de ce problème, la Cour, sur le terrain de l’article 46 (exécution), dit que l’Ukraine doit réformer son système de réexamen des peines de perpétuité réelle en recherchant dans chaque cas si le maintien en détention est justifié et en permettant aux condamnés à une peine de perpétuité réelle de savoir ce qu’ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d’un élargissement et quelles sont les conditions applicables.
LES FAITS
Le requérant, Volodymyr Petukhov, est un ressortissant ukrainien né en 1973. Condamné en 2004 pour un certain nombre d’infractions graves liées au crime organisé, il purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie. Entre 2010 et 2014, souffrant de tuberculose, il fut examiné régulièrement par des médecins et fit l’objet de divers tests de dépistage et analyses. À la suite d’une rechute en juillet 2010, il fut transféré dans un hôpital pénitentiaire de Kherson spécialisé dans le traitement de la tuberculose. Il fut reconnu invalide au troisième degré (niveau le plus bas) en raison de sa tuberculose et d’autres problèmes de santé. Par la suite, sa tuberculose s’étendit à d’autres organes que les poumons, de sorte qu’en 2011 les médecins diagnostiquèrent chez lui une tuberculose génito-urinaire. En 2013, il apprit qu’il avait développé une résistance à la plupart des médicaments antituberculeux et fut placé en soins palliatifs. Son état de santé se stabilisa et, en 2015, il fut transféré au centre de détention provisoire de Kyiv, où il continue de purger sa peine.
Il se plaignit auprès des autorités pénitentiaires du caractère selon lui inadéquat des soins médicaux reçus pendant cette période, en particulier de la pénurie frappant les médicaments dont il avait besoin. En réponse, les autorités pénitentiaires reconnurent (en 2010, 2011 et 2012) qu’il y avait une pénurie de médicaments antituberculeux à l’hôpital pénitentiaire de Kherson. Par ailleurs, de 2010 à 2015, M. Petukhov adressa en vain plusieurs plaintes aux autorités pénitentiaires et de poursuite, ainsi qu’au commissaire parlementaire pour les droits de l’homme, affirmant avoir subi des conditions de détention déplorables à l’hôpital pénitentiaire ainsi que dans une autre structure de Kherson où il avait été détenu pendant quelques mois en 2014. La Cour a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans une autre requête introduite par M. Petukhov (no 43374/02), concernant l’insuffisance des soins médicaux reçus pendant une période de détention non couverte par la présente affaire, c’est-à-dire avant juillet 2010 (date de son transfert à l’hôpital pénitentiaire de Kherson).
Article 3 (soins médicaux en détention)
La Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel l’état de santé de M. Petukhov était satisfaisant. Au contraire, sa tuberculose s’est aggravée de manière irréversible pendant sa détention, jusqu’à devenir « incurable » en 2013, lorsqu’il a développé une résistance à la plupart des médicaments antituberculeux.
Concernant l’hôpital pénitentiaire, les autorités ont même reconnu plusieurs fois une pénurie de médicaments antituberculeux. De plus, M. Petukhov s’est vu administrer un médicament utilisé en soins palliatifs, de l’isoniazide, alors qu’il avait développé une résistance à celui-ci, ce qui a rendu ce traitement inefficace, voire toxique.
Pour ce qui est de la structure où M. Petukhov est actuellement détenu, le Gouvernement n’a pas établi que des dispositions médicales particulières auraient été prises pour l’intéressé. Eu égard à un certain nombre d’autres requêtes contre l’Ukraine dans lesquelles elle a déjà relevé l’existence de soins médicaux inadéquats pour la tuberculose, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du fait que, depuis son transfert à l’hôpital pénitentiaire en juillet 2010, les autorités n’ont pas protégé la santé de M. Petukhov en détention.
Article 3 (peines de perpétuité réelle)
La Cour rappelle que, pour être compatible avec l’article 3, une peine d’emprisonnement à vie doit offrir une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen. En Ukraine, la grâce présidentielle est la seule possibilité d’allègement d’une peine d’emprisonnement à vie. Les orientations figurant dans les règles relatives à cette procédure indiquent que les condamnés à perpétuité « peuvent bénéficier d’une grâce à titre exceptionnel et dans des circonstances extraordinaires », mais ne donnent aucune explication sur la signification exacte de ces termes. Les condamnés à une peine de perpétuité réelle ne savent donc pas au départ ce qu’ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d’un élargissement et quelles sont les conditions applicables. En outre, ce système ne comporte pas de garanties procédurales adéquates contre les abus. Ni la commission de grâce ni le président n’ont besoin de justifier leurs décisions concernant les demandes de grâce. La rédaction de rapports sur les activités des organes chargés de la grâce permettrait de compenser ce défaut de transparence ; or, à l’exception d’un point presse isolé tenu en 2016, aucune information de ce type n’a été rendue publique en Ukraine. Cette situation est encore aggravée par l’absence de contrôle juridictionnel. De plus, pour que le réexamen d’une peine d’emprisonnement à vie soit réellement capable d’aboutir à une commutation, une remise ou une levée de peine, ou à une libération conditionnelle, les États sont tenus de faire en sorte que les condamnés à perpétuité aient la possibilité de s’amender. Or le Gouvernement n’a pas expliqué de quelle manière les condamnés à perpétuité peuvent progresser sur la voie de l’amendement alors qu’ils sont séparés des autres détenus et passent jusqu’à 23 heures par jour dans leur cellule, en ayant peu d’activités organisées. En conséquence, la Cour considère que le régime actuellement appliqué aux condamnés à perpétuité en Ukraine est incompatible avec l’objectif de l’amendement. En pratique, les chances pour un condamné à perpétuité d’obtenir une grâce sont négligeables. Depuis l’instauration en 2000 de la peine d’emprisonnement à vie, une seule demande de grâce formée par un condamné à perpétuité a été accueillie. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 3, M. Petukhov n’ayant pas de persp
BOLTAN c. TURQUIE du 12 février 2019 requête n° 33056/16
Violation de 3 : une condamnation à perpétuité d'un terroriste kurde n'est pas justifiée par une prétendue dangerosité à perpétuité
2. Sur la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée infligée au requérant
38. Le requérant soutient que sa condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il se réfère aux arrêts Öcalan c. Turquie (no 2) (nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, §§ 62-71, 18 mars 2014), Vinter et autres c. Royaume-Uni ([GC], nos 66069/09 et 2 autres, CEDH 2013 (extraits)), et Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, CEDH 2014 (extraits)).
39. Le Gouvernement conteste cette thèse, et il indique que l’article 104 de la Constitution turque prévoit que la grâce présidentielle peut être accordée pour cause de maladie chronique, de handicap ou de vieillesse à tout condamné.
40. La Cour rappelle avoir déjà dit qu’une peine perpétuelle incompressible est contraire à l’article 3 de la Convention (Vinter et autres précité, §§ 107-131, Harakchiev et Tolumov précité, §§ 247-268, Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, §§ 99-104, 26 avril 2016, et Matiošaitis et autres c. Lituanie, nos 22662/13 et 7 autres, §§ 156-183, 23 mai 2017 ; pour un contexte similaire, voir l’affaire T.P. et A.T c. Hongrie, nos 37871/14 et 73986/14, 4 octobre 2016, où la réclusion à perpétuité était l’objet d’un réexamen automatique au bout de quarante ans (violation) ; voir également Hutchinson c. Royaume-Uni [GC], no 57592/08, §§ 37-73, 17 janvier 2017).
41. S’agissant de la question de la grâce présidentielle évoquée par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà jugé que la libération pour motifs humanitaires ne correspond pas à la notion de « perspective d’élargissement » pour des motifs légitimes d’ordre pénologique (Vinter et autres, précité, § 129, Öcalan (no 2) précité, § 203, et László Magyar c. Hongrie, no 73593/10, §§ 55-58, 20 mai 2014). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
42. Sur la question de savoir si la réclusion criminelle à perpétuité aggravée en droit turc est compatible avec l’article 3 de la Convention, la Cour renvoie à ses arrêts Öcalan (no 2) (précité, §§ 193-207), Kaytan c. Turquie (no 27422/05, §§ 63-68, 15 septembre 2015) et Gurban c. Turquie (no 4947/04, §§ 30-35, 15 décembre 2015), et elle conclut, en l’espèce, à la violation de l’article 3 de la Convention pour les mêmes motifs, car elle ne constate aucun élément ou argument nécessitant d’examiner plus avant le grief (comparer avec Bodein c. France, no 40014/10, §§ 53-62, 13 novembre 2014, affaire dans laquelle la condamnation du requérant à une peine perpétuelle, étant susceptible d’être réexaminée vingt-six ans après son prononcé, a été considérée conforme à la Convention, et Hutchinson précité, §§ 37-73).
43. La Cour souligne que ce constat de violation ne saurait être compris comme donnant au requérant une perspective d’élargissement imminent. Il incombe aux autorités nationales de vérifier, dans le cadre d’une procédure à établir par l’adoption d’instruments législatifs appropriés et en conformité avec les principes exposés par la Cour dans les paragraphes 111-113 de son arrêt Vinter et autres précité, si le maintien en détention du requérant se justifiera toujours après un délai minimum de détention, soit parce que les impératifs de répression et de dissuasion ne seront pas encore entièrement satisfaits, soit parce que le maintien en détention de l’intéressé sera justifié par des raisons de dangerosité (Öcalan (no 2), précité, § 207).
Grande Chambre HUCHINSON C. ROYAUME UNI du 17 janvier 2017, requête 57592/08
Non violation de l'article 3 : La procédure de réexamen des peines de perpétuité réelle au Royaume-Uni est conforme à la Convention. La Cour conclut que la peine de perpétuité réelle peut à présent être considérée comme compressible, en conformité avec l’article 3 de la Convention.
37. Dans leurs observations, les parties se sont concentrées uniquement sur le point de savoir si, à la lumière de la décision McLoughlin, la situation du requérant quant à sa peine de perpétuité réelle répondait à présent aux exigences de l’article 3 telles qu’exposées dans l’arrêt Vinter (précité, §§ 123–131). À cet égard, la Cour recherchera tout d’abord si l’imprécision du droit interne a été corrigée et, dans l’affirmative, si les exigences en question sont maintenant respectées en l’espèce. Elle n’examinera pas séparément la question d’une éventuelle violation de l’article 3 dans la période de détention du requérant antérieure à la décision McLoughlin.
1. Sur la question de savoir si le droit interne a été clarifié
38. Dans l’arrêt Vinter, la Cour a estimé qu’à la lumière de l’article 6 de la loi sur les droits de l’homme (paragraphe 14 ci-dessus), on pouvait voir dans l’article 30 de la loi de 1997 (paragraphe 15 ci-dessus) une obligation pour le ministre de libérer tout détenu purgeant une peine de perpétuité réelle dont le maintien en détention se révélerait incompatible avec l’article 3, par exemple parce qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permettrait plus de justifier cette mesure. Elle a relevé que c’était d’ailleurs la lecture de l’article 30 à laquelle la Cour d’appel s’était livrée dans ses arrêts Bieber et Oakes et qui serait, en principe, conforme aux exigences de l’article 3 telles que précisées dans l’affaire Kafkaris c. Chypre ([GC], no 21906/04, CEDH 2008). Cependant, outre la jurisprudence pertinente, la Cour a également eu égard aux ordonnances publiées et à l’application pratique de la législation aux détenus condamnés à la perpétuité réelle. Elle a estimé que la politique exposée par le ministre dans le manuel sur les peines de durée indéterminée (paragraphe 16 ci-dessus) était trop restrictive pour être conforme aux principes dégagés dans l’arrêt Kafkaris. Elle a ensuite souligné que le manuel sur les peines de durée indéterminée ne donnait aux détenus condamnés à la perpétuité réelle qu’une vue partielle des conditions dans lesquelles le pouvoir de libération pouvait être exercé. Elle a conclu que le contraste entre le libellé de l’article 30, interprété par les juridictions internes d’une manière conforme à la Convention, et les conditions restrictives figurant dans le manuel entraînait un tel manque de clarté du droit que les peines de perpétuité réelle ne pouvaient pas être qualifiées de compressibles aux fins de l’article 3 de la Convention.
39. Dans la décision McLoughlin, la Cour d’appel a répondu explicitement aux critiques exprimées dans l’arrêt Vinter. Elle a affirmé l’obligation légale pour le ministre d’exercer son pouvoir de libération d’une manière compatible avec l’article 3 de la Convention. Quant à la politique publiée, qu’elle a également considérée comme extrêmement restrictive (voir les paragraphes 11 et 32 de la décision McLoughlin, cités au paragraphe 19 ci-dessus), la Cour d’appel a précisé que le manuel sur les peines de durée indéterminée ne pouvait restreindre l’obligation pour le ministre d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes pour la libération au regard de l’article 30. Elle a ajouté que la politique publiée ne pouvait pas limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre en prenant en compte uniquement les considérations évoquées dans le manuel sur les peines de durée indéterminée. Elle a ensuite expliqué que le fait que les autorités n’avaient pas révisé la politique officielle pour l’aligner sur les dispositions légales et la jurisprudence pertinentes n’avait aucune conséquence du point de vue du droit interne.
40. La Cour estime que la Cour d’appel a clarifié le contenu du droit interne pertinent, et a gommé l’incohérence constatée dans l’arrêt Vinter. Quant à la possibilité d’abroger ou d’annuler la politique dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel envisagée dans l’arrêt Vinter (Vinter et autres, précité, § 129), la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le manuel sur les peines de durée indéterminée garde toute sa validité en cas de libération pour des motifs d’humanité (au sens étroit de ce terme). Ce qui importe, c’est que – comme la Cour d’appel l’a confirmé dans la décision McLoughlin – pareille situation soit uniquement l’une des circonstances dans lesquelles la libération d’un détenu peut, ou plutôt doit, être ordonnée (voir les paragraphes 32–33 de la décision McLoughlin, cités au paragraphe 19 ci-dessus).
41. Estimant que le droit interne applicable a été clarifié, la Cour se propose à présent d’en poursuivre l’analyse.
2. Sur la question de savoir si le droit interne répond aux exigences de l’article 3
a) Principes généraux dégagés par la Cour dans sa jurisprudence sur les peines perpétuelles
42. Les principes pertinents, et les conclusions à en tirer, sont exposés en détail dans l’arrêt Vinter (précité, § 103–122 ; ces principes ont été récemment résumés dans l’arrêt Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, §§ 99-100, CEDH 2016). La Convention n’interdit pas d’infliger une peine d’emprisonnement à vie à une personne convaincue d’une infraction particulièrement grave, telle le meurtre. Cependant, pour être compatible avec l’article 3, pareille peine doit être compressible de jure et de facto, c’est-à-dire qu’elle doit offrir une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen. Pareil réexamen doit notamment se fonder sur une évaluation du point de savoir si des motifs légitimes d’ordre pénologique justifient le maintien en détention du détenu. Les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion figurent au nombre de ces motifs. L’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, et peut évoluer au cours de l’exécution de la peine, de sorte que ce qui était la justification première de la détention au début de la peine ne le sera peut‑être plus une fois accomplie une bonne partie de celle-ci. La Cour a souligné l’importance de l’objectif de réinsertion, relevant que c’est sur cet objectif que les politiques pénales européennes mettent désormais l’accent, ainsi qu’il ressort de la pratique des États contractants, des normes pertinentes adoptées par le Conseil de l’Europe et des instruments internationaux applicables (Vinter et autres, précité, §§ 59‑81).
43. La Cour a récemment déclaré, dans le contexte de l’article 8 de la Convention, que « l’accent mis sur l’amendement et la réinsertion des détenus était à présent un élément que les États membres étaient tenus de prendre en compte dans l’élaboration de leurs politiques pénales ». (Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, § 121, CEDH 2015 ; voir également les affaires citées dans l’arrêt Murray, précité, § 102). Des considérations similaires doivent s’appliquer dans le contexte de l’article 3, eu égard au fait que le respect de la dignité humaine oblige les autorités pénitentiaires à œuvrer à la réinsertion des condamnés à perpétuité (Murray, précité, §§ 103-104). Il s’ensuit que le réexamen requis doit prendre en compte les progrès du détenu sur le chemin de l’amendement et déterminer si le détenu a fait des progrès tels qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie plus son maintien en détention (Vinter et autres, précité, §§ 113-116). Partant, un réexamen de la peine limité à des motifs d’humanité ne saurait suffire (ibidem, § 127).
44. Les critères et conditions énoncés dans le droit interne concernant le réexamen doivent avoir un degré suffisant de clarté et de certitude, et doivent aussi refléter la jurisprudence pertinente de la Cour. La certitude en la matière constitue non seulement une exigence générale de l’état de droit mais sous‑tend également le processus d’amendement qui risque d’être entravé si les modalités de réexamen des peines et les perspectives d’élargissement sont floues ou incertaines. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a donc le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et ce que sont les conditions applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité (Vinter et autres, précité, § 122). À cet égard, la Cour a constaté qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international une nette tendance en faveur de l’instauration d’un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après le prononcé de la peine perpétuelle, puis de réexamens périodiques par la suite (ibidem, §§ 68, 118, 119 et 120). Elle a cependant également indiqué qu’il s’agit là d’une question relevant de la marge d’appréciation à accorder aux États en matière de justice criminelle et de détermination des peines (ibidem, §§ 104, 105 et 120).
45. Quant à la nature du réexamen, la Cour a souligné qu’elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) qu’il doit prendre, eu égard à la marge d’appréciation qu’il convient d’accorder aux États contractants en la matière (Vinter et autres, précité, § 120). Il appartient donc à chaque État de décider si le réexamen des peines doit être conduit par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir judiciaire.
b) Application de ces principes
i. Nature du réexamen
46. En Angleterre et au pays de Galles, le réexamen des peines est confié au ministre, ce que le requérant juge par principe injustifié, arguant que ce réexamen devrait être de nature juridictionnelle. Il ajoute qu’il y a lieu de distinguer les mécanismes de grâce présidentielle du système interne, les présidents pouvant être considérés, de par la nature même de leurs fonctions, comme des personnalités non partisanes détachées du combat politique et donc moins exposées aux pressions de l’opinion publique. Pour le requérant, confier le réexamen des peines à un membre du gouvernement ne permet guère d’opérer une appréciation équitable, approfondie et cohérente des motifs de libération d’un détenu condamné à la perpétuité réelle.
47. La Cour observe qu’une procédure judiciaire s’accompagne de garanties importantes : l’indépendance et l’impartialité du décideur, des garanties procédurales et la protection contre l’arbitraire. Dans deux affaires, la Cour a jugé le droit interne conforme à l’article 3 de la Convention en raison de l’existence d’une procédure judiciaire de réexamen de la peine (Čačko c. Slovaquie, no 49905/08, 22 juillet 2014 et Bodein c. France, no 40014/10, 13 novembre 2014).
48. Dans l’arrêt Bodein (précité, § 59), la Cour a exclu de son examen le pouvoir de grâce présidentielle. De même, elle a estimé que des systèmes similaires en Hongrie et en Bulgarie ne répondaient pas à la norme requise (László Magyar c. Hongrie, no 73593/10, 20 mai 2014, et Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, CEDH 2014 (extraits), où il était question du système de grâce présidentielle en vigueur jusqu’en janvier 2012). Cependant, c’est en raison de diverses lacunes dans les procédures et non en raison de la nature exécutive du réexamen en tant que tel que les États en question se sont vu reprocher une violation de l’article 3. De plus, dans l’affaire László Magyar, la Cour a formulé des suggestions concernant les mesures à prendre aux fins de l’exécution de l’arrêt mais n’a pas donné à entendre qu’un mécanisme judiciaire était requis (paragraphe 71 de cet arrêt ; voir, dans le même sens, Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 207, 18 mars 2014).
49. L’appréciation par la Cour des systèmes chypriote et bulgare montre qu’un réexamen par l’exécutif peut satisfaire aux exigences de l’article 3. En ce qui concerne la situation à Chypre, le pouvoir du président chypriote a été jugé suffisant à la lumière de la pratique suivie (Kafkaris, précité, §§ 102–103). Quant au système bulgare, la Cour a estimé qu’à la suite d’une réforme intervenue en 2012 le pouvoir conféré au président bulgare était en conformité avec l’article 3 (Harakchiev et Tolumov, précité, §§ 257–261). La Cour relève à cet égard que les normes européennes pertinentes n’excluent pas un réexamen par l’exécutif mais indiquent que les décisions de libération conditionnelle devraient être prises par des « autorités établies par disposition légale » (paragraphe 32 de de la Recommandation Rec(2003)22, cité au paragraphe 20 ci-dessus).
50. Il ressort donc clairement de la jurisprudence que la nature exécutive d’un réexamen n’est pas en soi contraire aux exigences de l’article 3. La Cour ne voit aucune raison de conclure autrement.
51. Quant aux critiques formulées par le requérant à l’égard du système interne, la Cour estime qu’elles sont neutralisées par l’effet de la loi sur les droits de l’homme. Comme il a été rappelé au paragraphe 29 de la décision McLoughlin (paragraphe 19 ci-dessus), le ministre est tenu par l’article 6 de cette loi d’exercer son pouvoir d’élargissement d’une manière compatible avec les droits reconnus par la Convention. Il doit avoir égard à la jurisprudence pertinente de la Cour et motiver chacune de ses décisions en la matière. Le pouvoir ou, selon les circonstances, le devoir du ministre de libérer un détenu pour des motifs d’humanité ne saurait être assimilé aux larges prérogatives discrétionnaires conférées au chef d’État dans d’autres ordres juridiques et qui a été jugé insuffisant aux fins de l’article 3 dans les affaires évoquées ci-dessus.
52. De plus, les décisions du ministre concernant les demandes de libération sont soumises au contrôle des juridictions internes, qui sont elles‑mêmes tenues par la même obligation d’agir d’une manière compatible avec les droits consacrés par la Convention. La Cour prend note à cet égard de la déclaration du Gouvernement selon laquelle le contrôle juridictionnel d’un refus du ministre de libérer un détenu ne se limiterait pas à des motifs formels ou procéduraux mais impliquerait également un examen au fond. Ainsi, la High Court aurait le pouvoir d’ordonner directement la libération du détenu si elle le jugeait nécessaire pour se conformer à l’article 3 (paragraphe 26 ci-dessus).
53. Si la Cour ne dispose d’aucun exemple de contrôle juridictionnel relatif à une décision du ministre refusant de libérer un détenu condamné à perpétuité, elle estime néanmoins qu’une garantie judiciaire importante a été mise en place (E. c. Norvège, 29 août 1990, § 60, série A no 181‑A). L’absence de pratique à ce jour, qui n’est pas surprenante eu égard à la période relativement brève qui s’est écoulée depuis la décision McLoughlin, ne joue pas nécessairement contre le système interne, de même qu’elle n’a pas joué contre les systèmes slovaque et français, qui ont tous deux été jugés conformes à l’article 3 sans qu’il fût fait référence à une quelconque pratique judiciaire (voir, en particulier, Bodein, § 60).
ii. Portée du réexamen
54. Dans la décision McLoughlin, la Cour d’appel, à l’instar de la Cour dans son arrêt Vinter, a jugé que la politique énoncée dans le manuel sur les peines de durée indéterminée était extrêmement restrictive. Elle a réitéré la position qu’elle avait exprimée dans l’arrêt Bieber, à savoir que le ministre devait exercer son pouvoir de libération de manière compatible avec les principes du droit administratif interne et avec l’article 3 de la Convention (voir, respectivement, les paragraphes 32 et 29 de la décision McLoughlin, cités au paragraphe 19 ci-dessus).
55. Ensuite, et surtout, elle a précisé, eu égard à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Vinter, que les « circonstances exceptionnelles » visées à l’article 30 ne pouvaient être juridiquement limitées aux situations de fin de vie prévues par le manuel sur les peines de durée indéterminée (paragraphe 16 ci-dessus), mais qu’elles devaient inclure toutes les circonstances exceptionnelles pertinentes pour une libération pour des motifs d’humanité. Tout en s’abstenant de préciser plus avant le sens de l’expression « circonstances exceptionnelles » dans ce contexte, ou de fixer des critères, la Cour d’appel a rappelé la jurisprudence interne antérieure selon laquelle les progrès exceptionnels accomplis par un détenu pendant son séjour en prison devaient être pris en compte (Lord Chief Justice Bingham en 1998 dans l’affaire R. v. Home Secretary ex parte Hindley ; voir également Lord Steyn dans la même affaire, lorsque celle-ci a été tranchée par la Chambre des lords en 2001 – paragraphe 19 ci-dessus). La Cour relève également que dans l’affaire Bieber, la Cour d’appel, expliquant à quel moment l’infliction de la perpétuité réelle pouvait être contestée sur le fondement de l’article 3, a évoqué « l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment [le] temps passé et [l]es progrès accomplis en prison » (passage reproduit dans l’arrêt Vinter et autres, précité, § 49). Eu égard à l’ensemble de ces dicta, le droit établi en Angleterre et au pays de Galles consacre à l’évidence l’idée que des progrès exceptionnels accomplis par un détenu sur le chemin de l’amendement sont couverts par le libellé de la loi et constituent donc un motif de réexamen.
56. Quant à l’autre expression utilisée à l’article 30, « motifs d’humanité », l’arrêt de la Cour d’appel, qui précisait qu’elle ne se limitait pas aux motifs humanitaires mais avait une acception large (paragraphe 33 de la décision McLoughlin, repris au paragraphe 19 ci-dessus), a là aussi corrigé l’interprétation étroite donnée à cette expression dans le manuel sur les peines de durée indéterminée pour la mettre en conformité avec l’article 3 (paragraphe 33 de la décision McLoughlin, repris au paragraphe 19 ci‑dessus). À cet égard également, la loi sur les droits de l’homme joue un rôle important, son article 3 exigeant que la législation soit interprétée et mise en œuvre par l’ensemble des autorités publiques d’une manière compatible avec la Convention.
57. Ces précisions suffisent à la Cour pour conclure à l’existence d’un réexamen par une autorité qui a non seulement le pouvoir mais également l’obligation de considérer si, à la lumière d’un changement significatif chez un détenu condamné à la perpétuité réelle et de l’accomplissement par celui‑ci de progrès sur le chemin de l’amendement, des motifs légitimes d’ordre pénologique permettent toujours de justifier son maintien en détention (Vinter et autres, précité, § 125).
iii. Critères et modalités du réexamen
58. La Cour doit ensuite examiner les critères et les modalités du réexamen des peines de perpétuité réelle. Dans la décision McLoughlin, la Cour d’appel n’a pas précisé la signification de l’expression « circonstances exceptionnelles », jugeant la notion suffisamment certaine en soi. Le requérant est critique à ce propos, alléguant qu’il reste de ce fait dans l’incertitude. Le Gouvernement estime que les choses sont suffisamment claires, et qu’il n’était ni possible ni réalisable d’apporter davantage de précision. Comme la Cour l’a déjà relevé ci-dessus, l’expression « circonstances exceptionnelles » s’étend aux progrès accomplis par le détenu concerné au cours de sa peine (paragraphe 55 ci-dessus). La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si un détenu purgeant une peine perpétuelle dans le système national sait ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions il peut obtenir un réexamen de sa peine (Vinter et autres, précité, § 122 ; voir également le paragraphe 18 de la Recommandation Rec(2003)22 et la règle 30.3 des Règles pénitentiaires européennes, cités aux paragraphes 20 et 21 ci‑dessus).
59. Les deux parties ont invoqué des affaires examinées par des chambres de la Cour postérieurement à l’arrêt Vinter. Ces arrêts sont effectivement pertinents en l’espèce, en ce qu’ils illustrent l’application par la Cour de la jurisprudence Vinter. Dans l’affaire Lásló Magyar, c’est le manque d’indications précises quant aux critères et modalités de collecte et d’évaluation des « renseignements personnels » du détenu que la Cour a critiqué. Elle a estimé dans cette affaire que, le pouvoir exécutif n’ayant aucune obligation de motiver ses décisions, il en découlait que les détenus ne savaient pas ce que l’on attendait d’eux pour que leur libération pût être envisagée (Lásló Magyar, précité, §§ 57–58). Dans le cadre de l’article 46, elle a appelé les autorités nationales à procéder à une réforme prévoyant le réexamen requis et assurant que les détenus condamnés à perpétuité sachent « avec un certain degré de précision » ce qu’ils doivent faire (Lásló Magyar, précité, § 71). Dans l’affaire Harakchiev et Tolumov, la Cour a critiqué le système tel qu’il se présentait avant 2012 en raison de son opacité, de l’absence de déclarations politiques accessibles au public, du défaut de motivation des décisions de grâce individuelles ainsi que du défaut total de garanties formelles et informelles (Harakchiev et Tolumov, précité, § 262). Dans une autre affaire (Trabelsi c. Belgique, no 140/10, CEDH 2014 (extraits)), la chambre a fondé son constat de violation de l’article 3 sur l’absence de mécanisme de réexamen des peines opérant sur la base de « critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle » (§ 137). Le requérant en l’espèce a tout particulièrement tiré argument de ce constat. La Cour observe que si les formulations employées dans ces arrêts varient quelque peu, on retrouve dans chacun d’eux le même point essentiel, à savoir que les critères et modalités du système de réexamen des peines doivent présenter un certain degré de spécificité ou de précision, en conformité avec l’impératif général de sécurité juridique.
60. Il convient également d’avoir égard aux affaires post-Vinter dans lesquelles la Cour a conclu que le système interne répondait aux exigences de l’article 3 quant à la compressibilité des peines perpétuelles. Ces arrêts, au nombre de trois, démontrent qu’un degré élevé de précision n’est pas requis pour que le système concerné soit jugé conforme à la Convention.
61. Dans la première de ces affaires, Harakchiev et Tolumov, la Cour a estimé qu’à compter de 2012 les modalités d’exercice du droit de grâce présidentielle étaient suffisamment claires. Bien que, en raison de sa nature même, la procédure ne fût pas assortie de critères légaux, la Cour constitutionnelle a tiré des principes directeurs des valeurs constitutionnelles, à savoir « l’équité, l’humanité, la compassion, la pitié, ainsi que l’état de santé et la situation familiale du condamné, et tous les changements positifs de sa personnalité » (Harakchiev et Tolumov, précité, § 258). Seul ce dernier élément a trait aux progrès accomplis par le détenu. La Cour a relevé que si la procédure ne prévoyait pas la motivation des décisions dans les cas individuels, la transparence était néanmoins assurée par d’autres moyens. Elle a noté que la commission de grâce, instaurée pour émettre des recommandations sur les demandes de grâce, fonctionnait conformément à des règles de procédure publiées, lesquelles exigeaient la prise en compte de la jurisprudence pertinente des juridictions internationales sur l’interprétation et l’application des instruments internationaux de protection des droits de l’homme applicables. Elle a ajouté que la commission était tenue en vertu de ses règles de procédure de publier des rapports d’activité, ce qu’elle faisait sur une base mensuelle et annuelle, dans lesquels elle donnait des précisions sur les critères qui la guidaient dans l’examen des demandes de grâce, les motifs des recommandations adressées par elle au vice-président et les décisions de celui-ci sur ces demandes (ibidem, §§ 90-107). Elle a estimé que ces mesures avaient accru la transparence de la procédure de grâce et constituaient une autre garantie d’un exercice cohérent et transparent des pouvoirs présidentiels à cet égard (ibidem, § 259).
62. Dans l’affaire Čačko, la Cour a relevé que, pour prétendre à une libération anticipée, le détenu devait « avoir démontré, par l’accomplissement de ses obligations et par son bon comportement, qu’il s’était amendé » et que « l’on [pouvait] attendre de lui qu’il se conduis[ît] bien à l’avenir » (Čačko, précité, § 43). Dans l’affaire Bodein, elle a noté que le réexamen en droit français se fondait sur la dangerosité du détenu et sur l’évolution de sa personnalité au cours de l’exécution de sa peine (Bodein, précité, § 60).
63. En l’espèce, sur ce point précis, la Cour n’estime pas le système national défaillant, et ce pour deux raisons étroitement liées. Premièrement, il découle clairement de la décision McLoughlin et des dispositions de la loi sur les droits de l’homme que l’exercice du pouvoir conféré par l’article 30 doit être guidé par l’ensemble de la jurisprudence pertinente de la Cour en son état actuel et telle qu’elle sera développée ou précisée à l’avenir. En rappelant ci-dessus sa jurisprudence pertinente, la Cour entend aider le ministre et les juridictions nationales à s’acquitter de leur obligation légale d’agir d’une manière compatible avec la Convention dans ce domaine.
64. Deuxièmement, ainsi que la Cour d’appel l’a déclaré et que la chambre l’a admis, on peut s’attendre à ce que la pratique permette de préciser encore la signification concrète du libellé de l’article 30. L’obligation pour le ministre de motiver chacune de ses décisions, sous le contrôle des juridictions nationales, revêt de l’importance à cet égard, et permet de garantir un exercice cohérent et transparent du pouvoir d’élargissement.
65. La Cour juge cependant opportun d’ajouter qu’il serait souhaitable de réviser le manuel sur les peines de durée indéterminée (ainsi que d’autres sources d’information officielles) pour mettre ces textes en adéquation avec le droit tel qu’il a été clarifié par la Cour d’appel et avec la jurisprudence pertinente relative à l’article 3 de la Convention, de manière à ce que les règles applicables en la matière soient immédiatement accessibles. La Cour renvoie de nouveau aux normes pertinentes définies par le Conseil de l’Europe (paragraphe 18 de la Recommandation Rec(2003)22, cité au paragraphe 20 ci-dessus).
iv. Moment du réexamen
66. Le moment du réexamen de la peine constitue un aspect particulier de la sécurité juridique, la Cour ayant déclaré dans l’arrêt Vinter qu’un détenu ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité avec l’article 3 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus).
67. En règle générale, l’existence d’un réexamen automatique de la peine après une période minimale définie représente pour le détenu une garantie importante contre le risque d’une détention contraire à l’article 3. La Cour renvoie à cet égard à l’affaire Öcalan (no 2), dans laquelle elle a estimé qu’à l’évidence le droit interne n’offrait au requérant aucune possibilité de demander à quelque moment que ce fût le réexamen de sa peine de réclusion à perpétuité aggravée pour des motifs légitimes d’ordre pénologique. Elle a donc appelé les autorités turques à mettre en place une procédure permettant de vérifier si le maintien en détention du requérant se justifierait toujours après un délai minimum de détention (Öcalan (no 2), précité, §§ 204 et 207). En l’espèce, le système interne est différent, en ce que le processus de réexamen peut être initié par le détenu à tout moment. La Cour rappelle qu’elle a examiné un mécanisme similaire à Chypre, où les détenus condamnés à perpétuité pouvaient obtenir le bénéfice des dispositions pertinentes à tout moment sans avoir à purger une période de sûreté (Kafkaris, précité, § 103). Cela peut être vu comme étant dans l’intérêt des détenus, puisqu’ils n’ont pas à attendre pendant un nombre déterminé d’années pour bénéficier d’un premier réexamen ou de réexamens ultérieurs. Eu égard à l’extrême gravité des crimes commis par les personnes relevant de cette catégorie, il y a cependant lieu de s’attendre à ce qu’elles purgent une longue période de détention.
68. Dans deux des affaires postérieures à l’arrêt Vinter qui ont fait l’objet d’un arrêt de la Cour, le système national prévoyait un réexamen de la peine après une période déterminée – vingt-cinq ans dans l’affaire Čačko et trente dans l’affaire Bodein (vingt-six ans en réalité dans le cas du requérant). Cependant, dans l’affaire Harakchiev et Tolumov, le système interne tel qu’il se présentait postérieurement aux réformes de 2012 ne prévoyait pas un délai précis pour le réexamen des peines. Par ailleurs, dans l’affaire László Magyar, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 et a donné des indications en vertu de l’article 46 quant aux mesures nécessaires, sans aborder la question du moment du réexamen sous l’angle de l’une ou l’autre de ces dispositions.
69. Quant aux faits de la présente affaire, la Cour estime qu’on ne saurait dire que les préoccupations exprimées dans l’arrêt Vinter tenant à l’absence de calendrier et à ses conséquences pour un détenu condamné à une peine de perpétuité réelle (Vinter et autres, précité, § 122) valent également pour le requérant en l’espèce. Aux termes de l’article 30 de la loi de 1997, le ministre peut ordonner sa libération « à tout moment ». Partant, ainsi que le Gouvernement l’a confirmé, il est loisible au requérant de demander à tout moment un réexamen de sa peine par le ministre. Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le degré d’efficacité généralement atteint en pratique par un tel système, réglementé a minima. C’est la situation particulière du requérant qui est en jeu en l’espèce, et celui-ci n’a en rien insinué qu’on l’avait empêché ou dissuadé de demander à tout moment au ministre d’envisager sa libération. Avant de conclure, la Cour renvoie cependant de nouveau, comme elle l’a fait dans l’affaire Vinter, aux éléments pertinents de droit comparé et de droit international d’où se dégage « une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite » (Vinter et autres, précité, § 120 ; voir, plus récemment et dans le même sens, Murray, précité, § 99).
v. Conclusion
70. La Cour estime que la décision McLoughlin a permis de remédier au manque de clarté du droit interne constaté dans l’arrêt Vinter, qui découlait de l’incohérence dans le système national entre le droit applicable et la politique officielle publiée. De plus, la Cour d’appel a donné des précisions quant à la portée, aux critères et aux modalités du réexamen par le ministre, ainsi qu’à l’obligation pour celui-ci de libérer un détenu condamné à une peine de perpétuité réelle dont le maintien en détention ne peut plus se justifier par des motifs légitimes d’ordre pénologique. De ce fait, le système interne, fondé sur des textes législatifs (la loi de 1997 et la loi sur les droits de l’homme), la jurisprudence (des juridictions internes et de la Cour) et la politique officielle publiée (le manuel sur les peines de durée indéterminée), ne présente plus le contraste que la Cour avait relevé dans l’arrêt Vinter et autres (précité, § 130). La pratique interne pourra définir de manière plus précise les circonstances dans lesquelles un détenu condamné à une peine de perpétuité réelle peut demander sa libération, sur la base de motifs légitimes d’ordre pénologique justifiant la détention. L’obligation légale pour les juridictions nationales de prendre en compte la jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention, telle qu’elle pourrait se développer à l’avenir, représente une garantie additionnelle importante.
71. Comme la Cour l’a souvent dit, ce sont les autorités nationales qui sont responsables au premier chef de la protection des droits reconnus par la Convention (voir, par exemple, O.H. c. Allemagne, no 4646/08, § 118, 24 novembre 2011). Pour la Cour, la Cour d’appel a tiré les conclusions nécessaires de l’arrêt Vinter et, en clarifiant le droit interne, a remédié à la cause de la violation de la Convention (voir également Kronfeldner c. Allemagne, no 21906/09, § 59, 19 janvier 2012).
72. La Cour conclut que la peine de perpétuité réelle peut à présent être considérée comme compressible, en conformité avec l’article 3 de la Convention.
73. Ainsi qu’elle l’a indiqué d’emblée (paragraphe 37 ci-dessus), eu égard au fait que les observations des parties se sont limitées à l’état actuel du droit interne, la Cour juge inutile d’examiner séparément si la situation du requérant dans la période antérieure à la décision Loughlin répondait aux exigences de l’article 3 relativement aux peines de perpétuité réelles, telles qu’exposées dans l’arrêt Vinter. Elle observe néanmoins que, comme le Gouvernement l’avait en fait lui-même reconnu avant que la Cour d’appel ne rendît sa décision dans l’affaire McLoughlin, les circonstances matérielles entourant la peine de perpétuité réelle infligée au requérant en l’espèce étaient alors identiques à celles des requérants en l’affaire Vinter (paragraphe 23 ci-dessus).
HUCHINSON C. ROYAUME UNI du 3 février 2015, requête 57592/08
non violation de l'article 3, la peine de perpétuité réelle en droit britannique, soumise à contrôle, est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans son arrêt de Grande Chambre en l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni (requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10) du 9 juillet 2013, la Cour avait dit que le droit britannique régissant le pouvoir pour le ministre de la Justice de mettre en liberté les détenus condamnés à une peine de réclusion à perpétuité n’était pas clair. En outre, avant l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur la justice pénale, la nécessité de la perpétuité réelle était automatiquement réexaminée par le ministre au bout de 25 ans d’emprisonnement. Ce système fut supprimé en 2003 et aucun autre mécanisme de contrôle ne fut mis en place. Dans ces conditions, la Cour avait estimé que les peines de perpétuité réelle infligées aux requérants dans cette affaire n’étaient pas compatibles avec la Convention.
M. Hutchinson estime son cas comparable à l’affaire Vinter et autres, dans laquelle la Cour a constaté une violation de l’article 3. Cependant, le gouvernement britannique souligne que, dans un arrêt rendu le 10 février 2003, la Cour d’appel, dans une autre affaire (R v. Newell; R v. McLoughlin), a dit que les peines de perpétuité réelle font l’objet d’un contrôle en droit national et sont donc compatibles avec l’article 3.
La Cour relève que le différend opposant les parties est axé sur la question de savoir si la faculté offerte au ministre de la Justice par la loi de 2003 de libérer un détenu condamné à la perpétuité réelle suffit à rendre cette peine juridiquement et concrètement compressible.
La Cour estime que l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire R v. Newell; R v. McLoughlin a bel et bien répondu expressément aux préoccupations exprimées par la Cour dans l’arrêt Vinter et autres. En particulier, la Cour d’appel a souligné que, si un détenu condamné à la perpétuité peut établir que des « circonstances exceptionnelles » sont apparues postérieurement à l’imposition de sa peine, le ministre de la Justice doit examiner – d’une manière compatible avec l’article 3 de la Convention – si ces circonstances justifient la libération. La décision que prend le ministre doit alors être motivée par les circonstances du cas d’espèce et peut être attaquée devant le juge. Depuis l’arrêt R v. Newell; R v. McLoughlin, le droit britannique offre donc aux détenus de ce type un espoir et une possibilité de libération si les circonstances font que la peine n’est plus justifiée.
La Cour souligne que c’est au premier chef aux juridictions nationales qu’il revient de trancher les problèmes d’interprétation du droit interne. Le juge britannique ayant expressément répondu aux interrogations de la Cour et exposé clairement l’état du droit, elle considère que le pouvoir permettant au ministre de la Justice de libérer un détenu condamné à la perpétuité suffit à respecter les exigences de l’article 3. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.
T.P. et A.T. c. Hongrie du 4 octobre 2016, requêtes nos 37871/14 et 73986/14
Violation de l'article 3 : La nouvelle législation hongroise sur le réexamen des peines de réclusion à perpétuité n’est pas compatible avec la Convention européenne.
La Cour rappelle qu’en mai 2014, dans l’affaire László Magyar c. Hongrie (no 73593/10), elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention parce que la grâce présidentielle – qui constituait alors la seule possibilité de remise en liberté pour un détenu condamné à une peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle – ne permettait pas aux condamnés à perpétuité de savoir ce qu’ils devaient faire pour que leur libération puisse être envisagée et à quelles conditions.
Par ailleurs, la loi ne garantissait pas une prise en compte adéquate de l’évolution des condamnés à perpétuité et de leurs progrès sur la voie de l’amendement. Pour se conformer aux conclusions formulées dans cette affaire, l’État a adopté de nouvelles dispositions législatives qui ont mis en place un réexamen automatique des peines perpétuelles – une procédure obligatoire de recours en grâce – une fois que le condamné a purgé 40 ans de sa peine. La Cour estime néanmoins trop longue une période d’attente de 40 ans avant qu’un détenu puisse pour la première fois espérer qu’une mesure de clémence soit envisagée dans son cas. Une telle période est en effet nettement plus longue que l’intervalle maximal recommandé – 25 ans – pour le réexamen des peines perpétuelles, comme la Cour l’a établi dans un précédent arrêt, Vinter et autres c. Royaume-Uni (requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10), sur le fondement d’un consensus qui ressortait du droit comparé et du droit international.
De plus, une période d’attente aussi longue ne relève pas de la marge de manœuvre acceptable (« marge d’appréciation ») dont jouissent les États pour se prononcer sur les questions relevant de la justice pénale et de la fixation des peines.
En outre, la Cour exprime certaines préoccupations concernant le reste de la procédure prévue par les nouvelles dispositions législatives.
En premier lieu, si la nouvelle législation expose les critères objectifs et prédéfinis que doit prendre en compte la commission des grâces pour décider s’il y a lieu ou non de recommander une mesure de grâce pour un détenu condamné à perpétuité, ces critères ne s’appliquent pas au président de la Hongrie, lequel a le dernier mot quant à l’octroi d’une éventuelle mesure de grâce dans tel ou tel cas. En d’autres termes, la nouvelle législation n’oblige pas le président à déterminer si le maintien en prison est justifié.
En second lieu, la nouvelle législation n’a pas imparti de délai au président pour se prononcer sur la demande de mesures de clémence et ne l’oblige pas à motiver sa décision, même si elle s’écarte de la recommandation formulée par la commission des grâces.
La Cour n’est donc pas convaincue qu’à l’heure actuelle les peines de réclusion à perpétuité prononcées contre les requérants puissent passer pour leur offrir la perspective d’une libération ou une possibilité de réexamen. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Grande Chambre Murray c. Pays Bas, Arrêt du 26 avril 2016 requête n° 10511/10
Violation de l'article 3 : Resté des décennies sans bénéficier d’un traitement, un détenu à vie atteint d’une maladie mentale a été privé de toute perspective réaliste de libération
1. Les principes pertinents
a) Les peines perpétuelles
99. Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, le prononcé d’une peine d’emprisonnement à vie à l’encontre d’un délinquant adulte n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ou une autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci (Kafkaris, précité, § 97, et les références qui y sont mentionnées), à condition qu’elle ne soit pas nettement disproportionnée (Vinter et autres, précité, § 102). La Cour a néanmoins estimé qu’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 (Kafkaris, précité, § 97). Le simple fait qu’une peine perpétuelle puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 3 si une peine perpétuelle est compressible de jure et de facto (Kafkaris, précité, § 98, et Vinter et autres, précité § 108). Après s’être livrée à une analyse minutieuse des éléments pertinents se dégageant de sa jurisprudence et des tendances récentes perceptibles en matière de peines perpétuelles dans les domaines du droit comparé et du droit international, la Cour a conclu dans l’arrêt Vinter et autres qu’une peine perpétuelle ne peut demeurer compatible avec l’article 3 de la Convention qu’à la condition d’offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen, les deux devant exister dès le prononcé de la peine (Vinter et autres, précité, §§ 104-118 et 122). Elle a en outre constaté dans ladite affaire qu’il se dégageait des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (ibidem, § 120 ; voir également Bodein c. France, no 40014/10, § 61, 13 novembre 2014). C’est aux États – et non à la Cour – qu’il appartient de décider de la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen (Kafkaris, précité, § 99, et Vinter et autres, précité, §§ 104 et 120). La Cour a ainsi jugé qu’un mécanisme de grâce présidentielle peut satisfaire aux exigences posées par sa jurisprudence (Kafkaris, précité, § 102).
100. La Cour a en outre estimé qu’un motif légitime d’ordre pénologique doit justifier la détention. Les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et d’amendement figurent au nombre des motifs propres à justifier une détention. En matière de perpétuité, un grand nombre d’entre eux seront réunis au moment où la peine est prononcée. Cependant l’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, il pourra évoluer au cours de l’exécution de la peine. C’est seulement par un réexamen de la justification du maintien en détention à un stade approprié de l’exécution de la peine que ces facteurs ou évolutions peuvent être correctement appréciés (Vinter et autres, précité, § 111). Le réexamen exigé pour qu’une peine perpétuelle puisse être réputée compressible doit, en conséquence, permettre aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (ibidem, § 119). Cette appréciation doit être fondée sur des règles ayant un degré suffisant de clarté et de certitude (ibidem, §§ 125 et 129 ; voir également László Magyar c. Hongrie, no 73593/10, § 57, 20 mai 2014, et Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, §§ 255, 257 et 262, CEDH 2014 (extraits)), et les conditions définies dans le droit interne doivent refléter celles énoncées dans la jurisprudence de la Cour (Vinter et autres, précité, § 128). Par conséquent, la possibilité pour un détenu purgeant une peine perpétuelle de bénéficier d’une grâce ou d’une mise en liberté pour des motifs d’humanité tenant à un mauvais état de santé, à une invalidité physique ou à un âge avancé ne correspond pas à ce que recouvre l’expression « perspective d’élargissement » employée dans l’arrêt Kafkaris (Vinter et autres, précité, § 127, et Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 203, 18 mars 2014). Une chambre de la Cour a jugé dans une affaire récente que l’appréciation doit reposer sur des critères objectifs et définis à l’avance (Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 137, CEDH 2014 (extraits)). Le droit du détenu à un réexamen implique une appréciation concrète des informations pertinentes (László Magyar, précité, § 57) et le réexamen doit être entouré de garanties procédurales adéquates (Kafkaris, précité, § 105, et Harakchiev et Tolumov, précité, § 262). Dans la mesure nécessaire pour que le détenu sache ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions, une motivation des décisions peut être requise, et il faut donc que le détenu ait accès à un contrôle juridictionnel pour faire remédier à tout défaut à cet égard (László Magyar, précité, § 57, et Harakchiev et Tolumov, précité, §§ 258 et 262). Enfin, pour apprécier si une peine perpétuelle est compressible de facto, il peut être utile de prendre en compte les données statistiques sur le mécanisme de recours antérieures au réexamen en question, notamment le nombre de personnes ayant obtenu une grâce (Kafkaris, précité, § 103, Harakchiev et Tolumov, précité, §§ 252 et 262, et Bodein, précité, § 59).
b) L’amendement et la perspective de libération des détenus à vie
101. Ainsi qu’il ressort du paragraphe précédent, le réexamen exigé pour qu’une peine perpétuelle puisse être réputée compressible doit permettre aux autorités nationales d’apprécier toute évolution du détenu et tout progrès sur la voie de l’amendement accompli par lui. C’est ainsi que dans son arrêt Vinter et autres (précité), la Grande Chambre a soulevé la question de la démarche à adopter pour déterminer si, dans un cas donné, une peine perpétuelle peut être réputée compressible, à la lumière, précisément, de la fonction d’amendement de l’incarcération. Dans ce contexte, elle a estimé que la dignité humaine, qui se trouve au cœur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté (ibidem, § 113). Elle a ensuite noté que le droit européen et le droit international confortent aujourd’hui clairement le principe voulant que tous les détenus, y compris ceux purgeant des peines perpétuelles, se voient offrir la possibilité de s’amender et la perspective d’être mis en liberté s’ils y parviennent (ibidem, § 114). Si le châtiment demeure l’un des objectifs de la détention, les politiques pénales européennes mettent désormais l’accent sur l’objectif de réinsertion poursuivi par la détention, y compris dans le cas des détenus à vie, ainsi qu’en attestent les règles 6, 102.1 et 103.8 des règles pénitentiaires européennes, la résolution Res(76)2 et les Recommandations Rec(2003)23 et Rec(2003)22 du Comité des Ministres, les déclarations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que la pratique de certains États contractants. On trouve ce même engagement en faveur de la réinsertion dans le droit international, ainsi que l’illustrent notamment l’article 10 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’observation générale s’y rapportant (ibidem, §§ 115-118).
102. La Cour observe que le principe de réinsertion, qui vise le retour dans la société d’une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale, se trouve reflété dans les normes internationales (paragraphes 70‑76 ci‑dessus), qu’il est aujourd’hui reconnu dans la jurisprudence de la Cour relative à plusieurs articles de la Convention et qu’il y revêt même une importance croissante (outre Vinter et autres, précité, voir, par exemple, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 72, CEDH 2002‑VIII, Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 28, CEDH 2007‑V, James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, nos 25119/09, 57715/09 et 57877/09, § 209, 18 septembre 2012, et Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, §§ 121 et 144-145, CEDH 2015). Dans un contexte légèrement différent, la Cour a de plus jugé que lorsqu’un Gouvernement, pour justifier le maintien en détention d’un délinquant, se fonde exclusivement sur le risque que celui-ci représente pour la société civile, il doit tenir compte de la nécessité de l’encourager à s’amender (James, Wells et Lee, précité, § 218). L’un des objectifs de l’amendement est d’empêcher la récidive et, partant, de protéger la société.
103. Bien que la Convention ne garantisse pas, en tant que tel, un droit à la réinsertion, la jurisprudence de la Cour part donc du principe que les personnes condamnées, y compris celles qui se sont vu infliger une peine d’emprisonnement à vie, doivent pouvoir travailler à leur réinsertion. La Cour a en effet jugé qu’« un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir (...) ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables » (Vinter et autres, précité, § 122). Elle a aussi jugé, en se référant à l’arrêt Vinter et autres, que les autorités nationales doivent donner aux détenus à vie une chance réelle de se réinsérer (Harakchiev et Tolumov, précité, § 264). Il en résulte que les détenus à vie doivent se voir offrir une possibilité réaliste au regard des limites imposées par le cadre carcéral d’accomplir sur la voie de l’amendement des progrès propres à leur permettre d’espérer pouvoir un jour bénéficier d’une libération conditionnelle. Cet objectif peut être atteint, par exemple, par la mise en place et le réexamen périodique d’un programme individualisé, propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime.
104. Les détenus à vie doivent donc se voir offrir la possibilité de s’amender. En ce qui concerne l’étendue des obligations qui pèsent sur les États à cet égard, la Cour considère que même si les États ne sont pas tenus de garantir que les détenus à vie réussissent à s’amender (Harakchiev et Tolumov, précité, § 264), ils ont néanmoins l’obligation de leur donner la possibilité de s’y employer. Sans cette obligation, un détenu à vie pourrait de fait se voir priver de la possibilité de s’amender, avec pour conséquence que le mécanisme de réexamen requis pour que la peine puisse être réputée compressible, et dans le cadre duquel les progrès accomplis par le détenu sur la voie de l’amendement doivent être évalués, risquerait de ne jamais permettre réellement une commutation, une remise ou une cessation de la peine perpétuelle ou encore la libération conditionnelle du détenu. À cet égard, la Cour rappelle le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel la Convention garantit des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi de nombreux précédents, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 123, CEDH 2010). L’obligation d’offrir au détenu une possibilité de s’amender doit être considérée comme une obligation de moyens et non de résultat. Cela étant, elle implique une obligation positive de garantir pour les détenus à vie l’existence de régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l’objectif d’amendement et qui permettent aux détenus en question de progresser sur cette voie. À cet égard, la Cour a conclu précédemment à l’existence de pareille obligation dans des cas où c’était le régime ou les conditions de détention qui faisaient obstacle à l’amendement des détenus (Harakchiev et Tolumov, précité, § 266).
c) Les soins prodigués aux détenus souffrant de troubles mentaux
105. En ce qui concerne le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux, la Cour a toujours affirmé que l’article 3 de la Convention exige que les États veillent à ce que la santé et le bien-être des intéressés soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir, parmi de nombreux précédents, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Sławomir Musiał c. Pologne, no 28300/06, § 87, 20 janvier 2009, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 128, CEDH 2009). Le manque de soins médicaux appropriés pour des personnes privées de liberté peut ainsi engager la responsabilité d’un État au regard de l’article 3 (Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). Les obligations découlant de l’article 3 peuvent aller jusqu’à imposer à l’État de transférer des détenus (notamment des détenus souffrant de pathologies mentales) vers des établissements adaptés afin qu’ils puissent bénéficier des soins appropriés (Raffray Taddei c. France, no 36435/07, § 63, 21 décembre 2010).
106. En ce qui concerne les détenus souffrant de maladies mentales, la Cour a jugé que l’appréciation du point de savoir si des conditions données de détention sont ou non compatibles avec l’article 3 doit tenir compte de la vulnérabilité des individus en cause et, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux (voir, par exemple, Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 82, série A no 244, et Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). De plus, il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi ; il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mis en œuvre (Raffray Taddei, précité, § 59).
d) Les détenus à vie souffrant de déficiences mentales et/ou de troubles mentaux
107. Les détenus à vie qui ont été reconnus pénalement responsables des infractions dont ils ont été déclarés coupables – et qui ne sont donc pas considérés comme « aliénés » au sens de l’article 5 § 1 e) de la Convention – peuvent néanmoins présenter des troubles mentaux ; ils peuvent, par exemple, avoir des problèmes sociaux ou comportementaux, ou encore souffrir de différents types de troubles de la personnalité, le risque de récidive pouvant être influencé par la présence ou l’absence de ces éléments pathogènes. La Cour ne s’est jamais prononcée sur la question spécifique de la compressibilité des peines perpétuelles infligées à des personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic de déficiences mentales et/ou de troubles mentaux. À la lumière de la jurisprudence exposée aux paragraphes 99 à 106 ci-dessus, la Cour juge approprié, pour traiter cette question, d’adopter la démarche exposée dans les paragraphes qui suivent.
108. La Cour considère que pour qu’un État puisse être réputé s’acquitter, à l’égard des détenus à vie souffrant de déficiences mentales et/ou de troubles mentaux, de ses obligations résultant de l’article 3 de la Convention, il faut d’abord qu’il apprécie les besoins thérapeutiques des intéressés en ayant à l’esprit le souci de faciliter leur réinsertion et de réduire le risque de les voir récidiver. Ce faisant, il doit aussi tenir compte des chances de réussite présentées par les éventuelles formes existantes de traitement, l’article 3 ne pouvant imposer à un État d’offrir à un détenu à vie la possibilité de bénéficier d’un traitement dont aucun effet notable sur sa capacité à progresser sur la voie de l’amendement ne pourrait être raisonnablement escompté. Il convient donc de prendre en considération la situation individuelle de l’intéressé ainsi que sa personnalité. La Cour admet par ailleurs que certaines pathologies mentales sont difficiles, voire impossibles à traiter. Dès lors que les détenus visés peuvent, en raison de leur santé mentale, ne pas avoir eux-mêmes suffisamment conscience de leur besoin d’être soignés, l’appréciation susmentionnée doit être réalisée indépendamment de la question de savoir s’ils ont ou non formulé une demande de traitement (paragraphe 106 ci-dessus). Lorsque l’évaluation mène à la conclusion qu’un traitement ou une thérapie donnés pourraient effectivement aider le détenu à s’amender, il convient de lui permettre d’en bénéficier dans toute la mesure de ce qui est possible eu égard aux contraintes du contexte carcéral (voir les instruments pertinents du Conseil de l’Europe exposés aux paragraphes 66 à 69 ci-dessus ; voir également le paragraphe 103 ci-dessus). Ce point revêt une importance particulière dans les cas où l’administration d’un traitement constitue, de fait, une condition préalable à toute possibilité pour le détenu de prétendre, dans le futur, à une remise en liberté. Il s’agit donc d’un aspect essentiel pour l’appréciation de la question de savoir si une peine perpétuelle est ou non de facto compressible.
109. Pour donner réellement aux détenus à vie la possibilité de se réinsérer, il peut dès lors être nécessaire, en fonction de leur situation individuelle, de leur permettre d’entreprendre des thérapies ou des traitements – qu’ils soient médicaux, psychologiques ou psychiatriques – adaptés à leur cas et aptes à faciliter leur amendement. Une possibilité réelle de réinsertion implique aussi que les intéressés soient autorisés à prendre part à des activités, notamment professionnelles, lorsque celles-ci apparaissent de nature à favoriser leur amendement.
110. D’une manière générale, c’est à l’État, et non à la Cour, qu’il appartient de décider quels dispositifs, mesures ou traitements sont nécessaires pour donner à un détenu à vie les moyens de s’amender de façon à pouvoir remplir les conditions d’une remise en liberté. Les États disposent par conséquent d’une ample marge d’appréciation pour choisir les mesures aptes à permettre d’atteindre cet objectif, et l’obligation résultant de l’article 3 doit être interprétée de manière à ne pas imposer un fardeau excessif aux autorités nationales.
111. Dans ces conditions, un État sera réputé avoir satisfait à ses obligations découlant de l’article 3 lorsqu’il aura mis en place des conditions de détention et des dispositifs, mesures ou traitements propres à permettre l’amendement du détenu à vie, quand bien même celui-ci ne progresserait pas suffisamment dans la voie de l’amendement pour qu’il soit possible de conclure que le danger qu’il présente pour la société a diminué à un point tel qu’il peut prétendre à une remise en liberté. À cet égard, la Cour rappelle que la Convention impose aux États de prendre des mesures visant à protéger le public contre les crimes violents et qu’elle ne leur interdit pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige (Vinter et autres, précité, § 108, et les références qui s’y trouvent citées). Les États peuvent s’acquitter de cette obligation positive de protection du public en maintenant en détention les condamnés à perpétuité aussi longtemps qu’ils demeurent dangereux (voir, par exemple, Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, §§ 115-122, 15 décembre 2009).
112. En conclusion, il convient d’offrir aux détenus à vie des conditions de détention et des traitements propres à leur donner une possibilité réaliste de s’amender et de nourrir ainsi un espoir d’être remis en liberté. L’absence de pareille possibilité pour un détenu peut par conséquent rendre sa peine perpétuelle incompressible de facto.
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
113. La Cour doit maintenant rechercher si la peine perpétuelle infligée au requérant était ou non compressible. Elle rappelle que pour qu’une peine perpétuelle puisse être réputée compressible et donc compatible avec l’article 3, elle doit offrir à la fois une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen (Vinter et autres, précité, §§ 109-110).
114. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (paragraphe 92), la chambre a examiné la question de la compatibilité de la peine perpétuelle du requérant avec l’article 3 séparément de ses autres griefs, portant sur ses conditions de détention, fondés sur cet article. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour et sur les principes exposés aux paragraphes 107-112, la Grande Chambre considère toutefois qu’en l’espèce les différents volets des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 sont étroitement liés. Ils étaient du reste présentés ensemble dans la lettre du requérant datée du 2 novembre 2012 (paragraphe 91 ci-dessus), et l’intéressé a fondé ses principales observations devant la Grande Chambre sur l’argument consistant à dire qu’il ne pouvait nourrir aucun espoir d’être un jour remis en liberté, faute d’avoir jamais bénéficié, pour les troubles mentaux dont il souffrait, d’un traitement qui aurait pu réduire le risque de récidive qu’il était présumé présenter. Dans ces conditions, la Cour juge opportun d’examiner conjointement les différents volets des griefs fondés sur l’article 3.
115. Pour déterminer si la peine perpétuelle infligée au requérant était ou non compressible, la Cour recherchera donc si l’absence de traitement psychiatrique ou psychologique a effectivement privé l’intéressé de toute perspective de libération.
116. La Cour fondera son appréciation sur la situation qui a été celle du requérant à compter de l’introduction de sa requête en 2010. Elle ne perdra cependant pas de vue que l’intéressé avait alors déjà passé environ trente ans en détention. Elle observe à cet égard que les rejets des différents recours en grâce introduits par lui reposaient notamment sur l’appréciation selon laquelle le risque de récidive qu’il était présumé présenter existait toujours. Dans les dernières années de son incarcération, cet élément devint le seul motif donné pour justifier les refus de lui accorder une libération, sous quelque forme que ce fût. Si le risque de récidive et la nécessité de protéger la société constituent des motifs d’ordre pénologique propres à justifier la poursuite de la détention d’un condamné à perpétuité (paragraphe 100 ci-dessus), la Cour doit néanmoins examiner si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant s’est vu offrir, y compris au cours de la période de détention ayant précédé l’introduction de sa requête, des possibilités de s’amender, étant donné que l’existence ou non de pareilles possibilités, en particulier concernant ses troubles mentaux, pouvait avoir une incidence sur ses perspectives de remise en liberté.
117. La Cour observe à cet égard que dans le cadre de la procédure pénale pour meurtre menée à son encontre, le requérant fut en 1979 examiné par un psychiatre, qui vit en lui un jeune homme mentalement attardé, infantile et narcissique, dont la personnalité avait une structure gravement altérée et de type psychopathique. Le psychiatre recommanda que l’intéressé fût traité dans un cadre institutionnel pendant une longue période ou que l’on tentât de mettre en œuvre au sein de la prison (paragraphe 33 ci‑dessus) des mesures propres à renforcer la structure de sa personnalité et à prévenir toute récidive. Constatant qu’il n’était pas possible à l’époque – le droit applicable ne prévoyant pas cette mesure – d’ordonner un internement dans un établissement de soins spécialisés aux Antilles néerlandaises et considérant qu’un internement dans un établissement de ce type dans la partie européenne du Royaume n’était pas réalisable, la Cour commune de justice infligea au requérant, le 11 mars 1980, une peine d’emprisonnement à vie (paragraphes 15-16 ci‑dessus). La Cour estime toutefois que la détention de l’intéressé dans une prison plutôt que dans un établissement de soins ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître la nécessité du traitement recommandé. Elle ne peut pas davantage admettre que le seul fait que la sanction infligée au requérant ne fût pas assortie d’une mesure stipulant qu’il devait être soigné exonérait le Gouvernement de toute obligation à cet égard pour la durée de l’incarcération de l’intéressé. La Cour rappelle que les États ont l’obligation de dispenser aux détenus ayant des problèmes de santé – y compris à ceux qui souffrent de troubles mentaux – les soins médicaux appropriés (paragraphe 105 ci-dessus), notamment pour leur permettre, dans la mesure du possible, de s’amender, que les intéressés aient ou non formulé des demandes à cet égard (paragraphes 106 et 108 ci-dessus).
118. La thèse du requérant selon laquelle il n’a jamais bénéficié d’aucun traitement pour ses troubles mentaux pendant sa détention trouve un certain appui dans des rapports émis par le CPT à la suite de visites effectuées par lui dans les prisons de Curaçao et d’Aruba où l’intéressé était, ou avait été, détenu, et aux termes desquels les soins de santé mentale prodigués aux détenus dans ces deux établissements étaient insuffisants (paragraphe 57 ci‑dessus). Sa thèse est en outre clairement corroborée par les éléments de son dossier, et notamment par le courriel du responsable du service social de la prison d’Aruba daté du 29 juillet 2014 (paragraphe 46 ci-dessus) et par un rapport en date du 1er septembre 2014 établi par la psychologue de cette prison, tous deux attestant que le dossier médical du requérant ne faisait état d’aucun traitement psychiatrique ou psychologique qui aurait été administré au requérant (paragraphe 45 ci-dessus).
119. Au demeurant, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant n’a pas bénéficié d’un traitement à proprement parler, mais il indique que lorsqu’il était détenu à Curaçao l’intéressé bénéficia d’une certaine forme d’assistance psychiatrique, à laquelle il choisit de renoncer en demandant son transfert à Aruba, où les possibilités en la matière étaient très limitées, ce qu’elles demeurèrent assurément pendant les premières années de son incarcération là-bas. Cela étant, même si l’on admet que le requérant a pu avoir accès à des soins psychiatriques élémentaires, il s’agit de déterminer si ceux-ci étaient suffisants pour satisfaire à l’obligation qu’avait le gouvernement défendeur de donner à l’intéressé la possibilité de s’amender.
120. À cet égard, la Cour observe tout d’abord que le principe de réinsertion des détenus est consacré explicitement, au moins depuis 1999, par le droit interne applicable, qui énonce qu’une peine privative de liberté doit aussi préparer les détenus à leur réinsertion dans la société (paragraphe 48 ci-dessus). La Cour relève par ailleurs que les autorités internes adoptèrent un certain nombre de mesures et dispositifs qui peuvent être considérés comme ayant œuvré dans le sens de la réinsertion du requérant, même si ce n’était pas leur objectif principal. L’intéressé fut ainsi transféré de Curaçao vers Aruba en 1999. Il avait sollicité ce transfert pour se rapprocher des membres de sa famille, et les autorités avaient jugé que la mesure était de nature à faciliter sa réinsertion et à produire des effets bénéfiques sur son état psychologique (paragraphe 34‑35 ci-dessus). À Aruba, il eut la possibilité de travailler et put profiter du caractère structuré de la vie au sein de la prison (paragraphe 42 ci‑dessus). Il ressort des différents rapports établis qu’il changea au fil des ans : s’il peut passer pour avoir été un détenu perturbateur pendant les premières années de son incarcération à Curaçao, son comportement s’améliora notablement pendant sa détention à Aruba (paragraphes 19, 40 et 42 ci-dessus).
121. Néanmoins, tout au long de sa détention le risque qu’il récidive fut jugé trop élevé pour qu’il pût prétendre à l’octroi d’une grâce ou à une libération conditionnelle après le réexamen périodique de sa peine perpétuelle. À cet égard, la Cour relève que, consulté en 1997 sur un recours en grâce introduit par le requérant, l’un des trois juges de la Cour commune de justice estima qu’il serait irresponsable de lui octroyer une grâce dès lors qu’il avait été établi qu’il présentait un risque élevé de récidive et qu’il n’avait pas reçu en prison le traitement recommandé (paragraphe 24 ci‑dessus). Dans l’avis relatif au même recours en grâce qu’elle donna au gouverneur de Curaçao, la Cour commune de justice nota quant à elle que le requérant n’avait bénéficié d’aucun traitement (psychiatrique) visant à renforcer la structure de sa personnalité dans le but d’empêcher une récidive (paragraphe 24 ci-dessus). Enfin, et c’est notable, la Cour commune de justice observa dans l’arrêt qu’elle rendit le 21 septembre 2012 à l’issue du réexamen périodique de la peine perpétuelle du requérant que des caractéristiques importantes de la personnalité perturbée de l’intéressé, qui avaient initialement fait conclure à un risque de récidive élevé, étaient toujours présentes et qu’aucun traitement n’avait été mis en place pendant les années de détention. Tout en estimant que, après trente-trois ans, l’incarcération du requérant ne remplissait plus l’objectif rétributif dévolu à la peine, elle conclut que le maintien en détention de l’intéressé s’imposait aux fins de protection du public, le risque de récidive demeurant trop élevé pour autoriser une remise en liberté (paragraphe 8.4, 8.6, 8.7 et 8.12 de l’arrêt de la Cour commune cité au paragraphe 32 ci-dessus).
122. Il ressort clairement des décisions de la Cour commune de justice évoquées au paragraphe précédent qu’il existait en l’espèce un lien étroit entre la persistance d’un risque de récidive dans le chef du requérant, d’une part, et l’absence de traitement, d’autre part. La Cour observe par ailleurs que les autorités savaient parfaitement que l’administration d’un traitement avait été recommandée à des fins de prévention de la récidive et que l’intéressé n’en avait jamais reçu aucun.
123. Le requérant se trouvait donc dans une situation où, compte tenu du risque de récidive qu’il présentait, il était réputé ne pouvoir bénéficier ni d’un élargissement ni d’une libération conditionnelle, alors que la persistance du risque de récidive était liée au fait qu’aucune évaluation de ses besoins thérapeutiques et des possibilités de traitement existantes n’avait été menée et qu’aucune forme de traitement susceptible de faciliter sa réinsertion ne lui avait été proposée. Ainsi, l’administration d’un traitement au requérant constituait, en pratique, une condition préalable à la possibilité pour lui de progresser sur la voie de l’amendement et de réduire son risque de récidive. Il y avait donc en jeu une question touchant à la compressibilité de facto de sa peine.
124. Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué ci-dessus (paragraphe 110), les États disposent d’une ample marge d’appréciation dans la détermination des dispositifs ou mesures propres à donner à un détenu à vie la possibilité de s’amender de manière à pouvoir un jour prétendre au bénéfice d’une remise en liberté. Par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de dire quel traitement était nécessaire dans les circonstances spécifiques de l’espèce. Toutefois, bien qu’une évaluation eût révélé dès avant la condamnation du requérant à une peine perpétuelle que celui-ci avait besoin d’être soigné, il apparaît que des évaluations complémentaires ne furent jamais menées, ni lorsque l’intéressé commença à purger sa peine ni par la suite, sur les types de traitements qui pouvaient être requis et disponibles ou sur la capacité et la volonté du requérant d’en bénéficier. La Cour estime qu’il convient d’accorder peu de poids au fait que le requérant lui-même ne s’était apparemment pas soucié d’obtenir un traitement et avait préféré être transféré de Curaçao vers Aruba, où la possibilité de bénéficier d’une assistance psychiatrique était (encore plus) limitée. Il faut en effet garder présent à l’esprit que les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent avoir des difficultés à évaluer leur propre situation ou leurs propres besoins et être incapables d’indiquer de manière cohérente, ou même d’indiquer tout court, qu’elles ont besoin de se faire soigner (paragraphe 106 ci-dessus).
125. Eu égard à ce qui précède, et notamment au fait que le requérant n’a bénéficié d’aucun traitement et que ses besoins et les possibilités en la matière n’ont jamais été évalués, la Cour estime qu’au moment de l’introduction par lui de sa requête devant la Cour, aucun de ses recours en grâce n’était en pratique apte à mener à la conclusion qu’il avait fait des progrès tels sur la voie de l’amendement qu’aucun motif d’ordre pénologique ne justifiait plus son maintien en détention. Cette appréciation vaut aussi pour le premier, et en définitive unique, réexamen périodique de la peine perpétuelle du requérant qui fut effectué. Aussi la Cour conclut-elle que, contrairement aux exigences de l’article 3, la peine perpétuelle du requérant n’était pas de facto compressible.
126. Dans ces conditions, la Cour juge ne devoir se livrer à un examen plus approfondi ou détaillé ni du système des recours en grâce et du mécanisme de réexamen périodique aux fins de déterminer si la peine perpétuelle était compressible de jure, ni du régime de détention qui fut réservé requérant.
127. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
LÉGER c. FRANCE du 11 avril 2006 Requête no 19324/02
La détention après une condamnation à perpétuité n'est pas un acte inhumain et dégradant si la peine est appliquée
"89. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, § 162).
90. La Cour a déjà déclaré que la compatibilité avec l’article 3 d’une « peine indéterminée » infligée à des mineurs pourrait « inspirer des doutes » sans les motifs avancés à l’appui (Weeks précité, § 47 ; Hussain précité § 53 ; arrêts T. et V. précités, §§ 99 et 100). Par ailleurs, et s’agissant des adultes, la Cour n’écarte pas le fait que dans des circonstances particulières l’exécution de peines privatives de liberté à vie et incompressible puisse également poser problème au regard de la Convention lorsqu’il n’existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la libération conditionnelle par exemple (Nivette c. France, (déc) no 44190/98, 3 juillet 2001 ; Einhorn précité ; Sawoniuk précité ; Partington c ; Royaume-Uni, déc no 58853/00, 26 juin 2003).
91. La Cour rappelle que la Convention impose aux Etats l’obligation de prendre des mesures propres à protéger le public contre les crimes violents (V. c. Royaume-Uni, précité, § 98). Elle estime ainsi que l’élément de rétribution inhérent au principe de la période punitive n’emporte pas en soi violation de l’article 3. Par la suite, et « dès lors qu’il a été satisfait à l’élément punitif de la sentence » le maintien en détention doit être motivé par des considérations de risque et de dangerosité (Stafford précité, § 80). Or, la Cour a considéré à cet égard que le requérant n’a pas été détenu arbitrairement (paragraphes 71 à 77 ci-dessus).
92. L’intéressé a recouvré sa liberté après quarante et une années de détention, soit un emprisonnement d’une exceptionnelle durée, issue d’une peine infligée à une époque où les périodes de sûreté n’existaient pas. Toutefois, à partir de 1979, soit après quinze années, il a eu la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers et a bénéficié de garanties procédurales. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le requérant ne peut prétendre qu’il était privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de sa peine, laquelle n’était pas incompressible de jure ou de facto. Elle en conclut que le maintien en détention du requérant, en tant que tel, et aussi long fut-il, n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant.
93. Tout en reconnaissant qu’une condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, la Cour ne considère pas que, dans les circonstances de l’espèce, la peine du requérant atteignait le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Elle n’aperçoit aucune autre circonstance, quant à une éventuelle aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, pour conclure que le requérant a été victime d’une épreuve exceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3.
94. Partant, il n’y pas eu violation de cette disposition"
Arrêt PATSOS c. GRÈCE du 25 septembre 2012 Requête no 10067/11
Les faits condamnés sont graves. Le requérant âgé de 79 ans est soigné. Il n'y a pas de violation de l'article 3
a) Principes applicables
50. La Cour rappelle que pour qu’une peine ou un traitement puissent être qualifiés d’« inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation infligées à la victime doivent aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, CEDH 2006-IX).
51. Lorsqu’il s’agit en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, et Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le défaut de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peuvent en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004).
52. Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre le détenu en liberté ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne peut exclure que, dans des conditions particulièrement graves, on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que soient prises des mesures de nature humanitaire (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
53. La Convention n’interdit pas l’emprisonnement de personnes d’un âge avancé. Cependant, le fait de ne pas prodiguer aux détenus les soins médicaux nécessaires peut constituer un traitement inhumain et l’Etat est tenu d’adopter des mesures en vue d’assurer le bien-être des personnes privées de leur liberté (Kudla, précité). En appliquant ces principes, la Cour a déjà conclu que le maintien en détention pendant une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, de surcroît malade, pouvait relever de la protection de l’article 3 (Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI, Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI, et Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). Cela étant, pour examiner la compatibilité du maintien en détention d’un requérant avec un état de santé préoccupant, la Cour doit tenir compte notamment de trois éléments, à savoir : a) la situation du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé de l’intéressé (Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 53, 2 décembre 2004, Sakkopoulos précité, § 39, Enea c. Italie, [GC], no 74912/01, § 59, 17 septembre 2009, Arutyunyan c. Russie, no 48977/09, 10 janvier 2012, Sakhvadze c. Russie, no 15492/09, 10 janvier 2012 et Vladimir Vasilyev c. Russie, no 28370/05, 10 janvier 2012).
54. La Cour a déjà eu plusieurs fois à se prononcer sur des cas comparables quant à l’âge à celui du requérant, le premier étant l’affaire Papon (no 1) précitée. Elle a alors procédé à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, pour déterminer si l’état de santé du requérant ou la détresse qu’il alléguait atteignaient un niveau de gravité suffisant pour entraîner une violation de l’article 3.
55. Dans l’affaire Papon, elle a déclaré le grief tiré de l’article 3 irrecevable au motif que le requérant bénéficiait régulièrement d’une surveillance et de soins médicaux et que les autorités internes avaient tenu compte autant que possible de son état de santé et de son âge (voir, mutatis mutandis, Sawoniuk, Priebke et Farbtuhs, précités). Dans les arrêts Gelfmann c. France (no 25875/03, § 59, 14 décembre 2004) et Matencio (précité, § 84), elle a conclu à la non-violation de cet article : elle a notamment relevé, respectivement, que le requérant ne se plaignait pas des conditions matérielles de sa détention et que les autorités étaient attentives à son état de santé, ou que le requérant faisait l’objet d’un suivi médical dans un hôpital civil et s’était vu attribuer une cellule individuelle. Elle a conclu de la même manière dans l’arrêt Prencipe c. Monaco (no 43376/06, 16 juillet 2009). Il convient cependant de préciser que dans ces trois dernières affaires, les requérants souffraient aussi de pathologies graves et étaient âgés respectivement d’une quarantaine, d’une cinquantaine et d’une soixantaine d’années.
b) Application des principes au cas d’espèce
56. La Cour note d’abord que le cas du requérant ne relève d’aucune des dispositions bénéfiques de l’article 110A du code pénal, qui prévoient la libération conditionnelle des détenus présentant des problèmes graves de santé.
57. La Cour observe, toutefois, que le requérant, âgé aujourd’hui de quatre-vingt deux ans, souffre de diabète traité par insuline, de troubles coronariens, d’œsophagite avec reflux gastro-œsophagien, d’hyperlipidémie, de tension artérielle et d’anémie ferriprive, mais non d’un handicap physique qui affecterait considérablement et durablement ses aptitudes sensorielles et motrices (voir, a contrario, Xiros c. Grèce, no 1033/07, § 91, 9 septembre 2010).
58. La Cour constate, cependant, que depuis le début de son incarcération, y compris la période non couverte par le délai des six mois, les autorités pénitentiaires ont suivi à intervalle régulier l’état de santé du requérant et ont pris les mesures appropriées. En effet, le requérant a été hospitalisé à plusieurs reprises au dispensaire de la prison ou dans des hôpitaux publics (paragraphe 23 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant ne soulève aucun grief concret concernant les brèves périodes pendant lesquelles il a séjourné, pour les besoins de la procédure à la prison de Korydallos.
59. En outre, dans la prison de Larissa, le requérant dispose d’un espace personnel de 5 m². Selon les standards du CPT, cet espace est satisfaisant. A cet égard, la Cour rappelle aussi que l’espace personnel attribué à chaque détenu doit être apprécié aussi en fonction de la liberté dont celui-ci dispose dans la journée à l’intérieur de la prison (Nurmagomedov c. Russie, (déc.) no 30138/02, 16 septembre 2004). Or, le requérant n’affirme pas qu’il était dans l’impossibilité de quitter sa cellule par ses propres moyens (a contrario, Vincent c. France, no 6253/03, § 103, 24 octobre 2006)
60. Le médecin de la prison décrit, en outre, l’état de santé du requérant comme « bon ». Certes, cet état peut à tout moment se détériorer, en raison de son âge mais rien ne permet d’affirmer qu’il en serait autrement si le requérant était en liberté. De plus, même si le Gouvernement ne soulève pas d’exception de non-épuisement à cet égard, la Cour relève que le requérant s’est borné à demander la suspension de l’exécution de sa peine et ne s’est pas adressé aux autorités pénitentiaires, et en particulier au procureur-superviseur de la prison ou à son adjoint, pour se plaindre notamment des conditions de sa détention (article 6 de la loi no 2776/1999 et arrêté ministériel no 58819/2003) ni au procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité qui, de plus, est censé visiter la prison au moins une fois par semaine (article 572 du code de procédure pénale).
61. En l’espèce, la Cour ne saurait conclure que le requérant n’a pas bénéficié des soins médicaux adéquats, que son état de santé s’est détérioré au-delà de l’évolution normale de ses pathologies ou qu’il a souffert outre mesure du fait d’une assistance médicale insuffisante (voir, mutatis mutandis, Grishin c. Russie, no 30983/02, § 78, 15 novembre 2007 ; Bordikov c. Russie, no 921/03, §§ 70-71, 8 octobre 2009 et Chaykovskiy c. Russie, no 2295/06, § 57, 15 octobre 2009). Le requérant lui-même, d’ailleurs, ne fait état d’aucun argument et d’aucun élément pour soutenir ou démontrer que son état de santé s’est aggravé du fait de sa détention plutôt qu’en raison de son âge ou de l’évolution de ses maladies.
62. La Cour note, de surcroît, que l’article 56 du code pénal, qui est entré en vigueur le 23 décembre 2010 et qui prévoit la possibilité d’une mise en liberté d’un condamné du seul fait qu’il a dépassé soixante-quinze ans, ne peut s’appliquer que lorsque l’intéressé est condamné à une peine d’emprisonnement. Le requérant, condamné à la réclusion, ne pourra donc pas bénéficier de cette disposition. Or, le fait de limiter la possibilité de libération en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise n’est pas de l’avis de la Cour déraisonnable. La Cour relève, par ailleurs que cette possibilité prévue par l’article 56 n’est pas automatique. En effet, la prolongation de la détention dans un établissement pénitentiaire peut paraître nécessaire pour empêcher l’intéressé de commettre d’autres infractions de gravité similaire.
63. En l’espèce, la Cour rappelle que le requérant, alors qu’il était âgé de soixante dix-neuf ans, a été condamné en 2009 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour faux et usage de faux contre l’Etat, commis de manière répétitive, « par profession et habitude » et fraudes à répétition devant le tribunal. La section des sursis de la cour d’appel a, à deux reprises, les 15 mars et 18 octobre 2010, rejeté la demande de sursis à exécution de la peine du requérant, par des motifs qui ne sauraient être qualifiés d’arbitraires, à savoir que les conditions de l’article 497 § 7 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies, car le requérant était particulièrement dangereux et il existait des raisons fondées de craindre qu’il commettrait de nouvelles infractions. Par ailleurs, la section des sursis de la cour d’appel a dûment pris en compte, en l’occurrence, l’ensemble des éléments concernant la santé du requérant (paragraphes 13 et 16 ci-dessus).
64. Dans ces conditions et après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n’estime pas établi que le maintien en détention du requérant dans la prison de Larissa, entrecoupé par de courts transferts à la prison de Korydallos pour les besoins de la procédure judiciaire, constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
LA POSSIBILITE D'ELARGISSEMENT DU CONDAMNE DOIT ETRE PREVUE
WINTER ET AUTRES c.ROYAUME-UNI
Requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 du 9 juillet 2013
LA CEDH a conclu en particulier que, pour qu'une peine perpétuelle demeure compatible avec l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il doit exister aussi bien une possibilité d'élargissement qu'une possibilité de réexamen. Cependant, en constatant une violation dans cette affaire, la Cour n'entend pas offrir aux requérants la moindre perspective d'élargissement imminent. L'opportunité de leur mise en liberté dépendrait par exemple du point de savoir si leur maintien en détention se justifie toujours par des motifs légitimes d'ordre pénologique ou pour des raisons de dangerosité.
LA CEDH
1. La « nette disproportion »
102. Selon l’arrêt de la chambre, toute peine nettement disproportionnée est contraire à l’article 3 de la Convention. Tel est également l’avis qui a été exprimé par les parties dans leurs observations devant la chambre et devant la Grande Chambre. Quant à celle-ci, elle approuve et fait sienne la conclusion de la chambre. Elle estime aussi, avec cette dernière, qu’il ne sera satisfait au critère de la nette disproportion que dans des cas rares et exceptionnels (paragraphe 83 ci-dessus et paragraphes 88 et 89 de l’arrêt de la chambre).
2. Les peines de réclusion à perpétuité
103. Dès lors toutefois que les requérants n’ont pas cherché à plaider la nette disproportion de leurs peines de perpétuité réelle, il est nécessaire de rechercher, comme la chambre l’a fait, si ces peines sont contraires pour d’autres raisons à l’article 3 de la Convention. Les principes généraux exposés ci-dessous guideront cette analyse.
104. Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que le choix que fait l’Etat d’un régime de justice pénale, y compris le réexamen de la peine et les modalités de libération, échappe en principe au contrôle européen exercé par elle, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (Kafkaris, précité, § 99).
105. De plus, comme la Cour d’appel l’a fait observer dans son arrêt R v. Oakes and others (paragraphe 50 ci-dessus), les questions relatives au caractère juste et proportionné de la peine donnent matière à des débats rationnels et à des désaccords courtois. Dès lors, les Etats contractants doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation pour déterminer la durée adéquate des peines d’emprisonnement pour les différentes infractions. Ainsi que la Cour l’a déclaré, elle n’a pas à dire quelle doit être la durée de l’incarcération pour telle ou telle infraction ni quelle doit être la durée de la peine, de prison ou autre, que purgera une personne après sa condamnation par un tribunal compétent (T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, § 117, 16 décembre 1999 ; V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 118, CEDH 1999‑IX, et Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001‑VI).
106. Pour les mêmes raisons, les Etats contractants doivent également rester libres d’infliger des peines perpétuelles aux adultes auteurs d’infractions particulièrement graves telles que l’assassinat : le faire n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ni par aucune autre disposition de la Convention et n’est pas incompatible avec celle-ci (Kafkaris, précité, § 97). C’est encore plus vrai dans le cas d’une peine non pas obligatoire mais prononcée par un juge indépendant qui aura considéré l’ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes propres au cas d’espèce.
107. Toutefois, comme la Cour l’a aussi dit dans l’arrêt Kafkaris, infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible peut soulever une question sous l’angle de l’article 3 (ibidem). De ce principe découlent deux points particuliers, mais connexes, que la Cour juge nécessaire de souligner et de réaffirmer.
108. Premièrement, le simple fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Une peine perpétuelle compressible de jure et de facto ne soulève aucune question sur le terrain de l’article 3 (Kafkaris, précité, § 98).
A cet égard, la Cour tient à souligner qu’aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 3 si, par exemple, un condamné à perpétuité qui, en vertu de la législation nationale, peut théoriquement obtenir un élargissement demande à être libéré, mais se voit débouté au motif qu’il constitue toujours un danger pour la société. En effet, la Convention impose aux Etats contractants de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et elle ne leur interdit pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige (voir, mutatis mutandis, T. c. Royaume-Uni, § 97, et V. c. Royaume-Uni, § 98, précités). D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 72, CEDH 2002‑VIII ; Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, § 108, 15 décembre 2009, et, mutatis mutandis, Choreftakis et Choreftaki c. Grèce, no 46846/08, § 45, 17 janvier 2012). Il en est particulièrement ainsi dans le cas des détenus reconnus coupables de meurtre ou d’autres infractions graves contre la personne. Le simple fait qu’ils sont peut-être déjà restés longtemps en prison n’atténue en rien l’obligation positive de protéger le public qui incombe à l’Etat : celui-ci peut s’en acquitter en maintenant en détention les condamnés à perpétuité aussi longtemps qu’ils demeurent dangereux (voir, par exemple, l’arrêt précité Maiorano et autres).
109. Deuxièmement, pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la Cour recherche si l’on peut dire qu’un détenu condamné à perpétuité a des chances d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l’article 3 (Kafkaris, précité, § 98).
110. Plusieurs raisons expliquent que pour demeurer compatible avec l’article 3, une peine perpétuelle doit offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen.
111. Il va de soi que nul ne peut être détenu si aucun motif légitime d’ordre pénologique ne le justifie. Comme l’ont dit la Cour d’appel dans son arrêt Bieber et la chambre dans son arrêt rendu en l’espèce, les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion figurent au nombre des motifs propres à justifier une détention. En matière de perpétuité, un grand nombre d’entre eux seront réunis au moment où la peine est prononcée. Cependant, l’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, il pourra évoluer au cours de l’exécution de la peine. Ce qui était la justification première de la détention au début de la peine ne le sera peut‑être plus une fois accomplie une bonne partie de celle-ci. C’est seulement par un réexamen de la justification du maintien en détention à un stade approprié de l’exécution de la peine que ces facteurs ou évolutions peuvent être correctement appréciés.
112. De plus, une personne mise en détention à vie sans aucune perspective d’élargissement ni possibilité de faire réexaminer sa peine perpétuelle risque de ne jamais pouvoir se racheter : quoi qu’elle fasse en prison, aussi exceptionnels que puissent être ses progrès sur la voie de l’amendement, son châtiment demeure immuable et insusceptible de contrôle. Le châtiment, d’ailleurs, risque de s’alourdir encore davantage avec le temps : plus longtemps le détenu vivra, plus longue sera sa peine. Ainsi, même lorsque la perpétuité est un châtiment mérité à la date de son imposition, avec l’écoulement du temps, elle ne garantit plus guère une sanction juste et proportionnée, pour reprendre les termes utilisés par le Lord Justice Laws dans l’arrêt Wellington (paragraphe 54 ci-dessus).
113. En outre, comme la Cour constitutionnelle fédérale allemande l’a reconnu dans l’affaire relative à la prison à vie (paragraphe 69 ci-dessus), il serait incompatible avec la disposition de la Loi fondamentale consacrant la dignité humaine que, par la contrainte, l’Etat prive une personne de sa liberté sans lui donner au moins une chance de recouvrer un jour celle-ci. C’est ce constat qui a conduit la haute juridiction à conclure que les autorités carcérales avaient le devoir d’œuvrer à la réinsertion des condamnés à perpétuité et que celle-ci était un impératif constitutionnel pour toute société faisant de la dignité humaine son pilier. Elle a d’ailleurs précisé ultérieurement, dans une affaire relative à un criminel de guerre, que ce principe s’appliquait à tous les condamnés à perpétuité, quelle que soit la nature de leurs crimes, et que prévoir la possibilité d’un élargissement pour les seules personnes infirmes ou mourantes ne suffisait pas (paragraphe 70 ci-dessus).
Des considérations similaires doivent s’appliquer dans le cadre du système de la Convention, dont l’essence même, la Cour l’a souvent dit, est le respect de la dignité humaine (voir, entre autres, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 65, CEDH 2002‑III, et V.C. c. Slovaquie, no 18968/07, § 105, CEDH 2011).
114. De fait, le droit européen et le droit international confortent aujourd’hui clairement le principe voulant que tous les détenus, y compris ceux purgeant des peines perpétuelles, se voient offrir la possibilité de s’amender et la perspective d’être mis en liberté s’ils y parviennent.
115. La Cour a déjà eu l’occasion de relever que, si le châtiment demeure l’une des finalités de l’incarcération, les politiques pénales en Europe mettent dorénavant l’accent sur l’objectif de réinsertion de la détention, en particulier vers la fin des longues peines d’emprisonnement (voir, par exemple, Dickson, précité, § 75, et Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 83, CEDH 2012, et les autres références citées). Les règles pénitentiaires européennes sont l’instrument juridique du Conseil de l’Europe qui exprime cela le plus clairement : la règle no 6 dispose que chaque détention doit être gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société des personnes privées de liberté, et la règle no 102.1 prévoit que le régime carcéral des détenus condamnés doit être conçu de manière à leur permettre de mener une vie responsable et exempte de crime (paragraphe 77 ci-dessus).
116. En outre, les instruments pertinents du Conseil de l’Europe présentés aux paragraphes 60 à 64 et 76 ci-dessus démontrent tout d’abord que l’impératif de réinsertion vaut tout autant pour les détenus condamnés à la prison à vie et ensuite que, lorsque pareils détenus s’amendent, ils doivent eux aussi pouvoir espérer bénéficier d’une libération conditionnelle.
La règle no 103 des règles pénitentiaires européennes prévoit que, dans le cadre du régime carcéral des détenus condamnés, des projets individuels d’exécution de peine doivent être établis et prévoir notamment une préparation à la libération. La règle no 103.8 ajoute expressément qu’un projet de ce type doit aussi être dressé pour les détenus condamnés à la prison à vie (paragraphe 77 ci-dessus).
La résolution 76(2) du Comité des Ministres recommande que le cas de tous les détenus – y compris ceux condamnés à la perpétuité – soit examiné aussitôt que possible pour déterminer si une libération conditionnelle peut leur être accordée. Elle recommande en outre que le réexamen des peines perpétuelles ait lieu au bout de huit à quatorze ans de détention et soit répété périodiquement (paragraphe 60 ci-dessus).
La Recommandation 2003(23), concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée, souligne que les condamnés à perpétuité doivent bénéficier d’une préparation constructive en vue de leur libération et notamment pouvoir, à cette fin, progresser au sein du système carcéral. Elle ajoute expressément que les condamnés à perpétuité doivent avoir la possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle (voir, en particulier, les paragraphes 2, 8 et 34 de la recommandation et le paragraphe 131 du rapport joint à celle-ci, tous ces passages étant reproduits au paragraphe 61 ci-dessus).
La Recommandation 2003(22), concernant la libération conditionnelle, précise bien elle aussi que tous les détenus doivent avoir la possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle et que les condamnés à perpétuité ne doivent pas être privés de tout espoir de libération (paragraphe 4.a de la recommandation et paragraphe 131 de l’exposé des motifs, tous deux cités au paragraphe 62 ci-dessus).
Le Comité européen pour la prévention de la torture a exprimé des vues similaires, en dernier lieu dans son rapport sur la Suisse (paragraphe 64 ci‑dessus).
117. Par ailleurs, la pratique des Etats contractants reflète cette volonté à la fois d’œuvrer à la réinsertion des condamnés à perpétuité et de leur offrir une perspective de libération. C’est ce qui ressort de la jurisprudence des juridictions constitutionnelles allemande et italienne sur la réinsertion et les peines perpétuelles (paragraphes 69 à 71 et 72 ci-dessus) et des autres éléments de droit comparé produits devant la Cour. Ces éléments montrent qu’une large majorité d’Etats contractants soit ne prononcent jamais de condamnation à perpétuité, soit – s’ils le font – prévoient un mécanisme spécial, intégré à la législation en matière de fixation de la peine, qui garantit un réexamen des peines perpétuelles après un délai fixe, en général au bout de vingt-cinq années d’emprisonnement (paragraphe 68 ci-dessus).
118. On trouve dans le droit international cette même volonté de réinsérer les condamnés à perpétuité et de leur offrir la perspective d’être libérés un jour.
L’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus enjoint aux autorités carcérales de faire appel à tous les moyens disponibles pour assurer aux délinquants un retour dans la société (règles 58 à 61, 65 et 66, citées au paragraphe 78 ci-dessus). D’autres règles font aussi expressément référence à la réinsertion (paragraphe 79 ci-dessus).
De même, l’article 10 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose expressément que le système pénitentiaire a pour but essentiel l’amendement et le reclassement social des détenus. C’est ce qu’a souligné le Comité des droits de l’homme dans son Observation générale sur l’article 10, qui insiste sur le fait qu’aucun système pénitentiaire ne doit être axé uniquement sur le châtiment (paragraphes 80 et 81 ci-dessus).
Enfin, la Cour prend note des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel sont parties 121 Etats, dont la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, et qui prévoit en son article 110 § 3 le réexamen des peines perpétuelles après vingt-cinq ans d’emprisonnement, puis périodiquement. L’importance de cette disposition est soulignée par l’énoncé, à l’article 110 §§ 4 et 5 de ce même Statut et dans les règles 223 et 224 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI, des garanties procédurales et matérielles détaillées qui doivent présider à ce réexamen. Parmi les critères de réduction de la peine figurent le point de savoir si le comportement en prison du détenu condamné montre qu’il désavoue son crime ainsi que ses possibilités de resocialisation (règle 223 a) et b), citée au paragraphe 65 ci-dessus).
3. Conclusion générale concernant les peines de réclusion à perpétuité
119. Pour les raisons avancées ci-dessus, la Cour considère qu’en ce qui concerne les peines perpétuelles l’article 3 doit être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention.
120. La Cour tient toutefois à souligner que, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux Etats contractants en matière de justice criminelle et de détermination des peines (paragraphes 104 et 105 ci‑dessus), elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen. Pour la même raison, elle n’a pas à dire à quel moment ce réexamen doit intervenir. Cela étant, elle constate aussi qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (paragraphes 117 et 118 ci-dessus).
121. Il s’ensuit que, là où le droit national ne prévoit pas la possibilité d’un tel réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article 3 de la Convention.
122. Même si le réexamen requis est un événement qui par définition ne peut avoir lieu que postérieurement au prononcé de la peine, un détenu condamné à la perpétuité réelle ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les exigences de l’article 3 en la matière. Cela serait contraire non seulement au principe de la sécurité juridique mais aussi aux principes généraux relatifs à la qualité de victime, au sens de ce terme tiré de l’article 34 de la Convention. De plus, dans le cas où la peine est incompressible en vertu du droit national à la date de son prononcé, il serait inconséquent d’attendre du détenu qu’il œuvre à sa propre réinsertion alors qu’il ne sait pas si, à une date future inconnue, un mécanisme permettant d’envisager son élargissement eu égard à ses efforts de réinsertion sera ou non instauré. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article 3 en résultant prend naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention.
4. La présente affaire
123. Il reste à déterminer si, eu égard aux éléments ci-dessus, les peines de perpétuité réelle prononcées contre les requérants en l’espèce satisfont aux exigences de l’article 3 de la Convention.
124. La Cour observe tout d’abord que, pas plus que la chambre (voir le paragraphe 94 de l’arrêt de celle-ci), elle n’est convaincue par les raisons données par le Gouvernement pour expliquer la décision de ne pas inclure un réexamen au bout de vingt-cinq ans dans la législation actuellement en vigueur en Angleterre et au pays de Galles en matière de prison à vie, à savoir la loi de 2003 (paragraphe 95 ci-dessus). Elle rappelle qu’un tel réexamen, quoiqu’entre les mains de l’exécutif, existait dans le régime antérieur (paragraphe 46 ci-dessus).
Le Gouvernement explique que si le réexamen après vingt-cinq ans n’a pas été repris dans la loi de 2003 c’est parce que l’une des finalités de ce texte était de confier à des juges les décisions quant à la durée d’emprisonnement à fixer à des fins de châtiment et de dissuasion (paragraphe 95 ci-dessus). Or la nécessité de faire statuer par des juges indépendants sur l’opportunité d’ordonner la perpétuité réelle est tout à fait distincte de celle de faire réexaminer une telle peine à un stade ultérieur afin de vérifier qu’elle demeure justifiée par des motifs légitimes d’ordre pénologique. De plus, étant donné que le but déclaré de cet amendement législatif était d’exclure entièrement l’exécutif du processus décisionnel en matière de peines perpétuelles, il eût été plus logique, au lieu de le supprimer complètement, de prévoir que le réexamen au bout de vingt-cinq ans serait désormais conduit dans un cadre entièrement judiciaire plutôt que, comme auparavant, par l’exécutif sous le contrôle du juge.
125. En outre, la législation régissant aujourd’hui les possibilités d’élargissement pour les condamnés à perpétuité manque de clarté. Il est vrai que l’article 30 de la loi de 1997 donne au ministre le pouvoir de libérer les détenus de toutes catégories, y compris ceux purgeant une peine de perpétuité réelle (paragraphe 42 ci-dessus). Il est vrai également que, lorsqu’il exerce ce pouvoir – comme c’est le cas lorsqu’il exerce n’importe quel autre pouvoir que lui confère la loi –, le ministre est légalement tenu d’agir en conformité avec la Convention (voir l’article 6 § 1 de la loi sur les droits de l’homme, cité au paragraphe 33 ci-dessus). Comme le Gouvernement le soutient dans ses observations devant la Cour, on pourrait donc voir dans l’article 30 non seulement un pouvoir d’élargissement conféré au ministre mais aussi une obligation pour lui d’exercer ce pouvoir et de libérer tout détenu dont le maintien en détention se révélerait incompatible avec l’article 3, par exemple parce qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permettrait plus de justifier cette mesure.
C’est d’ailleurs la lecture de l’article 30 à laquelle la Cour d’appel s’est livrée dans son arrêt Bieber et qu’elle a confirmée dans son arrêt Oakes (voir, en particulier, le paragraphe 49 ci-dessus, où sont repris les paragraphes 48 et 49 de l’arrêt Bieber, avec le passage dans lequel la Cour d’appel observait que, si le ministre utilisait avec parcimonie le pouvoir découlant de l’article 30, rien ne s’opposait à ce qu’il en fît usage de manière à assurer le respect requis de l’article 3 de la Convention).
Une telle lecture de l’article 30, propre à offrir certaines perspectives légales de libération aux détenus condamnés à la perpétuité réelle, serait, en principe, conforme à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Kafkaris (précité). Dans le cas des requérants, si l’on pouvait établir avec suffisamment de certitude que le droit national actuellement en vigueur va dans ce sens, leurs peines ne pourraient passer pour incompressibles et leurs causes ne révéleraient aucune violation de l’article 3.
126. Cependant, la Cour doit s’attacher à la législation telle qu’elle se trouve actuellement explicitée dans les ordonnances publiées ou dans la jurisprudence et telle qu’elle est appliquée en pratique aux détenus condamnés à la perpétuité réelle. Or il demeure que, malgré l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Bieber, le ministre n’a pas modifié la teneur de la politique restrictive expressément énoncée par lui quant aux situations où il entend exercer le pouvoir que lui confère l’article 30. Nonobstant la lecture donnée de cette disposition par la Cour d’appel, l’ordonnance de l’administration pénitentiaire reste en vigueur et prévoit que l’élargissement ne sera ordonné que dans certains cas, qui sont énumérés de manière exhaustive et non pas cités à titre d’exemples : il faut que le détenu soit atteint d’une maladie mortelle en phase terminale ou d’une grave invalidité et que d’autres conditions soient respectées (il faut qu’il soit établi que le risque de récidive est minime, que le maintien en détention réduirait l’espérance de vie du détenu, que des dispositions adéquates ont été prises pour soigner et traiter le détenu hors de la prison et qu’une libération anticipée serait grandement dans l’intérêt du détenu ou de sa famille).
127. Ce sont là des conditions extrêmement restrictives. A supposer même qu’un détenu condamné à la perpétuité réelle puisse les remplir, la Cour estime que la chambre a eu raison de douter que la mise en liberté pour motifs d’humanité pouvant être accordée aux personnes atteintes d’une maladie mortelle en phase terminale ou d’un grave handicap physique puisse être considérée comme une véritable libération si elle se résume à permettre à l’intéressé de mourir chez lui ou dans un hospice plutôt qu’entre les murs d’une prison. De fait, aux yeux de la Cour, pareille mise en liberté pour motifs d’humanité ne correspond pas à ce que recouvre l’expression « perspective d’élargissement » employée dans l’arrêt Kafkaris (précité). En soi, les dispositions de l’ordonnance en question ne seraient pas conformes à cet arrêt et ne suffiraient donc pas à satisfaire aux exigences de l’article 3.
128. De surcroît, l’ordonnance de l’administration pénitentiaire est censée s’adresser aussi bien aux détenus qu’aux autorités carcérales. Cependant, elle ne renferme pas précisions faites à titre de réserves par la Cour d’appel dans l’arrêt Bieber, et invoquées par le Gouvernement dans ses observations devant la Cour, quant aux effets de la loi sur les droits de l’homme et de l’article 3 de la Convention sur l’exercice par le ministre du pouvoir d’élargissement que lui confère l’article 30 de la loi de 1997. En particulier, l’ordonnance n’indique pas la possibilité – offerte par la loi sur les droits de l’homme – qu’ont les détenus condamnés à la perpétuité, même à la perpétuité réelle, de demander, à un moment donné au cours de l’accomplissement de leur peine, leur élargissement pour des motifs légitimes d’ordre pénologique. Dans cette mesure, si l’on se fie aux propres observations du Gouvernement quant à l’état du droit national applicable, on peut craindre que l’ordonnance de l’administration pénitentiaire ne donne aux détenus condamnés à la perpétuité réelle – ceux qui sont directement touchés par elle – qu’une vue partielle des conditions exceptionnelles susceptibles de conduire le ministre à exercer le pouvoir que lui confère l’article 30.
129. Dès lors, eu égard au manque de clarté qui règne actuellement quant à l’état du droit national applicable aux détenus condamnés à la perpétuité réelle, la Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’article 30 de la loi de 1997 peut être considéré comme constituant une voie de droit appropriée et adéquate que les requérants pourraient exercer le jour où ils chercheraient à démontrer qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie plus leur maintien en détention et que celui-ci est donc contraire à l’article 3 de la Convention. Aujourd’hui, nul ne peut dire si, saisi d’une demande de libération formulée au titre de l’article 30 par un détenu purgeant une peine de perpétuité réelle, le ministre suivrait sa politique restrictive actuelle, telle qu’énoncée dans l’ordonnance de l’administration pénitentiaire, ou s’il s’affranchirait du libellé apparemment exhaustif de ce texte en appliquant le critère de respect de l’article 3 énoncé dans l’arrêt Bieber. Certes, tout refus de libération opposé par le ministre serait attaquable par la voie du contrôle juridictionnel et l’état du droit pourrait très bien être clarifié dans le cadre d’une telle procédure, par exemple par l’abrogation et le remplacement de l’ordonnance par le ministre ou par son annulation par le juge. Toujours est-il que ces éventualités ne suffisent pas à pallier le manque de clarté qui existe actuellement quant à l’état du droit national régissant les possibilités exceptionnelles d’élargissement des détenus condamnés à la perpétuité réelle.
130. Eu égard, dès lors, à ce contraste entre le libellé très général de l’article 30 (interprété par la Cour d’appel d’une manière conforme à la Convention, comme l’exige le droit du Royaume-Uni en application de la loi sur les droits de l’homme) et la liste exhaustive des conditions posées par l’ordonnance de l’administration pénitentiaire, ainsi qu’à l’absence d’un mécanisme spécial permettant de réexaminer les peines de perpétuité réelle, la Cour n’est pas convaincue que, à l’heure actuelle, les peines perpétuelles infligées aux requérants puissent être qualifiées de compressibles aux fins de l’article 3 de la Convention. Elle conclut donc que les exigences de cette disposition en la matière n’ont été respectées à l’égard d’aucun des trois requérants.
131. Cela étant, la Cour relève qu’aucun des requérants n’a cherché à soutenir au cours de la présente instance que plus aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie son maintien en détention. Les intéressés ont également reconnu que, quand bien même les impératifs de châtiment et de dissuasion viendraient à être entièrement satisfaits, leur maintien en détention demeurerait toujours possible pour des raisons de dangerosité. Le constat de violation prononcé dans leurs causes ne saurait donc être compris comme leur donnant une perspective d’élargissement imminent.
László Magyar c. Hongrie du 20 mai 2014, requête n° 73 593/10
Violation de l'article 8 : La Hongrie devrait réformer son système de réexamen des peines de réclusion à perpétuité, pour prévoir
les conditions d'élargissement.
La CEDH n'a pas été convaincue que, en vertu du droit hongrois, les détenus à perpétuité savaient comment faire pour pouvoir
prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions. De plus, le droit ne garantissait aucune prise en considération des changements dans la vie du
détenu et de ses progrès sur la voie de l'amendement. La Cour en a conclu que la peine infligée à M. Magyar ne pouvait passer pour compressible, ce
qui était constitutif d'une violation de l'article 3. Par ailleurs, elle a jugé que le constat de violation ne pouvait être regardé comme offrant à M.
Magyar la perspective d'une libération imminente : il n'avait même pas été soutenu en l'espèce que sa détention ne fût plus justifiée par un quelconque motif. La Cour estime en outre que cette affaire révèle un problème structurel susceptible de donner lieu à des requêtes similaires. Dès lors,
aux fins de la bonne exécution du présent arrêt, il faudrait que la Hongrie réforme son système de réexamen des peines de perpétuité réelle afin de
garantir qu’il soit examiné dans chaque cas si le maintien en détention se justifie par des motifs légitimes et de permettre aux détenus condamnés à la
perpétuité réelle de prévoir ce qu'ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d'un élargissement, et sous quelles conditions.
La Cour reconnaît que les personnes reconnues coupables d'un crime grave peuvent être condamnées à une peine d'emprisonnement à durée indéterminée si la protection du public l'exige.
Toutefois, l'article 3 doit être interprété comme imposant la compressibilité de la peine, en ce que les autorités nationales doivent pouvoir réexaminer la peine de perpétuité afin de déterminer si les détenus condamnés à cette peine ont accompli des progrès sur la voie de l'amendement tels que leur maintien en détention ne peut plus se justifier. De plus, dès que débute l'exécution de leur peine, ces détenus ont le droit de savoir ce qu'ils doivent faire pour pouvoir prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions.
La Cour distingue la présente affaire d’une affaire hongroise antérieure qui concernait une peine de perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle et relève que, au vu des règles et de la pratique, la grâce présidentielle appelle un contrôle plus strict si elle ne s'accompagne pas d'une possibilité réelle, fût-elle mince, de libération conditionnelle. Premièrement, la législation hongroise n'oblige pas les autorités et le président de la République à vérifier, dès lors qu'un détenu à perpétuité sollicite la grâce, si le maintien en détention de celui-ci se justifie. Deuxièmement, bien que les autorités aient l'obligation générale de recueillir des informations sur les détenus et de les joindre aux demandes de grâce formées par eux, la loi ne donne aucune indication précise sur les types de critères dont il faut tenir compte lors de la collecte de ces renseignements personnels et de l'examen de la demande. Enfin, ni le ministre de la Justice ni le président de la République n’ont à motiver leurs décisions lorsqu'ils statuent sur ces demandes.
Dès lors, la Cour n'est pas convaincue que l'institution de la grâce présidentielle aurait permis à tout détenu de savoir ce qu'il devait faire pour pouvoir prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions. De plus, le droit ne garantissait aucune prise en compte des progrès accomplis par les détenus à perpétuité sur la voie de l'amendement, aussi importants fussent-ils. La Cour en conclut que la peine infligée à M. Magyar ne peut passer pour compressible et viole l'article 3.
Bodein C. France arrêt du 13 novembre 2014, requête 40014/10
Non violation de l'article 3 : Condamné à perpétuité, la peine du requérant peut être révisée après 30 ans de détention à partir du jour du mandat de dépôt. Il doit encore faire 20 ans pour savoir s'il est ou non encore dangereux sachant qu'il est un criminel multi récidiviste. Cette jurisprudence est en droit ligne avec la jurisprudence habituelle de la CEDH qui cherche à protéger les citoyens contre les criminels.
53. La Cour juge utile de revenir sur ce qu’elle a rappelé, d’une part, et dit, d’autre part, dans son arrêt de Grande Chambre en l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, CEDH 2013 (extraits)).
54. Infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible peut soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Ce qu’interdit cette disposition, c’est que la peine soit de jure et de facto incompressible. Dans le cas contraire, aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 3 si, par exemple, un condamné à perpétuité qui, en vertu de la législation nationale, peut théoriquement obtenir un élargissement demande à être libéré, mais se voit débouté au motif qu’il constitue toujours un danger pour la société. En effet, la Convention impose aux États contractants de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et elle ne leur interdit pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement (§ 108). Par ailleurs, pour déterminer si une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, il faut rechercher si l’on peut dire qu’une détenu condamné à la perpétuité a des chances d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l’article 3 (§ 109).
55. En ce qui concerne les peines perpétuelles, l’article 3 doit être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (§ 119). La Cour a précisé qu’un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de connaître, dès la date d’imposition de cette peine, les conditions d’accès à un tel réexamen. En l’absence de perspective d’être un jour libéré, faute de mécanisme ou de possibilité de réexamen d’une telle peine, l’incompatibilité avec l’article 3 de la Convention en résultant prend naissance ab initio et non à un stade ultérieur de la détention (§ 122). Elle a ajouté que la forme que devait prendre le réexamen et la question de la durée subie de détention à partir de laquelle il devait intervenir relève de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux États en matière de justice criminelle et de détermination des peines. Néanmoins, elle a indiqué qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle puis des réexamens périodiques (§ 120).
56. Faisant application des principes dégagés dans l’arrêt Vinter, la Cour a récemment jugé que la seule perspective d’une libération pour motifs humanitaires, ou d’une grâce présidentielle pouvant prendre la forme du pardon - sans que le détenu ne sache ce qu’il devait faire pour que sa libération soit envisagée et quelles étaient les conditions applicables - ne sont pas des mécanismes efficients de réexamen de la peine permettant la prise en compte de l’évolution des condamnés à perpétuité (Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 203, 18 mars 2014, et, László Magyar c. Hongrie , no 73593/10, §§ 57-58, 20 mai 2014).
57. En l’espèce, il convient d’examiner les perspectives de réexamen prévues par le droit français. La Cour rappelle au préalable que le représentant du requérant n’a présenté aucune observation en réponse à celles du Gouvernement et qu’elle examinera en conséquence la requête en l’état. La Cour constate que le requérant a été condamné le 2 octobre 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité pour trois meurtres dont deux commis sur des mineurs de quinze ans précédés ou accompagnés d’un viol ; la cour d’assises, au vu de l’état de récidive résultant de la condamnation prononcée contre le requérant en 1996 (paragraphe 6 ci-dessus) a décidé qu’aucune des mesures d’aménagement de peine ne pourra lui être accordée.
58. Conformément à l’article 720-4 du code de procédure pénale (paragraphe 21 ci-dessus), à l’expiration d’une période de trente ans d’incarcération, le condamné est susceptible de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine. Pour cela, il faut que le juge de l’application des peines désigne un collège de trois experts médicaux avec mission de se prononcer sur l’état de dangerosité du condamné. Ensuite, il incombe à une commission de magistrats de la Cour de cassation de juger, au vu de l’avis du collège d’experts, s’il y a lieu de mettre fin à l’application de la décision de la cour d’assises. En cas de décision favorable, le requérant recouvrera alors la possibilité de demander un aménagement de peine. Cette procédure peut être renouvelée le cas échéant, selon le Conseil constitutionnel (paragraphe 22 ci-dessus). Le requérant dispose par ailleurs de la possibilité de saisir le président de la République d’une demande de grâce et de demander une suspension de sa peine pour raisons médicales (paragraphes 24 et 25 ci‑dessus).
59. La Cour estime d’emblée qu’il convient d’exclure de son champ d’examen la requête en grâce qui n’est qu’une faveur accordée de manière discrétionnaire par le président de la République. Le Gouvernement n’a fourni aucun exemple d’une personne purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité qui ait obtenu un aménagement de sa peine en vertu d’une grâce présidentielle (a contrario, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, §§ 258 à 260, 8 juillet 2014). Il en est de même de la suspension de peine pour raisons médicales qui, bien que constituant une garantie pour assurer la protection de la santé et du bien-être des prisonniers (Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 43 et 44, CEDH 2002‑IX), n’est pas un mécanisme qui correspond à la notion de « perspective d’élargissement » pour des motifs légitimes d’ordre pénologique (voir, dans le même sens, Vinter, § 129).
60. S’agissant du réexamen de la situation du requérant à l’issue d’un délai de trente ans, tel que prévu par l’article 720-4 du CPP, la Cour observe qu’il aura précisément pour but de se prononcer sur sa dangerosité et de prendre en compte son évolution au cours de l’exécution de sa peine. À la différence du système britannique déclaré non conforme par la Cour dans l’arrêt Vinter, en raison de l’incertitude de l’état du droit régissant les possibilités d’élargissement des détenus condamnés à la perpétuité réelle, notamment quant aux délais et conditions d’une perspective de libération « dès la date d’imposition de la peine perpétuelle », la Cour observe que l’article 720-4 prévoit un réexamen judiciaire de la période de sûreté perpétuelle, ouvert au ministère public et au condamné (paragraphe 22 ci‑dessus), dans la perspective de contrôler si des motifs légitimes justifient toujours le maintien en détention. S’il est mis fin à la décision spéciale de la cour d’assises de n’accorder aucune mesure d’aménagement de peine, le requérant sera alors éligible à ces mesures, notamment à la libération conditionnelle. La Cour ne peut spéculer sur les résultats d’un tel mécanisme, faute d’applications concrètes à ce jour de celui-ci, mais elle ne peut que constater qu’il ne laisse pas d’incertitude sur l’existence d’une « perspective d’élargissement» dès le prononcé de la condamnation. En outre, elle observe que le Conseil constitutionnel a validé les dispositions litigieuses de la loi du 1er février 1994 au motif que le juge de l’application des peines pourra y mettre fin « au regard du comportement du condamné et de l’évolution de sa personnalité » (paragraphe 22 ci-dessus).
61. Reste la question du moment où pourra intervenir ce réexamen. La Cour rappelle qu’elle n’a pas à dire à quel moment il convient de procéder à celui-ci, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux États en la matière (Vinter, précité, § 120). Elle observe que le délai de trente ans prévu à l’article 720-4 du code de procédure pénale se situe au‑delà de la « tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle » (ibidem). Toutefois, cette disposition prévoit que le relèvement de la période de sûreté en cause pourra être accordé si « le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans ». Ce libellé implique que la privation de liberté subie à compter du mandat de dépôt (paragraphe 8 ci-dessus) soit comptabilisée dans la durée d’incarcération et que cette date, soit le 1er juillet 2004, soit considérée comme le point de départ de la période de sûreté perpétuelle. Il s’agit de l’application, mutatis mutandis, du principe édicté par l’article 716-4 du code de procédure pénale (paragraphe 23 ci‑dessus) selon lequel la détention provisoire subie au cours de la procédure est déduite de la peine privative de liberté prononcée. La Cour observe à cet égard qu’il n’est pas contesté par les parties que c’est donc en 2034, soit vingt-six ans après le prononcé de la peine perpétuelle par la cour d’assises le 2 octobre 2008, que le requérant pourra saisir le juge de l’application des peines d’une demande de relèvement de la décision spéciale de la cour d’assises de ne lui octroyer aucun aménagement de peine (paragraphe 49 ci-dessus) et se voir accorder, le cas échéant, une libération conditionnelle. Au regard de la marge d’appréciation des États en matière de justice criminelle et de détermination des peines, la Cour conclut que cette possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité est suffisante pour considérer que la peine prononcée contre le requérant est compressible aux fins de l’article 3 de la Convention.
62. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Shlykov et autres c. Russie du 19 janvier 2021 requête no 78638/11
Article 3 : La Russie doit réformer le régime des menottes dans les prisons
La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des démocraties, l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, quelles que soient les circonstances. Pour que la protection de l’article 3 entre en jeu, les souffrances endurées doivent aller au-delà de ce que l’on peut raisonnablement attendre d’une détention. Pour la Cour, l’utilisation de menottes ne donne normalement pas lieu à des violations de droits ; cependant, le menottage systématique d’un prisonnier à la sortie d’une cellule peut être considéré comme une violation. La Cour observe que, dans le cas des requérants, ces derniers sont restés menottés pendant de longues périodes, durant de nombreuses années, et que cela a porté atteinte à leur estime de soi. Or il n’y avait aucune obligation légale d’imposer cette mesure. La Cour relève également qu’il ne semble pas y avoir eu de réexamen régulier du régime imposé, et qu’il n’apparaissait donc pas pour quels motifs les autorités auraient pu ordonner et maintenir les restrictions. En somme, l’imposition du port de menottes aux requérants à chaque fois qu’ils quittaient leurs cellules a constitué une violation de leurs droits. La Cour conclut également à la violation de l’article 3 en ce qui concerne le régime pénitentiaire appliqué à M. Shyklov.
Tomov et autres c. Russie du 9 avril 2019
requêtes nos 18255/10, 63058/10, 10270/11, 73227/11, 56201/13 et 41234/16
Violation de l'article 3 : La Cour constate de multiples violations pour ce qui concerne le transport des détenus en Russie : un problème systémique que l’État doit régler
La Cour estime que ces violations résultent principalement de l’adhésion des autorités à des normes dépassées en matière de transport des détenus qui prévoyaient notamment que certains détenus devaient être transportés dans des cabines faites de lourdes plaques métalliques placées dans les fourgons cellulaires, alors que d’autres devaient voyager de nuit dans des compartiments de train qui ne disposaient pas de places de couchage en nombre suffisant.
Sur le terrain de l’article 46 (exécution), la Cour indique les mesures visant à résoudre ce qui constitue un problème structurel récurrent et donne à la Russie dix-huit mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif pour mettre en place des recours internes effectifs aptes à prévenir des violations similaires
2. Sur l’observation de l’article 3 de la Convention
a) Principes généraux
114. Les principes généraux relatifs à l’interdiction absolue des traitements inhumains et dégradants dans le contexte de la privation de liberté sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. Les États doivent s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate. Le fait que les mauvaises conditions subies par le détenu ne soient pas imputables à une intention de l’humilier ou de le rabaisser doit être pris en compte mais n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3 de la Convention. En effet, il incombe à l’État défendeur d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer le respect de la dignité des détenus, indépendamment de difficultés financières ou logistiques (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96-101, 20 octobre 2016, Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, §§ 91-93, 22 mai 2012, et Ananyev et autres, [nos 42525/07 et 60800/08], §§ 139‑142, [10 janvier 2012]).
115. L’appréciation visant à déterminer si les conditions auxquelles un requérant a été soumis ont dépassé le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention dépend de l’effet cumulatif de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment de la durée pendant laquelle le requérant a subi ces conditions. Elle prend en compte les allégations spécifiques du requérant qui doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Les principes régissant les règles de preuve et la répartition de la charge de la preuve en pareil cas sont énoncés dans l’arrêt Ananyev et autres (précité, §§ 121-125) et mettent en particulier l’accent sur le rôle que doit jouer l’État défendeur dans la production des documents en sa possession.
116. En ce qui concerne les normes élaborées par des autorités nationales ou par des organisations internationales telles que le Comité pour la prévention de la torture (« le CPT »), la Cour rappelle que bien qu’elles puissent contribuer à son analyse d’une violation alléguée, elles ne sauraient constituer un élément déterminant aux fins de son appréciation au regard de l’article 3 de la Convention. La Cour doit en effet se prononcer sur des affaires individuelles au vu des faits propres à l’affaire, alors que le CPT et les autorités nationales élaborent des normes d’application générale afin de prévenir des violations analogues. Elle examinera néanmoins soigneusement les cas où il apparaît que les conditions concrètes n’ont pas respecté les normes pertinentes élaborées par le CPT (Muršić, précité, §§ 111-113).
b) Jurisprudence pertinente pour l’appréciation des conditions de transport
117. La Cour a établi une jurisprudence abondante concernant les conditions de transfert de détenus dans des fourgons cellulaires entre maisons d’arrêt et tribunaux. Depuis l’affaire Khoudoïorov ([no 6847/02], §§ 117‑119, [CEDH 2005‑X (extraits)]), dans laquelle elle s’est prononcée pour la première fois sur cette question, elle a conclu à la violation de l’article 3 dans de nombreuses affaires où les requérants avaient été transportés dans des conditions d’exiguïté extrême – moins de 0,5 mètre carré de surface au sol par personne, parfois même seulement 0,25 mètre carré (voir, entre autres, Yakovenko c. Ukraine, no 15825/06, §§ 107-109, 25 octobre 2007, Vlassov c. Russie, no 78146/01, §§ 92-99, 12 juin 2008, Starokadomski c. Russie, no 42239/02, §§ 55-60, 31 juillet 2008, Idalov, précité, § 103, Retunscaia c. Roumanie, no 25251/04, § 78, 8 janvier 2013, M.S. c. Russie, [no 8589/08], § 76, [10 juillet 2014], Korkin c. Russie, no 48416/09, § 73, 12 novembre 2015, et Radzhab Magomedov c. Russie, no 20933/08, § 61, 20 décembre 2016).
118. La Cour a aussi constaté dans certaines affaires que la hauteur des cellules à l’intérieur des fourgons – 1,60 mètre – était insuffisante pour qu’un homme de taille normale puisse y entrer ou se lever sans se pencher, ce qui obligeait les détenus à rester en position assise pendant toute la durée du trajet (Idalov, précité, § 103, et Trepachkine c. Russie (no 2), no 14248/05, § 133, 16 décembre 2010). Outre la surface au sol limitée, elle a également observé que les fourgons étaient parfois occupés par un nombre de détenus supérieur à leur capacité d’accueil, ce qui aggravait la situation des requérants (Vlassov, précité, § 93, Starokadomski, précité, § 96, et Retunscaia, précité, § 78). Elle a aussi considéré comme des facteurs aggravants une ventilation insuffisante par grande chaleur ou l’absence de chauffage lorsque le fourgon était à l’arrêt (Vlassov, précité, § 94, et Yakovenko, précité, § 109).
119. La Cour prend également en compte la fréquence des trajets effectués dans ces conditions, ainsi que leur nombre et leur durée. Elle a ainsi conclu à la violation de l’article 3 dans des affaires où les requérants avaient enduré des dizaines, voire des centaines de trajets de ce type. Elle a en revanche jugé que le seuil minimum de gravité n’avait pas été atteint dans des affaires où le requérant n’avait été soumis à de telles conditions que pendant un laps de temps limité (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 59, 26 juin 2008, où le requérant n’avait effectué que deux trajets de trente minutes dans un fourgon surpeuplé, et Jatsõšõn c. Estonie, no 27603/15, § 45, 30 octobre 2018, où le requérant avait refusé de poursuivre le trajet après être resté vingt minutes dans le fourgon).
120. En ce qui concerne les dispositifs de sécurité qui réduisent le risque de blessure dans un véhicule en déplacement, la Cour a estimé que l’absence de ceintures de sécurité ne peut en soi emporter violation de l’article 3 (Voicu c. Roumanie, no 22015/10, § 63, 10 juin 2014, et Jatsõšõn, précité, §§ 42-43). Elle a toutefois jugé que, dans certaines circonstances et en combinaison avec d’autres facteurs, l’absence de ceintures de sécurité ou de poignées peut soulever un problème au regard de l’article 3 (Engel c. Hongrie, no 46857/06, § 28, 20 mai 2010, où le requérant était paraplégique et avait été transporté sans que son fauteuil roulant ne fût arrimé dans le véhicule en déplacement, et Tararieva c. Russie, no 4353/03, §§ 112-117, CEDH 2006‑XV (extraits), où un détenu, après avoir été opéré, avait été transporté sur un brancard dans un fourgon cellulaire inadapté).
121. Un nombre plus restreint d’affaires a porté sur les conditions de transport en train. Des griefs de ce type ont principalement été soulevés par des condamnés qui avaient été transportés sur de longues distances vers le lieu où ils devaient purger leur peine d’emprisonnement (Polyakova et autres c. Russie, nos 35090/09 et 3 autres, 7 mars 2017, concernant l’affectation de détenus dans des établissements pénitentiaires éloignés en Russie). La durée totale des trajets – de douze heures à plusieurs jours – et les conditions de promiscuité auxquelles avaient été soumis les requérants, placés avec plus de dix personnes dans un compartiment de trois mètres carrés, ont constitué les éléments déterminants qui ont mené la Cour à conclure à la violation de l’article 3 (Yakovenko, précité, §§ 110-113, Soudarkov c. Russie, no 3130/03, §§ 63‑69, 10 juillet 2008, M.S. c. Russie, précité, § 79, et Dudchenko c. Russie, no 37717/05, § 131, 7 novembre 2017).
122. Dans une affaire dont la Cour avait été saisie, le requérant avait voyagé seul dans un compartiment plus petit, de deux mètres carrés, pendant soixante-cinq heures. Conformément aux règlements régissant le transport des détenus, il avait été surveillé par des gardiens qui l’avaient obligé à changer de position toutes les deux heures. La Cour a jugé que la privation de sommeil qui en était résulté avait constitué un lourd fardeau physique et psychologique pour l’intéressé (Gouliyev, [no 24650/02], §§ 61‑65, [19 juin 2008]).
c) Résumé de l’approche à suivre
123. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et pour une application uniforme et prévisible des principes généraux, la Cour juge nécessaire, comme la Grande Chambre l’a fait récemment dans l’affaire Muršić (précitée, §§ 136‑141), de résumer l’approche à suivre dans les affaires où une violation de l’article 3 est alléguée à raison de conditions de transfèrement inhumaines et dégradantes.
124. La Cour rappelle que l’appréciation de la compatibilité avec l’article 3 ne peut se réduire à un calcul purement numérique de l’espace dont disposait le détenu pendant son transfèrement. Seul un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce permet d’appréhender précisément la réalité vécue par la personne transportée (Muršić, précité, § 123, et Jatsõšõn, précité, § 41).
125. La Cour considère néanmoins que le transport de détenus dans un véhicule offrant moins de 0,5 mètre carré d’espace par personne donne lieu à une forte présomption de violation (voir la jurisprudence citée au paragraphe 117 ci-dessus). Il importe peu que l’exiguïté résulte du nombre excessif de détenus transportés ou de la capacité réduite des compartiments puisque l’analyse de la Cour porte sur les conditions objectives de transfèrement et leurs effets sur les requérants plus que sur leurs causes. Une faible hauteur de plafond qui oblige les détenus à se pencher, en particulier dans des cabines individuelles, peut exacerber leur souffrance physique et leur fatigue. Une protection inadéquate contre les températures extérieures, lorsque les cellules ne sont pas suffisamment chauffées ou ventilées, constitue un facteur aggravant (voir la jurisprudence citée au paragraphe 118 ci-dessus).
126. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut être réfutée qu’en cas de transfèrement de brève durée ou occasionnel (voir la jurisprudence citée au paragraphe 119 ci-dessus). En revanche, les effets pernicieux de la surpopulation doivent être considérés comme se faisant d’autant plus sentir que la durée du trajet est plus longue et les trajets plus fréquents, renforçant ainsi la thèse d’une violation (Idalov, précité, § 103 in fine, et Starokadomski, précité, § 57).
127. En ce qui concerne les longs voyages, notamment ceux comportant des trajets nocturnes en train, l’approche de la Cour est analogue à celle applicable à un séjour dans un lieu de privation de liberté pour une durée comparable (Fedotov c. Russie, no 5140/02, §§ 66-70, 25 octobre 2005, Sizarev c. Ukraine, no 17116/04, §§ 101-107, 17 janvier 2013, Nemtsov c. Russie, no 1774/11, §§ 117-121, 31 juillet 2014, et Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, §§ 249-250, 27 janvier 2015). Même si une surface au sol restreinte peut être tolérée grâce à l’utilisation de lits superposés, il serait incompatible avec l’article 3 que les détenus perdent une nuit de sommeil à raison d’un nombre insuffisant d’emplacements pour dormir ou de couchages inappropriés (Ananyev et autres, précité, § 148 a), Soudarkov, précité, § 68, et la jurisprudence citée aux paragraphes 121 et 122 ci‑dessus). Des éléments tels que l’incapacité à garantir à chaque détenu un emplacement individuel pour dormir, une quantité appropriée d’eau potable et de nourriture ou un accès adéquat aux toilettes aggravent sérieusement la situation des détenus au cours de leurs transfèrements et sont révélateurs d’une violation de l’article 3.
128. Enfin, la Cour tient à souligner l’importance du rôle du CPT, qui contrôle les conditions de transfèrement et élabore des normes à cette fin (paragraphe 79 ci-dessus). Lorsqu’elle statue sur les conditions de transfèrement d’un requérant, elle demeure attentive à ces normes et à leur respect par les États contractants (Muršić, précité, § 141).
d) Application aux cas d’espèce
129. À la lumière de ces principes généraux et exigences, la Cour va maintenant examiner si les faits des présents cas d’espèce ont emporté violation de l’article 3 à l’égard de chacun des requérants.
i. MM. Tomov, Vasilyev, Roshka et Barinov
130. Les requérants MM. Tomov, Vasilyev, Roshka et Barinov se plaignaient des conditions dans lesquelles ils avaient été transportés sur de longues distances dans différents types de véhicules, notamment dans des fourgons cellulaires et en train. La Cour examinera de manière globale et cumulative les conditions de ces transfèrements, composés chacun de plusieurs trajets jusqu’à la destination finale.
131. Les requérants effectuèrent la partie la plus longue de leur voyage dans un wagon réservé aux détenus. Lors de son premier trajet, M. Tomov passa une nuit dans un grand compartiment avec neuf personnes et la deuxième nuit dans un petit compartiment avec trois personnes (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). Jusqu’à treize hommes partagèrent avec M. Vasilyev le grand compartiment dans lequel il voyagea vers Iekaterinbourg, et ils furent jusqu’à onze au retour (paragraphes 46 et 48 ci‑dessus). Un transfèrement particulièrement long que M. Tomov effectua avec MM. Roshka et Barinov requit trois trajets dans un grand compartiment d’un wagon pour détenus avec respectivement cinq, sept et neuf autres détenus (paragraphes 51, 52 et 55 ci-dessus). La dernière partie de leur voyage fut la plus longue puisqu’ils passèrent trois nuits dans le train.
132. Le nombre de détenus par compartiment était généralement conforme aux instructions relatives au transport de prisonniers qui, pour les voyages de plus de quatre heures, permettaient de placer jusqu’à douze détenus dans un grand compartiment (paragraphe 67 ci-dessus). Rien n’indique que les compartiments aient été remplis au-delà de leur capacité maximale autorisée, à l’exception de celui dans lequel M. Vasilyev a été transporté vers Iekaterinbourg, qui a accueilli jusqu’à treize personnes. Le respect formel du droit interne n’est toutefois pas déterminant dans l’appréciation par la Cour d’une violation alléguée de l’article 3. Ce qui importe, c’est que chaque trajet comportait au moins une nuit en train et que seuls six couchages individuels étaient disponibles dans les grands compartiments et trois dans les petits (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Les détenus étaient parfois deux fois plus nombreux que les places disponibles pour dormir, et les couchettes de soixante centimètres de largeur trop étroites pour accueillir plus d’une personne dans des conditions normales. La demi‑couchette « pont » ne pouvait servir de couchage d’appoint en ce qu’elle était trop courte pour une personne de taille moyenne. Étant positionnée au niveau de la poitrine, elle empêchait tout mouvement dans un compartiment déjà surpeuplé et interdisait aux passagers de se tenir debout.
133. La Cour constate que les requérants MM. Tomov, Vasilyev, Roshka et Barinov ont été privés d’une, voire de plusieurs nuits de sommeil consécutives en raison du nombre insuffisant de places de couchage. Ce seul fait s’analyse en un traitement inhumain et dégradant qui a emporté violation de l’article 3 (paragraphe 127 ci-dessus), mais la Cour ne saurait ignorer plusieurs autres éléments qui ont dû aggraver les souffrances des intéressés.
134. Premièrement, le circuit de chauffage dans le wagon réservé aux détenus ne fonctionnait pas lorsque le train était à l’arrêt. En conséquence, MM. Tomov, Roshka et Barinov ont passé au moins quinze heures enfermés dans un compartiment non chauffé alors que la température extérieure était inférieure à zéro (paragraphe 55 ci-dessus).
135. Deuxièmement, en ce qui concerne les conditions matérielles de transfèrement de ces trois requérants, deux passages aux toilettes et trois récipients d’eau par jour pour un voyage d’une durée totale de soixante‑deux heures ne sauraient être considérés comme des dispositions adéquates (paragraphe 127 ci-dessus).
136. Troisièmement, les quatre requérants ont été transportés vers la gare ferroviaire et au départ de celle-ci dans un fourgon cellulaire standard composé de cellules collectives. À chaque fois, le trajet a duré d’une heure à deux heures et demie et chaque détenu avait moins de 0,5 mètre carré de surface au sol à sa disposition. Considérées isolément, ces conditions n’auraient sans doute pas atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 à raison de leur durée relativement brève et de leur caractère ponctuel. En l’espèce, elles ont toutefois immédiatement précédé ou suivi un voyage en train dans des conditions que la Cour a qualifiées ci-dessus de traitement inhumain et dégradant. Au vu de l’effet cumulatif des conditions de transport du début à la fin du trajet, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à l’égard de MM. Tomov, Vasilyev, Roshka et Barinov.
ii. Mmes Punegova et Kostromina
137. Il apparaît que les requérantes, Mmes Punegova et Kostromina, ont enduré des conditions de transport particulièrement difficiles. La réglementation applicable exigeait que certaines catégories de détenus vulnérables, dont les femmes, fussent transférées séparément des autres détenus (paragraphe 66 ci-dessus). Cette exigence avait pour but légitime de prévenir les incidents liés à la sécurité, la violence entre détenus et le harcèlement sexuel. Compte tenu du déséquilibre existant au sein de la population carcérale en général, où les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes, les cellules collectives sont généralement affectées aux hommes, tandis que les femmes sont reléguées dans d’étroites cabines en métal pendant toute la durée du transfèrement. En conséquence, Mmes Kostromina et Punegova ont à chaque trajet été placées dans des cabines individuelles, appelées stakan, mesurant 0,325 mètre carré (paragraphe 17 ci-dessus).
138. Mme Kostromina a dû voyager dans l’une de ces cabines pas moins de sept fois sur une période de trois semaines (paragraphe 34 ci-dessus). Le fait qu’elle passait généralement jusqu’à deux heures dans un espace aussi confiné est suffisant en lui-même pour conclure à une violation de l’article 3, mais la Cour ne saurait ignorer les éléments qui ont dû aggraver ses souffrances au-delà du seuil de ce qui peut être toléré dans une société civilisée. Souffrant de diabète, la requérante était corpulente. Son état exigeait qu’elle bénéficiât d’une place assise et d’un bon accès à la ventilation, afin de rendre ses conditions de transfèrement plus supportables. Les autorités compétentes n’ont toutefois pas tenu compte de ses besoins particuliers. Pire encore, elles ont placé une autre femme avec elle pendant toute la durée de chaque trajet. La Cour admet que, ce faisant, elles ont suivi à la lettre les règlements imposant la séparation des sexes, élément sur lequel les fonctionnaires se sont appuyés pour justifier leur conduite (paragraphe 35 ci-dessus). La Cour ne saurait toutefois l’accepter comme justifiant le placement de Mme Kostromina dans une situation de souffrance physique extrême. Elle juge que l’approche suivie par les agents d’escorte révèle un mépris pour le bien-être des détenus transportés, qui est incompatible avec le respect de la dignité humaine.
139. Mme Punegova a également été transportée dans une cabine individuelle. La durée de ses transferts a toutefois été bien plus courte dans les premiers temps, ne dépassant parfois pas trois minutes (paragraphe 27 ci‑dessus). Elle n’a fourni aucune information quant à la distance parcourue ou la durée de ses transferts au cours des mois suivants (paragraphe 28 ci‑dessus), mais il apparaît qu’ils étaient peu fréquents, tous les deux mois environ. La Cour juge que la présomption de violation de l’article 3 à raison d’un espace personnel restreint est réfutée par la brièveté et le caractère occasionnel de ces transferts.
140. Leur fréquence a augmenté et leur durée s’est allongée après le début du procès de Mme Punegova. Sur une période de deux mois, celle-ci a effectué au moins dix trajets, passant à chaque fois une heure et dix minutes dans une cellule individuelle pour se rendre aux audiences et pour en revenir. Il convient de relever une caractéristique de ce type de cellule : elle était composée de plaques de métal qui formaient une cabine entièrement close dont la porte était percée de petits trous pour laisser passer l’air (paragraphe 17 ci-dessus). Le détenu était ainsi totalement séparé de la zone non sécurisée du fourgon. Cette configuration avait cependant pour effet d’isoler thermiquement la cellule, empêchant ainsi le flux d’air chaud provenant du radiateur situé dans la partie centrale du fourgon de pénétrer dans la cabine. Il n’y avait pas de chauffage dans la cellule et comme le panneau arrière de la cabine était directement attaché au panneau du fourgon donnant sur l’extérieur, le froid extérieur y pénétrait. La Cour juge que les conditions du transport de Mme Punegova pendant son procès, caractérisées par un espace restreint et une exposition à de basses températures, ont emporté violation de l’article 3.
e) Conclusion
141. La Cour constate que tous les requérants ont le plus souvent été transportés dans des conditions qui satisfaisaient aux exigences du droit interne. Aucun d’entre eux n’a soutenu que des fonctionnaires avaient cherché à lui infliger des épreuves ou des souffrances. Même en l’absence de toute intention d’humilier ou de rabaisser les requérants, les conditions concrètes de leurs transfèrements en l’espèce ont toutefois eu pour effet de les soumettre à une détresse d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Ces conditions ont porté atteinte à leur dignité humaine et s’analysent en un traitement « inhumain et dégradant ».
142. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de tous les requérants, sauf en ce qui concerne les transferts de Mme Punegova avant son procès.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder à la jurisprudence gratuite sur :
- LES CONDITIONS D'ACCOUCHEMENT ET DE MATERNITÉ
- LES VIOLENCES DES AUTORITÉS CONTRE LES DÉTENUS
- LES TRANSFÈREMENTS + ISOLEMENT + FOUILLES
- LES FOUILLES CORPORELLES
- L'ÉTAT DOIT PROTÉGER LES DÉTENUS CONTRE LA VIOLENCE DES CODÉTENUS
- LES VIOLENCES ENTRE LES DÉTENUS DANS LES PRISONS EN FRANCE
CONDITIONS D'ACCOUCHEMENT ET DE MATERNITÉ
Korneykova et Korneykov c. Ukraine du 24 mars 2016 requête no 56660/12
Violation de l'article 3 : La requérante a toujours été attachée durant sa détention préventive quand elle a été l'hôpital pour accoucher. Elle et son bébé étaient dans une cellule sans eau et sans sanitaires. Ils ont été tous deux privés de nourriture. Ils ont été privés de promenade. Elle n'a eu qu'un repas par jour au moment des audiences.
La plupart des six employés de la maternité ont attesté que Mme Korneykova avait été attachée à un fauteuil d’examen gynécologique ou à son lit. Il est vrai que selon plusieurs de ces témoins, Mme Korneykova n’était pas attachée pendant son accouchement ; elle ne l’a toutefois jamais nié dans ses observations adressées à la Cour. Par ailleurs, la Cour n’est pas disposée à prendre pour argent comptant les déclarations des agents de sécurité ayant nié que la requérante avait été menottée, car ce sont eux qui étaient directement responsables de toute mesure de sécurité appliquée à celle-ci. Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour juge suffisamment établi que Mme Korneykova a été constamment attachée lors de son séjour à la maternité, du 22 au 25 mai 2012.
Un risque quelconque qu’elle se comportât de façon violente ou tentât de s’évader n’était guère imaginable au regard de son état et du fait qu’elle était sous la surveillance constante de trois agents de sécurité. En fait, il n’a jamais été allégué qu’elle se serait comportée de façon agressive vis-à-vis du personnel hospitalier ou de la police, ou qu’elle aurait tenté de s’évader ou aurait mis en danger sa propre sécurité.
En conséquence, la Cour estime au vu des circonstances que le fait d’attacher une femme pendant la phase des contractions et immédiatement après son accouchement s’analyse en un traitement inhumain et dégradant. Il y a donc eu à cet égard violation de l’article 3 de la Convention.
Concernant les conditions de détention infligées à Mme Korneykova et à son bébé. Prenant acte des photographies – fournies par le Gouvernement – montrant la cellule prévue pour les femmes avec enfants, dans laquelle les requérants ont été détenus, la Cour estime suffisamment établi que les intéressés ont séjourné dans une cellule lumineuse et en bon état.
Cependant, les allégations de Mme Korneykova concernant l’absence d’eau chaude et la fourniture irrégulière d’eau froide ainsi que l’insuffisance quantitative et qualitative de la nourriture sont corroborées par les déclarations de plusieurs autres détenues. En outre, le manque de nourriture est confirmé par le fait que la mère de la requérante lui a envoyé de nombreux colis de denrées alimentaires et le fait qu’elle a manqué au moins un repas les jours d’audience. Enfin, une photographie soumise par le Gouvernement montrant Mme Korneykova avec son bébé marchant dans une zone spécialement prévue pour les mères détenues – dotée d’un parterre floral et d’une peinture murale – n’est pas une preuve suffisamment convaincante pour réfuter le grief de Mme Korneykova relatif à la durée et au lieu de ses promenades quotidiennes en plein air avec son bébé.
En conséquence, la Cour considère que l’effet cumulé de la malnutrition d’une mère allaitante, de conditions sanitaires et hygiéniques inadéquates pour la mère et son bébé, et de l’insuffisance des promenades en plein air, a dû être d’une intensité propre à engendrer une souffrance physique et une angoisse s’analysant en un traitement inhumain et dégradant pour la mère et l’enfant, à l’origine d’une violation supplémentaire de l’article 3.
Soins médicaux dispensés au bébé de Mme Korneykova
La Cour observe que l’enfant de Mme Korneykova est resté en détention avec sa mère pendant près de six mois, et ce à partir de son quatrième jour. Nouveau-né, il était particulièrement vulnérable et avait besoin d’être sous la surveillance étroite d’un spécialiste. Or son dossier médical, fourni par le Gouvernement, montre un certain nombre d’inexactitudes et de contradictions, notamment pour ce qui concerne les dates des examens médicaux. En effet, en septembre 2012 le médecin-chef de l’hôpital pour enfants – qui assurait le suivi des nouveau-nés au centre de détention provisoire de Kharkiv – a déclaré qu’il était impossible de donner des informations sur l’état de santé de l’enfant parce que jusque-là il n’y avait eu pour lui aucune demande de soins médicaux. Dès lors, la Cour juge établi que le fils de Mme Korneykova a été privé de suivi pédiatrique du 28 mai au 10 septembre 2012, ainsi que l’intéressée l’a affirmé. Il y a donc eu une troisième violation de l’article 3, en raison du caractère inadéquat des soins médicaux dispensés au bébé de Mme Korneykova.
LES VIOLENCES DES AUTORITÉS CONTRE LES DÉTENUS
Kukhalashvili et autres c. Géorgie du 2 avril 2020 requêtes nos 8938/07 et 41891/07
Article 2 : Une opération de police pour juguler une mutinerie dans une prison a usé de la force de manière disproportionnée.
L’affaire concerne le décès des proches des requérantes, survenu lors d’une opération de police destinée à réprimer une mutinerie dans une prison où ils étaient détenus. Tout d’abord, la Cour relève divers manquements dans l’enquête menée par les autorités sur les circonstances dans lesquelles une force antiémeute a jugulé les troubles qui avaient éclaté dans la prison, lorsque les proches des requérantes ont été tués. À titre d’exemple, les premières mesures d’enquête ont été adoptées par le service pénitentiaire, c’est-à-dire l’organe même qui avait ordonné et mis en œuvre les mesures antiémeute. La Cour juge également que, si les services répressifs étaient peut-être fondés à décider d’employer la force meurtrière face aux tirs de détenus en rébellion, le niveau de force employé n’était pas absolument nécessaire. C’est ce qu’il ressort, entre autres, du défaut de planification adéquate de la réaction des services répressifs, de l’usage d’une force meurtrière aveugle et excessive, et du fait que les autorités n’ont pas par la suite apporté une assistance médicale adéquate aux détenus.
FAITS
Les requérantes, Sofio Kukhalashvili, Marina Gordadze et Rusudan Chitashvili, sont trois ressortissantes géorgiennes nées respectivement en 1977, en 1956 et en 1938. Elles résident en Géorgie. La première et la deuxième requérante sont respectivement la sœur et la mère de Z.K., et la troisième requérante est la mère de A.B. Les deux hommes, Z.K. et A.B., étaient détenus à la prison n o 5 de Tbilissi, où ils ont trouvé la mort en mars 2006, lors d’une opération menée par la police antiémeute. Ils avaient respectivement 23 ans et 29 ans. L’opération antiémeute eut lieu en réaction à des troubles ayant éclaté après que les autorités avaient extrait d’un hôpital pénitentiaire six chefs de gang supposés et leurs proches complices. Le but des autorités avait été de réduire l’influence supposée de ces chefs de gang dans le milieu carcéral mais l’extraction de ceux-ci par la force avait déclenché des troubles dans les prisons n os 1 et 5, proches des lieux. Les autorités eurent recours à une brigade antiémeute afin d’endiguer les troubles particulièrement intenses qui régnaient dans la prison n o 5. Ces incidents causèrent la mort de sept détenus et firent 24 blessés (22 détenus et deux agents pénitentiaires).
Par la suite, les requérantes obtinrent du parquet des documents relatifs au décès de leurs proches, indiquant que tous deux avaient été blessés par balles. Les procureurs indiquèrent séparément à chaque famille que la force meurtrière avait été utilisée contre Z.K. et A.B. « dans un moment d’extrême urgence ». Ils refusèrent d’accorder aux requérantes la qualité de partie civile dans les affaires relatives à la mort de leurs proches. Les informations que le Gouvernement a soumises à la Cour européenne montrent notamment que les autorités ont mené des investigations sur l’émeute et sur l’usage de la force par la police. Six détenus – les prétendus chefs de gang et leurs proches complices – furent finalement inculpés pour instigation de l’émeute et condamnés à des peines d’emprisonnement. La juridiction du fond établit que des détenus de la prison n o 5 avaient jeté des morceaux de briques et de fer sur des agents pénitentiaires et que la brigade antiémeute avait riposté en utilisant des balles en caoutchouc. Des détenus avaient ensuite tiré à l’aide de pistolets Makarov et de pistolets à gaz, et avaient résisté jusqu’à l’intervention d’agents pénitentiaires et des forces antiémeute. Par ailleurs, le parquet ouvrit des dossiers séparés concernant, d’une part, un éventuel abus de pouvoir commis par la police et les agents pénitentiaires du fait qu’ils avaient ouvert le feu lors de l’émeute et, d’autre part, d’éventuels homicides sur les personnes de Z.K. et de A.B. Des mesures d’enquête furent adoptées dans la première affaire mais il n’est pas certain qu’il en aille de même pour la seconde, relative au décès de Z.K. et de A.B.
Article 2 et article 13
Obligation d’enquêter
La Cour examine tout d’abord les griefs des requérantes du point de vue de l’obligation incombant à l’État de mener une enquête effective sur les homicides illégaux ou décès suspects (volet procédural de l’article 2) et elle rappelle sa jurisprudence en la matière. Selon des informations fournies par le Gouvernement, l’enquête sur l’usage de la force par les services répressifs à la prison n’a débuté qu’en juin 2006, ce qui pour la Cour représente un délai bien trop long eu égard à l’ampleur des événements et au risque qu’après un si long laps de temps les informations importantes ne puissent plus être recueillies. En outre, les autorités ont dans un premier temps refusé d’ouvrir une enquête séparée sur le recours à une force supposément disproportionnée, estimant que cet aspect était déjà couvert par les mesures d’enquête adoptées lors de la procédure pénale ayant visé les six instigateurs allégués de l’émeute. Or cette enquête a été menée par le service pénitentiaire, c’est-à-dire l’organe même qui avait organisé la riposte à l’émeute. Par ailleurs, cette enquête n’a pas porté sur la planification de l’opération ni sur l’utilisation de la force physique ou meurtrière ayant tué ou blessé des détenus. Même lorsque les autorités ont ouvert une enquête pénale distincte sur le recours à la force, en juin 2006, les requérants n’y ont pas été associés en tant que victimes, ce qui les a privés d’importants droits procéduraux. La participation des familles de Z.K. et de A.B. et le droit de regard du public sur l’enquête ont donc été pratiquement inexistants. Enfin, l’enquête n’a toujours pas abouti à des constats définitifs, ce qui constitue un retard excessif incompatible avec les obligations qui découlent de l’article 2. La Cour conclut que l’enquête pénale sur l’usage de la force par les services répressifs semble avoir été ineffective, eu égard à son ouverture tardive, à son défaut d’indépendance et d’impartialité, au défaut d’association des proches et aux retards excessifs. Il y a donc eu violation de l’article 2 sous son volet procédural. Compte tenu de cette conclusion, la Cour juge qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13.
Le recours à la force
La Cour recherche ensuite si l’usage de la force meurtrière contre les proches des requérantes était légitime (volet matériel de l’article 2). N’ayant pas d’informations directes sur les faits qui se sont produits à la prison, la Cour doit se reposer sur les constats opérés au niveau interne. Or les juridictions n’ont pas achevé l’examen de cette question du recours à la force et aucune enquête parlementaire n’a été menée, ce que la Cour juge regrettable compte tenu de l’ampleur des événements. Il revenait donc au gouvernement défendeur d’expliquer de manière satisfaisante et convaincante le déroulement des faits et de produire des éléments de preuve solides afin de réfuter les allégations des requérantes relatives à l’usage d’une force meurtrière disproportionnée par des agents de l’État. Si le Gouvernement n’en a rien fait, la Cour peut en tirer de solides conclusions. La Cour peut également se servir de tous les éléments dont elle dispose, notamment de rapports d’organisations de défense des droits de l’homme tels que ceux établis par Amnesty International et Human Rights Watch dans cette affaire. Les conclusions factuelles auxquelles aboutit la Cour doivent reposer sur le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Au vu des éléments qui sont en sa possession, la Cour constate que la conduite des détenus qui se sont barricadés dans la prison n o 5 et ont tiré en direction des agents des forces de l’ordre au moment des troubles faisait penser à une tentative de soulèvement. Confronté à une violence illégale et à un risque d’insurrection, l’État défendeur était donc fondé à recourir à des mesures impliquant une force potentiellement meurtrière pouvant être compatible avec les buts énoncés à l’article 2 § 2 a) et c) de la Convention. Se pose toutefois la question de savoir si le recours à la force meurtrière était « absolument nécessaire », en particulier à la lumière du nombre de personnes qui ont été tuées ou blessées. Pour apprécier la proportionnalité du recours à la force meurtrière, la Cour relève que les autorités connaissaient le risque que les six chefs de gang supposés et leurs complices ne provoquent des troubles à la prison lors de leur extraction. Or la brigade antiémeute n’avait pas reçu d’instructions ou d’ordres spécifiques quant à la forme et à l’intensité d’une éventuelle force meurtrière qui permettrait de limiter autant que possible le nombre de victimes potentielles.
Le Gouvernement n’a pas non plus établi que la brigade antiémeute avait agi de manière contrôlée et systématique, avec une chaîne de commandement claire. Selon les éléments recueillis par Human Rights Watch, les autorités ne savaient même pas exactement qui était responsable de l’opération. Apparemment, les autorités n’ont pas non plus pensé à employer du gaz lacrymogène ou des canons à eau, omission qui est semble-t-il résultée d’un défaut de planification stratégique. Par ailleurs, la possibilité d’atténuer la crise en négociant avec les détenus barricadés n’a pas été suffisamment envisagée. En outre, les autorités n’ont pas fourni une assistance médicale adéquate aux détenus de la prison n o 5 à l’issue de l’opération, alors que de telles dispositions auraient dû être prises. La Cour relève l’existence de comptes rendus fiables, recueillis par des observateurs internes mais aussi internationaux, selon lesquels de nombreux détenus se sont vu infliger des mauvais traitements par des agents des forces spéciales et se sont même fait tirer dessus dans leurs cellules alors qu’ils n’opposaient plus de résistance. Enfin, ni les autorités nationales ni le gouvernement défendeur n’ont fourni d’informations sur le sort de Z.K. et celui de A.B., qui ont été tués lors de l’opération. La Cour conclut que Z.K. et A.B. ont succombé à une force meurtrière qui, bien qu’ayant poursuivi des buts légitimes visés à l’article 2, ne peut être considérée comme ayant été « absolument nécessaire » au sens de cette disposition. La Cour rappelle que l’opération antiémeute n’a pas été menée de manière contrôlée et systématique et que les agents des services répressifs n’ont pas reçu d’ordres ou d’instructions clairs qui auraient visé à limiter autant que possible le risque qu’il y ait des victimes. Les autorités n’ont pas envisagé de recourir à des moyens moins violents pour faire face à un incident de sécurité, par exemple la négociation pour résoudre la crise. La force meurtrière employée pendant l’opération antiémeute a été aveugle et excessive et les autorités n’ont pas fourni d’assistance médicale adéquate aux victimes. Elles n’ont pas non plus rendu compte des circonstances individuelles dans lesquelles Z.K. et A.B. avaient trouvé la mort. La Cour conclut que l’opération antiémeute a emporté violation de l’article 2 sous son volet matériel.
Satisfaction équitable (article 41)
La Cour dit que la Géorgie doit verser pour préjudice moral 40 000 euros (EUR) à la première et à la deuxième requérante conjointement, et 32 000 EUR à la troisième requérante. Elle dit également que la Géorgie doit verser pour frais et dépens 5 400 EUR à la première et à la deuxième requérante conjointement, et 3 400 EUR à la troisième requérante
J.M. c. FRANCE du 5 décembre 2019 Requête no 71670/14
Violation de l'article 3 : Violence des gardiens de prison contre un détenu. Violation sur le plan matériel car les faits sont avérés et violation sur le plan procédural, car l'enquête du juge d'instruction n'était pas effective.
a) Sur le volet matériel
Les principes généraux
83. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, et Ghedir et autres c. France, no 20579/12, § 108, 16 juillet 2015).
84. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Ketreb c. France, no 38447/09, § 108, 19 juillet 2012, et Ghedir, précité, § 109).
85. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré, étant entendu que la circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, entre autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999‑IX, Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 114, CEDH 2014 (extraits), et Boukrourou et autres c. France, no 30059/15, §§ 79 et 87, 16 novembre 2017).
86. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (voir, parmi d’autres, Gäfgen c. Allemagne, [GC], no 22978/05, § 89, CEDH 2010, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 88, CEDH 2015). Il faut en outre préciser qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011).
87. Par ailleurs, au regard des faits de la cause, la Cour est consciente du potentiel de violence existant dans les établissements pénitentiaires et du fait que la désobéissance des détenus peut rapidement dégénérer et rendre la situation ingérable (Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 77, 21 décembre 2006, et Tali c. Estonie, no 66393/10, §§ 59 et 75, 13 février 2014). La Cour admet que le recours à la force peut parfois être nécessaire pour assurer la sécurité dans les prisons, maintenir l’ordre ou prévenir la criminalité dans les lieux de détention. Néanmoins, elle estime particulièrement important de souligner que lorsqu’une personne est privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de cette personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Bouyid, précité, § 88, et Alboreo c. France, no 51019/08, § 87, 20 octobre 2011).
88. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006 IX). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Gäfgen, précité, § 92,).
89. Sur ce dernier point la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en détention, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII, et Gäfgen, précité, § 87). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 152, CEDH 2012, et Bouyid, précité, § 83). Cela est justifié par le fait que les personnes détenues sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Salman, précité, § 99).
L’application de ces principes au cas d’espèce
90. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que les surveillants pénitentiaires ont, à plusieurs reprises, entre le 5 et 6 juillet 2007, usé de la force à l’encontre du requérant : lors de son placement au quartier disciplinaire le 5 juillet 2007, au moment de l’intervention avec une lance à incendie dans sa cellule dans la nuit du 5 au 6 juillet 2007, puis lors de sa sortie de cellule le lendemain matin.
91. Elle retient par ailleurs que quatre certificats médicaux différents (paragraphes 21, 23-24, 27 et 38 ci-dessus), dont le premier a été établi dès le lendemain des faits dénoncés, constatent de nombreuses lésions sur l’ensemble du corps et du visage du requérant et en particulier une trace qualifiée de strangulation par le Dr R. Le Dr S. décrit en effet un sillon linéaire rouge au niveau du cou mesurant 18 cm de long et 3 mm de large, dans la région basse du cou, sous la glotte, et légèrement ascendant (paragraphe 23 ci-dessus). Ce médecin légiste conclut que les multiples lésions d’origine traumatiques relevées sont compatibles avec les déclarations du requérant. Outre les souffrances physiques que le requérant a dû supporter, la Cour considère que l’on peut retenir que le traitement auquel il a été soumis a engendré peur, angoisse et souffrance mentale, ainsi qu’en atteste le Dr U. Ce médecin a en effet observé un traumatisme psychologique important chez le requérant à la suite des faits allégués.
92. Se pose donc la question de savoir si, au vu notamment de l’ensemble des constatations des autorités internes, la force physique dont il a été fait usage à l’encontre du requérant était ou non rendue strictement nécessaire par son comportement.
93. La Cour relève avec les juridictions internes (paragraphes 43 et 48 51 ci-dessus) que le requérant était dans un état d’extrême agitation. La virulence de J.M. résulte des déclarations concordantes du personnel pénitentiaire et de ses actes : refus de regagner sa cellule, mise à feu de papiers provoquant un risque d’incendie, destruction des sanitaires dans sa cellule.
94. Néanmoins, la Cour observe que le requérant était en état de détresse psychique et que le matin du 5 juillet 2007, il a été emmené à l’UCSA à la suite d’entailles au bras qu’il s’était infligées. La cour d’appel fait par ailleurs état de quatre tentatives de pendaison (paragraphe 55 ci-dessus). En raison de ses troubles psychiques et de sa privation de liberté, le requérant était donc particulièrement vulnérable (Renolde c. France, no 5608/05, § 84, CEDH 2008 (extraits)) et cet aspect primordial doit être pris en considération dans l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité de la force utilisée par les agents pénitentiaires (Tekın et Arslan, précité, § 103). La Cour a déjà pu observer que l’usage de la force par les forces de l’ordre sur une personne vulnérable pouvait avoir pour effet d’amplifier son agitation et sa résistance (Boukrourou et autres, précité, § 85). L’inspection des services pénitentiaires a d’ailleurs critiqué le manque de professionnalisme et de discernement de la première surveillante, Mme L., intervenue lors de la sortie de cellule du requérant, et lui a notamment reproché de ne pas avoir essayé, avant l’usage de la force, de le calmer (paragraphe 35 ci-dessus).
95. D’autre part, la Cour note que, exceptée l’intervention rendue indispensable par le risque d’incendie, il ne s’agissait pas d’interventions nécessaires pour maîtriser une personne qui constituait une menace pour la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes (Tekın et Arslan, précité, § 101). Les actions entreprises, au cours desquelles le requérant s’est vivement débattu, avaient pour but de conduire le requérant au quartier disciplinaire ou en salle d’attente en vue de son transfert.
96. Concernant le risque d’incendie, la Cour relève que l’inspection des services pénitentiaires a elle-même jugé l’usage d’une lance à incendie disproportionné au regard de l’ampleur limitée du sinistre et de la situation qui ne présentait pas un caractère d’urgence absolue (paragraphe 34 ci‑dessus). Comme l’a indiqué à juste titre l’ISP, l’usage d’une lance à incendie plutôt que d’un extincteur ne pouvait qu’inonder une cellule de neuf mètres carrés. Ce manque de discernement du surveillant a eu pour conséquence un arrosage intempestif du requérant et de son paquetage, le contraignant à passer la nuit avec pour seul vêtement un tee-shirt mouillé, générant ainsi un sentiment d’humiliation.
97. La Cour relève par ailleurs que les dénégations de l’ensemble des surveillants, qui réfutent avoir entravé les pieds du requérant avec du scotch le 6 juillet 2007, sont démenties par le surveillant M. Q. Ce responsable du transfert, atteste qu’il a trouvé le requérant prostré dans la salle d’attente, à moitié nu, les mains menottées dans le dos et les pieds attachés avec du scotch (paragraphe 15 ci-dessus). De plus, dans un courrier à sa hiérarchie, un autre surveillant, M. V., fait état d’un « passage à tabac » concernant les faits subis par le requérant (paragraphe 39 ci-dessus). Au regard de ces témoignages, la Cour s’interroge sur le crédit à accorder aux déclarations des surveillants affirmant qu’ils ont fait un usage de la force strictement proportionné. Elle observe, en outre, que les différents certificats médicaux produits établissent de très nombreux hématomes et contusions sur le corps du requérant.
98. De plus, malgré les enquêtes diligentées et l’information judiciaire, l’origine de la marque de strangulation type fil hémicirconférentielle de 18 cm constatée sur le cou du requérant reste inconnue. La cour d’appel a considéré que ces marques pouvaient être dues aux conséquences du blocage du requérant à l’aide d’un bouclier plaqué contre son torse, et dont le rebord légèrement incurvé, aurait pu entrer en contact avec la gorge de ce dernier. Cependant, la Cour ne trouve pas dans la description de la blessure en cause des éléments de nature à étayer cette hypothèse qu’aucune expertise médicale n’est venue confirmer.
99. Enfin, il n’est pas contesté que, lors de ce transfert qui a duré près de quatre heures, le requérant a été conduit du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence vers celui de Varennes-le-Grand vêtu uniquement d’un tee-shirt et muni seulement d’un drap pour tenter de cacher sa nudité. L’ISP a d’ailleurs conclu que le responsable du transfert aurait dû attendre l’ouverture du vestiaire et la remise de vêtements appropriés au requérant (paragraphe 36 ci-dessus). La Cour ne doute pas qu’un tel traitement a provoqué chez le requérant des sentiments d’arbitraire, d’infériorité, d’humiliation et d’angoisse. Ce traitement constitue un grave manque de respect pour sa dignité humaine. La circonstance qu’il n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser le requérant n’exclut pas qu’il soit qualifié de dégradant et tombe ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3.
100. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que le requérant a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention.
101. Il s’ensuit qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3.
b) Sur le volet procédural
Les principes généraux
102. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts El-Masri (précité, §§ 182-185) et Bouyid (précité, §§ 114-123).
103. Il en ressort que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV). Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Bouyid, précité, § 120).
104. En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Gäfgen, précité , § 121, et Jeronovičs, précité, § 106).
105. D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut également que les institutions et les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (Bouyid, précité, § 118).
L’application de ces principes au cas d’espèce
106. Dans la présente affaire, la Cour relève que des enquêtes indépendantes ont été menées avec célérité concernant les événements dénoncés par le requérant. Le jour même de l’arrivée du requérant au centre de détention de Varennes-Le-Grand, le parquet a diligenté d’office une enquête sur les circonstances du transfert du requérant et les violences qu’il dénonçait. La Cour observe surtout qu’une instruction a été conduite par un juge. Si l’enquête administrative interne et celle de l’inspection des services pénitentiaires ont été versées au dossier d’instruction, le magistrat ne s’est pas contenté d’en reprendre les conclusions, mais a entendu et interrogé le requérant comme l’ensemble des surveillants mis en cause, avant de rendre une ordonnance de non-lieu motivée. L’instruction s’est certes déroulée en conformité avec les prescriptions légales et elle était entre les mains d’une autorité indépendante. Cependant, la Cour relève que l’enquête n’a pas mené à l’identification et à la punition des responsables des traitements inhumains et dégradants qu’elle a constatés.
107. Elle observe à ce titre que la juge d’instruction s’est limitée à entendre les surveillants, sous le statut de témoins assistés. De l’avis de la Cour, la juge d’instruction, comme la chambre de l’instruction, semblent avoir appliqué des critères différents lors de l’évaluation des témoignages, celui du requérant étant considéré comme subjectif, à l’inverse de ceux des surveillants. La crédibilité de ces derniers témoignages aurait également dû être minutieusement vérifiée, dans la mesure où l’enquête était censée établir si les surveillants étaient responsables d’infractions pénales (Barabanchtchikov c. Russie, no 36220/02, § 61, 8 janvier 2009) et où de sérieux éléments de doutes résultaient du dossier.
108. À ce titre, la Cour relève que le magistrat instructeur n’a ni procédé à une confrontation entre les surveillants ayant des déclarations contradictoires ni entendu le surveillant M. V. qui, dans un courrier à sa hiérarchie, a dénoncé le « passage à tabac » subi par le requérant (paragraphes 15, 39 et 97 ci-dessus). Enfin, la juge d’instruction n’a pas ordonné d’expertise médicale et technique, afin d’établir si la marque de strangulation constatée avait pu être causée ou non par l’usage normal d’un bouclier. De telles mesures étaient pourtant nécessaires pour tenter d’éclaircir les faits.
109. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’une enquête effective. Elle conclut en conséquence à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
Ebru Dinçer c. Turquie du 29 janvier 2019 requête n° 43347/09
Violation de l’article 3 dans une affaire où une détenue a été gravement brûlée lors d’une opération policière dans la prison de Bayrampaşa
L’affaire concerne une opération menée par les forces de l’ordre dans la prison Bayrampaşa (Istanbul), en décembre 2000, au cours de laquelle Mme Dinçer fut gravement brûlée sur différentes parties de son corps, notamment au visage, en raison d’un incendie dans le dortoir des femmes. La Cour juge en particulier que seule une enquête ou une procédure efficace pouvait permettre de déterminer l’origine de l’incendie. Or, à ce jour, la lumière n’a toujours pas été faite sur l’origine de l’incendie et, 18 ans après les faits, la procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises. En outre, les procédures diligentées n’ont pas démontré que l’usage de la violence à l’origine des souffrances physiques et psychiques de Mme Dinçer avait été rendu inévitable par son propre comportement.
CEDH
59. La Cour rappelle que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État ‑ comme pendant les opérations telles que celle incriminée en l’espèce –, la charge de la preuve incombe au gouvernement défendeur ; ainsi, c’est à celui-ci qu’il appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les allégations formulées à son endroit, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits litigieux et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, précisément, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui y figurent, Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 60, 23 juin 2009, Perişan et autres, précité, § 92, İsmail Altun, précité, § 69, Erol Arıkan et autres, précité, § 82, et Kavaklıoğlu et autres, précité, § 234).
60. Or, la Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur l’opération anti-mutinerie en cause en l’espèce dans le cadre des affaires İsmail Altun (précitée, § 78), Düzova (précitée, § 91), Şat c. Turquie (no 14547/04, § 81, 10 juillet 2012) et Erol Arıkan et autres (précitée, § 84) et qu’elle a conclu que le Gouvernement n’avait pas été en mesure de donner des explications suffisantes concernant l’origine des blessures dénoncées en l’occurrence, en fournissant notamment des éléments se rapportant directement à la préparation et à la conduite de l’intervention.
Dans la présente affaire, la Cour n’aperçoit aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente, notamment pour ce qui est des deux points cruciaux suivants.
61. Premièrement, la Cour constate une fois de plus que nul ne saurait tirer argument des « agissements » de la requérante lors des événements ou de son comportement (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Selmouni, précité, § 95, Perişan et autres, précité, §§ 92 et 95, et Kavaklıoğlu et autres, précité, § 234 et les références qui y figurent), puisqu’aucun élément vérifiable du dossier ne donne à penser que l’intéressée ait activement résisté aux forces de l’ordre ou les ait attaquées. Elle note que l’action publique intentée contre la requérante pour rébellion s’est éteinte par prescription et que cette extinction a été confirmée par un arrêt du 13 février 2012 de la Cour de cassation (paragraphes 25 et 26 ci‑dessus). Elle note également que le fait que, au mépris de cette situation de droit, le Conseil d’État ait simplement évoqué dans son arrêt rendu deux mois plus tard que la requérante « figurait » parmi les insurgés (paragraphe 27 ci-dessus) n’emporte aucune conséquence sur cet aspect précis.
62. Deuxièmement, la Cour observe, comme dans l’affaire Erol Arıkan et autres, que la lumière n’a toujours pas été faite sur l’origine de l’incendie litigieux. Elle relève que la requérante soutient que le feu s’est déclaré dans le dortoir qu’elle occupait en raison des grenades lancées par les forces de l’ordre, ce que le Gouvernement ne conteste pas (paragraphe 58 ci-dessus). Elle note que cette thèse n’est pas non plus réfutée par l’institut médicolégal (paragraphe 9 ci-dessus), selon lequel il était impossible de déterminer avec exactitude la raison de l’incendie ; seuls les pompiers ont présumé qu’il avait été déclenché volontairement par les détenues (paragraphe 8 ci‑dessus).
63. Il n’appartient pas à la Cour de tirer des conclusions de pareilles divergences qui ne font qu’accentuer le problème au cœur du litige. À ses yeux, seule une enquête ou une procédure efficace pouvait permettre de déterminer l’origine de l’incendie. Or force est de parvenir ici au même constat que dans les affaires mentionnées ci-dessus (paragraphe 59) : près de dix-huit ans après les faits dénoncés, la procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises de Bakırköy et les circonstances dans lesquelles le feu s’est déclaré dans la cellule où se trouvait la requérante n’ont toujours pas été établies (voir, dans le même sens, Erol Arıkan et autres, précité, §§ 90 et 91).
64. Force est donc de relever que, à ce jour, les procédures diligentées n’ont toujours pas permis de fournir les éléments propres à justifier les blessures subies par la requérante, c’est-à-dire, à démontrer que l’usage de la violence à l’origine de ses souffrances physiques et psychiques avait été rendu inévitable par son propre comportement.
65. Partant, la Cour rejette l’exception tirée de la litispendance du procès actuellement en instance devant la cour d’assises de Bakırköy (paragraphes 21, 39 et 40 ci-dessus) et conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.
GHEORGHE DIMA c. ROUMANIE du 19 avril 2016 requête 2770/09
Violation de l'article 3 : Pas d'enquête effective sur les violences des gardiens contre les détenus. Les gardiens avaient fait signé que les violences étaient commises entre les détenus pour se protéger.
a) Les principes applicables
98. La Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des sévices contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII et Ion Bălăşoiu c. Roumanie, no 70555/10, § 85, 17 février 2015).
99. L’enquête menée doit être « effective » en pratique comme en droit et ne pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV (extraits)). Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 98, Recueil 1996‑VI et Alboreo c. France, no 51019/08, § 148, 20 octobre 2011). S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV et Batı et autres, précité, § 134).
100. Certes, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens (voir, parmi d’autres, l’arrêt Assenov et autres, précité, §§ 103 à 105). Les autorités sont tenues de préserver et recueillir les preuves nécessaires à l’établissement des faits, qu’il s’agisse – par exemple – des dépositions de témoins ou des preuves matérielles (Zelilof c. Grèce, no 17060/03, § 56, 24 mai 2007). Nul doute qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, par exemple, Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001, et Özgür Kılıç c. Turquie (déc.), no 42591/98, 24 septembre 2002).
b) L’application de ces principes en l’espèce
101. La Cour note que le requérant a subi des blessures graves, confirmées par des certificats médicolégaux, alors qu’il se trouvait en prison sous la responsabilité d’agents de l’État. Elle estime dès lors que le requérant avait sous l’angle de l’article 3 de la Convention un grief défendable qui appelait, de la part de l’État, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, CEDH 1999‑V).
102. La Cour constate, certes, qu’une enquête a été ouverte au niveau interne en décembre 2008 à la suite de la plainte dans laquelle le requérant alléguait avoir subi des actes de torture et autres mauvais traitements de la part d’agents de l’État. Il reste à apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée.
103. La Cour note qu’au fil du temps, l’enquête avait poursuivi plusieurs pistes afin d’identifier l’agresseur du requérant : l’enquête s’était concentrée d’abord sur les responsables de la prison et du groupe spécial d’intervention, pour se diriger pendant deux années environs vers les détenus et revenir ensuite vers les membres du groupe spécial d’intervention et l’un des responsables de la prison.
104. La Cour constate qu’un premier non-lieu a été rendu dans l’affaire le 11 janvier 2010 par le parquet près la cour d’appel de Bucarest en faveur des responsables de la prison. Par la suite, se fondant sur les déclarations des membres du groupe spéciale d’intervention faites en 2010 et selon lesquelles les détenus s’étaient agressés réciproquement (paragraphe 41 ci‑dessus), le parquet près le tribunal départemental a rendu une ordonnance de non-lieu, en estimant qu’il ne ressortait pas du dossier que les membres du groupe d’intervention aient soumis le requérant à des mauvais traitement et à la torture, et ordonna la continuation de l’enquête du chef de coups et blessures. Ce constat fut suffisant pour déterminer le parquet à élargir l’enquête en direction des détenus. Ainsi du 7 juin 2011 à 6 décembre 2012, une enquête fut menée contre les détenus et elle a pris fin par un non-lieu, au motif qu’il ne ressortait pas des preuves que les détenus aient agressé le requérant.
105. Tout en prenant note de ce que des actes d’enquête ont été réalisés de manière constante par le parquet, la Cour note qu’en l’espèce, ses efforts de faire avancer l’enquête et d’identifier rapidement les responsables ont été ralentis de manière considérable en raison des déclarations contradictoires faites par les agents de l’État, à savoir les membres du groupe spéciale d’intervention. Malgré le fait qu’enquête soit ouverte contre eux dès décembre 2008, les membres du groupe spécial d’intervention n’ont été identifiés et interrogés qu’au début de l’année 2010, soit plus d’un an après les faits (paragraphes 29 et 41 ci-dessus). Bien que rien ne suggère qu’ils se soient entendus entre eux ou avec les cadres de la prison mis en cause dans le cadre de la même plainte pendant ce laps de temps, le simple fait que des démarches appropriées n’aient pas été entamées rapidement pour réduire le risque de collusion entre ces personnes a eu un impact négatif sur la diligence avec laquelle l’enquête a été menée (voir, mutatis mutandis, Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 330, CEDH 2007‑II et Buntov c. Russie, no 27026/10, § 127, 5 juin 2012).
106. La Cour note ensuite que lorsqu’ils ont été entendus dans le cadre des poursuites pénales, les membres du groupe spécial d’intervention ont changé leurs déclarations initiales : si lors des déclarations données pendant l’enquête pénale ils avaient déclaré que les détenus s’étaient agressés entre eux (paragraphe 41 ci-dessus) et qu’ils n’avaient pas observé qui avait frappé le requérant lors de l’incident (paragraphe 51 ci-dessus), lors de leur interrogatoire réalisé dans le cadre des poursuites pénales, à savoir cinq ans et trois mois environ après les faits, ils ont tous déclaré que le requérant avait été frappé par J.I.D. (paragraphe 68 ci-dessus). A la lumière de ces nouvelles déclarations, toute l’enquête menée antérieurement quant aux cadres de la prison et surtout à l’encontre des détenus s’est avérée inutile.
107. La Cour est frappée par ce changement du contenu des déclarations données par des agents de l’État et trouve désinvolte cette attitude, d’autant plus qu’aucune explication ne ressort du dossier quant à ce changement. Elle estime que les agents de l’État doivent agir de manière responsable alors qu’ils sont interrogés sur des allégations de mauvais traitement et aider les organes d’enquête à éclaircir rapidement les faits et non pas à rendre leur travail encore plus difficile. Par ailleurs, la Cour rappelle l’importance, en cas d’allégation de mauvais traitement, que les mis en cause et les témoins soient interrogés dans un cadre légale qui garantit la validité des preuves recueillies (Maslova et Nalbandov c. Russie, no 839/02, §§ 94-96, 24 janvier 2008 et Lyapin c. Russie, no 46956/09, § 133, 24 juillet 2014).
108. La Cour note également d’autres aspects qui ont ralenti en l’espèce l’enquête. Ainsi, elle observe l’impossibilité pour les enquêteurs d’identifier le responsable des actes dirigés contre le requérant, vu que lors de l’intervention, tous les membres du groupe portaient des cagoules (paragraphe 60 ci-dessus). Elle se réfère au non-lieu du 21 juin 2013 du parquet près le tribunal départemental de Bucarest qui avait conclu qu’étant donné qu’ils portaient des cagoules, les membres du groupe spécial d’intervention ne pouvaient pas être identifiés. À cet égard, elle réaffirme que, lorsque les circonstances sont telles que les autorités doivent déployer des agents cagoulés pour procéder à une arrestation, il faut que ces agents soient tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permette par la suite de les identifier en cas de contestation de la part des personnes appréhendées (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 92, 11 octobre 2011 et Antayev et autres c. Russie, no 37966/07, § 109, 3 juillet 2014). À la suite d’une cassation avec renvoi, des poursuites pénales ont été ouvertes contre les membres du groupe d’intervention qui ont changé le contenu de leurs déclarations antérieures.
109. De surcroit, la Cour note qu’en l’espèce, comme l’ont d’ailleurs remarqué le parquet près le tribunal de première instance et le tribunal départemental de Bucarest (paragraphes 58 et 63 ci-dessus), une preuve qui eût été déterminante pour accréditer ou infirmer les allégations de mauvais traitements du requérant et permettre ainsi à l’enquête d’avancer était l’enregistrement vidéo réalisé le jour de l’incident (voir, mutatis mutandis, Ataun Rojo c. Espagne, no 3344/13, § 36, 7 octobre 2014). Toutefois, ni les responsables de la prison ni les autres autorités, pourtant informés rapidement de l’incident du 27 novembre 2008, n’ont estimé nécessaire de demander la sauvegarde de l’enregistrement, Or, de l’avis de la Cour, une telle mesure s’imposait d’autant plus qu’une agression physique avait été évoquée et que le requérant avait été hospitalisé dans la nuit suivant l’incident et elle aurait accéléré l’enquête.
110. La Cour note que les allégations du requérant concernant les traitements subis de la part des agents de l’État font toujours l’objet d’une enquête devant les autorités internes, à la suite de la réouverture de l’enquête à l’égard de J.I.D. et la poursuite de celle-ci à l’égard des membres du groupe spéciale d’intervention (paragraphe 68 ci-dessus). Le parquet est en train d’administrer des preuves pour éclaircir les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé. S’il est vrai que ces derniers actes prouvent qu’une enquête est encore menée au niveau interne, il n’en reste pas moins qu’en raison du temps écoulé depuis les faits et des éléments présentés ci-dessus, elle ne peut pas être considérée comme une enquête diligente.
111. La Cour estime enfin que quelle que soit la qualification juridique donnée aux faits en droit interne, tant que la substance du grief du requérant est examinée par les juridictions internes, il ne peut pas être reproché au requérant de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes (voir Kulic, précité, §§ 54 et 55, et, mutatis mutandis, Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 54, 24 juillet 2008). Par ailleurs, la Cour considère que, en soutenant que le grief tiré du volet matériel de l’article 3 de la Convention est prématuré, le Gouvernement admet que l’enquête pendante vise bien les faits dénoncés par l’intéressé.
112. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tiré du non‑épuisement des voies de recours internes quant à ce grief. Elle juge également que le retard dans l’enquête implique par lui-même que celle-ci n’a pas été effective aux fins de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention du fait des retards apportés à l’enquête.
BAMOUHAMMAD c. BELGIQUE du 17 novembre 2015 requête 47687/13
Violation de l'article 3 : les conditions de détention avec des isolements prolongés et des transfèrements incessants ont transformé le requérant en bête sauvage
a) Rappel des principes généraux
115. La Cour l’a dit à maintes reprises, l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, §§ 113-114, CEDH 2014 (extraits) et références citées). Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011, et El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 202, CEDH 2012).
116. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation.
117. La Cour considère que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux États parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou de perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (voir, notamment, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 138, CEDH 2006‑IX, et Piechowicz c. Pologne, no 20071/07, § 161, 17 avril 2012).
118. Cela étant, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI). La Cour a souligné que les personnes privées de liberté étaient dans une position vulnérable et que les autorités avaient le devoir de les protéger (Enache c. Roumanie, no 10662/06, § 49, 1er avril 2014).
119. La Cour a jugé que la souffrance due à une maladie qui survient naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (voir, notamment, Hüseyin Yıldırım c. Turquie, no 2778/02, § 73, 3 mai 2007, et Gülay Çetin c. Turquie, no 44084/10, § 101, 5 mars 2013). Ainsi, la détention d’une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (Kudła, précité, § 94, Rivière c. France, no 33834/03, § 74, 11 juillet 2006, et Claes c. Belgique, no 43418/09, §§ 94‑97, 10 janvier 2013).
120. Pour déterminer si la détention d’une personne malade est conforme à l’article 3 de la Convention, la Cour prend en considération plusieurs éléments.
121. Un premier élément est l’état de santé de l’intéressé et l’effet des modalités d’exécution de sa détention sur son évolution (voir, parmi d’autres, Matencio c. France, no 58749/00, §§ 76-77, 15 janvier 2004, et Gülay Çetin, précité, §§ 102 et 105). La Cour a jugé que les conditions de détention ne pouvaient en aucun cas soumettre une personne privée de liberté à des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale du requérant (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 99, CEDH 1999‑V). Elle a reconnu, à ce sujet, que les détenus atteints de troubles mentaux étaient plus vulnérables que les détenus ordinaires, et que certaines exigences de la vie carcérale les exposaient davantage à un danger pour leur santé, renforçaient le risque qu’ils se sentent en situation d’infériorité, et étaient forcément source de stress et d’angoisse. Une telle situation entraîne selon la Cour la nécessité d’une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (Sławomir Musiał c. Pologne, no 28300/06, § 96, 20 janvier 2009; voir également Claes, précité, § 101).
122. Un deuxième élément est le caractère adéquat ou non des soins et traitements médicaux dispensés en détention (Rivière, précité, § 63, et Sławomir Musiał, précité, §§ 85-88). Il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi, encore faut-il qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi soit mise en œuvre (Claes, précité, §§ 94‑97). De même, l’obligation d’assurer des soins médicaux appropriés ne se limite pas à la prescription d’un traitement adéquat, il faut aussi que les autorités pénitentiaires surveillent que celui-ci soit correctement administré et suivi (Renolde c. France, no 5608/05, §§ 100-104, CEDH 2008 (extraits), et Jasińska c. Pologne, no 28326/05, § 78, 1er juin 2010) et qu’il le soit par un personnel qualifié (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 115-116, CEDH 2001‑III, et Gülay Çetin, précité, § 112). Dans l’hypothèse où la prise en charge n’est pas possible sur le lieu de détention, le détenu doit pouvoir se faire hospitaliser ou être transféré dans un service spécialisé (Raffray Taddei c. France, no 36435/07, §§ 58-59, 21 décembre 2010; voir également, a contrario, Kudła, précité, §§ 82-100, et Cocaign c. France, no 32010/07, 3 novembre 2011).
123. Troisièmement, se pose la question du maintien en détention compte tenu de l’état de santé de l’intéressé. Certes, la Convention n’impose aucune « obligation générale » de libérer un détenu pour raisons de santé, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner. Il n’en demeure pas moins qu’à cet égard, la Cour a reconnu la possibilité que, dans des conditions d’une particulière gravité, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale commande que soient prises des mesures de nature humanitaire (Gülay Çetin, précité, § 102 ; voir également Raffray Taddei, précité, § 59, et G. c. France, no 27244/09, §§ 77-82, 23 février 2012).
b) Application de ces principes à la présente affaire
i. Les modalités d’exécution de la détention du requérant
124. Le requérant ne se plaint pas des conditions matérielles de sa détention mais soutient que l’ensemble des mesures de sécurité dont il a fait l’objet pendant sa détention et leur effet combiné ont constitué des traitements inhumains et dégradants dont il a résulté une détérioration de son état de santé mentale: transferts incessants d’une prison à l’autre, mesures de coercition extrême (menottage systématique, grille américaine, fouille, privation de contacts, y compris avec un psychologue, et d’activités), mesures d’isolement et de harcèlements à la prison de Lantin du 16 décembre 2007 au 5 juin 2008 et maintien entre juin 2008 et décembre 2013 d’un régime de sécurité particulier individuel impliquant notamment mise à l’isolement, menottage et fouilles systématiques.
α) Les transfèrements
125. Le Gouvernement fait valoir les différences avec l’affaire Khider c. France (no 39364/05, 9 juillet 2009) : alors que les transferts du requérant dans cette dernière affaire s’inscrivaient dans le cadre d’un régime de rotation de sécurité anticipé à son égard, en l’espèce, les transfèrements ont chaque fois été jugés nécessaires par l’administration pénitentiaire pour réagir face au comportement violent ou agressif. À l’instar de l’affaire Payet c. France (no 19606/08, 20 janvier 2011), il faut accorder un poids important à la dangerosité du requérant. Selon le Gouvernement, les transfèrements ont toujours été justifiés par des impératifs de sécurité et l’administration pénitentiaire a constamment recherché à maintenir un juste équilibre entre ces impératifs et la dignité du requérant.
126. La Cour rappelle qu’elle a admis que le transfert d’un détenu vers un autre établissement pouvait s’avérer nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison et empêcher tout risque d’évasion (Khider, précité, § 110). Ainsi, dans l’affaire Payet citée par le Gouvernement, elle a considéré, eu égard au risque réel d’évasion du requérant, que le transfèrement régulier de celui-ci était justifié et que, compte tenu de son profil, de sa dangerosité et de son passé, les autorités pénitentiaires avaient ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au requérant des conditions humaines de détention (§§ 57-64). La Cour est parvenue à une conclusion similaire sur la base des mêmes motifs à propos des systèmes de rotation dans les affaires Alboreo c. France (no 51019/08, §§ 121-130, 20 octobre 2011) et Khider c. France ((déc.), no 56054/12, § 37, 1er octobre 2013).
127. En l’espèce, à la différence de ces affaires, les motifs avancés par le Gouvernement pour justifier les transferts réguliers du requérant ne sont pas liés à un quelconque risque d’évasion de ce dernier.
128. La Cour note qu’entre 2006 et la date de l’introduction de la requête devant la Cour en septembre 2013, le requérant avait fait l’objet de quarante-trois transferts d’un établissement pénitentiaire à l’autre. Elle relève que si certains de ces transferts étaient justifiés par le comportement indiscipliné et violent du requérant envers le personnel pénitentiaire, en particulier dans les premières années de son incarcération, et la crainte de le voir passer à l’acte, ou ont été effectués à sa demande en vue d’intégrer une prison de plus petite taille, un grand nombre d’entre eux semblent s’inscrire dans le cadre d’une politique poursuivie par l’administration pénitentiaire d’éviter d’imposer au personnel pénitentiaire et aux différents directeurs de prison un détenu plus difficile à gérer et qui s’était rendu indésirable auprès des établissements pénitentiaires qu’il avait fréquentés. Il ne ressort pas du dossier que la grande majorité des transferts aient été la conséquence de comportements dangereux formellement identifiés par les autorités mais plutôt, et contrairement à ce que soutient le Gouvernement, d’un a priori négatif et anticipé au sein des établissements pénitentiaires à l’égard du requérant.
129. Il en est de même du système de rotation tous les trois mois qui, sans se référer à des comportements répréhensibles précis de la part du requérant, fut instauré en janvier 2011 dans le but d’améliorer la planification des transferts et de l’inciter à stabiliser son comportement. Il convient d’ailleurs d’observer que ce système a été suspendu par la cour d’appel de Bruxelles en décembre 2013 au motif qu’il était « vide de sens » et portait atteinte au bien-être du requérant sans améliorer les relations avec les agents pénitentiaires.
130. La Cour en déduit que si, vu les lourds antécédents judiciaires et disciplinaires du requérant, des motifs de sécurité ont effectivement pu motiver certains transferts, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les quarante-trois transferts du requérant sur une période de six ans n’apparaissent pas au fil du temps justifiés par de tels impératifs.
131. La Cour observe en outre que la majorité des rapports psycho-sociaux et médicaux versés au dossier concordent pour dire que les changements répétés d’établissement imposés au requérant ont eu des conséquences très néfastes sur son bien-être psychique et étaient de nature à créer et à exacerber chez lui des sentiments d’angoisse aigus quant à son adaptation dans les différents lieux de détention et ont rendu pendant longtemps quasi impossible la mise en place d’un suivi médical cohérent sur le plan psychologique (voir, mutatis mutandis, Khider, précité, §§ 109 et 111).
132. Vu ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue qu’un juste équilibre ait été ménagé par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au requérant des conditions humaines de détention.
β) Le placement sous régime de sécurité particulier et les mesures coercitives
133. La Cour rappelle que lorsqu’elle évalue les conditions de détention, elle prend en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑II, et Piechowicz, précité, § 163).
134. En l’espèce, les griefs du requérant portent sur les prolongations répétées de son maintien à l’isolement et sur les mesures coercitives de sécurité qui lui furent imposées tout au long de sa détention. Il se plaint en particulier des conditions particulièrement humiliantes subies à la prison de Lantin sans qu’aucun rapport d’un médecin ne soit venu attester de sa capacité à supporter le régime de sécurité prescrit, en particulier sa mise à l’isolement, la pratique du menottage et les fouilles à corps systématiques.
135. Dans ce contexte, la Cour a précédemment jugé que l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constituait pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumain (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 191, CEDH 2005‑IV). Pour apprécier si pareille mesure peut tomber sous le coup de l’article 3 dans une affaire donnée, il y a lieu d’avoir égard aux conditions de l’espèce, à la sévérité de la mesure, à sa durée, à l’objectif qu’elle poursuit et à ses effets sur la personne concernée (Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 51, CEDH 2003‑II, et Piechowicz, précité, § 163).
136. La Cour note que les mesures d’isolement cellulaire ont débuté à la prison d’Ittre en décembre 2007 où le requérant resta une dizaine de jours dans un cachot pieds et mains menottés. Elles se sont prolongées à la prison de Lantin, dès son arrivée et pendant toute la durée de sa détention dans cet établissement du 16 décembre 2007 au 5 juin 2008, dans le cadre d’un « régime cellulaire strict » dans un bloc séparé de la prison. Après son départ de Lantin, la mise à l’isolement fut maintenue, dans le cadre d’un « régime de sécurité particulier individuel » renouvelé tous les deux mois par les directeurs des différents établissements fréquentés jusqu’en avril 2013. Enfin, à la prison de Nivelles d’avril à décembre 2013, le requérant fut à nouveau détenu dans un cachot. Le requérant, toujours soumis au même régime, intégra les quartiers ordinaires de la prison de Nivelles en décembre 2013. Le régime de sécurité fut maintenu jusqu’à sa libération en novembre 2014.
137. En dehors des passages au cachot où l’isolement était total, l’isolement imposé au requérant dans le cadre du « régime cellulaire strict » à Lantin ou du « régime de sécurité particulier individuel » dans les autres établissements était relatif, impliquant l’absence de contact avec les autres détenus et l’interdiction de participer aux activités communes mais ne privant pas le requérant de l’accès au préau individuel ni de la participation à titre individuel aux activités de culte, de loisirs ou de formation dans la mesure compatible avec la sécurité. Il a également pu continuer à recevoir des visites de sa famille et de ses avocats. Il semble aussi qu’à plusieurs occasions la mise à l’isolement ait été souhaitée par le requérant.
138. Outre l’isolement, le régime de sécurité imposé au requérant comportait tout un arsenal de mesures coercitives qui évolua avec le temps et le lieu de détention. À la prison de Lantin, le « régime cellulaire strict » prévoyait le port systématique de menottes, poignets dans le dos, à chaque sortie de cellule, y compris pour les visites en parloir, les conversations téléphoniques et les douches. À chaque sortie de cellule, le requérant faisait systématiquement l’objet d’une fouille au corps face au mur, jambes écartées et menottes dans le dos. Le régime prévoyait enfin des restrictions des visites et de l’usage du téléphone ainsi que la distribution des repas ainsi que les visites des intervenants au sein de la prison à travers une grille « américaine ». Après son départ de Lantin, en juin 2008, le régime de sécurité fut assoupli. Les fouilles au corps, le port systématique de menottes et la grille américaine furent supprimés mais, sauf dans quelques établissements, les mesures suivantes furent maintenues jusqu’à la libération du requérant: fouille systématique des vêtements à chaque sortie et entrée de cellule ou après les visites de parloir, interdiction de prendre part aux activités communes, en particulier le préau collectif, privation partielle d’usage du téléphone, confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation entre les visiteurs et le détenu.
139. La Cour rappelle avoir jugé que les décisions de prolongation d’un isolement devaient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Les décisions doivent ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation doit être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Cela étant, ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment (Ramirez Sanchez, précité, §§ 139 et 145‑146, et Piechowicz, précité, § 163).
140. À ce sujet, la Cour observe qu’en l’espèce, toutes les décisions de l’administration pénitentiaire se référaient à des degrés divers à la nécessité d’assurer, par les mesures prises, l’ordre et la sécurité au sein des différents établissements. Alors qu’à la prison de Lantin, le « régime cellulaire strict » se référait à des incidents disciplinaires précis, les prolongations, à partir de juin 2008, du régime de sécurité particulier individuel étaient rédigées dans des termes plus vagues et souvent stéréotypés, se référant au comportement violent du requérant et notamment à des tensions, sous la forme le plus souvent d’altercations verbales, avec le personnel pénitentiaire en particulier lors de l’arrivée du requérant dans un nouvel établissement, au souci d’éviter qu’il soit en possession d’objets dangereux et d’écarter les risques de conflits avec les tiers, ou encore à la nécessité d’assurer l’intervention rapide des membres du personnel en cas de problème.
141. La Cour constate qu’un rapport établi par le service psychosocial de l’établissement pénitentiaire où se trouvait le requérant en mars 2010 (voir paragraphe 64, ci-dessus) fit état de la détérioration de l’état de santé psychique du requérant à partir de 2005 et l’attribuait en partie à l’isolement relationnel et aux frustrations qu’il avait subis en raison de son régime carcéral particulier. D’autres rapports firent apparaître l’impact particulièrement fort sur le requérant des mesures coercitives qui lui furent imposées à la prison de Lantin (voir paragraphe 65, ci-dessus). Cela étant, la Cour constate également qu’à partir de 2011, les décisions successives des directeurs de prison se référaient à l’avis préalable du psychiatre référent du requérant selon lequel le maintien des mesures de sécurité ne posait pas de problème.
142. La Cour n’est certes pas en mesure de procéder elle-même et a posteriori à une évaluation du lien causal entre les modalités d’exécution de la détention du requérant et la dégradation de son état de santé mentale. De même, elle ne saurait remettre en cause l’analyse de la cour d’appel de Liège dans son arrêt du 24 novembre 2011 selon laquelle les conditions de détention étaient en adéquation avec la personnalité du requérant, les mesures de sécurité étaient inscrites dans le cadre légal et aucune faute ne pouvait être reprochée à l’État belge dans l’exercice de son pouvoir d’exécution des peines à la prison de Lantin (voir paragraphe 43, ci-dessus).
143. Il n’en demeure pas moins que la Cour est frappée par la durée particulièrement longue – sept ans, de 2007 à 2014 – du maintien du requérant à l’isolement et de l’application des autres mesures de sécurité d’exception. Elle n’est par ailleurs pas convaincue par la formulation souvent stéréotypée et répétitive des décisions de prolongation du « régime particulier de sécurité individuel » qui, au total, fournissent fort peu d’éléments sur les circonstances ou attitudes concrètes du requérant montrant qu’il continuait de représenter une menace permanente pour la sécurité des différents établissements fréquentés. Partant, la Cour a des doutes quant à la nécessité des mesures prises dans le cadre de la détention, sur une période aussi longue et sur une base systématique, pour parvenir au but de sécurité invoqué par l’administration pénitentiaire (voir, mutatis mutandis, Frérot c. France, no 70204/01, § 38, 12 juin 2007, Khider, précité, §§ 102-105, et Kashavelov c. Bulgarie, no 891/05, §§ 39-40, 20 janvier 2011).
144. À la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’alors que le requérant faisait déjà l’objet de mesures de transferts répétés, sa mise à l’isolement et la prolongation des mesures de sécurité d’exception pour une période si longue combinée avec la dégradation de son état de santé mentale, entrent en ligne de compte pour apprécier si le seuil de gravité requis par l’article 3 est atteint.
ii. La qualité du suivi et des soins fournis au requérant
145. Le requérant ne formule pas de grief précis sur l’adéquation des soins dont il a bénéficié au cours de sa détention. Il reproche toutefois aux autorités belges d’avoir retardé, en raison de leur politique de transferts, la mise en place d’un suivi psychologique régulier et cohérent.
146. La Cour a déjà constaté que le requérant avait été diagnostiqué en 2007 par un psychiatre attaché au ministère de la Justice comme présentant une association de symptômes correspondant au syndrome de Ganser, diagnostic qui ne fut ensuite plus remis en question (voir paragraphes 62-63, ci-dessus). Elle relève, par ailleurs, que la nécessité d’un suivi psychologique du requérant est soulignée par toutes les expertises médicales versées au dossier depuis 2007 et n’a pas été contestée par le Gouvernement. Toutefois, il apparaît que les transferts incessants du requérant ont empêché un tel suivi et qu’il a fallu attendre 2011 pour qu’un médecin psychiatre référent soit désigné et 2012 pour que soit mis en place un système assurant la continuité du suivi médical d’un établissement à l’autre.
147. La Cour observe en outre que les expertises montrent que, dans l’ensemble, l’état de santé psychique déjà fragile du requérant n’a pas cessé de se dégrader au fur et à mesure que sa détention se poursuivait. Cette évolution n’est d’ailleurs pas en tant que telle contestée par le Gouvernement. La circonstance mentionnée par celui-ci qu’une stabilisation ait été constatée dans le rapport approfondi psychosocial du 4 décembre 2012 ne saurait être prise en compte de façon déterminante sachant que ce même rapport limite cette stabilisation à quelques mois et fait par ailleurs le constat d’une détérioration générale de son état psychique.
148. Il est évident que le requérant n’a pas été traité comme un détenu ordinaire. Néanmoins, la Cour déduit du retard mis à lui fournir des soins appropriés que les autorités pénitentiaires n’ont pas suffisamment pris la mesure de sa vulnérabilité ni envisagé sa situation dans une perspective humanitaire. C’est précisément ce point que la Cour doit examiner à présent en tant que troisième élément d’appréciation : le maintien du requérant en détention.
iii. Le maintien du requérant en détention
149. La Cour note que plusieurs dispositifs existent en droit belge en vue d’octroyer aux détenus des permissions de sortie et des congés pénitentiaires et de les aider à préparer leur réinsertion dans la société. Le requérant, qui était admissible à ces dispositifs et fit plusieurs demandes à partir de 2008, vit toutefois ses demandes systématiquement rejetées alors que plusieurs rapports établis par les équipes psychosociales des services pénitentiaires et les avis de plusieurs directeurs de prison y étaient favorables.
150. La Cour relève en particulier l’avis positif rendu le 17 janvier 2011 par le directeur de la prison de Jamioulx en vue du placement du requérant sous surveillance électronique (voir paragraphe 65, ci-dessous). Selon cet avis, l’enfermement carcéral du requérant avait été un échec total et mettait en cause l’aptitude du requérant à la détention. Toujours selon ce rapport, l’octroi des mesures précitées était la seule possibilité pour le requérant d’envisager l’avenir et de progresser dans la concrétisation de son plan de reclassement.
151. Le psychiatre de référence du requérant constatait, quant à lui, dans une note du 6 juillet 2012 l’attitude de plus en plus dépressive du requérant face à l’absence de perspectives de permissions de sortie ou de congés pénitentiaires malgré les efforts consentis.
152. L’aptitude du requérant à être incarcéré fut également questionnée par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles dans son jugement du 18 mars 2013 (voir paragraphe 57, ci-dessus) dans lequel il reconnut expressément que la prison n’avait plus aucun sens ni aucun impact sur le requérant à tout le moins sans l’ouverture possible que permettaient les sorties et les congés. Toutefois, le tribunal rejeta, ainsi qu’il l’avait fait plusieurs fois déjà, la surveillance électronique, les congés et les permissions au motif que la condition posée par la loi que ces mesures puissent être accordées à court terme n’était pas remplie vu l’importance du travail qui devait encore être accompli pour améliorer l’état psychique du requérant. De même, le 28 mai 2014, le ministre de la Justice refusa de réserver une suite positive à une demande de congés pénitentiaires en vue de suivre une psychothérapie en dehors de la prison au motif que son séjour à la prison où il avait été transféré n’avait pas été assez long pour avoir le recul suffisant.
153. La Cour observe le contraste entre, d’une part, les constats des professionnels qui, au contact direct avec la réalité de la détention du requérant, considéraient de manière récurrente depuis 2011 que l’incarcération du requérant, quasiment ininterrompue depuis 1984, ne remplissait plus ses objectifs légitimes et qui étaient favorables à la mise en place d’alternatives et, d’autre part, la réponse des autorités pénitentiaires, qui ont persisté dans leur refus de faire évoluer la situation du requérant malgré la dégradation de son état de santé. La Cour estime que ces décisions sont, en tous cas, illustratives de l’impasse dans laquelle se trouvait le requérant, impasse qui, selon ses affirmations, l’a finalement poussé à entamer une grève de la faim en octobre 2014.
154. De l’avis de la Cour, ces éléments montrent qu’en l’espèce les dispositifs qui auraient pu permettre au requérant de poursuivre sa détention dans des conditions dignes ont été appliqués en privilégiant plutôt les exigences formelles que les considérations liées aux conditions particulières dans lesquelles était détenu le requérant ou la compatibilité de la détention avec son état de santé.
iv. Conclusion
155. À la lumière de ce qui précède, les modalités d’exécution de la détention du requérant, soumis à des transferts répétés d’établissements pénitentiaires et à des mesures d’exception répétitives, combinées avec le retard mis par l’administration pénitentiaire à mettre en place une thérapie, et le refus des autorités à envisager le moindre aménagement de la peine malgré l’évolution négative de l’état de santé du requérant, ont pu provoquer chez lui une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que les autorités belges ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles vu les exigences de l’article 3 de la Convention. Le seuil de gravité pour qu’un traitement soit considéré, au sens de cet article, comme dégradant, a ainsi été dépassé. Il y a donc eu violation de cette disposition.
Milić et Nikezić c. Monténégro du 28 avril 2015
requêtes nos 54999/10 et 10609/11
Violation de l'article 3 : Usage d’une force excessive par des gardiens de prison, équivalant à de mauvais traitements, à l’encontre de deux détenus lors d’une fouille de leur cellule
Les requérants, Igor Milić et Dalibor Nikezić, sont des ressortissants monténégrins nés respectivement en 1974 et 1981 et résidant à Podgorica.
Selon les requérants, qui étaient alors détenus au Centre d’exécution des sanctions pénales, l'incident se produisit le 27 octobre 2009, date à laquelle la cellule des intéressés dut être fouillée en raison du transfert imminent de M. Milić dans une unité disciplinaire. D’après les requérants, plusieurs gardiens entrèrent dans la cellule et se saisirent de M. Milić, qu'ils menottèrent et frappèrent à coups de matraque et à coups de poing. M. Nikezić, qui avait tenté de s’interposer, reçut également des coups de poing et de pied. M. Milić refusa par la suite de voir un médecin, mais M. Nikezić fut examiné par un médecin légiste, qui releva que l’intéressé présentait des ecchymoses à la cuisse gauche et autour des yeux.
Selon le Gouvernement, les gardiens de prison durent avoir recours à la force pour venir à bout de la résistance des requérants à leur entrée dans la cellule. En particulier, M. Nikezić aurait agressé et insulté l'un des gardiens.
Les mères des requérants remarquèrent lors d'une visite que leurs fils avaient été blessés et saisirent par la suite le procureur, qui sollicita auprès des juridictions internes l’ouverture d’une enquête. Le juge d'instruction demanda alors que les gardiens de prison impliqués soient identifiés, que les requérants subissent un examen médical et qu'un enregistrement vidéo soit soumis ; il entendit également les requérants, les gardiens de prison concernés et les détenus qui partageaient la cellule des requérants. Sur la base de ces constatations, le procureur rejeta les plaintes en février puis en octobre 2010, concluant que les gardiens de prison avaient dû avoir recours à la force, c’est-à-dire à l’utilisation de matraques en caoutchouc, pour venir à bout de la résistance des requérants, et avaient donc agi dans les limites de leurs pouvoirs.
Dans l'intervalle, en mars 2010, la médiatrice adjointe, qui rendit également visite aux requérants en prison et remarqua des blessures, donna son avis sur l'incident. Estimant que les gardiens avaient eu recours à une force excessive, elle recommanda l’ouverture d’une procédure disciplinaire. À l’issue de la procédure disciplinaire qui s’ensuivit, en mai 2010, trois gardiens furent jugés coupables d'abus de pouvoir pour avoir fait usage d'une force excessive pendant l'incident – en particulier pour avoir frappé les requérants à coups de matraque – et se virent infliger une amende.
Les requérants introduisirent également une action en réparation devant les tribunaux civils et se virent finalement accorder 1 500 euros chacun pour dommage moral en octobre 2014 par la Cour suprême. Celle-ci estima que les gardiens ne pouvaient justifier un tel recours à la force par la résistance des requérants et que leurs actes avaient porté atteinte à la dignité humaine.
Arrêt SABA C. ITALIE du 1er juillet 2014 requête 31620/10
Violation de l'article 3 : Le requérant a subi des coups et blessures sans laisser aucune trace, plus des abus d'autorité pour l'avilir et l'humilier, de la part des gardiens de prison. Après un long procès judiciaire qui a abouti à des condamnations d'amendes, ils n'ont subi en matière administrative que des peines légères. La CEDH constate la disproportion entre les sanctions et les faits reprochés particulièrement graves.
ARRÊT DE LA GRANDE CHAMBRE
M.S.S contre Grèce et Belgique du 21 janvier 2011 requête 30696/09
La Cour ne sous-estime pas le poids que fait actuellement peser sur les Etats situés aux frontières extérieures de l’UE l’afflux croissant de migrants et de demandeurs d’asile, ni les difficultés engendrées par l’accueil de ces personnes dans les grands aéroports internationaux. Néanmoins, cette situation ne saurait exonérer la Grèce de ses obligations au regard de l’article 3, vu le caractère absolu de cette disposition.
Lorsque le requérant, venant de Belgique, est arrivé à Athènes, les autorités grecques avaient connaissance de son identité et de sa situation de demandeur d’asile potentiel. Malgré cela, il a été immédiatement placé en détention, sans aucune explication. La Cour relève que divers rapports d’organes internationaux et d’organisations non gouvernementales établis au cours des dernières années ont confirmé que la mise en détention systématique des demandeurs d’asile sans information sur les motifs de leur détention était une pratique généralisée des autorités grecques. Les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des brutalités de la part des policiers pendant sa deuxième période de détention sont également confortées par les nombreux témoignages recueillis par différents organismes internationaux, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), dont les conclusions, comme celles du HCR, confirment également les allégations du requérant quant à l’insalubrité et à la surpopulation du centre de détention attenant à l’aéroport international d’Athènes.
Même s’il n’a été détenu que sur une durée relativement brève, la Cour estime que les conditions subies par le requérant au centre de détention ont été inacceptables. Elle est d’avis que, pris ensemble, le sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse qu’il a dû éprouver ainsi que celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions s’analysent en un traitement dégradant. De surcroît, la détresse de l’intéressé a été accentuée par la vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile, du fait de sa migration et des expériences traumatisantes qu’il a dû vivre. La Cour conclut à la violation de l’article 3.
POPANDOPULO c. Russie du 10 mai 2011 Requête no 4512/09
Détenu gréviste de la faim incarcéré dans des conditions inhumaines et frappé à coup de matraques en caoutchouc au cours d’une perquisition menée dans sa cellule par une unité d’inspection spéciale
PRINCIPAUX FAITS
Le requérant, Dimitrios Popandopulo, est un ressortissant russe né en 1979. Condamné entre autres pour meurtre qualifié, il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité dans un pénitencier de la région autonome de Yamalo-Nenetsk (Russie).
Soupçonné de meurtre, de vol simple et de vol qualifié, le requérant fut arrêté en avril 2005 et condamné en novembre 2007. Sa condamnation fut confirmée en dernier ressort en juillet 2009.
L’intéressé se plaignait d’avoir été maltraité dans la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg où il avait été placé en détention provisoire sous le coup de ces accusations. Il alléguait notamment que, le 28 octobre 2007, une perquisition avait été effectuée dans sa cellule par une unité d’inspection spéciale dont les membres cagoulés avaient frappé tous les occupants avec des matraques en caoutchouc. Il prétendait que cette opération, qui avait pour objectif officiel la recherche d’objets interdits, visait en réalité à contraindre les détenus à mettre fin à une grève de la faim collective. L’examen médical qu’il subit après cette opération révéla qu’il présentait de multiples égratignures au dos et une ecchymose au genou. Le requérant se plaignit immédiatement auprès des autorités de poursuite d’avoir été frappé. S’appuyant sur le rapport médical et sur les dires de quatre agents pénitentiaires entendus lors d’une enquête, celles-ci décidèrent, en août 2008, de ne pas engager de poursuites pénales contre les agents mis en cause au motif que ceux ci avaient été contraints de recourir à la force devant le refus de l’intéressé d’obéir à leurs ordres. En juillet 2009, cette décision fut annulée et une nouvelle enquête dans le cadre de laquelle le requérant et le chef de l’unité d’inspection spéciale impliquée dans les événements dénoncés devaient être entendus fut ordonnée. L’intéressé n’a pas encore été informé de l’issue de ce complément d’enquête.
M. Popandopulo se plaignait en outre des conditions d’incarcération subies au cours de deux périodes – de mai 2005 à septembre 2008 et de juin à septembre 2009 – dans la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg où il était détenu dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Avant sa condamnation, prononcée en novembre 2007, il aurait été détenu dans des cellules surpeuplées. Par la suite, il aurait été placé à l’isolement et, jusqu’en avril 2008 – époque à laquelle des travaux de réfection auraient été réalisés dans la maison d’arrêt – il aurait été contraint de dormir sur un bat-flanc en béton dans une cellule dont les fenêtres obturées par un treillis métallique ne laissaient pas passer l’air frais et la lumière naturelle et n’aurait bénéficié que d’une heure de promenade par jour.
Article 3
Mauvais traitements
Il ne prête pas à controverse entre les parties que, le 28 octobre 2007, des agents de l’administration pénitentiaire ont effectué une perquisition dans la cellule où le requérant était détenu à Saint-Pétersbourg et qu’ils ont utilisé contre lui des matraques en caoutchouc, lui infligeant de multiples blessures. La Cour estime que les autorités n’ont pas suffisamment justifié la nécessité de pareil traitement. En effet, les motifs contenus dans la décision rendue en août 2008 par laquelle les autorités avaient jugé inutile d’ouvrir des poursuites pénales se bornaient à évoquer évasivement le refus de l’intéressé d’obéir à un ordre, sans même préciser le contenu de cet ordre et la forme qu’avait prise le refus du requérant. Particulièrement préoccupée par l’implication d’une unité d’inspection spéciale dans les faits dénoncés, la Cour considère que le recours à la force s’analysait en une opération de rétorsion et qu’il avait pour objectif de contraindre M. Popandopulo à se soumettre aux autorités. Pareil traitement n’a pu manquer de lui causer des souffrances physiques et psychiques, au mépris de l’article 3.
Par ailleurs, l’enquête menée sur les allégations de l’intéressé n’a pas été effective. Après la survenance des événements dénoncés, il a fallu plus de neuf mois aux autorités d’enquête pour décider de ne pas déclencher de poursuites pénales, et près d’un an de plus pour annuler cette décision et ordonner l’ouverture d’une nouvelle enquête. M. Popandopulo n’a pas reçu d’information sur l’issue de ce complément d’enquête qui visait à remédier aux insuffisances de la première, notamment par l’interrogatoire de l’intéressé et du chef de l’unité d’inspection spéciale, et le Gouvernement n’a avancé aucune explication satisfaisante propre à justifier cet état de choses. En conséquence, la Cour dit qu’il y a également eu violation de l’article 3.
Conditions de détention
La Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3, d’abord en raison de la surpopulation carcérale dont le requérant a été victime de mai 2005 à novembre 2007 dans la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg – elle rappelle à cet égard avoir constaté dans plusieurs affaires similaires que cet établissement était gravement surpeuplé –, ensuite en raison du placement du requérant à l’isolement de novembre 2007 jusqu’à au moins avril 2008, époque à laquelle l’intéressé a été contraint de passer une partie considérable de ses journées confiné dans une cellule – où il ne disposait pas d’un couchage adéquat et où il était privé d’un accès suffisant à la lumière naturelle – sans pouvoir bénéficier de promenades régulières.
Il ressort des informations fournies par les parties sur les périodes s’échelonnant d’avril à septembre 2008 et de juin à septembre 2009 que des travaux de réfection avaient été réalisés dans la maison d’arrêt, que les bat-flancs en béton y avaient été remplacés par des lits superposés et que des mesures avaient été prises pour améliorer l’éclairage naturel des cellules. Dans ces conditions, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les conditions de détention du requérant au cours de ces périodes n’ont pas atteint un seuil de gravité suffisant pour entraîner un constat de violation de l’article 3.
Article 6 § 1
La Cour estime que la durée – près de trois ans et demi – de la procédure pénale dirigée contre M. Popandopulo n’a pas été excessive. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de ce chef.
Article 41 (satisfaction équitable)
La Cour dit que la Russie doit verser au requérant 18 000 euros (EUR) pour dommage moral. L’intéressé n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens.
Alboreo c. France du 20 octobre 2011 requête no 51019/08
Les mauvais traitements subis par un détenu considérés par la Cour comme inhumains et dégradants
Le requérant, Éric Alboreo, est un ressortissant français né en 1963 et résidant à Lannemezan (France).
Le 24 janvier 1999, il fut placé en détention provisoire. Il lui était reproché d’avoir participé au braquage d’un fourgon blindé au cours duquel un convoyeur avait été abattu.
Pour les infractions qui lui étaient reprochées, Monsieur Alboreo fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, le 22 novembre 2002, à une peine de vingt années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de dix ans.
Du 3 février 2000 au 26 novembre 2009, il fut inscrit par l’administration pénitentiaire au registre des « détenus particulièrement signalés » (DPS). Il fut alors soumis à un régime de sécurité comportant notamment de fréquents changements d’établissement ainsi que des placements à l’isolement.
Le 14 avril 2003, alors qu’il purgeait sa peine à la maison d’arrêt d’Aix Luynes, il s’évada en hélicoptère, puis il fut interpellé, le 9 mai 2003, et réincarcéré. Pour cette évasion, il fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, le 19 janvier 2007, à cinq années de prison supplémentaires.
Entre le 9 mai 2003, et le 16 juillet 2007, le requérant fut transféré à dix-sept reprises dans différentes maisons d’arrêt réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Le 21 mars 2006, Monsieur Alboreo saisit le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande de suspension de l’exécution de la mesure de transfèrement.
Par une ordonnance du 10 avril 2006, le juge des référés rejeta la demande. Il considéra que cette décision, qui ne modifiait pas le régime de détention applicable à Monsieur Alboreo, devait s’analyser en une mesure d’ordre intérieur insusceptible d’être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Par un arrêt du 20 décembre 2006, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi contre cette ordonnance, estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de suspension, dès lors que la décision de transfèrement critiquée avait été entièrement exécutée.
Dans le cadre d’une de ces rotations de sécurité, Monsieur Alboreo fut transféré à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses, et fut placé dans une cellule du quartier d’isolement. Pour protester contre ces rotations de sécurité, il refusa à plusieurs reprises d’intégrer ou de sortir de sa cellule. En conséquence, il fut placé en quartier disciplinaire.
Une fois sa peine disciplinaire effectuée, Monsieur Alboreo devait réintégrer sa cellule en quartier d’isolement, mais face à ces différents refus, et suite à des altercations avec les surveillants le 26 et 27 novembre 2005, la directrice de la maison d’arrêt décida de faire appel aux équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) pour contraindre le requérant à quitter la cellule disciplinaire, le 3 décembre 2005.
Suite à cette intervention, Monsieur Alboreo déposa une plainte simple, suivie d’une plainte avec constitution de partie civile afin de dénoncer ses conditions de détention.
Une enquête fut diligentée, à la suite de laquelle une ordonnance de non-lieu fut rendue en juillet 2007.
Monsieur Alboreo, saisit alors la chambre de l’instruction, qui confirma l’ordonnance de non-lieu. Il forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par un arrêt du 3 février 2009.
A compter du 16 juillet 2007 et jusqu’à sa libération, Monsieur Alboreo fut détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan.
Libérable le 9 juillet 2018, il a bénéficié le 17 mars 2010 d’une libération conditionnelle pour raison de santé.
Invoquant notamment l’article 3, Monsieur Alboreo se plaignait des rotations de sécurité dont il fit l’objet au cours de son incarcération et des mauvais traitements auxquels il fut soumis durant ses placements à l’isolement et, plus particulièrement, en quartier disciplinaire.
Invoquant également l’article 13 combiné à l’article 3, il se plaignait de l’absence de recours effectif pour contester le régime des rotations de sécurité qui lui fut imposé.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 octobre 2008.
Sur la question de savoir si le requérant a fait l’objet de violences au cours de son placement en cellule disciplinaire
La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable, l’article 3 impose néanmoins à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine.
Pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum se fait par rapport au cas d’espèce et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
Concernant les faits des 26 et 27 novembre 2005, la Cour constate que le certificat médical ne mentionne que des lésions bénignes n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail, elle écarte donc une quelconque violation de l’article 3 quant aux faits de l’espèce.
Pour ce qui est du 3 décembre 2005, les membres des ERIS intervinrent à trois reprises et le certificat médical établi à la suite des faits, révèle notamment une fracture des côtes. La cour relève que le Gouvernement ne s’exprime pas au sujet de cette fracture, alors que le requérant était en détention.
Or, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3.
Le Gouvernement français indique que les différents agents ont assuré qu'ils n'avaient
fait usage que de la force strictement nécessaire au regard du comportement du requérant.
Toutefois, la Cour estime que les allégations du requérant sont plausibles au vu de la manière dont les opérations se sont déroulées et notamment du fait que le requérant, mesurant 1,72 m et pesant 66 kgs, a été maîtrisé par quatre agents des ERIS et fermement plaqué au sol à deux reprises.
Elle considère qu’en l’espèce l’absence totale d’explication sur ce point de la part du Gouvernement et l’impossibilité d’établir les circonstances exactes dans lesquelles le requérant a été blessé, alors qu’il se trouvait sous le contrôle des agents de l’État, ne l’empêche pas de parvenir à un constat de violation matérielle de cet article.
La Cour estime donc que Monsieur Alboreo a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention.
Sur les griefs formulés par le requérant sur les mesures de rotation de sécurité et de ses placements à l’isolement
La Cour considère en l’espèce que, compte tenu du profil, de la dangerosité et des antécédents de Monsieur Alboreo, les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention.
Article 13 combiné avec l’article 3
La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Elle considère que l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant.
La Cour relève que le fait qu’elle ait estimé que l’article 3 n’avait pas été violé concernant les rotations de sécurité imposées au requérant ne signifie pas que son grief n’était pas défendable.
Le Gouvernement expose que, jusqu’aux années 2000, le Conseil d’État considérait de façon constante que les décisions de transfèrement administratif n’étaient pas des actes administratifs faisant grief, mais entraient dans la catégorie des mesures d’ordre intérieur, non susceptibles de recours juridictionnel.
Toutefois, par trois décisions d’Assemblée du 14 décembre 2007, le Conseil d’État a étendu les possibilités de recours des détenus devant la juridiction administrative, en particulier pour ce qui concerne les rotations de sécurité.
La Cour considère que l’efficacité du recours cité par le Gouvernement dans le cas des transfèrements du requérant pendant la période de son incarcération n’est pas établie.
En effet, c’est par un arrêt du 14 décembre 2007 que le Conseil d’État a admis qu’une décision soumettant un détenu à un régime de sécurité ne constituait pas une mesure d’ordre intérieur, mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir.
La Cour en déduit qu’à l’époque, Monsieur Alboreo ne disposait pas d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention concernant ses transfèrements répétés. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec cette disposition.
TALI C. ESTONIE du 13 février 2014, requête 66303/10
L’usage de gaz poivre contre un détenu qui se trouvait dans une cellule était injustifié et constitutif d’un traitement inhumain. De plus, il a subi le maintien dans un lit de contention alors qu'il était seul dans une cellule. L'article 3 de la Convention est violée.
Compte tenu des éléments communiqués par le gouvernement estonien – en particulier des informations selon lesquelles le requérant avait précédemment été reconnu coupable d’agressions sur les agents pénitentiaires et sur d’autres détenus – la Cour admet que le personnel de la prison avait des raisons d’être inquiet pour sa sécurité et d’être prêt à prendre les mesures nécessaires dans le cas où le requérant se montrerait agressif. Elle relève cependant que les lésions présentées par celui-ci révélaient qu’un certain degré de force avait été utilisé à son encontre. Observant que les autorités estoniennes n’ont pas été en mesure de déterminer avec certitude s’il avait été frappé avec une matraque télescopique avant ou après avoir été menotté, elle note qu’elle n’est pas mieux placée que les autorités nationales pour établir les circonstances factuelles exactes dans lesquelles ces coups ont été portés.
En ce qui concerne la légitimité de l’usage de gaz poivre contre le requérant, la Cour rappelle les préoccupations exprimées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) quant à l’utilisation de tels produits par les agents des forces de l’ordre. Celui-ci a estimé que le gaz poivre était une substance potentiellement dangereuse qui ne devait pas être utilisée dans un espace confiné et, en toute hypothèse, ne devait jamais l’être à l’égard d’un prisonnier qui était déjà sous contrôle. Il a souligné que le gaz poivre pouvait avoir de graves conséquences pour la santé, notamment une irritation des voies respiratoires et des yeux, des spasmes, des allergies et, à forte dose, des oedèmes pulmonaires et des hémorragies internes.
Compte tenu de ces conséquences potentiellement graves de l’usage du gaz poivre dans un espace confiné et du fait que les agents pénitentiaires disposaient d’autres moyens d’immobiliser le requérant, notamment des casques et des boucliers, la Cour conclut que les circonstances ne justifiaient pas l’usage du gaz poivre.
En ce qui concerne l’immobilisation du requérant sur un lit de contention, la Cour rappelle qu’elle a jugé récemment dans une autre affaire dirigée contre l’Estonie que le fait de soumettre un détenu à une telle mesure pendant près de neuf heures avait emporté violation de l’article 3. Elle relève qu’en l’espèce, la mesure dont le requérant a fait l’objet a duré moins longtemps, à savoir trois heures et demie, que le rapport établi par les gardiens indique qu’il s’était montré agressif, et que la situation a été réévaluée toutes les heures. Pour autant, elle considère que l’usage du lit de contention ne se justifiait pas dans les circonstances de l’espèce. Elle souligne que les mesures de contention ne doivent jamais être utilisées pour punir les détenus, mais pour les empêcher d’agir d’une manière dangereuse pour eux-mêmes, pour autrui ou pour la sécurité de la prison. Elle estime qu’il n’a pas été démontré de manière convaincante en l’espèce qu’à l’issue de l’altercation entre le requérant et les gardiens, l’intéressé, qui était enfermé seul dans une cellule disciplinaire, ait constitué une telle menace pour lui ou pour les autres que l’application de cette mesure aurait été justifiée. Elle juge que la durée pendant laquelle il est resté sanglé au lit de contention (trois heures et demie) est loin d’être négligeable et que cette immobilisation prolongée a dû être source pour lui de détresse et de gêne physique.
À la lumière de ces considérations, et compte tenu de l’effet cumulatif des mesures employées contre le requérant le 4 juillet 2009, la Cour conclut qu’il a fait l’objet de traitements inhumains et dégradants, en violation de l’article 3.
LES TRANSFÈREMENTS + ISOLEMENT + FOUILLES
KHIDER C. FRANCE DU 9 JUILLET 2009 Requête n° 39364/05
Un caïd ayant séquestré des personnes libérées contre rançon et auteur d'une tentative d'évasion de son frère, par hélicoptère subit des transfèrement répétées de prison, un maintien particulièrement long à l'isolement ainsi que des fouilles anales répétées particulièrement dégradantes. La CEDH condamne pour "actes inhumains et dégradants".
"99.L'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La Convention interdit en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la conduite de la personne concernée (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX, et Ramirez Sanchez, précité, § 116).
100. Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX).
101. De plus, pour dire s'il y a eu ou non violation de l'article 3, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Ramirez Sanchez, précité, § 117).
102. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Frérot c. France, no 70204/01, 12 juin 2007, § 37),
103. Certes, l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux Etats parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d'évasion, d'agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles (Ramirez Sanchez, précité, § 138).
104. Plus précisément, la Cour a déjà rappelé que les décisions de prolongation d'un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d'éviter tout risque d'arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d'établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte « d'emprisonnement dans la prison », qu'exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des règles pénitentiaires adoptées par la Comité des Ministres le 11 janvier 2006. Un contrôle régulier de l'état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s'assurer de sa compatibilité avec le maintien à l'isolement, devrait également être instauré (Ramirez Sanchez, précité, § 139).
105. Par ailleurs, la Cour a précédemment jugé que si les fouilles à corps pouvaient parfois s'avérer nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, elles devaient être menées selon les modalités adéquates et devaient être justifiées. La Cour a estimé que, même isolée, une fouille corporelle pouvait s'analyser en un traitement dégradant eu égard à la manière dont elle était pratiquée, aux objectifs d'humiliation et d'avilissement qu'elle pouvait poursuivre et à son caractère injustifié (Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII et Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001). Dans l'affaire Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99, CEDH 2003-II), la Cour a dit que la pratique de la fouille corporelle, même selon des modalités « normales », avait un effet dégradant et s'analysait en une violation de l'article 3 de la Convention dès lors qu'elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant.
106. La Cour a déjà eu à se prononcer sur le système français des fouilles corporelles pratiquées dans les établissements pénitentiaires, tel que prévu par l'article D. 275 du code de procédure pénale et la circulaire du 14 mars 1986. Dans l'arrêt Frérot c. France précité, elle a conclu que les modalités de ces fouilles n'étaient pas, d'un point de vue général, inhumaines ou dégradantes (ibid., §§ 40-41). Toutefois, compte tenu de la fréquence notable des fouilles intégrales subies par l'intéressé en l'espèce, dont un certain nombre d'inspections anales, et du fait que, de l'avis de la Cour, celle-ci ne reposaient pas sur un « impératif convaincant de sécurité » (arrêt Van der Ven précité, § 62), elle a conclu que les fouilles litigieuses s'analysaient en un traitement dégradant et qu'il y avait violation de l'article 3.
107. Enfin, lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du détenu (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001–II).
b) Application des principes en l'espèce
i. Les transfèrements
108. La Cour note que du 27 août 2001, date d'incarcération du requérant, au mois de février 2008, le requérant a fait l'objet de quatorze transferts vers des établissements pénitentiaires différents, plus deux transits et une hospitalisation en hôpital pénitentiaire qui ont duré quelques jours. Elle relève que si certains de ces transferts étaient justifiés selon les autorités par le comportement du requérant envers le personnel pénitentiaire et la crainte de le voir passer à l'acte, ils semblent néanmoins s'inscrire dans le cadre de la mise en place d'un régime de rotation de sécurité anticipé à son égard, comme l'indique le directeur de la maison d'arrêt des Hauts-de Seine, dans son rapport du 22 décembre 2004. La Cour constate que selon la note de service adoptée le 20 octobre 2003 par le ministre de la Justice, le régime de rotation de sécurité institué pour les détenus les plus dangereux a pour but de perturber les auteurs des tentatives d'évasion et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets. Il convient de rappeler, à cet égard, que cette note a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 février 2008. La Cour estime cependant que la tentative avortée d'évasion à laquelle avait participé le requérant en mai 2001 ne saurait justifier, à elle seule, la soumission indéfinie à un régime strict de rotation de sécurité. En outre, elle observe que depuis 2004 le requérant n'a jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires par l'autorité pénitentiaire pour un éventuel comportement agressif envers un membre du personnel.
109. La Cour ne peut que souscrire aux conclusions du CPT qui, dans son rapport de 2007 concernant la France relevait que le transfert continuel d'un détenu d'un établissement vers un autre pouvait avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être, sur ses possibilités de réinsertion, ainsi que compliquer le maintien de contacts appropriés avec son avocat et sa famille et indiquait que les conditions minimales pour l'existence d'un milieu de vie cohérent et suivi n'étaient plus assurées.
110. La Cour considère que si le transfert d'un détenu vers un autre établissement peut s'avérer nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison et empêcher tout risque d'évasion, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les quatorze transfèrements du requérant sur sept années de détention n'apparaissaient plus au fil du temps justifiés par de tels impératifs.
111. De plus, elle estime qu'un nombre si élevé de transferts du requérant pendant son incarcération – les 27 août 2001, 20 décembre 2001, 4 juin 2002, 5 mai 2003, 8 novembre 2003, 13 février 2004, 12 mai 2004, 22 novembre 2004, 16 décembre 2004, 24 décembre 2004, 2 août 2005, 26 décembre 2005, 30 décembre 2005, 6 juin 2006, 19 mars 2007, 5 septembre 2007 et en avril 2008 – même s'ils ont eu lieu dans des prisons de la région parisienne – était de nature à créer chez lui un sentiment d'angoisse aigu quant à son adaptation dans les différents lieux de détention et la possibilité de continuer de recevoir les visites de sa famille et rendait quasi impossible la mise en place d'un suivi médical cohérent sur le plan psychologique.
112. Vu ce qui précède, et à l'instar des conclusions du CPT dans son rapport de 2007, la Cour n'est pas convaincue qu'un juste équilibre ait été ménagé par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de sécurité et l'exigence d'assurer au détenu des conditions humaines de détention.
ii. Le maintien à l'isolement
113. Les griefs du requérant portent également sur les prolongations injustifiées et répétées de son maintien à l'isolement en dépit des constats des médecins selon lesquels sa santé était gravement endommagée de ce fait.
114. La Cour note, en premier lieu, que les parties n'indiquent pas la même date comme point de départ de la mise à l'isolement du requérant : selon celui-ci, le point de départ se situerait le 27 août 2001 ; selon le Gouvernement, le 5 novembre 2002. Quoiqu'il en soit, cette mesure a été renouvelée jusqu'au 19 mars 2007, avec deux périodes d'interruption, à savoir de décembre 2001 à novembre 2002 et de décembre 2004 à août 2005, soit une période totale de quatre ans environ. Il convient aussi de noter que lorsque l'administration pénitentiaire a décidé de mettre fin à l'isolément, le requérant a lui-même demandé de bénéficier de ce régime le 19 mars 2007 afin de bénéficier d'un « semblant de tranquillité ».
115. En deuxième lieu, la Cour relève que, d'après la circulaire d'application du décret du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'isolement des détenus, la décision de mise à l'isolement doit être motivée. L'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire et la seule référence à l'appartenance au grand banditisme, ou à un risque d'évasion, non étayé, est insuffisante. De même, le classement d'un détenu au registre des détenus particulièrement signalés ou la commission d'une faute disciplinaire même grave ne peuvent justifier à eux seuls un placement à l'isolement. En cas de transfert suivi d'une nouvelle décision de placement à l'isolement, il convient notamment de rappeler dans la motivation en quoi le transfert n'a pas été suffisant pour assurer la sécurité des personnes ou l'établissement.
116. Or, en l'espèce, les décisions de l'administration pénitentiaire renouvelant la mesure, des 5 mai, 28 juillet et 15 novembre 2003, invoquaient la participation du requérant à une tentative d'évasion par hélicoptère et l'usage d'armes à feu, commise en 2001, à quoi s'est ajouté, le 12 mai 2004, le comportement agressif et menaçant de celui-ci à l'encontre des personnels pénitentiaires et, le 6 août 2004, la logistique dont il pourrait disposer pour tenter une évasion. Les mêmes motifs ont été réitérés dans les autres décisions prolongeant la mesure, les faits commis par le requérant en 2001 paraissant toujours déterminants. Ainsi, dans le courrier du 9 septembre 2006 à l'état-major de la sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire, le directeur de la maison d'arrêt de la Santé précisait que compte tenu des faits pour lesquels le requérant était détenu, son retour en détention classique paraissait peu probable. Pourtant, le 12 décembre 2004, l'administration pénitentiaire avait levé la mesure d'isolement.
117. Le 15 mars 2007, le tribunal administratif de Paris a écarté ces motifs. Le tribunal a constaté que les informations dont l'administration disposerait quant à un projet d'évasion en préparation avec l'aide extérieure du réseau de banditisme auquel il appartiendrait, résultaient de dénonciations calomnieuses ou de renseignements imprécis dont le bien-fondé n'était pas établi. Il a relevé qu'à partir de la fin décembre 2004, le comportement du requérant n'était plus incompatible avec une condition ordinaire de détention et que la réalité des menaces proférées à l'égard d'un médecin et d'un surveillant n'avait pas été établie.
118. Par conséquent, la Cour constate que, si les motifs avancés par l'administration pénitentiaire avaient pu être considérés comme pertinents au début de la détention du requérant, ils ont cessé de l'être à partir de décembre 2004.
119. La Cour constate surtout que plusieurs de ces prolongations ont été ordonnées en dépit des diagnostics établis par les différents médecins qui suivaient l'état de santé du requérant tout au long de son incarcération. Ainsi, le 27 juillet 2004, le docteur K. a refusé d'attester de la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé ; les 7 juin et 11 septembre 2006, le médecin de la prison a précisé qu'il était certain qu'un isolement ainsi prolongé ne pouvait qu'entraîner des signes de type paranoïaque et recommandait un examen psychiatrique afin de définir si le maintien en isolement était compatible avec les signes psychiatriques que présentait le requérant ; le 8 août 2006, le docteur P.A. a constaté que le requérant souffrait d'une pathologie invalidante de l'appareil musculo–squelettique qui était liée aux conditions de détention au quartier d'isolement. Il a préconisé un assouplissement du régime de détention. Deux certificats médicaux, des 21 décembre 2006 et 2 février 2007 ont fait état d'une souffrance psychologique résultant de sa condition de détenu isolé. Enfin, pour annuler la décision du ministre du 2 octobre 2006, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, entre autres, sur la dégradation de l'état de santé du requérant, telle qu'établie par le certificat médical du 7 juin 2006.
120. La Cour considère que l'administration pénitentiaire n'a pas tiré les conclusions adéquates suggérées par ces certificats médicaux qui se prononçaient de manière claire sur l'état de santé du requérant. Elle ne peut que relever à cet égard, que dans son rapport de 2007, le CPT critiquait la tendance de l'administration de faire du quartier d'isolement un lieu de rejet de détenus difficiles à gérer, psychiquement atteints et cela dans un espace où l'accès aux soins notamment psychiatriques, est moins bon.
121. La Cour note, de surcroît, qu'une expérience sans mise à l'isolement du requérant, qui avait commencé le 16 décembre 2004 à l'occasion de son transfert à la maison d'arrêt de la Santé et s'était déroulée sans incident, n'a pu être poursuivie car la mesure a été réinstaurée à l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Rouen, le 2 août 2005.
122. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'alors qu'il faisait déjà l'objet de mesures de transferts réitérés, la mise à l'isolement pour une si longue période, combinée avec la dégradation de l'état de santé psychologique et somatique du requérant, qui d'après les certificats médicaux serait imputable aux prolongations répétées de celle-ci, entre en ligne de compte pour apprécier si le seuil de gravité requis par l'article 3 a été atteint.
iii. Les fouilles corporelles
123. S'agissant des fouilles corporelles, la Cour note que le requérant a été soumis, à différentes périodes de sa détention, au régime applicable à des détenus particulièrement signalés, notamment, comme il l'affirme lui-même, lors de ses séjours dans les établissements de Villepinte, Liancourt, Nanterre et des Yvelines. A Rouen, le requérant admet que les fouilles se limitaient à des palpations de sécurité, sans obligation de se dévêtir.
124. Comme elle l'a constaté dans l'arrêt Frérot précité (§ 44), le code de procédure pénale n'indique pas dans quelles circonstances la fouille est intégrale ou est effectuée par palpation. La circulaire du 14 mars 1986 précise en revanche que des fouilles intégrales doivent systématiquement être effectuées à l'égard des détenus entrant et sortant de l'établissement, quelle que soit la raison de ce mouvement (y compris, par exemple, en cas d'hospitalisation ou consultation en milieu extérieur), à l'issue de la visite de toute personne (parents, amis, avocat) dès lors que l'entrevue s'est déroulée dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation, et avant tout placement en cellule de punition ou d'isolement. La circulaire ajoute que des fouilles intégrales inopinées d'un ou plusieurs détenus peuvent être effectuées « toutes les fois que le chef d'établissement ou l'un de ses collaborateurs directs l'estiment nécessaire », « notamment (...) à l'occasion des mouvements en détention (promenades, ateliers, salles d'activités) » ; « elles concernent principalement, mais non exclusivement, les détenus particulièrement signalés (...) ».
125. Dans ce même arrêt, la Cour a aussi constaté que, dans les maisons d'arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis, les fouilles corporelles étaient particulièrement nombreuses et incluaient l'ordre d'ouvrir la bouche et « de se pencher et de tousser » (ibid. §§ 46-47). Or, M. Khider a aussi été incarcéré dans ces maisons d'arrêt, à trois reprises à Fleury–Mérogis et une fois à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes.
126. Même si le requérant ne produit pas un décompte exact des fouilles intégrales et des fouilles effectuées par palpation qu'il a subies, la Cour estime, au regard des éléments du dossier, que les premières paraissent avoir été pratiquées de manière systématique. Il convient de relever à cet égard le nombre de transfèrements dont il a fait l'objet, la fréquence de ses placements à l'isolement et en cellule disciplinaire et le nombre de fois où il s'est rendu au parloir. Le Gouvernement ne conteste d'ailleurs pas les allégations du requérant quant au caractère systématique de cette mesure, compte tenu du classement du requérant au registre des DPS.
127. A cet égard, la Cour rappelle que dans l'arrêt Frérot précité (§ 67), elle a considéré que des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, pouvaient créer chez les détenus le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, caractérisent un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus.
128. La Cour attache beaucoup d'importance aux constats du CPT à ce sujet, qui dans son rapport de 2007 a relevé que les fouilles de sécurité étaient dans nombre de cas d'une fréquence excessive et a également estimé qu'une fréquence élevée de fouilles à corps – avec mise à nu systématique – d'un détenu comportait un risque élevé de traitement dégradant.
129. Le caractère répété de ces fouilles, combiné avec le caractère strict des conditions de détention dont le requérant se plaint, ne paraissent pas être justifiées par un impératif convaincant de sécurité, de défense de l'ordre ou de prévention des infractions pénales et sont, de l'avis de la Cour, de nature à créer en lui le sentiment d'avoir été victime de mesures arbitraires.
130. Selon la Cour, ces fouilles répétées, pratiquées sur un détenu qui présentait des signes d'instabilité psychiatrique et de souffrance psychologique, ont été de nature à accentuer son sentiment d'humiliation et d'avilissement à un degré tel qu'on peut les qualifier de traitement dégradant.
131. En ce qui concerne la fouille du 30 juin 2004 et l'enquête y relative, la Cour note que les allégations des parties divergent radicalement sur ce point et qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de souscrire à l'une ou à l'autre des thèses en présence. Elle relève cependant que, lors de son audition par le juge d'instruction dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, le requérant a lui-même reconnu qu'il n'avait pas voulu se plier à la fouille préalable à son entrée dans le quartier disciplinaire. L'article D.283-5 du code de procédure pénale permet alors, en cas d'inertie physique à un ordre donné, l'usage de la force strictement nécessaire. Or, si le requérant a été immobilisé à terre et si ses jambes ont été écartées, rien n'indique qu'il a été victime d'une agression sexuelle. En outre, bien que le procureur ait classé sans suite la plainte du 5 novembre 2004 après avoir reçu les observations écrites du directeur de la maison d'arrêt et sans avoir entendu les protagonistes, la plainte avec constitution de partie civile, du 14 juin 2005, a été instruite. Tant le juge d'instruction que la chambre d'instruction, saisie en appel par le requérant, ont estimé par des décisions motivées et apparemment dépourvues d'arbitraire qu'il n'y avait pas lieu à suivre.
132. Dans ces conditions, la Cour estime que rien ne permet de remettre en cause la motivation des juridictions internes quant au déroulement de la fouille du 30 juin 2004.
iv. Conclusion
133. Selon la Cour, les conditions de détention du requérant, classé DPS dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d'établissements pénitentiaires, placé en régime d'isolement à long terme et faisant l'objet de fouilles corporelles intégrales régulières s'analysent, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3. Il y a donc violation de cette disposition."
PAYET contre FRANCE du 20 JANVIER 2011 REQUÊTE 19606/08
Rotations de sécurité
Le requérant a fait l’objet de 26 changements d’affectation (11 translations judiciaires et 15 transferts administratifs). Si la Cour admet que les transferts continuels d’un détenu peuvent avoir des effets très néfastes sur lui, elle estime que les craintes du gouvernement français quant à de possibles évasions – à l’origine de la décision d’opérer des rotations de sécurité – n’étaient pas déraisonnables étant donné que M. Payet s’est évadé par deux fois, qu’une tentative a été menée pour le faire évader et que lui-même a organisé l’évasion de certains de ses complices. La Cour note par ailleurs que le requérant est détenu au même endroit depuis septembre 2008.
Par conséquent, compte tenu du profil, de la dangerosité et du passé du requérant, les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention, lesquelles n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Ainsi, il n’y a pas eu violation de l’article 3 concernant les rotations de sécurité imposées au requérant.
Sanction disciplinaire à la prison de Fleury-Mérogis
Les allégations du requérant quant aux mauvaises conditions de détention au quartier disciplinaire (saleté, vétusté, inondations, absence de lumière suffisante pour lire ou écrire etc…) semblent confirmées par plusieurs sources.
Dans son arrêt du 9 avril 2008, le Conseil d’État a mentionné que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait « constaté que l’état des locaux des quartiers disciplinaires de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis [était] particulièrement dégradé » et la sénatrice Mme Campion s’est dit choquée par sa visite dans ces quartiers. Son constat selon lequel des travaux auraient du être engagés depuis longtemps était partagé par l’expert architecte nommé par le tribunal de Versailles.
La Cour estime que, même si les autorités n’avaient pas l’intention d’humilier le requérant, les conditions de détention qui lui ont été imposées étaient de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à sa dignité humaine. Elle conclut à la violation de l’article 3 à cet égard.
CHERVENKOV c. BULGARIE du 27 novembre 2012 Requête 45358/04
Un isolement long doit être adéquat à la santé et la psychologie du détenu
60. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000‑XI ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 50, Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, § 71, 11 mars 2004 et Piechowicz c. Pologne, no 20071/07, § 162, 17 avril 2012).
61. Des mesures privatives de liberté impliquent souvent un élément de souffrance ou d’humiliation. Toutefois, l’on ne peut dire que la détention dans des établissements pénitentiaires de haute sécurité soulève en soi une question au regard de l’article 3 de la Convention. Ainsi, l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux États parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (voir, par exemple, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, §§ 80-82 et 138, CEDH 2006‑IX, Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 42-54, CEDH 2000‑X, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 103-109, CEDH 2000‑IV, Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 78, 21 juillet 2005, Van der Ven, précité, §§ 26-31 et 50, et Csüllög c. Hongrie, no 30042/08, §§ 13-16, 7 juin 2011).
62. Lorsque la Cour examine la conformité des conditions de détention aux exigences de l’article 3 de la Convention, elle doit prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑II).
63. Bien que l’interdiction des contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection puisse dans certaines circonstances être justifiée, un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment. Il serait également souhaitable que des solutions alternatives à la mise à l’isolement soient recherchées pour les individus considérés comme dangereux et pour lesquels une détention dans une prison ordinaire et dans des conditions normales est considérée comme inappropriée (Ramirez Sanchez, précité, §§ 145-146, et Piechowicz, précité, § 164).
64. De plus, afin d’éviter tout risque d’arbitraire, la décision de continuer une période prolongée de maintien en isolement doit reposer sur des motifs sérieux. Ainsi, il doit apparaître de cette décision que les autorités ont conduit un examen tenant compte des changements dans la situation du requérant ou dans son comportement. Plus le temps passe, plus ces motifs devraient être détaillés et argumentés. De même, l’isolement social, qui représente une forme « d’emprisonnement au sein de la prison », devrait être appliqué de manière exceptionnelle et seulement une fois que toutes les précautions ont été prises, comme indiqué dans le paragraphe 53.1 des Règles pénitentiaires européennes (Piechowicz, précité, § 165, et d’autres références qui s’y trouvent citées ; voir également paragraphe 44 ci-dessus).
65. La Cour a aussi considéré que toute forme d’isolement qui n’est pas accompagné d’une stimulation mentale ou physique pourrait, à long terme, avoir des effets néfastes, résultant dans la détérioration des facultés mentales et des capacités sociales (Iorgov, précité, § 83, Csüllög, précité, § 30, et Piechowicz, précité, § 173).
66. Les allégations de traitements contraires à l’article 3 doivent être prouvées « au-delà de tout doute raisonnable » et la preuve de ces traitements peut également résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 54, 2 décembre 2004). Dans l’établissement des faits pertinents, la Cour doit s’appuyer sur l’ensemble des éléments de preuve fournis par les parties ou qu’elle s’est, au besoin, procurés d’office (ibidem).
67. En l’espèce, le requérant a décrit avec beaucoup de détails les conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu (paragraphe 7-11 ci‑dessus). Il a également présenté une déclaration datée de 2005 et signée par un autre détenu purgeant une peine de réclusion à perpétuité dans le même établissement pénitentiaire (paragraphe 14 ci-dessus). Cette déclaration corrobore les allégations du requérant concernant l’isolement social, l’absence d’hygiène suffisante, l’utilisation de seaux hygiéniques en plastique, et la qualité et la quantité insuffisantes des repas servis au prisonniers. Par ailleurs, les constats effectués par le CPT lors de ces visites de la prison de Burgas en 1999 et 2002 confirment ces allégations, même si certaines améliorations ont été notées en 2002 pour ce qui est du lancement d’un projet d’intégration des condamnés à la réclusion à perpétuité dans un autre établissement pénitentiaire en Bulgarie (paragraphes 37 et 42 ci‑dessus). De plus, la Cour note que le rapport du Comité bulgare d’Helsinki de 2011 a indiqué également que la pratique du seau hygiénique existait toujours (paragraphe 46 ci-dessus).
68. A cet égard, il convient de distinguer la présente espèce de l’affaire Iorgov (no 2), précitée, où la Cour a établi une évolution positive des conditions de détention et du régime pénitentiaire de l’intéressé (arrêt précité, §§ 65-66). Dans l’affaire qui lui est soumise, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas contesté la description faite par l’intéressé de ses conditions matérielles de détention à la prison de Burgas pendant la période comprise entre 1996 et 2007 (voir paragraphe 52 ci-dessus).
69. Le Gouvernement ne conteste pas non plus le fait que la mesure d’isolement social accompagnait automatiquement l’exécution de la peine de réclusion à perpétuité. Il apparaît des communications du Gouvernement du début 2012 que cet isolement n’a pas été justifié pendant toute la période entre novembre 1996 et juin 2007. En effet, le requérant est demeuré sous le régime en question pendant plus de dix ans car le changement est intervenu cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’exécution des peines (paragraphe 24 ci-dessus) et le Gouvernement n’indique pas que ce régime a été entretemps examiné en vue de son allègement. Ceci confirme le caractère automatique du régime pour la période de cinq ans après l’entrée de vigueur de la modification législative de 2002.
70. La Cour a déjà constaté, à l’occasion de l’examen d’autres affaires dirigées contre la Bulgarie, que l’application prolongée d’un régime pénitentiaire restrictif, combinée avec les effets néfastes de conditions matérielles inadéquates en prison, avait pour résultat de soumettre les détenus à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (voir, mutatis mutandis, Iorgov, précité, § 86, 11 mars 2004, et Iordan Petrov c. Bulgarie, no 22926/04, § 128, 24 janvier 2012). A cet égard, le CPT a demandé que l’isolation repose sur une évaluation personnalisée et s’applique aussi peu de temps que possible (paragraphe 43 ci-dessus). Les recommandations pertinentes du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe vont dans le même sens (voir paragraphes 44 et 45 ci-dessus). Au vu des éléments qui lui sont soumis, la Cour considère que dans la présente affaire également le requérant a été soumis à un traitement inhumain et dégradant.
71. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
Hellig c. Allemagne du 7 juillet 2011 Requête no 20999/05
Maintenir un prisonnier nu dans une cellule de sécurité pendant sept jours était injustifié
LES FAITS
Le requérant, Herbert Hellig, est un ressortissant allemand né en 1953 et résidant à Francfort-sur-le-Main.
En octobre 2000, alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à Butzbach, il fut prié par les autorités pénitentiaires de quitter sa cellule individuelle pour une cellule qu’il allait devoir partager avec deux codétenus et qui ne comportait ni écran ni rideau de séparation entre les toilettes et le reste de la pièce. Dans une lettre adressée au directeur de la prison, M. Hellig indiqua qu’il refusait de changer d’endroit et que placer une personne dans une telle cellule était illégal. Le 12 octobre 2000, des agents de la prison lui ordonnèrent de quitter sa cellule individuelle et l’avertirent qu’en cas de refus ils allaient recourir à la force. Sur le seuil de la cellule collective, M. Hellig refusa à nouveau de bouger et une lutte s’ensuivit entre lui et le personnel. Il y a controverse sur le point de savoir si les agents pénitentiaires ont frappé M. Hellig et lui ont donné des coups de pied face à une simple résistance passive, ou si l’intéressé lui-même a donné des coups de pied aux agents.
Par la suite, M. Hellig fut placé dans une cellule de sécurité d’environ 8 m2, équipée d’un matelas et de toilettes sans siège et dépourvue de tout objet perçu comme dangereux ; l’intéressé y fut déshabillé et fouillé à corps. Le médecin de la prison l’examina le jour même, puis à plusieurs reprises les jours suivants. Dans son rapport, il signala quelques ecchymoses sans gravité et un hématome pouvant guérir sans complications. Le pasteur de la prison, qui rendit visite à M. Hellig trois jours après son placement en cellule de sécurité, indiqua dans son rapport que l’intéressé était nu. Le requérant resta dans cette cellule pendant une semaine puis, avec son consentement, fut placé à l’hôpital de la prison.
Après son transfert à l’hôpital de la prison, M. Hellig saisit le tribunal régional, qu’il pria de déclarer illégales sa détention en cellule d’isolement et la force qu’avaient utilisée les autorités pénitentiaires. En avril 2004, le tribunal le débouta, estimant qu’il avait été placé en cellule d’isolement parce qu’eu égard à son comportement il y avait eu un risque spécifique qu’il n’infligeât violences et dommages physiques à autrui, comme l’avaient confirmé les agents de la prison, selon lesquels l’intéressé avait commencé à les pousser et à les frapper. La juridiction régionale considéra que la détention du requérant dans cette cellule avait été une mesure proportionnée, compte tenu du risque particulier que l’intéressé ne résistât par la force à toute tentative de transfert dans une autre cellule. D’après un rapport du psychologue de la prison, il avait refusé tout compromis.
Le tribunal souligna par ailleurs que le placement dans une cellule pour plusieurs détenus où les toilettes n’étaient pas séparées du reste de la pièce par un écran ou un rideau aurait été illégal. La décision du tribunal régional fut confirmée en appel et, le 28 décembre 2004, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel formé par M. Hellig.
En mars 2001, une procédure pénale distincte que le requérant avait entamée contre les agents pénitentiaires impliqués dans son placement en cellule de sécurité fut close par le procureur, lequel observa qu’aucune fracture ni autre atteinte osseuse n’avaient été décelées lors de l’examen radiographique effectué quelques jours après le transfert du requérant et estima que l’on ne pouvait établir si les lésions mineures sur le corps de l’intéressé avaient été causées par le personnel de la prison, notamment par des coups de pied, ou si elles étaient le résultat inévitable du placement forcé en cellule de sécurité.
ARTICLE 3
La Cour déclare irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief de M. Hellig relatif aux mauvais traitements qu’il aurait subis. Elle observe que l’intéressé n’a soumis aucun élément de preuve réfutant le constat des juridictions internes selon lequel c’était lui qui avait usé de la violence contre les gardiens de prison, et non l’inverse, et elle conclut que, eu égard au caractère mineur des lésions litigieuses, le seuil requis pour que l’on puisse parler de traitement inhumain n’a pas été atteint en ce qui concerne le traitement réservé à l’intéressé lors de son transfert.
S’agissant du placement et de la détention du requérant en cellule de sécurité, la Cour estime que l’équipement extrêmement rudimentaire de cette cellule ne convenait pas pour un placement de longue durée. Le placement du requérant n’était toutefois pas censé être une mesure de longue durée, comme le démontre le fait que les autorités pénitentiaires et le service de soutien psychologique se sont employés à convaincre l’intéressé de quitter la cellule de sécurité et l’ont finalement transféré à l’hôpital de la prison, aucune autre cellule individuelle n’ayant apparemment été disponible à ce moment-là.
Les documents soumis par les parties n’indiquent pas clairement si l’intéressé est resté nu pendant l’intégralité de son séjour dans cette cellule, et il ne semble pas que pendant son placement en cellule de sécurité ou au cours de la procédure devant les juridictions internes il se soit expressément plaint d’avoir été privé de vêtements. Cependant, la Cour prend note des observations du Gouvernement selon lesquelles il est courant de placer les détenus sans vêtements dans ce type de cellule, ce afin de les protéger, tant qu’ils sont agités, contre tout risque qu’ils ne se blessent eux-mêmes. En outre, le pasteur de la prison, qui avait rendu une brève visite à M. Hellig trois jours après son placement en cellule de sécurité, avait indiqué qu’il était nu. Présumant que la règle générale invoquée par le Gouvernement a été appliquée à M. Hellig, la Cour conclut à l’existence d’indices suffisamment solides, clairs et concordants selon lesquels l’intéressé est resté nu pendant l’intégralité de son séjour en cellule de sécurité. Les autorités internes ont eu connaissance de ces indices et auraient été en mesure d’examiner les faits de manière approfondie.
La Cour estime que priver un détenu de vêtements est une mesure de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier et à avilir l’intéressé. Elle prend note du fait que la pratique consistant à placer un détenu en cellule de sécurité sans vêtements vise à empêcher l’individu concerné de se faire du tort à lui-même.
Cependant, le tribunal régional n’a pas établi avec certitude s’il y avait eu un risque sérieux que l’intéressé ne se blessât lui-même ou ne se suicidât pendant son séjour en cellule de sécurité, et rien n’indique que les autorités pénitentiaires aient envisagé de recourir à des mesures moins intrusives, telles la mise à disposition de vêtements indéchirables, pratique recommandée par le Comité européen pour la prévention de la torture.
A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que si, en soi, le placement de sept jours en cellule de sécurité a pu être justifié par les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas de motifs suffisants pour justifier un traitement aussi dur que celui ayant consisté à priver M. Hellig de vêtements pendant l’intégralité de sa détention en cellule de sécurité.
Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l’article 3.
B.M. et autres c. France requêtes no 84187/17 et 5 autres du 6 juillet 2023
Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Mauvaises conditions de détention notamment pour les fouilles corporelles
Art 13 (+ Art 3) • Absence de recours effectif préventif
Art 3 : La Cour européenne juge que la procédure de référé liberté constitue une voie de recours effective pour remédier aux atteintes à l’article 3 de la Convention résultant d’un régime de fouilles corporelles intégrales
Violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme dans les requêtes nos 1734/18, 13562/18, et 29241/18, à raison des conditions matérielles de détention des requérants et de l’absence de recours effectif. Les affaires concernent les conditions de détention à la maison d’arrêt de Fresnes et l’existence d’un recours effectif pour y remédier, ainsi que, pour cinq des six requérants, l’application d’un régime de fouille intégrale à la sortie des parloirs. En ce qui concerne les requêtes n os 1734/18, 13562/18, et 29241/18, la Cour note les trois requérants étaient détenus à la maison d’arrêt de Fresnes aux mêmes périodes que l’étaient les requérants dans l’affaire J.M.B. et autres, dans laquelle elle avait conclu que les intéressés avaient été soumis à des conditions de détention constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention et avait également jugé qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif susceptible de leur assurer une amélioration de leurs conditions matérielles de détention, en violation de l’article 13 de la Convention. La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans les présentes affaires. Elle considère donc qu’il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des conditions de détention subies par les requérants du fait de la surpopulation carcérale et de l’absence de recours effectif préventif à l’époque de leur détention. La nouveauté de ces affaires réside dans le grief des requérants portant sur l’application du régime de fouilles à la maison d’arrêt de Fresnes. Les requérants, qui étaient détenus lorsqu’ils ont saisi la Cour, soutenaient être soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales les exposant à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et, par conséquent, à une violation continue du droit garanti par cette disposition. Après avoir relevé que la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de la justice administrative, qui permet au juge des référés, en cas d’urgence caractérisée, de remédier à bref délai aux atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale, a effectivement permis, dans un certain nombre de cas, de remédier à la violation de l’article 3 de la Convention s’agissant de la pratique des fouilles intégrales, la Cour conclut, au vu des circonstances, qu’eu égard à l’office du juge administratif, le référé-liberté doit être regardé, à l’époque des faits litigieux, comme constituant, en la matière, une voie de recours effective et disponible, en théorie comme en pratique.
cedh
54. La Cour renvoie aux principes relatifs à l’épuisement des voies de recours internes tels qu’ils ont été rappelés dans les arrêts Selahattin Demirtaş c. Turquie (no2) ([GC], no 14305/17, §§ 205-206, 22 décembre 2020), Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) ([GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 71, 25 mars 2014) et Pagerie c. France (no 24203/16, 19 janvier 2023).
55. En particulier, la règle de l’épuisement des voies de recours internes a pour finalité de permettre à un État contractant d’examiner, et ainsi de prévenir ou redresser, la violation de la Convention qui est alléguée contre lui. Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention a, en effet, une vocation subsidiaire (idem, § 120).
56. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité requises (idem, § 121).
57. Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation litigieuse et présenter des perspectives raisonnables de succès. Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné, qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec, ne constitue pas une raison propre à justifier le non-exercice du recours en question (idem, § 122).
58. En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement d’établir devant la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Il revient ensuite au requérant d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été exercé ou bien que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de l’exercer (idem, § 123).
59. À titre liminaire, la Cour relève, en premier lieu, que lorsqu’ils ont saisi la Cour, les requérants se trouvaient détenus et soutenaient être soumis à un régime de fouilles les exposant à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et, partant, à une violation continue du droit garanti par cette disposition. Elle constate, en second lieu, que les requérants n’ont engagé aucune procédure devant les juridictions internes pour contester l’application de ce régime de fouilles et obtenir qu’il y soit mis un terme. À cet égard, ils font valoir qu’ils étaient dispensés de l’obligation d’épuiser les recours internes dont ils disposaient du fait de la pratique généralisée de l’administration de la MA de Fresnes, réfractaire à toute injonction ou recommandation de la part des autorités juridictionnelles ou d’autres organes de contrôle qui avaient déjà été saisis de la légalité d’un régime soumettant l’ensemble des personnes détenues à des fouilles systématiques à la sortie des parloirs. Pour déterminer si les exigences d’épuisement des voies de recours internes ont été ou non respectées, il revient à la Cour de vérifier si les recours ouverts devant le juge administratif et dont se prévaut le Gouvernement au titre de son exception d’irrecevabilité étaient adéquats, effectifs et de nature à obtenir qu’il soit mis fin aux pratiques dénoncées par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il s’agit de déterminer s’il existait ou non un recours préventif effectif de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée.
60. En ce qui concerne les procédures de référé qui permettent au juge administratif de statuer dans l’urgence et, le cas échéant, de mettre un terme à une violation continue de l’article 3 de la Convention (voir, pour des exemples récents de fouilles à nu répétées, aléatoires ou systématiques contraires à cette disposition, Roth c. Allemagne, nos 6780/18 et 30776/18, §§ 70-72, 22 octobre 2020, Safi et autres c. Grèce, no 5418/15, §§ 190 à 192, 7 juillet 2022), le Gouvernement soutient que les requérants auraient dû exercer un référé-liberté. S’agissant du contrôle exercé par le juge des référés sur l’application d’un régime de fouilles corporelles intégrales, la Cour renvoie aux développements ci-dessus (paragraphes 36 à 43). Elle rappelle que, dans l’arrêt El Shennawy c. France (no 51246/08, § 57, 20 janvier 2011), elle a pris acte de l’existence de cette voie de recours (§ 57), qui est dispensée de ministère d’avocat tant en première instance qu’en appel (J.M.B. et autres précité, § 137). Reste à examiner si elle était effective dans les circonstances de l’espèce.
61. À cet égard, la Cour rappelle que la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de la justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence caractérisée, de remédier à bref délai, aux atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale (Pagerie, précité, § 129 et les références citées). Elle souligne aussi que les décisions du juge des référés revêtent un caractère exécutoire (idem).
62. En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales, la Cour relève qu’il ressort de la jurisprudence constante et bien établie du Conseil d’Etat que le juge des référés exerce un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de l’application à une personne détenue d’un régime de fouilles, pour déterminer s’il porte atteinte ou non à sa dignité (paragraphes 37, 40 et 42 ci-dessus). Elle souligne par ailleurs que ce contrôle ne se limite pas aux mesures individuelles de fouille mais peut également porter sur une note de service de l’administration pénitentiaire instituant un régime de fouille ou sur une pratique administrative révélant une décision informelle d’appliquer un tel régime (paragraphes 41 et 48 ci-dessus). La Cour relève également que le juge des référés peut, dans le cadre de ses pouvoirs, suspendre l’exécution de la mesure de fouille critiquée, enjoindre à l’administration d’aménager ou de modifier les conditions d’application d’un régime de fouille ou d’en réévaluer à intervalle régulier le bien-fondé (paragraphes 41, 42 et 48 ci-dessus). Elle en déduit qu’eu égard à son office, le juge du référé-liberté est doté de pouvoirs lui permettant de faire cesser, à bref délai, les violations continues dont il est saisi.
63. La Cour considère donc, contrairement aux affirmations des requérants, qu’en dépit des difficultés qu’ils invoquent à ce que soient modifiées les pratiques existantes au sein de la MA de Fresnes, la voie du référé-liberté avait une chance raisonnable de succès en ce qui les concerne.
64. Elle souligne certes qu’ils déplorent à bon droit l’absence de notification ou de traçabilité des fouilles pratiquées en détention mais elle rappelle que cette carence n’affecte pas, en pratique, l’exercice d’un recours en référé-liberté puisque que le juge peut être saisi d’une demande de suspension d’un régime de fouilles non formalisé par écrit (paragraphe 62 ci‑dessus) et qu’il peut, dans le cadre du débat contradictoire (paragraphe 33 ci-dessus), demander à l’administration pénitentiaire de produire tout élément de nature à révéler la pratique d’un tel régime. Par ailleurs, les requérants font valoir que cette voie de recours était nécessairement vouée à l’échec en raison de l’incapacité du juge à obtenir qu’il soit effectivement mis fin au régime de fouilles en place à la MA de Fresnes. Rappelant que les procédures de référé-liberté ont effectivement permis de remédier à la violation de l’article 3 de la Convention en la matière, dans un certain nombre de cas (paragraphes 37, 40, 42 et 48 ci-dessus), la Cour ne saurait, en l’absence de toute procédure engagée par les intéressés dans les présentes affaires, spéculer dans l’abstrait sur l’impossibilité d’obtenir l’exécution effective de mesures ordonnées par le juge des référés. Elle rappelle en outre qu’ils disposaient de procédures leur permettant, le cas échéant, de rechercher l’exécution des mesures prescrites par le juge des référés (J.M.B. et autres, précité, §§ 147 à 149, paragraphe 51 ci-dessus).
65. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut qu’eu égard à l’office du juge administratif, et en particulier à l’étendue de son contrôle et à la portée de ses pouvoirs, le référé-liberté doit être regardé, à l’époque des faits litigieux, comme constituant, en la matière, une voie de recours effective et disponible, en théorie comme en pratique.
66. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère effectif des autres voies recours invoquées par le Gouvernement, la Cour conclut que l’exception préliminaire de ce dernier doit être accueillie, et que le grief des requérants tiré de l’article 3 relatif aux fouilles doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 et de la Convention.
67. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence de recours effectif pour y mettre fin. Aux termes des dispositions de l’article 13 :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
68. La Cour relève que les parties sont parvenues à des règlements amiables dans trois affaires. Dans les trois autres affaires, les requérants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits par les termes des déclarations unilatérales soumises par le Gouvernement à la Cour. La Cour examinera ces deux cas de figure séparément.
69. La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle considère que ces accords reposent sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne relève par ailleurs aucune raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). Elle en déduit qu’il convient de rayer cette partie des requêtes du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
70. Dans des lettres des 31 mai et 30 juillet 2021, auxquelles se trouve joint le texte de déclarations unilatérales, le Gouvernement invite la Cour à rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
71. Ayant examiné les termes de ces déclarations unilatérales, la Cour considère, en dépit des concessions consenties par le Gouvernement sur le fondement de l’arrêt J.M.B. et autres précité, que les montants des indemnisations proposées ne constituent pas, eu égard aux montants généralement alloués dans des affaires similaires, et en particulier dans cet arrêt, une réparation adéquate (comparer avec ce dernier, §§ 333 et 335).
72. En conséquence, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de cette partie des requêtes du rôle. Il lui incombe dès lors de poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond des affaires.
73. La Cour constate que les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention. Partant, la Cour les déclare recevables.
74. Les trois requérants font valoir qu’ils ont été détenus dans des conditions matérielles gravement attentatoires à l’article 3 de la Convention sans disposer de recours pour y mettre fin.
75. Le Gouvernement souligne qu’à la suite de l’arrêt JM.B. et autres précité, le législateur français, sur l’initiative de la Cour de cassation, a adopté la loi no 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (paragraphe 28 ci-dessus). Il soutient que le nouveau recours créé par cette loi, combiné aux recours en référés devant le juge administratif déjà à la disposition des personnes détenues (paragraphe 32 ci‑dessus), permettent d’améliorer les conditions matérielles de détention ou de remédier à la situation dans le respect de la jurisprudence de la Cour. Cela étant, en ce qui concerne les trois requérants, il s’en remet à la sagesse de la Cour car ils étaient détenus à la MA de Fresnes à la même période que les intéressés dans l’affaire J.M.B. et autres.
76. La Cour relève en effet que les trois requérants étaient détenus à la MA de Fresnes aux mêmes périodes que l’étaient les requérants dans l’affaire J.M.B. et autres (§§ 110 à 112). Dans cette dernière, elle a conclu que les intéressés avaient été soumis à des conditions de détention constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention (§§ 299 à 301). Elle a également jugé qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif susceptible de leur assurer une amélioration de leurs conditions matérielles de détention, en violation de l’article 13 de la Convention (§§ 212 à 221).
77. La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans les présentes affaires. Dans ces conditions, elle considère qu’il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des conditions de détention subies par les requérants et de l’absence de recours effectif préventif à l’époque de leur détention.
KONSTANTINOPOULOS et autres c. GRÈCE (n° 2) du 22 novembre 2018 Requêtes nos 29543/15 et 30984/15
Violation de l'article 3 : Onze détenus de la prison de Grevena ont subi des mauvais traitements lors d’une fouille dans leurs cellules en 2013
LES FAITS
Les 22 requérants sont des ressortissants grecs, albanais et bulgares, détenus à la prison de Grevena (Grèce). Le 13 avril 2013, une fouille surprise des cellules eut lieu à la prison de Grevena en raison d’informations faisant état d’une possible évasion ou d’une révolte des prisonniers. La fouille fut effectuée en la présence d’un procureur, par le personnel pénitentiaire de la prison, assisté des policiers de l’EKAM (unité spéciale de lutte contre le terrorisme). À la fin de la fouille, 28 détenus furent examinés par le médecin de la prison qui constata des contusions et des traces de dermatite, sans pouvoir en déterminer la cause. Quelques jours plus tard, certains détenus introduisirent une plainte auprès du parquet du tribunal correctionnel de Grevena, invoquant, entre autres, que les membres de l’EKAM avaient fait un usage excessif de « tasers » sur 31 détenus, qu’ils les avaient frappés et agressés verbalement et qu’ils les avaient forcés à se rendre à quatre pattes dans la salle de sport de la prison, à se déshabiller entièrement et à se tenir debout, la tête face au mur pendant un certain temps. Une enquête préliminaire fut menée, aboutissant à la conclusion qu’aucune faute disciplinaire n’avait été commise. Le directeur de police classa l’affaire. En novembre 2014, le procureur près le tribunal correctionnel décida qu’il n’y avait pas d’indices suffisants pour engager des poursuites pénales. Le mois suivant, le procureur près la cour d’appel décida de classer l’affaire.
CEDH
1. Sur les allégations de mauvais traitements infligés par les policiers
67. Les requérants soutiennent que l’usage de la force à leur égard était disproportionné dans les circonstances de la cause et était infligé de manière délibérée et intentionnelle dans le but de les intimider et de les humilier. L’EKAM est une unité formée pour combattre le terrorisme et ses membres sont équipés de gilets pare-balles, de casques et de vestes résistantes au feu. À supposer qu’il y eût des cafés lancés et de tables renversées, cela ne constituait pas une vraie menace pour des hommes si bien entraînés. En outre, contrairement aux dires du procureur, un seul couteau improvisé a été découvert lors de la fouille. Les membres de l’EKAM, assistés par le personnel pénitentiaire, ouvraient les cellules une par une et leur nombre était bien supérieur à celui des trois détenus par cellule qui ne pouvaient en aucun cas constituer une menace pour la sécurité dans la prison. Le rapport du médecin légiste fait état des traces de « taser » sur le cou de la plupart des requérants et des traces des coups sur leur thorax, leurs bras, leurs pieds et même sur les testicules du requérant Starova.
68. Le Gouvernement soutient que l’usage de la force n’était pas excessif mais approprié dans les circonstances de la cause, notamment pour faire face au comportement d’un groupe spécifique de détenus. L’usage des « tasers » a été fait dans les limites strictes du déroulement de la fouille et afin d’assurer le bon fonctionnement de la prison, pour une période très courte (2 secondes) et par des fonctionnaires de police spécialement entrainés à leur maniement. En raison de l’étroitesse du lieu dans lesquels la fouille a été effectuée, l’utilisation d’un autre équipement moins drastique, comme la matraque ou les gaz lacrymogènes, n’était pas indiquée. Au-delà d’une gêne instantanée, l’utilisation des « tasers » n’a pas eu pour effet de causer ni de lésions corporelles ou psychiques, ni des sentiments d’angoisse et d’infériorité propres à humilier les détenus. Il n’est pas fortuit, que des 140 détenus de l’aile B et de 70 détenus de la sous-aile A2, seulement 26 ont demandé à être examiné par le médecin de la prison et 29 par le médecin légiste. Sur plusieurs d’entre eux, aucune lésion n’a été relevée et dans le cas où il y en avait, la cause n’était pas certaine.
69. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V).
70. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement, porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Selmouni, précité, § 99, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, §§ 52-53).
71. Dans pareils cas, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Tekin, précité, §§ 52 et 53, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).
72. La Cour garde à l’esprit le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire et le fait qu’une désobéissance des détenus puisse dégénérer rapidement en une mutinerie, nécessitant ainsi l’intervention des forces de l’ordre (Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 77, 21 décembre 2006). En l’occurrence, la Cour note que les forces de police de l’EKAM qui sont intervenus dans la prison de Grevena n’ont pas été appelés soudainement pour faire face à une mutinerie spontanée des détenus. Leur intervention était ordonnée et organisée par les autorités pénitentiaires et le parquet de Grevena dans le cadre d’une opération plus générale concernant plusieurs prisons et faisant suite à d’autres fouilles effectuées antérieurement dans la prison de Grevena. Les requérants n’étaient donc pas blessés au cours d’une opération menée au hasard qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels les forces de police présentes aurait pu être appelées à réagir sans y être préparées, mais au cours d’une opération programmée et suffisamment rôdée du point de vue de l’évaluation des risques (Kurnaz et autres c. Turquie, no 36672/97, § 55, 24 juillet 2007 ; Rehbock c. Slovènie, no 29462/95, § 72, 28 novembre 2000).
73. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu’aucun tribunal national n’a statué sur les faits litigieux, la Cour considère qu’il appartient au Gouvernement de démontrer par des arguments convaincants que le recours à la force n’était pas excessif (voir, mutatis mutandis, Matko c. Slovènie, no 43393/98, § 104, 2 novembre 2006).
74. La Cour note que le Gouvernement tente de justifier le recours à la force par des motifs se rapportant à la sécurité générale dans la prison. Se fondant sur les constats du procureur qui a effectué l’enquête, il soutient que les forces de l’EKAM étaient prévenus par les autorités de la prison que la plupart des détenus étaient armés avec des lames improvisées, que certains détenus lançaient des objets aux forces de l’EKAM, renversaient des tables et tentaient d’occuper le couloir devant les cellules afin de prendre possession de l’espace extérieur de celles-ci et se confronter avec les forces de police.
75. Toutefois, la Cour note que dans ce même rapport, il est indiqué que les détenus entraient dans leurs cellules dont les portes fermaient immédiatement. Par la suite, les portes s’ouvraient une par une et les membres de l’EKAM entraient dans les cellules afin de prévenir toute tentative de résistance des détenus ou toute tentative de voies de fait avec des armes improvisées. La Cour en déduit que l’ensemble des forces de l’EKAM et du personnel pénitentiaire n’avait qu’à contrôler une seule cellule et ses trois occupants. À supposer même que ceux-ci aient refusé d’obtempérer, la Cour est d’avis que la sécurité de la prison et le besoin de contrôler trois détenus qui auraient pu lancer des objets et renverser des tables ne nécessitait pas l’usage, sinon de matraques, du moins des « tasers ».
76. Or, le rapport du médecin légiste précisait que certains des requérants avaient des lésions qui auraient pu provenir de l’utilisation de « tasers », mais qu’il était difficile de l’affirmer ou de l’exclure, compte tenu de l’écoulement d’un grand laps de temps.
77. D’un autre côté, le rapport établi par l’officier supérieur de police qui a mené l’enquête administrative assermentée notait que l’un des policiers entendus avait déposé que lorsque des détenus avaient réagi de manière agressive en lançant des objets et en renversant des tables, les policiers firent usage de « tasers » pour une durée minimale (deux secondes) afin de mettre fin à ce comportement. Il soulignait aussi qu’en raison de l’étroitesse des lieux, il n’était pas possible d’utiliser un instrument moins drastique, telle du gaz lacrymogène ou de matraques.
78. La Cour attache aussi de l’importance aux déclarations du député, président de la commission parlementaire chargée du contrôle du système pénitentiaire, qui s’était rendu à la prison de Grevena et selon lesquelles le rapport du médecin de la prison que lui avait remis le directeur de la prison « ne laissait aucun doute quant au tabassage impitoyable et aux tortures subis par le détenus avant la fouille dans les cellules ». Toutefois, le rapport du médecin de la prison qui a examiné en premier les détenus et tout de suite après la fouille ne figure pas parmi les documents déposés par le Gouvernement à la Cour.
79. À cela s’ajoutent les allégations des requérants selon lesquelles ils ont été obligés de ramper à quatre pattes jusqu’à la salle de sport de se dénuder et rester debout longtemps face au mûr. Si mention de ces allégations n’est faite dans aucun rapport établi par les autorités, la Cour note que ces dernières n’ont pas consenti à la demande des détenus de produire les bandes sono et vidéo de la prison lors de l’enquête.
80. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’en ce qui concerne les requérants qui ne présentent aucune preuve ou commencement de preuve pour des lésions prétendument subies ou quant à ceux qui n’ont pas été examinés par le médecin légiste ou refusé de le faire (paragraphes 20-21 ci-dessus), il n’a pas été établi que ceux-ci ont fait l’objet de mauvais traitements, du moins, pas à un niveau de gravité tombant sous le coup de l’article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999).
81. Il en va autrement des requérants cités au paragraphe 19 ci-dessus. Le rapport de médecin légiste concernant ces personnes indique en effet de nombreuses lésions réparties sur le corps, lesquelles atteignent, aux yeux de la Cour, le seuil de gravité en question (Labita précité, mêmes références). Par ailleurs, vu les éléments du dossier précités, la Cour considère aussi que les lésions décelées sur ces requérants ont eu lieu lors de la fouille du 13 avril 2013.
82. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, mais aussi au contexte dans lesquels ces sévices ont eu lieu, la Cour estime que les requérants ont subi des mauvais traitements et non des actes de torture.
83. La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 de ce chef dans le cas des requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda et à la non-violation de cet article dans le cas des requérants Konstantinopoulos, Baku, Xaka, Hysa, Beiko, Cerepi, Himaj, Buluko-Megi, Cela et Shtypalli.
2. Sur l’absence d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements
b) Principes généraux
90. La Cour rappelle que lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis alors qu’il se trouve dans les mains d’agents de l’État, la notion de « recours effectif » requiert une enquête approfondie et effective. Quant au type d’enquête, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir dès qu’une plainte officielle est déposée. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 133, 3 juin 2004).
91. L’enquête menée doit être « effective » en pratique comme en droit et ne pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (ibid. § 134 et jurisprudence citée).
92. Pour qu’une enquête menée au sujet de torture ou de mauvais traitements commis par des agents de l’État puisse passer pour effective, l’on peut considérer, d’une manière générale, qu’il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements. Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (ibid. § 135 et jurisprudence citée).
93. Nul doute qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (ibid. § 136 et jurisprudence citée).
94. S’agissant en particulier de détenus blessés pendant une opération des forces spéciales de la police dans une prison, l’article 3 impose par ailleurs aux autorités l’obligation positive de faire effectuer un examen médical de ceux-ci d’une manière rapide (Karabet et autres, précité, § 264 ; Dedovskiy et autres c. Russie, no 7178/03, § 90, CEDH 2008 (extraits)).
c) Application des principes en l’espèce
i) Caractère approfondi de l’enquête
95. En l’espèce, la Cour note que le médecin légiste a examiné les requérants le 4 mai 2013, soit plus de 20 jours après les faits. Il a constaté que certains d’entre eux avaient des lésions qui auraient pu provenir de l’utilisation de « tasers », mais a souligné qu’il était difficile de l’affirmer ou de l’exclure, compte tenu de l’écoulement d’un grand laps de temps. Le médecin légiste a aussi insisté sur cet élément temporel lors de l’examen d’un autre détenu, non requérant, pour lequel il a affirmé que les traces visibles des blessures auraient pu disparaitre avec le temps (paragraphes 18 et 22 ci-dessus).
96. En deuxième lieu, la Cour a des doutes quant à l’impartialité du médecin de la prison, lui-même un codétenu, qui alors qu’il a examiné les requérants tout de suite après la fin de la fouille, il prétendait ne pas pouvoir déterminer la cause des contusions et des traces portées par ceux-ci et déclarait seulement que de telles traces étaient habituelles parmi les détenus et provenaient souvent des rixes entre eux et ne risquaient en aucun cas de provoquer une lésion corporelle pérenne.
97. En troisième lieu, l’officier de police supérieur qui a mené l’enquête administrative assermentée, alors qu’il a constaté l’utilisation des « tasers » et a cité en entier les conclusions du médecin légiste qui avait examiné les requérants, n’en a tiré aucune conséquence. Il a seulement reproduit en longueur les dépositions de certains officiers de police impliqués dans l’incident qui décrivaient les circonstances dans lesquelles la fouille s’était déroulée.
98. En quatrième lieu, le procureur chargé de l’enquête préliminaire, tout en admettant que l’utilisation des « tasers » était probable, a qualifié les blessures des requérants comme des « lésions corporelles mineures, ne méritant pas d’être mentionnées ou commentées », en se fiant aux conclusions du médecin légiste. Le procureur a rédigé son rapport sur la base des dépositions du chef de l’unité de l’EKAM et d’un agent pénitentiaire, le rapport du médecin légiste et les conclusions de l’officier de police supérieur qui a mené l’enquête administrative assermentée.
99. La Cour note que l’officier de police supérieur et le procureur n’ont pas approfondi leur enquête alors qu’ils se trouvaient en présence des déclarations contradictoires : d’une part, celles du directeur de la prison qui affirmait que ni lui, ni le procureur présent, ni le directeur de la police de Grevena, ni les autres officiers de police présents, n’avaient remarqué l’emploi de cet appareil ; d’autre part, les dépositions de certains policiers qui affirmaient avoir fait une utilisation limitée des « tasers » pour deux seconds environ. À cet égard, la Cour note que les autorités n’ont pas donné suite à la demande des représentantes des requérants de recevoir une copie de la bande audio et vidéo de la prison du jour de la fouille. Ainsi, le droit des requérants de participer effectivement à l’enquête n’a pas été assuré.
ii) Caractère rapide de l’enquête
100. En ce qui concerne le caractère rapide de l’enquête, la Cour note en premier lieu, que les autorités n’ont pas agi tout de suite dès que la question des mauvais traitements leur avaient été signalé, d’une part, par les plaintes des détenus des 13 et 18 avril 2013 (paragraphes 12 et 16 ci-dessus) , d’autre part, par la mobilisation des députés et du ministre de la Justice qui se sont rendus à la prison les jours qui ont suivi la fouille et ont fait des déclarations dans la presse (paragraphe 15 ci-dessus).
101. La Cour note aussi que le 18 juillet 2013, la représentante des requérants demandait au procureur d’agir et de prendre toutes les mesures nécessaires pour rassembler et préserver tous les éléments de preuve (paragraphe 24 ci-dessus). Le 7 août 2013, les requérants, par l’intermédiaire de leur représentante, se sont plaints auprès du procureur de l’inaction des autorités (paragraphe 26 ci-dessus). Ce n’est que le 31 octobre 2013 que le directeur de la prison a été entendu dans le cadre de l’enquête (paragraphe 27 ci-dessus). Le 12 février 2014, quatre députés ont engagé une procédure de contrôle parlementaire relative à l’inefficacité de l’enquête (paragraphe 28 ci-dessus). Alors que le 15 mars 2014, le procureur près le tribunal correctionnel a demandé à la Direction de police de Macédoine de l’ouest de mener une enquête administrative assermentée, celle-ci n’a désigné l’officier supérieur pour la mener que le 28 août 2014. Ce dernier a déposé son rapport le 8 octobre 2014 (paragraphes 29-30 ci-dessus). Enfin, le 10 décembre 2014, le procureur près la cour d’appel de la Macédoine de l’ouest a décidé de classer l’affaire en suivant la proposition du procureur près le tribunal correctionnel, qui avait complété son rapport le 24 novembre 2014 (paragraphes 36-37 ci-dessus).
102. Vingt mois environ se sont donc écoulés entre la plainte des requérants et la date à laquelle les autorités ont classé l’affaire sans suite. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation, au titre de l’article 3, de mener leur enquête avec diligence et célérité (voir, mutatis mutandis, Lolayev c. Russie, no 58040/08, § 84, 15 janvier 2015 ; Aleksey Borisov c. Russie, no 12008/06 ; § 54, 16 juillet 2015).
iii) Indépendance des autorités responsables de l’enquête
103. En ce qui concerne l’exigence d’indépendance des autorités responsables de l’enquête, la Cour note d’emblée que l’enquête a été confiée à un membre du parquet du tribunal correctionnel de Grevena. Or, les procureurs près ce tribunal sont aussi les procureurs superviseurs de la prison de Grevena et l’un d’entre eux était aussi présent lors de la fouille du 13 avril 2013.
104. En sus de cette proximité fonctionnelle, la Cour relève que le procureur chargé de l’enquête a fait preuve de parti pris à l’égard des requérants : non seulement en refusant de communiquer à la représentante des requérants la copie de la bande vidéo et audio des caméras de la prison, mais en considérant que les membres de l’EKAM avaient agi en respectant les principes de la légalité, de la proportionnalité et de l’indulgence et sans faire un usage disproportionné de la force, compte tenu des circonstances dans lesquelles s’était déroulée la fouille (détenus furieux dont la plupart étaient armés avec des couteaux improvisés) (paragraphe 36 ci-dessus). Or, le 13 avril 2013, un seul couteau a été découvert dans les cellules qui ont été fouillées (paragraphe 10 ci-dessus).
105. Enfin, force est de constater que le procureur a ouvert aussi une enquête contre les détenus concernés pour « résistance et agression contre des officiers de police ». L’affaire fut classée par la suite au motif que les auteurs de ces infraction n’étaient pas identifiables et donc une enquête préliminaire ou une instruction ne pourrait pas aboutir (paragraphe 25 ci-dessus). Toutefois, à l’instar des requérants, la Cour voit à cette enquête et le classement de l’affaire une tentative d’intimidation des requérants car l’identité de ceux qui ont refusé d’obtempérer pendant la fouille était bien connue des autorités de la prison.
106. De l’avis de la Cour, il n’y a pas eu d’enquête indépendante au sujet des allégations de mauvais traitements des requérants.
iv) Effectivité des recours existants
107. La Cour note que les requérants ont fait usage du recours prévu à l’article 572 du code de procédure pénale et que les recours prévus à l’article 6 du code pénitentiaire et à l’article 31 du Règlement intérieur des établissements de détention, mentionnés par le Gouvernement, sont du même type que celui de l’article 572 précité. Compte tenu des motifs à l’origine de son constat de violation de l’article 3 relativement aux aspects procéduraux, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, ces recours ne peuvent pas être considérés comme effectifs.
108. Enfin, en ce qui concerne l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil mentionnée par le Gouvernement, la Cour note que cet article ne s’applique qu’en cas de dommages causés par des actes illégaux des organes de l’État dans l’exercice de la puissance publique. Or, en l’espèce, les circonstances de la fouille ont fait l’objet d’une enquête administrative assermentée mais qui n’a décelé aucun acte ou omission illégaux de la part des forces de police (paragraphes 35-37 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime qu’une action sur le fondement de l’article 105 précité n’aurait pas eu de véritables chances de succès. Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que l’obligation faite par l’article 3 à un Etat de mener une enquête pouvant conduire à l’identification et au châtiment de ceux qui sont responsables de mauvais traitements serait illusoire si, en présence d’un grief tiré de cet article, le requérant était obligé d’épuiser une voie de recours qui ne peut aboutir qu’à l’octroi de dommages-intérêts (Okkalı c. Turquie, no. 52067/99, § 58, CEDH 2006‑XII (extraits), Taymuskhanovy c. Russie, no. 11528/07, § 75, 16 décembre 2010, Zontul c. Grèce, no 12294/07, § 73, 17 janvier 2012).
v) Conclusion
109. Eu égard aux défaillances susmentionnées des autorités grecques, la Cour considère que l’enquête menée au sujet des allégations de mauvais traitements des requérants n’était ni approfondie, ni rapide, ni indépendante. Ce constat conforte les critiques exprimés à plusieurs reprises par le CPT quant aux insuffisances des enquêtes des autorités judiciaires et policières sur les allégations de violences policières en Grèce (paragraphes 44-45 cidessus).
110. La Cour rejette alors l’exception préliminaire du Gouvernement relatif au non-épuisement des voies de recours internes et conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 dans son volet procédural dans le chef des requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda. Elle conclut par ailleurs à la non violation de cette même disposition dans le chef des autres requérants (voir paragraphe 80 ci-dessus).
El Schennawy c. FRANCE du 20 janvier 2011 Requête no 51246/08
Les fouilles corporelles par des hommes cagoulés sont inutiles et des actes inhumains et dégradants
La Cour rappelle que des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles doivent cependant, en plus d’être « nécessaires » pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des « modalités adéquates », pour que le degré de souffrance ou d’humiliation ne dépasse pas celui que comportent inévitablement de telles fouilles.
Concernant le décompte des fouilles intégrales auxquelles le requérant a été soumis – sur lequel les parties ne s’accordent pas – la Cour s’en tient au constat du Conseil d’Etat selon lequel elles avaient lieu quatre à huit fois par jour. En plus de la dénudation, le requérant devait accomplir une flexion, ce qui allait au delà des modalités de fouilles applicables à l’époque, avec l’usage de la force en cas d’opposition de sa part.
Les fouilles intégrales en France concernent principalement les détenus appartenant à la catégorie des détenus particulièrement signalés, à laquelle le requérant appartient. La Cour partage l’avis du gouvernement français selon lequel le passé et le profil pénal du requérant justifiaient des mesures de sécurité importantes lors des extractions vers la cour d’assises, tout en relevant que ses faits d’évasion remontaient à quatre ans et que le projet d’évasion de son coaccusé ne le visait pas. La Cour observe par ailleurs que des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été mises en place lors du procès du requérant.
Le requérant a subi un cumul de fouilles, effectuées par les différentes forces de sécurité intervenant dans sa prise en charge – administration pénitentiaire et forces de police – alors que le Ministère de la Justice, dans une note sur les fouilles par les ERIS, recommande d’éviter un tel cumul qui ne serait pas justifié, en particulier lors de la remise d’un détenu par les ERIS au GIPN. Or, du 9 au 11 avril – jours où le requérant retournait déjeuner à la maison d’arrêt – la fréquence des fouilles a été très élevée.
Quant aux fouilles pratiquées par des hommes cagoulés, la Cour rappelle qu’elle a récemment considéré2 avec inquiétude cette « pratique intimidatoire » qui, sans vouloir humilier, peut créer un sentiment d’angoisse. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat en l’espèce.
Par ailleurs, les fouilles intégrales étaient filmées, au moins les premiers jours du procès, alors même que les modalités de ces enregistrements n’étaient pas clairement définies et qu’une note de 2009 précisait que la fouille intégrale d’un détenu « ne [devait] pas faire l’objet d’un enregistrement vidéo qui pourrait être interprété comme une atteinte à la dignité humaine ».
Ces fouilles ne reposaient pas comme il se doit sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales. Bien qu’elles se soient déroulées sur une courte période, elles ont pu provoquer chez le requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus.
La Cour prend acte à cet égard de la loi pénitentiaire de 2009 qui apporte un cadre législatif au régime de la fouille des détenus et dont l’article 57, bien que ne visant pas spécifiquement les DPS, limite strictement le recours aux fouilles intégrales désormais « possibles [seulement] si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes».
La Cour conclut, dans le cas de M. El Shennawy, à la violation de l’article 3.
JETZEN C. LUXEMBOURG (N° 2) du 31 octobre 2013 requête 47229/12
note de Frédéric Fabre
La CEDH protège le Grand Duché du Luxembourg. Cet arrêt de rejet, concernant les fouilles corporelles, en est encore un exemple alors que la salle de fouilles, est jugée non conforme à la convention. Des agents féminins de la prison luxembourgeoise, humilient des détenus. La CEDH ne considère pas ce fait pourtant rapporté par un trop grand nombre d'ex détenus.
1. Sur le volet matériel
a) Thèses des parties
47. Le requérant indique que la fouille corporelle du 24 février 2010 - dont il ne conteste pas en soi la nécessité - se serait déroulée en présence d’un nombre anormalement élevé de gardiens et dans le but de l’humilier. Il aurait été possible, tant en théorie qu’en pratique, qu’une femme travaillant à la prison ait assisté à la fouille. Le requérant explique qu’il aurait dû se déshabiller entièrement dans une cabine ouverte, et que pour récupérer ses vêtements à la fin de la fouille, il aurait dû se rendre dans une deuxième cabine. Pour ce faire, il aurait dû parcourir une distance totale de deux mètres, qui plus est dans une pièce donnant sur le guichet de la prison où deux personnes féminines travaillent.
48. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il expose que la fouille corporelle a été accomplie suivant les dispositions légales applicables et « selon les modalités adéquates » (Valašinas c. Lituanie, no
44558/98 , § 117, CEDH 2001‑VIII).Il explique que le 24 février 2010, le requérant a été escorté au tribunal par trois agents du CPL qui ont seuls procédé à la fouille. Certes, deux ou trois autres gardiens en attente de procéder aux fouilles des détenus qu’ils allaient escorter se trouvaient dans la salle où sont situées les cabines, mais leur présence était strictement indépendante de la fouille corporelle du requérant et uniquement due à des raisons d’organisation interne afin que tous les détenus puissent être escortés en temps utile au tribunal.
L’affirmation selon laquelle le requérant aurait dû traverser entièrement dénudé la salle à proximité du guichet où travaillent deux femmes ne correspondrait pas à la vérité. Ainsi, le requérant se déshabillait et était fouillé dans la cabine de gauche, ses vêtements étant déposés dans la cabine de droite. Les agents impliqués dans la fouille témoignaient que le caleçon était toujours le dernier vêtement à être contrôlé et était rendu au détenu pendant qu’il était encore dans la cabine gauche. Ensuite seulement le requérant se rendait dans la cabine droite pour se revêtir. Pour cela, le requérant ne devait nullement « traverser la salle d’accueil », mais faire seulement quelques pas, les clichés photographiques démontrant que la distance entre les deux cabines était de l’ordre de quelques centimètres. En outre, il résulte des témoignages recueillis que lors des fouilles les portes des cabines étaient toujours ouvertes de manière à ce que seuls les agents en charge de l’escorte (et donc de la fouille) puissent voir le fouillé. Quant à la présence, dans le bureau attenant à la salle d’accueil, d’agents de sexe féminin, le Gouvernement précise qu’une seule femme était en service le jour de la fouille litigieuse, et que l’emplacement de son bureau l’empêchait de voir la salle des cabines de fouilles (l’agente tournait le dos à la salle). Cette agente, qui s’occupe d’ailleurs uniquement de tâches administratives et n’est pas en charge des fouilles, n’a pu voir le requérant à aucun moment pendant la fouille.
b) Appréciation de la Cour
49. La Cour réaffirme d’emblée que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime, même dans les circonstances les plus difficiles, tels la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.
Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. La Cour a ainsi jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales ; elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou un traitement puisse être qualifié d’« inhumain » ou de « dégradant », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Frérot c. France, no 70204/01, § 35, 12 juin 2007, et El Shennawy c. France, no 51246/08, § 33, 20 janvier 2011).
50. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Frérot, précité, § 37).
51. Des conditions générales de détention – dans lesquelles s’inscrivent les modalités des fouilles imposées au détenu – peuvent s’analyser en un traitement contraire à l’article 3, tout comme une fouille corporelle isolée (Valašinas, précité, § 117, Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001, et Yankov c. Bulgarie, no 39084/97 , § 110, CEDH 2003‑XII (extraits)).
52. S’agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n’a aucune difficulté à concevoir qu’un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu’il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu’il lui faut adopter des postures embarrassantes (Frérot, précité, § 38, et El Shennawy, précité, § 36).
53. Des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez les détenus le sentiment d’être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque l’obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, peuvent caractériser un degré d’humiliation dépassant celui, tolérable parce qu’inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus (Frérot, précité, § 47, et Khider c. France, no 39364/05, § 127, 9 juillet 2009).
54. Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales (Francesco Schiavone c. Italie (déc.), no 65039/01, Ciupercescu c. Roumanie, no 35555/03, § 116, 15 juin 2010).
Il n’en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d’être « nécessaires » pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des « modalités adéquates », de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention (Frérot, précité, § 38, et El Shennawy, § 38).
Il va en outre de soi que plus importante est l’intrusion dans l’intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l’obligation de se dévêtir devant autrui, et de surcroît lorsque l’intéressé doit prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s’impose (ibidem).
55. En l'espèce, il n’est pas contesté que le requérant est soumis au régime des fouilles tel qu’il est décrit dans la note de service DIS01 (paragraphes 36 et 37 ci-dessus).
Selon les normes nationales et européennes applicables en la matière, retranscrites dans ladite note, les détenus sont soumis à une visite corporelle lorsque le directeur ou le chef des services de garde l’estime nécessaire, et notamment chaque fois qu’ils sont extraits du centre pénitentiaire. Les fouilles sont ordonnées dans l’intérêt de la sécurité et de la sûreté, pour vérifier le respect de l’ordre et de la discipline et pour prévenir et constater d’éventuelles infractions.
La note décrit aussi les modalités pratiques à respecter par le personnel pénitentiaire lors d’une fouille, qui s’effectue par deux agents au moins, du même sexe que la personne contrôlée et à l’abri du regard des tiers. Ainsi, l’agent procède au contrôle visuel de la cavité buccale, des oreilles et des mains, suivi du passage de la main dans les cheveux et derrière les oreilles. Le détenu enlève alors ses vêtements, qui sont vérifiés en détail. Les jambes écartées et les mains à plat contre le mur, il se penche vers l’avant, permettant ainsi le contrôle visuel de l’entrejambe et des aisselles, de la plante des pieds et des espaces entre les orteils. Hormis la tête, les mains et les pieds, le gardien ne touche pas le détenu qui coopère.
La note impose aux agents effectuant les fouilles le respect strict de la dignité des personnes contrôlées et précise qu’aucune forme d’humiliation ou de voyeurisme ne saurait être tolérée.
Elle prévoit que tout incident est à consigner dans un compte-rendu d’incident et à signaler sans délai au chef des services de garde qui en informe la direction.
56. Quant à la fouille du 24 février 2010, mise en cause devant la Cour, les parties sont en désaccord sur les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée. Le requérant indique avoir eu à parcourir une distance de deux mètres entièrement nu pour récupérer ses vêtements et affirme qu’une personne de sexe féminin travaillant au CPL aurait pu, en théorie et en pratique, assister à la fouille. Le Gouvernement expose que le requérant était fouillé dans la cabine de gauche et, une fois que le caleçon lui avait été remis, faisait quelques pas pour se rhabiller entièrement dans la cabine adjacente ; la seule agente féminine travaillant au guichet du greffe le jour en question n’avait vu le requérant à aucun moment lors de la fouille.
57. La Cour s’en tiendra, pour l’examen de son grief, à l’ensemble des éléments recueillis par la police judiciaire et relatés en détail dans le rapport du 20 novembre 2011, qui conclut que les résultats de l’enquête étaient aux antipodes des allégations du requérant (paragraphes 22 à 25 ci-dessus).
58. La Cour note qu’il n’est pas contesté que la fouille litigieuse, intervenue dans le cadre de son extraction vers le tribunal, a été imposée au requérant dans le contexte d’événements caractérisant leur nécessité quant à la sécurité ou la prévention d’infractions pénales (Frérot, précité, § 45). En plus, on ne saurait voir en l’espèce une « routine » comparable à celle condamnée par la Cour dans l’affaire Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99 , § 62, CEDH 2003‑II) dans laquelle une fouille intégrale était imposée systématiquement - sans qu’elle ne réponde à un impératif de sécurité concret - lors de chaque inspection hebdomadaire de la cellule du requérant.
59. La Cour doit donc déterminer si la fouille a été menée selon des « modalités adéquates ».
L’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction judiciaire témoignent de manière concordante que la fouille s’est déroulée dans des conditions normales et conformes aux règles décrites dans la note DIS01 (paragraphes 22 à 25 ci-dessus).
La fouille a été effectuée dans la cabine de gauche selon le procédé habituel, par les seuls agents en charge de l’escorte du requérant et à l’abri du regard de tiers. Une fois la fouille effectuée, le requérant s’est vu remettre son caleçon et a fait quelques pas pour se rendre dans la cabine de droite (adjacente et très rapprochée de la cabine de gauche) où il s’est rhabillé entièrement.
Certes, il s’est avéré que les agents en charge de l’escorte suivante se trouvaient dans la salle d’accueil (dans laquelle sont situées les deux cabines) au moment où le requérant était fouillé, mais à titre purement incident, vu le nombre élevé de détenus à extraire en temps utile le matin en question.
La seule agente féminine travaillant le jour en question au bureau du greffe (attenant à la salle d’accueil) n’avait vu le requérant à aucun moment lors de la fouille. Il résulte en effet de l’instruction, ainsi que des photos remises à la Cour, que l’emplacement du bureau de cette agente était tel qu’elle tournait le dos à la salle et qu’en tout état de cause, la vue des occupants du bureau sur les cabines était obstruée par la disposition des portes de ces dernières. L’agente en question a confirmé que les fouilles se déroulaient rapidement et à l’intérieur des cabines et a, de surcroît, témoigné avoir été informée dès sa prise de fonctions du comportement à adopter au moment des fouilles : ainsi, elle ne quittait pas l’emplacement de son bureau (de sorte qu’elle tournait le dos à la salle d’accueil) dès l’instant où le début des fouilles lui était signalé.
60. La Cour fait toutefois remarquer que la configuration des lieux n’est pas exemplaire, dans la mesure où les cabines donnent sur une salle où les détenus fouillés sont potentiellement exposés au regard de tiers. S’il est vrai qu’il résulte de l’instruction judiciaire que le personnel pénitentiaire met en pratique les consignes claires et strictes reçues en la matière, il serait préférable que les fouilles corporelles puissent s’exécuter dans un lieu complètement à l’abri de tout risque potentiel d’exposition au regard de tiers. Cependant, l’on ne saurait déduire de cette seule configuration des lieux que les fouilles qui y sont pratiquées impliquent un degré de souffrance ou d’humiliation dépassant l’inévitable. De surcroît et pour ce qui est plus particulièrement de la fouille litigieuse, il ne ressort du dossier aucune volonté d’humiliation, le requérant n’alléguant d’ailleurs pas avoir été victime de gardiens irrespectueux ou qui auraient fait preuve d’un comportement démontrant qu’ils poursuivaient le but de l’humilier (a contrario, Valašinas, précité, § 117, et Iwańczuk, précité, §§ 57-60).
61. Dans ces conditions, après s’être livrée à une appréciation globale du déroulement de la fouille litigieuse sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime qu’il n’est pas établi que le requérant ait subi un traitement atteignant le niveau de gravité suffisant pour porter atteinte au droit garanti par l’article 3 de la Convention.
62. Partant, elle considère qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition sous son volet matériel.
2. Sur le volet procédural
63. Le requérant dénonce une obstruction à son désir de voir instruire les traitements inhumains et dégradants qu’il aurait subis.
64. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il avance que trois enquêtes ont été menées : une première administrative, une deuxième par le Médiateur, et finalement une instruction judiciaire. A ce dernier égard, il rappelle qu’à la suite de l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 7 décembre 2010 une enquête approfondie a été entamée le 13 décembre 2010 quant aux doléances formulées par le requérant. Sur ordonnance du juge d’instruction, la police judiciaire a ainsi effectué plusieurs visites des lieux et a auditionné le directeur général du CPL, les agents du greffe qui étaient en poste le jour en question, ainsi que les trois gardiens ayant effectué la fouille. C’est sur base d’un rapport détaillé - dressé le 20 novembre 2011 et concluant que les faits instruits n’étaient susceptibles d’aucune qualification pénale - que les autorités compétentes ont abouti à une décision de non-lieu.
65. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, Pantea c. Roumanie, no 33343/96 , § 199, CEDH 2003‑VI (extraits), et Turan Cakir c. Belgique, no 44256/06, § 65, 10 mars 2009).
66. En l’espèce, le requérant a, dans un premier temps, signalé des irrégularités concernant les fouilles des 24, 25 et 26 février 2010. Il a été informé que ses reproches n’étaient pas fondés, sur base d’un rapport de l’administration pénitentiaire du 17 mars 2010 dressé à la suite d’une enquête interne, lors de laquelle les responsables et gardiens concernés avaient été interrogés.
67. Une plainte au sujet de la seule fouille du 24 février 2010 (qui est mise en cause devant la Cour) s’est soldée en un premier temps par une ordonnance de non-informer de la part du juge d’instruction.
En revanche, le 7 décembre 2010, la chambre du conseil de la cour d’appel a réformé cette ordonnance, estimant qu’une fouille corporelle, au cas où elle aurait effectivement été pratiquée en présence de huit personnes de la façon exposée par le requérant et où elle aurait causé à celui-ci une atteinte à son intégrité psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, était susceptible d’être qualifiée de coups et blessures volontaires, sinon involontaires.
68. A la suite de cet arrêt, une enquête a été diligentée sur les faits dénoncés par le requérant, dans le cadre de laquelle des examens approfondis ont été réalisés, tel que cela résulte du rapport circonstancié dressé en date du 20 novembre 2011 (paragraphe 25 ci-dessus). Ainsi, la police judiciaire a entendu l’ensemble des responsables et agents impliqués, saisi les plans de service du greffe et du « Service Escortes » et pris des clichés photographiques des lieux, afin d’élucider le déroulement exact de la fouille litigieuse et de vérifier la véracité des doléances du requérant.
69. Sur base des résultats de l’instruction judiciaire, les autorités compétentes ont conclu à un non-lieu à poursuivre (décisions rendues les 16 janvier, 15 février et 24 avril 2012).
70. Au surplus, la Cour note qu’à la demande du requérant, le Médiateur a procédé à des recherches sur les circonstances de la fouille litigieuse, sans en tirer de conclusions déterminantes (paragraphe 16).
71. La Cour estime que les éléments ci-dessus lui suffisent pour conclure que la fouille du 24 février 2010 a fait l’objet d’enquêtes effectives, de sorte que les autorités luxembourgeoises ont respecté l’obligation procédurale découlant de l’article 3 de la Convention.
72. Il n’y a donc pas eu, à cet égard, violation de cette disposition.
L'ÉTAT DOIT PROTÉGER LES DÉTENUS CONTRE LA VIOLENCE DES CODÉTENUS
OSHURKO c. UKRAINE Requête no 33108/05 du 8 septembre 2011
L'Etat doit protéger les détenus des violences des codétenus
En janvier 2003 M. Oleg Ivanovich Oshurkoil fut appréhendé dans le cadre d'une procédure pénale et placé en centre d'isolement provisoire. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait des coups et blessures infligés par ses co-détenus lors de sa détention au centre d'isolement provisoire ainsi que de l'enquête menée par les autorités sur lesdits traitements, jugée par lui insuffisante. Les coups et blessures portés au requérant ainsi que le défaut de soins médicaux adéquats apportés en temps voulu lors de sa détention ont conduit à la perte totale de ses capacités visuelles.
LA CEDH
65. La Cour note que le grief tiré par le requérant de l’article 3 de la Convention pose, en l’espèce, trois questions distinctes, bien qu’étroitement liées entre elles : celle, tout d’abord, de l’imputabilité du mauvais traitement subi par le requérant aux autorités de l’Etat défendeur ; celle, ensuite, du caractère adéquat du traitement médical suite à ces lésions ; et celle, enfin, de l’effectivité de l’enquête entamée en raison du mauvais traitement.
a) Sur les lésions subies par le requérant et la responsabilité des autorités
66. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention doit être considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention et comme consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49, CEDH 2002-III). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d’après l’article 15 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996-V).
67. En général, les actes interdits par l’article 3 de la Convention n’engagent la responsabilité d’un Etat contractant que s’ils sont commis par des personnes exerçant une fonction publique. Toutefois, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (Pretty précité, §§ 50 et 51).
68. La Cour a conclu, dans un certain nombre d’affaires, à l’existence d’une obligation positive pour l’Etat de fournir une protection contre les traitements inhumains ou dégradants (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003-XII).
69. Cette protection appelle des mesures raisonnables et efficaces, pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 53, 12 octobre 2006). Notamment, la Cour a établi qu’un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains de ses fonctionnaires, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002). Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (mutatis mutandis, Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 71, 16 novembre 2000).
70. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 3 de la Convention, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question (mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110-115, CEDH 2001-III).
71. La Cour relève que nul ne conteste que le requérant a subi des coups et blessures lors de sa détention provisoire, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des gardiens et de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Les rapports médicaux établis par les praticiens attestent, en effet, la multiplicité et l’intensité des coups portés au requérant lors de l’incident avec les codétenus, qui avaient entraîné des hématomes aux yeux, à la nuque et à la cage thoracique, des fractures du nez et de deux côtes gauches, une plaie au zygoma gauche, la commotion du cerveau, un épanchement de sang de l’œil droit et une plaie pénétrable à l’œil gauche, ce qui a conduit finalement à la perte totale des capacités visuelles du requérant.
72. Or, de l’avis de la Cour, il s’agit là d’éléments de fait clairement établis qui, à eux seuls, sont assez sérieux pour conférer aux faits incriminés le caractère d’un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention (Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 185, CEDH 2003-VI (extraits)). La Cour relève en outre que le traitement en cause se trouve aggravé par plusieurs circonstances (idem, § 186). Tout d’abord, l’un des codétenus, « Sova », multirécidiviste, souffrait d’une psychopathie de type excitable dont les autorités auraient dû avoir connaissance; partant, la cohabitation du requérant avec celui-ci présentait un degré élevé de dangerosité, ce qui aurait du susciter une surveillance accrue de la cellule. La Cour constate que les gardiens C. et P. ne sont pas intervenus pour faire sortir le requérant de la cellule lors de l’incident, ou pour faire cesser les agressions des codétenus à son encontre (idem, § 194), alors que les altercations ont eu lieu pendant au moins six heures (voir paragraphe 10 ci-dessus). La Cour retient, enfin, que, même après l’incident avec les deux codétenus, le requérant a été laissé par les gardiens dans la même cellule que ses agresseurs (idem, § 194).
73. Dans ces circonstances, la Cour conclut que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les personnes privées de liberté et à empêcher qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique. Partant, le mauvais traitement que le requérant subit en détention est imputable à l’Etat et il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
b) Sur le traitement médical
74. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (McGlinchey c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 45, CEDH 2003-V).
75. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d’une personne privée de liberté (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, Mouisel c. France, no 67263/01, § 38-40, CEDH 2002-IX, Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). Il ressort de sa jurisprudence qu’il ne peut y avoir violation de l’article 3 de la Convention du seul fait de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais qu’une telle violation peut en revanche découler de lacunes dans les soins médicaux (Melnik c. Ukraine, nº 72286/01, §§ 104-106, 28 mars 2006 ; Keenan, précité, §§ 110-115). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé (voir ci-dessous), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
76. Quoiqu’il ne s’en déduise pas une obligation générale de remettre en liberté ou de transférer dans un hôpital civil un détenu (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004 ; Mouisel, précité, § 40, Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), no 22682/02), la Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos, précité, § 38).
77. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le requérant se plaint d’omissions, de retards et de défaillances de la part des autorités pour assurer le traitement médical approprié (mutatis mutandis, Sakkopoulos, précité, § 41).
78. La Cour prend note de la position du requérant selon laquelle les conséquences irréparables sur ses capacités visuelles ont été causées, pour l’essentiel, par l’absence d’une intervention médicale qui était impérative (voir paragraphe 36 ci-dessus). En même temps, la Cour observe que le rapport d’expertise du 4 juin 2003, cité par le jugement définitif du 19 septembre 2007, a conclu que « même une aide médicale opportune n’était pas en mesure de garantir au requérant la sauvegarde de l’usage des capacités visuelles de l’œil gauche » (voir paragraphes 27 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour retient qu’une telle affirmation vaut reconnaissance, quoique de manière indirecte, du fait qu’une aide médicale n’a pas été fournie au requérant en temps utile.
79. Il n’est donc pas possible de discerner avec certitude dans quelle mesure la perte totale des capacités visuelles du requérant résulte exclusivement du retard du traitement médical et s’il aurait pu sauvegarder ses capacités visuelles en obtenant une aide médicale plus tôt. La Cour considère toutefois que cette difficulté n’est pas déterminante pour trancher la question de savoir si les autorités ont respecté l’obligation où les mettait l’article 3 de protéger le requérant de tout traitement ou de toute peine contraire à cette disposition (mutatis, mutandis, Keenan, précité, § 112). Elle doit rechercher si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés.
80. La Cour relève qu’en l’espèce les autorités pénitentiaires sont allées au-delà des obligations posées par elle, en choisissant de libérer le requérant 48 heures après les événements en question, de sorte qu’il a pu se présenter en toute indépendance à l’hôpital civil.
81. En même temps, la Cour observe que l’incident à la suite duquel le requérant s’est trouvé affligé de nombreuses lésions a eu lieu entre le 12 avril 2003, 19 heures, et le 13 avril 2003 à une heure du matin. Ensuite, ce n’est que dans l’après-midi de ce jour, et vers 11 heures le 14 avril 2003, que le requérant a subi des examens médicaux. A deux reprises, les médecins ont informé des autorités pénitentiaires de l’état grave de santé du requérant et du fait qu’il nécessitait une assistance médicale approprié. Dans ces circonstances, la Cour estime que, eu égard aux recommandations des avis médicaux orientant le requérant vers l’hôpital (voir paragraphe 11 ci-dessus), la prise en charge des lésions du requérant n’était possible qu’à l’extérieur. Cependant, le requérant n’a pu obtenir cette assistance médicale extérieure qu’avec un retard considérable, en l’occurrence vers minuit le soir du 14 avril 2003, soit plus de 48 heures après l’incident, en se rendant à l’hôpital grâce à l’initiative de ses parents. A la lumière des circonstances particulières de l’espèce, le retard et le manquement à offrir au requérant une aide adaptée à ses besoins dans le délai plus bref représentent une lacune dans les soins médicaux.
82. La Cour estime que les autorités nationales n’ont pas réagi de manière adéquate aux graves problèmes de santé du requérant et l’ont soumis ainsi à un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention.
83. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
c) Sur le caractère adéquat des investigations menées par les autorités internes
i. Principes généraux
84. L’article 3 de la Convention entraîne l’obligation positive de mener une enquête officielle (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 102). Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat (voir M.C., précité, § 151).
Seule une enquête diligente, rapide et indépendante satisfait aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (Mikheïev c. Russie, no 77617/01, §§ 108-110, 26 janvier 2006), privant de toute impunité les agents de l’Etat qui méconnaissent l’interdiction qu’édicte l’article 3 de la Convention (Assenov et autres, précité, § 102).
85. Ainsi, les autorités ont l’obligation d’agir dès qu’une plainte officielle est déposée. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement. Une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Or, la tolérance des autorités envers de tels actes ne peut que saper la confiance du public dans le principe de la légalité et son adhésion à l’Etat de droit (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV (extraits), Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 60, 2 novembre 2004, et, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II).
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
86. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que trois enquêtes sont en question.
87. L’enquête contre les codétenus du requérant qui lui ont causé ses blessures a été ouverte que le 15 mai 2003, soit pas moins d’un mois après l’incident. Elle a duré quatre ans et cinq mois environ (voir paragraphes 27-36 ci-dessus), quoique des autorités compétentes avaient disposé en temps utile d’éléments de preuve tangibles et suffisants.
88. En ce qui concerne l’enquête contre les policiers, la Cour observe que les autorités internes ne sont pas restées inactives face aux graves allégations de mauvais traitements dans l’affaire du requérant. Toutefois, cela ne saurait suffire à les dégager de toute responsabilité sur le terrain de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural (Pantea, précité, § 210). La Cour rappelle à cet égard que les autorités ne doivent pas sous-estimer l’importance du message qu’elles envoient à toutes les personnes concernées, ainsi qu’au grand public, lorsqu’elles décident d’engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, la Cour estime qu’elles ne doivent en aucun cas donner l’impression qu’elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 71, CEDH 2000-XII).
89. En l’espèce, la Cour note que la plainte contre les policiers de garde C. et P. a été déposée par la mère du requérant un mois et demi après l’incident. Elle a été classée trois fois avant que, au bout de quatre ans et huit mois environ, l’enquête soit finalement ouverte. Les policiers n’ont comparu devant le tribunal que cinq ans et cinq mois environ après leur identification. L’enquête a été refermée à plusieurs reprises ; les décisions de classement ont été annulées par la voie judiciaire trois fois, en raison justement des contradictions et des défauts de fondement et de motivation qui les entachaient, et de la nécessité de vérifications complémentaires (voir paragraphes 39-46 ci-dessus). La durée globale de la procédure, à compter à partir de l’incident, a duré six ans et trois mois, ce qui ne satisfait pas aux exigences de rapidité. Quoique les policiers C. et P. ont été reconnu coupables de mauvais traitement subi par le requérant, en raison de la tardivité de la condamnation les coupables n’ont purgé aucune peine effective. Enfin, les tribunaux ont refusé, finalement, la demande du requérant tendant à ce que soit introduite une action pénale contre les gardiens Iv. et Kh., et ce au bout de six ans et un mois environ à compter de la date de l’incident (voir paragraphes 48-49 ci-dessus).
90. La Cour rappelle par ailleurs, que dès le début de l’incident litigieux, le requérant avait été confronté à l’indifférence totale des autorités compétents ; les gardiens ayant refusé d’intervenir sur le lieu et, sans aucun raison valable, d’appliquer la loi aux agresseurs.
91. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour conclut que dans le cas de la présente espèce les autorités ukrainiennes ont manqué à leur obligation positive issue du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Partant, il y a eu la violation de cette disposition. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (voir paragraphe 61 ci-dessus) doit donc être rejetée.
VIOLENCE ENTRE LES DÉTENUS DANS LES PRISONS EN FRANCE
STASI C. France du 20 octobre 2011 requête 25001/07
L'Etat français a bien protégé le détenu des violences des codétenus
75. La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 84, CEDH 2000-VII).
76. Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine, Selmouni précité, § 88, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 181, CEDH 2003-VI (extraits)).
77. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et, à ce titre, prohibe en termes absolus la torture et les peines et les traitements inhumains et dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, no 22893/05, § 66, 27 mai 2008). Il astreint les autorités des États contractants non seulement à s’abstenir de provoquer de tels traitements, mais à prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (A. c. Royaume-Uni précité, § 22, M.C. c. Bulgarie précité, § 149, et Šečić c. Croatie, no 40116/02, § 52, 31 mai 2007).
78. S’agissant plus particulièrement des détenus, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner qu’ils sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001-III, et Renolde c. France, no 5608/05, § 83, 16 octobre 2008). Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Pantea précité, § 189).
79. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 3, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question.
80. La Cour rappelle enfin que l’article 3 astreint les États membres à mettre en place une législation efficace de nature pénale qui constitue une dissuasion effective contre les actes portant atteinte à l’intégrité physique et permette de les réprimer (A. c. Royaume-Uni précité, § 22, M.C. c. Bulgarie précité, § 150, et Beganović c. Croatie, no 46423/06, § 71, 25 juin 2009).
b) Application au cas d’espèce
i. Sur les traitements subis par le requérant
81. Le requérant s’est plaint d’avoir subi à plusieurs reprises des violences de la part de codétenus, et notamment de la part de P. qui a partagé sa cellule, ainsi que du fait que ce dernier l’aurait contraint de porter une étoile rose lors de tous ses déplacements au vu des surveillants.
82. Sur ce dernier point, la Cour observe que l’affirmation du requérant n’est étayée par aucun élément de preuve et qu’elle est en contradiction avec les déclarations faites aux policiers tant par lui-même que par les personnels pénitentiaires. En conséquence, cette allégation ne peut être considérée comme établie.
83. S’agissant des violences qu’aurait subies le requérant, la Cour constate qu’il a produit plusieurs certificats médicaux relatifs aux différents incidents dont il se plaint. Le certificat établi le 6 avril 2007 fait état de volumineux hématomes à l’arrière de la cuisse gauche et au-dessus du genou droit, ainsi que d’un hématome plus ancien en haut du bras droit, et d’une perte de poids de six kg, justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de huit jours. Le certificat du 4 décembre 2007 mentionne des hématomes à la jambe droite, sans ITT. Le certificat médical du 2 février 2008 indique une brûlure de cigarette sur le bord externe de l’œil gauche, ainsi qu’un trouble psychologique réactionnel avec quatre jours d’ITT. Enfin, le certificat médical du 9 août 2008 mentionne un hématome sous-orbitaire et une décompensation névrotique, sans ITT.
84. La Cour estime donc établi que le requérant a subi en détention des violences suffisamment sérieuses pour conférer aux faits en cause le caractère de traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 (voir Pantea précité, § 185, Georgescu c. Roumanie, no 25230/03, § 73, 13 mai 2008, et Premininy c. Russie, no 44973/04, § 81, 10 février 2011). Reste à établir si les autorités ont respecté leurs obligations positives découlant de l’article 3.
i. Sur le respect par l’État de ses obligations
α) Sur l’existence d’une législation pénale efficace
85. La Cour observe que le droit pénal français réprime les atteintes à l’intégrité physique de la personne telles que celles dénoncées par le requérant : le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle, cette peine pouvant être portée à vingt ans lorsqu’il est commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime ; les violences sont sanctionnées d’une peine de prison pouvant aller de trois à cinq ans, et d’une amende de 45 000 EUR à 75 000 EUR en fonction, d’une part, de la durée de l’incapacité de travail qu’elles ont occasionnées à la victime et, d’autre part, du fait qu’elles ont été commises en raison de son orientation sexuelle (paragraphe 44 ci-dessus).
86. La Cour constate que, s’agissant du viol et des violences subies par le requérant durant sa première période d’incarcération, une enquête préliminaire a été ouverte à la demande du procureur général après la parution de l’article dans le journal Libération, et qu’une information judiciaire des chefs de viol et violences, actuellement pendante, a été ouverte en décembre 2009 et confiée à un juge d’instruction (paragraphe 33 ci-dessus).
87. Pour ce qui est des violences survenues pendant la seconde période d’incarcération du requérant, la Cour observe qu’elles sont de nature à rentrer dans le champ d’application des articles 222-11 à 222-13 du code pénal (paragraphe 44 ci-dessus) et qu’elles ont également fait l’objet d’une enquête préliminaire. A l’issue de celle-ci, le requérant avait la possibilité de porter plainte entre les mains du procureur de la République, comme le lui ont proposé les enquêteurs et, en cas de silence ou de refus du procureur d’engager des poursuites (paragraphe 45 ci-dessus), de porter plainte avec constitution de partie civile, ce qui aurait mis en mouvement l’action publique.
88. La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter du constat qu’elle a fait dans l’affaire Slimani c. France (no 57671/00, § 41, CEDH 2004-IX (extraits)), selon lequel une telle plainte présente des chances raisonnables de succès et est susceptible d’aboutir à la saisine des juridictions répressives, lesquelles sont compétentes non seulement pour trancher les questions de droit pénal qui leur sont soumises, mais aussi pour statuer sur l’action civile et, le cas échéant, réparer le préjudice causé par l’infraction à la partie civile.
89. Dans ces conditions, la Cour considère, à l’instar du Gouvernement (paragraphes 56-59 ci-dessus), que le droit interne assurait au requérant une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique (a contrario, A c. Royaume-Uni précité, §§ 22 et 24 et avis de la Commission, § 48, M.C. c. Bulgarie précité, §§ 185-187, et Beganović précité, § 87).
β) Sur le comportement des autorités pénitentiaires
90. La Cour doit établir si, dans les circonstances de l’espèce, les autorités auraient dû savoir que le requérant risquait d’être soumis à de mauvais traitements de la part des autres détenus et, dans l’affirmative, si elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient évité un tel risque (Pantea précité, § 190, et Premininy précité, § 84).
91. La Cour observe que, dès son arrivée à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, le requérant a fait état de son orientation sexuelle et des violences qu’il avait subies lors de sa première incarcération. En conséquence, le directeur de l’établissement a décidé de le placer seul en cellule dans un secteur calme du bâtiment abritant des détenus dits fragiles, ce que le requérant reconnaît comme étant adapté à sa situation. Il est resté seul du 27 juillet 2006 au 27 février 2007. Il a ensuite partagé sa cellule avec P. pendant trois semaines jusqu’au 18 mars 2007, date de la libération de ce dernier.
92. Il ressort des faits que, lorsqu’elle a été informée de ce que le requérant n’était plus seul en cellule, la juge d’instruction chargée de son dossier a demandé des explications au directeur de l’établissement, qui a motivé cette décision par l’augmentation ponctuelle du nombre des détenus et le fait que le profil de P., incarcéré pour la première fois, était compatible avec celui du requérant. Il concluait en indiquant que le service médical et les services de détention étaient bien au fait de la situation du requérant.
93. Le requérant affirme que, pendant leur cohabitation, P. l’aurait notamment frappé et forcé à rester dans la cellule pour cacher les traces des coups.
94. La Cour relève que le requérant ne s’est jamais plaint de ces faits aux autorités pénitentiaires, même après la libération de P. Il ressort du procès-verbal d’audition du lieutenant pénitentiaire Ci. que, lorsqu’elle a reçu le 9 juillet 2007 le requérant après sa tentative de suicide, il ne l’a pas informée qu’il avait subi des violences. En outre, lors d’un entretien du 4 février 2008 avec le lieutenant pénitentiaire D., il a simplement indiqué que la cohabitation avec P. s’était « mal passée », sans donner de détails. Il ressort également du dossier qu’il n’a pas communiqué à l’administration de la maison d’arrêt le certificat médical établi le 6 avril 2007. Dans ces conditions, et compte tenu de la localisation de ses lésions, la Cour conclut que les autorités pénitentiaires ne pouvaient pas avoir connaissance des violences qu’il avait subies (voir a contrario Premininy précité, § 86).
95. S’agissant de l’incident du 6 novembre 2007, où le requérant dit avoir été poussé dans les escaliers par un codétenu, ce qui lui a occasionné un hématome à la jambe droite, il ne ressort pas davantage du dossier qu’il l’aurait signalé aux autorités pénitentiaires ou leur aurait communiqué le certificat médical.
96. En revanche, le requérant a informé les autorités de la maison d’arrêt de l’incident du 31 janvier 2008, lors duquel un détenu a écrasé une cigarette sous son œil gauche. La Cour relève que la responsable du bâtiment a reçu le requérant le 4 février 2008 et a décidé de le changer de cellule, de lui permettre d’accéder seul aux douches en dehors des horaires prévus, et de le faire accompagner par un surveillant lors de ses déplacements. Des investigations ont été menées pour essayer d’identifier le détenu responsable, mais elles n’ont pas pu aboutir faute de coopération du requérant.
97. Enfin, s’agissant des deux incidents qui se sont produits dans les douches en août 2008, il apparaît que seul le premier – un violent échange verbal - s’est produit en présence du surveillant, et que le détenu responsable du coup donné au requérant n’a pu être identifié.
98. Le requérant reproche enfin aux autorités de l’avoir contraint en août 2008 à quitter l’étage du bâtiment où il se sentait « protégé », ce qui l’a obligé à faire une grève de la faim.
99. La Cour observe que la décision de changer le requérant d’étage a été prise en raison de la mise en place à cet étage d’un régime différencié pour les détenus condamnés à une peine de moins de dix-huit mois de prison, impliquant de leur part une préparation active de leur sortie, et de la passivité du requérant dans sa démarche d’insertion, constatée par la COP lors du bilan effectué début août (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour relève en outre que le requérant s’est vu proposer deux affectations successives en cellule individuelle dans deux secteurs calmes de l’établissement, et qu’il a finalement accepté la seconde. Pendant sa grève de la faim, il a fait l’objet d’un suivi médical régulier et d’un compte-rendu quotidien de l’administration pénitentiaire. Enfin, après le signalement du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il a été vu en consultation par le médecin et placé à l’isolement jusqu’à sa sortie.
100. La Cour note en dernier lieu que les autorités pénitentiaires ont pris les mesures adéquates lors de la tentative de suicide du requérant le 9 juillet 2007 : il a été vu le jour-même par l’infirmière, appelée par un surveillant inquiet de son état, ainsi que par la responsable du bâtiment. Il a également été reçu en consultation par le médecin le lendemain, et par le psychiatre les 11 et 18 juillet 2007. Par ailleurs il a été placé jusqu’au 26 juillet 2007 sur la liste des détenus présentant un risque de suicide. Enfin, il ressort du dossier que, sur demande du procureur de la République, le directeur de l’établissement lui a rendu compte des faits.
101. Dans ces conditions, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des faits qui ont été portés à leur connaissance, les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger l’intégrité physique du requérant (voir a contrario Pantea précité, § 195, Rodić précité, § 73, et Premininy précité, § 90).
γ) Conclusion
102. La Cour arrive à la conclusion que le droit interne assurait au requérant une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique et que les autorités pénitentiaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger. La Cour estime en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 26 mars 2014 relatives au quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone
1. L'article 9 de la loi du
30 octobre 2007 permet au Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, lorsqu'il constate une violation grave
des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de
saisir sans délai les autorités compétentes de ses
observations en leur demandant d'y répondre. Postérieurement
à la réponse obtenue, il constate s'il a été mis fin à la
violation signalée ; il peut rendre publiques ses
observations et les réponses obtenues.
En application de cette disposition d'urgence, mise en œuvre
pour la quatrième fois depuis le début de son mandat, le
Contrôleur général publie les présentes recommandations
relatives au quartier des mineurs de la maison d'arrêt de
Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), visité de manière
particulière par deux contrôleurs du 17 au 20 février 2014,
à fin de porter une appréciation sur des informations
relatives aux violences qui s'y déroulent, indications
portées préalablement à la connaissance du contrôle général.
2. Il a rendu destinataires des présentes recommandations la
garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des
affaires sociales. Un délai de seize jours leur a été
imparti pour faire connaître leurs observations. A l'issue
de ce délai, aucune réponse n'est parvenue au contrôle.
A la suite de cette procédure et conformément à la
loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général
des lieux de privation de liberté a décidé de rendre
publiques les constatations et recommandations suivantes.
3. Localement, les contrôleurs ont eu des entretiens avec le
directeur de la maison d'arrêt, le chef de détention, le
chef et l'officier responsables du bâtiment A (où se trouve
le quartier des mineurs), les personnels pénitentiaires
affectés dans ce même quartier, un surveillant chargé des
promenades, le responsable de l'unité éducative au sein du
service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de
Montpellier, les éducateurs de la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse, le responsable local de
l'enseignement (RLE), la psychologue, le médecin de l'unité
sanitaire de l'établissement et des mineurs incarcérés. Ils
ont participé à une réunion de fonctionnement du quartier
des mineurs.
Postérieurement à la visite, des entretiens téléphoniques
ont été réalisés avec le vice-procureur, substitut des
mineurs, près le tribunal de grande instance de Montpellier,
une juge des enfants, le directeur du STEMO de Montpellier
et le militaire chargé de la maison d'arrêt à la gendarmerie
de Villeneuve-lès-Maguelone.
4. Il a été rencontré pendant et après la visite des
difficultés importantes pour obtenir des autorités
responsables les informations nécessaires à l'établissement
des faits.
Dès le premier jour de leur visite, les contrôleurs ont
demandé à être informés de la tenue d'éventuelles
commissions de discipline devant lesquelles comparaîtraient
des mineurs. Deux commissions de discipline relatives à des
mineurs ont été tenues durant la visite. Les contrôleurs,
qui n'ont pas été informés, ou l'ont été à tort, n'ont pu
assister à aucune.
Les contrôleurs ont demandé communication de documents, en
particulier les comptes rendus des commissions
d'incarcération de l'année 2013, les enregistrements vidéo
des incidents survenus dans la cour de promenade les 4
janvier et 11 février, enfin la totalité des comptes rendus
d'incidents, des procédures disciplinaires et des comptes
rendus téléphoniques d'incident (CRTI) établis entre le 1er
janvier et le 17 février 2014.
Le compte rendu de la commission d'incarcération du 7 mai
2013, au cours de laquelle avait été abordée la question des
agressions de mineurs, et l'enregistrement vidéo du 4
janvier n'ont été fournis qu'après réclamation expresse des
contrôleurs, ayant constaté que ces documents n'avaient pas
été remis. Les autres documents reçus sont loin d'être
exhaustifs, comme le montre la circonstance que les
contrôleurs disposent de comptes rendus d'incidents graves
sans les procédures disciplinaires subséquentes, de CRTI
sans les comptes rendus d'incidents les ayant motivés, ou de
décisions disciplinaires sans les comptes rendus préalables
des personnels. Une demande relative à la vidéo et aux
comptes rendus des violences survenues postérieurement à la
visite, le 28 février, n'a pas abouti. En d'autres termes,
malgré les rappels opérés, les contrôleurs sont loin d'avoir
la certitude que les violences identifiées ci-après ont été
recensées en totalité.
Ce d'autant moins que des difficultés de même nature ont été
rencontrées avec le STEMO de Montpellier, qui n'a transmis
aucune des « notes de situation » du responsable de l'unité
éducative en 2013 qui lui avaient été demandées, et avec le
parquet, qui a cru pouvoir invoquer le secret de
l'instruction pour s'abstenir de communiquer une note écrite
par un juge des enfants ― qui lui avait été transmise ― sur
les violences au sein des quartiers des mineurs de la maison
d'arrêt.
5. Le Contrôleur général se voit donc contraint de rappeler
qu'en application de l'article 8 de la loi du 30 octobre
2007 il obtient des autorités responsables du lieu visité
toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission,
sauf si cette communication est susceptible de porter
atteinte à un secret protégé, dont aucun n'était en cause
dans les documents demandés, le secret « administratif » ne
lui étant pas opposable.
Il est naturellement conduit à s'interroger sur le sens des
restrictions volontaires qui lui ont été opposées. Tout
s'est passé comme si on avait voulu minimiser, d'une part,
l'ampleur des violences en cause, d'autre part, l'absence de
réactions efficaces de certains responsables. En tout état
de cause, le défaut de la transparence, requise par la loi,
dans des affaires de violences ne plaide pas en faveur de
ceux qui n'ont pas souhaité leur donner les éclaircissements
nécessaires.
6. Tels qu'ils ont pu être établis, c'est-à-dire très
vraisemblablement sous-estimés, les constats de violences
qui se déroulent au quartier des mineurs de la maison
d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone sont graves.
7. Le 18 février 2014, le quartier des mineurs héberge vingt
enfants détenus, dont six sont incarcérés pour la première
fois. Durant la totalité de l'année 2013, 114 mineurs ont
été détenus dans le quartier, pendant une durée moyenne de
soixante-trois jours. 13 % de ces mineurs étaient âgés de
moins de seize ans lors de leur placement sous écrou. Ils
sont tous hébergés en cellule individuelle, sauf en cas de
sur-occupation (ainsi au printemps et à l'été 2013). De ce
fait, l'essentiel des violences identifiées a lieu hors des
cellules, lors des déplacements et dans la cour de
promenade.
Les enfants sont divisés en deux groupes à peu près d'égale
importance (douze et huit respectivement le 18 février).
Chacun des groupes a accès à la cour de promenade de manière
séparée une heure et demie le matin, autant l'après-midi.
Hormis un point d'eau, la cour, dédiée exclusivement aux
mineurs, ne dispose d'aucun équipement, ni sanitaire ni
sportif, ni d'aucune sorte. En revanche, elle est un lieu
d'échanges et de trafics, les enfants allant rechercher dans
les zones neutres bordant la cour des projections d'objets
destinées aux majeurs incarcérés et remis ensuite à ceux-ci
(par porosité entre quartiers), ces derniers pouvant laisser
une part du butin aux mineurs.
8. Du 1er janvier 2013 au 11 février 2014, ont été recensées
vingt-quatre violences graves dans la cour. Pour les raisons
indiquées, les contrôleurs estiment que les violences entre
enfants sont beaucoup plus nombreuses que celles qui ont été
identifiées. Des interlocuteurs ont mentionné, en outre, que
toutes ne faisaient pas l'objet d'un compte rendu
d'incident. Un enfant a mentionné aux contrôleurs avoir «
cassé le nez et salement amoché » un autre dans la cour : ce
dernier aurait expliqué ensuite qu'il était tombé « en
faisant des pompes et le surveillant s'est contenté de cette
explication ».
La violence est perceptible dans les comptes rendus remis :
4 juillet 2013, la victime a reçu de nombreux coups de poing
à la tête, elle « est tombée inconsciente plusieurs minutes
avant d'être conduite à l'infirmerie et a été extraite [de
l'établissement] pour des examens complémentaires » ; 4
janvier 2014 : trois enfants en agressent un quatrième et
lui portent « plusieurs coups de poing et de pied au visage
au seul motif qu'il est arrivé récemment à l'établissement »
(la victime sera extraite au CHU de Montpellier). Des armes
par destination ont été utilisées (lames de rasoir par
exemple).
9. Parmi les agressions recensées, neuf (plus du tiers)
impliquent des enfants arrivés la veille ou l'avant-veille
dans l'établissement. Il existe donc vraisemblablement ou
bien un « rite de passage » à l'entrée en prison, comme
l'évoque une commission réunie le 7 mai 2013, ou bien de
fréquents règlements de comptes pour des affaires
extérieures à la prison. L'origine géographique pèse
également : lors de la visite, huit mineurs proviennent de
Montpellier, cinq de Nîmes, trois de Marseille, deux de
Sète, un de Toulouse. Mais, quels que soient les motifs, les
contrôleurs ont recueilli de manière indirecte des
témoignages relatifs à certains d'entre eux, libérés ou
transférés, faisant état d'« enfants traumatisés ». Aucune
plainte n'est déposée (à l'exception de celle,
exceptionnelle, d'une mère en février 2014).
10. A la date de la visite, aucune parade efficace à ces
agressions n'a été mise en œuvre et, par conséquent, elles
se poursuivent. Le personnel pénitentiaire apparaît démuni
matériellement. La surveillance de la cour n'est pas sans
défaut dès lors que des angles morts existent (vision et
caméra fixe) qui ne disparaissent que si l'on fait usage
d'une caméra mobile et à la condition supplémentaire que le
soleil (le matin) n'en obscurcisse pas la vision ; les
témoignages recueillis établissent que de nombreux incidents
échappent au surveillant chargé de surveiller la cour à
distance. Les procédures d'intervention des surveillants,
dont l'intégrité physique doit évidemment être préservée, en
cas d'incident dans la cour, sont lourdes et lentes.
Surtout, les procédures disciplinaires sont également
lentes. Les délais de convocation devant la commission de
discipline peuvent atteindre plusieurs mois ; compte tenu de
la durée moyenne de la détention des enfants, beaucoup ne
sont jamais punis à raison des violences physiques qu'ils
ont exercées : ainsi, les six agresseurs poursuivis pour des
violences commises le 18 avril 2013 ont été déférés devant
la commission de discipline du 27 juin suivant ; à cette
date, au moins quatre étaient déjà sortis. Au surplus, les «
mesures de bon ordre » définies dans la réglementation (note
du 19 mars 2012) pour les fautes de faible gravité ne sont
jamais utilisées, sauf par le responsable local de
l'enseignement. Dans ces conditions, « les agents ne croient
plus en rien » dit un responsable. A tout le moins, leur
conviction relative à l'efficacité de mesures contre la
violence paraît singulièrement émoussée.
11. Il existe, en application des textes en vigueur, une
prise en charge pluridisciplinaire des enfants incarcérés.
Mais, à la réunion à laquelle ont assisté les contrôleurs,
la manière de procéder n'a pas permis d'examiner la
situation individuelle de chaque mineur. Contrairement à la
circulaire du 24 mai 2013, aucun cahier de consignes n'est
tenu dans le quartier ; autrement dit, la transmission
d'informations paraît mal assurée. De leur côté, les
soignants de l'unité sanitaire, qui ont à connaître des
effets des violences, ne souhaitent pas être liés à
d'éventuelles suites judiciaires. Le médecin responsable se
refuse à produire les certificats établis à toute autre
personne qu'aux intéressés, jugés « suffisamment matures »
pour apprécier les suites à donner, même s'il prend soin de
préciser que ces certificats sont à la disposition de tout
expert que nommerait l'autorité judiciaire. Le parquet a,
quant à lui, indiqué ouvrir une enquête judiciaire à chaque
fait de violence commis par des mineurs détenus. Mais, d'une
part, il n'a pas été possible d'établir quelle part de ces
faits avait été portée à sa connaissance (notamment, le
logiciel judiciaire CASSIOPÉE ne permet pas d'identifier les
dossiers en fonction du lieu de commission des infractions),
par conséquent de restituer l'ensemble des violences et de
leurs suites ; d'autre part, ces enquêtes se heurtent, dans
la grande majorité des situations, au silence des victimes
et de leurs parents.
12. Le seul facteur d'évolution identifié réside dans
l'initiative de la direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse de réunir une commission
interdisciplinaire à compter d'octobre 2013 sur le thème
d'un « plan d'action violence », dont les axes d'action se
traduisent avant tout par des journées de formation.
13. La persistance de pratiques violentes au sein du
quartier des mineurs visité met en péril de manière très
sérieuse l'intégrité corporelle des mineurs incarcérés dans
l'établissement. Cette situation grave et urgente amène le
Contrôleur général à formuler les observations ci-dessous.
14. Il doit être rappelé en tout premier lieu qu'aux termes
de l'article 37 de la Convention internationale des droits
de l'enfant les Etats signataires veillent à ce que « tout
enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge
». En outre, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, «
la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral
des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge
et à leur personnalité... [a] été constamment reconnue par
les lois de la République (...) [que toutefois], les
dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945
n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et
n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent
prononcées à leur égard des mesures telles que le placement,
la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de
treize ans, la détention ; que telle est la portée du
principe fondamental reconnu par les lois de la République
en matière de justice des mineurs » (Cons. constit. n°
2002-461 DC du 29 août 2002, consid. 26). Si la détention
est donc admise, elle ne doit pas faire disparaître pour
autant toute recherche de « relèvement éducatif ».
15. Or, il existe une sorte de résignation aux formes
d'agression constatées, tirée du motif que ces enfants sont
de toute évidence portés à la violence et que rien d'utile
ne peut être opposé à ce qui apparaît comme relevant de leur
nature. Ce sentiment ne peut être admis. S'il est vrai que
des mineurs, évidemment plus nombreux parmi ceux qui sont
emprisonnés, recourent volontiers à la violence, cette
circonstance ne peut être admise comme un fait irrémédiable.
Le dispositif éducatif de milieu ouvert et le système
pénitentiaire doivent adapter leur prise en charge aux
personnes qui leur sont confiées. Il n'est ni motivant ni
utile de regretter un temps, dont la réalité est très
douteuse, où les mineurs auraient été différents. Des
réflexions ont été entreprises. Elles doivent être
amplifiées et traduites dans chaque quartier de mineurs,
pour lequel des audits réguliers devraient être conduits.
16. Dès ses premières recommandations publiques relatives à
un établissement pénitentiaire (recommandations relatives à
la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, Journal
officiel du 6 janvier 2009, § 4), le Contrôleur général des
lieux de privation de liberté soulignait que les cours de
promenade des prisons « constituent paradoxalement un espace
dépourvu de règles dans des établissements soumis à des
normes multiples et incessantes. Elles sont, en quelque
sorte, abandonnées aux détenus, qui considèrent volontiers
la cour comme un exutoire au confinement en cellule et comme
un marché, substitut aux privations. En cas de rixe ou
d'agression, il faut attendre que les détenus aient
réintégré le bâtiment pour reprendre le contrôle de la
situation. Les conséquences en sont triples : le plus fort
impose sa loi ; des blessures graves sont fréquemment
constatées ; bon nombre de détenus refusent d'aller en
promenade, de peur des agressions. Et les coupables
d'infractions sont loin d'être toujours sanctionnés ». Il
faisait valoir que « la reconquête des cours de promenade,
qui ne peut se concevoir que comme un processus de longue
haleine, doit être recommandée comme un objectif de
l'administration pénitentiaire. Progressivement, dans
certaines hypothèses, dans certains établissements, jusqu'à
s'appliquer en toutes circonstances et en tous lieux, les
surveillants, en effectifs suffisants, comme d'ailleurs tout
autre acteur, doivent coexister dans tous les espaces avec
les détenus. La cour doit redevenir ce pour quoi elle est
faite : un lieu de promenade, c'est-à-dire de détente, de
sociabilité ou de possibilité de rester seul ». Cinq ans
plus tard, aucun effort en ce sens n'a été entrepris. La
présence du personnel pénitentiaire, pourvu qu'il soit connu
et apprécié, dans les cours, pourrait précisément être
entamée dans les cours de quartiers de mineurs, afin de
prévenir à la fois la récupération des « projections », les
trafics et les violences. Elle doit évidemment s'accompagner
des mesures de sécurité nécessaires, notamment de procédures
d'intervention beaucoup plus promptes.
17. Simultanément, la prise en charge éducative des enfants,
qu'exprime la présence d'éducateurs de la direction de la
protection judiciaire de la jeunesse en prison, doit
comprendre l'éducation au règlement des différends, au
respect mutuel, à la dénonciation des mythologies
(différences supposées fondées sur des origines
géographiques distinctes). En même temps, les éducateurs en
détention doivent recevoir de leur environnement
professionnel l'appui et les outils que nécessitent ces
apprentissages. Les enfants en souffrance doivent être
identifiés et pris en charge de manière adaptée.
18. La prison doit, plus encore dans le cas particulier des
enfants, établir, même pour des séjours de courte durée, des
liens de confiance avec les familles. L'absence de plaintes
en cas de violence traduit la résignation ou la peur, ou les
deux : le dialogue instauré à intervalles réguliers doit
faciliter les rapprochements et les démarches nécessaires.
Corollairement, les auteurs d'agressions doivent être
identifiés et leurs proches placés devant leurs
responsabilités.
19. Les directions et les parquets (et, avec eux, les forces
de police ou de gendarmerie) doivent poursuivre ces auteurs
sur les plans disciplinaire et, si nécessaire, pénal. A
cette fin, les procédures doivent être conciliées, dans le
respect des droits de la défense, avec des durées
d'emprisonnement le plus souvent courtes. On a aussi souvent
indiqué que des délais rapides étaient infiniment plus
éducatifs que des procédures aboutissant longtemps après la
commission des faits : cette assertion se vérifie aussi en
prison, autant pour les auteurs que pour les personnels. Il
n'est pas acceptable que les violents puissent développer
dans la prison un sentiment d'impunité comparable à celui
qu'ils peuvent éprouver au-dehors. On veillera naturellement
à ce que la matérialité des faits soit établie : les
quartiers de mineurs doivent être outillés en conséquence.
20. Enfin, la question du signalement à l'autorité
judiciaire par les médecins ayant été amenés à évaluer les
conséquences corporelles des agressions se pose. Le
rapprochement des deux dispositions du
code de déontologie médicale applicables (articles
R. 4127-10 et
R. 4127-44 du code de la santé publique) devrait autoriser
ce signalement. En effet, lorsqu'il découvre que la personne
qu'il examine a fait l'objet de sévices ou de mauvais
traitements, le médecin ne peut saisir l'autorité judiciaire
qu'avec l'accord de l'intéressé ; mais cet accord n'est pas
requis dans le cas d'un mineur ou d'une personne incapable
(et de surcroît dans cette hypothèse l'autorité
administrative peut également être saisie). L'application de
ces dispositions suppose que soient reconnues comme «
sévices », au sens où le terme est ici employé, les
conséquences des coups reçus en cour de promenade. Elle
suppose aussi que le médecin n'invoque pas de «
circonstances particulières » dont l'article R. 4127-44 lui
reconnaît le droit de les invoquer « en conscience » pour
s'abstenir d'aviser les autorités. La portée de la
réglementation ne saurait toutefois faire de doute : les
enfants sont particulièrement protégés des violences
d'autrui. De plus, si des circonstances particulières
peuvent être invoquées dans le cas de mineurs détenus, ce ne
peut être que celle d'être isolés, parce que coupés de leurs
familles, et celle d'être paralysés par la crainte de
représailles en cas de plainte. Ces circonstances imposent
au médecin une vigilance encore plus attentive qu'au-dehors
et, par conséquent, un signalement conçu largement. La
protection que vaut au malade le secret médical, évidemment
essentielle, n'a pas à se retourner contre lui. C'est ce
qu'il adviendrait si aucun signalement n'était fait. Ce
n'est pas ainsi que peut être conçu le code de déontologie.
Il appartient aux autorités sanitaires d'en rappeler la portée dans les établissements pénitentiaires. JM DELARUE.
Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 avril 2015 relatives à la maison d'arrêt de Strasbourg
L'article 9, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 2007
permet au Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, lorsqu'il constate une violation grave des droits
fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir
sans délai les autorités compétentes de ses observations en
leur demandant d'y répondre. Postérieurement à la réponse
obtenue, il constate s'il a été mis fin à la violation
signalée ; il peut rendre publiques ses observations et les
réponses obtenues.
Lors de la visite de la maison d'arrêt de Strasbourg du 9 au
13 mars 2015, les contrôleurs ont fait le constat de
situations individuelles et de conditions de détention
mettant en exergue des atteintes graves aux droits
fondamentaux des personnes détenues dans cet établissement.
Dès la fin de la mission, le chef d'établissement a été
informé oralement des principaux constats auxquels la visite
a donné lieu. Outre l'urgence intrinsèque à certaines
situations, certains constats effectués lors de la première
visite de l'établissement en 2009 demeurent d'actualité et
les conditions de détention ont connu une certaine
détérioration. La gravité de cette situation conduit la
Contrôleure générale à mettre en œuvre, pour la première
fois depuis le début de son mandat, cette procédure
d'urgence.
Ces recommandations ont été adressées à la garde des sceaux,
ministre de la justice, et à la ministre des affaires
sociales, de la santé et du droit des femmes. Un délai de
quinze jours leur a été imparti pour faire connaître leurs
observations. A l'issue de ce délai, leurs réponses lui sont
parvenues.
A la suite de cette procédure, la Contrôleure générale des
lieux de privation de liberté a décidé de rendre publiques
les constatations et recommandations suivantes.
1. En premier lieu, les contrôleurs ont eu connaissance de
la situation d'une personne détenue au sein de cet
établissement déclarant avoir été frappée et violée pendant
la nuit par son codétenu (1). Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Strasbourg est d'ores
et déjà saisi de la plainte formée par cette personne à
l'encontre de son codétenu. Toutefois, la Contrôleure
générale a effectué un signalement auprès de cette même
autorité en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi
du 30 octobre 2007 modifiée, afin de l'informer des
circonstances dans lesquelles les faits allégués seraient
survenus.
Ceux-ci pourraient révéler l'absence de mesures efficaces
prises par le personnel pénitentiaire pour préserver
l'intégrité physique de l'intéressé. En effet, les éléments
recueillis lors de la visite permettent d'établir que cette
personne a déclaré au personnel du service
médico-psychiatrique régional (SMPR) être impliquée malgré
elle dans un trafic de produits stupéfiants et de téléphones
mobiles, subir des violences de la part de son codétenu et
craindre pour son intégrité physique. Un médecin a effectué
un signalement auprès d'un gradé de l'établissement en
précisant qu'il y avait urgence à procéder à un changement
de cellule. Ce gradé se serait immédiatement rendu au sein
de la cellule de l'intéressé pour solliciter, en présence du
codétenu mis en cause, des précisions sur les motifs de son
inquiétude. Il ne l'a toutefois pas changé de cellule. Le
lendemain, la personne concernée indiquait avoir été victime
de viol durant la nuit.
S'il appartient au procureur de la République de
caractériser l'existence d'une infraction pénale, la
Contrôleure générale considère que les éléments recueillis
permettent d'établir que l'absence de suites données au
signalement circonstancié du SMPR constitue une atteinte
grave à la préservation de l'intégrité physique de
l'intéressé, d'autant plus grave que le lien de dépendance
vis-à-vis de l'administration pénitentiaire découlant de sa
qualité de personne détenue ne lui permettait pas d'assurer
seul sa protection. Il en découle qu'une vigilance
particulière doit être de mise lorsqu'une personne détenue
fait état de risques pour sa sécurité. Il est impératif
qu'elle puisse être rapidement reçue par un personnel gradé
dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs
échanges. Toute mesure de protection doit être prise dans
les meilleurs délais sans que la circonstance de la
sur-occupation des cellules ne puisse y faire obstacle, au
besoin en procédant à une affectation provisoire (2) au
quartier d'isolement ou au quartier arrivants.
2. A l'issue de la visite de l'établissement effectuée du 23
au 26 mars 2009, le Contrôleur général avait formulé des
observations relatives à l'état de saleté des cours de
promenade et de l'absence de sanitaires, de points d'eau en
état de fonctionnement et de bancs dans celles-ci, à la
nécessité de procéder à la rénovation des douches et à
rendre le réseau de distribution d'eau chaude opérationnel
dans les cellules.
Force est de constater que, près de cinq ans après cette
première visite, la situation n'a guère évolué sur ces
points, voire que les conditions de détention se sont
dégradées. Ainsi, les contrôleurs ont constaté que :
- les points d'eau et les sanitaires des cours de promenade sont toujours dans
un état de saleté déplorable et pour beaucoup d'entre eux hors d'usage. Une cour
intérieure est remplie de détritus de toutes natures. L'état de cette cour, bien
que non accessible aux personnes détenues, génère des nuisances indirectes dans
la mesure où elle attire de nombreux rongeurs et des pigeons dont la présence a
été largement constatée ;
- si certaines salles de douche ont été rénovées, l'une d'entre elles est
dégradée et ne comprend aucune paroi de séparation permettant de préserver un
minimum d'intimité. Malgré les travaux effectués, il n'en demeure pas moins que
l'eau des douches est glaciale tant au quartier des hommes qu'au quartier des
femmes. L'eau chaude n'est toujours pas installée dans les cellules ;
- de nombreux matelas, notamment au quartier d'isolement, sont dévorés par les
moisissures témoignant du haut degré d'humidité qui règne dans les cellules.
Cette humidité est à l'origine de nombreuses dégradations du revêtement des murs
et des plafonds. Elle est susceptible d'entraîner différentes pathologies
respiratoires et dermatologiques ;
- il fait froid dans les cellules. A titre d'exemple, la température mesurée par
les contrôleurs dans une cellule du quartier des mineurs était de 17 °C le jour,
sans doute plus basse la nuit. Afin d'élever la température à un niveau
convenable, beaucoup de personnes maintiennent allumée leur plaque chauffante en
permanence, risquant ainsi de provoquer des accidents domestiques tels des
brûlures ou incendies ;
- au quartier disciplinaire, alors que la température extérieure était de 10 °C
environ, la température relevée dans les cellules s'élevait à 14,6 °C. Dans
l'une d'elles, une personne punie, transie de froid, était équipée d'une «
dotation-protection d'urgence » (DPU) appelée également « kit anti-suicide » et
constituée d'un pyjama déchirable et d'une couverture indéchirable. Une seconde
couverture faisait office de drap. Le recours à cette dotation nécessite que la
personne se mette entièrement nue, de gré ou de force, avant de la revêtir ;
- par ailleurs, le CGLPL rappelle que le recours à la DPU est indiqué dans le
seul cas où une crise suicidaire a été diagnostiquée. La crise suicidaire est
une crise psychique mettant la personne en situation de souffrance et de
rupture. Son risque majeur est le suicide (3). Il rappelle également que la
majorité des suicides en détention a lieu au quartier disciplinaire. En
conséquence, le CGLPL conteste le bien-fondé d'y maintenir une personne dont
l'état de crise suicidaire a été constaté par l'administration pénitentiaire
elle-même (recours à la DPU).
Ces conditions de détention portent gravement atteinte à la dignité des
personnes et représentent un traitement inhumain et dégradant. En conséquence,
toute mesure doit être prise pour y remédier immédiatement.
3. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées dans des locaux où se
déroulent les activités médicales du service de psychiatrie. Le personnel
infirmier qui a obstrué ces caméras pour en contester la présence s'est vu
retirer l'habilitation à exercer en milieu pénitentiaire. L'usage de moyens de
vidéosurveillance dans un espace de soins constitue une atteinte grave au secret
médical et à l'indépendance des soignants en milieu pénitentiaire. Si le juste
équilibre entre l'accès aux soins et les impératifs de sécurité, notamment de
protection de la sécurité des personnels soignants, justifie que certains
dispositifs puissent être mis en œuvre (comme l'apposition de dispositifs
d'alerte), la confidentialité des activités thérapeutiques doit conduire à
proscrire toute installation de vidéosurveillance dans un lieu de soin. Le CGLPL
recommande par conséquent que ce dispositif soit retiré.
4. Enfin, il y a également lieu à faire état du climat général dans lequel cette
mission de contrôle s'est déroulée en ce qu'il fait écho aux difficultés
évoquées par les personnes détenues, dont certaines ont été expressément
constatées par les contrôleurs, mais aussi à la violation manifeste de la
confidentialité des correspondances entre les personnes détenues et le CGLPL.
Très peu de demandes d'entretiens ont été remises aux contrôleurs durant leur
visite dans l'établissement. Alors que 758 personnes étaient écrouées le jour de
leur arrivée, seule une vingtaine de demandes leur est parvenue, ce qui est très
largement inférieur à la moyenne des sollicitations lors de la visite d'un
établissement pénitentiaire. De plus, les contrôleurs ont constaté qu'un grand
nombre d'enveloppes contenant ces demandes, initialement fermées, ont
manifestement été ouvertes. Cette pratique a été confirmée par les dires de
nombreuses personnes détenues ayant spontanément déclaré voir leurs courriers
régulièrement ouverts et non acheminés par des personnels de surveillance.
Certes, conformément aux recommandations formulées par le CGLPL à la suite de la
visite de 2009, des boîtes à lettres ont été installées dans les coursives, mais
celles-ci sont en nombre insuffisant et ne portent pas la mention du
destinataire auquel elles sont dédiées, ce qui rend nécessaire le maintien
d'échanges de courriers de la main à la main.
La Contrôleure générale rappelle que l'article 4 de la loi pénitentiaire du 24
novembre 2009 garantit la confidentialité des correspondances adressées au et
par le CGLPL et que cette disposition s'applique aux demandes d'entretien
adressées à l'occasion des visites d'établissement.
Par ailleurs, si les correspondances non protégées peuvent faire l'objet d'un
contrôle, celui-ci ne peut être effectué que par une personne expressément
désignée pour exercer les fonctions de vaguemestre.
5. L'encadrement du personnel de détention est manifestement défaillant. Le chef
de détention n'est secondé que par trois officiers pénitentiaires. La détention
est apparue livrée à elle-même.
Ainsi, les contrôleurs ont constaté que les sièges dans les miradors de
surveillance des cours de promenade étaient en position de sieste et que les
cellules pour personnes à mobilité réduite étaient manifestement utilisées à des
fins de repos du personnel, des cartes de jeux y ont été retrouvées.
Le tutoiement des personnes captives, déjà relevé en 2009, a été constaté à
plusieurs reprises. Il a été fait état de façon récurrente et concordante
d'humiliations et de provocations de la part des surveillants pénitentiaires à
l'encontre de la population pénale. Beaucoup de personnes détenues ont hésité à
s'exprimer par crainte de représailles. Certaines ont évoqué la passivité des
surveillants face aux violences entre détenus et une participation active de
certains agents à des trafics illicites, sans que cette allégation qui semble
récurrente n'ait donné lieu à des mesures de contrôle propres à l'infirmer ou à
la confirmer.
La Contrôleure générale s'inquiète que de tels comportements puissent avoir lieu
sans entraîner de réponse forte de la direction de l'établissement dans la
mesure où ils caractérisent d'une part, un défaut de surveillance qui, outre la
sécurité de l'établissement, est de nature à engendrer la violation des droits
fondamentaux des personnes détenues, tout particulièrement la préservation de
leur intégrité physique et d'autre part, le non-respect des obligations
déontologiques s'imposant aux personnels pénitentiaires.
Enfin, la Contrôleure générale recommande que la direction soit particulièrement
vigilante au respect des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 30 octobre
2007 modifié qui prévoit qu'« aucune sanction ne peut être prononcée et aucun
préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui
lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction ».
DÉTENTION EN CELLULE DISCIPLINAIRE
Astruc c. France du requête du 14 mai 2020 n° 5499/15
Article 3 : Le maintien en isolement du requérant détenu en prison n’a pas constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à la Convention
L’affaire concerne le maintien en isolement du requérant, détenu en prison, après une hospitalisation. La mesure contestée visait à clarifier comment le requérant se procurait des objets et produits non autorisés en détention et à empêcher la réitération de ces faits. La Cour note que si aucune évaluation de l’aptitude du requérant à être placé à l’isolement n’a été réalisée par l’administration pénitentiaire, son état de santé ne justifiait pas, en tout état de cause, le recours à une telle expertise après sa sortie de l’unité psychiatrique d’hospitalisation (UPH). Le registre pénitentiaire permet également de constater que le requérant a fait l’objet d’un suivi très régulier par les équipes soignantes. Il a été en outre vérifié que son état de santé ne nécessitait pas des aménagements de sa détention. Enfin, la Cour estime que le requérant a bénéficié des garanties procédurales minimales requises en la matière et visant à éviter tout risque de décision arbitraire.
FAITS
M. Astruc fit l’objet de cinq mandats de dépôt, dans le cadre d’informations judiciaires ouvertes contre lui, plusieurs portant sur des fraudes à la taxe carbone, qui avaient conduit à un détournement de 146 millions d’euros. Il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes le 10 janvier 2014, dans le cadre de l’une de ces affaires. Le 26 mars 2014, l’administration pénitentiaire informa le juge d’instruction que des écoutes téléphoniques avaient permis d’identifier les contacts extérieurs dont le requérant se servait pour obtenir des services. Le 8 avril 2014, M. Astruc fut placé à l’isolement à titre provisoire pour avoir été trouvé en possession d’objets ne pouvant être achetés dans la prison. Le 11 avril 2014, le chef d’établissement pénitentiaire décida son placement à l’isolement du 12 avril 2014 au 12 juillet 2014, afin de « prévenir la réitération de ces introductions frauduleuses d’objets ». Le 13 avril 2014, M. Astruc saisit le juge des référés administratifs aux fins de voir suspendre l’exécution de cette décision ; le juge des référés rejeta la requête comme étant dépourvue de caractère d’urgence. Le 30 avril 2014, M. Astruc fut admis à l’unité psychiatrique d’hospitalisation (UPH) de la prison et se vit appliquer un protocole dit de mise en cellule d’isolement médical. Il sortit de l’UPH le surlendemain, à sa demande, et fut replacé à l’isolement. Le 5 mai 2014, M. Astruc présenta une nouvelle demande de suspension de l’exécution de la décision le plaçant à l’isolement. Il fit notamment valoir que son état de santé s’était considérablement dégradé depuis son précédent recours et que la détention de produits d’hygiène et autres ne constituait pas un risque pour l’établissement pénitentiaire ou les personnes ; le même jour, le juge des référés rejeta la requête par ordonnance. M. Astruc fit appel de l’ordonnance.
Dans un courrier du 16 juin 2014, le chef de l’établissement informa le juge d’instruction que d’autres saisies d’objets interdits en détention avaient été effectuées dans la cellule, que M. Astruc bénéficiait de très nombreuses visites, de remises de colis de denrées alimentaires et qu’il achetait des produits en cantine dans des quantités telles qu’il avait fallu prévoir un stockage dans une autre cellule. Le 17 juin 2014, M. Astruc fut condamné disciplinairement à un confinement en cellule de détention ordinaire pendant sept jours en raison de la présence dans sa cellule d’une clé USB ne pouvant pas être achetée dans la prison. Le 23 juin 2014, soit avant le terme prévu, le directeur du centre pénitentiaire décida la levée de la mesure d’isolement. Le 23 juillet 2014, le Conseil d’État déclara non admis le pourvoi du requérant contre l’ordonnance du 5 mai 2014. Le 13 septembre 2017, M. Astruc fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à neuf ans de prison et un million d’euros d’amende dans l’affaire des fraudes à la taxe carbone. Le 9 septembre 2019, la cour d’appel de Paris porta la peine du requérant à dix ans de prison. En fuite, depuis sa remise en liberté en 2015, le requérant ne se présenta pas aux deux audiences.
Article 3
La Cour relève que si les produits trouvés lors des fouilles de la cellule ne présentaient pas une dangerosité particulière, l’administration pénitentiaire a fondé sa décision de placement en isolement sur le profil pénal et les capacités financières importantes du requérant lui permettant d’obtenir des services de personnes extérieures, venant ainsi troubler l’ordre public en détention. La mesure litigieuse visait donc en particulier à clarifier comment le requérant se procurait les objets et produits non autorisés en détention et à empêcher la réitération des faits. La Cour note encore que si aucune évaluation de l’aptitude du requérant à être placé à l’isolement n’a été réalisée par l’administration pénitentiaire, faute d’avoir été faite par un médecin n’intervenant pas dans la prison, il apparaît que son état de santé ne justifiait pas, en tout état de cause, le recours à une telle expertise après sa sortie de l’UPH. Ainsi que les juridictions internes l’ont noté, aucun élément ne démontrait une aggravation de son état de santé. Le requérant est ressorti le jour ouvrable suivant son hospitalisation, et celle-ci n’a pas été jugée nécessaire par le psychiatre de l’UPH. Le registre pénitentiaire permet également de constater que le requérant a fait l’objet d’un suivi très régulier par les équipes soignantes. Il a été en outre vérifié que son état de santé ne nécessitait pas des aménagements de sa détention. S’agissant des garanties procédurales, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’un débat contradictoire en présence de son avocat lors d’une audience préalable à son placement à l’isolement définitif. Auparavant, le requérant a eu notification des pièces relatives à la procédure et a formulé des observations écrites. Le requérant a également introduit deux recours auprès du juge des référés, puis deux appels devant le Conseil d’État, en avril et en mai 2014, rejetés par ces différentes juridictions. Il a, enfin, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la mainlevée de la décision auprès de la direction de l’établissement pénitentiaire, qui a d’abord été refusée puis finalement acceptée en juin 2014. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a bénéficié des garanties procédurales minimales requises en la matière et visant à éviter tout risque de décision arbitraire. La Cour conclut que le requérant a été placé dans un isolement partiel et relatif justifié par des raisons de sécurité et compatible avec son état de santé, lequel a fait l’objet d’une surveillance médicale, que sa situation a régulièrement été réexaminée et qu’il a bénéficié des garanties procédurales nécessaires permettant de préserver la procédure de l’arbitraire. Le grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
CEDH
36. Le requérant allègue que son maintien à l’isolement est contraire à l’article 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
37. Le Gouvernement fait valoir que le placement à l’isolement du requérant et son maintien ont été motivés par des raisons de sécurité compte tenu de son profil pénal et de l’utilisation de ses capacités financières pour contourner les règles en vigueur en détention et obtenir des services en provenance de l’extérieur de nature à troubler l’ordre public en détention. Il souligne que le placement de l’intéressé a fait l’objet d’un examen évolutif de la situation.
38. Le Gouvernement affirme que le requérant a fait l’objet d’un suivi médical régulier qui n’a pas démontré de dégradation ou d’incompatibilité avec la mise à l’isolement. L’administration pénitentiaire a d’ailleurs adapté l’intensité du suivi médical pour s’assurer que le placement du requérant ne portait pas atteinte à ses droits.
39. Enfin, le Gouvernement souligne que des garanties procédurales utiles ont entouré la procédure de placement à l’isolement, puisqu’un débat contradictoire avant la décision définitive a été organisé en présence de l’avocat du requérant et que celui-ci a exercé des recours aussi bien auprès de l’administration pénitentiaire qu’auprès des autorités judiciaires qui ont motivé leurs décisions.
40. Le requérant souligne le caractère disproportionné de la mesure litigieuse, qui ne répondrait pas à un impératif de sécurité, et fait valoir que celle-ci n’a pas été justifiée par des motifs clairs et que son aptitude à l’isolement n’a pas été évaluée. Il considère que les objets saisis n’étaient pas dangereux et que les motifs du placement à l’isolement étaient succincts. Il estime qu’aucune évaluation n’a été faite de son aptitude à être placé au quartier d’isolement car les médecins du centre pénitentiaire ne sont pas habilités à se prononcer sur l’aptitude à l’isolement en tant que telle.
41. Le requérant considère enfin que les garanties procédurales et les recours juridictionnels dont il a fait usage sont insuffisants.
42. La Cour rappelle que l’isolement n’est pas, en soi, contraire à l’article 3 de la Convention. La compatibilité d’une mesure d’isolement s’apprécie en fonction de sa durée, de sa rigueur, de l’objectif qu’elle poursuit et de son effet sur la personne détenue. Toute décision de placement à l’isolement ou de sa prolongation doit être dûment motivée, faire l’objet d’un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite de la personne détenue et celle-ci doit pouvoir bénéficier de garanties procédurales afin d’éviter tout risque d’arbitraire (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, §§ 123, 139 et 145, CEDH 2006‑IX, Onoufriou c. Chypre, no 24407/04, §§ 69-70, 7 janvier 2010 et A.T. (No 2) c. Estonie, no 70465/14, §§ 72-73, CEDH 2018).
43. En l’espèce, la Cour constate que si, selon le requérant, les produits trouvés lors des fouilles de sa cellule ne présentaient pas une dangerosité particulière, l’administration pénitentiaire a fondé sa décision sur son profil pénal et ses capacités financières importantes lui permettant d’obtenir des services de personnes extérieures, venant ainsi troubler l’ordre public en détention. La Cour ne doute pas de l’objectif de la mesure litigieuse, à savoir la protection de l’ordre interne de l’établissement pénitentiaire ou de ses occupants, la surveillance du requérant ayant révélé à plusieurs reprises, et même lorsqu’il était placé en isolement, des incidents qui, mis en perspective avec le profil pénal de l’intéressé, pouvaient faire craindre la commission d’autres infractions (paragraphes 5, 6, 7 et 18 ci-dessus). La mesure litigieuse visait en particulier à clarifier comment le requérant se procurait les objets et produits non autorisés en détention et à empêcher la réitération des faits.
44. La Cour relève par ailleurs que la décision d’isoler le requérant a été prise par le directeur de l’établissement pour une durée de trois mois, comme l’autorise les dispositions législatives et réglementaires internes (paragraphe 26 et 29 ci-dessous). Si cette durée peut aggraver les effets négatifs de l’isolement (paragraphe 33 et 34 ci-dessus), il convient de constater, premièrement, que le requérant n’a jamais prétendu ni devant les juridictions internes ni devant la Cour que la durée globale de son isolement constituait un traitement inhumain ou dégradant. Il ne s’est plaint en particulier devant la Cour, dans son formulaire de requête et dans ses observations, que du maintien de celui-ci après son hospitalisation, soit une période d’un mois et demi environ. Deuxièmement, la Cour constate que le requérant n’a jamais prétendu non plus que le régime de détention réservé aux personnes placées à l’isolement à des fins préventives prévu à l’article R 57-7-62 du CPP (paragraphes 25 et 27 ci-dessus), à savoir un régime qui préserve au minimum l’accès aux communications téléphoniques, les droits familiaux, le droit à l’information, l’accès à la cantine et une promenade quotidienne (paragraphes 18 et 27 ci-dessus), contrevenait à l’article 3 de la Convention. Troisièmement, le requérant ne s’est pas plaint non plus des conditions matérielles de son placement à l’isolement. Enfin, la Cour observe que le directeur de la prison a décidé de la mainlevée de la mesure avant son terme, après avoir constaté une évolution positive de la conduite du requérant (paragraphe 21 ci-dessus).
45. La Cour note encore que si, selon le requérant, aucune évaluation de son aptitude à être placé à l’isolement n’a été réalisée par l’administration pénitentiaire, faute d’avoir été faite par un médecin n’intervenant pas dans la prison, il apparaît que son état de santé ne justifiait pas, en tout état de cause, le recours à une telle expertise après sa sortie de l’UHP. En effet, ainsi que les juridictions internes l’on noté, aucun élément ne démontrait une aggravation de son état de santé : d’une part, le requérant est ressorti le jour ouvrable suivant son hospitalisation, et celle-ci n’a pas été jugée nécessaire par le psychiatre de l’UHP (paragraphe 15 ci-dessus) ; d’autre part, la seule attestation produite par le requérant émanant de la psychologue du centre de soins constate une « évolution certaine » de son état (paragraphe 10 ci-dessus). Dès lors, le placement à l’isolement après l’hospitalisation du requérant a pu être maintenu sur décision du chef de l’établissement.
46. Le registre pénitentiaire produit par le Gouvernement permet également de constater que le requérant a fait l’objet d’un suivi très régulier par les équipes soignantes. Il a été en outre vérifié que son état de santé ne nécessitait pas des aménagements de sa détention (paragraphe 16 ci-dessus).
47. Enfin, s’agissant des garanties procédurales, la Cour relève que les pièces du dossier démontrent que le requérant a bénéficié d’un débat contradictoire en présence de son avocat lors d’une audience préalable à son placement à l’isolement définitif (paragraphe 6 ci-dessus). Auparavant, le requérant a eu notification des pièces relatives à la procédure et a formulé des observations écrites (paragraphe 5 ci-dessus). Le requérant a également introduit deux recours auprès du juge des référés, puis deux appels devant le Conseil d’État, en avril et mai 2014, rejetés par ces différentes juridictions. Il a, enfin, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la mainlevée de la décision auprès de la direction de l’établissement pénitentiaire, qui a d’abord été refusée puis finalement acceptée en juin 2014. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a bénéficié des garanties procédurales minimales requises en la matière et visant à éviter tout risque de décision arbitraire (mutatis mutandis, A.T. (No2), précité, § 85).
48. La Cour conclut que le requérant a été placé dans un isolement partiel et relatif justifié par des raisons de sécurité et compatible avec son état de santé, lequel a fait l’objet d’une surveillance médicale, que sa situation a régulièrement été réexaminée et qu’il a bénéficié des garanties procédurales nécessaires permettant de préserver la procédure de l’arbitraire. Partant, elle estime que son grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Mazziotti c. France du 11 octobre 2013 requête n° 65089/13
Articles 3 et 13 : Irrecevabilité La sanction disciplinaire de courte durée infligée à un détenu n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant
L’affaire concerne l’infliction d’une mesure disciplinaire à un détenu, surpris en possession d’un téléphone portable. La Cour reconnaît la validité des motifs disciplinaires de la sanction ainsi que sa nécessité quant aux impératifs de sécurité. Elle observe que la durée du placement en cellule disciplinaire a été relativement courte et que les deux derniers jours de la sanction ont été convertis en travaux d’intérêt général, ce qui démontre que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances et de sa situation. Le requérant a bénéficié d’une consultation par un psychiatre et par un infirmier avant son placement en quartier disciplinaire puis le jour même de la mise à exécution de cette sanction, ce qui a permis de vérifier la compatibilité de son état de santé avec celle-ci. Il a par ailleurs été vu régulièrement par un médecin ou un psychologue au cours la période considérée
LES FAITS
Le requérant, M. Michael Mazziotti, est un ressortissant français, né en 1987 et détenu à Marseille. Placé sous mandat de dépôt en mai 2010, condamné à quatre reprises, M. Mazziotti fut renvoyé devant la cour d’assises. Par un arrêt du 15 octobre 2013, la cour d’assises des Bouches du Rhône le condamna à 12 ans d’emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme, violence aggravée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Peu auparavant, le 12 octobre 2012, alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Nice, il fut trouvé en possession d’un téléphone portable et d’une puce de téléphone. La commission de discipline de l’établissement lui infligea une peine de cellule disciplinaire de 7 jours à effectuer entre le 22 et le 28 novembre 2012. Le 22 novembre 2012, M. Mazziotti saisit le juge des référés afin de suspendre l’exécution de cette décision. Le juge des référés rejeta la demande. Le 27 novembre 2012, M. Mazziotti forma un pourvoi contre cette décision devant le Conseil d’Etat. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Conseil d’Etat déclara n’y avoir lieu à statuer, la sanction disciplinaire ayant été déjà exécutée.
Articles 3 et 13
La Cour observe tout d’abord que M. Mazziotti se contente d’indiquer de manière très générale que la mesure infligée n’était pas nécessaire eu égard au but poursuivi. Or, la Cour n’aperçoit rien dans le dossier qui puisse la faire douter des motifs disciplinaires de la sanction ni de sa nécessité quant aux impératifs de sécurité. Par ailleurs, la Cour constate que la durée du placement en cellule disciplinaire était relativement courte et que cette durée a, de plus, été réduite par l’administration pénitentiaire qui a fait droit à la demande de M. Mazziotti de convertir les deux derniers jours de la sanction en travaux d’intérêt général. Aucun élément du dossier ne permet non plus à la Cour de penser que la décision de transférer M. Mazziotti en cellule disciplinaire donnait lieu de craindre à une mise en danger de sa santé physique ou psychique. Elle constate au contraire que M. Mazziotti a fait l’objet d’une surveillance médicale constante, qu’il a bénéficié d’une consultation par un psychiatre et par un infirmier avant son placement en quartier disciplinaire, puis le jour même de l’exécution de sa sanction. Il a été vu régulièrement par un médecin ou un psychologue au cours de la période considérée. Enfin, la Cour constate que les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire n’ont jamais fait l’objet d’une plainte de la part de M. Mazziotti, ni devant les autorités internes ni devant la Cour. La Cour ne décèle par conséquent aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. Il en découle par conséquent aussi que le grief fondé sur l’article 13 doit être rejeté.
CEDH
31. Quant à violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils ont été rappelés dans les arrêts Plathey c. France (no 48337/09, §§ 47 à 49, 10 novembre 2011) et Ketreb c. France (no 38447/09, §§ 108 à 111, 19 juillet 2012).
32. S’agissant de l’effectivité des recours exigés par l’article 13, la Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent notamment énoncés également dans les arrêts Payet (§§ 127-130) et Plathey (§§ 72 à 74) précités. Dans ces deux arrêts, la Cour a considéré que le recours non suspensif prévu, à l’époque, à l’article D. 250-5 du code de procédure pénale (aujourd’hui l’article R. 57-7-32 du CPP, paragraphe 14 ci-dessus) pour contester les sanctions disciplinaires n’était pas un recours apte à prospérer en temps utile et donc ni adéquat ni effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Elle avait pris soin de noter que la présentation d’une requête en référé-liberté par le détenu n’était pas encore possible à l’époque des faits dont elle était saisie.
33. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le requérant se contente d’indiquer de façon très générale que la mesure litigieuse n’était pas nécessaire au regard du but poursuivi. La Cour n’aperçoit rien cependant dans le dossier qui puisse la faire douter des motifs disciplinaires de la sanction ni de sa nécessité au regard notamment des impératifs de sécurité (voir, a contrario, Goriunov c. République de Moldova, no 14466/12, 29 mai 2018).
34. Par ailleurs, si la Cour ne perd pas de vue que le placement en cellule disciplinaire est une période sensible pour le détenu (Cocaign c. France, no 32010/07, § 60, 3 novembre 2011), elle constate que la durée du placement à laquelle le requérant a été condamné, soit sept jours, était relativement courte, et qu’elle a même été réduite puisque l’administration pénitentiaire a fait droit à la demande du requérant de convertir les deux derniers jours de quartier disciplinaire en travaux d’intérêt général. Le requérant n’a ainsi effectué que cinq jours de détention dans le quartier disciplinaire, à la place de sept, ce qui démontre que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances et de sa situation.
35. La Cour relève encore qu’aucun élément du dossier ne permet de penser que la décision de transférer le requérant en cellule disciplinaire pouvait faire craindre une mise en danger de sa santé physique ou psychique. La lecture du compte rendu de la mission d’inspection mandatée par le Gouvernement ne fait mention d’aucune maladie. Elle révèle, certes, que le requérant était angoissé puisqu’un traitement anxiolytique lui a été, en vain, proposé. Toutefois, la Cour constate que le requérant a fait l’objet d’une surveillance médicale constante. Il a en effet bénéficié d’une consultation par un psychiatre et par un infirmier avant son placement en quartier disciplinaire puis le jour même de la mise à exécution de cette sanction, ce qui a permis de vérifier la compatibilité de son état de santé avec celle-ci. Il a par ailleurs été vu régulièrement par un médecin ou un psychologue au cours la période considérée.
36. La Cour constate enfin que les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire n’ont jamais fait l’objet d’une plainte de la part du requérant, ni devant les autorités internes ni devant elle (a contrario, Payet, précité, §§ 80 à 85 et Plathey, précité, §§ 52 à 57).
37. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les autorités françaises de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
38. En l’absence de grief défendable de violation de l’article 3 de la Convention, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. Il s’ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
SURPEUPLEMENT ET VETUSTE D'UNE PRISON
SONT DES ACTES INHUMAINS ET DEGRADANTS
Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement à la JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR :
- L'OBLIGATION DE CELLULE INDIVIDUELLE EN FRANCE
- LE MANQUE D'HYGIÈNE ET LA PRISON VÉTUSTE
Décision Chatzivasiliadis c. Grèce requête no 51618/12 du 19 décembre 2013
L'action indemnitaire constitue une voie de recours qui peut être intentée par un requérant ayant souffert des conditions de détention à la prison de Korydallos
La Cour observe que M. Chatzivasiliadis a été remis en liberté le 12 décembre 2011. Ayant saisi la Cour le 4 août 2012, il ne visait pas la cessation de sa détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais visait à obtenir un constat de violation de l’article 3 et le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’il estimait avoir subi.
La Cour note que les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire garantissent en ces domaines des droits subjectifs qui peuvent être invoqués devant les juridictions. M. Chatzivasiliadis disposait d’une voie de recours interne, fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire, ainsi qu’avec l’article 3 de la Convention, recours interne qu’il aurait pu exercer, ce qu’il n’a pas fait.
La requête doit être par conséquent rejetée pour non-épuisement des voies de recours interne.
Bardali c. Suisse du 24 novembre 2020 requête n° 31623/17
Non violation article 3 : Conditions de détention dans la prison de Champ-Dollon : non-violation de la Convention
La Cour juge en particulier que le manque d’espace du requérant dans la prison de Champ-Dollon ne saurait à lui seul caractériser une violation de l’article 3 de la Convention. En effet, la surface individuelle dont disposait le requérant, inférieure à la norme de 4 m2 établie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), doit être examinée avec les autres conditions matérielles de détention du requérant afin d’établir s’il y a ou non violation de l’article 3. Au vu de l’ensemble des conditions matérielles de détention du requérant dans la prison de ChampDollon qu’elle a eu à connaître, la Cour conclut que ce dernier n’a pas été soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Conditions convenables de détention d’un détenu en prison malgré la surpopulation • Espace personnel supérieur à 3 m2 mais inférieur à la norme de 4 m2 énoncée par le CPT • Bon état de l’hygiène et de l’aération, de l’approvisionnement en eau et en nourriture, du chauffage et de la lumière • Promenade quotidienne à l’air libre et autres activités hors cellule • Soins médicaux appropriés • Détenu non soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention
FAITS
Le 15 avril 2015, M. Bardali fut condamné à une peine privative de liberté de 36 mois par le Tribunal correctionnel du canton de Genève pour tentative de lésions corporelles graves et entrée illégale en Suisse. En prison, il entama une grève de la faim et de la soif afin de protester contre sa condamnation qu’il estimait injuste. Le 8 mai 2015, il fit une tentative de suicide. Il fut amené en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève, puis transféré en unité de psychiatrie pénitentiaire à proximité de la prison de Champ-Dollon, qu’il réintégra le 11 mai 2015. M. Bardali saisit ensuite la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, se plaignant entre autres de la surpopulation carcérale dans la prison de Champ-Dollon. Partageant une cellule de 10 m2 environ avec deux autres détenus, il fit valoir qu’il se trouvait dans l’impossibilité de se mouvoir dans la cellule, ne disposant que d’un espace individuel net de 3,39 m2, entravé par divers meubles. La Cour de justice reconnut ces conditions de détention, mais jugea qu’elles n’étaient pas contraires à la dignité humaine.
Le Tribunal fédéral rejeta le recours de M. Bardali. Il constata que le requérant avait en effet été détenu durant 98 jours consécutifs, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, dans une cellule individuelle occupée par trois détenus, ne lui offrant de ce fait qu’un espace individuel de 3,39 m2. Cependant, le Tribunal considéra que le délai de trois mois fixé par la jurisprudence interne – au-delà duquel les conditions de détention similaires ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine – était une durée indicative à prendre en compte dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, comprenant notamment l’état d’hygiène et d’aération, l’approvisionnement en eau et en nourriture, le chauffage et la lumière. Le Tribunal jugea qu’en l’espèce, ces conditions avaient été convenables. Au vu de l’ensemble des circonstances et compte tenu du fait que la détention litigieuse n’avait dépassé que très faiblement le seuil critique de trois mois, le Tribunal fédéral conclut que M. Bardali n’avait pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine. M. Bardali fut transféré à la prison de La Brenaz à Puplinge où il finit de purger sa peine le 5 mars 2018.
Article 3
La Cour note que, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, à l’exception de trois jours d’hospitalisation, le requérant a été détenu, avec deux autres personnes, dans une cellule individuelle dont la superficie était de 10,18 m², sanitaires exclus. Il disposait donc d’un espace personnel de 3,39 m². Les conditions de détention du requérant ont été les mêmes pendant la période du 17 novembre 2014 au 12 janvier 2015, dans cette même cellule ainsi que dans une autre. La Cour constate donc que, pendant ces deux périodes non consécutives, le requérant a disposé d’un espace personnel supérieur à 3 m² mais inférieur à la norme de 4 m² énoncée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans ses recommandations. La Cour note cependant que, en dehors des périodes litigieuses, à savoir pendant une majeure partie de sa détention à la prison de Champ-Dollon, le requérant a disposé de plus de 4 m² d’espace personnel.
La Cour doit donc examiner les autres aspects matériels des conditions de détention du requérant, afin de déterminer si ce manque d’espace s’accompagnait d’autres déficiences, notamment d’un défaut d’accès à une cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. En premier lieu, la Cour observe qu’il n’est pas contesté entre les parties que les sanitaires de la cellule étaient séparés du reste de la pièce et que le requérant a pu utiliser ces installations librement et de manière privée. Il n’est pas contesté non plus que la cellule disposait d’une baie vitrée et bénéficiait de la lumière naturelle, qu’elle était pourvue d’un apport direct d’air frais et d’une extraction d’air mécanique ainsi que d’un ventilateur afin de minimiser les effets de la chaleur en été. Le requérant avait donc un accès non obstrué à l’air et à la lumière naturels ainsi qu’à l’eau potable. La Cour admet que dans ce contexte, et selon l’avis du Tribunal fédéral, les conditions concrètes de la détention du requérant, comprenant notamment l’état d’hygiène et d’aération, l’approvisionnement en eau et en nourriture, le chauffage et la lumière, étaient des conditions convenables. En second lieu, la Cour constate que le requérant ne lui a pas soumis de liste détaillée et cohérente de ses doléances ; il n’a pas mentionné les dates ou les circonstances précises des restrictions dont il se plaint, et le dossier ne fait pas apparaître une dégradation de son état physique ou un risque pour sa santé. Il ressort par ailleurs du dossier que le requérant a pu bénéficier d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre et, entre le 17 novembre 2014 et le 19 août 2015, d’une heure de sport hebdomadaire dans une salle de gymnastique. Dans ses observations, le Gouvernement a ajouté que le requérant a travaillé dans l’atelier cuisine entre le 15 février 2016 et le 27 octobre 2016, ce qui l’a occupé tous les jours de 3 heures à 5 heures et 45 minutes ; il pouvait quitter sa cellule en cas de visite et pour la prière du vendredi toutes les deux semaines. En troisième lieu, en ce qui concerne les autres éléments soulevés par le requérant dans ses observations – à savoir le manque d’activités sociales ou récréatives, la température élevée et des moisissures dans la cellule ainsi qu’une mauvaise aération, l’impossibilité de prendre une douche tous les jours et des restrictions quant aux visites et appels téléphoniques – la Cour note que ces griefs n’ont pas été valablement soumis aux juridictions internes et ne sauraient donc être pris en considération par la Cour. Enfin, ce qui concerne enfin la grève de la faim entreprise en mai 2015, rien ne permet de constater que le requérant aurait manqué de soins médicaux appropriés, ni de réfuter l’allégation du Gouvernement selon laquelle l’intéressé a été pris en charge par un psychiatre à sa sortie de l’hôpital. La Cour conclut donc que les conditions de détention dans la prison de Champ-Dollon n’ont pas soumis le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
CEDH
a) Rappel des principes
44. La Cour a réitéré les principes pertinents concernant la prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants et la protection des personnes privées de liberté contre des traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans l’arrêt Muršić (précité, §§ 96-100), et plus récemment dans l’arrêt Rezmiveș et autres c. Roumanie (nos 61467/12 et 3 autres, §§ 71‑73, 25 avril 2017).
45. En ce qui concerne les conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant. En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Ananyev et autres, précité, § 142, Muršić, précité, § 101, et Rezmiveș et autres, précité, § 74).
46. Lorsque le surpeuplement atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et 6 autres, § 68, 8 janvier 2013). En effet, l’exiguïté extrême dans une cellule de prison est un aspect particulièrement important qui doit être pris en compte afin d’établir si les conditions de détention litigieuses étaient « dégradantes » au sens de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 104).
47. La Cour a confirmé que l’exigence de 3 m² de surface au sol par détenu (incluant l’espace occupé par les meubles, mais non celui occupé par les sanitaires) dans une cellule collective doit demeurer la norme minimale pertinente aux fins de l’appréciation des conditions de détention au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, §§ 110 et 114). Elle a également précisé qu’un espace personnel inférieur à 3 m² dans une cellule collective fait naître une présomption, forte mais non irréfutable, de violation de cette disposition. La présomption en question peut notamment être réfutée par les effets cumulés des autres aspects des conditions de détention, de nature à compenser de manière adéquate le manque d’espace personnel ; à cet égard, la Cour tient compte de facteurs tels que la durée et l’ampleur de la restriction, le degré de liberté de circulation et l’offre d’activités hors cellule, et le caractère généralement décent ou non des conditions de détention dans l’établissement en question (Muršić, précité, §§ 122-138, et Rezmiveș et autres, précité, § 77).
48. En revanche, dans des affaires où le surpeuplement n’était pas important au point de soulever à lui seul un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Comme la Cour l’a précisé dans son arrêt Muršić (précité, § 139), lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. Aussi, dans pareilles affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, telles qu’un manque de ventilation et de lumière (Torreggiani et autres, précité, § 69 ; voir également Moisseiev c. Russie, no 62936/00, §§ 124-127, 9 octobre 2008), un accès limité à la promenade en plein air (István Gábor Kovács c. Hongrie, no 15707/10, § 26, 17 janvier 2012, Efremidze c. Grèce, no 33225/08, § 38, 21 juin 2011, et Gladkiy c. Russie, no 3242/03, § 69, 21 décembre 2010) ou un manque total d’intimité dans les cellules (Szafransky c. Pologne, no 17249/12, §§ 39-41, 15 décembre 2015, Veniosov c. Ukraine, no 30634/05, § 36, 15 décembre 2011, et Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 106-107, CEDH 2005-X (extraits)).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
49. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint du surpeuplement cumulé notamment avec un confinement en cellule pendant 23 heures par jour.
50. Il ressort du parcours cellulaire du requérant que, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, à l’exception de trois jours d’hospitalisation entre le 8 et le 11 mai 2015, il a été détenu avec deux autres personnes dans la cellule individuelle no 271 située dans l’aile Nord de la prison de Champ‑Dollon, dont la superficie était de 10,18 m2, sanitaires exclus. Ainsi, le requérant disposait d’un espace individuel de 3,39 m2 durant cette période, de même que pendant la période entre le 17 novembre 2014 et le 12 janvier 2015 lorsqu’il partageait avec deux autres personnes soit la cellule no 271 soit la cellule individuelle no 279.
51. La Cour constate donc que, pendant ces deux périodes non consécutives, le requérant a disposé d’un espace personnel supérieur à 3 m2 mais inférieur à la norme de 4 m2 énoncée par le CPT dans ses recommandations. Dans son rapport CPT/Inf(2016)18 (paragraphe 22 ci‑dessus), le CPT a par ailleurs confirmé que la prison de Champ-Dollon était confrontée à un problème de surpeuplement. Il ressort cependant du parcours cellulaire du requérant que, en dehors des périodes litigieuses, à savoir pendant une majeure partie de sa détention à la prison de Champ‑Dollon, il a disposé de plus de 4 m² d’espace personnel.
52. En ce qui concerne la période de 98 jours consécutifs, voire de 155 jours non consécutifs, au cours de laquelle le requérant disposait d’un espace personnel compris entre 3 m² et 4 m², la Cour estime qu’il s’agit d’une période non négligeable. Pour se prononcer sur le respect de l’article 3 de la Convention, la Cour doit donc examiner le caractère suffisant ou insuffisant des autres aspects des conditions matérielles de détention du requérant, afin de déterminer si ce manque d’espace s’accompagnait d’autres déficiences, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (voir, notamment, Muršić, précité, § 139).
53. À cet égard, la Cour observe d’abord qu’il n’est pas contesté entre les parties que les sanitaires de la cellule étaient séparés du reste de la pièce et que le requérant a pu utiliser ces installations librement et de manière privée. Le requérant ne dément non plus l’allégation du Gouvernement (paragraphe 39 ci-dessus) selon laquelle la cellule était munie d’une baie vitrée et disposait ainsi de la lumière naturelle, puis qu’elle était pourvue d’un apport direct d’air frais, d’une extraction d’air mécanique et d’un ventilateur afin de minimiser les effets de la chaleur en été. Le requérant avait donc un accès non obstrué à l’air et à la lumière naturels ainsi qu’à l’eau potable. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il n’aurait pas disposé d’un lit individuel.
54. Il convient de noter dans ce contexte que, de l’avis du Tribunal fédéral, les conditions concrètes de la détention du requérant, comprenant notamment l’état d’hygiène et d’aération, l’approvisionnement en eau et en nourriture, le chauffage et la lumière, étaient convenables (paragraphe 10 ci‑dessus).
55. Ensuite, constatant que le requérant n’a pas soumis une liste détaillée et cohérente de ses doléances, n’ayant notamment pas mentionné les dates ou des circonstances plus précises des restrictions dont il se plaint (voir, entre autres, Podeschi c. Saint-Marin, no 66357/14, § 112, 13 avril 2017), et que le dossier ne fait pas apparaître une dégradation de son état physique ou un risque pour sa santé (voir, a contrario, Modarca c. Moldova, no 14437/05, §§ 11, 28 et 64, 10 mai 2007), la Cour relève dans le rapport du directeur de la prison (paragraphe 7 ci-dessus) et dans les observations du Gouvernement (paragraphes 39 et 41 ci-dessus) que l’intéressé a pu bénéficier d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre et, entre le 17 novembre 2014 et le 19 août 2015, d’une heure de sport hebdomadaire dans une salle de gymnastique. Le Gouvernement a ajouté que le requérant avait travaillé au sein de l’atelier cuisine entre le 15 février 2016 et le 27 octobre 2016, ce qui l’occupait tous les jours pendant 3 heures à 5 heures et 45 minutes, et qu’il pouvait également quitter sa cellule en cas de visite et pour la prière du vendredi toutes les deux semaines.
56. Pour ce qui est des autres éléments soulevés par le requérant dans ses observations adressées à la Cour, à savoir le manque d’activités sociales ou récréatives, la température élevée et des moisissures dans la cellule ainsi qu’une mauvaise aération de celle-ci, l’impossibilité de prendre une douche tous les jours et des restrictions quant aux visites et appels téléphoniques, il y a lieu de noter que ces griefs n’ont pas été valablement soumis aux juridictions internes (paragraphe 27 ci-dessus) et ne sauraient donc être pris en considération par la Cour (voir, mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, §§ 132-133, 147).
57. En ce qui concerne enfin la grève de la faim mentionnée par le requérant (paragraphe 37 ci-dessus), il ressort des documents soumis par le Gouvernement que, dans sa lettre adressée au directeur de la prison et reçue par ce dernier le 7 mai 2015, le requérant contestait sa condamnation et se plaignait d’une injustice, sans évoquer les conditions de sa détention. Le service médical a été avisé le 8 mai 2015. Lors de son hospitalisation à cette dernière date, le requérant a également déclaré qu’il entendait contester sa condamnation et qu’il était frustré en raison de ses problèmes avec la justice. Le rapport de l’hôpital fait apparaître que le matin même du 8 mai 2015, le requérant s’était rendu au service médical de la prison pour une prise de sang et que son traitement anxiolytique avait été arrêté quelques jours avant en raison de sa grève et des malaises en résultant. Rien ne permet donc de constater que le requérant n’aurait pas bénéficié de soins médicaux appropriés, ni de réfuter l’allégation du Gouvernement (paragraphe 43 ci-dessus) selon laquelle il a été pris en charge par un psychiatre à sa sortie de l’hôpital.
Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les conditions de sa détention dans la prison de Champ-Dollon n’ont pas soumis le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
59. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
Bădulescu c. Portugal du 20 octobre 2020 requête n° 33729/18
Article 3 : La surpopulation de la prison de Porto constitue un traitement dégradant pour les détenus
Traitement dégradant • Conditions de détention durant six ans et demi • Surpeuplement carcéral, aggravé par l’absence de chauffage
L’affaire concerne les conditions de détention dans la prison de Porto (Portugal) où M. Bădulescu fut détenu entre octobre 2012 et mars 2019. La Cour relève que la prison de Porto a été surpeuplée pendant toute la période où M. Bădulescu a purgé sa peine (six ans et demi) et qu’il a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m2 dans les cellules où il fut détenu. La Cour juge en particulier que M. Bădulescu a traversé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, ce qui constitue un traitement dégradant. Elle dit aussi que l’absence de chauffage a constitué un facteur aggravant, vu l’inconfort voire la détresse qu’il a pu causer au requérant tout au long de sa détention. Elle note enfin que la surpopulation de cette prison et ses conséquences ont constitué la principale inquiétude du Médiateur dans son rapport du 20 avril 2017.
FAITS
Le requérant, Ionuţ-Marian Bădulescu, est un ressortissant roumain né en 1981. Il est actuellement détenu à Tulcea, en Roumanie. À une date non précisée, M. Bădulescu fut condamné à neuf ans et six mois d’emprisonnement pour vol au Portugal. Le 19 octobre 2012, il fut arrêté et placé en détention à la prison de Porto, d’où il fut libéré le 6 mars 2019. Durant cette période, M. Bădulescu se plaint d’avoir été détenu dans des cellules surpeuplées et d’avoir bénéficié d’un espace personnel réduit. Il soutient également que les cellules étaient insalubres, froides en hiver et chaudes en été, et que les toilettes n’étaient pas cloisonnées. Il se plaint aussi de la tardiveté des soins dentaires dont il a bénéficié et de leur déficience, ainsi que des appels téléphoniques avec sa famille qui ne pouvaient pas excéder cinq minutes par jour.
Article 3
Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce. En effet, la prison de Porto a été surpeuplée d’un bout à l’autre de la période pendant laquelle M. Bădulescu a purgé sa peine. Ainsi, quoique prévue pour accueillir 686 personnes, la prison de Porto était occupée par 1 070 détenus au 31 décembre 2012, 1 159 détenus au 31 décembre 2013, 1 207 détenus au 31 décembre 2014, 1 197 détenus au 31 décembre 2015, 1 183 détenus au 31 décembre 2016, 1 128 détenus au 31 décembre 2017 et 1 070 détenus au 31 décembre 2018. D’ailleurs, la surpopulation de cette prison et ses conséquences constituent la principale inquiétude qui ait été évoquée par le Médiateur dans son rapport du 20 avril 2017. Pendant toute la durée de son incarcération à la prison de Porto, M. Bădulescu a donc disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel, plus précisément de 2,8 m2 dans les cellules prévues pour deux personnes et de 2,1 m2 dans les cellules collectives, où cohabitaient jusqu’à six personnes. Eu égard à la longue durée de la période d’incarcération (six ans et demi), la Cour estime que M. Bădulescu a traversé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, ce qui constitue un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. La Cour estime aussi que l’absence de chauffage a constitué un facteur aggravant, vu l’inconfort voire la détresse qu’il a pu causer à M. Bădulescu tout au long de sa détention à la prison de Porto. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne le grief portant sur l’accès tardif et déficient à des soins dentaires, la Cour relève que M. Bădulescu n’indique pas les dates auxquelles il aurait demandé à être vu par un dentiste ou aurait reçu des soins dentaires, et il n’explique pas en quoi les soins qui lui auraient été prodigués auraient été déficients. Par conséquent, ce grief n’est pas suffisamment étayé et est rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Article 8
M. Bădulescu se plaignait qu’il ne pouvait passer à sa famille des appels téléphoniques de plus de cinq minutes par jour. La Cour considère en particulier qu’eu égard à la nécessité d’assurer à tout détenu un accès au téléphone, la limitation du temps des communications téléphoniques quotidiennes n’est pas une mesure disproportionnée. D’ailleurs, dans son rapport relatif à sa visite au Portugal en 2016, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a considéré qu’un accès au téléphone pendant cinq minutes par jour était satisfaisant. En outre, M. Bădulescu n’a pas indiqué avoir été empêché de communiquer avec sa famille par d’autres moyens. Ce grief est donc manifestement mal fondé et est rejeté.
CEDH
Article 3
27. La Cour renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence relative aux mauvaises conditions de détention (Muršić, précité, §§ 96‑101, et Petrescu, précité, §§ 97 et 101).
28. Dans son arrêt de principe Petrescu, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
29. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.
30. Elle observe d’abord que la prison de Porto a été surpeuplée d’un bout à l’autre de la période pendant laquelle le requérant a purgé sa peine. Ainsi, quoique prévue pour accueillir 686 personnes, la prison de Porto était occupée par 1 070 détenus au 31 décembre 2012, 1 159 détenus au 31 décembre 2013, 1 207 détenus au 31 décembre 2014, 1 197 détenus au 31 décembre 2015, 1 183 détenus au 31 décembre 2016, 1 128 détenus au 31 décembre 2017 et 1 070 détenus au 31 décembre 2018 (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour relève par ailleurs que la surpopulation de cette prison et ses conséquences constituent la principale inquiétude qui ait été évoquée par le Médiateur dans son rapport du 20 avril 2017 (paragraphe 15 ci-dessus).
31. La Cour constate que pendant toute la durée de son incarcération à la prison de Porto, soit du 19 octobre 2012 au 6 mars 2019, le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel, plus précisément de 2,8 m2 dans les cellules prévues pour deux personnes et de 2,1 m2 dans les cellules collectives, où cohabitaient jusqu’à six personnes (paragraphe 6 ci-dessus). Eu égard à sa jurisprudence concernant l’espace personnel minimum dont les détenus doivent normalement pouvoir disposer, en vertu de laquelle une détention dans des conditions où le détenu dispose de moins de trois mètres carrés d’espace personnel donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3 qui ne peut être renversée que si se trouvent réunis toute une série de facteurs atténuants, au nombre desquels figure la brièveté des périodes concernées (Muršić, précité, § 138), la Cour, eu égard à la longue durée (six ans et demi) de la période ici en cause, estime que le requérant a traversé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et qui s’analyse dès lors en un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention (comparer avec Samaras et autres c. Grèce, no 11463/09, §§ 63-65, 28 février 2012, Muršić, précité, §§ 151-153 et Nikitin et autres c. Estonie, nos 23226/16 et 6 autres, §§ 173, 178 et 188, 29 janvier 2019). Au demeurant, elle estime que l’absence de chauffage a constitué, en l’espèce, un facteur aggravant, vu l’inconfort voire la détresse qu’il a pu causer chez le requérant tout au long de sa détention à la prison de Porto (voir les considérations faites sur ce point dans l’arrêt de principe Petrescu, précité, § 109).
32. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce.
Article 8
35. Toujours sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne pouvait passer à sa famille des appels téléphoniques de plus de cinq minutes par jour. Le Gouvernement explique que la limitation des appels téléphoniques résulte de la réglementation interne. Il estime que le régime incriminé n’est pas déraisonnable, chaque détenu pouvant, en sus des appels aux avocats ou aux institutions auxquelles les détenus doivent avoir accès, passer chaque jour un appel téléphonique, d’une durée maximale de cinq minutes, vers l’extérieur.
36. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018), la Cour estime que le grief du requérant se prête à un examen sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Elle rappelle que toute détention, comme toute autre mesure privative de liberté, entraîne par nature des restrictions pour la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire autorise le détenu à maintenir le contact avec sa famille proche et qu’elle l’y aide au besoin (Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, § 106, CEDH 2015, et les références qui y sont citées). À supposer que la limitation du nombre d’appels téléphoniques auxquels le requérant avait droit puisse être considérée comme une restriction constitutive d’une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale ou de la correspondance, la Cour estime qu’elle peut se justifier à la lumière du second paragraphe de l’article 8. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment de la nécessité de partager les postes téléphoniques entre l’ensemble des détenus (A.B. c. Pays-Bas, no 37328/97, §§ 92‑94, 29 janvier 2002, et Voyevodin et autres c. Russie (déc.), nos 6558/18 et 9 autres, § 18, 10 septembre 2019). La Cour constate par ailleurs en l’espèce que la limitation des appels téléphoniques est prévue à l’article 132 du règlement général des établissements pénitentiaires fixé par le décret-loi no 51/2011 du 11 avril 2011 (paragraphe 11 ci-dessus). Elle considère qu’eu égard à la nécessité d’assurer à tout détenu un accès au téléphone, la limitation du temps des communications téléphoniques quotidiennes n’est pas une mesure disproportionnée. Elle note également que dans son rapport susmentionné (paragraphe 17 ci-dessus), le CPT a considéré qu’un accès au téléphone pendant cinq minutes par jour était satisfaisant. Au surplus, la Cour observe que le requérant n’a pas indiqué avoir été empêché de communiquer avec sa famille par d’autres moyens (A.B. c. Pays-Bas, précité, § 92).
37. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant fondé sur l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
J.M.B. et autres c. France du 30 janvier 2020 requête n° 9671/15 et 31 autres
Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) : Les autorités françaises doivent mettre fin au problème de surpopulation dans les prisons et aux conditions de détention dégradantes
L'arrêt dans son ensemble au format pdf
La CEDH met sous contrôle la France au sens de l'article 46, pour que ses prisons soient humaines et non dégradantes. La CEDH exige qu'un organe judiciaire ait un pouvoir d'injonction sur l'administration pénitentiaire.
Les trente-deux affaires concernent les mauvaises conditions de détention dans les centres pénitentiaires de Ducos (Martinique), Faa’a Nuutania (Polynésie française), Baie-Mahault (Guadeloupe) ainsi que dans les maisons d’arrêt de Nîmes, Nice et Fresnes, prisons surpeuplées et l’effectivité des recours préventifs permettant aux détenus concernés d’y remédier. La Cour estime que les requérants ont, pour la majorité d’entre eux, disposé d’un espace personnel inférieur à la norme minimale requise de 3 m² pendant l’intégralité de leur détention, situation aggravée par l’absence d’intimité dans l’utilisation des toilettes. Pour les requérants qui ont disposé de plus de 3 m2 d’espace personnel, la Cour considère que les établissements dans lesquels ils ont été ou sont détenus n’offrent pas, de manière générale, des conditions de détention décentes ni une liberté de circulation et des activités hors des cellules suffisantes. La Cour a jugé en outre que les recours préventifs – le référé-liberté et le référé mesures utiles – sont ineffectifs en pratique. La Cour considère que le pouvoir d’injonction du juge administratif a une portée limitée. Malgré une évolution favorable de la jurisprudence, la surpopulation carcérale et la vétusté de certains établissements font obstacle à la possibilité, au moyen de ces recours offerts aux personnes détenues, de faire cesser pleinement et immédiatement des atteintes graves aux droits fondamentaux. Sous l’angle de l’article 46, la Cour constate que les taux d’occupation des prisons concernées révèlent l’existence d’un problème structurel. La Cour recommande à l’État défendeur d’envisager l’adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention, et établir un recours préventif effectif.
FAITS
Les trente-deux requérants dans cette affaire sont 29 ressortissants français, un ressortissant cap verdien, un ressortissant polonais et un ressortissant marocain nés entre 1945 et 1995.
Le Centre pénitentiaire de Ducos, situé à quatorze kilomètres de Fort de France, est le seul établissement pénitentiaire de la Martinique. Au 1 er janvier 2015, le taux d’occupation de cet établissement était de 213,7 % en quartier maison d’arrêt et de 124,6 % en quartier centre de détention. Au 1 er janvier 2019, il était de 134 % en maison d’arrêt et de 86,1 % en centre de détention. Une première phase de travaux a conduit à la réhabilitation et l’extension de certaines zones et à la construction d’un nouveau bâtiment. La capacité d’hébergement du centre a été accrue de 60 %. Une réorganisation des unités sanitaires est prévue. Les requérants se plaignent d’un manque d’espace personnel, celui-ci se réduisant en moyenne à moins de 3 m² par personne. Tous se plaignent de la proximité de la table à manger avec les toilettes, séparées du reste de la cellule par un rideau. Ils dénoncent l’insalubrité des cellules, infestées de rats, cafards, souris et fourmis, de la saleté des toilettes, du manque d’hygiène et d’aération. Certains requérants se plaignent d’un manque de lumière. D’autres craignent un climat de violence. Certains se plaignent de l’absence de soins ou de leur insuffisance. Tous affirment être enfermés entre quinze heures et vingt-deux heures par jour.
En juillet 2014, les requérants (à l’exception de deux d’entre eux) saisirent le tribunal administratif de la Martinique d’une action en responsabilité de l’Etat pour obtenir réparation du préjudice subi. Le tribunal administratif retint que les conditions de détention étaient dégradantes au sens de l’article 3 de la Convention et constitutives d’une faute. L’Etat fut condamné à verser aux plaignants des sommes comprises entre 2 880 euros (EUR) et 7 300 EUR en réparation.
Le centre de Faa’a-Nuutania en Polynésie française, d’une capacité d’accueil de 119 places, a été construit en 1970 sur l’île de Tahiti. Au 1 er septembre 2016, trois mois après que les requérants eurent saisi la Cour, le taux d’occupation du quartier maison d’arrêt était de 143 % et celui du centre de détention de 185,7 %. La construction d’un nouveau centre de détention a été achevée en mars 2017, pour accueillir 410 détenus et désengorger le centre de Faa’a-Nuutania, surpeuplé et matériellement très dégradé. Au moment de l’introduction de leur requête, les requérants partageaient des cellules de 8 à 12 m² avec trois codétenus, sanitaires et ameublement compris. En conséquence, chacun disposait d’un espace personnel de 2 à 3 m² par personne. Tous les requérants dénoncent la présence d’animaux nuisibles dans les cellules et les parties communes du centre. Tous se plaignent de la vétusté des locaux communs et des installations sanitaires, du manque d’hygiène à l’intérieur des cellules, des odeurs, de l’absence d’eau chaude et d’eau potable, des rations insuffisantes de nourriture. Ils dénoncent un climat de tension et de violence. Plusieurs affirment que les délais pour obtenir des soins médicaux sont déraisonnables. Un requérant se plaint que son courrier soit ouvert. Le Gouvernement indique que de nombreuses rénovations ont été mises en œuvre à l’intérieur du centre depuis 2013.
Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault, dans la périphérie de Pointe-à-Pitre, a été construit en 1996. Sa capacité théorique est de 503 places. En mars 2017, le taux de surpopulation était de 150 %. En janvier 2019, le taux d’occupation de la maison d’arrêt était de 189 % et celui du centre de détention de 89 %. Des travaux sont prévus pour l’année 2020. Le requérant indique qu’il partage sa cellule avec deux codétenus et qu’il dort sur un matelas posé à même le sol, à 80 cm des toilettes. Il dénonce le climat de tension et de violence et se plaint d’avoir été plusieurs fois agressé.
La maison d’arrêt de Nîmes, d’une capacité de 192 places, mise en service en 1974, est l’unique établissement pénitentiaire du Gard. Le taux de surpopulation y était de 215 % en février 2015. L’Observatoire international des prisons (OIP) et l’ordre des avocats au barreau de Nîmes initièrent en 2015, un recours en référé-liberté afin de faire cesser les atteintes graves aux libertés fondamentales des détenus. En janvier 2019, le taux de surpopulation était de 205 %. Les requérants se plaignent de la vétusté des cellules qu’ils doivent parfois partager avec des détenus très âgés dont ils doivent s’occuper. Ils se plaignent du bruit et des odeurs, de l’absence de ventilation et d’isolation thermique et du défaut d’hygiène. La maison d’arrêt de Nice a été construite à la fin du XIXe siècle. Le taux de surpopulation y est très élevé et la situation du quartier des femmes a été qualifiée à maintes reprises d’intolérable. Cette maison d’arrêt fait partie du programme immobilier pénitentiaire 2022-2027.
Enfin, la maison d’arrêt de Fresnes, d’une capacité de 1320 places, est intégrée au centre pénitentiaire de Fresnes ; elle a été construite en 1898 à la périphérie de Paris dans le Val-de-Marne. Le 1er novembre 2017, son taux de surpopulation était de 195,6 % et au 1 er janvier 2019, de 197 %.
Le 3 octobre 2016, l’OIP initia devant le tribunal administratif de Melun un recours en référé-liberté afin que soient notamment mises en place des mesures pour stopper la prolifération des nuisibles dans les bâtiments. Les requérants se plaignent d’avoir disposé dans leurs cellules d’un espace personnel inférieur à 3 m² jusqu’à 4 m². Ils indiquent être enfermés dans leurs cellules vingt-deux heures par jour. Ils se plaignent de la médiocrité des repas, du manque d’hygiène dans les cellules infestées de punaises de lit et de cafards et de la présence de rats dans les parties communes. Dénonçant un climat de tension et de violence, tous se plaignent de fouille à nu systématique à l’issue de chaque parloir.
DECISION DE LA CEDH
La Cour déclare recevable le grief des requérants tiré de leurs conditions de détention à l’exception de trois requérants qui n’étaient plus détenus au moment de l’introduction de leur requête et qui auraient dû engager un recours indemnitaire auprès des juridictions internes, et de deux requérants qui ont obtenu la reconnaissance du caractère indigne de leurs conditions de détention et le redressement de la violation alléguée de l’article 3. La Cour déclare également recevable le grief de tous les requérants tiré de l’absence de recours préventif effectif en droit interne.
Article 13
La Cour relève que les recours préconisés par le Gouvernement comme étant préventifs au sens de sa jurisprudence sont les recours en référé exercés devant le juge administratif. La Cour relève qu’à la faveur d’une évolution de la jurisprudence, la saisine du juge du référé-liberté a permis la mise en œuvre de mesures visant à remédier à des atteintes graves auxquelles sont exposées les personnes détenues, notamment en matière d’hygiène. Ce contexte jurisprudentiel est principalement dû aux recours engagés par l’Observatoire international des prisons en vue de la défense collective des détenus. Le référé-liberté est un recours disponible pour les détenus euxmêmes. La Cour constate que le juge du référé-liberté statue rapidement et conformément aux principes généraux énoncés dans sa jurisprudence sur le terrain de l’article 3. La question est de savoir si ce recours permet de mettre réellement fin à des conditions de détention contraires à la Convention.
En ce qui concerne l’effectivité du référé-liberté, premièrement, la Cour constate que le pouvoir d’injonction conféré à ce juge a une portée limitée. Il ne lui permet pas d’exiger la réalisation de travaux d’une ampleur suffisante pour mettre fin aux conséquences de la surpopulation carcérale. Il ne l’autorise pas à prendre des mesures de réorganisation du service public de la justice. Deuxièmement, la Cour note que le juge du référé-liberté fait dépendre son office du niveau des moyens de l’administration ainsi que des actes qu’elle a déjà engagés. Un directeur de prison est tenu d’accueillir les personnes mises sous écrou, y compris en cas de sur-occupation de l’établissement. La prise en compte des actes et des engagements de l’administration conduit le juge du référé-liberté à prescrire des mesures transitoires et peu contraignantes qui ne permettent pas de faire cesser rapidement des conditions de traitement inhumain ou dégradant. L’administration peut par ailleurs invoquer l’ampleur des travaux à réaliser ou bien leur coût pour faire obstacle au pouvoir d’injonction du juge. Troisièmement, la Cour observe que la mise en œuvre des injonctions connaît des délais qui ne sont pas conformes avec l’exigence d’un redressement diligent. On ne saurait attendre d’un détenu qui a obtenu une décision favorable qu’il multiplie les recours afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits fondamentaux au niveau de l’administration pénitentiaire. Enfin, indépendamment des procédures d’exécution, la Cour relève que les mesures exécutées ne produisent pas toujours les résultats escomptés. Finalement, les injonctions prononcées par le juge référé-liberté, dans la mesure où elles concernent des établissements pénitentiaires surpeuplés, s’avèrent en pratique difficiles à mettre en œuvre. La surpopulation des prisons et leur vétusté, a fortiori sur des territoires où n’existent que peu de prisons et où les transferts s’avèrent illusoires, font obstacle à ce que l’emploi du référé-liberté offre aux personnes détenues la possibilité de faire cesser pleinement et immédiatement les atteintes graves portées à l’article 3 ou d’y apporter une amélioration substantielle. La Cour conclut que le Gouvernement n’a pas démontré que le référé-liberté peut être considéré comme le recours préventif qu’exige la Cour. Il en va de même du référé mesures-utiles qui, outre son caractère subsidiaire par rapport au référé-liberté et le caractère limité du pouvoir du juge, se heurte aux mêmes obstacles pratiques. Les requérants – à l’exception d’un seul n’ayant pas présenté le grief – n’ont donc pas disposé d’un recours effectif. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.
Article 3
La Cour rappelle que, lorsque la description faite par les requérants des conditions de détention est crédible et raisonnablement détaillée, la charge de la preuve est transférée au gouvernement défendeur, seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou infirmer les allégations du requérant. Le gouvernement défendeur doit alors recueillir et produire les documents pertinents et fournir une description détaillée des conditions de détention du requérant. Dans son examen de l’affaire, la Cour tient également compte des informations émanant d’organes internationaux, par exemple le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), ou des autorités et institutions nationales compétentes. Dans les espèces examinées, la Cour constate que les informations communiquées par le Gouvernement sur la surface de l’espace personnel des requérants sont limitées, voire en certains cas inexistantes (détenus de Faa’a Nuutania, Baie-Malhault et Nice). D’autres informations sont incomplètes ne précisant pas toujours la superficie des cellules ni n’indiquant si les annexes sanitaires y sont ou non incluses. Seules celles communiquées à propos de la maison d’arrêt de Nîmes lui ont permis de déterminer de manière précise l’espace individuel des requérants et les périodes au cours desquelles ils ont disposé de cet espace. Dans ces conditions, la Cour estime donc que le Gouvernement n’a pas réfuté les allégations des requérants des centres pénitentiaires de Ducos, Faa’a Nuutania, Baie-Mahault, Nice et Fresnes (pour deux requérants dans ce dernier établissement), selon lesquelles ils auraient disposé de moins de 3 m² d’espace personnel pendant l’intégralité de leur détention. Ces allégations sont en outre corroborées par des informations procédant des autorités nationales comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), ou d’organes internationaux comme le CPT. La Cour observe que, pour l’ensemble des prisons concernées, le Gouvernement donne une explication sécuritaire à l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier des toilettes. Elle estime que cette justification n’est pas compatible avec l’exigence de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3, du fait des conditions de détention, à l’égard de tous les requérants dont le grief a été déclaré recevable. La Cour rejette pour non-épuisement des voies de recours internes le grief de M. Mixtur qui se plaint d’une violation de l’article 3 en raison des violences qu’il aurait subies à la prison de Baie-Mahault.
Article 8
Eu égard à son constat relatif à l’article 3, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu au surplus violation de l’article 8, en raison des conditions de détention des requérants. Quant au grief d’un requérant (R.I.) se plaignant de l’ouverture de certains de ses courriers, la Cour considère que ce grief n’est pas étayé et qu’il doit être rejeté en conséquence pour défaut manifeste de fondement.
Article 46
La Cour recommande à l’État défendeur d’envisager l’adoption de mesures générales. De telles mesures devraient être prises afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention. Cette mise en conformité devrait comporter la résorption définitive de la surpopulation carcérale. Ces mesures pourraient concerner la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires et l’amélioration du respect de cette capacité d’accueil. Par ailleurs, devrait être établi un recours préventif et effectif, combiné avec le recours indemnitaire, permettant aux détenus de redresser la situation dont ils sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée.
Article 41
La Cour dit que la France doit verser aux requérants des sommes comprises entre 4 000 et 25 000 euros (EUR) pour dommage moral.
Arrêt CEDH
Principes généraux
254. La Cour renvoie aux principes pertinents à appliquer pour l’examen des cas de surpopulation carcérale ainsi qu’à ceux concernant d’autres aspects des conditions matérielles de détention tels qu’ils se trouvent énoncés dans les arrêts Muršić et Rezmiveș et autres précités. Elle rappelle, pour les besoins des présentes affaires, ce qui suit.
255. La norme minimale pertinente en matière d’espace personnel est de 3 m², à l’exclusion de l’espace réservé aux installations sanitaires (Muršić, précité, §§ 110 et 114). Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², la Cour considère ce qui suit :
« 137. (...) le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (...).
138. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (...) ;
2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (...) ;
3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (...). » (idem, §§ 122 à 138).
256. Dans les affaires où le surpeuplement n’est pas important au point de soulever à lui seul un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour considère que d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En revanche lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, ce facteur, en lui-même, ne pose pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 139 et Rezmiveș et autres, précité, § 78).
257. Concernant les installations sanitaires et l’hygiène, la Cour rappelle que l’accès libre à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain, et que les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type d’installation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’une annexe sanitaire qui n’est que partiellement isolée par une cloison n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu. Par ailleurs, la présence d’animaux nuisibles tels que les cafards, rats, poux, punaises ou autres parasites doit être combattue par les autorités pénitentiaires par des moyens efficaces de désinfection, des produits d’entretien, des fumigations et des vérifications régulières des cellules, en particulier la vérification de l’état des draps et des endroits destinés au stockage de la nourriture (idem, § 79 et les références citées).
Application de ces principes dans les espèces examinées
a) Remarques liminaires tenant aux preuves, aux périodes de détention et à l’absence de cloisonnement des toilettes dans les cellules
258. La Cour rappelle d’emblée que lorsque la description faite par les requérants des conditions de détention supposément dégradantes est crédible et raisonnablement détaillée, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve d’un mauvais traitement, la charge de la preuve est transférée au gouvernement défendeur, qui est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant. Le gouvernement défendeur doit alors, notamment, recueillir et produire les documents pertinents et fournir une description détaillée des conditions de détention du requérant. La Cour tient aussi compte, dans son examen de l’affaire, des informations pertinentes à ce sujet émanant d’autres organes internationaux, par exemple du CPT, ou des autorités et institutions nationales compétentes (Muršić, précité, § 128, Utvenko et Borisov c. Russie, nos 45767/09 et 40452/10, § 144, 5 février 2019).
259. Dans les espèces examinées, la Cour note que le Gouvernement a produit des informations sur la fin de la détention des requérants ou sur la date de leur fin de peine. En revanche, elle constate que la précision des informations communiquées par le Gouvernement sur l’espace personnel des requérants est limitée. Celles-ci sont parfois inexistantes, comme c’est le cas pour les détenus de Faa’a-Nuutania, Baie-Mahault et Nice. Pour d’autres, elles sont incomplètes car elles ne précisent pas toujours la superficie des cellules et n’indiquent pas si les annexes sanitaires sont comprises dans ces superficies. Enfin, les informations ne sont pas toujours étayées par un document écrit tel qu’un historique de codétention. La Cour a relevé ces insuffisances probatoires dans les requêtes concernant les prisons de Ducos et de Fresnes.
De plus, la Cour n’a pas pu connaître précisément la superficie de la partie sanitaire des cellules, à l’exception de celles de la MA de Nîmes, ce qui a rendu difficile le calcul de l’espace personnel des requérants lorsqu’elle a disposé d’informations sur la superficie totale de la cellule. Elle a alors présumé qu’un tel espace se situait entre 1 et 2 m2.
Finalement, seules les données communiquées par le Gouvernement quant à la superficie des cellules de la MA de Nîmes, bien qu’incomplètes pour deux d’entre elles (paragraphes 76 et 78 ci-dessus), ont permis à la Cour de déterminer de manière précise l’espace individuel alloué aux requérants concernés et les périodes au cours desquelles ils ont disposé de cet espace (paragraphes 271 et suivants ci-dessous).
260. Dans ces conditions, et alors qu’il admet la situation de surpeuplement de l’ensemble des prisons concernées, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas réfuté de façon convaincante les allégations des requérants des CP de Ducos, Faa’a-Nuutania, Baie-Malhaut, Nice et Fresnes (s’agissant de R.M. et A.T. pour ce dernier établissement) selon lesquelles ils auraient disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel pendant l’intégralité de leur détention (paragraphes 29, 49, 59, 92 et 113 ci-dessus). Ces allégations sont en outre corroborées par les informations pertinentes des autorités nationales comme le CGLPL ou d’organes internationaux comme le CPT.
261. La Cour observe enfin que pour l’ensemble des prisons concernées, le Gouvernement donne une explication sécuritaire à l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier des toilettes. Cette justification n’est pas compatible avec les exigences de la protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées (paragraphe 257 ci-dessus). Le cloisonnement partiel des WC constitue donc, en tout état de cause, un facteur aggravant du manque d’espace dont les requérants ont pu souffrir.
b) Les détenus du CP de Ducos
262. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).
263. Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des requérants du CP de Ducos ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3.
264. La Cour prend note de l’information selon laquelle des travaux d’amélioration, dont la construction de cent soixante nouvelles places livrées à la fin de l’année 2016, ont contribué à réduire le taux d’occupation de la prison (paragraphe 14 ci‑dessus). Toutefois, ce seul fait ne modifie pas substantiellement la situation des requérants toujours détenus (paragraphes 20 à 24 ci-dessus), compte tenu des informations dont elle dispose sur les conditions de détention indécentes, de façon générale, au sein du CP de Ducos. La Cour se réfère à cet égard au constat le plus récent du CGLPL (paragraphe 13 ci-dessus) qu’aucune information n’est venue contredire.
c) Les détenus du CP de Faa’a-Nuutania
265. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).
266. Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des requérants du CP de Faa’a-Nuutania ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3.
267. La Cour note que la construction d’un nouveau CD situé à Tahiti, livré en 2017, ne modifie pas substantiellement la situation des requérants toujours détenus (paragraphes 44 et 45 ci-dessus) compte tenu de l’absence d’amélioration des conditions de détention au sein du CP de Faa’a-Nuutania (paragraphe 40 ci-dessus).
d) M. Mixtur
268. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel du requérant par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).
269. Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention du requérant ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3.
270. La Cour note que la rénovation du CP de Baie-Mahault débutera en 2020 et elle en déduit que le requérant se trouve toujours détenu dans les conditions de détention dénoncées au moment de l’introduction de la requête.
e) Les détenus de Nîmes
271. La Cour observe que les requérants contestent la détermination faite par le Gouvernement de leur espace personnel. Leur récit concorde avec les constats du CGLPL, du juge des référés et du CPT (paragraphes 70, 72 et 152 ci-dessus), à savoir que les détenus sont souvent à trois dans des cellules de 9 m2 conçues pour deux personnes. Cela étant, la Cour n’a pas de raison de douter de l’authenticité des documents communiqués à la Cour par le Gouvernement. Elle examinera donc les périodes de détention selon les données communiquées par ce dernier.
F.R.
272. Pendant sa détention, F.R. a séjourné dans des cellules où il s’est vu attribuer un espace personnel entre 2,48 m2 et 3,72 m2.
Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2
273. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé de 2,48 m2 sont les suivantes : du 11 septembre 2013 au 9 mai 2014 (sept mois et vingt‑sept jours), du 26 mai 2014 au 8 septembre 2014 (trois mois et quatorze jours), du 22 septembre au 1er octobre 2014 (dix jours), du 17 décembre 2014 au 5 mai 2015 (quatre mois et dix-sept jours).
274. Compte tenu de ces périodes et des principes pertinents énoncés dans sa jurisprudence (paragraphe 255 ci-dessus), la Cour conclut qu’il y a en l’espèce une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Il lui faut donc vérifier s’il existe des facteurs propres à réfuter cette présomption.
275. À l’exception de la période de dix jours, la Cour note que les périodes pendant lesquelles le requérant a vu son espace personnel réduit à une surface inférieure à 3 m2 étaient longues et répétées (comparer avec Muršić, précité, §§ 151-152 où une période de vingt-sept jours n’a pas permis de réfuter la présomption). Cette circonstance suffit à la Cour pour conclure que pour ces périodes, la forte présomption de l’article 3 de la Convention ne peut être remise en cause.
276. La période du 22 septembre au 1er octobre 2014 n’ayant duré que dix jours, peut être considérée comme courte. Toutefois, resituée parmi les autres phases d’extrême restriction d’espace, elle ne peut être qualifiée d’occasionnelle. Au surplus, la Cour doit tenir compte des autres éléments pertinents, à savoir le caractère suffisant ou non de la liberté de circulation et des activités hors cellules ainsi que les conditions générales de détention du requérant. Il incombe au Gouvernement de prouver la présence de tels éléments.
Pour ce qui est de la liberté de circulation et des activités hors cellules, la Cour note que les déclarations du Gouvernement ne sont pas très détaillées car elles indiquent la participation des requérants à certaines activités sportives et culturelles mais non leurs fréquences. Ces activités semblent au demeurant très ponctuelles. Il apparaît en tout état de cause que les conditions dont se plaint le requérant sur ce point sont corroborées par les constats du CGLPL et du CPT qui concluent à l’insuffisance des activités (paragraphes 72, 151 et 152 ci-dessus). Pour ce qui est de la promenade dans les cours, le requérant n’en conteste pas la durée indiquée par le Gouvernement. Cela étant, les craintes qu’il fait valoir quant à la sécurité des promenades sont soulignées par le CGLPL dans son rapport de 2012 et attestent d’un problème qui, s’il semble résolu maintenant avec la création d’une cour de promenade réservée aux personnes vulnérables (paragraphe 72 ci-dessus), était bien réel. Dans ce contexte, la Cour est d’avis que l’on ne peut considérer que la liberté de circuler hors des cellules et les possibilités de s’occuper offertes à la MA de Nîmes constituent des éléments atténuant les inconvénients liés au manque d’espace personnel.
Pour ce qui est du point de savoir si les conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu à la MA de Nîmes étaient généralement décentes, la Cour note que les déclarations du Gouvernement ne sont pas très détaillées ni corroborées par des éléments de preuves suffisants, en particulier par des photos. Seules des photos de la nouvelle salle de musculation, du parloir et de la cour de promenade ont été jointes à ses déclarations selon lesquelles les conditions de détention à la MA ne dépassent pas le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention. Au surplus, ces déclarations ne correspondent pas à certains des constats faits par le juge du référé, le CGLPL et le CPT (paragraphes 70, 72 et 152 ci-dessus) qui corroborent davantage les affirmations des requérants (paragraphe 79 ci‑dessus). La Cour rappelle à cet égard que le juge administratif a, par exemple, enjoint à l’administration de prendre des mesures pour améliorer les conditions matérielles d’installation des détenus durant la nuit au motif que les détenus dormaient souvent au sol, sur un matelas. Il a également demandé que l’accès aux produits d’entretien des cellules ainsi qu’à des draps et des couvertures propres soit amélioré (paragraphe 70 ci-dessus). De même, le CGLPL a souligné en 2012, comme en 2016, la vétusté des locaux de la MA ainsi que l’insuffisance des conditions d’hygiène, indiquant notamment que les espaces de douche étaient dégradés par l’humidité et l’absence d’aération (paragraphe 72 ci‑dessus). Le CPT a par ailleurs qualifié les conditions de détention au sein de la MA d’extrêmement préoccupantes dans son rapport publié en 2017 (paragraphes 151 et 152 ci‑dessus) et a notamment formulé des critiques sur les conditions de vie dans les cellules, l’aération et les températures. Enfin, la Cour renvoie à ce qu’elle a dit sur le manque d’intimité aux toilettes (paragraphe 261 ci‑dessus). En conséquence, elle considère que les conditions de détention du requérant à la MA de Nîmes n’étaient pas de manière générale décentes.
277. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut, en ce qui concerne la période courte pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel, que le Gouvernement n’a pas réfuté la forte présomption de violation de l’article 3 car l’intéressé a disposé d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule insuffisantes et qu’il était détenu dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions indécentes. En conséquence, la Cour estime que les conditions de détention du requérant pendant les périodes où il a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel
278. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel se situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 23 juillet au 11 septembre 2013 (un mois et dix-neuf jours – 3,72 m2), du 9 au 26 mai 2014 (dix-huit jours – 3,72 m2), du 8 au 22 septembre 2014 (quinze jours – 3,72 m2), du 1er octobre au 22 novembre 2014 (un mois et vingt-et-un jours – 3,72 m2).
279. La Cour note qu’il ressort du paragraphe précédent que le requérant a disposé pendant plusieurs périodes non consécutives d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² – de 3,72 m² exactement.
280. La Cour rappelle que lorsqu’un détenu dispose d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m2, le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturelle, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (Muršić, précité, § 139).
281. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus relativement à la période courte où le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel (paragraphe 276 ci‑dessus), la Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé pendant les périodes où il a disposé de 3 à 4 m² d’espace personnel sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
E.A.
282. E.A. a séjourné dans des cellules où il s’est vu attribuer un espace personnel se situant entre de 2,48 m2 et 3,72 m2.
Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2
283. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m2 sont les suivantes : du 14 au 21 novembre 2014 (huit jours – 2,48 m2), du 17 décembre 2014 au 15 février 2015 (un mois et vingt-neuf jours – 2,48 m2), du 4 au 12 septembre 2014 (neuf jours – 2,74 m2) et du 13 au 19 septembre 2014 (sept jours – 2,74 m2).
Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel
284. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel se situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 28 août au 5 septembre 2014 (huit jours – 3,72 m2), du 12 au 13 septembre 2014 (un jour – 3,29 m2), du 19 septembre au 14 novembre 2014 (vingt-cinq jours – 3,72 m2).
Conclusion
285. La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas du requérant F.R. pour les périodes de détention où le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel, y compris lorsque ces périodes ont été courtes, et pour les périodes où il a disposé de 3 à 4 m2. Elle rappelle en outre qu’elle ne dispose pas de données chiffrées pour la fin de la période de détention du requérant (paragraphe 76 ci-dessus) et présume que son espace personnel est resté le même jusqu’à la fin de sa détention compte tenu notamment de ses allégations (paragraphe 240 ci-dessus) et des constats du CGLPL sur l’insuffisance de l’espace attribué aux personnes détenues à la MA de Nîmes (paragraphe 72 ci-dessus).
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé ont été constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues.
A.M.
286. A.M. a séjourné dans de nombreuses cellules où il s’est vu attribuer un espace personnel se situant entre 2,74 m2 et 16,45 m2.
La période pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m2
287. A.M. a séjourné dans une cellule de moins de 3 m2 du 17 juin au 25 juillet 2013 (un mois et sept jours).
Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel
288. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel se situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 16 juillet au 8 août 2012 (vingt-trois jours – 3,72 m2), du 27 mars au 14 juin 2013 (deux mois et dix-huit jours – 3,72 m2), du 14 au 17 juin 2013 (trois jours – 3,29 m2) du 12 décembre 2013 au 15 juin 2016 (deux ans, six mois et trois jours – 3,72 m2).
Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de plus de 4 m2 d’espace personnel
289. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel supérieur à 4 m2 sont les suivantes : du 10 au 16 juillet 2012 (sept jours – 7,45 m2 ), du 8 août au 5 septembre 2012 (vingt-huit jours – 16,45 m2), du 5 septembre 2012 au 27 mars 2013 (six mois et 20 jours – 7,45 m2), du 30 octobre au 11 décembre 2013 (un mois et onze jours – 8,22 m2), du 11 au 12 décembre 2013 (un jour – 5,48 m2).
Conclusion
290. La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas des requérants F.R. et E.A. pour les périodes de détention où le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel, y compris en cas de période courte, et pour les périodes où il a disposé de 3 à 4 m2. S’agissant des périodes où le requérant a disposé de plus de 4 m2 d’espace personnel, elle considère que les aspects des conditions de détention rappelés au paragraphe 276 ci-dessus sont pertinents pour conclure au caractère dégradant des conditions de détention du requérant au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 140).
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention d’A.M. sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues. Elle note, alors que l’intéressé est toujours détenu, que le taux d’occupation de la MA de Nîmes reste très élevé (paragraphe 74 ci-dessus).
H.H.
291. H.H. a séjourné dans de nombreuses cellules où il s’est vu attribuer un espace personnel se situant entre 2,74 m2 et 8,22 m2. Les informations données par le Gouvernement vont jusqu’au 5 février 2015. Il a été transféré le 17 novembre 2015.
Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3m2
292. H.H. a disposé d’un espace personnel de 2,74 m2 au cours des périodes suivantes : du 15 janvier au 7 février 2014 (vingt-trois jours), du 10 au 12 février 2014 (trois jours), du 14 au 26 février 2014 (trois jours), du 5 mars au 12 août 2014 (cinq mois et huit jours), du 13 au 21 août 2014 (neuf jours), du 22 août au 12 septembre 2014 (vingt et un jours), du 15 septembre au 14 octobre 2014 (vingt-neuf jours), du 22 octobre au 9 décembre 2014 (un mois et dix-sept jours), du 10 au 11 décembre 2014 (deux jours) et du 19 décembre 2014 au 5 février 2015 (un mois et dix‑sept jours).
Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel
293. H.H. a disposé d’un espace personnel de 3,29 m2 au cours des périodes suivantes : du 6 au 7 novembre 2011 (trois jours), du 8 au 26 novembre 2011 (dix-neuf jours), du 8 au 15 janvier 2014 (huit jours), du 7 au 10 février 2014 (quatre jours), du 12 au 14 février 2014 (trois jours), du 26 février au 5 mars 2014 (sept jours), du 12 au 13 août 2014 (deux jours), du 21 au 22 aout 2014 (deux jours), du 12 au 15 septembre 2014 (quatre jours), du 14 au 16 octobre 2014 (trois jours), du 9 au 10 décembre 2014 (deux jours), du 11 au 19 décembre 2014 (neuf jours).
H.H. a par ailleurs disposé d’un espace personnel de 3,72 m2 du 23 au 27 mai 2013 (cinq jours).
Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de plus de 4 m2 d’espace personnel
294. H.H. a disposé d’un espace personnel supérieur à 4 m2 au cours des périodes suivantes : du 27 au 29 mai 2013 (trois jours – 7,45 m2), du 29 mai au 23 août 2013 (deux mois et vingt-cinq jours – 4,11 m2), du 23 août au 9 octobre 2013 (un mois et seize jours – 5,48 m2), du 9 au 19 octobre 2013 (onze jours – 8,22 m2), du 19 octobre au 6 novembre 2013 (dix-huit jours – 5,48 m2), du 7 au 8 novembre 2013 (deux jours – 4,11 m2), du 26 novembre 2013 au 8 janvier 2014 (un mois et douze jours – 4,11 m2), du 16 au 22 octobre 2014 (sept jours – 4,11 m2).
Conclusion
295. La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas du requérant A.M. (paragraphes 287 à 290 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé ont été constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues.
f) Les détenues de la MA de Nice
296. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel des requérantes par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).
297. Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des requérantes ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3.
298. La Cour note, s’agissant des requérantes toujours détenues (paragraphes 87 et 88 ci-dessus), que la situation de l’établissement a été jugée très préoccupante par le CGLPL et le ministre de la Justice et que les travaux de rénovation de la MA de Nice ne débuteront qu’en 2022 (paragraphes 83 à 86 ci-dessus).
g) Les détenus de Fresnes
299. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, et s’agissant de la détention de R.M. et A.T., la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de contestation de cette réfutation, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).
300. En ce qui concerne A.B.A., la Cour a retenu qu’il a disposé d’un espace personnel d’environ 4 m2 (paragraphe 113 ci-dessus). Dans ses observations, le Gouvernement indique que l’espace personnel d’A.B.A. n’est pas inférieur à 3 m2 (paragraphe 250 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y a lieu de considérer que le requérant a disposé d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m2 tout au long de sa détention.
Le Gouvernement indique encore que les promenades et la possibilité de faire du sport sont suffisantes pour considérer que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention n’est pas atteint. Eu égard aux constats du juge du référé, du CGLPL et du CPT qui observent et décrivent les conditions de détention très dégradées au sein de la MA de Fresnes (paragraphes 106, 108, 151 et 152 ci-dessus), la Cour ne partage pas ce point de vue. Elle note en effet qu’il ressort de leurs décisions et rapports que la MA de Fresnes, vétuste en raison de son ancienneté et du manque de rénovation, est confrontée de façon récurrente à la présence de nuisibles, et notamment de punaises dans les lits des détenus, et que ces derniers souffrent du manque de luminosité et de l’humidité dans les cellules (idem). Elle relève également que si la durée des promenades dans les cours de la prison n’est pas contestée par les requérants, c’est l’état de ces lieux qui est en cause : dans ses recommandations en urgence publiées en décembre 2016, le CGLPL a indiqué que les cours étaient exiguës (vingt‑cinq personnes dans 45 m2) et dépourvues d’abris et de toilettes et que les rats y évoluaient en masse (paragraphe 106 ci-dessus). La Cour ne dispose pas d’information sur l’état actuel de ces cours mais la description qu’en font les requérants détenus à Fresnes au moment de l’introduction de leur requête en 2017 correspond à celle qui a été faite par le CGLPL en 2016 (paragraphe 106 ci‑dessus) et au constat du juge interne en 2018 qui a considéré que les conditions dans lesquelles se déroulent les promenades sont attentatoires à la dignité des personnes détenues (paragraphe 109 ci‑dessus).
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention de A.B.A. ont été constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
301. En conclusion, la Cour juge que les trois requérants ont été et sont soumis à des conditions de détention qui leur ont fait subir une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et qui sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3. S’agissant du requérant toujours détenu, R.M., (paragraphe 111 ci‑dessus), la Cour note que le taux d’occupation de la MA de Fresnes reste très élevé (paragraphes 104 et 193 ci-dessus).
h) Conclusion
302. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de tous les requérants dont le grief a été déclaré recevable.
Petrescu c. Portugal du 3 décembre 2019 requête n° 23190/17
Violation article 3 : Mauvaises conditions de détention dans les prisons portugaises : la Cour recommande à l’État d’adopter des mesures générales pour y remédier
Plusieurs violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des conditions de détention dans deux établissements pénitentiaires au Portugal entre 2012 et 2016. Au vu des conditions de détention de M. Petrescu dans les prisons de la police judiciaire (PJ) de Lisbonne et de Pinheiro da Cruz, la Cour juge que ce dernier a subi un traitement dégradant durant 376 jours non consécutifs ainsi que des traitements inhumains et dégradants pendant plusieurs périodes de 385, 36 et 18 jours. La Cour recommande à l’État portugais d’envisager l’adoption de mesures générales. D’une part, des mesures devraient être prises pour que les détenus puissent bénéficier de conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention. D’autre part, un recours devrait être ouvert pour empêcher la continuation d’une violation alléguée ou pour permettre aux détenus d’obtenir une amélioration de leurs conditions de détention.
LES FAITS
Le requérant, Daniel Andrei Petrescu, est un ressortissant roumain né en 1987. Il réside actuellement en Roumanie. En 2012, M. Petrescu fut arrêté et placé en détention à la prison de la PJ de Lisbonne en vue de purger une peine d’emprisonnement de sept ans à laquelle il avait été condamné pour vol et association de malfaiteurs. Il y fut détenu entre le 9 mars 2012 et le 17 octobre 2014, date de son transfert à la prison de Pinheiro da Cruz qu’il quitta le 19 décembre 2016. Dans sa requête, M. Petrescu se plaignait en particulier de ses conditions de détention, notamment de la surpopulation carcérale, du manque d’hygiène et de chauffage, ainsi que de l’insalubrité des lieux.
1. Sur la recevabilité M. Petrescu n’a entrepris aucune démarche administrative ou juridictionnelle au niveau national pour se plaindre de ses conditions de détention. Le Gouvernement invite donc la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne les recours préventifs, la Cour estime que le droit interne n’offrait aucun recours suffisamment accessible et effectif pour empêcher la continuation de la violation alléguée ou pour obtenir une amélioration des conditions de détention de M. Petrescu, pour les raisons suivantes. Premièrement, une réclamation, une plainte ou un exposé auprès du directeur de la prison, du Directeur général des services pénitentiaires ou de l’Inspection générale des services pénitentiaires ne constitue pas un recours effectif car ces instances ne disposent pas de l’indépendance exigée pour statuer en la matière puisqu’elles relèvent directement de l’administration pénitentiaire. Deuxièmement, le Gouvernement prétend que M. Petrescu aurait pu saisir les juridictions administratives et le juge de l’exécution des peines afin qu’ils ordonnent l’amélioration des conditions de détention. Il ne présente toutefois aucune preuve quant à l’effectivité de pareils recours. Par ailleurs, au vu des nombreux rapports nationaux et internationaux montrant qu’un problème structurel de surpeuplement carcéral existait au moment des faits et touche encore aujourd’hui la moitié des établissements pénitentiaires, il apparaît que ce problème ne concerne pas uniquement M. Petrescu. Ainsi, même si ces tribunaux rendaient une décision favorable, l’administration pénitentiaire aurait des difficultés à l’exécuter. Troisièmement, le Médiateur ne rend pas de décisions contraignantes. Il ne formule que des recommandations et le Gouvernement ne démontre que ces recommandations auraient pu permettre d’améliorer rapidement les conditions de détention dénoncées. En ce qui concerne les recours indemnitaires invoqués par le Gouvernement, ce dernier ne présente aucun exemple pertinent. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’est pas possible de conclure avec un degré de certitude suffisant que le droit portugais offrait à M. Petrescu un recours préventif et/ou indemnitaire concernant ses conditions de détention.
2. Sur le fond Durant son séjour à la prison de la PJ de Lisbonne, M. Petrescu a subi : - un traitement dégradant pendant 376 jours non consécutifs durant lesquels il fut détenu dans différentes cellules collectives lui offrant un espace personnel inférieur à 3 m2 ;
- des traitements inhumains et dégradants pendant 385 jours non consécutifs au cours desquels il fut détenu dans des cellules où il disposait d’un espace personnel entre 3m2 et 4m2 . Ces cellules étaient en outre dépourvues de chauffage et disposaient d’une annexe sanitaire partiellement isolée par une cloison, ce qui est inacceptable lorsqu’il y a plusieurs détenus. L’intéressé ne s’est pas non plus vu proposer de travail ni d’activité éducative, culturelle ou sportive pendant cette période. - des traitements inhumains et dégradants pendant 36 jours durant lesquels il a partagé une cellule avec un autre détenu alors que les installations sanitaires n’étaient que partiellement séparées du reste de la pièce par une cloison à hauteur d’homme.
Durant son séjour à la prison de Pinheiro da Cruz, M. Petrescu a subi un traitement inhumain et dégradant pendant 18 jours où il fut détenu dans une cellule dans laquelle il ne disposait que d’un espace personnel de 1,79 m2 et où les installations sanitaires n’étaient à nouveau que partiellement séparées du reste de la pièce par une cloison à hauteur d’homme. Par conséquent, la Cour recommande à l’État portugais d’envisager l’adoption de mesures générales. D’une part, des mesures devraient être prises pour que les détenus puissent bénéficier de conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention. D’autre part, un recours devrait être ouvert pour empêcher la continuation d’une violation alléguée ou pour permettre aux détenus d’obtenir une amélioration de leurs conditions de détention.
CEDH
RECEVABILITE
b) Appréciation de la Cour
i. Principes applicables
74. La Cour renvoie aux principes établis dans sa jurisprudence, tels qu’énoncés aux paragraphes 69 à 77 de l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC] nos 17153/11 et 29 autres, 25 mars 2014) et rappelés dans l’arrêt Varga et autres c. Hongrie (nos 14097/12 et 5 autres, §§ 44-47, 10 mars 2015) et plus récemment dans l’arrêt Nikitin et autres c. Estonie (nos 23226/16 et 6 autres, §§ 119-121, 29 janvier 2019).
75. En ce qui concerne l’appréciation de l’effectivité des recours relatifs aux conditions de détention, la question décisive est de savoir si la personne intéressée peut obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, et pas simplement une protection indirecte de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. La Cour a certes accepté le principe selon lequel un recours indemnitaire était suffisant dans les affaires portant sur la durée de procédures judiciaires ou la non-exécution de jugements (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 187, CEDH 2006‑V et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 99, CEDH 2009), mais elle a estimé qu’en ce qui concerne les allégations de conditions d’internement ou de détention contraires à l’article 3, un recours exclusivement en réparation ne saurait être considéré comme suffisant, dans la mesure où il n’a pas un effet « préventif » en ce sens qu’il n’est pas à même d’empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre aux détenus d’obtenir une amélioration de leurs conditions matérielles de détention (Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et 6 autres, § 50, 8 janvier 2013, voir aussi les nombreuses références qui y sont citées). Pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent donc coexister de façon complémentaire (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012). Lorsqu’un requérant est détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention, le meilleur redressement possible est la cessation rapide de la violation du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Si, en revanche, le requérant a quitté l’établissement pénitentiaire où il allègue avoir subi une détention portant atteinte à sa dignité, il doit pouvoir obtenir une réparation pour la violation subie (Ananyev et autres, précité, § 97).
76. L’« instance » évoquée à l’article 13 de la Convention peut ne pas être forcément, dans tous les cas, une institution judiciaire au sens strict. La Cour a déjà estimé qu’un recours introduit devant une autorité administrative peut satisfaire aux exigences de cette disposition en ce qui concerne les griefs relatifs aux conditions de détention (Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 111, 22 octobre 2009). Néanmoins, les pouvoirs de cette instance et les garanties procédurales qu’elle offre entrent en ligne de compte aux fins de l’appréciation de l’effectivité du recours (voir Torreggiani et autres, précité, § 51).
77. Par exemple, pour qu’un recours préventif introduit devant une instance administrative en vue de dénoncer des conditions de détention soit effectif, l’instance en question doit :
a) être indépendante des autorités pénitentiaires,
b) s’assurer de la participation effective des détenus à l’examen de leurs griefs,
c) veiller au traitement rapide et diligent des griefs,
d) disposer d’une large gamme d’instruments juridiques permettant de mettre fin aux problèmes à l’origine des griefs,
e) être propre à rendre des décisions contraignantes et exécutoires (Ananyev et autres, précité, §§ 214-16 et 219).
f) permettre un redressement dans un délai raisonnable (Torreggiani et autres, précité, § 97).
78. Par ailleurs, pour qu’un recours interne visant à dénoncer des conditions de détention soit effectif, l’autorité ou la juridiction saisie doit statuer conformément aux principes pertinents énoncés dans la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 3 de la Convention. La réalité de la situation – et non les apparences – étant ce qui importe, le seul fait de renvoyer à cet article dans les décisions internes ne suffit pas : l’affaire doit avoir été effectivement examinée conformément aux normes découlant de la jurisprudence de la Cour (voir la jurisprudence citée dans Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, §§ 185-187, 27 janvier 2015). Si elle constate, expressément ou en substance, une violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions dans lesquelles l’intéressé est ou a été détenu, l’autorité ou la juridiction interne saisie doit accorder un redressement approprié (idem, § 188). En ce qui concerne les recours préventifs, ce redressement peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné, soit – lorsqu’il y a surpopulation – en des mesures plus générales propres à résoudre les problèmes de violations massives et simultanées des droits des détenus résultant des mauvaises conditions de détention dans tel ou tel établissement pénitentiaire (Ananyev et autres, précité, § 219).
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
79. À titre liminaire, la Cour relève que, au moment de l’introduction de la requête devant la Cour, le requérant n’était plus détenu.
80. Elle constate que le requérant n’a entrepris aucune démarche administrative ou juridictionnelle pour se plaindre de ses conditions matérielles de détention. Pour déterminer si les exigences d’épuisement des voies de recours internes ont été respectées, il convient donc d’examiner tous les recours évoqués par le Gouvernement afin de vérifier s’ils étaient adéquats, effectifs et de nature à permettre un redressement direct et approprié des conditions dénoncées par le requérant.
α) Voies de recours préventives
81. Premièrement, le Gouvernement affirme qu’en vertu de l’article 116 du CEP (paragraphe 70 ci-dessus), le requérant aurait pu déposer une réclamation, une plainte ou un exposé auprès du directeur de la prison en cause, du Directeur général des services pénitentiaires ou de l’Inspection générale des services pénitentiaires. La Cour estime toutefois que les instances en question ne disposaient pas de l’indépendance exigée pour statuer en la matière étant donné qu’elles relevaient directement de l’administration pénitentiaire (Ananyev et autres, précité, § 215). À cet égard, elle note d’ailleurs que selon le dernier rapport du CPT, les détenus n’ont de manière générale pas confiance dans le système de dépôt de plainte mis en place au sein du système pénitentiaire (paragraphe 54 ci-dessus). Elle en conclut que ce recours ne constituait pas un recours effectif propre à remédier à la violation alléguée de l’article 3 de la Convention.
82. Deuxièmement, le Gouvernement considère que le requérant aurait pu saisir les juridictions administratives et le juge de l’exécution des peines (paragraphes 71 et 72) afin qu’ils ordonnent à l’administration fiscale d’améliorer ses conditions de détention. La Cour observe qu’en vertu de l’article 4 du statut des tribunaux administratifs, il appartient aux tribunaux administratifs de statuer sur tout litige relatif aux droits fondamentaux. Par ailleurs, le CPTA dispose, en ses articles 2 § 2 o) et 109 § 1, que les tribunaux administratifs peuvent émettre des injonctions visant à protéger les droits, libertés et garanties de toute personne (paragraphes 28, 29 et 30 ci-dessus). En vertu de l’article 115 de la loi sur l’organisation du système judiciaire, les tribunaux de l’exécution des peines ont quant à eux compétence pour garantir les droits des détenus, en se prononçant sur la légalité des décisions rendues par l’administration pénitentiaire (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour observe cependant que le Gouvernement n’apporte aucune preuve de l’effectivité de pareils recours. Elle note que les décisions du tribunal des conflits auxquelles il renvoie (paragraphe 72 ci-dessus) portaient non pas sur des questions de fond relatives aux conditions de détention, mais sur des transferts de détenus vers d’autres établissements pénitentiaires qui, en l’occurrence, avaient été ordonnés pour des raisons de sécurité par l’administration pénitentiaire (paragraphes 42, 43 et 44 ci‑dessus). En outre, au vu des nombreux rapports nationaux et internationaux montrant qu’un problème structurel de surpeuplement carcéral existait au moment des faits et touche encore aujourd’hui la moitié des établissements pénitentiaires (paragraphes 37, 50 et 53 ci-dessus), il apparaît que ce problème ne concerne pas uniquement le requérant. Par conséquent, quand bien même ces tribunaux rendraient une décision favorable, l’administration pénitentiaire pourrait avoir des difficultés à l’exécuter (Ananyev et autres, précité, § 111, Torreggiani et autres, précité, § 54, Vasilescu c. Belgique, no 64682/12, § 73, 25 novembre 2014, Neshkov et autres, précité, § 210, et Varga et autres, précité, § 63). Par conséquent, la Cour ne peut que conclure que ces recours n’étaient pas effectifs pour redresser la violation alléguée de l’article 3 de la Convention.
83. Troisièmement, en ce qui concerne le Médiateur (paragraphe 70 ci‑dessus), la Cour loue son intervention en tant que mécanisme national de prévention (paragraphe 37 ci-dessus). Cela étant, elle observe relativement à la question de l’effectivité des recours qu’il ne peut pas rendre de décisions contraignantes (paragraphe 34 ci-dessus) et qu’il a le pouvoir non pas de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration mais uniquement de formuler des recommandations (Mandić et Jović c. Slovénie, nos 5774/10 et 5985/10, § 117, 20 octobre 2011, Ananyev et autres, précité, §§ 105-106, et Mironovas et autres c. Lituanie, nos 40828/12 et 6 autres, §§ 107-109, 8 décembre 2015 ; voir, a contrario, Sakin c. Turquie (déc.), no 20616/13, § 33, 28 juin 2016). En outre, il n’a pas été démontré, en l’espèce, que les recommandations en question auraient pu permettre d’améliorer rapidement les conditions de détention dénoncées (Torreggiani et autres, précité, § 97). Les recours devant le Médiateur ne remplissent donc pas les conditions d’effectivité que requiert un recours préventif propre à permettre de dénoncer des conditions matérielles de détention.
84. Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que conclure que le droit interne n’offrait au requérant, lorsqu’il était détenu, aucun recours préventif suffisamment accessible et effectif pour empêcher la continuation de la violation alléguée ou pour obtenir une amélioration de ses conditions de détention (Torreggiani et autres, précité, § 50).
β) Voies de recours indemnitaires
85. Le Gouvernement soutient que l’introduction d’une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’État aurait pu permettre au requérant d’obtenir réparation du préjudice causé par ses mauvaises conditions de détention (paragraphe 72 ci-dessus).
86. La Cour constate que les articles 3 et 7 § 3 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007 imposent à l’État de réparer tout dommage causé, notamment par le dysfonctionnement d’un service public (paragraphe 32 ci-dessus). Or, alors qu’il lui appartenait de prouver l’effectivité des voies de recours avancées par lui (Varga et autres, précité, § 50), le Gouvernement n’a en l’espèce fait mention d’aucune jurisprudence ni d’aucune information tendant à prouver que cette voie de droit offrait un recours effectif pour se plaindre de conditions de détention contraires aux exigences de l’article 3 de la Convention (Benediktov c. Russie, no 106/02, § 29, 10 mai 2007 et Shishanov c. République de Moldova, no 11353/06, § 76, 15 septembre 2015 ; voir aussi, a contrario, Žirovnický c. République tchèque (déc.), nos 60439/12 et 73999/12, § 97, 15 novembre 2016).
87. En l’absence d’exemples pertinents, la Cour n’est pas en mesure de conclure que l’action en responsabilité civile extracontractuelle constituait un recours effectif relativement à la violation de l’article 3 alléguée en l’espèce.
d) Conclusion
88. Eu égard à ce qui précède, s’il est vrai que le requérant n’a fait usage d’aucun des recours suggérés par le Gouvernement, la Cour estime qu’en l’espèce, il n’est pas possible de conclure avec un degré de certitude suffisant que le droit portugais offrait au requérant un recours préventif et/ou indemnitaire concernant ses conditions de détention à la prison de la PJ de Lisbonne et à la prison de Pinheiro da Cruz. En conséquence, l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.
2. Le respect du délai de six mois
89. La Cour note que le requérant fut détenu à la prison de la PJ de Lisbonne du 9 mars 2012 au 17 octobre 2014, date à laquelle il fut transféré à la prison de Pinheiro da Cruz où il resta jusqu’à sa libération, le 19 décembre 2016. La requête ayant été introduite le 2 mai 2017, la question pourrait se poser de savoir si le délai de six mois a été respecté en ce qui concerne la première période de détention. En effet, la règle de six mois est une règle d’ordre public, la Cour est donc compétente pour l’appliquer d’office (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 160, CEDH 2004 II) même si le Gouvernement n’a pas soulevé cette exception (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000 I).
90. La Cour rappelle que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle opéré par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités de l’État la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus (Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 129, 19 décembre 2017).
91. En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. Toutefois, lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 76573/01, 2 juillet 2002).
92. En matière de conditions de détention concernant plusieurs lieux d’incarcération, la violation alléguée peut s’analyser en une « situation continue » si les caractéristiques principales des périodes de détention examinées sont essentiellement les mêmes. Dans le cas contraire, chaque durée de détention doit être traitée séparément et le grief correspondant à chacune de ces périodes doit être introduit devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle celle-ci a pris fin (Toncu c. République de Moldova (déc.), no 26710/08, § 33, 13 novembre 2014, et références citées ; voir également, Ananyev et autres, précité, § 78 et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 86, CEDH 2014 (extraits)).
93. En l’espèce, le requérant se plaint essentiellement du surpeuplement, de l’insalubrité, de l’absence de chauffage et du manque d’intimité autant à la prison de la PJ de Lisbonne qu’à la prison de Pinheiro da Cruz (paragraphe 95 ci-dessous) où il a purgé la peine à laquelle il avait été condamné par le tribunal de Lisbonne (paragraphe 7 ci-dessus). Or, il ressort du dossier qu’il n’y a pas eu de changement notable dans les conditions de détention du requérant après son transfert à la prison de Pinheiro da Cruz. Aux yeux de la Cour, les faits de l’espèce s’analysent donc en « une situation continue » justifiant un examen de la totalité de la période de détention dont se plaint le requérant (voir Haghilo c. Chypre, no 47920/12, §§ 147-150, 26 mars 2019 et a contrario, Maltabar et Maltabar c. Russie, no 6954/02, § 83, 29 janvier 2009, Ananyev et autres, précité, § 76 et Mitrokhin c. Russie, no 35648/04, § 38, 24 janvier 2012, ), d’autant plus que la période de détention globale concerne une seule et même peine d’emprisonnement (paragraphe 7 ci-dessus). Les griefs du requérant tirés des conditions de sa détention à la prison de la PJ de Lisbonne ne peuvent donc être considérés comme tardifs.
3. Conclusion
94. Constatant, par ailleurs, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
FOND
a) Rappel des principes
97. La Cour a réitéré les principes pertinents concernant la prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants et la protection des personnes privées de liberté contre des traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans l’arrêt Muršić (précité, §§ 96-100), et plus récemment dans l’arrêt Rezmiveș et autres c. Roumanie (nos 61467/12 et 3 autres, §§ 71‑73, 25 avril 2017).
98. En ce qui concerne les conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant. En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Ananyev et autres, précité, § 142, Torreggiani et autres, précité, § 66, Muršić, précité, § 101, et Rezmiveș et autres, précité, § 74).
99. Lorsque le surpeuplement atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (Torreggiani et autres, § 68). En effet, l’exiguïté extrême dans une cellule de prison est un aspect particulièrement important qui doit être pris en compte afin d’établir si les conditions de détention litigieuses étaient « dégradantes » au sens de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 104).
100. La Cour a confirmé que l’exigence de 3 m² de surface au sol par détenu (incluant l’espace occupé par les meubles, mais non celui occupé par les sanitaires) dans une cellule collective doit demeurer la norme minimale pertinente aux fins de l’appréciation des conditions de détention au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, §§ 110 et 114). Elle a également précisé qu’un espace personnel inférieur à 3 m² dans une cellule collective fait naître une présomption, forte mais non irréfutable, de violation de cette disposition. La présomption en question peut notamment être réfutée par les effets cumulés des autres aspects des conditions de détention, de nature à compenser de manière adéquate le manque d’espace personnel ; à cet égard, la Cour tient compte de facteurs tels que la durée et l’ampleur de la restriction, le degré de liberté de circulation et l’offre d’activités hors cellule, et le caractère généralement décent ou non des conditions de détention dans l’établissement en question (Muršić, précité, §§ 122-138, et Rezmiveș et autres, précité, § 77).
101. Les autres aspects concernant les conditions matérielles de détention ont été résumés dans l’arrêt Rezmiveș et autres (précité), comme suit :
« 78. En revanche, dans des affaires où le surpeuplement n’était pas important au point de soulever à lui seul un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base (voir également les éléments ressortant des règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres, citées au paragraphe 43 ci-dessus). Comme la Cour l’a précisé dans son arrêt Muršić (précité, § 139 ; voir également Khlaifia, précité, § 167), lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. Aussi, dans pareilles affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, telles qu’un manque de ventilation et de lumière (Torreggiani et autres, précité, § 69 ; voir également Moisseiev c. Russie, no 62936/00, §§ 124-127, 9 octobre 2008 ; Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008 ; et Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007), un accès limité à la promenade en plein air (István Gábor Kovács c. Hongrie, no 15707/10, § 26, 17 janvier 2012 ; Efremidze c. Grèce, no 33225/08, § 38, 21 juin 2011 ; Yevgeniy Alekseyenko c. Russie, no 41833/04, §§ 88-89, 27 janvier 2011 ; Gladkiy c. Russie, no 3242/03, § 69, 21 décembre 2010 ; Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, § 39, 29 octobre 2009 ; et Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, § 36, 2 juillet 2009) ou un manque total d’intimité dans les cellules (Szafransky c. Pologne, no 17249/12, §§ 39-41, 15 décembre 2015 ; Veniosov c. Ukraine, no 30634/05, § 36, 15 décembre 2011 ; Mustafayev c. Ukraine, no 36433/05, § 32, 13 octobre 2011 ; Belevitski c. Russie, no 72967/01, §§ 73-79, 1er mars 2007 ; Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 106-107, CEDH 2005-X (extraits) ; et Novosselov c. Russie, no 66460/01, §§ 32 et 40-43, 2 juin 2005).
79. Concernant les installations sanitaires et l’hygiène, la Cour rappelle que l’accès libre à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain, et que les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type d’installation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité (Ananyev et autres, précité, §§ 156 et 157 ; voir également les éléments ressortant des Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres, citées au paragraphe 43 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle qu’une annexe sanitaire qui n’est que partiellement isolée par une cloison n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu (Canali c. France, no 40119/09, § 52, 25 avril 2013), qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions d’hygiène en cellule (Vasilescu c. Belgique, no 64682/, § 103, 25 novembre 2014; Ananyev et autres, précité, §§ 156-159 ; Florea c. Roumanie, no 37186/03, § 59, 14 septembre 2010 ; Modarca c. Moldavie, no 14437/05, §§ 65-69, 10 mai 2007 ; et Kalachnikov, précité, §§ 98-103). Un autre aspect sanctionné par la Cour en matière d’hygiène est la présence de cafards, rats, poux, punaises ou autres parasites. Elle a rappelé que les autorités des centres de détention doivent combattre ce type d’infestation par des moyens efficaces de désinfection, des produits d’entretien, des fumigations et des vérifications régulières des cellules, en particulier la vérification de l’état des draps et des endroits destinés au stockage de la nourriture (Ananyev et autres, précité, § 159). »
b) Application de ces principes au cas d’espèce
i. Prison de la PJ de Lisbonne
102. À titre liminaire, la Cour constate qu’au moment des faits, le Portugal connaissait une situation de surpeuplement carcéral, parfois extrême dans certains établissements pénitentiaires (paragraphe 50 ci-dessus).
103. Le requérant fut détenu à la prison de la PJ de Lisbonne du 9 mars 2012 au 17 octobre 2014, soit deux ans, sept mois, et neuf jours. Il ressort des rapports statistiques de la DGRS que la prison était occupée par 134 détenus en 2012, 122 détenus en 2013 et 140 en 2014. Prévue pour 116 détenus, la prison était donc bien en situation de surpeuplement pendant la période au cours de laquelle le requérant y était détenu (paragraphes 38 et 39 ci-dessus). La raison pour laquelle le requérant a toujours occupé une cellule collective à la prison de la PJ de Lisbonne n’a pas été précisée par les parties. La Cour observe toutefois que l’article 26 du CEP prévoit que les détenus soient détenus en cellule individuelle, sauf en cas de risque physique ou psychologique, pour des raisons de sécurité ou en cas d’insuffisance du nombre de cellules disponibles (paragraphe 26 ci-dessus).
104. En ce qui concerne le requérant, il ressort des informations communiquées par le Gouvernement, non contestées par le requérant, que celui-ci a occupé diverses cellules collectives. L’espace personnel qui lui était alloué dans chacune d’elles (sur ce point, voir les précisions figurant dans l’arrêt Muršić, précité, § 114) est indiqué ci-dessous :
- Du 9 mars 2012 au 13 mars 2012 (4 jours), 2,05 m² ;
- Le 14 mars 2012, 2,3 m² ;
- Du 15 mars 2012 au 12 juillet 2012 (116 jours), 3,7 m² ;
- Du 13 juillet 2012 au 19 août 2012 (36 jours), 4,6 m² ;
- Du 20 août 2012 au 24 juin 2013 (304 jours), 2,3 m² ;
- Du 25 juin 2013 au 2 septembre 2013 (67 jours), 2,78 m² ;
- Du 3 septembre 2013 au 5 février 2014 (153 jours), 3,7 m² ;
- Du 6 févier 2014 au 17 octobre 2014 (250 jours), 3,7 m² (paragraphe 11 ci-dessus).
105. La Cour déduit de ces informations que lors de ses séjours en cellule collective, le requérant a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² pendant 376 jours non consécutifs, d’un espace personnel compris entre 3 m² et 4 m² pendant 385 jours non consécutifs, et d’un espace personnel supérieur à 4 m² pendant trente-six jours. Eu égard à la jurisprudence de la Cour citée ci-dessus, il convient de se pencher sur ces trois périodes de détention distinctes, à savoir la période au cours de laquelle le requérant disposait d’un espace personnel inférieur à 3 m², celle au cours de laquelle il disposait d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², et celle au cours de laquelle il disposait d’un espace personnel supérieur à 4 m².
α) Période au cours de laquelle le requérant disposait d’un espace personnel inférieur à 3 m²
106. Dans la mesure où le requérant a été détenu pendant 376 jours non consécutifs, soit une longue période, dans différentes cellules collectives offrant un espace personnel inférieur à 3 m², il existe en l’espèce une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention, ne pouvant, en l’espèce, être remise en cause (comparer avec Muršić, précité, § 153, Nikitin et autres, précité §§ 173, 178, 188). La Cour juge donc que le requérant a subi une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et dès lors constitutive d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention.
β) Période au cours de laquelle le requérant disposait d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m²
107. En ce qui concerne la période de 385 jours non consécutifs au cours de laquelle le requérant disposait d’un espace personnel compris entre 3 m² et 4 m², la Cour observe d’emblée qu’il s’agit d’une longue période. Il reste à déterminer s’il existait des facteurs propres à compenser le manque d’espace personnel constaté (voir Muršić, précité, § 138).
108. Tout d’abord, le Gouvernement allègue que les détenus de la prison de la PJ de Lisbonne étaient libres de circuler librement et se détendre dans la cour extérieure entre 9 heures et 11 h 45 et entre 14 heures et 17 h 30, soit pendant six heures et quinze minutes (paragraphes 15 et 96 ci-dessus). Certes, ce temps n’est pas négligeable. Cependant, il ressort du rapport rédigé par le CPT à la suite de sa dernière visite au Portugal que la prison de la PJ de Lisbonne ne proposait aucun travail ni aucune activité éducative, sportive ou culturelle, et que les détenus passaient donc leur temps à regarder la télévision, à jouer à des jeux ou à marcher dans la cour (paragraphes 51 et 52 ci-dessus). Cette circonstance est inacceptable en l’espèce étant donné que le requérant a été détenu dans cet établissement pénitentiaire pendant plus de deux ans et sept mois, soit une très longue période.
109. Ensuite, la Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas l’absence de chauffage et qu’il estime toujours cette considération dénuée d’importance compte tenu du climat à Lisbonne. La Cour ne partage pas cet avis. Elle considère qu’une température basse peut contribuer à un certain inconfort, voire à une détresse. Il ressort en outre des informations figurant dans les rapports publiés par l’IPMA en 2018 et 2016 que la température moyenne au Portugal a oscillé entre 15 oC et 16 oC entre 2014 et 2016, et qu’elle était de 10,9 oC entre décembre 2015 et février 2016 et de 13,11 oC entre mars et mai 2016 (paragraphes 46 et 47 ci-dessus). Ces relevés montrent que le climat peut parfois être froid.
110. Enfin, en ce qui concerne les installations sanitaires (paragraphe 12 ci-dessus), la Cour rappelle qu’une annexe sanitaire qui n’est que partiellement isolée par une cloison n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu (Canali c. France, no 40119/09, § 103, 25 avril 2013; comparer avec Janusz Wojciechowski c. Pologne, no 54511/11, § 56, 28 juin 2016).
111. Les observations qui précèdent suffisent pour considérer que le requérant a subi des traitements inhumains et dégradants pendant cette période de 385 jours de détention. Ceci dispense la Cour d’examiner les allégations d’insalubrité et de manque de luminosité soulevées par le requérant concernant les cellules de la prison de la PJ de Lisbonne.
γ) Période au cours de laquelle le requérant disposait de plus de 4 m² d’espace personnel
112. Pendant trente-six jours, le requérant a partagé avec un autre détenu une cellule offrant 4,6 m² d’espace personnel. Si cet aspect des conditions matérielles de détention du requérant ne soulève pas de problème, la Cour doit néanmoins se pencher sur les autres normes pertinentes découlant des rapports généraux du CPT pour apprécier le caractère adéquat des conditions de détention de l’intéressé au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 140). La Cour observe à nouveau que les installations sanitaires de cette cellule n’étaient que partiellement séparées du reste de la pièce par une cloison à hauteur d’homme (paragraphe 17 ci-dessus), ce qui, comme indiqué précédemment (paragraphe 110 ci-dessus), est inacceptable. Cet élément à lui seul est suffisant pour conclure que, même s’il disposait d’un espace personnel supérieur à 4 m² pendant ces trente-six jours, le requérant a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention.
ii. Conditions de détention à la prison de Pinheiro da Cruz
113. La Cour relève que le requérant a été transféré à la prison de Pinheiro da Cruz le 17 octobre 20014 et qu’il y est resté jusqu’à sa libération le 19 décembre 2016, soit deux ans, deux mois et six jours.
114. Pendant cette période, il n’apparaît pas que la prison ait été surpeuplée (paragraphes 40 et 41 ci-dessus).
En ce qui concerne le requérant, la Cour constate que pendant une période de dix-huit jours ‑ du 17 octobre 2014 au 5 novembre 2014 ‑, il a partagé avec un autre détenu une cellule offrant un espace personnel de 1,79 m².
Il a passé le reste de son séjour, soit plus d’un an, dans une cellule individuelle de 3,58 m² (paragraphe 16 ci-dessus). Cette période ne soulevant aux yeux de la Cour aucun problème au regard de l’article 3 de la Convention étant donné qu’il s’agissait d’une cellule individuelle, il convient d’examiner uniquement la première période de détention à la prison de Pinheiro da Cruz.
115. Ainsi que la Cour vient de le relever, le requérant a passé dix-huit jours dans une cellule dans laquelle il disposait d’un espace personnel de 1,79 m². Aucun des facteurs invoqués par le Gouvernement (paragraphes 20, 21, 22 et 23 ci-dessus) ne saurait compenser l’exiguïté de cet espace personnel, d’autant que les installations sanitaires n’étaient, à nouveau, que partiellement séparées du reste de la pièce par une cloison à hauteur d’homme (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour ne peut qu’en déduire que lors de son séjour à l’établissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz, le requérant a été victime pendant la période comprise entre le 17 octobre 2014 et le 5 novembre 2014 d’un traitement dégradant et inhumain contraire à l’article 3 de la Convention.
iii. Conclusion
116. Au vu des constations qui précèdent, la Cour conclut, en ce qui concerne le séjour du requérant à la prison de la PJ de Lisbonne, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pendant la période de 376 jours, non consécutifs, au cours de laquelle l’intéressé disposait d’un espace personnel inférieur à 3 m² (paragraphe 106 ci-dessus), pendant la période de 385 jours, non consécutifs, au cours de laquelle il disposait d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² (paragraphe 111 ci-dessus) et pendant la période de trente-six jours (entre le 13 juillet 2012 et le 19 août 2012) au cours de laquelle il disposait d’un espace personnel supérieur à 4 m² (paragraphe 112 ci-dessus) et, en ce qui concerne son séjour de la prison de Pinheiro da Cruz, pendant la période de dix-huit jours (entre le 17 octobre 2014 et le 5 novembre 2014) au cours de laquelle il était détenu en cellule collective et disposait d’un espace personnel inférieur à 3 m² (paragraphe 115 ci-dessus).
117. Dans ce contexte, la Cour recommande à l’État défendeur d’envisager l’adoption de mesures générales. D’une part, des mesures devraient être prises afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention. D’autre part, un recours devrait être ouvert aux détenus aux fins d’empêcher la continuation d’une violation alléguée ou de permettre à l’intéressé d’obtenir une amélioration de ses conditions de détention (voir, à ce propos, Torreggiani et autres, précité, § 50 et Vasilescu, précité, § 128).
SYLLA ET NOLLOMONT c. BELGIQUE du 16 mai 2017 requête 37768/13 et 36467/14
Violation de l'article 3 : Le premier requérant a un espace inférieur à trois mètres carrés dans sa cellule car ils étaient trois pour une cellule de 9 m2.
Le second requérant a un espace de 4 m2 qui est suffisant. En revanche, il subit un régime pauvre en activités extérieures à la cellule (1 heure par jour) et au sein de la cellule, de l’exposition au tabagisme passif ainsi que du manque d’intimité dans l’usage des toilettes.
A. En ce qui concerne M. Sylla
25. Bien que le requérant ait fait référence dans sa requête à la totalité de sa détention à la prison de Forest, la Cour constate que les conditions de détention dont il se plaint correspondent à celles qu’il a vécues quand il partageait entre le 5 novembre 2012 et le 24 janvier 2013 une cellule de 9 m2 avec deux autres détenus (voir paragraphe 5, ci-dessus). Il y a donc lieu de limiter la requête à cette période.
26. Durant cette période, le requérant disposait d’un espace au sol de 3 m².
27. La Cour rappelle que selon la méthode qu’elle applique pour calculer la surface minimale de l’espace personnel devant être alloué à un détenu hébergé en cellule collective, la surface totale de la cellule ne doit pas comprendre celle des sanitaires. En revanche, le calcul de la surface disponible dans la cellule doit inclure l’espace occupé par les meubles. L’important est de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule (Muršić, précité, § 114).
28. Appliquée en l’espèce, cette méthode amène la Cour à constater que le requérant bénéficiait d’un espace personnel inférieur à 3 m2.
29. La Cour rappelle les principes qu’elle a énoncés dans l’arrêt Muršić précité et qu’elle applique dans une telle situation :
« 137. Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (...).
138. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (...) ;
2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (...) ;
3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (...). »
30. En l’espèce, les autres conditions de détention dont se plaint le requérant sont les suivantes : l’accès à la cour de promenade était limité à une heure par jour, aucune autre activité hors cellule n’était prévue, l’accès aux douches était limité à deux fois par semaine et il était arrivé que l’eau était froide en raison de pannes, les vêtements, draps et serviettes n’étaient changés que toutes les trois semaines.
31. Les conditions dont se plaint le requérant (voir paragraphe 6, ci‑dessus) sont confirmées par le Gouvernement, lequel ne fait, par ailleurs, état d’aucun facteur qui ait pu atténuer de manière décisive l’inconfort provoqué par le manque d’espace individuel suffisant.
32. La Cour estime que le manque d’espace dont a disposé le requérant combiné à l’absence d’activités hors cellule suffit pour considérer que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention est atteint.
33. Partant, la Cour conclut à une violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne M. Sylla.
34. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les autres aspects des conditions de détention mis en cause par le requérant.
B. En ce qui concerne S. Nollomont
35. En ce qui concerne la période de détention litigieuse, la Cour note que les conditions de détention dont S. Nollomont se plaint correspondent à celles qu’il a vécues dans la maison d’arrêt de l’établissement pénitentiaire de Lantin. Se référant à la fiche établie par l’administration pénitentiaire, elle constate que cette période a débuté le 24 février 2015 (voir paragraphe 7, ci-dessus).
36. Le requérant partage, à la maison d’arrêt de Lantin, une cellule de 8,8 m² avec un autre détenu. Il dispose donc d’un espace au sol de 4,4 m² (voir paragraphe 8, ci-dessus).
37. La Cour note que les parties n’ont pas fourni d’indications chiffrées permettant de déterminer avec précision l’espace personnel dont disposait le requérant si l’on déduit les installations sanitaires de la surface au sol. Cela étant, la Cour relève que le requérant ne se plaint pas non plus de la difficulté qu’il aurait de se mouvoir normalement dans sa cellule.
38. Partant, la Cour part de l’hypothèse que l’espace personnel dont dispose le requérant n’est, en tous les cas, pas inférieur à 4 m² et considère que cet aspect des conditions matérielles de détention ne pose pas de problème (Muršić, précité, § 140).
39. Cela étant, la Cour estime que les autres aspects des conditions matérielles demeurent pertinents pour apprécier le caractère adéquat des conditions de détention du requérant au regard de l’article 3 (ibidem).
40. Les autres conditions de détention dénoncées par le requérant ne sont pas contestées par le Gouvernement (voir paragraphe 9, ci-dessus). Ce dernier ne conteste pas davantage que le requérant soit régulièrement exposé au tabagisme passif et que les cellules ne soient pas équipées de détecteurs de fumée.
41. La Cour estime que du fait de la combinaison d’un régime pauvre en activités extérieures à la cellule, et au sein de la cellule, de l’exposition au tabagisme passif ainsi que du manque d’intimité dans l’usage des toilettes, le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention est atteint (voir Florea c. Roumanie, no 37186/03, §§ 57-62, 14 septembre 2010).
42. Partant, la Cour conclut à une violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne S. Nollomont.
REZMIVEȘ ET AUTRES c. ROUMANIE du 25 avril 2017 Requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13
Violation de l'article 3 pour cause de surpopulation carcérale, la CEDH constate que les décisions prises par l'État roumain de diminuer les condamnations à des peines de prison ferme, va dans le bon sens, pour réduire le nombre des détenus.
1. Principes généraux
102. La Cour rappelle que l’article 46 de la Convention interprété à la lumière de l’article 1 impose à l’État défendeur l’obligation légale de mettre en œuvre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou individuelles appropriées pour garantir le droit d’un requérant dont la Cour a constaté la violation. L’État doit également appliquer ces mesures à l’égard des autres personnes se trouvant dans la même situation que le requérant, l’objectif pour lui devant être de résoudre les problèmes qui ont conduit la Cour à son constat de violation (voir, parmi d’autres, Rutkowski et autres c. Pologne, nos 72287/10 et al., § 200, 7 juillet 2015 ; Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, § 142, CEDH 2014 ; Torreggiani et autres, précité, § 83 ; Broniowski c. Pologne, [GC], no 31443/96, §§ 192-193, CEDH 2004-V et les références qui y sont citées).
103. Afin de faciliter une mise en œuvre effective de ses arrêts, la Cour peut adopter une procédure d’arrêt pilote lui permettant de mettre clairement en lumière l’existence de problèmes structurels à l’origine des violations et d’indiquer à l’État défendeur des mesures pour y remédier (voir la Résolution Res(2004)3 relative aux arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent, adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 2004, et Broniowski, précité, §§ 189-194). Cette démarche judiciaire est toutefois suivie dans le respect des rôles respectifs des organes de la Convention : il appartient au Comité des Ministres d’évaluer la mise en œuvre des mesures individuelles et générales en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention (Rutkowski et autres, précité, § 201, et les références qui y sont citées).
104. Un autre but important de la procédure d’arrêt pilote est d’inciter l’État défendeur à trouver, au niveau national, une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même problème structurel, donnant ainsi effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention. En effet, ce n’est pas en répétant les mêmes conclusions dans un grand nombre d’affaires que la Cour s’acquitte forcément au mieux de sa tâche, qui consiste selon l’article 19 de la Convention à « assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles » (Rutkowski et autres, précité, § 202, et Varga et autres c. Hongrie (nos 14097/12 et al., § 96, 10 mars 2015).
105. La procédure de l’arrêt pilote a pour but de faciliter le redressement le plus rapide et le plus efficace des dysfonctionnements qui affectent la protection des droits conventionnels en cause dans l’ordre juridique interne. Si elle doit tendre principalement au règlement de pareils dysfonctionnements et à la mise en place, le cas échéant, de recours internes effectifs permettant de dénoncer les violations commises, l’action des États défendeurs peut aussi comprendre l’adoption de solutions ad hoc telles que des règlements amiables avec les requérants ou des offres unilatérales d’indemnisation, en conformité avec les exigences de la Convention (Rutkowski et autres, précité, § 202 ; Varga et autres, précité, § 97 ; et Torreggiani et autres, précité, § 86). La Cour peut donc décider d’ajourner l’examen de toutes les affaires similaires, donnant ainsi aux États défendeurs une possibilité de les régler selon ces diverses modalités. Si toutefois l’État défendeur n’adopte pas ces mesures à la suite de l’arrêt pilote et s’il persiste à méconnaître la Convention, la Cour n’a d’autre choix que de reprendre l’examen de toutes les requêtes similaires portées devant elle et de statuer sur celles-ci afin de garantir le respect effectif de la Convention (Ališić et autres, précité, § 143).
2. Application de ces principes en l’espèce
a) Sur l’existence d’une situation incompatible avec la Convention appelant l’application de la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce
106. La Cour souligne que les premiers constats de violation de l’article 3 de la Convention à raison de conditions de détention inadéquates dans certaines prisons en Roumanie datent de 2007-2008 (Bragadireanu, précité, et Petrea, précité) et que, depuis l’adoption de ces arrêts, leur nombre n’a cessé de croître. On compte en effet 93 arrêts de violation entre 2007 et 2012. La plupart des affaires concernaient, comme les présentes espèces, le surpeuplement carcéral et différents autres aspects récurrents des conditions matérielles de détention (mauvaise hygiène, ventilation et éclairage insuffisants, installations sanitaires non fonctionnelles, nourriture insuffisante ou inadéquate, accès limité aux douches, présence de rats, cafards, poux, etc.).
107. Eu égard à l’afflux important de requêtes portant sur le même sujet, la Cour a estimé nécessaire de s’adresser, en 2012, aux autorités roumaines en vertu de l’article 46 de la Convention. L’existence et l’ampleur du problème structurel identifié par la Cour dans l’affaire Iacov Stanciu (précité) a justifié l’indication de mesures générales visant à améliorer les conditions matérielles dans les prisons roumaines, mesures combinées avec un système adéquat et efficace de voies de recours internes, préventifs et compensatoires, afin d’assurer le plein respect des articles 3 et 46 de la Convention (Iacov Stanciu, précité, §§ 195-199).
108. Parallèlement, le Comité des Ministres a évalué, à deux reprises, les mesures générales adoptées par les autorités roumaines en réponse aux constats par la Cour, et ses conclusions n’ont fait que confirmer une situation préoccupante dans la grande majorité des dépôts de la police et des prisons, qui continuaient à être gravement surpeuplés et dont les conditions matérielles étaient précaires. Selon le comité des Ministres, des mesures additionnelles étaient nécessaires pour mettre en place un système adéquat et efficace de voies de recours (paragraphe 47 ci‑dessus). La réalité de la situation est aussi confirmée par les derniers rapports du CPT, qui soulignent l’importance du problème lié au surpeuplement dans les établissements pénitentiaires roumains. Les mêmes rapports considèrent les dépôts de la police comme inadéquats pour des détentions prolongées, car généralement surpeuplés, dépourvus d’accès direct à des toilettes, mal ventilés et souffrant d’un manque d’hygiène. Quant aux établissements pénitentiaires, le CPT a constaté que le surpeuplement persistait dans les prisons roumaines, que certaines d’entre elles souffraient de mauvaises conditions d’hygiène, d’un éclairage et d’une ventilation insuffisants, d’installations sanitaires non fonctionnelles, d’une nourriture inadéquate ainsi que d’activités socioculturelles insuffisantes (paragraphes 52‑54 ci‑dessus). Tous ces constats sont également confirmés par les recommandations de l’avocat du peuple, qui, après avoir visité certaines prisons, a demandé aux autorités pénitentiaires de mettre un terme au surpeuplement, aux mauvaises conditions d’hygiène, à l’absence de cantine, à la présence de rats, souris et punaises, à l’absence de cloison pour les toilettes, et leur a également demandé de fournir de l’eau potable et un mobilier suffisant et de permettre l’accès à des douches en état de fonctionnement (paragraphes 39-40 ci-dessus).
109. Plus de quatre ans après l’identification du problème structurel, la Cour procède à l’examen des présentes affaires après avoir déjà conclu, dans 150 arrêts, à la violation de l’article 3 de la Convention à raison du surpeuplement et des conditions matérielles inadéquates dans plusieurs prisons et dépôts de la police roumains. Le nombre des constats de violation de la Convention à ce titre n’a cessé de croître. La Cour note que, en août 2016, 3 200 requêtes similaires étaient pendantes devant elle et qu’elles pourraient donner lieu à l’avenir à de nouveaux arrêts concluant à la violation de la Convention. La persistance de déficiences structurelles majeures causant des violations répétées de la Convention est non seulement un facteur aggravant quant à la responsabilité de l’État au regard de la Convention à raison d’une situation passée ou actuelle, mais également une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif de contrôle mis en place par la Convention (voir, mutatis mutandis, Broniowski, précité, § 193).
110. La Cour note que la situation des requérants ne peut pas être dissociée du problème général qui tire son origine d’un dysfonctionnement structurel propre au système carcéral roumain, qui a touché et est susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes. Malgré les mesures législatives, administratives et budgétaires adoptées au niveau interne, le caractère structurel du problème identifié en 2012 persiste et la situation constatée est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention (voir, mutatis mutandis, Torreggiani et autres, précité, § 88).
111. Au regard de cette situation, la Cour estime que les présentes affaires se prêtent à l’application de la procédure de l’arrêt pilote (voir, mutatis mutandis, Varga et autres, précité, § 100 ; Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et al., § 271, 27 janvier 2015 ; Torreggiani et autres, précité, § 90 ; et Ananyev et autres, précité, § 190).
b) Mesures à caractère général
112. La Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère essentiellement déclaratoire et qu’il appartient en principe à l’État défendeur de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII). Toutefois, cela n’empêche pas la Cour de suggérer, à titre purement indicatif, le type de mesures que l’État roumain pourrait prendre pour mettre un terme à la situation structurelle constatée (voir, mutatis mutandis, Ananyev et autres, précité, § 195).
113. Elle observe que l’État roumain a récemment pris des mesures susceptibles de contribuer à réduire le phénomène de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et les conséquences de celle-ci. Elle se félicite des démarches accomplies par les autorités nationales et ne peut qu’encourager l’État roumain à poursuivre dans cette voie. Néanmoins, il convient de constater que, malgré les efforts entrepris, le taux d’occupation des prisons roumaines reste très élevé, situation qui confirme les constats établis par l’avocat du peuple, le Comité des Ministres et le CPT (paragraphes 39-40, 46 et 54, ci-dessus).
114. Aux yeux de la Cour, des mesures générales de deux types devraient être mises en place pour remédier au problème structurel constaté dans le présent arrêt.
i. Mesures visant à diminuer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention
115. Ainsi qu’il ressort des données officielles publiées par l’ANP, le taux d’occupation de l’ensemble des établissements pénitentiaires roumains varie entre 149,11 % et 154,36 % (paragraphe 37 ci-dessus). À cet égard, il convient de rappeler que la majorité des arrêts les plus récents concernent des requérants qui purgent leur peine dans un espace vital de moins de 3 m², voire, pour certains d’entre eux, de moins de 2 m². Or la Cour rappelle que, lorsque l’État n’est pas en mesure de garantir à chaque détenu des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention, elle l’encourage à agir de manière à réduire le nombre des personnes incarcérées, notamment en appliquant davantage des mesures punitives non privatives de liberté (Norbert Sikorski, précité, § 158) et en réduisant à son minimum le recours à la détention provisoire (voir, entre autres, Varga et autres, précité, § 104 ; Ananyev et autres, précité, § 197 ; et Orchowski c. Pologne, no 17885/04, § 150, 22 octobre 2009).
116. Certes, il n’appartient pas à la Cour d’indiquer aux États la manière dont ils doivent organiser leurs systèmes pénaux et pénitentiaires, car ces processus soulèvent des questions complexes d’ordre juridique et pratique qui dépassent sa fonction judiciaire (Torreggiani et autres, précité, § 95). Néanmoins, la Cour renvoie aux recommandations émises par le CPT, aux évaluations effectuées par le Comité des Ministres et aux recommandations présentées dans le Livre blanc sur le surpeuplement carcéral, qui identifient un certain nombre de solutions possibles pour combattre le surpeuplement et les conditions matérielles inadéquates de détention (voir, respectivement, les paragraphes 49 et 54, 42, 46 et 57 ci-dessus).
117. En matière de détention avant condamnation, la Cour note d’abord que les dépôts attachés aux commissariats de police ont été considérés par le CPT et par le Comité des Ministres comme « structurellement inadaptés » pour des détentions dépassant quelques jours (paragraphes 44, 46, 52 et 54 ci-dessus). De plus, la Cour rappelle avoir déjà jugé que ces locaux étaient des lieux destinés à accueillir des personnes pour de très courtes durées (voir notamment sa jurisprudence citée au paragraphe 80 ci-dessus). Eu égard à ces constats, les autorités internes doivent s’assurer que les prévenus soient transférés dans une prison à l’issue de leur garde à vue. La Cour note que la réforme implémentée par le Gouvernement a eu pour effet une certaine réduction de l’effectif de la population placée en détention provisoire (paragraphe 92 ci‑dessus). Elle se félicite des démarches accomplies et encourage l’État roumain de s’assurer de la continuité de cette réforme et d’explorer également la possibilité de faciliter l’utilisation d’un plus grand recours aux mesures alternatives à la détention provisoire (paragraphes 42 et 92 ci‑dessus).
118. Pour ce qui est de la détention après condamnation, la Cour prend note avec intérêt de la reforme amorcée par le Gouvernement, qui se concentre, entre autres sur la réduction des limites des peines pour certaines infractions, sur l’amende pénale en tant qu’alternative à la peine à prison, sur la renonciation à une peine et l’ajournement de l’application d’une peine, ainsi que sur les effets positifs du système de probation (paragraphe 92 ci-dessus). Bien que les effets immédiats de cette réforme ne se fassent pas ressentir de manière significative au niveau du taux de surpeuplement, qui continue d’être assez élevé (paragraphe 37 ci-dessus), pareille mesures, doublées d’une diversification des peines alternatives à la détention (voir paragraphes 46 et 57 ci-dessus) pourraient avoir un impact positif sur la réduction du nombre des personnes incarcérées. D’autres pistes à explorer, tels que l’assouplissement des conditions de la renonciation à l’application d’une peine, de l’ajournement du prononcé d’une peine (paragraphe 32 ci‑dessus), et surtout l’élargissement des possibilités d’accès à la liberté conditionnelle (paragraphes 31 et 42 ci‑dessus), ainsi qu’un fonctionnement efficace du service de probation (voir paragraphe 97 ci-dessus), pourraient constituer des sources d’inspiration pour le gouvernement défendeur afin de résoudre le problème de l’accroissement de la population carcérale et des conditions matérielles inadéquates de détention.
119. Par ailleurs, la Cour note que la nouvelle stratégie du Gouvernement prévoit également des investissements en vue de la création de places de détention supplémentaires (paragraphe 94 et 97 ci-dessus). Bien que cette initiative démontre la volonté des autorités de trouver une solution au problème du surpeuplement carcéral, la Cour rappelle la Recommandation Rec(99)22 du Comité des Ministres selon laquelle cette mesure n’est pas, en principe, propre à offrir une solution durable pour remédier ce problème (paragraphe 42 ci-dessus). De plus, compte tenu des conditions matérielles et d’hygiène très précaires dans les prisons roumaines, des fonds devraient continuer à être également consacrés à des travaux de rénovation des lieux de détention existants.
120. La Cour laisse à l’État défendeur le soin de faire, sous le contrôle du Comité des Ministres, les démarches concrètes qu’il estimera nécessaires pour atteindre les buts recherchés par les indications ci-dessus et compatibles avec les conclusions contenues dans le présent arrêt.
ii. Voies de recours
121. En ce qui concerne la ou les voies de recours internes à adopter pour faire face au problème systémique reconnu dans les présentes affaires, la Cour rappelle que, en matière de conditions de détention, les remèdes « préventifs » et ceux de nature « compensatoire » doivent coexister de manière complémentaire. Ainsi, lorsqu’un requérant est détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention, le meilleur redressement possible est la cessation rapide de la violation du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. De plus, toute personne victime de conditions de détention portant atteinte à sa dignité doit pouvoir obtenir une réparation pour la violation subie (Ananyev et autres, précité, §§ 97-98 et 210-231 ; et Benediktov c. Russie, no 106/02, § 29, 10 mai 2007).
122. Comme la Cour l’a déjà dit dans l’arrêt Iacov Stanciu (précité, §§ 197-198), l’État défendeur doit mettre en place un recours préventif, permettant au juge de surveillance de l’exécution et aux tribunaux de mettre fin à la situation contraire à l’article 3 de la Convention et d’octroyer une indemnisation si un tel constat a été fait.
123. S’agissant des recours préventifs, la Cour observe avec intérêt que les exemples fournis par le Gouvernement (paragraphe 96 ci-dessus) attestent que les tribunaux internes analysent les situations de surpeuplement dénoncées par certains détenus et est consciente des efforts conséquents et soutenus des autorités pour assurer le respect de la norme interne établissant l’espace vital pour chaque détenu. La Cour reconnait cette évolution importante que les tribunaux internes opèrent récemment dans leur jurisprudence, mais constate, en revanche, qu’il est difficile d’imaginer la possibilité effective pour les détenus bénéficiant d’une décision favorable d’obtenir le redressement de leur situation, sans que les conditions de détention dans les prisons roumaines, décrites aux paragraphes 106 et108 ci-dessus, ne connaissent pas une amélioration.
124. Quant aux recours compensatoires, la Cour note avec satisfaction que certains tribunaux analysent les différents aspects visant les conditions matérielles de détention et indemnisent à ce titre certains détenus (paragraphe 96 ci-dessus). Cependant, elle constate qu’en droit roumain la responsabilité délictuelle est un régime qui est fondé sur la responsabilité subjective et qui repose donc sur la faute de l’auteur du dommage (paragraphe 36 ci-dessus). Or, en matière de mauvaises conditions de détention, la Cour rappelle que la charge de la preuve, qui incombe aux justiciables, ne doit pas peser un poids excessif. De plus, la Cour rappelle à ce sujet que les mauvaises conditions de détention ne sont pas nécessairement le résultat de défaillances imputables à l’administration pénitentiaire, mais qu’elles ont le plus souvent pour origine des facteurs plus complexes, comme des problèmes de politique pénale (Iacov Stanciu, précité, § 199). Même lorsque la possibilité d’obtenir une indemnité est prévue, une voie de recours peut ne pas offrir de chances raisonnables de succès, notamment lorsque l’octroi d’une indemnisation est conditionné à l’établissement d’une faute de la part des autorités (Ananyev et autres, précité, § 113 ; Roman Karasev c. Russie, no 30251/03, §§ 81‑85, 25 novembre 2010 ; et Shilbergs c. Russie, no 20075/03, §§ 71-79, 17 décembre 2009). Dès lors, les exemples fournis par le Gouvernement ne démontrent pas avec la certitude voulue l’existence d’un recours compensatoire effectif en la matière.
125. La Cour encourage l’État roumain à mettre en place un recours compensatoire spécifique, susceptible de permettre d’obtenir une indemnisation adéquate pour toute violation de la Convention s’étant déjà produite en raison d’un espace vital insuffisant et/ou des conditions matérielles précaires. Dans ce contexte, la Cour note avec intérêt l’initiative législative concernant la remise de peine (paragraphe 41 ci-dessus), qui peut constituer un redressement adéquat en cas de mauvaises conditions matérielles de détention à condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de l’article 3 de la Convention et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (Stella et autres c. Italie (déc.), nos 49169/09 et al., §§ 59‑60, 16 septembre 2014). Enfin, la Cour note qu’un recours compensatoire vient d’être implémenté par les autorités hongroises, à la suite de l’arrêt Varga et autres (précité).
126. À cet égard, compte tenu de l’importance et de l’urgence du problème identifié et de la nature fondamentale des droits en question, la Cour considère qu’un délai raisonnable pour la mise en œuvre des mesures à caractère général est nécessaire. Toutefois, elle considère qu’il n’incombe pas à la Cour, à ce stade, d’établir un tel délai, le Comité des Ministres étant mieux placé pour ce faire. Cela étant, la Cour conclut que le Gouvernement roumain doit fournir, en coopération avec le Comité des Ministres, dans les six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, un calendrier précis pour la mise en œuvre des mesures générales appropriées.
c) Procédure à suivre dans les affaires similaires
127. La Cour rappelle qu’elle peut se prononcer dans l’arrêt pilote sur la procédure à suivre dans l’examen de toutes les affaires similaires (voir également, mutatis mutandis, Torreggiani et autres, précité, § 100 ; Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, § 50, 22 décembre 2005 ; et Broniowski, précité, § 198).
128. La Cour décide, en attendant que les autorités internes adoptent, sous le contrôle du Comité des Ministres, des mesures nécessaires sur le plan national, d’ajourner l’examen des requêtes non communiquées ayant pour objet unique ou principal le surpeuplement carcéral et les mauvaises conditions de détention dans les prisons et les dépôts attachés aux commissariats de police en Roumanie. Elle précise qu’elle peut néanmoins à tout moment déclarer une requête de ce type irrecevable ou la rayer de son rôle en cas d’accord amiable entre les parties ou de règlement du litige par d’autres moyens, conformément aux articles 37 et 39 de la Convention. En revanche, s’agissant des requêtes déjà communiquées au gouvernement défendeur, la Cour pourra poursuivre leur examen (voir, mutatis mutandis, Torreggiani et autres, précité, § 101).
OPINION CONCORDANTE DU JUGE WOJTYCZEK
1. Le présent arrêt touche une question importante, qui fait actuellement l’objet de débats publics dans un certain nombre de pays et qui intéresse vivement l’opinion publique, à savoir la question du choix des politiques pénales.
2. Je note, dans ce contexte, que le mandat de la Cour a été défini de façon restrictive à l’article 19 de la Convention : « assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses Protocoles ». De plus, dans l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention les États parties se sont engagées à organiser des élections dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. La mise en œuvre de cet article suppose la création d’un parlement doté du pouvoir législatif et de la capacité d’effectuer des choix politiques exprimés dans les textes des lois. Il n’appartient pas à la Cour de s’immiscer dans la sphère politique, laquelle relève de la compétence exclusive des parlements et gouvernements nationaux. Ainsi, le choix de la politique pénale appartient aux parlements nationaux. Ceux-ci peuvent, en principe, opter soit pour une politique plus répressive, qui suppose un nombre plus important de places dans les prisons, soit pour une politique moins sévère, qui requiert un nombre moins important de places dans les établissements pénitentiaires.
Il faut rappeler, en même temps, que la sanction pénale, qu’elle soit privative de liberté ou non, constitue une ingérence cruciale dans la sphère de la liberté des personnes. Si l’ingérence touche le champ des droits protégés par la Convention, elle doit être proportionnée au poids des valeurs que celle-ci protège. Lorsqu’il limite les droits protégés par la Convention, l’État doit choisir les instruments qui sont les moins restrictifs pour ces droits.
D’un autre côté, la Convention peut exiger la mise en œuvre d’une législation pénale appropriée, capable de protéger efficacement les droits et les valeurs proclamés dans ce traité. Le défaut de sévérité d’une sanction pénale dans le cas de certains types de violations des droits de l’homme peut engager la responsabilité de l’État. Une ingérence insuffisante dans la liberté de l’homme peut ainsi constituer une violation de la Convention (voir, par exemple, Nikolova et Velichkova c. Bulgarie, no 7888/03, §§ 61‑62, 20 décembre 2007, Ali et Ayşe Duran c. Turquie (no 1 sur 4), no 42942/02, § 66, 8 avril 2008, et A. c. Croatie (no 1 sur 7), no 55164/08, §§ 66-67 et 78, 14 octobre 2010).
3. Je note que, dans un certain nombre d’arrêts concernant la surpopulation carcérale, la Cour a mis l’accent sur la liberté des États quant au choix des moyens pour résoudre ce problème et qu’elle a essayé de garder la neutralité dans les conflits concernant le choix des politiques pénales (voir, par exemple, Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013, et Neshkov c. Bulgarie, nos 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 et 9717/13, 27 janvier 2015).
4. Je constate que, dans la présente affaire, la Cour se prononce expressément sur la question de la politique pénale qui serait souhaitable, d’une part, en prônant la mise en place de mesures qui visent à réduire le nombre des personnes condamnées à des peines privatives de liberté (paragraphes 115 et 118 de l’arrêt) et, d’autre part, en exprimant des réserves quant à la possibilité de résoudre le problème par un programme de construction de nouvelles prisons (paragraphe 119 de l’arrêt).
Il est vrai que les recherches en sciences sociales démontrent que les politiques pénales sévères n’ont pas les effets escomptés. Toutefois, de lege lata, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas compétence pour se prononcer sur la rationalité des choix en matière de politique pénale.
5. Pour pouvoir formuler des recommandations rationnelles sur les modifications qui seraient souhaitables en matière de politique pénale, il est indispensable d’étudier au préalable en détail un certain nombre d’éléments, en particulier la nature et l’ampleur de la criminalité dans la société en question, le droit pénal en vigueur ainsi que le nombre de places dans les prisons considéré dans le contexte de la criminalité existante. Toute recommandation en la matière qui ne serait pas fondée sur des analyses minutieuses des éléments mentionnés n’a aucun pouvoir de persuasion.
Or la Cour formule des recommandations relativement à la future politique pénale sans avoir analysé de façon suffisamment approfondie les questions ci-dessus. Il ne paraît pas convaincant de formuler des recommandations visant à adoucir la politique pénale roumaine sans avoir au préalable démontré que l’état du droit pénal en Roumanie permet d’introduire, dans le contexte spécifique de la criminalité dans la société de ce pays, des sanctions moins sévères sans que cela porte pour autant préjudice à la protection pénale des valeurs fondamentales et des droits des personnes. De plus, même les politiques pénales les moins répressives vont nécessairement aboutir à une surpopulation carcérale si le nombre de places dans les prisons reste insuffisant par rapport aux besoins découlant d’un niveau donné de criminalité. D’une façon générale, une politique pénale rationnelle doit être adaptée avant tout, dans la mesure du possible, à la nature et à l’ampleur de la criminalité plutôt qu’à la capacité des prisons, même si la question de l’allocation optimale des ressources disponibles est un élément important qui doit inévitablement être pris en considération.
6. Je note que la question du choix de la politique dans le domaine en question est d’autant plus sensible que des mesures prises par le gouvernement roumain pour assouplir la politique pénale concernant la corruption (l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 13/2017 sur la modification et la mise en œuvre de la loi no 286/2009 relative au code pénal et de la loi no 135/2010 relative au code de procédure pénale , publiée dans le Journal officiel no 92/2017 et abrogée le 5 février 2017, Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală) ont provoqué des manifestations de masse dans ce pays.
GRANDE CHAMBRE MURŠIĆ c. CROATIE du 20 octobre 2016 requête 7434/13
Violation et non violation de l'article 3 : Un espace personnel de moins de 3 mètres, est possible si le détenu peut se promener dans la prison trois heures par jour, jouer au ping pong et prendre des douches, trois fois par semaine. Dans ce cas, un espace personnel de moins de 3 mètres n'est pas satisfaisant mais pas au point d'être un acte inhumain et dégradant.
1. Remarques liminaires
91. La Cour est fréquemment appelée à statuer sur des allégations de violation de l’article 3 de la Convention à raison d’un manque d’espace personnel en détention. Elle considère qu’il y a lieu en l’espèce de préciser les principes et les normes à appliquer pour apprécier au regard de l’article 3 de la Convention l’espace personnel alloué à un détenu.
92. Elle note par ailleurs qu’un certain nombre de questions peuvent aussi se poser dans le contexte d’un hébergement en cellule individuelle, à l’isolement ou sous d’autres régimes de détention analogues, ou encore dans les locaux de rétention ou les espaces similaires utilisés pour de très courtes périodes (locaux de garde à vue, établissements psychiatriques, centres de rétention pour étrangers), qui ne sont toutefois pas en cause en l’espèce (voir le paragraphe 50 ci-dessus et l’arrêt Géorgie c. Russie (I), [GC], no 13255/07, §§ 192-205, CEDH 2014 (extraits)).
93. La question de la surpopulation carcérale dans le cas d’un hébergement en cellule collective était l’un des points examinés par la Grande Chambre dans l’arrêt Idalov c. Russie ([GC], no 5826/03, §§ 96‑102, 22 mai 2012). Elle a aussi été traitée dans plusieurs arrêts pilotes et arrêts de principe dans lesquels la Cour a déjà indiqué des éléments précis relativement à l’appréciation du problème et à l’obligation pour les États de traiter les défaillances constatées par elle dans ces arrêts.
94. Ainsi, la Cour a adopté à ce jour des arrêts pilotes relatifs à la surpopulation carcérale à l’égard des États suivants : Bulgarie (Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 et 9717/13, 27 janvier 2015), Hongrie (Varga et autres, précité), Italie (Torreggiani et autres, précité), Pologne (Orchowski c. Pologne, no 17885/04, 22 octobre 2009, et Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, 22 octobre 2009) et Russie (Ananyev et autres, précité).
95. Elle a aussi rendu sur cette même question des arrêts de principe dans lesquels elle a indiqué en vertu de l’article 46 de la Convention qu’il était nécessaire d’améliorer les conditions de détention dans les États suivants : Belgique (Vasilescu c. Belgique, no 64682/12, 25 novembre 2014), Grèce (Samaras et autres c. Grèce, no 11463/09, 28 février 2012, Tzamalis et autres c. Grèce, no 15894/09, 4 décembre 2012, et Al.K. c. Grèce, no 63542/11, 11 décembre 2014), Roumanie (Iacov Stanciu c. Roumanie, no 35972/05, 24 juillet 2012), Slovénie (Mandić et Jović c. Slovénie, nos 5774/10 et 5985/10, 20 octobre 2011, et Štrucl et autres c. Slovénie, nos 5903/10, 6003/10 et 6544/10, 20 octobre 2011) et République de Moldova (Shishanov c. République de Moldova, no 11353/06, 15 septembre 2015).
2. Récapitulatif des principes pertinents
a) Les principes généraux
96. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 113, CEDH 2014 (extraits)).
97. Un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX, Idalov, précité, § 91, ainsi que Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI).
98. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de traitements de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (voir, entre autres, Idalov, précité, § 92, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002‑III, ainsi que Ananyev et autres, précité, § 140, et Varga et autres, précité, § 70). En effet, l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 81, CEDH 2015).
99. Pour ce qui est des mesures privatives de liberté, la Cour a toujours souligné que, pour relever de l’article 3, la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement la privation de liberté. L’État doit s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000‑XI, Idalov, précité, § 93, Svinarenko et Slyadnev, précité, § 116, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, § 178, CEDH 2016, ainsi que Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 102, CEDH 2001‑VIII, et Ananyev et autres, précité, § 141).
100. Le fait que les mauvaises conditions subies par le détenu ne soient pas imputables à une intention de l’humilier ou de le rabaisser doit être pris en compte mais n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3 de la Convention (voir, entre autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III, Mandić et Jović, précité, § 80, Iacov Stanciu, précité, § 179, et plus généralement, sur l’article 3, Svinarenko et Slyadnev, précité, § 114, et Bouyid, précité, § 86). En effet, il incombe à l’État défendeur d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer le respect de la dignité des détenus, indépendamment de difficultés financières ou logistiques (voir, parmi beaucoup d’autres, Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 63, 1er juin 2006, Orchowski, précité, § 153, Neshkov et autres, précité, § 229, et Varga et autres, précité, § 103).
101. Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de tenir compte de leurs effets cumulatifs ainsi que des allégations spécifiques du requérant. La durée de détention d’une personne dans des conditions particulières doit elle aussi être prise en considération (voir, parmi beaucoup d’autres, Idalov, précité, § 94, Orchowski, précité, § 121, Torreggiani et autres, précité, § 66, et Ananyev et autres, précité, § 142).
b) Les principes relatifs à la surpopulation carcérale
102. La Cour note que les principes et les normes qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de surpopulation carcérale concernent en particulier les questions suivantes : 1) quel est l’espace personnel minimum dont un détenu doit disposer au regard de l’article 3 de la Convention ? 2) l’attribution à un détenu d’un espace personnel d’une surface inférieure à la norme minimale fait-elle naître une présomption de violation de l’article 3 de la Convention ou est-elle en elle-même constitutive d’une telle violation ? 3) le manque d’espace personnel peut-il être compensé par d’autres facteurs, et si oui, lesquels ?
i. Quel est l’espace personnel minimum dont un détenu doit disposer au regard de l’article 3 de la Convention ?
α) La jurisprudence pertinente
103. La Cour a déjà dit à maintes reprises qu’elle ne peut pas donner une fois pour toutes la mesure chiffrée de l’espace personnel qui doit être octroyé à un détenu pour que ses conditions de détention puissent être jugées compatibles avec la Convention au regard de l’article 3. Elle considère en effet que plusieurs autres facteurs, tels que la durée de la privation de liberté, les possibilités d’exercice en plein air ou l’état de santé physique et mentale du détenu, jouent un rôle important dans l’appréciation des conditions de détention au regard des garanties de l’article 3 (Samaras et autres, précité, § 57, Tzamalis et autres, précité, § 38, et Varga et autres, précité, § 76, voir aussi, par exemple, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 92, 19 juillet 2007, Semikhvostov c. Russie, no 2689/12, § 79, 6 février 2014, Logothetis et autres c. Grèce, no 740/13, § 40, 25 septembre 2014, et Suldin c. Russie, no 20077/04, § 43, 16 octobre 2014).
104. Néanmoins, l’exiguïté extrême dans une cellule de prison est un aspect particulièrement important qui doit être pris en compte afin d’établir si les conditions de détention litigieuses étaient « dégradantes » au sens de l’article 3 de la Convention.
105. Dans bon nombre d’affaires où l’espace alloué au détenu dans une cellule collective était inférieur à 3 m², la Cour a jugé que la surpopulation était grave au point de justifier le constat d’une violation de l’article 3 (voir la jurisprudence citée dans les arrêts Orchowski, précité, § 122, Ananyev et autres, précité, § 145, et Varga et autres, précité, § 75).
106. D’autre part, dans les cas où il est apparu que les détenus disposaient chacun d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², la Cour a examiné le caractère suffisant ou insuffisant des autres aspects des conditions matérielles de détention du requérant pour se prononcer sur le respect de l’article 3. Elle n’a conclu à la violation de cette disposition que lorsque le manque d’espace s’accompagnait, dans un cas donné, d’autres déficiences dans les conditions matérielles de détention, concernant, notamment, l’accès à la cour de promenade et à l’air et à la lumière naturels, l’aération des locaux, le chauffage, la possibilité d’utiliser les toilettes dans l’intimité, le respect des normes sanitaires et hygiéniques de base (Orchowski, précité, § 122, Ananyev et autres, précité, § 149, Torreggiani et autres, précité, § 69, Vasilescu, précité, § 88, et Varga et autres, précité, § 78 ; voir aussi, par exemple, Jirsák c. République tchèque, no 8968/08, §§ 64-73, 5 avril 2012, Culev c. Moldova, no 60179/09, §§ 35-39, 17 avril 2012, Longin, précité, §§ 59‑61, et Barilo c. Ukraine, no 9607/06, §§ 80-83, 16 mai 2013).
107. Dans ces arrêts pilotes et ces arrêts de principe, la Cour a fixé aux fins de son appréciation à 3 m² de surface au sol la norme minimum applicable en matière d’espace personnel à allouer aux détenus dans une cellule collective (Orchowski, précité, § 123, Ananyev et autres, précité, § 148, Torreggiani et autres, précité, § 68, Vasilescu, précité, § 88, Neshkov et autres, précité, § 232, Samaras et autres, précité, § 58, Tzamalis et autres, précité, § 39, Varga et autres, précité, § 74, Iacov Stanciu, précité, § 168, et Mandić et Jović, précité, § 75). En outre, dans l’arrêt Idalov (précité, § 101), où elle a conclu que les conditions de détention du requérant avaient emporté violation de l’article 3, la Grande Chambre a dit notamment que « la détention de l’intéressé n’[avait pas été] conforme au standard minimal, tel qu’exposé dans la jurisprudence de la Cour, de 3 m² par personne ».
108. Par ailleurs, dans une minorité d’affaires, la Cour a considéré qu’un espace personnel inférieur à 4 m² était en soi un facteur suffisant pour justifier un constat de violation de l’article 3 (voir, entre autres, Cotleţ c. Roumanie (no 2), no 49549/11, §§ 34 et 36, 1er octobre 2013, et Apostu c. Roumanie, no 22765/12, § 79, 3 février 2015). Ce chiffre correspond à la norme minimale en matière d’espace vital par détenu en cellule collective telle qu’elle se dégage de la pratique du CPT et qu’elle a été récemment énoncée dans le document établi par celui-ci en 2015 (paragraphe 51 ci‑dessus).
β) L’approche à retenir
109. La Cour rappelle que, sans qu’elle soit formellement tenue de suivre ses arrêts antérieurs, il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas sans motif valable de ses propres précédents (voir, par exemple, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 74, CEDH 2002‑VI, Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 104, 17 septembre 2009, et Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 50, 29 juin 2012).
110. Elle ne voit pas de raison de s’écarter de l’approche qu’elle a adoptée dans les arrêts pilotes et les arrêts de principe cités ci-dessus et dans l’arrêt de Grande Chambre Idalov (paragraphe 107 ci-dessus). Elle confirme donc que l’exigence de 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective doit demeurer la norme minimale pertinente aux fins de l’appréciation des conditions de détention au regard de l’article 3 de la Convention (paragraphes 124-128 ci-dessous).
111. En ce qui concerne les normes élaborées par d’autres organes internationaux, dont le CPT, la Cour rappelle qu’elle a décidé de ne pas les considérer comme un argument déterminant aux fins de son appréciation au regard de l’article 3 (voir, par exemple, Orchowski, précité, § 131, Ananyev et autres, précité, §§ 144-145, Torreggiani et autres, précité, §§ 68 et 76, ainsi que Sulejmanovic, précité, § 43, Tellissi c. Italie (déc.), no 15434/11, § 53, 5 mars 2013, et G.C. c. Italie, no 73869/10, § 81, 22 avril 2014). Il en va de même des normes nationales applicables en la matière : elles peuvent éclairer la décision de la Cour dans un cas donné (Orchowski, précité, § 123), mais non revêtir un caractère déterminant pour sa conclusion sur le terrain de l’article 3 (voir, par exemple, Pozaić, précité, § 59, et Neshkov et autres, précité, § 229).
112. La principale raison de la réticence de la Cour à considérer les normes du CPT en matière d’espace disponible comme déterminantes pour sa conclusion sur le terrain de l’article 3 tient à ce que dans le cadre de son appréciation au regard de cette disposition, elle doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de la cause, tandis que les autres organes internationaux tels que le CPT élaborent des normes générales en la matière à des fins de prévention des mauvais traitements (paragraphe 47 ci-dessus, voir aussi Trepachkine, précité, § 92, et Jirsák, précité, § 63). De même, les normes nationales relatives à l’espace personnel varient grandement et constituent des exigences générales en matière d’hébergement adéquat dans un système pénitentiaire donné (paragraphes 57 et 61 ci‑dessus).
113. De plus, la Cour joue un rôle conceptuellement différent de celui confié au CPT, ce que celui-ci a lui-même reconnu. Le CPT n’a pas pour tâche de dire si des faits donnés sont constitutifs de peines ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 (paragraphe 52 ci‑dessus). Il agit principalement en amont dans un but de prévention, démarche qui tend par sa nature même vers un degré de protection plus élevé que celui qu’applique la Cour lorsqu’elle statue sur les conditions de détention d’un requérant (voir, au paragraphe 47 ci-dessus, le paragraphe 51 du 1er rapport général d’activités du CPT). Le CPT joue un rôle préventif tandis que la Cour est chargée de l’application judiciaire à des cas individuels de l’interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants posée à l’article 3 de la Convention (paragraphe 46 ci-dessus). La Cour tient néanmoins à souligner qu’elle demeure attentive aux normes élaborées par le CPT et que, nonobstant cette différence de fonctions, elle examine soigneusement les cas où les conditions de détention ne respectent pas la norme de 4 m² fixée par lui (paragraphe 106 ci-dessus).
114. Enfin, la Cour juge important d’expliquer plus précisément la méthode qu’elle applique aux fins de son examen sous l’angle de l’article 3 pour calculer la surface minimale de l’espace personnel devant être alloué à un détenu hébergé en cellule collective. Elle considère, s’appuyant en cela sur la méthode du CPT, que dans ce calcul, la surface totale de la cellule ne doit pas comprendre celle des sanitaires (paragraphe 51 ci‑dessus). En revanche, le calcul de la surface disponible dans la cellule doit inclure l’espace occupé par les meubles. L’important est de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule (voir, par exemple, Ananyev et autres, précité, §§ 147-148, et Vladimir Belyayev, précité, § 34).
115. La Cour observe par ailleurs que sa jurisprudence ne fait apparaître aucune distinction entre les détenus condamnés et ceux qui sont dans l’attente de leur procès pour ce qui est de l’application de la norme minimale de 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective. Ainsi, dans l’arrêt pilote Orchowski (précité, § 124), elle a appliqué les mêmes normes pour l’appréciation au regard de l’article 3 de l’espace personnel minimum en prison et en maison d’arrêt. Dans d’autres arrêts pilotes, elle a appliqué cette même norme aux conditions de la détention dans l’attente du procès (Ananyev et autres, §§ 143-148) et après condamnation (Torreggiani et autres, précité, §§ 65-69). Cette approche est suivie dans d’autres arrêts de principe sur le sujet (Iacov Stanciu, précité, §§ 171-179, Mandić et Jović, précité, §§ 72-76, Štrucl et autres, précité, § 80). Enfin, dans la jurisprudence récente, la même norme a été appliquée aux pénitenciers russes (Butko c. Russie, no 32036/10, § 52, 12 novembre 2015 ; pour la jurisprudence antérieure, voir, par exemple, Sergey Babushkin c. Russie, no 5993/08, § 56, 28 novembre 2013, et les affaires qui y sont citées).
ii. L’attribution à un détenu d’un espace personnel d’une surface inférieure à la norme minimale fait-elle naître une présomption de violation de l’article 3 ou est-elle en elle‑même constitutive d’une telle violation ?
α) La jurisprudence pertinente
116. Appelée à déterminer si un manque extrême d’espace personnel en détention avait emporté violation de l’article 3 de la Convention, la Cour a apporté différentes réponses à la question de savoir si l’attribution d’un espace personnel d’une surface inférieure à 3 m² était en elle-même constitutive d’une violation de l’article 3 ou si elle créait seulement une présomption de violation, réfutable par d’autres considérations pertinentes. Différentes approches se dégagent à cet égard.
117. Dans un certain nombre d’affaires, dès lors qu’elle avait constaté qu’un détenu avait disposé de moins de 3 m² d’espace personnel, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 (voir, par exemple, Sulejmanovic, précité, § 43, Trepachkine c. Russie (no 2), no 14248/05, § 113, 16 décembre 2010, Mandić et Jović, précité, § 80, Lin c. Grèce, no 58158/10, §§ 53-54, 6 novembre 2012, Blejuşcă c. Roumanie, no 7910/10, §§ 43-45, 19 mars 2013, Ivakhnenko c. Russie, no 12622/04, § 35, 4 avril 2013, A.F. c. Grèce, no 53709/11, §§ 77-78, 13 juin 2013, Kanakis c. Grèce (no 2), no 40146/11, §§ 106-107, 12 décembre 2013, Gorbulya c. Russie, no 31535/09, §§ 64-65, 6 mars 2014, et T. et A. c. Turquie, no 47146/11, §§ 96-98, 21 octobre 2014).
118. Dans d’autres affaires, elle a dit que le fait qu’un détenu eût disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² emportait violation de l’article 3 et elle a examiné ensuite d’autres aspects des conditions de détention qu’elle n’a considérés que comme des circonstances aggravantes (voir, par exemple, Torreggiani et autres, précité, § 77, et Vasilescu, précité, §§ 100‑104).
119. On trouve aussi dans la jurisprudence une autre approche reposant sur le critère de la « forte présomption » énoncé dans l’arrêt pilote Ananyev et autres (précité). Dans cet arrêt, la Cour a énoncé, après une analyse approfondie de sa jurisprudence antérieure sur la surpopulation carcérale, le triple critère suivant : 1) chaque détenu doit disposer d’un couchage individuel dans la cellule, 2) chacun doit bénéficier d’au moins 3 m² de superficie, et 3) la surface totale de la cellule doit permettre aux détenus de se déplacer librement entre les meubles. Elle a souligné que le non-respect de l’un de ces éléments faisait en soi naître une forte présomption que les conditions de détention étaient constitutives d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 (Ananyev et autres, précité, § 148).
120. Suivant un raisonnement analogue, la Cour a dit dans l’arrêt pilote Orchowski (précité, § 123) que tous les cas où un détenu aurait été privé de l’espace vital minimum de 3 m² dans sa cellule seraient fortement indicateurs d’une violation de l’article 3 (voir aussi Olszewski c. Pologne, no 21880/03, § 98, 2 avril 2013). Le critère de la « forte présomption » a en outre été rappelé dans plusieurs des arrêts pilotes relatifs à la question de la surpopulation carcérale cités ci-dessus (Neshkov et autres, précité, § 232, et Varga et autres, précité, §§ 74 et 77).
121. Dans cette ligne de jurisprudence, le constat de violation de l’article 3 découle de la conclusion que, dans les circonstances, la « forte présomption » ne se trouve pas réfutée par les autres effets cumulés des conditions de détention (Orchowski, précité, § 135, Ananyev et autres, précité, § 166, Lind c. Russie, no 25664/05, §§ 59-61, 6 décembre 2007, et Kokoshkina c. Russie, no 2052/08, §§ 62-63, 28 mai 2009). Ainsi, dans les affaires faisant suite à l’arrêt Ananyev et autres, affaires qui présentaient des circonstances factuelles diverses, la Cour a examiné les effets cumulés des conditions de détention avant de se prononcer sur les allégations de violation de l’article 3 à raison d’une surpopulation carcérale (voir, par exemple, Idalov, précité, § 101, Iacov Stanciu, précité, §§ 176‑178, Asyanov c. Russie, no 25462/09, § 43, 9 octobre 2012, Nieciecki c. Grèce, no 11677/11, §§ 49-51, 4 décembre 2012, Yefimenko c. Russie, no 152/04, §§ 80-84, 12 février 2013, Manulin c. Russie, no 26676/06, §§ 47-48, 11 avril 2013, Shishkov c. Russie, no 26746/05, §§ 90-94, 20 février 2014, Bulatović c. Monténégro, no 67320/10, §§ 123-127, 22 juillet 2014, Tomoiagă c. Roumanie (déc.), no 47775/10, §§ 22-23, 20 janvier 2015, Neshkov et autres, précité, §§ 246-256, Varga et autres, précité, § 88, et Mironovas et autres c. Lituanie, nos 40828/12, 29292/12, 69598/12, 40163/13, 66281/13, 70048/13 et 70065/13, §§ 118‑123, 8 décembre 2015).
β) L’approche à retenir
122. Dans l’harmonisation des divergences ci-dessus, la Cour se fondera sur les principes généraux de sa jurisprudence bien établie relative à l’article 3 de la Convention. Elle rappelle que selon cette jurisprudence, l’appréciation du seuil minimum de gravité que doit atteindre un mauvais traitement pour tomber sous le coup de l’article 3 est relative par essence (paragraphes 97-98 ci‑dessus) et que, en vertu d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni (précité, § 162), elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (paragraphe 97 ci-dessus).
123. L’appréciation de la compatibilité avec l’article 3 des conditions de détention ne peut donc se réduire à un calcul du nombre de mètres carrés alloués au détenu – approche qui, par ailleurs, ne tiendrait pas compte du fait qu’en pratique, seul un examen de l’ensemble des conditions de détention permet d’appréhender précisément la réalité quotidienne des détenus (paragraphes 62-63 ci-dessus).
124. La Cour considère néanmoins, après avoir analysé sa jurisprudence et compte tenu de l’importance attachée au facteur spatial dans l’appréciation globale des conditions de détention, que le fait que l’espace personnel dont dispose un détenu soit inférieur à 3 m² dans une cellule collective fait naître une forte présomption de violation de l’article 3.
125. La présence des éléments constitutifs du critère de la « forte présomption » doit être considérée comme un signe fort, mais non comme une présomption irréfutable, de violation de l’article 3. Cela signifie en particulier que, selon les circonstances, les effets cumulés des autres aspects des conditions de détention peuvent réfuter cette présomption – ce qui sera bien sûr difficile en cas de manque flagrant ou prolongé d’espace personnel (moins de 3 m²). Les circonstances dans lesquelles la présomption peut être réfutée sont exposées ci-dessous (paragraphes 130‑135).
126. Il s’ensuit que, lorsqu’il a été établi de manière certaine qu’un détenu avait disposé de moins de 3 m² de surface au sol en cellule collective, le point de départ de l’appréciation de la Cour est une forte présomption de violation de l’article 3. Il reste alors au gouvernement défendeur à démontrer de manière convaincante la présence de facteurs propres à compenser de manière adéquate le manque d’espace personnel. L’examen de l’effet cumulé des différents aspects des conditions de détention doit normalement permettre à la Cour de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, la présomption a été réfutée.
127. En ce qui concerne la méthode à appliquer pour cet examen, la Cour se réfère au critère de preuve bien établi dans sa jurisprudence en matière de conditions de détention (voir, par exemple, Ananyev et autres, précité, §§ 121-125). Dans ce contexte, elle rappelle qu’elle tient particulièrement compte des difficultés objectives auxquelles se heurtent les requérants lorsqu’il leur faut recueillir des preuves à l’appui de leurs allégations relatives à leurs conditions de détention, mais que les intéressés doivent toutefois fournir un récit détaillé et cohérent des circonstances dont ils se plaignent (ibidem, § 122). Dans certains cas, ils sont en mesure de produire au moins quelques éléments de preuve à l’appui de leurs allégations. La Cour a considéré comme des éléments de preuve, par exemple, des déclarations écrites de codétenus, ou des photographies fournies par les requérants qui avaient la possibilité de le faire (voir, par exemple, Golubenko c. Ukraine (déc.), no 36327/06, § 52, 5 novembre 2013, et les affaires qui y sont citées ; voir aussi Tehrani et autres c. Turquie, nos 32940/08, 41626/08 et 43616/08, § 88, 13 avril 2010).
128. Lorsque la description faite des conditions de détention supposément dégradantes est crédible et raisonnablement détaillée, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve d’un mauvais traitement, la charge de la preuve est transférée au gouvernement défendeur, qui est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant. Le gouvernement défendeur doit alors, notamment, recueillir et produire les documents pertinents et fournir une description détaillée des conditions de détention du requérant. La Cour tient aussi compte, dans son examen de l’affaire, des informations pertinentes à ce sujet émanant d’autres organes internationaux, par exemple du CPT, ou des autorités et institutions nationales compétentes (voir aussi Ananyev et autres, précité, §§ 122‑125, et Neshkov et autres, précité, §§ 71-91).
iii. Facteurs susceptibles de compenser le manque d’espace personnel
129. Au vu des conclusions énoncées ci-dessus (paragraphes 124-125), la Cour doit déterminer quels facteurs sont susceptibles de compenser le manque d’espace personnel subi par un détenu, et ainsi de réfuter la forte présomption de violation de l’article 3 qui naît lorsque l’intéressé dispose de moins de 3 m² d’espace personnel en cellule collective.
130. Elle note d’abord, à la lumière de sa jurisprudence postérieure à l’arrêt Ananyev, que ce n’est normalement que lorsque les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis sont courtes, occasionnelles et mineures qu’il est possible de réfuter la forte présomption de violation de l’article 3. Tel était le cas, par exemple, des restrictions subies dans l’affaire Fetisov et autres (précité, §§ 134-138), où un détenu avait disposé d’environ 2 m² d’espace au sol pendant dix-neuf jours (voir aussi Dmitriy Rozhin, précité, §§ 52-53), ou dans l’affaire Vladimir Belyayev (précité, §§ 33-36), où un détenu avait disposé de 2,95 m² d’espace personnel pendant dix jours, puis, de façon non consécutive, de 2,65 m² pendant deux jours et de 2,97 m² pendant vingt-six jours. De même, en se référant aux arrêts Fetisov et autres et Dmitriy Rozhin, la Cour a conclu à la non‑violation de l’article 3 dans l’affaire Kurkowski (précité, §§ 66‑67), où le requérant avait disposé d’environ 2,1 m² d’espace au sol pendant quatre jours, puis de 2,6 m² d’espace au sol pendant quatre autres jours.
131. Cela étant, la Cour a aussi dit que, si la durée d’une période de détention peut être un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de la gravité de la souffrance ou de l’humiliation subies par un détenu du fait de ses mauvaises conditions de détention, la brièveté relative d’une telle période ne soustrait pas automatiquement à elle seule le traitement litigieux au champ d’application de l’article 3 lorsque d’autres éléments suffisent pour le faire relever de cette disposition (voir, par exemple, Vasilescu, précité, § 105, Neshkov et autres, précité, § 249, et Shishanov, précité, § 95).
132. La Cour note encore que dans d’autres affaires relatives à un manque d’espace personnel en détention, elle a recherché si les réductions de cet espace par rapport au minimum requis s’étaient accompagnées d’une liberté de circulation suffisante et d’activités hors cellule adéquates et si l’établissement était considéré de manière générale comme présentant des conditions décentes (voir, par exemple, Samaras et autres, précité, §§ 63‑65, et Tzamalis et autres, précité, §§ 44‑45). Dans les affaires Andrei Gueorgiev c. Bulgarie (no 61507/00, §§ 57‑62, 26 juillet 2007), Alexov c. Bulgarie (no 54578/00, §§ 107-108, 22 mai 2008) et Dolenec (précité, §§ 133-136), par exemple, elle a jugé que la réduction de l’espace personnel des requérants n’avait pas emporté violation de l’article 3. Elle considère que la forte présomption de violation de l’article 3 découlant de l’attribution d’un espace inférieur à 3 m² en cellule collective ne peut en principe être réfutée que lorsque sont réunies toutes les conditions suivantes : les réductions de l’espace personnel sont courtes, occasionnelles et mineures ; elles s’accompagnent d’une liberté de circulation hors de la cellule suffisante et d’activités hors cellule adéquates, et le lieu de détention présente, de façon générale, des conditions décentes (voir, mutatis mutandis, Varga et autres, précité, § 77, et Mironovas et autres, précité, § 122).
133. Pour déterminer ce qui constitue une liberté de circulation suffisante, la Cour s’est référée dans l’arrêt Ananyev et autres (précité, §§ 150-152) aux normes pertinentes du CPT, selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour, de préférence dans le cadre d’un programme plus large d’activités hors cellule, la cour de promenade devant être raisonnablement spacieuse et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries (voir aussi Neshkov et autres, précité, § 234). Selon les normes internationales pertinentes, les détenus doivent pouvoir passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule pour pratiquer des activités motivantes de nature variée (travail, loisirs, formation), et les régimes des établissements accueillant des détenus condamnés doivent être encore plus favorables (voir aussi les paragraphes 48, 53, 55 et 59 ci‑dessus).
134. Enfin, le caractère globalement décent des conditions de détention dans l’établissement considéré s’apprécie au regard d’un certain nombre d’aspects généraux que la Cour a déjà indiqués dans sa jurisprudence (voir aussi Ananyev et autres, précité, §§ 153-159, et Neshkov et autres, précité, §§ 237-244, ainsi que Iacov Stanciu, précité, §§ 173-179, et Varga et autres, précité, §§ 80-92) et des normes internationales pertinentes (rappelées aux paragraphes 48, 53, 55, 59 et 63-64 ci-dessus). Ainsi, lorsque les détenus bénéficient d’une liberté de circulation suffisante et d’activités hors cellule adéquates et qu’ils ne sont pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions générales de détention, la Cour ne conclura pas à la violation de l’article 3 (voir, par exemple, le raisonnement suivi dans les arrêts Alver c. Estonie, no 64812/01, § 53, 8 novembre 2005, Andrei Gueorgiev, précité, § 61, et Dolenec, précité, § 134).
135. Il découle de ce qui précède que, pour déterminer si les mesures visant à compenser le fait qu’un détenu dispose d’un espace personnel d’une surface au sol inférieure à 3 m² en cellule collective permettent de réfuter la forte présomption de violation de l’article 3, la Cour tient compte de facteurs tels que la durée et l’ampleur de la restriction, le degré de liberté de circulation et l’offre d’activités hors cellule, et le caractère généralement décent ou non des conditions de détention dans l’établissement en question.
c) Résumé des principes et normes à appliquer aux fins de l’examen des cas de surpopulation carcérale
136. À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Cour confirme que la norme prédominante dans sa jurisprudence, à savoir 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective, est la norme minimale applicable au regard de l’article 3 de la Convention.
137. Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (paragraphes 126-128 ci-dessus).
138. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (paragraphe 130 ci‑dessus) ;
2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (paragraphe 133 ci-dessus) ;
3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (paragraphe 134 ci‑dessus).
139. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (paragraphe 106 ci-dessus).
140. La Cour souligne aussi que lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel en cellule collective et que cet aspect de ses conditions matérielles de détention ne pose donc pas de problème, les autres aspects indiqués ci-dessus (paragraphes 48, 53, 55, 59 et 63-64) demeurent pertinents aux fins de l’appréciation du caractère adéquat des conditions de détention de l’intéressé au regard de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Story et autres c. Malte, nos 56854/13, 57005/13 et 57043/13, §§ 112-113, 29 octobre 2015).
141. Enfin, la Cour tient à souligner l’importance du rôle préventif du CPT, qui contrôle les conditions de détention et élabore des normes à cet égard. Elle rappelle que lorsqu’elle statue sur les conditions de détention d’un requérant, elle demeure attentive à ces normes et à leur respect par les États contractants (paragraphe 113 ci-dessus).
3. Application de ces principes au cas d’espèce
142. La Cour observe d’emblée que, bien qu’elle ait conclu à la violation de l’article 3 dans plusieurs affaires concernant un problème de surpopulation carcérale en Croatie (Cenbauer c. Croatie, no 73786/01, CEDH 2006-III, Testa c. Croatie, no 20877/04, 12 juillet 2007, Štitić c. Croatie, no 29660/03, 8 novembre 2007, Dolenec, précité, Longin, précité, et Lonić c. Croatie, no 8067/12, 4 décembre 2014), elle n’a jamais considéré jusqu’à présent que les conditions de détention dans ce pays révélaient un problème structurel au regard de l’article 3 de la Convention (voir, a contrario, les paragraphes 94-95 ci-dessus). De plus, aucune de ces affaires ne concernait les conditions de détention à la prison de Bjelovar, dont se plaint le requérant en l’espèce. La Cour a examiné à ce jour une affaire relative aux conditions de détention dans cet établissement, et elle a alors conclu à la non-violation de l’article 3 (Pozaić, précité).
143. En l’espèce, il s’agit d’examiner non pas un problème structurel relatif aux conditions de détention en Croatie, mais le grief spécifique du requérant concernant la surpopulation qu’il se plaint d’avoir subie à la prison de Bjelovar alors qu’il y purgeait une peine d’emprisonnement du 16 octobre 2009 au 16 mars 2011 (Poloufakine et Tchernychev c. Russie, no 30997/02, §§ 155-156, 25 septembre 2008).
144. Le requérant allègue en particulier que pendant plusieurs périodes non consécutives d’une durée totale de cinquante jours, dont une de vingt‑sept jours consécutifs, il a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel, et que pendant plusieurs autres périodes non consécutives, l’espace personnel en cellule qui lui était attribué était compris entre 3 et 4 m² (paragraphe 15 ci-dessus).
145. Eu égard au critère pertinent énoncé ci-dessus (paragraphes 136‑139), la Cour traitera les griefs relatifs à la période pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel à la prison de Bjelovar séparément de ceux concernant la période où il a disposé d’un espace compris entre 3 et 4 m².
a) La période pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel
i. Sur l’existence en l’espèce d’une forte présomption de violation de l’article 3
146. La Cour note que les informations relatives à l’espace personnel attribué au requérant reposent sur les documents fournis par le gouvernement défendeur et non contestés par l’intéressé (paragraphe 17 ci‑dessus). En particulier, pendant sa détention à la prison de Bjelovar, où il est demeuré un an et cinq mois (paragraphes 13-14 ci-dessus), le requérant a séjourné dans quatre cellules où l’espace personnel qu’il s’est vu attribuer était compris entre 3 et 6,76 m². Ce n’est que pendant les périodes non consécutives ci‑après qu’il a disposé d’un espace personnel inférieur (de 0,45 et 0,38 m² respectivement) à 3 m² : le 21 avril 2010 (un jour – 2,62 m²), du 3 au 5 juillet 2010 (trois jours – 2,62 m²), du 18 juillet au 13 août 2010 (vingt-sept jours – 2,62 m²), du 31 août au 2 septembre 2010 (trois jours – 2,55 m²), du 19 au 26 novembre 2010 (huit jours – 2,55 m²), du 10 au 12 décembre 2010 (trois jours – 2,62 m²), du 22 au 24 décembre 2010 (trois jours – 2,62 m²), et les 24 et 25 février 2011 (deux jours – 2,62 m²).
147. Il y a aussi eu certaines périodes pendant lesquelles l’espace personnel du requérant a été réduit de 0,08, 0,04 ou 0,01 m² par rapport au minimum requis de 3 m² (paragraphe 17 ci-dessus). Bien que ces réductions n’aient pas été du même degré ni de la même ampleur que celles mentionnées ci-dessus, d’autant que certaines d’entre elles ne sont guère démontrables et distinguables en termes d’espace, et qu’elles ne soient donc pas déterminantes pour l’issue de l’affaire, la Cour estime qu’elles ne peuvent être ignorées dans le cadre de l’appréciation globale des conditions de détention du requérant à la prison de Bjelovar.
148. Compte tenu de ce qui précède et des principes pertinents énoncés dans sa jurisprudence (voir le paragraphe 137 ci-dessus), la Cour conclut qu’il y a en l’espèce une forte présomption de violation de l’article 3. Il lui faut donc vérifier s’il existe des facteurs propres à réfuter cette présomption.
ii. Sur la présence de facteurs propres à réfuter la forte présomption de violation de l’article 3
149. La Cour note que, pour l’essentiel, les périodes pendant lesquelles le requérant a vu son espace personnel réduit à une surface inférieure à 3 m² ont été relativement courtes. Ainsi, il a disposé de 2,62 m² une fois pendant un jour, une fois pendant deux jours et trois fois pendant trois jours ; et de 2,55 m² une fois pendant huit jours et une fois pendant trois jours. Il y a toutefois eu une période de vingt-sept jours (du 18 juillet au 13 août 2010) pendant laquelle il a disposé de 2,62 m² (paragraphe 146 ci‑dessus).
150. Dans ces conditions, la Cour déterminera d’abord si cette période de vingt-sept jours, quant à laquelle elle partage les préoccupations de la chambre, peut être considérée comme une période de réduction mineure et courte de l’espace personnel du requérant par rapport au minimum requis.
α) La période de vingt-sept jours
151. La Cour observe que dans une affaire comparable (Vladimir Belyayev, précité), qui concernait plusieurs périodes non consécutives où l’espace personnel du requérant avait été réduit à une surface inférieure aux 3 m² requis, la plus longue de ces périodes avait duré vingt-six jours, pendant lesquels le requérant avait disposé de 2,97 m² d’espace personnel (paragraphe 130 ci-dessus). Toutefois, en l’espèce, le requérant a disposé de 2,62 m² d’espace personnel, et ce pendant vingt-sept jours (paragraphe 146 ci-dessus).
152. Ces circonstances suffisent à la Cour pour conclure que, pour ce qui est de la période de vingt-sept jours pendant laquelle le requérant n’a disposé que de 2,62 m², la forte présomption de violation de l’article 3 ne peut être remise en cause.
153. En conséquence, la Cour juge que, pendant les vingt‑sept jours durant lesquels il a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel à la prison de Bjelovar, le requérant a été soumis à des conditions de détention qui lui ont fait subir une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et, dès lors, constitutive d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention.
β) Les autres périodes
154. En ce qui concerne les périodes restantes, qui ont été de courte durée et pour lesquelles la forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention peut donc être réfutée par d’autres circonstances, la Cour doit tenir compte des autres éléments pertinents, à savoir le caractère suffisant ou non de la liberté de circulation et des activités hors cellule ainsi que les conditions générales de détention du requérant (paragraphes 137-138 ci‑dessus). Il incombe au Gouvernement de prouver la présence de tels éléments.
155. Pour ce qui est de la liberté de circulation et des activités hors cellule, la Cour note que, décrivant les équipements mis à la disposition des détenus de la prison de Bjelovar, le Gouvernement a expliqué que ces derniers étaient autorisés à circuler librement hors de leur cellule le matin et l’après-midi et à utiliser les installations situées dans l’enceinte de l’établissement, tant en intérieur qu’en extérieur. Il a indiqué que les détenus bénéficiaient en particulier de deux heures d’exercice en plein air et qu’ils pouvaient de plus circuler librement hors de leur cellule dans l’enceinte de la prison entre 16 et 19 heures. Il a aussi décrit de manière détaillée le régime quotidien des détenus ainsi que les installations disponibles à la prison de Bjelovar (paragraphes 19‑20 ci‑dessus).
156. À l’appui de ses déclarations, le Gouvernement a produit des photographies, des plans et d’autres documents relatifs aux installations disponibles dans l’établissement (paragraphe 21 ci-dessus), notamment des clichés qui ont été pris en 2007, 2010 et 2011 au moment de la rénovation de la prison et des visites sur place de différents responsables, et qui montrent l’intérieur de la prison, la cour de promenade, les cellules et leurs installations sanitaires. Ces clichés correspondent à la description faite par le Gouvernement des installations correspondantes. De même, les documents relatifs aux activités récréatives proposées aux détenus de la prison que le Gouvernement a communiqués à la Cour corroborent ses déclarations (voir, a contrario, Orchowski, précité, §§ 125 et 129).
157. Pour sa part, le requérant n’a opposé aux déclarations du Gouvernement que des protestations en termes très généraux, insistant sur le fait qu’il n’avait pas pu travailler. Il n’a pas donné de description détaillée de ses conditions de détention récusant les affirmations du Gouvernement relatives aux possibilités d’exercice en plein air ou aux autres éléments du régime pénitentiaire appliqué à la prison de Bjelovar (comparer avec décision précitée, § 61). Il a admis qu’il avait eu la possibilité de sortir de sa cellule trois heures par jour mais a affirmé que les installations extérieures étaient inadéquates et insuffisantes, notamment parce qu’il n’y avait qu’une cour de promenade ouverte (paragraphe 16 ci‑dessus).
158. La Cour observe en premier lieu que les déclarations du Gouvernement sont très détaillées et qu’elles correspondent à ce qu’il avait déjà dit dans l’affaire Pozaić relativement aux installations mises à la disposition des détenus du même établissement à l’époque (voir Pozaić, précité, §§ 15 et 60, et, a contrario, Idalov, précité, § 99). De plus, rien n’indique que les documents que le Gouvernement a communiqués à la Cour aient été établis après qu’il eut reçu communication du grief du requérant. La Cour n’a donc pas de raison de douter de leur authenticité, de leur objectivité ou de leur pertinence (Sergey Chebotarev c. Russie, no 61510/09, §§ 40-41, 7 mai 2014).
159. D’autre part, le requérant n’ayant donné aucun détail sur ses activités quotidiennes à la prison de Bjelovar, la Cour ne peut considérer ses allégations comme étant suffisamment établies ou crédibles (Ildani c. Géorgie, no 65391/09, § 27, 23 avril 2013). À cet égard, elle tient compte des documents communiqués par le Gouvernement. Elle attache aussi une importance particulière au fait que le requérant ne se soit jamais plaint au niveau interne de certains aspects de ses conditions de détention, tels que l’absence alléguée d’exercice en plein air et la durée pendant laquelle il pouvait circuler librement dans l’enceinte de l’établissement.
160. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a pour tâche en l’espèce de déterminer, au vu des documents dont elle est saisie, si l’on peut dire que le requérant a bénéficié d’une liberté de circulation suffisante et d’activités hors cellule adéquates, propres à atténuer les inconvénients découlant du manque d’espace personnel.
161. À cet égard, la Cour note que le régime quotidien ordinaire à la prison de Bjelovar laissait au requérant la possibilité de faire deux heures d’exercice en plein air par jour, norme fixée par les dispositions du droit interne pertinent (voir, au paragraphe 43 ci-dessus, l’article 14 § 1-9) de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement) et supérieure aux normes minimales du CPT (paragraphe 53 ci-dessus). La Cour note que les photographies qui lui ont été communiquées montrent la cour de promenade, laquelle, selon les déclarations non contestées du Gouvernement, a une surface de 305 m² et comprend une pelouse, des parties bitumées, une protection contre les intempéries et plusieurs équipements récréatifs, notamment un gymnase, un terrain de basketball et une table de ping-pong.
162. Par ailleurs, la Cour relève que l’intéressé ne conteste pas qu’il était autorisé à passer hors de sa cellule trois heures par jour, pendant lesquelles il pouvait circuler librement dans l’enceinte de la prison. Compte tenu également des deux heures d’exercice en plein air et du temps consacré au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, on ne peut pas dire qu’on l’ait laissé croupir dans sa cellule pendant une partie importante de la journée sans la moindre activité motivante, et ce d’autant qu’il ressort des documents dont la Cour dispose que la prison de Bjelovar offrait des possibilités de s’occuper, par exemple en regardant la télévision ou en empruntant des livres à la bibliothèque (comparer avec Valašinas, précité, § 111).
163. Dans ce contexte, la Cour estime que, même en tenant compte du fait que le requérant n’a pas pu travailler, impossibilité liée non seulement à l’absence objective de places de travail (paragraphe 20 ci-dessus) mais aussi, certainement, aux antécédents de l’intéressé (paragraphe 13 ci‑dessus), on peut considérer que la liberté de circuler hors de sa cellule et les possibilités de s’occuper qui lui étaient offertes à la prison de Bjelovar constituent des éléments atténuant significativement les inconvénients liés au manque d’espace personnel qu’il a subi.
164. Il reste à déterminer si les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à la prison de Bjelovar étaient généralement décentes (paragraphes 134 et 138 ci-dessus). La Cour est d’avis que les considérations exposées ci-dessus relativement aux documents en sa possession sont valables également en ce qui concerne les conditions générales de détention du requérant. En particulier, elle note que les déclarations détaillées du Gouvernement sont corroborées par des éléments de preuve pertinents (paragraphe 21 ci-dessus) et par les conclusions des autorités internes compétentes – notamment les instances judiciaires compétentes, la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice et le médiateur – sur le cas du requérant (paragraphes 25, 28, 30 et 38 ci-dessus), et qu’il n’y a pas de raison en l’espèce pour qu’elle remette en question ces conclusions. Elle attache par ailleurs une importance particulière au fait que le requérant n’a pas allégué – et encore moins démontré – devant la Cour constitutionnelle que la nourriture et les conditions d’hygiène dans les cellules fussent mauvaises ni que les activités récréatives et éducatives fussent notablement insuffisantes.
165. De plus, les déclarations du requérant quant aux conditions générales de sa détention sont contradictoires et infirmées par les éléments de preuve disponibles. Ainsi, il a dit, d’une part, que les cellules dans lesquelles il avait séjourné étaient insuffisamment meublées au regard du nombre d’occupants (paragraphe 16 ci-dessus) et, d’autre part, lorsqu’il entendait démontrer qu’il n’avait pas disposé de suffisamment d’espace en cellule, qu’il ne pouvait pas s’y déplacer normalement en raison des meubles fournis à chaque détenu (paragraphe 80 ci-dessus), ce qui est contradictoire. Par ailleurs, il a allégué que les installations sanitaires étaient dans la même pièce que l’espace de vie et qu’elles n’en étaient pas complètement séparées (paragraphe 16 ci-dessus), alors que les photographies et les plans de la prison datant de 1993, dont l’authenticité et la pertinence ne sont pas contestées, montrent que les cellules étaient équipées d’installations sanitaires totalement séparées.
166. De même, la Cour observe qu’il ressort des documents dont elle dispose que la qualité de la nourriture servie aux détenus était régulièrement contrôlée par le médecin de la prison et les autorités nationales compétentes, et que les détenus recevaient trois repas par jour, qui, au vu du menu communiqué par le Gouvernement, n’apparaissent ni médiocres ni insuffisants (comparer avec Alexov, précité, § 106, et, , Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, où les détenus n’avaient qu’un repas par jour). En outre, les détenus pouvaient accéder librement aux sanitaires et aucun problème ne se pose concernant l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais dans la cellule.
167. Il ressort aussi des documents disponibles que les détenus pouvaient prendre une douche trois fois par semaine (paragraphe 26 ci‑dessus, voir aussi, au paragraphe 55 ci-dessus, la règle 19.4 des règles pénitentiaires européennes, et, a contrario, Shilbergs c. Russie, no 20075/03, § 97, 17 décembre 2009,où le requérant n’avait la possibilité de prendre une douche qu’une fois tous les dix jours). Les locaux de la prison de Bjelovar ont été constamment rénovés et entretenus, y compris avant et pendant le séjour du requérant dans cet établissement (paragraphes 18 et 38 ci-dessus). À cet égard, la Cour prend note des photographies – dont l’authenticité n’est pas contestée – montrant l’intérieur de la prison, la cour de promenade, les cellules collectives et leurs installations sanitaires, qui semblent propres et en bon état (voir, a contrario, par exemple, Zuyev c. Russie, no 16262/05, § 59, 19 février 2013) et qui correspondent à la description donnée par le Gouvernement des installations mises à la disposition des détenus.
168. En conséquence, la Cour considère que les conditions de détention du requérant à la prison de Bjelovar étaient de manière générale décentes.
169. Au vu des éléments ci-dessus, elle conclut que, en ce qui concerne les autres périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel, le Gouvernement a réfuté la forte présomption de violation de l’article 3. En effet, ces périodes non consécutives peuvent être considérées comme des réductions courtes et mineures de l’espace personnel, pendant lesquelles le requérant a disposé d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule suffisantes et était détenu dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions décentes.
170. La Cour estime donc que, même si les conditions de détention du requérant n’ont pas été totalement satisfaisantes en ce qui concerne l’espace personnel dont il a disposé, on ne peut pas dire qu’elles aient atteint le seuil de gravité requis pour être constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Le fait que le droit interne pertinent prévoyait une norme de 4 m² d’espace personnel par détenu est sans incidence sur cette conclusion. Comme indiqué plus haut, cette norme peut éclairer la décision de la Cour mais elle ne saurait être considérée comme un argument déterminant aux fins de l’appréciation de la situation au regard de l’article 3 (paragraphe 111 ci‑dessus), a fortiori dans le système national croate, où, lorsqu’elle a examiné la question de l’espace personnel minimum à allouer aux détenus, la Cour constitutionnelle s’est référée à la norme de 3 m² énoncée par les juges de la Cour européenne dans l’arrêt Ananyev et autres (paragraphe 45 ci‑dessus).
171. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que les conditions de détention du requérant pendant les autres périodes où il a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel ne sont pas constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention.
γ) Conclusion
172. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour la période de vingt-sept jours (du 18 juillet au 13 août 2010) pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel (paragraphe 153 ci-dessus).
173. En revanche, elle juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention pour les autres périodes pendant lesquelles il a disposé de moins de 3 m² (paragraphe 171 ci-dessus).
b) Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m² d’espace personnel
174. Le requérant se plaignant aussi d’avoir manqué d’espace personnel en détention pendant les périodes où il a disposé de plus de 3 m² mais de moins de 4 m², périodes pour lesquelles l’élément spatial demeure un facteur de poids dans l’appréciation de la Cour (paragraphe 139 ci‑dessus), il reste à examiner la compatibilité avec l’article 3 de la restriction litigieuse de son espace personnel pendant ces périodes.
175. La Cour note qu’il ressort des éléments incontestés portés devant elle en ce qui concerne les conditions de détention du requérant à la prison de Bjelovar que pendant plusieurs périodes non consécutives l’intéressé a disposé d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² – de 3,38 m² à 3,56 m² exactement (paragraphe 17 ci-dessus).
176. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus relativement aux autres périodes où le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel (paragraphes 154-171 ci‑dessus), la Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé pendant la période où il a disposé de 3 à 4 m² d’espace personnel ne sauraient passer pour constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
177. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 3 de la Convention pour cette période.
ŞAKAR ET AUTRES c. TURQUIE du 20 octobre 2015 requête 38062/08
Violation article 3 : des militants du PKK entassés dans des cellules disciplinaires, la CEDH rappelle les conditions minimales de détention.
34. La Cour rappelle sa jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention qu’elle a notamment résumée dans son arrêt pilote Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, §§ 139-142, 10 janvier 2012), puis reprise dans ses arrêts Idalov c. Russie ([GC], no 5826/03, §§ 91‑94, 22 mai 2012), et Géorgie c. Russie (I) ([GC], no 13255/07, § 192, CEDH 2014 (extraits)) :
« (...) l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV). Un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses conséquences physiques ou mentales ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres précédents, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25).
Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (voir, parmi d’autres précédents, Vasyukov c. Russie, no 2974/05, § 59, 5 avril 2011).
Pour ce qui est des mesures privatives de liberté, la Cour a toujours souligné que, pour relever de l’article 3, la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement la privation de liberté. L’État doit s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000‑XI, et Popov c. Russie, no 26853/04, § 208, 13 juillet 2006).
Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de tenir compte de leurs effets cumulatifs ainsi que des allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑II). La durée de détention d’une personne dans des conditions particulières doit elle aussi être prise en considération (voir, parmi d’autres précédents, Alver c. Estonie, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005). »
35. En matière de surpopulation carcérale, la Cour a établi dans son arrêt Ananyev et autres (précité) les critères devant être utilisés pour déterminer si le manque d’espace personnel s’analyse en une violation de l’article 3 de la Convention. Elle doit ainsi avoir égard aux trois éléments suivants :
a) chaque détenu doit disposer d’un emplacement individuel pour dormir dans sa cellule ;
b) chaque détenu doit disposer d’un espace au sol d’au moins 3 m2 ;
c) la surface totale de la cellule doit être suffisante pour permettre aux détenus de circuler librement entre les meubles.
L’absence de l’un de ces éléments laisse à elle seule fortement présumer que les conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention (Ananyev et autres, précité, § 148).
36. La Cour rappelle aussi que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005). S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale étaient concernés les cas dans lesquels l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 103, 28 mars 2006, Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 52, 4 mai 2006, Trepachkine c. Russie (no 2), no 14248/05, § 113, 16 décembre 2010 et les références qui y figurent, Tzamalis et autres c. Grèce, no 15894/09, §§ 39-41, 4 décembre 2012, Nieciecki c. Grèce, no 11677/11, §§ 51‑52, 4 décembre 2012, et Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 77, 8 janvier 2013).
37. En l’espèce, la Cour note que la version des requérants diverge de celle du Gouvernement sur certains aspects des conditions de détention litigieuses.
38. La première divergence entre les parties porte sur le nombre de détenus présents dans la cellule pendant la période considérée. Les requérants soutiennent qu’ils étaient au total treize puis neuf détenus à occuper la cellule disciplinaire, alors que le Gouvernement, de son côté, affirme que la cellule était occupée par douze puis huit détenus.
39. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de résoudre le désaccord entre le Gouvernement et les requérants quant au nombre exact de détenus présents dans la cellule. Elle relève que selon les informations fournies par le Gouvernement, non contestées par les requérants, la cellule avait une superficie totale de 19 m2. Or, à supposer que la cellule était occupée par douze puis huit détenus – comme le soutient le Gouvernement –, force est de relever que chaque détenu disposait d’un espace vital individuel d’environ 1,60 m2 (pendant quatre jours) puis de 2,40 m2 (pendant vingt‑quatre jours). Cet espace se trouvait par ailleurs encore restreint par la présence de mobilier dans la cellule (un ou plusieurs lits superposés) et des toilettes dont les dimensions ne sont pas indiquées.
40. L’autre divergence entre les parties porte sur le nombre de lits mis à la disposition des détenus. Les requérants affirment qu’il n’y avait qu’un seul lit superposé, où ils dormaient à quatre, obligeant les autres détenus à dormir à même le sol sur les couvertures fournies par l’administration pénitentiaire. Le Gouvernement, quant à lui, indique qu’il y avait suffisamment de lits superposés dans la cellule, sans toutefois en préciser le nombre. Selon le directeur de la prison d’Osmaniye, entendu par le procureur de la République (paragraphe 23 ci‑dessus), la cellule était équipée de trois lits superposés.
41. Ici aussi, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de résoudre le désaccord entre les parties. Même si l’on admet que la cellule disciplinaire était équipée de trois lits superposés, comme l’a affirmé le directeur de la prison, le nombre de détenus excédait le nombre de lits disponibles. La Cour attache également une importance particulière aux déclarations faites par le directeur de la prison lui-même, lequel faisait état d’un problème général de surpopulation dans l’établissement en question. Selon les affirmations dudit directeur, pendant la période de détention contestée, la capacité de la prison d’Osmaniye avait été dépassée de cent personnes et il y avait dans tous les dortoirs des détenus qui dormaient à même le sol (paragraphe 23 ci‑dessus). Les requérants ne disposaient donc pas d’un espace individuel pour dormir dans la cellule disciplinaire.
42. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu de la durée de la période passée en détention dans les conditions incriminées et du nombre d’heures par jour passées confinés dans la cellule disciplinaire, la Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié d’un espace de vie conforme aux critères jugés acceptables par sa jurisprudence.
43. Il y a donc eu violation en l’espèce de l’article 3 de la Convention à raison de l’absence d’espace personnel suffisant pour les requérants. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les autres griefs formulés par ces derniers et relatifs à d’autres aspects de leur détention.
NIKOLAOS ATHANASIOU ET AUTRES c. GRÈCE du 23 octobre 2014 requête 36546/10
ARTICLE 3 non respecté par l'Etat : Trois fois plus de détenus que de places disponibles dans la prison.
76. En ce qui concerne les conditions matérielles de détention et notamment la surpopulation dans les prisons, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’elle les a récemment rappelés dans ses arrêts Ananyev et autres (précité, §§ 139 à 159) et Tzamalis et autres c. Grèce (no 15894/09, §§ 38 à 40, 4 décembre 2012). Elle rappelle aussi que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
77. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale étaient concernés les cas où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque d’espace n’était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d’autres aspects des conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Ainsi, même dans les cas où un requérant disposait dans une cellule d’un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 3 en prenant en compte l’exiguïté combinée avec l’absence établie de ventilation et d’éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001‑III).
78. En l’espèce, la Cour note d’emblée que la version des requérants diverge de celle du Gouvernement sur certains aspects des conditions de détention dans la prison d’Alikarnassos. Toutefois, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir la véracité de chaque allégation car le point central de son appréciation est l’espace de vie disponible pour les requérants dans cette prison. Elle rappelle qu’il est impossible d’appliquer rigoureusement dans toutes les affaires devant elle le principe affirmanti, non neganti, incumbit probatio, car il arrive que, dans certains cas, l’État défendeur ait seul accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations du requérant. L’omission du Gouvernement de fournir ces informations, sans motif valable, peut donner lieu à certaines déductions quant à la pertinence des allégations du requérant (Fadeyeva c. Russie, no 55723/00, § 79, CEDH 2005-IV, et Manulin c. Russie, no 26676/06, § 40, 11 avril 2013).
79. La Cour relève tout d’abord que les requérants et le Gouvernement s’accordent sur le fait que les cellules de la prison d’Alikarnassos avaient chacune une superficie d’environ 10 m2. En outre, elle note que, selon les constatations faites par le médiateur de la République lors de ses visites de 2010 et de 2011, la prison d’Alikarnassos, d’une capacité de 105 détenus, en hébergeait respectivement 264 et 287. Elle se réfère aussi à la question écrite soumise par quatre députés aux ministres compétents sur les conditions de détention à la prison d’Alikarnassos. Ces derniers mentionnaient qu’à la fin de 2011 ladite prison hébergeait 400 individus.
80. La Cour estime raisonnable de conclure sur la base des éléments précités qu’à l’époque des faits le nombre des détenus incarcérés à la prison d’Alikarnassos atteignait trois fois la capacité d’hébergement de cet établissement. Il s’ensuit que les requérants partageaient leurs cellules avec deux ou avec trois autres détenus. La Cour se demande ainsi de combien d’espace personnel les trois ou quatre détenus disposaient dans chaque cellule d’une superficie de 10 m2 une fois déduite la place occupée par les lits, les toilettes et le lavabo, pour lesquels le Gouvernement ne précise pas s’ils sont comptés dans les 10 m2. Elle note sur ce point que, bien que les requérants mentionnent dans leur requête les numéros des cellules où ils étaient détenus, le Gouvernement ne fournit pas de registres qui permettraient de vérifier le nombre et l’identité de toutes les personnes qui partageaient à l’époque des faits les cellules des requérants.
81. En outre, la Cour relève que, dans son rapport de 2010, le médiateur de la République a considéré que la surpopulation était le problème majeur de la prison d’Alikarnassos. À cet égard, le médiateur mentionnait aussi que les détenus étaient « entassés » dans les cellules en raison du manque d’espace et que l’atmosphère de celles-ci était suffocante parce qu’il n’y avait pratiquement pas d’espace entre les lits. La Cour attache aussi une importance particulière au restant des constatations faites par le médiateur de la République au sujet de cette prison. Si le ratio entre le nombre total des détenus et le nombre de détenus affectés à un poste de travail a été considéré comme relativement satisfaisant, le rapport de 2010 fait état de plaintes des détenus quant à l’alimentation, tant du point de vue de la qualité que de la quantité. De surcroît, tant le rapport de 2010 que celui de 2011 ont souligné l’état général insatisfaisant des locaux.
82. Compte tenu des considérations ci-dessus, la Cour estime établi que le nombre des détenus excédait manifestement la capacité pour laquelle les cellules de la prison d’Alikarnassos avaient été conçues. En effet, même à considérer que le manque d’espace n’était pas aussi flagrant pour chacun des requérants, la prise en compte en général des conditions matérielles de détention établit l’absence de conformité de la situation des requérants figurant en annexe sous les numéros 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 à l’article 3 de la Convention. Les requérants en question ont donc subi un traitement dégradant en violation de ladite disposition.
ARRÊT GRANDE CHAMBRE
IDALOV c. RUSSIE Requête n°5826/03 du 22 mai 2012
Une détention provisoire pendant plus d'une année dans des cellules surpeuplées avec des transports dans des fourgons à 25 détenus sans les avoir auparavant nourri pour se défendre devant un tribunal, est un acte inhumain et dégradant.
a) Principes généraux
91. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). Un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses conséquences physiques ou mentales ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres précédents, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25).
92. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (voir, parmi d’autres précédents, Vasyukov c. Russie, no 2974/05, § 59, 5 avril 2011).
93. Pour ce qui est des mesures privatives de liberté, la Cour a toujours souligné que, pour relever de l’article 3, la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement la privation de liberté. L’Etat doit s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI ; et Popov c. Russie, no 26853/04, § 208, 13 juillet 2006).
94. Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de tenir compte de leurs effets cumulatifs ainsi que des allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). La durée de détention d’une personne dans des conditions particulières doit elle aussi être prise en considération (voir, parmi d’autres précédents, Alver c. Estonie, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005).
95. Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve adéquats. Pour leur appréciation, la Cour applique généralement le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).
b) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
i. Les conditions de détention à la maison d’arrêt no IZ-77/2 de Moscou
96. La Cour constate que les parties divergent sur la plupart des points relatifs aux conditions de détention du requérant. Cependant, lorsqu’il y a contestation sur les conditions de détention, point n’est besoin pour elle d’établir la véracité de chaque élément litigieux. Elle peut conclure à la violation de l’article 3 sur la base de toute allégation grave non réfutée par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Grigorievskikh c. Russie, no 22/03, § 55, 9 avril 2009).
97. Tout d’abord, la Cour rappelle qu’elle a récemment conclu à la violation de l’article 3 à raison de la surpopulation qui régnait dans la même maison d’arrêt à peu près à la même période que celle considérée en l’espèce (Skachkov, précité, §§ 50-59 ; Soudarkov, précité, §§ 40-51 ; Denissenko et Bogdantchikov, précité, §§ 97-100 ; et Bychkov, précité, §§ 34-43). D’une manière générale, la surpopulation dans les maisons d’arrêt russes est un problème qui la préoccupe particulièrement. Dans un grand nombre d’affaires, elle a systématiquement conclu à la violation des droits des requérants à raison de l’insuffisance de l’espace personnel dont ils avaient pu bénéficier au cours de leur détention provisoire. A cet égard, la présente affaire ne constitue pas une exception. Au vu de ces éléments, la Cour admet que le requérant a été détenu pendant plus d’un an dans des cellules fortement surpeuplées où il disposait de moins d’un mètre carré d’espace personnel. Il ne pouvait sortir dans la cour de promenade qu’une heure par jour et restait confiné dans sa cellule tout le reste du temps.
98. Ensuite, la Cour observe que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application stricte du principe affirmanti incumbit probatio (« la preuve incombe à celui qui affirme ») car, dans certaines affaires, comme en l’espèce, le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant. Le fait que, sans donner de justification satisfaisante, un gouvernement s’abstienne de fournir les informations en sa possession peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations en question (Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, § 426, 6 avril 2004).
99. En l’espèce, le Gouvernement n’a produit aucun document original pour réfuter les allégations du requérant, expliquant que les archives avaient été détruites après l’expiration du délai légal de conservation (paragraphe 83 ci-dessus). Ses arguments reposent sur les déclarations d’agents de la maison d’arrêt recueillies environ quatre ans après les faits. En outre, force est pour la Cour de constater une certaine incohérence entre les chiffres avancés dans cette affaire et ceux livrés dans d’autres. Par exemple, dans l’affaire Skachkov, le Gouvernement avait dit que, entre le 11 février et le 8 août 2003, la cellule no 159 avait été occupée par vingt-deux détenus (Skachkov, précité, § 18). Or, en l’espèce, les autorités nationales affirment que, entre le 18 février et le 23 avril 2003 puis entre le 25 avril et le 15 août 2003, cette même cellule n’a hébergé que treize détenus. La contradiction manifeste entre les chiffres avancés par le Gouvernement dans ces affaires ne peut que nuire à la crédibilité des informations produites concernant la cellule no 159, et elle incite en outre à considérer avec réserve les informations données au sujet des autres cellules.
100. Dans ces conditions, les documents établis par les autorités plusieurs années après la période considérée en l’espèce ne peuvent passer pour suffisamment fiables (voir, parmi d’autres précédents, Novinski c. Russie, no 11982/02, § 105, 10 février 2009).
101. Au vu de ce qui précède, la Cour juge crédibles les allégations du requérant selon lesquelles la maison d’arrêt était surpeuplée. Ce surpeuplement a fait que la détention de l’intéressé n’était pas conforme au standard minimal, tel qu’exposé dans la jurisprudence de la Cour, de 3 m2 par personne (voir, parmi de nombreux autres précédents, Trepachkine c. Russie (no 2), no 14248/05, § 113, 16 décembre 2010 ; Kozhokar c. Russie, no 33099/08, § 96, 16 décembre 2010 ; Svetlana Kazmina c. Russie, no 609/04, § 70, 2 décembre 2010). Les détenus devaient dormir à tour de rôle, compte tenu de l’absence d’emplacements individuels pour dormir (voir les allégations du requérant exposées au paragraphe 40 ci-dessus). Sachant par ailleurs que le requérant devait passer vingt-trois heures par jour dans une cellule aussi surpeuplée, la Cour conclut qu’il a fait l’objet d’un traitement humain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention à raison des conditions dans lesquelles il a été détenu à la maison d’arrêt no IZ-77/2 de Moscou du 29 octobre 2002 au 20 décembre 2003.
102. Compte tenu de ces éléments, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner le reste des observations des parties relatives aux autres aspects des conditions de détention du requérant au cours de la période en question.
ii. Les conditions de détention au tribunal et les conditions de transport vers et depuis ce lieu
103. La Cour constate que, en dehors de la description des fourgons (paragraphe 54 ci-dessus), le Gouvernement n’a pas été en mesure de donner le moindre détail sur les conditions de transport du requérant entre la maison d’arrêt et le tribunal. Vu la hauteur des véhicules (environ 1,60 m), les détenus ne pouvaient s’y trouver autrement qu’en position assise. Or la superficie totale des compartiments du fourgon de marque ZIL étant de 11,28 m2 et celle des fourgons de marque GAZ étant de 8,93 m² (paragraphe 54 ci-dessus), elle n’estime pas concevable que trente-six personnes à l’intérieur d’un fourgon ZIL ou vingt-cinq personnes à l’intérieur d’un fourgon GAZ aient pu être convenablement assises et disposer d’un espace suffisant pour être transportées dans des conditions humaines. Au vu de ces éléments, elle juge crédibles les allégations du requérant concernant la surpopulation dans les fourgons, problème dont les conséquences négatives se faisaient d’autant plus sentir que la durée du trajet était plus longue (paragraphe 61 ci-dessus).
104. En ce qui concerne la détention du requérant au tribunal, le Gouvernement n’a produit aucun chiffre officiel sur sa durée ni le moindre détail sur les cellules où l’intéressé a séjourné. La Cour donne donc foi à la version de ce dernier (paragraphe 62 ci-dessus) et conclut que, au tribunal, il a été détenu dans des conditions inhumaines à l’intérieur d’un espace exigu.
105. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que le requérant ait été convenablement nourri les jours d’audience. Comme on peut s’en rendre compte à la lecture du rapport établi par les autorités nationales (paragraphe 90 ci-dessus), en général les détenus partaient de la maison d’arrêt avant l’heure du petit déjeuner et ils y étaient reconduits après le dîner. Le Gouvernement n’a produit aucun élément attestant que le requérant eût reçu la moindre « ration sèche » ou quelque autre nourriture.
106. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans un certain nombre d’affaires dirigées contre la Russie à raison des conditions d’exiguïté dans lesquelles les requérants avaient été détenus au tribunal et transportés vers et depuis ce lieu (voir, par exemple, Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 118-120, CEDH 2005-X ; et Starokadomski c. Russie, no 42239/02, §§ 53-60, 31 juillet 2008).
107. Au vu des éléments en sa possession, la Cour constate que le Gouvernement n’a présenté aucun fait ou argument à même de la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.
108. Prises cumulativement, les considérations ci-dessus suffisent pour conclure que le requérant a fait l’objet d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention lors de sa détention au tribunal et de son transport vers et depuis ce lieu. Il y a donc eu violation de cette disposition à cet égard.
Florea C. Roumanie du 14 septembre 2010 requête n° 37186/03
LA CEDH accepte de limiter la surface de vie d'un détenu à trois mètres carrés !
Dans les affaires concernant l’espace de vie de détenus, la Cour a retenu un seuil d’espace personnel minimum à 3 m².
Voici le texte compatible du paragraphe 51 de l'arrêt
"S'agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que lorsqu'elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l'article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernés les cas de figure où l'espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007,Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadikis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque de l'espace n'était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d'autres aspects des conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d'une situation donnée à l'article 3 de la Convention. Il s'agissait en particulier de facteurs tels que la possibilité pour un requérant de bénéficier d'un accès aux toilettes dans des conditions respectueuses de son intimité, la ventilation, l'accès à la lumière naturelle, l'état des appareils de chauffage ainsi que la conformité avec les normes d'hygiène. Ainsi, même dans les cas où un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², était accordé au requérant dans une cellule, la Cour a néanmoins conclu à la violation de l'article 3 en prenant en compte l'exiguïté combinée avec l'absence établie de ventilation et d'éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007)."
En cas d’espace supérieur à ce seuil, la Cour prend également en compte d’autres facteurs, tels que les normes d’hygiène. En l’espèce, en considérant les surfaces totales par rapport au nombre de détenus, il s’avère que M. Florea a disposé de respectivement environ 1,57 m² à 2,36 m² à la prison et de 3,63 à 1,89 m² à l’hôpital. La Cour relève que le ministère de la justice a reconnu le dépassement de la capacité d’accueil dans la prison de Botoşani, et, avec les juridictions roumaines, un problème systémique de surpopulation carcérale dans le pays.
Ainsi, pendant environ 3 ans, M. Florea a subi une grande promiscuité, disposant d’un espace personnel inférieur au standard européen. La Cour note cependant que depuis, la norme d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives a été relevée à 4 m² en Roumanie.
Concernant les autres facteurs, la Cour note que M. Florea a été confiné dans sa cellule 23 heures par jour, et que les conditions d’hygiène étaient déplorables, la chambre et la salle à manger étant un seul et même lieu. Au sujet du tabagisme dont se plaint le requérant, la Cour relève qu’il n’existe pas de consensus dans les États membres du Conseil de l’Europe concernant la protection contre le tabagisme passif dans les établissements pénitentiaires.
M. Florea n’a jamais disposé de cellule individuelle et il a dû supporter le tabagisme de ses codétenus, même à l’infirmerie de la maison d’arrêt de Botoşani et dans les salles des malades chroniques de l’hôpital pénitentiaire et ce, en dépit de la recommandation du médecin. Pourtant, une loi de juin 2002 prévoit une interdiction de fumer dans les établissements hospitaliers, et les tribunaux roumains ont souvent considéré que les détenus fumeurs et non-fumeurs devaient être séparés.
Par conséquent, les conditions de détentions subies par le requérant ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3, qui a été méconnu. Eu égard à cette conclusion, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’impact des conditions de détention sur l’état de santé général de M. Florea, aucune expertise médicale n’ayant établi les causes des maladies de M. Florea ou leur évolution défavorable en détention.
Mikhail Khodorkovskiy c. Russie arrêt du 31 mai 2011 requête N° 5829/04
LA CEDH considère maintenant que 4 mètres carrés sont insuffisants
Les conditions dans lesquelles M. Khodorkovskiy avait été détenu entre les 8 août et 5 octobre 2005 étaient inhumaines et dégradantes. C’est ainsi notamment que son espace personnel était limité à 4m² et que les conditions sanitaires étaient déplorables. Il y a donc eu violation de l’article 3.
Mandić et Jović c. Slovénie 20 octobre 2011 requêtes n° 5774/10 et 5985/10
et Štrucl et autres c. Slovénie requêtes n° 5903/10, 6003/10 et 6544/10
LA CEDH considère à nouveau que 3 mètres carrés sont insuffisants
Article 3
La Cour observe que les requérants ont tous été détenus pendant plusieurs mois dans une cellule où l’espace dont ils disposaient était de 2,7 m² par personne. Ce fait en soi soulève une question sous l’angle de l’article 3. Leur situation a en outre été exacerbée par le fait qu’ils se trouvaient confinés dans leur cellule nuit et jour en dehors de deux heures quotidiennes d’exercice pour MM. Mandić et Jović. Quant aux requérants dans la deuxième affaire, la Cour note qu’ils étaient certes autorisés à passer plus de temps en dehors de leur cellule mais qu’il est difficile d’admettre l’argument du Gouvernement selon lequel ils avaient en réalité pu passer la plus grande partie de ce temps dans la salle de loisir, sachant qu’il n’y avait qu’une seule salle de ce type, d’une taille de 50 m², par étage, et que la prison était surpeuplée.
La Cour prend note par ailleurs des griefs des requérants au sujet de la chaleur régnant dans les cellules, griefs corroborés par des rapports du médiateur slovène pour les droits de l’homme.
Tout en admettant que les conditions sanitaires ont pu pâtir de la surpopulation, la Cour ne juge pas, à partir des éléments de preuve dont elle dispose, que la propreté des zones considérées de la prison était insuffisante.
Rien n’indique qu’il y ait eu une intention d’humilier ou d’avilir les requérants.
Cependant, étant donné que ceux-ci n’ont eu pendant la majeure partie de leur détention qu’un espace de moins de 3 m² à leur disposition à l’intérieur de leur cellule pendant la plus grande partie du jour et de la nuit, la Cour estime que la détresse et les épreuves qu’ils ont subies ont dépassé le niveau inévitable de souffrance inhérent à une détention et sont allées au-delà du niveau de gravité permis au titre de l’article 3. Les intéressés ont donc fait l’objet de traitements dégradants, au mépris de l’article 3.
Article 13
La Cour constate qu’aucun des recours susceptibles d’être utilisés par les requérants, aux dires du gouvernement slovène, ne saurait passer, avec un degré suffisant de certitude, pour un recours effectif.
En particulier, le transfert dans une autre prison d’un individu en détention provisoire ne pouvait être demandé que par le directeur de la prison aux termes de la loi sur la procédure pénale, tandis que le transfert d’un détenu condamné en vertu de la loi sur l’exécution des sanctions pénales devait normalement être proposé par le directeur de la prison. En outre, les autorités avaient connaissance du problème structurel que constituait la surpopulation à la prison de Ljubljana et auraient pu ordonner le transfert des requérants si cela avait été possible.
Pour ce qui est des recours qu’un individu peut présenter au titre de la loi sur les litiges administratifs, la Cour n’a connaissance d’aucune décision de nature à démontrer qu’un recours à propos de conditions de détention pouvait être adressé directement au tribunal administratif avec une chance d’obtenir qu’il soit mis un terme dans des délais raisonnables à la violation alléguée. La Cour observe de plus que les recours civils prévus par le code civil n’ont qu’un caractère indemnitaire et qu’aucun tribunal interne n’a jusqu’à présent rendu d’injonction en vue de modifier une situation se trouvant à l’origine d’une atteinte aux droits personnels d’un détenu. En conséquence, notant que les requérants dans la première affaire et deux des requérants dans la seconde affaire, MM. Štrucl et Klanšek, étaient détenus au moment de l’introduction de leur requête, la Cour considère que l’ouverture d’une procédure civile n’aurait pas permis de redresser leur situation.
S’agissant de M. Dukić, qui a introduit sa requête après sa sortie de la prison de Ljubljana, la Cour prend note d’une décision récente où un tribunal interne local a conclu à la violation de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants à raison des conditions insatisfaisantes régnant dans cette prison et a accordé une réparation au plaignant. Tout en se félicitant de cette évolution de la jurisprudence nationale, la Cour considère qu’il s’agit pour l’instant d’une décision isolée, raison pour laquelle on ne saurait considérer à l’heure actuelle qu’un recours civil en indemnisation constitue une voie suffisamment certaine en pratique pour redresser des conditions de détention insatisfaisantes.
En outre, pour ce qui est du contrôle susceptible d’être exercé par le président d’un tribunal de district, la législation ne comporte aucune procédure formelle d’examen des plaintes, et le président ne peut pas non plus rendre de décisions juridiquement contraignantes. De même, un recours auprès du médiateur des droits de l’homme ne peut que déboucher sur des recommandations, et la Cour ne juge pas qu’il s’agit là d’un recours effectif. Enfin, comme le Gouvernement l’a reconnu, les requérants n’avaient pas un accès direct à la Cour constitutionnelle ; ils auraient seulement pu former un recours constitutionnel après avoir exercé les voies de recours susmentionnées.
Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 13.
Samaras et autres c. Grèce requête n°11463/09 du 28 février 2012
La CEDH revient à 3 mètres carrés mais exige des conditions de détention la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, le mode d’aération, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base.
56. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention, qui consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soit la nature des agissements reprochés à la personne concernée (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 127, 28 février 2008, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). Il impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92-94, CEDH 2000-XI).
57. La Cour rappelle également qu’une surpopulation carcérale grave pose en soi un problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 97, CEDH 2002-VI). Cependant, la Cour ne saurait donner la mesure, de manière précise et définitive, de l’espace personnel qui doit être octroyé à chaque détenu aux termes de la Convention, cette question pouvant dépendre de nombreux facteurs, tels que la durée de la privation de liberté, les possibilités d’accès à la promenade en plein air ou la condition mentale et physique du prisonnier (Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 92, 19 juillet 2007).
58. Il n’en demeure pas moins que dans certaines affaires le manque d’espace personnel pour les détenus était tellement flagrant qu’il justifiait, à lui seul, le constat de violation de l’article 3. Dans ces affaires, les requérants disposaient individuellement de moins de 3 m² (Aleksandr Makarov c. Russie, no 15217/07, § 93, 12 mars 2009 ; Lind c. Russie, no 25664/05, § 59, 6 décembre 2007 ; Kantyrev c. Russie, no 37213/02, 21 juin 2007, §§ 50-51 ; Andreï Frolov, précité, §§ 47-49 ; Labzov c. Russie, no 62208/00, § 44, 16 juin 2005, et Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 40, 20 janvier 2005).
59. En revanche, dans des affaires où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour rappelle avoir noté que d’autres aspects des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, le mode d’aération, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Aussi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière (Moisseiev c. Russie, no 62936/00, 9 octobre 2008 ; Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine, précité, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001-III). De plus, la Cour a souvent considéré qu’un exercice en plein air d’une durée très limitée consituait un facteur qui aggravait la situation du requérant qui était confiné dans sa cellule pour le reste de la journée sans aucune liberté de mouvement (Gladkiy c. Russie, no 3242/03, § 69, 21 décembre 2010 et Yevgeniy Alekseyenko c. Russie, no 41833/04, § 88, 27 janvier 2011). Dans un cas, la situation du requérant était encore plus grave car la cour de la prison était fermée pour travaux et il était obligé de rester à l’intérieur pour plus d’un mois (Trepachkine c. Russie, précité, §§ 32 et 94
60. S’agissant de la présente affaire, la Cour estime devoir souligner d’emblée certains des constats contenus dans le rapport établi par le médiateur de la République à la suite de sa visite à la prison d’Ioannina en 2009. Le médiateur relevait que, compte tenu du nombre des détenus, les dortoirs et les cellules étaient « absolument insuffisants », et que la proportion espace/nombre des détenus était « absolument intolérable ». Il observait que les détenus ne disposaient même pas d’un espace de 1 m² pour se tenir debout ; que, faute de réfectoire, de chaises et de tables, ils étaient obligés de manger assis sur leurs lits ; qu’il n’y avait pas non plus d’espace pour l’exercice physique et que les étrangers n’avaient pas la possibilité de travailler ; que, enfin, la proportion de détenus autorisés à travailler par rapport à l’ensemble de la population carcérale (57/248) n’était pas satisfaisante. A cet égard, la Cour note de surcroît que, par une lettre du 19 janvier 2008, le médecin de la prison d’Ioannina avait informé le directeur de la prison que les détenus encouraient un risque accru de présenter des troubles psychiatriques et des maladies physiques à cause de la surpopulation carcérale et du manque d’exercice physique.
61. La Cour rappelle en outre qu’elle a déjà eu à se prononcer sur les conditions de vie des détenus à la prison d’Ioannina. Dans l’affaire Nisiotis (précitée, § 44), elle a constaté qu’il a pu être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que pendant une période considérable le requérant avait dû subir à la prison d’Ioannina une grande promiscuité étant donné que l’espace personnel dont il pouvait disposer – 1,65 m² – comme tous les détenus du reste – était inférieur au minimum « humanitaire » de 6 m² par détenu, garanti tant au niveau interne par l’article 21 § 4 de la loi 2776/1999 qu’au niveau européen, selon les normes fixées par le Comité européen pour la prévention de la torture. Elle est parvenue au même constat dans l’arrêt Taggatidis et autres c. Grèce (no 2889/09, 11 octobre 2011).
62. La seule différence de la présente affaire par rapport aux arrêts Nisiotis et Taggatidis précités – et le Gouvernement le relève à juste titre – consiste dans le fait que onze des treize requérants travaillaient dans les ateliers de la prison et échappaient ainsi pendant une partie de la journée à la promiscuité régnant dans les dortoirs et les cellules.
63. La Cour n’entend pas mettre en question sa jurisprudence selon laquelle des éléments autres que la surpopulation ou l’espace personnel dont dispose un détenu peuvent être pris en compte dans l’examen du respect des exigences de l’article 3 en la matière. La possibilité de circuler en dehors du dortoir ou de la cellule constitue certes un de ces éléments. Toutefois, de l’avis de la Cour, ce facteur ne saurait être considéré en soi si déterminant qu’il suffirait à lui seul, s’il était avéré, à faire pencher la balance dans le cadre de l’examen susmentionné en faveur de la non-violation de l’article 3. La Cour doit aussi examiner les modalités et la durée de cette liberté de mouvement par rapport à la durée globale de la détention et aux conditions générales régnant dans l’enceinte de la prison. Elle estime que des facteurs ayant contribué à atténuer la rigueur des conditions de détention pourraient être pris en considération au titre de la satisfaction équitable dans la fixation du montant susceptible d’être accordé aux requérants à la suite d’un constat éventuel de violation.
64. En l’espèce, la Cour relève que onze des treize requérants ont travaillé pendant leur détention pour des périodes allant de trois à seize mois. Plus particulièrement, M. Samaras a travaillé seize mois sur une période de trente-six mois de détention ; M. Karapanos onze mois sur vingt ; M. Hussein trois mois sur quinze ; M. Aspiotis trois mois sur dix-sept ; M. Zygouris neuf mois sur vingt-deux ; M. Papazoglou vingt et un mois sur vingt-sept ; M. Garnavos six mois sur onze ; M. Bazakas quatre mois sur dix-sept ; M. Boulios onze mois sur quarante-deux ; M. Bikas trois mois sur dix et M. Dimitriadis trois mois sur dix-huit. M. Ramadanoglou et M. Al Abid el Hilal, détenus pendant vingt-sept et quatorze mois respectivement, n’ont pas du tout travaillé, le deuxième étant de nationalité somalienne et n’ayant pour cette raison pas la possibilité de travailler, comme le souligne le médiateur dans son rapport.
65. La Cour note que, dans la plupart des cas susmentionnés, la période pendant laquelle les requérants ont travaillé était une fraction limitée de la durée totale de leur incarcération. Le reste de la durée s’est écoulée dans les mêmes conditions que celles prévalant pour l’ensemble des détenus, cantonnés dans leurs dortoirs et cellules. A supposer même que la journée de travail était de huit heures, tous les requérants se retrouvaient après la fin de celle-ci pour le reste de la journée, vivaient dans les cellules surpeuplées, étaient obligés de manger sur leur lit et étaient privés de toute intimité, ainsi que de tout espace leur permettant de se distraire ou de faire de l’exercice.
66. Dans ces circonstances, la Cour estime que les conditions dans lesquelles les requérants ont été détenus ont atteint le niveau minimum de gravité requis pour constituer un traitement « dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Arrêt BUDACA c. ROUMANIE du 17 juillet 2012 Requête no 57260/10
LA CEDH CONSIDERE QUE 3 METRES CARRES SANS COMPTER LES MEUBLES SONT SUFFISANTS
35. Le requérant allègue que la surpopulation carcérale et l’absence d’hygiène à la prison de Botoşani ont représenté un traitement humiliant et qui a porté atteinte à sa santé.
36. Le Gouvernement affirme que les conditions de détention étaient adéquates et renvoie aux renseignements fournis par les autorités pénitentiaires.
37. La Cour relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l’incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Dans ce contexte, l’article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 93-94, CEDH 2000-XI, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 131, 22 octobre 2009).
38. S’agissant des conditions de détention, la Cour rappelle que lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).
39. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernés les cas de figure où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006).
40. Faisant application des principes susmentionnés au cas d’espèce, la Cour se penchera sur le facteur qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace personnel accordé au requérant à la prison de Botoşani.
41. Selon les donnés communiquées par le Gouvernement, le requérant a disposé dans la cellule no 128 d’un espace personnel de 1,43 m2 et ce sans prendre en compte le mobilier dont la présence réduisait encore cette superficie.
42. La Cour en conclut que le requérant a vécu pendant environ un an et six mois, dans la prison de Botoşani, disposant d’un espace individuel extrêmement réduit, en dessous de la norme recommandée par le CPT (voir les paragraphes 23 et 24 ci-dessus).
43. La Cour a déjà conclu à plusieurs reprises à l’égard de la Roumanie, à la violation de l’article 3 à cause des conditions de détention inappropriées dans la prison de Botoşani (voir, Florea, précité, § 51 et suiv.) ainsi que dans d’autres établissements pénitentiaires (voir, Bragadireanu, précité, § 95 ; Petrea, précité, § 49 ; Gagiu, précité, § 77 ; Măciucă, précité, § 25 ; Brânduşe, précité, § 49 ; Viorel Burzo, précité, § 98 et Marian Stoicescu, précité, § 24).
44. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d’assurer au requérant des conditions de détention qui soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et afin d’assurer que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
45. De l’avis de la Cour, les conditions de détentions subies par le requérant ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
46. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Jirsák c. République tchèque du 5 avril 2012 requête n° 8968/08
Le requérant, Zdeněk Jirsák, est un ressortissant tchèque né en 1953. Il purge actuellement une peine de prison dans un établissement pénitentiaire de Karviná (République tchèque). Il se plaignait de ses conditions de détention dans un autre établissement, la prison de Valdice, où il avait été incarcéré de 2000 à 2005. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait en particulier d’avoir dû, du 10 novembre 2000 au 29 janvier 2001, partager avec neuf autres détenus une cellule de 36 mètres carrés environ dépourvue de système d’aération et ne comprenant qu’un W.C. pour dix personnes.
36 divisé par 9 = 4 mètres carrés par détenu. Le manque d'aération est compensé par la possibilité d'ouvrir de larges fenêtres. Les toilettes partagés à 10 sont séparées du reste de la cellule par un mur et une porte qui les rendent privatifs. Les températures varient de 13 degrés en hiver à 22 degrés en été. La CEDH déclare qu'il n'ya pas eu violation de l'article 3 de la Convention quant aux conditions de détention.
Arrêt BYGYLASHVILI c. GRÈCE du 25 septembre 2012 Requête 58164/10
Une cellule de 12 M2 pour 5 détenues, est insuffisante. Les promenades doivent être prévues.
55. La Cour réaffirme d’emblée que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques et qu’il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
56. Elle rappelle ensuite que, si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996‑III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). Elle rappelle également qu’elle doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008‑...).
57. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que la requérante a été détenue dans le centre de Petrou Ralli du 27 juillet 2010 au 6 janvier 2011 mais que les parties présentent des versions qui ne coïncident pas quant aux conditions de détention prévalant dans le lieu de détention en cause.
58. En ce qui concerne l’espace attribué à chaque détenu, la Cour a, à maintes reprises, souligné que si une superficie de 4 m² constitue un standard souhaité, le fait pour chaque détenu de disposer d’une superficie au sol inférieure à 3 m² provoque une surpopulation telle qui peut conduire à elle seule à une violation de l’article 3 de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, no 42525/07 et 60800/08, § 145, 10 janvier 2012). Dans cette affaire la Cour a conclu à la violation de cet article en raison notamment du fait que les requérants disposaient moins de trois mètres carrés d’espace personnel tout en étant obligés de rester tout le temps dans leur cellule sauf pendant une période quotidienne d’une heure où ils pouvaient effectuer un peu d’exercice à l’extérieur (ibid. § 166).
59. A cet égard, la Cour note qu’en l’espèce, la requérante prétend que sa cellule, qu’elle partageait avec quinze à vingt autres détenues, avait une superficie de 12 m². De son côté, le Gouvernement, affirme que la requérante était placée avec quatre autres détenues dans une cellule de 12 m². Or, quelle que soit la superficie exacte de la cellule où la requérante passait l’essentiel de ses journées, l’espace qui, selon le Gouvernement, était attribué à la requérante était inférieure à celui qui, selon la jurisprudence rappelée dans l’arrêt Ananyev et autres précité, suffit à conclure à la violation de l’article 3, sur cette seule base.
60. Le Gouvernement ne fournit pas non plus d’informations quant à la possibilité des détenues de se promener ou d’avoir une quelconque activité physique à l’air libre. En revanche, la requérante fait état de sérieux problèmes à cet égard en soulignant que les détenues étaient autorisées à sortir dans le couloir vingt minutes par jour et que, pendant toute la durée de sa détention, elles ont été emmenées une seule fois dans un stade couvert voisin. La Cour relève que le Gouvernement ne réfute non plus ces affirmations. Dans son rapport du 17 novembre 2010 faisant suite à sa visite de septembre 2009, le CPT affirmait que même si la cour extérieure pour la promenade était « maintenant praticable », les détenus n’y avaient pas accès tous les jours (paragraphe 38 ci-dessus).
61. La Cour constate, en outre, que dans ce rapport, le CPT a encore fait le constat que le centre de Petrou Ralli, où la requérante a séjourné plus de cinq mois, demeurait en 2009 un établissement non approprié à une détention de longue durée de migrants en situation irrégulière. A cela s’ajoute le fait que la requérante, avant d’être transférée dans ce centre, a été détenue à partir du 8 juillet 2010 et pendant une période assez longue – dix-huit jours – dans le commissariat de police d’Arnaia. Or la Cour observe que, d’une part, le droit interne lui-même interdit la détention des personnes pendant de longues périodes dans les commissariats (article 66 § 6 du décret 141/1991 – paragraphe 35 ci-dessus) et que, d’autre part, le CPT a dénoncé dans sa déclaration publique du 15 mars 2011 (paragraphe 39 ci-dessus) la pratique des autorités consistant à utiliser les commissariats pour la détention des clandestins.
62. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a été soumise à un traitement dégradant incompatible avec l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
Arrêt LIN C. Grêce du 6 novembre 2012 requête 58158/10
Une cellule de 13 Mètres carrés pour 15 ou 20 détenus, est une violation de la Convention.
50. La Cour réaffirme d’emblée que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques et qu’il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
51. Elle rappelle ensuite que, si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008‑...). Dans chaque cas, les allégations de mauvais traitements doivent être prouvées « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Čistiakov c. Lettonie, no 67275/01, § 43, 8 février 2007).
52. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que les parties présentent des versions qui ne coïncident pas quant aux conditions de détention prévalant dans le lieu de détention en cause. En particulier, le requérant, qui met essentiellement en cause la surpopulation dans le centre d’Helleniko, expose qu’il partageait une cellule d’une superficie maximale de 13 m² avec 15 à 20 autres détenus et qu’il n’y avait qu’une seule toilette pour 15 personnes. Pour sa part, le Gouvernement explique que le requérant a séjourné dans une cellule de 27 m² contenant 5 lits doubles et que le centre dispose d’une cour d’une superficie de 525 m². Il est ainsi difficile à la Cour d’établir avec certitude la réalité à laquelle le requérant a dû faire face.
53. En ce qui concerne l’espace attribué à chaque détenu, la Cour a, à maintes reprises, souligné que si une superficie de 4 m² constitue un standard souhaité, le fait pour chaque détenu de disposer d’une superficie au sol inférieure à 3 m² provoque une surpopulation telle qui justifie à elle seule une violation de l’article 3 de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, no 42525/07 et 60800/08, § 145, 10 janvier 2012). Dans cette affaire la Cour a conclu à la violation de cet article en raison notamment du fait que les requérants disposaient moins de trois mètres carrés d’espace personnel et étaient obligés de rester tout le temps dans leur cellule sauf pendant une période quotidienne d’une heure où ils pouvaient effectuer un peu d’exercice à l’extérieur (ibid. § 166).
54. A cet égard, la Cour note qu’en l’espèce, le requérant prétend que sa cellule, qu’il partageait avec quinze à vingt autres détenus, avait une superficie maximale de 13 m². De son côté, le Gouvernement affirme que le requérant était placé dans une cellule de 27 m² qui contenait 5 lits doubles, soit moins de 3 m² par détenu. Or, quelle que soit la bonne version, l’espace attribué au requérant était inférieure à celui qui, selon l’arrêt Ananyev et autres précité permet de conclure, sur cette seule base, à la violation de l’article 3 de la Convention.
55. En outre, la Cour relève que si le Gouvernement affirme que l’administration fournissait aux détenus les sommes nécessaires à leur alimentation, il ne précise pas quel était, selon lui, le montant alloué pour chaque détenu. A l’inverse, le requérant prétend que la somme de 5,87 euros par jour que les détenus recevaient pour leur alimentation ne suffisait que pour l’achat des deux sandwiches d’une qualité douteuse, ce qui constituait l’unique nourriture pendant toute la durée de la détention. Or, la Cour rappelle que cette somme de 5,87 euros dont la réalité a été établie dans plusieurs arrêts de la Cour, a joué dans certains d’entre eux un rôle déterminant dans le constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, 2 juillet 2009 ; Tabesh, précité, Efremidze c. Grèce, no 33225/08, 21 juin 2011). A défaut d’informations plus explicites de la part du Gouvernement pour étayer ses allégations sur l’alimentation des détenus, la Cour se fie aux affirmations du requérant.
56. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a été soumis à un traitement dégradant incompatible avec l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
SCARLAT c. ROUMANIE du 23 juillet 2013 Requêtes nos 68492/10 et 68786/11
4 M2 PAR PERSONNE SANS LES MEUBLES, SONT SUFFISANTS POUR UNE CELLULE DE PRISON
56. Même si l’on ne s’en tient qu’aux renseignements fournis par le Gouvernement, le requérant a disposé de février à juillet 2010 d’un espace individuel réduit allant de 2,45 m² à 3,43 m², soit une surface inférieure à la norme de 4 m² recommandée par le CPT pour les cellules collectives (voir, mutatis mutandis, Colesnicov c. Roumanie, no 36479/03, §§ 78-82, 21 décembre 2010, et
Budaca c. Roumanie, no 57260/10, §§ 40-45, 17 juillet 2012).57. Quant aux conditions d’hygiène dans la prison de Bucarest-Jilava, la Cour observe que, les rapports issus de la visite du CPT de juin 2006 qualifient les conditions de détention dans cette prison de « atterrantes » (paragraphe 42 ci-dessus ; voir également Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 30, 13 octobre 2009). Il suffit à ce titre d’observer que, dans le dernier rapport du CPT précité, ces conditions sont décrites comme étant relativement similaires dans l’ensemble de la prison et sont qualifiées d’« extrêmement médiocres » même par la direction de la prison. La Cour note également que dans le cadre d’une plainte adressée par le requérant, le juge délégué s’est limité à constater certaines défaillances sanitaires sans toutefois ordonner des mesures concrètes et immédiates susceptibles d’améliorer sa situation (paragraphe 23 ci-dessus). Une telle conclusion trop formaliste ne prenant pas en compte les nécessités présentes des détenus rend ineffectif le recours formulé par l’intéressé. Il est vrai que le Gouvernement a fourni des procès-verbaux constatant que des désinsectisations avaient lieu régulièrement. Toutefois, ces documents correspondent à une période ultérieure à la détention du requérant dans cette prison. En outre, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à plusieurs reprises à la violation de l’article 3 en raison des conditions de détention inappropriées dans la prison de Bucarest-Jilava correspondant à des périodes proches de celle où l’intéressé y a été incarcéré (Banu c. Roumanie, no 60732/09, §§ 36‑37, 11 décembre 2012, Iacov Stanciu, précité, Flamînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, 12 avril 2011).
58. S’agissant des conditions de détention que le requérant a subies dans la prison de Bucarest-Rahova, le Cour constate que le requérant a bénéficié d’un espace individuel allant de 2,45 m² à 3,07 m², ce qui reste en-dessous de la norme de 4 m² recommandée par le CPT. Par ailleurs, sur plainte du requérant, le tribunal de première instance de Bucarest constata implicitement dans son jugement du 18 août 2011 que des produits nécessaires pour assurer le ménage n’étaient pas remis aux détenus et ordonna que ces produits soient mis à la disposition de l’intéressé (paragraphe 30 ci-dessus). Cela étant, ce jugement n’a été rendu que plusieurs mois après le transfert du requérant dans une autre prison, à savoir celle de Giurgiu, de sorte qu’il n’avait pas pu améliorer la situation de l’intéressé.
59. La Cour estime que les conditions de détention subies par le requérant pendant un laps de temps d’environ un an et dix mois, n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
60. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher en outre sur la partie du grief relative aux conditions de détention à la prison de Giurgiu, dans la mesure où les thèses des parties concernant les conditions de détention divergent (Micu c. Roumanie, no 29883/06, § 90, 8 février 2011).
OLARIU c. ROUMANIE du 17 septembre 2013 Requête 12845/08
UNE CELLULE NE PEUT ÊTRE INFERIEURE A 4 METRES CARRES POUR UN INDIVIDU
26. Le requérant allègue que la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions d’hygiène qu’il subirait depuis le 30 juin 2007 dans la prison de Iaşi constituent un traitement inhumain et dégradant.
27. Le Gouvernement considère que les conditions dont se plaint le requérant n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il soutient que, dans les cellules qu’il a occupées depuis le 30 juin 2007, le nombre de détenus était inférieur au nombre de lits et que le grief de surpopulation carcérale est donc sans fondement. De plus, selon le Gouvernement, le requérant a accès à une douche d’eau chaude deux fois par semaine et bénéficie de deux heures de promenade par jour.
28. La Cour rappelle que, si les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients, son incarcération ne lui fait toutefois pas perdre le bénéfice des droits garantis par la Convention.
29. Elle rappelle en outre que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la compatibilité d’une situation donnée avec l’article 3 (voir, en ce sens, Ciucă c. Roumanie, no 34485/09, § 41, 5 juin 2012, et Pavalache c. Roumanie, no 38786/03, § 94, 18 octobre 2011).
30. Faisant application des principes susmentionnés à la présente affaire, la Cour se penchera sur le facteur qui est primordial en l’espèce, à savoir l’espace personnel accordé au requérant à la prison de Iaşi où il est incarcéré depuis le 30 juin 2007.
31. Toutefois, selon les données communiquées par le Gouvernement relatives aux superficies des cellules et au nombre de lits dans chacune des cellules, il ressort que le requérant a disposé, pendant la majeure partie du temps passé dans cette prison, d’un espace personnel allant de 1,26 m² à 2,21 m². La Cour constate que le Gouvernement n’a fourni aucune information officielle concernant le nombre de détenus incarcérés dans chacune des sept cellules successivement occupées par l’intéressé. Le caractère incomplet de ces données ne saurait constituer une raison suffisante à cet égard pour écarter purement et simplement les allégations de l’intéressé quant au surpeuplement des cellules. La Cour, rappelant que la norme recommandée par le CPT est de 4 m² d’espace individuel (paragraphe 16 ci-dessus), conclut que le requérant a vécu dans une grande promiscuité et a souffert d’une situation de surpopulation carcérale grave (Stana c. Roumanie, no 44120/10, § 46, 5 mars 2013). Cela est confirmé par les constats de la Cour dans une affaire similaire, dans laquelle un requérant dénonçait les conditions de sa détention dans la prison de Iaşi de mars 2001 à mars 2004, et plus particulièrement la surpopulation carcérale et les conditions d’hygiène (Mazalu c. Roumanie, no 24009/03, §§ 52-54, 12 juin 2012). La Cour estime qu’un surpeuplement aussi grave ne peut qu’accroître les difficultés des autorités et des détenus à maintenir un niveau d’hygiène correcte (Ion Ciobanu c. Roumanie, no 67754/10, § 42, 30 avril 2013).
32. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Constantin Aurelian Burlacu c. Roumanie du 10 juin 2014 requête 51318/12
Violation de l'article 3 : Même un bref séjour de 4 jours en détention dans un espace vital de moins de 4 m2 est un acte inhumain et dégradant.
23. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
24. S’agissant des conditions de détention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
25. La Cour observe que, même en se tenant aux renseignements fournis par le Gouvernement, chacune des personnes détenues, dont le requérant, disposait d’un espace individuel en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT, à savoir 4 m² (paragraphe 16 ci-dessus). Qui plus est, les renseignements fournis par le Gouvernement ne font pas apparaître le temps que les détenus passaient à l’extérieur des cellules.
26. La Cour note ensuite que les allégations du requérant concernant le problème du surpeuplement carcéral sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par l’APADOR-CH dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les deux centres de détention dans lesquels le requérant a été incarcéré (paragraphe 18 ci-dessus).
27. La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 3 de la Convention en raison principalement du manque d’espace individuel suffisant, d’absence d’hygiène ou de ventilation ou éclairage inadéquats dans les locaux de la direction générale de la police de Bucarest (Ogică c. Roumanie, no 24708/03, §§ 42 et suiv., 27 mai 2010, et Căşuneanu c. Roumanie, no 22018/10, §§ 60 et suiv., 16 avril 2013) et dans la prison de Rahova (Dimakos c. Roumanie, no 10675/03, §§ 46 et suiv., 6 juillet 2010, Micu c. Roumanie, no 29883/06, §§ 86-87, 8 février 2011 et Flamînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, §§ 89-91, 12 avril 2011, et Toma Barbu c. Roumanie, no 19730/10, §§ 56 et suiv., 30 juillet 2013).
28. S’agissant de l’argument du Gouvernement concernant la durée d’incarcération du requérant de seulement trois mois dans les locaux de la direction générale de la police de Bucarest, la Cour rappelle qu’elle est déjà arrivée à des constats de violation en présence de mauvaises conditions de détention nonobstant la durée brève de cette détention (voir, pour des périodes de quatre et dix jours, Koktysh c. Ukraine, no 43707/07, §§ 93-95, 10 décembre 2009, pour une période de cinq jours, Gavrilovici c. Moldova, no 25464/05, §§ 30 et 43, 15 décembre 2009, pour une période d’une semaine, Parascineti c. Roumanie, no 32060/05, §§ 47-55, 13 mars 2012, et pour une période de cinq jours, Ciupercescu c. Roumanie (no 2), no 64930/09, § 46, 24 juillet 2012).
29. La Cour estime qu’en l’occurrence les conditions de détention que le requérant a dû supporter pendant plus de quatre ans, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule, ont porté atteinte à sa dignité et lui ont inspiré des sentiments d’humiliation.
30. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
BUJOREAN c. ROUMANIE du 10 juin 2014, requête n° 13054/12
Violation de l'article 3 de la Convention : les conditions d’hygiène précaires, notamment l’accès à l’eau chaude et aux douches ainsi que l’aération et l’éclairage des cellules sont un acte inhumain et dégradant.
26. L’État est donc tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Benediktov c. Russie, no 106/02, § 37, 10 mai 2007 et Soukhovoï c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008).
27. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que les parties s’accordent sur le fait que le requérant a purgé la plus grande partie de sa peine à la prison de Botoşani, dont il donne une description détaillée. À cet égard, la Cour relève qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans des affaires similaires dans lesquelles les requérants mettaient en cause les conditions matérielles de détention dans cette même prison (Cucolaş c. Roumanie, no 17044/03, § 94, 14 septembre 2010, Budaca c. Roumanie, no 57260/10, § 42, 17 juillet 2012, Stoleriu, précité, § 66 et Cotleţ c. Roumanie (no 2), no 49549/11, § 34, 1 octobre 2013).
28. S’agissant en particulier de l’espace personnel accordé au requérant, la Cour observe que selon les informations qu’il a fournies, non contredites par le Gouvernement, il disposait d’un espace individuel réduit, inférieur à deux mètres carrés, ce qui est en-dessous de la norme de quatre mètres carrés recommandée par le CPT pour les cellules collectives (Stoleriu, précité, § 66 et Cotleţ, précité, § 34).
29. La Cour note que, pendant sa détention sous le régime semi-ouvert, le requérant a bénéficié de la possibilité de quitter sa cellule. Cependant, cette mesure ne peut constituer en elle-même une solution au manque d’espace individuel dans les établissements pénitentiaires, d’autant plus que, comme en l’espèce, le requérant subissait une situation de surpeuplement grave (Györgypál c. Roumanie, no 29540/08, § 74, 26 mars 2013).
30. Outre le problème de surpopulation carcérale, les allégations du requérant quant aux conditions d’hygiène précaires, notamment l’accès à l’eau chaude et aux douches ainsi que l’aération et l’éclairage des cellules sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines (Cucolaş, précité, § 95).
31. La Cour estime dès lors que les conditions de détention en cause ont soumis le requérant à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).
32. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la partie du grief relative aux conditions de transport du requérant (Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 102, 30 juin 2009, Micu c. Roumanie, no 29883/06, § 90, 8 février 2011 et Pop Blaga c. Roumanie, no 37379/02, § 47, 27 novembre 2012).
33. Au vu de ce qui précède, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
FAKAILO DIT SAFOKA ET AUTRES c. FRANCE du 2 octobre 2014 requête 2871/11
Violation de l'article 3 pour actes inhumains et dégradants : La surface des cellules du commissariat de Nouméa est moins de 2 m2 par détenu. Une grande cellule de 11 m2 contient 8 ou 9 détenus. Les surfaces sont trop restreintes. Pour les conditions de détention, la CEDH considère qu'il faut faire le recours devant les juridictions administratives pour épuiser les voies de recours internes.
CONDITION DE DÉTENTION EN PRISON
35. Quant à la détention provisoire subie au Camp Est de Nouméa, la Cour constate qu’elle s’est achevée le 2 juin 2009, soit un an et demi avant l’introduction de la requête. Compte tenu de ce qu’elle a décidé dans les affaires Lienhardt et Rhazali précitée, la Cour estime qu’il était raisonnable d’attendre des requérants qu’ils engagent un recours indemnitaire devant les juridictions administratives pour satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, elle fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement concernant la détention subie au Camp Est.
COMMISSARIAT DE NOUMEA
39. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (voir, par exemple, Irlande c. Royaume‑Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).
40. La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation durant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a, ou non, atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, récemment Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 100, 18 mars 2014).
41. La Cour note que d’après les informations figurant dans le procès‑verbal de constat, deux requérants ont été retenus au commissariat de police de Nouméa dans des cellules individuelles d’un peu plus de 2 m2, et les autres dans des cellules collectives d’un peu plus de 11 m2 avec huit à neuf gardés à vue, disposant chacun de moins de 1 m2 d’espace personnel. Il apparaît ainsi que les requérants disposaient d’un espace largement inférieur au standard minimum souhaitable préconisé par le CPT dans ses normes et ses rapports nationaux (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). La Cour note de surcroît que, s’agissant des requérants gardés à vue dans les cellules collectives, ils ne disposaient pas de toilettes isolées. Elle estime que bien que la cour d’appel ait considéré que « le fait que chacune des cellules dispose d’un WC à la turque, n’implique en rien que les gardés à vue ont été contraints de faire leur besoin devant les autres », rien n’indique le contraire puisque les photos des cellules attestent de la présence de toilettes non cloisonnées ne satisfaisant pas aux exigences normales d’hygiène et d’intimité. Il ressort enfin du dossier que les cellules ne disposaient pas, ou de manière insuffisante, d’un système d’aération et qu’elles étaient privées de lumière naturelle.
42. La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas que les conditions décrites ci-dessus ne répondaient pas aux standards européens. Néanmoins, il estime que les requérants n’ont pas été exposés à des traitements atteignant le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention en raison de la brève durée de leur détention.
43. La Cour ne partage ce point de vue. Elle rappelle que, de par leur nature même, les commissariats de police sont des lieux destinés à accueillir des personnes pour de très courtes durées (paragraphe 25 ci-dessus ; voir, parmi beaucoup d’autres, Efremidi c. Grèce, no 33225/08, § 41, 21 juin 2011). Il est vrai que le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées est un facteur important à considérer (voir, pour des exemples de brèves durées de détention, l’arrêt Totolici c. Roumanie, no 26576/10, § 59, 14 janvier 2014 ; voir, également, les affaires Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, § 474, 25 juillet 2013, et, Dan Costache Patriciu c. Roumanie (déc), no 43750/05, 17 janvier 2012 ; voir, aussi, s’agissant de requérants vulnérables, la jurisprudence citée par le Gouvernement, paragraphe 38 ci-dessus, et, par exemple, pour une durée de détention de deux jours, Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 86, 5 avril 2011, ou de quelques jours, Horshill c. Grèce, no 70427/11, § 48 et suivants, 1er août 2013). Cependant, une durée extrêmement brève de détention n’interdit pas un constat de violation de l’article 3 de la Convention « si les conditions de détention sont à ce point graves qu’elle portent atteinte au sens même de la dignité humaine » (Rahimi, précité, § 86).
44. La Cour estime que tel est le cas en l’espèce, eu égard à la taille des cellules dans lesquelles les requérants ont été placés en garde à vue. Elle relève que leur superficie, allant d’un peu plus de 2 m2 pour les cellules individuelles à moins de 1 m2 par détenu pour les cellules collectives, n’était pas adaptée pour une période de détention de quarante-huit heures. Elle se réfère à cet égard aux recommandations du CPT selon lesquelles ce genre de cellule ne devrait pas être utilisé pour des périodes de détention excédant quelques heures - ce qui exclut d’y passer une nuit - et devrait être aménagé de manière à éviter le plus possible la sensation d’oppression et d’enfermement (paragraphe 26 ci-dessus). Elle note d’ailleurs que les cellules ne bénéficiaient pas d’un éclairage adéquat, et que l’aération était quasi inexistante (paragraphe 13 ci-dessus), ce qui n’a pu que générer une atmosphère encore plus étouffante, rendant la détention des requérants, nonobstant sa durée, contraire à la dignité humaine.
45. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention en cause ont causé aux intéressés des souffrances aussi bien physiques que mentales ainsi qu’un sentiment de profonde atteinte à leur dignité humaine, et qu’elles doivent s’analyser en un traitement inhumain et dégradant infligé en violation de l’article 3 de la Convention.
SURPOPULATION ET ENCELLULEMENT INDIVIDUELLE
DES DETENUS DANS LES PRISONS EN FRANCE
Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 24 mars 2014 relatif à l'encellulement individuel dans les établissements pénitentiaires
1. Les conditions matérielles dans lesquelles une personne détenue est incarcérée sont déterminantes pour le respect
de ses droits fondamentaux. Il
appartient à ce titre à l'autorité publique « de s'assurer
que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont
compatibles avec le respect de la dignité humaine » (Cour
européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, Kudla
c/Pologne, 26 octobre 2000, GACEDH, § 94). Cette obligation
incombant à l'Etat lui impose notamment de ne pas infliger
au prisonnier des conditions de détention qui sont
objectivement inacceptables (Cour européenne des droits de
l'homme, Dougoz c/Grèce, 6 mars 2001, n° 40907/98, § 46).
Parmi de telles conditions que les autorités doivent éviter,
figurent la configuration dépourvue de tout élément de
confort des cellules mais aussi leur surpopulation (Karalevicius
c/Lituanie, 7 avril 2005, n° 53254/99, § 36 et 39).
2. Le régime de l'encellulement individuel (qu'on appelle
alors, avec Tocqueville, régime « philadelphien ») est
apparu en France, avec la loi du 5 juin 1875 sur le régime
des prisons départementales, pour des raisons tout à fait
distinctes. Il est réservé à tous les prévenus et aux «
courtes peines » (un an ou moins) et s'applique jour et
nuit. Il accompagne d'autres mesures, comme le port de la
cagoule pour tous les déplacements en prison, ou la
construction d'alvéoles dans les chapelles pour que les
fidèles ne puissent se voir ou encore le silence imposé
pendant le travail. Il s'agit de priver la personne détenue
de toute relation avec ses semblables pour que, laissée face
à elle-même, elle puisse s'amender. L'encellulement
individuel garantit ainsi l'efficacité du châtiment.
3. Aujourd'hui, l'encellulement individuel a une toute autre
signification. Il vise à offrir, à chaque personne
incarcérée, un espace où elle se trouve protégée d'autrui et
où elle peut donc ainsi préserver son intimité et se
soustraire, dans cette surface, aux violences et aux menaces
des rapports sociaux en prison. En permettant à chacun de se
livrer aux activités (autorisées) qu'il a choisies,
d'étudier, de réfléchir, de se prendre en charge,
l'encellulement individuel n'est plus condition de
l'application de la punition elle-même mais plutôt, par la
préservation de la personnalité de chacun, garantie de la
réinsertion ultérieure. Comme tel, il concourt au caractère
effectif des droits fondamentaux. Le contrôle général des
lieux de privation de liberté est donc particulièrement
attentif à cette question.
4. Actuellement, le
code de procédure pénale définit deux règles relatives à
l'encellulement.
L'article 716 s'applique aux prévenus en détention
provisoire : il dispose qu'ils sont placés en cellule
individuelle sauf dérogation fondée, à la demande des
intéressés, sur leur intérêt de ne pas être seuls ; si
l'organisation du travail ou de la formation professionnelle
où ils sont inscrits l'impose. Cette disposition précise en
outre que lorsque les prévenus sont placés en cellule
collective « leur sécurité et leur dignité doivent être
assurées ».
L'article 717-2 traite de la situation des condamnés. En
maison d'arrêt, ils sont soumis à l'emprisonnement
individuel de jour et de nuit ; dans les établissements pour
peines, à un emprisonnement individuel la nuit seulement.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées pour les
mêmes motifs que précédemment (sous réserve de l'absence de
mention ― guère explicable ― de la formation
professionnelle).
5. L'application de ces dispositions fait difficulté en
raison de ce qu'un universitaire a appelé « la crise du
logement pénitentiaire » (Pierrette Poncela, Revue des
sciences criminelles, 2008, p. 972). Si l'administration
pénitentiaire pratique un numerus clausus de fait dans les
établissements pour peines, en n'y affectant que des
condamnés qu'à mesure que des places sont disponibles, et
s'assure ainsi de respecter les dispositions de l'article
717-2 applicables à ces établissements (s'agissant du
principe de l'encellulement individuel mais non pas
nécessairement de sa limitation à la seule période
nocturne), il n'en va pas de même dans les maisons d'arrêt,
dans lesquelles la surpopulation conduit à « doubler » des
cellules conçues pour une personne, à « tripler » des
cellules faites pour deux, voire davantage. Ces
établissements, on le perçoit mal au-dehors, fonctionnent
ainsi dans une tension permanente qui use les personnels et
les personnes détenues. Depuis longtemps, l'encellulement
individuel en maison d'arrêt est une situation très rare,
accordée aux personnes détenues dans des quartiers
particuliers (isolement, discipline), souvent à vocation
punitive ou de désocialisation, ou présentant des situations
particulières (comportements hétéro-agressifs...).
6. Confronté à cette situation de fait, le législateur a
imaginé des palliatifs provisoires, destinés à écarter
momentanément la portée du principe de l'encellulement
individuel posé par le
code de procédure pénale. Il a sursis à l'exécution de
l'entrée en vigueur d'une dérogation très précisément
limitée à ce principe : autrement dit, il a laissé en usage
la possibilité de s'en écarter plus aisément. Par la loi du
15 juin 2000 (II de l'article 68), il a repoussé à 2003
l'application d'une dérogation strictement limitée. On doit
noter qu'au 1er janvier 2000 la population pénale s'élève à
51 441 personnes ― soit 16 979 de moins qu'aujourd'hui ― et
la densité des maisons d'arrêt et quartiers « maison d'arrêt
» est de 114, soit 23,5 points de moins qu'actuellement.
Trois ans après, le délai a été de nouveau repoussé de cinq
ans par l'article 41 de la loi du 12 juin 2003 : il expirait
donc en 2008.
7. A cette date, le Gouvernement a imaginé un dispositif,
inséré dans la partie réglementaire du code de procédure
pénale (article D. 53-1, abrogé et inséré en 2013 dans le
règlement intérieur type des établissements, article 38),
qui consiste à prévoir que, lorsqu'un prévenu demande à être
en cellule seul et qu'il ne peut être satisfait dans
l'établissement où il est affecté à cette demande, il peut
demander son transfèrement dans un établissement dans lequel
il pourra être en cellule seul. Autrement dit, le principe
de l'encellulement individuel ne doit pas s'apprécier au
regard de l'établissement où la personne est incarcérée,
mais par rapport à l'ensemble des maisons d'arrêt. Le
Conseil d'Etat a validé ce raisonnement (6/1, 29 mars 2010,
n° 319 043, au rec., M. Guyomar, rapp. publ.). Ce qui
revient au fond, pour la personne détenue (sous réserve de
l'accord du magistrat), à devoir choisir entre la proximité
de l'établissement avec les siens, donc la possibilité de
parloirs, et l'encellulement individuel. Une telle
alternative n'est pas satisfaisante au regard des droits
fondamentaux, en particulier du respect du droit à une vie
familiale.
8. Ce dispositif a été retenu à titre subsidiaire dans la
loi pénitentiaire de 2009. Mais, à titre principal, la loi a
maintenu, contre l'avis du Gouvernement, le principe de
l'encellulement individuel et le système d'un nouveau sursis
à l'application de dérogations restreintes à ce principe,
dont l'entrée en vigueur a été repoussée à cinq ans après la
publication de la loi. Celle-ci ayant été publiée le 25
novembre 2009, c'est donc à la date du 25 novembre 2014 que
le principe de l'encellulement individuel devrait être conçu
plus strictement.
Que convient-il d'espérer à cette échéance ?
9. En dépit des constructions d'établissements
pénitentiaires, l'accroissement des flux d'entrée et la
durée des détentions provisoires et des peines prononcées
maintiennent, on le sait, une surpopulation carcérale
insupportable. Depuis l'avis rendu sur ce point (cf. avis du
Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 22
mai 2012 relatif au nombre de personnes détenues, Journal
officiel du 13 juin 2012), la situation ne s'est nullement
améliorée. Au 1er mars 2014, selon les données de
l'administration pénitentiaire, la densité de la population
dans les établissements pénitentiaires est de 117,8. Mais,
en raison du numerus clausus déjà mentionné, pratiqué dans
les établissements pour peines, la densité dans les maisons
d'arrêt et les quartiers « maison d'arrêt » des
établissements mixtes est de 137,5.
10. Dans ces conditions, le dispositif imaginé en 2008, non
seulement présente des inconvénients sérieux pour les
personnes qui en demanderaient le bénéfice, mais se
présente, dans les faits, de manière très théorique puisque
les maisons d'arrêt qui pourraient être choisies, même
éloignées du lieu d'affectation initial, ne présentent en
réalité aucune possibilité d'encellulement individuel. On
doit ajouter en outre que ce dispositif ne s'applique à
l'origine qu'aux seuls prévenus, l'administration
pénitentiaire l'ayant étendu par voie de circulaire aux
condamnés des maisons d'arrêt. Or, comme il a été rappelé
ci-dessus (article 717-2), tous les condamnés séjournant en
maison d'arrêt sont censés aussi être hébergés en cellule
individuelle. Or, ils sont majoritaires dans ces
établissements (lors des visites par le contrôle général : à
Grenoble-Varces, 65 % ; à Basse-Terre, 75 % ; à Bois-d'Arcy,
70 % ; à Lyon-Corbas, 56 % ; à Nîmes, 61 %...). Par
conséquent, le dispositif, en raison de l'ampleur de la
surpopulation carcérale est totalement inopérant et ne peut
être, par conséquent, qu'illusoire.
11. On doit ajouter à ces effets de nombre les effets de
leur gestion par l'administration pénitentiaire. Les règles
d'affectation et de séparation de personnes détenues, les
placements à l'isolement et les transfèrements décidés par
mesure d'ordre conduisent à rendre plus contraignant le
régime de détention des uns sans aboutir à protéger
efficacement les autres plus vulnérables. Les visites du
contrôle général et les courriers qu'il reçoit en offrent de
nombreux témoignages.
12. Trois solutions sont théoriquement possibles.
13. La première consiste à prendre, sans modifier le reste
des données qui déterminent la population carcérale, une
nouvelle disposition législative destinée à offrir un
nouveau délai de plusieurs années avant la mise en œuvre
d'un régime « normal » d'encellulement individuel, ainsi
qu'il a déjà été fait à trois reprises en quatorze ans, en
dépit, faut-il noter, d'un programme de construction de
prisons permettant d'accroître le nombre de places
disponibles.
Une telle solution n'est pas satisfaisante, en ce qu'elle se
borne à enregistrer une situation très dommageable aux
personnes détenues, prévenues comme condamnées, sans
perspective d'amélioration autre que de moyen terme. Le
contrôle général reçoit de nombreux courriers de prisonniers
se plaignant des conditions dans lesquelles ils sont en
surnombre dans les cellules, en méconnaissance des normes
que la direction de l'administration pénitentiaire avait
adopté en 1988 (notre DAP n° 88G 05G du 16 mars 1988 : une
seule place dans une cellule de superficie inférieure à 11
m²). Plus le délai est repoussé, d'ailleurs, moins la mise
en œuvre effective de l'encellulement individuel peut avoir
de crédibilité. De mal nécessaire, le report prendrait le
corps d'un expédient commode pour ne pas prendre les mesures
qui s'imposent.
14. La deuxième solution tient, a contrario, dans la volonté
de laisser le délai fixé en 2009 venir à expiration et, par
conséquent, donner sans qu'il soit besoin de modifier la
loi, leur plein effet aux dispositions des articles
716 et
717-2 du code de procédure pénale. Naturellement, c'est là
une solution en apparence favorable aux personnes détenues,
qui pourront tirer de la loi, sauf dérogations restrictives,
un « droit » à être affecté seules en cellule, droit en
suspens depuis quatorze ans. Le contrôle général, dont
l'objet est de prévenir les conditions de vie dégradantes en
prison, devrait être tout naturellement favorable à un tel
choix.
On doit néanmoins s'interroger sur son réalisme. Si, dans
des conditions nettement moins défavorables de densité
carcérale, on a estimé en 2000 nécessaire de repousser la
date de mise en œuvre du principe, comment peut-on espérer
le mettre en œuvre aujourd'hui, avec une densité
sensiblement plus élevée ? La loi peut être prospective, et
même volontariste. Elle ne saurait être sans risques tout à
fait irréaliste. Sans doute peut-elle anticiper des
situations : mais à la condition qu'elle s'en donne les
moyens. Tel n'est pas le cas. Les incertitudes qui pèsent
sur les effets d'une nouvelle sanction pénale (la «
contrainte pénale ») que le Parlement doit encore adopter
(l'étude d'impact du projet de loi relatif à la prévention
de la récidive et l'individualisation des peines a des
difficultés à les quantifier) ne permettent pas le choix de
s'affranchir résolument des restrictions en vigueur. Ce
choix aurait au surplus pour effet de créer de vaines
attentes parmi les personnes détenues, génératrices de
tensions qu'on doit épargner aux établissements, qui n'en
manquent pas. Il faut donc renoncer à une solution aussi
expéditive et sans portée.
15. Reste une troisième solution, de portée plus modeste,
qui consiste à commencer à rétablir l'encellulement
individuel dans la rigueur des principes du
code de procédure pénale au bénéfice de certaines
catégories de personnes détenues, déterminées par un texte
réglementaire ; à entrer par conséquent dans une dynamique
de retour progressif des principes du code dans la réalité
carcérale.
a) Cette solution comporte deux préalables.
Le premier consiste à desserrer l'étreinte de la
surpopulation carcérale, comme les Etats-Unis, pourtant
prodigues en la matière, ont commencé de le faire depuis
plusieurs années, comme le prévoit aussi le projet de loi
déposé au Parlement, comme l'ont défini des rapports et
études dont on ne reprendra pas ici les indications qui
conduisent à agir à la fois sur les flux d'entrée, par
diminution, et sur les flux de sortie, par augmentation.
Quelques initiatives locales arrêtées par l'autorité
judiciaire, en accord avec les directions d'établissement,
ont permis de diminuer les flux d'entrée, par la prise en
considération des places disponibles, ou d'accroître les
sorties possibles, par une politique active d'aménagement
des peines. Ainsi, on pourra redonner aux maisons d'arrêt
quelques marges de manœuvre qui leur permettront d'affecter
en cellule, seules, un plus grand nombre de personnes
détenues.
Le second doit assurer la protection des personnes détenues
sujettes à des pressions contraires à leur dignité,
autrement dit à assurer l'effectivité de cette disposition
de la loi pénitentiaire aux termes de laquelle «
l'administration pénitentiaire doit assurer à chaque
personne une protection effective de son intégrité physique,
en tous lieux collectifs et individuels ». A cette fin, sur
le fondement de dispositions réglementaires expresses du
code de procédure pénale, des quartiers destinés à les
abriter doivent être institués dans tous les établissements,
en particulier pour hommes, au-dessus d'un seuil d'effectifs
déterminé par le règlement. Une affectation dans de tels
quartiers peut aider beaucoup à supporter un encellulement «
doublé » (à deux) dès lors qu'il ne se traduit pas par des
menaces ou des violences. Ces quartiers doivent
naturellement maintenir l'accès à l'ensemble des droits en
vigueur en détention (promenades séparées, accès aux
activités...). La protection des personnes menacées
permettra d'éviter des incidents et des demandes de
transfèrement, parfois brutales, fondés sur la crainte
qu'inspire le fait de demeurer dans un établissement parce
qu'on s'y trouve en danger. Cette manière de procéder se
concilie avec le troisième alinéa de l'article 44 de la loi
pénitentiaire.
b) Ces préalables réalisés, il reste aux pouvoirs publics à
assurer le développement de la vie personnelle, condition
nécessaire à la réinsertion. A cette fin, certaines
catégories de personnes détenues, appelées à s'accroître
dans le temps, doivent avoir l'assurance d'être affectées
dès à présent selon le principe de l'encellulement
individuel. L'expérience des personnels, celle du contrôle
général, permettent de les identifier aisément. Il s'agit
des personnes souffrant de handicaps, entraînant des pertes
d'autonomie, notamment de pathologies invalidantes ou bien
des personnes sourdes et muettes ou encore aveugles ; des
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ; des personnes
fragiles à raison des maladies dont elles sont atteintes, en
particulier des affections mentales les plus sérieuses ; des
personnes de nationalité étrangère qui n'entendent pas la
langue française. Ces personnes devraient le plus vite
possible être affectées seules en cellule à moins
naturellement (on pense en particulier aux étrangers)
qu'elles fassent connaître de manière dénuée d'équivoque
leur demande d'avoir une vie cellulaire partagée (dans cette
hypothèse, l'administration devra s'efforcer d'affecter un
codétenu que la personne aura agréé).
c) En conséquence, le projet de disposition suivant pourrait
être soumis au vote du Parlement.
« Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de
la présente loi, il peut être dérogé au placement individuel
dans les maisons d'arrêt, au motif de ce que la capacité de
l'établissement et le nombre de personnes détenues présentes
ne permettent pas son application.
« Toutefois, cette dérogation n'est pas applicable aux
personnes, définies par voie réglementaire, dont la
situation particulière au regard de l'incarcération, tenant
notamment à l'âge, aux conditions de santé, à de sérieuses
difficultés de communication, exige une attention accrue au
respect de leur droit à une vie privée. Elles sont placées
en cellule individuelle en toutes circonstances, sauf
lorsqu'elles présentent une demande expresse contraire ou
que les risques qu'elles encourent justifient qu'elles ne
soient pas laissées seules. »
16. Pour les autres catégories de personnes, le décret
élargira à mesure des possibilités leur vocation à
bénéficier de l'encellulement individuel, la loi se bornant
par conséquent à poser le principe d'une application
diversifiée de la règle, diversité juridiquement fondée par
des situations objectivement différentes au regard de la vie
carcérale.
17. Cette manière de faire doit aussi permettre de redonner
un sens plus restreint à l'usage du quartier d'isolement des
établissements : il ne doit être utilisé que pour les
personnes dont le chef d'établissement estime qu'elles font
courir des risques au personnel ou aux codétenus et non
simultanément, comme aujourd'hui, aux personnes qui
demandent à être protégées des autres, ce qui aboutit à
donner à ces quartiers un caractère hybride inapproprié.
L'isolement devrait faire ainsi l'objet d'un encadrement
plus strict par les dispositions en vigueur, de manière en
particulier que la durée maximale en soit réduite, en raison
de ses conséquences (sur ce point, CEDH, Öcalan c/Turquie,
18 mars 2014, n° 24069/03..., § 104-106).
18. Enfin un programme d'investissement spécifique doit
conduire à la disparition rapide dans les établissements
pénitentiaires, y compris ceux d'outre-mer, de ces cellules
appelées « chauffoirs », où s'entassent cinq, six personnes
ou davantage, dans des conditions de détention
particulièrement choquantes, d'autant plus que, dans les
maisons d'arrêt où ces chauffoirs existent, le régime
applicable et l'absence d'activités font que les occupants y
restent l'essentiel de leur temps.
Pour les personnes qui, sans ambiguïté ni pression,
choisissent librement d'accomplir leur détention dans une
cellule partagée (trois au plus), les plans et les budgets
des établissements doivent prévoir de véritables
aménagements de cellules collectives, assortis de la
superficie (12 à 14 m² pour deux, 15 à 19 m² pour trois) et
de l'ameublement adéquats.
Il en résulte qu'au projet de disposition cité au paragraphe
15 ci-dessus devraient être ajoutés les deux alinéas
suivants :
« Lorsque les personnes soumises à la détention provisoire
ou condamnées sont placées en cellule collective, la
superficie et l'équipement de celle-ci doivent, dans la
limite de trois personnes au plus, être adaptées au nombre
de personnes hébergées, de manière à assurer leur sécurité
et leur dignité. Les personnes doivent être aptes à
cohabiter.
« Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement un
rapport sur l'application de cette disposition, en
particulier sur l'élargissement des catégories de personnes
bénéficiant d'un encellulement individuel. » JM DELARUE.
LES CONDITIONS D'HYGIENE DOIVENT ÊTRE RESPECTEES
LA VÉTUSTE DE LA PRISON EST INCOMPATIBLE
Clasens c. Belgique du 28 mai 2019 requête n° 26564/16
Violation de l'article 3 : L’affaire concerne la dégradation des conditions de détention de M. Clasens dans la prison d’Ittre durant une grève des agents pénitentiaires qui s’est déroulée entre avril et juin 2016.
La Cour juge que les conditions de détention de M. Clasens, lors de la grève des agents pénitentiaires, s’analysent en un traitement dégradant en raison de l’effet cumulé de l’absence continue d’activité physique, des manquements répétés aux règles d’hygiène, de l’absence de contact avec le monde extérieur et de l’incertitude de voir les besoins élémentaires satisfaits. Elle estime que M. Clasens a subi une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure privative de liberté. La Cour juge aussi que le système belge tel qu’il était en vigueur au moment des faits ne disposait pas d’un recours effectif en pratique, c’est-à-dire susceptible de redresser la situation dont M. Clasens était victime et d’empêcher la continuation des violations alléguées
LES FAITS
En avril 2016, un mouvement de grève des agents pénitentiaires toucha les prisons de Bruxelles et de Wallonie. En conséquence, le service minimum garanti ne fut plus assuré et le régime ordinaire de détention fut suspendu à des degrés divers selon les prisons concernées. En mai 2016, M. Clasens introduisit une requête en référé auprès de la présidente du tribunal de première instance (TPI), lui demandant d’ordonner à l’État belge de restaurer sans délai le régime ordinaire et dénonçant ses conditions de détention. Le lendemain, la présidente du TPI fit en partie droit à cette demande, condamnant l’État belge à assurer et/ou rétablir différents services sous peine d’une astreinte de 10 000 euros (EUR) par infraction. Environ trois semaines plus tard, en raison de difficultés d’exécution de l’ordonnance, M. Clasens fit signifier à l’État belge un commandement de payer les astreintes. L’État belge fit opposition. En avril 2017, la cour d’appel – qui avait été saisie par l’État belge entre-temps – confirma en grande partie l’ordonnance rendue par la présidente du TPI, réduisant cependant le montant de l’astreinte à 250 EUR par jour. Dans son arrêt, la cour d’appel releva notamment que les conditions de détention des détenus s’étaient gravement détériorées, en violation de l’article 3 de la Convention. La grève s’acheva en juin 2016 à la prison d’Ittre. À son terme, la commission de surveillance de la prison établit une attestation récapitulative des conditions de détention ayant affecté les détenus. Du 7 au 9 mai 2016, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectua une visite ad hoc à la prison d’Ittre.
CEDH
1. Thèses des parties
31. Le requérant fait valoir que la situation qu’il a subie à la prison d’Ittre durant la grève a déjà été évaluée par les juridictions internes qui ont considéré qu’elle avait été constitutive de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il souligne que dans le contexte belge, les grèves des agents pénitentiaires, de par leur fréquence, ne sont pas des événements imprévisibles et leurs conséquences humaines dramatiques sont connues des autorités. Or, depuis une quinzaine d’années, l’État belge était en défaut d’apporter une solution à cette situation récurrente par exemple par l’introduction d’un service légal minimum obligatoire.
32. Le Gouvernement souligne que les conditions décrites dans le rapport du CPT et reprises par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 26 avril 2017 doivent être distinguées selon les établissements et être lues dans le contexte du début de la grève. Elles ne sont pas illustratives de la situation dans les prisons concernées durant toute la grève. En effet, la situation a évolué et s’est améliorée grâce aux efforts des renforts auxquels le Gouvernement a fait appel. Cela démontre le souci de celui-ci de s’assurer que les prisonniers soient détenus dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. De fait, tout a été mis en œuvre pour réduire au minimum les inconvénients et le niveau de souffrance qu’ont pu connaître les détenus durant la grève. Enfin, le Gouvernement indiquait dans ses observations qu’à l’époque de la grève, il travaillait à une loi en matière de service garanti par les membres du personnel pénitentiaire.
2. Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle que, lors de l’évaluation des conditions de détention, il faut tenir compte des effets cumulatifs de ces conditions ainsi que des allégations spécifiques formulées par le requérant. Indépendamment de la nécessité de disposer d’espaces personnels suffisants, d’autres aspects des conditions matérielles de détention sont pertinents pour déterminer si elles sont conformes à l’article 3 (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 140, 20 octobre 2016). Ces éléments incluent l’accès aux exercices en plein air, à la lumière naturelle ou à l’air, la disponibilité de ventilation, l’adéquation des installations de chauffage, la possibilité d’utiliser les toilettes en privé et le respect des exigences sanitaires et hygiéniques de base. La durée de la détention d’une personne dans certaines conditions doit également être prise en compte (voir, par exemple, Story et autres c. Malte, nos 56854/13 et 2 autres, §§ 112‑113, 29 octobre 2015). À cet égard, la Cour rappelle l’importance du rôle préventif du CPT, qui contrôle les conditions de détention et élabore des normes à cet égard. Lorsqu’elle statue sur les conditions de détention d’un requérant, elle demeure attentive à ces normes et à leur respect par les États contractants (Muršić, précité, § 141), ainsi qu’aux constats établis par le CPT lors de ses visites.
34. En particulier, la Cour a souvent considéré qu’un exercice en plein air d’une durée très limitée constituait un facteur qui aggravait la situation du requérant, confiné dans sa cellule pour le reste de la journée sans aucune liberté de mouvement (voir, par exemple, Canali c. France, no 40119/09, § 50, 25 avril 2013). Concernant l’installation sanitaire et l’hygiène, elle rappelle que l’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain et que les détenus doivent jouir d’un accès facile aux installations sanitaires et protégeant leur intimité (Ananyev et autres, précité, §§ 156-157).
35. En l’espèce, la Cour constate que la description des conditions matérielles de détention à la prison d’Ittre pendant la grève fait l’objet d’un consensus de la part des observateurs qui se sont rendus sur les lieux au cours de la période litigieuse (paragraphes 14-15, ci-dessus). Cette description a également été reprise par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 26 avril 2017 pour confirmer la condamnation de l’État belge du fait de conditions de détention ayant porté atteinte à la dignité humaine en violation de l’article 3 de la Convention pendant la durée de la grève (paragraphes 17-18, ci-dessus). S’il apparaît, comme le souligne le Gouvernement, que le début de la grève a été marqué par des conditions encore plus extrêmes, ainsi que l’a constaté le CPT lors de sa visite ad hoc (paragraphe 13, ci-dessus), il n’est pas contesté devant la Cour que pendant toute la durée de la grève, soit pendant près de deux mois, le requérant n’a eu accès à aucune activité extérieure à sa cellule, a été confiné dans sa cellule 24 h sur 24, à l’exception d’une sortie d’une heure tous les trois jours dans la cour de promenade, et n’a eu accès aux douches qu’une à deux fois par semaine, sans possibilité de s’approvisionner en produits d’hygiène dont la distribution avait été interrompue.
36. À ces conditions matérielles de détention se sont ajoutées les conséquences résultant de l’absence d’encadrement de la continuité des missions des agents pénitentiaires en période de grève, à savoir que les détenus se sont retrouvés tributaires du refus d’un grand nombre d’agents pénitentiaires de travailler, réduits à accepter l’irrégularité et la précarité des services minimums, sans savoir quand la grève prendrait fin et donc sans perspective de voir la situation s’améliorer, privés de quasiment tout contact avec le monde extérieur, qu’il s’agisse de l’usage du téléphone, des visites familiales ou des rencontres avec leurs avocats.
37. Ainsi que l’a constaté la présidente du TPI du Brabant wallon lors de la descente sur les lieux effectuée le 25 mai 2016, le personnel pénitentiaire connaissait un manque crucial d’effectifs (paragraphe 15, ci-dessus). Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il ne ressort d’aucun des rapports établis à la suite des visites de l’établissement pendant la grève que la présence de la police, principalement affectée à la sécurité et la surveillance, ait permis une amélioration substantielle du quotidien des détenus.
38. Eu égard à ce qui précède, la Cour se dit convaincue par la conclusion à laquelle est parvenue la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 26 avril 2017 (paragraphe 17-18, ci-dessus). Elle considère que l’effet cumulé de l’absence continue d’activité physique, des manquements répétés aux règles d’hygiène, de l’absence de contact avec le monde extérieur et de l’incertitude de voir ses besoins élémentaires satisfaits, a nécessairement engendré chez le requérant une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure privative de liberté.
39. Dès lors, la Cour estime que ces conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, et qu’il y a eu violation de cette disposition.
Danilczuk c. Chypre du 3 avril 2018 requête n°21318/12
Le requérant, Robert Tadeusz Danilczuk, est un ressortisant polonais né en 1965 et actuellement détenu à la prison de Czarne, en Pologne. L’affaire concernait son grief selon lequel il aurait subi des conditions de détention inadéquates à la prison centrale de Nicosie. En janvier 2011, à Chypre, M. Danilczuk fut déclaré coupable d’un certain nombre d’infractions (notamment cambriolage, vol, infraction routière et séjour illégal). Il fut condamné à des peines allant de six mois à deux ans d’emprisonnement, qui furent confondues. Il passa toute sa période de détention, de septembre 2010, lorsqu’il fut placé en détention provisoire, jusqu’à mai 2012, lorsqu’il fut remis en liberté en vertu d’un décret présidentiel, dans trois différents quartiers de la prison. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de la surpopulation, du défaut d’éclairage adéquat, de la froideur et de l’hygiène médiocre des cellules. Sur ce dernier point, il se plaignait en particulier de la difficulté d’accéder aux toilettes (les cellules n’étaient pas pourvues de toilettes) et de ce que, lorsque les cellules étaient fermées à clé, il était contraint d’uriner dans une bouteille et de déféquer dans un sac poubelle.
KOUREAS et autres c. GRÈCE du 18 janvier 2018 requête n° 300300/15
Article 3 : La détention pour une surface disponible hors meuble de moins de 3 mètres. Si la surface est entre trois et quatre mètres, il faut que l'hygiène soit déficiente pour dire que la surface laissée au détenu, soit insuffisante.
62. Les requérants renvoient à leur propre version des conditions de détention dans la prison de Grevena. Ils se prévalent aussi des constats du médiateur de la République dans son rapport du 16 décembre 2013 sur la situation dans la prison de Grevena. Enfin, ils consacrent de longs développements sur les 11e et 25e Rapports Généraux du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants concernant la situation des condamnés à perpétuité et des autres détenus purgeant de longues peines.
63. Le Gouvernement se réfère à sa propre version des conditions de détention dans la prison de Grevena. Il soutient que, à supposer même que ces conditions ne puissent être considérées comme totalement satisfaisantes, elles ne dépassent pas le seuil de gravité rendant le traitement des détenus inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il estime aussi que les requérants se plaignent de manière générale et abstraite des déficiences de la prison de Grevena sans préciser s’ils pâtissent eux-mêmes de ces déficiences et si celles-ci engendrent à leur égard une souffrance dépassant le seuil de celle inhérente à toute détention en prison.
64. En ce qui concerne les principes généraux d’application de l’article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente cause, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, en dernier lieu, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96‑141, 20 octobre 2016).
65. En l’espèce, elle constate d’emblée que les thèses des parties divergent sur tous les aspects des conditions de détention dans cette prison.
1. Les conditions générales de détention
66. En ce qui concerne l’allégation de surpopulation, la Cour note que, selon les informations fournies par le médiateur de la République, la prison accueillait 732 détenus à la date du 1er juillet 2013, ce nombre s’étant élevé dans le passé à 800 personnes (paragraphe 41 ci-dessus) pour une capacité officielle de 579 détenus. En outre, elle relève qu’il ressort du document adressé par le ministère de la Justice au Parlement dans le cadre du contrôle parlementaire que le nombre de détenus au 1er avril 2014 dans cette prison s’élevait à 757 (paragraphe 39 ci-dessus). Selon les informations fournies par le Gouvernement, ce nombre atteignait 517 en juin 2015 et 519 en janvier 2017 (paragraphe 16 ci-dessus).
67. Or la Cour observe que tous les requérants ont été admis à la prison lors d’années où il existait effectivement une surpopulation telle que décrite ci-dessus : trois requérants ont été admis en 2010, trois en 2011, deux en 2012, quatre en 2013, dix en 2014 et trois en 2015. Il est donc évident que pendant toutes ces années où le nombre des détenus par cellule était supérieur à trois, l’un d’eux était obligé de dormir par terre compte tenu du fait que chaque cellule était équipée de seulement trois lits. Toutefois, les requérants ne décrivent pas leur situation individuelle, ni dans leur requête ni dans leurs observations, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer lesquels d’entre eux ont pu être affectés par cet aspect de la surpopulation.
68. Quoi qu’il en soit, même si chaque cellule de 12 à 13 m², sans tenir compte des sanitaires, accueillait quatre détenus, l’espace personnel de chacun restait dans les critères considérés comme admissibles par la Cour.
69. Dans l’arrêt Muršić c. Croatie précité, la Cour a dit que lorsqu’un détenu disposait, dans sa cellule, d’un espace personnel compris entre 3 m² et 4 m², le facteur spatial demeurait un élément de poids dans l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article 3 de la Convention si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques.
70. La Cour examinera donc l’essentiel des autres allégations des requérants en commençant par celle relative à l’alimentation.
71. Sur ce point, elle accorde du crédit à la thèse du Gouvernement selon laquelle les repas servis à la prison de Grevena sont équilibrés et variés : elle estime que ceci ressort des menus hebdomadaires sur une période de sept mois déposés devant elle par le Gouvernement. Elle prend aussi note des informations fournies par ce dernier et non contestées les requérants sur les diverses possibilités pour les détenus de se procurer des suppléments de nourriture à des prix raisonnables au sein de la prison (paragraphe 23 ci‑dessus).
72. En ce qui concerne l’hygiène au sein de la prison, la Cour relève que, tous les trois mois, la direction de la santé publique de la région de Grevena procède à un contrôle sanitaire et que des désinfections et des dératisations ont aussi lieu à des intervalles réguliers (paragraphe 21 ci‑dessus).
73. Quant aux autres griefs des requérants, relatifs à certains aspects de la détention de nature plus personnelle, tels que les visites de leurs proches parents ou les problèmes de santé, la Cour note que les intéressés ne précisent pas s’ils sont effectivement concernés ou, dans l’affirmative, à quel degré ils sont affectés.
74. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que les conditions générales de détention des requérants excédaient le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et constituaient un traitement dégradant. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
Alexandu Enache c. Roumanie du 3 octobre 2017 requête n° 16986/12
Article 3 : Le détenu avait un espace personnel de moins de 3 m2 et des conditions d'hygiène déplorables.
Article 8 combiné à l'article 14 : le détenu avait demandé un report de peine d'un an pour cause de naissance d'enfants. Ce moyen est recevable mais cette possibilité réservée aux femmes dans le droit roumain a pour but de protéger la spécificité de la maternité. Par conséquent, le repect d'égalité homme femme peut ne pas être respecté par l'État quia sur ce point une grande marge d'appréciation.
ARTICLE 3
B. Sur la recevabilité
36. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité du grief relatif aux conditions de détention à la prison de Giurgiu pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant n’a jamais saisi les autorités compétentes pour se plaindre de ses conditions de détention dans cette prison sur le fondement des dispositions de la loi no 275/2006.
37. La Cour relève que, s’agissant des conditions matérielles de sa détention, le grief du requérant porte en particulier sur la surpopulation carcérale et sur les mauvaises conditions d’hygiène. Elle rappelle à ce propos avoir déjà jugé, dans des affaires portant sur un grief similaire et dirigées contre la Roumanie que, eu égard à la particularité de ce grief, l’action indiquée par le Gouvernement et fondée sur les dispositions de la loi no 275/2006 ne constituait pas un recours effectif à épuiser (Marin Vasilescu c. Roumanie, no 62353/09, § 27, 11 juin 2013 ; Bulea c. Roumanie, no 27804/10, §§ 41-42, 3 décembre 2013 ; et Bujorean c. Roumanie, no 13054/12, § 21, 10 juin 2014). En l’espèce, les arguments du Gouvernement ne sauraient conduire la Cour à une conclusion différente. Dès lors, il convient de rejeter cette exception.
38. Constatant que le grief concernant les conditions de détention du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
C. Sur le fond
39. Le requérant se plaint du surpeuplement carcéral dans les locaux de détention de la police à Bucarest et dans les prisons de Bucarest‑Rahova, de Mărgineni et de Giurgiu. Se référant aux rapports du CPT ainsi qu’à ceux d’une organisation non gouvernementale roumaine, il allègue que, dans ces établissements, il a bénéficié d’un espace de vie bien inférieur à la norme recommandée par le CPT. Il ajoute qu’il n’y avait pas d’eau chaude ni de chauffage, que les matelas et le linge de lit étaient sales et que les cellules étaient infestées de rats, de cafards et de parasites.
40. Le Gouvernement expose que les conditions de détention litigieuses n’ont pas dépassé le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention. S’agissant en particulier de la prison de Giurgiu, il indique que le requérant a bénéficié d’un espace de vie mesurant entre 3,39 m2 et 3,49 m2.
41. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure en cause ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI ; Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 141, 10 janvier 2012 ; et Enășoaie, précité, § 46).
42. La Cour a récemment réitéré les principes pertinents, notamment ceux relatifs à la surpopulation carcérale et aux facteurs susceptibles de compenser le manque d’espace personnel, dans l’arrêt Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, §§ 96-141, 20 octobre 2016). Elle a dit notamment que lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (Ibid., § 137). En revanche, lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation qu’elle fait du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, la Cour conclura à la violation de l’article 3 de la Convention si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité dans les toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (Ibid., § 139).
43. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint du surpeuplement dans les locaux de détention de la police à Bucarest et dans les prisons de Bucarest-Rahova, de Mărgineni et de Giurgiu. Elle note que, s’agissant des trois premiers établissements pénitentiaires, les parties divergent tant sur la superficie des cellules où a été détenu le requérant que sur le nombre de personnes y logées (voir les paragraphes 13, 14 et 15 pour la version du requérant et les paragraphes 17, 18 et 19 pour la version du Gouvernement). Quoi qu’il en soit, la Cour relève que, même en retenant la version du Gouvernement, on parvient à la conclusion que dans tous ces établissements le requérant a bénéficié d’un espace de vie inférieur à 3 m2.
44. Outre le problème de surpopulation carcérale, les allégations du requérant quant aux conditions d’hygiène précaires sont conformes aux conclusions de la Cour dans des affaires similaires relatives à la prison de Bucarest-Rahova (Geanopol c. Roumanie, no 1777/06, § 62, 5 mars 2013, et Constantin Aurelian Burlacu c. Roumanie, no 51318/12, § 27, 10 juin 2014) et à la prison de Mărgineni (Iacov Stanciu¸ précité, § 175, et Necula c. Roumanie, no 33003/11, § 57, 18 février 2014). S’agissant des conditions d’hygiène dans les locaux de détention de la police à Bucarest, les allégations du requérant sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans son rapport rendu à la suite des visites effectuées en 2010 dans les locaux de détention de la police à Bucarest (paragraphe 26 ci-dessus).
45. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait estimer que, par rapport à ces trois établissements, le Gouvernement ait fourni des éléments propres à réfuter la forte présomption de violation de l’article 3 qui découlait d’un espace personnel inférieur à 3 m².
46. Quant à la prison de Giurgiu, la Cour note que les parties sont en désaccord. Le requérant indique avoir été détenu dans des cellules surpeuplées, sans toutefois donner de détails sur leurs dimensions, tandis que le Gouvernement expose que l’intéressé a bénéficié, pendant ses sept mois de détention dans cet établissement, d’un espace de vie compris entre 3,39 m2 et 3,49 m2 (paragraphe 20 ci-dessus). Toutefois, la Cour rappelle avoir déjà conclu dans d’autres affaires à la violation de l’article 3 de la Convention à raison principalement du manque d’espace individuel et des mauvaises conditions d’hygiène dans la prison de Giurgiu, et cela pendant une période correspondant à celle où le requérant y a été incarcéré (Marian Toma c. Roumanie, no 48372/09, § 33, 17 juin 2014, et Adrian Radu c. Roumanie, no 26089/13, § 29, 7 avril 2015). Elle en déduit que, outre la surpopulation carcérale, le requérant a également dû faire face dans cette prison à d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment sur les plans sanitaire et hygiénique (Muršić, précité, § 139).
47. Dès lors, elle estime que les conditions de détention dans les établissements en cause ont soumis le requérant à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
48. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
Article 14 combiné à l'article 8 sur la demande de report de peine pour cause d'enfant de moins d'un an
a) Sur le point de savoir si la situation du requérant était comparable à celle d’une femme détenue ayant un enfant de moins d’un an
64. La Cour rappelle que, pour qu’une question se pose sous l’angle de l’article 14, il doit y avoir une différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 175, CEDH 2007-IV). L’obligation de démontrer l’existence de situations analogues ne signifie pas que les groupes comparés doivent être identiques. Il faut établir que le requérant, eu égard à la particularité de son grief, s’est trouvé dans une situation comparable à celle d’autres personnes qui ont été traitées différemment (Clift c. Royaume-Uni, no 7205/07, § 66, 13 juillet 2010).
65. En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties qu’il y avait en droit roumain une différence de traitement entre deux catégories de détenus ayant un enfant de moins d’un an : les femmes d’un côté, qui pouvaient bénéficier d’un report de l’exécution de la peine, et les hommes de l’autre, auxquels un tel report ne pouvait pas être octroyé. Il reste à déterminer si, par rapport à la formulation d’une demande de report de peine aux termes de l’article 453 § 1 b) du CPP, le requérant se trouvait dans une situation comparable à celle d’une femme détenue ayant un enfant de moins d’un an.
66. La Cour a déjà dit, dans un contexte relatif à l’emploi, que les hommes se trouvent dans une situation analogue à celle des femmes pour ce qui est du congé parental et de l’allocation de congé parental (Petrovic, précité, § 36, et Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 132, CEDH 2012 (extraits)). Dans ces deux affaires, la Cour a conclu, sans ignorer les différences qui pouvaient exister entre le père et la mère dans leur relation avec l’enfant que, pour ce qui est des soins à apporter à l’enfant pendant la période correspondant au congé parental (qui pouvait aller jusqu’aux trois ans de l’enfant dans l’affaire Konstantin Markin, précitée), les hommes et les femmes étaient placés dans des situations analogues.
67. La Cour ne saurait ignorer les arguments du Gouvernement tirés de la différence entre la présente affaire et les affaires relatives au congé parental en raison de la nature pénale de la mesure visée en l’espèce et de la marge d’appréciation dont bénéficie l’État dans la mise en œuvre de sa politique pénale (paragraphe 61 ci-dessus). Elle concède avec le Gouvernement que, la mesure de report d’une peine privative de liberté étant de nature pénale, elle est essentiellement différente du congé parental, qui est une mesure de droit du travail.
68. Toutefois, s’agissant de la question de savoir si, pendant la première année de l’enfant, un père détenu se trouve dans une situation analogue à celle d’une mère détenue, la Cour estime que les conclusions qu’elle a énoncées dans les affaires Petrovic et Konstantin Markin (précitées) sont applicables en l’espèce. En effet, comme le Gouvernement l’admet lui‑même (paragraphe 61 ci-dessus), l’institution du report d’une peine privative de liberté vise en premier lieu l’intérêt supérieur de l’enfant afin d’assurer qu’il reçoive l’attention et les soins adéquats pendant sa première année de vie ; or, bien qu’il puisse y avoir des différences dans leur relation avec leur enfant, tant la mère que le père peuvent apporter cette attention et ces soins (voir, mutatis mutandis, Konstantin Markin, précité, § 132). De plus, la Cour observe que la possibilité d’obtenir le report de la peine s’étend jusqu’au premier anniversaire de l’enfant et va donc au-delà des suites de la grossesse de la mère et de l’accouchement.
69. La Cour estime donc que, en ce qui concerne les faits du litige, le requérant peut prétendre se trouver dans une situation comparable à celle des femmes détenues. Les arguments du Gouvernement tirés de la marge d’appréciation de l’État dans la mise en œuvre de sa politique pénale doivent plutôt être examinés sous l’angle de la justification de la différence de traitement (paragraphe 78 ci-dessous).
b) Sur le point de savoir si la différence de traitement était objectivement justifiée
70. La Cour rappelle qu’une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC], nos 60367/08 et 961/11, § 64, CEDH 2017, et les affaires qui y sont citées).
71. Selon le Gouvernement, le but légitime poursuivi par la législation roumaine reconnaissant aux seules femmes détenues la possibilité d’obtenir le report de l’exécution de leur peine jusqu’au premier anniversaire de leur enfant était de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant nouveau-né (paragraphe 61 ci-dessus). Le Gouvernement fait aussi référence aux liens particuliers qui existent entre la mère et l’enfant pendant les premiers mois suivant la naissance (paragraphe 60 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà dit, dans des affaires concernant le droit au respect de la vie privée et/ou familiale, que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération et qu’il existe un large consensus autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, §§ 95‑96, CEDH 2013, et Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 208, 24 janvier 2017). Elle prend également note des divers instruments européens et internationaux qui traitent des besoins de protection des femmes contre les violences fondées sur le sexe, contre les abus et contre le harcèlement sexuel dans l’environnement pénitentiaire, ainsi que de la nécessité de protéger les femmes enceintes et les mères (paragraphes 27, 28 et 29 ci‑dessus).
72. La Cour rappelle ensuite avoir dit à maintes reprises que les différences fondées sur le sexe doivent être justifiées par des raisons particulièrement sérieuses, et que des références aux traditions, présupposés d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne peuvent en soi passer pour constituer une justification suffisante de la différence de traitement en cause, pas plus que ne le peuvent des stéréotypes du même ordre fondés sur la race, l’origine, la couleur ou l’orientation sexuelle (voir, mutatis mutandis, Konstantin Markin, précité, § 127 ; X et autres c. Autriche [GC], no 19010/07, § 99, CEDH 2013 ; Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 77, CEDH 2013 (extraits) ; et Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, § 109, CEDH 2014). Elle a également affirmé que les autorités nationales, qui se doivent aussi de prendre en considération, dans les limites de leurs compétences, les intérêts de la société dans son ensemble, disposent d’une grande latitude lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur des questions sensibles telles que les politiques pénales (Khamtokhu et Aksenchik, précité, § 85 ; voir également Clift, précité, § 73, et les affaires qui y sont citées, et Costel Gaciu c. Roumanie, no 39633/10, § 56, 23 juin 2015).
73. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a fait une demande de report de sa peine, arguant qu’il avait un enfant de moins d’un an, et que sa demande a été rejetée par les tribunaux internes au motif que la norme qu’il invoquait était d’interprétation stricte et qu’il ne pouvait pas demander son application par analogie (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour estime que, en l’espèce, plusieurs éléments sont à prendre en considération. Ainsi, à l’instar du Gouvernement, elle note que l’octroi aux femmes détenues de la mesure de report de leur peine n’était pas automatique. En effet, il ressort des éléments fournis par les parties que, en présence de demandes similaires formulées par des femmes détenues, les tribunaux internes ont procédé à un examen circonstancié desdites demandes et qu’ils les ont rejetées lorsque la situation personnelle des demanderesses ne justifiait pas un report de l’exécution de la peine (paragraphes 24 et 25 ci‑dessus).
74. La Cour observe ensuite que le droit pénal roumain en vigueur au moment des faits ménageait à tous les détenus, quel que fût leur sexe, d’autres possibilités de demander un report de leur peine. Ainsi, les tribunaux pouvaient notamment examiner si des circonstances spéciales découlant de l’exécution de la peine pouvaient avoir des conséquences graves pour la personne du détenu, mais aussi pour sa famille ou son employeur (paragraphe 22 ci-dessus). Le requérant s’est d’ailleurs prévalu de cette possibilité légale, mais les tribunaux internes ont jugé que les difficultés qu’il évoquait n’entraient pas dans la catégorie des circonstances spéciales prévues par l’article 453 § 1 c) du CPP (paragraphes 9 et 11 ci‑dessus).
75. Il est vrai que la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des États membres du Conseil de l’Europe, et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement (voir, mutatis mutandis, Petrovic, précité, § 37).
76. La Cour prend également en considération les arguments du Gouvernement selon lesquels le but des normes légales en question était de tenir compte de situations personnelles spécifiques, dont la grossesse de la femme détenue et la période précédant le premier anniversaire du nouveau‑né, ayant notamment regard aux liens particuliers qui existent entre la mère et l’enfant pendant cette période (paragraphes 60 et 71 ci-dessus). La Cour estime que ce but peut être tenu pour légitime au sens de l’article 14 de la Convention et que les arguments avancés par le Gouvernement ne sauraient passer pour manifestement dénués de fondement ou déraisonnables. Elle est prête à considérer que, dans le domaine spécifique concerné par la présente affaire, ces considérations peuvent constituer une base suffisante pour justifier la différence de traitement dont a fait l’objet le requérant.
77. En effet, la Cour accepte que la maternité présente des spécificités qu’il convient de prendre en compte, parfois par des mesures de protection. Elle note par exemple que l’article 4 § 2 de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes prévoit expressément que l’adoption par les États parties de mesures spéciales qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire (paragraphe 28 ci-dessus) et que les normes de droit international vont dans le même sens (paragraphe 29 ci-dessus). Elle estime que ces constats sont également valables lorsque la femme fait l’objet d’une mesure de privation de liberté.
78. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, compte tenu de l’ample marge d’appréciation qu’elle reconnaît à l’État défendeur dans ce domaine, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime recherché. L’exclusion litigieuse ne constitue donc pas une différence de traitement prohibée aux sens de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Khamtokhu et Aksenchik, précité, § 87).
79. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de celle-ci.
CATALIN EUGEN MICU c. ROUMANIE du 5 janvier 2016 requête 55014/13
Violation pour surpopulation carcérale mais non violation de l'article 3 pour avoir été contaminé par l'hépatite C et pour la délivrance de soin adéquat. Le requérant n'a pas apporté assez de preuves, ni de précisions sur les conditions de sa contamination alors qu'un rapport médical démontre pourtant qu'il était sain lors de son entrée en prison. En clair pour la CEDH, quand on se fait enculer de force, en prison et qu'on attrape une hépatite C on dit par qui, quand et comment !
54. S’agissant des personnes privées de liberté, la Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État l’obligation d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Soukhovoy c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008, et Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, § 68, 27 novembre 2014). Cette obligation positive requiert que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX).
55. Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII et Helhal c. France, no 10401/12, § 48, 19 février 2015). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à la situation particulière de celui‑ci (Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 91, 24 mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité du traitement avec les exigences de l’article 3 de la Convention. Ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état particulier de santé du détenu. En général, la dégradation de la santé du détenu ne joue pas, en soi, un rôle déterminant quant au respect de l’article 3 de la Convention. La Cour examinera à chaque fois si la détérioration de l’état de santé de l’intéressé était imputable à des lacunes dans les soins médicaux dispensés (Cirillo c. Italie, no 36276/10, § 37, 29 janvier 2013).
i. Quant à la contamination alléguée par le virus de l’hépatite C en prison
56. Se tournant vers la présente affaire, la Cour note qu’en octobre 2012 les médecins ont dépisté l’hépatite C chez le requérant et que celui-ci allègue avoir contracté cette maladie en prison. La Cour considère d’abord que les exigences qui pèsent sur l’État concernant l’état de santé d’un détenu peuvent être différentes s’il s’agit d’une contamination avec une maladie transmissible (voir, par exemple, Fűlöp c. Roumanie, no 18999/04, § 34, 24 juillet 2012 et Ghavtadze c. Géorgie, no 23204/07, § 86, 3 mars 2009 dans lesquelles les requérants alléguaient avoir contracté la tuberculose en prison) ou d’une maladie non‑transmissible (voir, l’affaire Iamandi c. Roumanie, no 25867/03, § 65, 1er juin 2010 dans laquelle le requérant souffrait de diabète). La Cour estime que la propagation des maladies transmissibles et, notamment, de la tuberculose, de l’hépatite et du VIH/SIDA, devrait constituer une préoccupation de santé publique majeure, surtout dans le milieu carcéral. À ce sujet, la Cour estime qu’il serait souhaitable que, avec leur consentement, les détenus puissent bénéficier dans un délai raisonnable après leur admission en prison de tests gratuits de dépistage concernant les hépatites et le VIH/SIDA (voir, en ce sens, Jeladze c. Géorgie, no 1871/08, § 44, 18 décembre 2012 où la Cour avait estimé que le retard de trois ans avant de soumettre le requérant à un dépistage de l’hépatite C constituait une négligence de l’État quant à ses obligations générales de prendre les mesures effectives afin de prévenir la transmission de l’hépatite C ou d’autres maladies transmissibles en prison). Une telle possibilité aurait pu avoir des conséquences sur la charge de la preuve en la matière. Faute d’une telle possibilité ouverte au requérant, la Cour doit examiner les allégations selon lesquelles l’intéressé a contracté l’hépatite C en prison à la lumière des preuves fournies au dossier par l’intéressé.
À cet égard, la Cour note que, lors du placement en détention du requérant en octobre 2009, la fiche médicale établie ne mentionnait pas que l’intéressé souffrait de cette maladie (paragraphe 14 ci-dessus). Selon les documents fournis au dossier de l’affaire devant la Cour, aucun examen par prise de sang n’a été réalisé lors de l’incarcération de l’intéressé pour vérifier si celui-ci était porteur du virus de l’hépatite C. De plus, selon les affirmations du Gouvernement non infirmées par le requérant, la fiche médicale précitée a été complétée en prenant en compte les déclarations de ce dernier. Par conséquent, la Cour estime que les allégations du requérant selon lesquelles il a contracté l’hépatite C en prison ne sont pas étayées par des preuves suffisantes (Vartic c. Roumanie (no 2), no 14150/08, §§ 61 et 62, 17 décembre 2013). Qui plus est, il n’y a pas d’éléments dans le dossier qui pourraient permettre d’indiquer à quel moment et de quelle manière le requérant a contracté l’hépatite C (Ghavtadze, précité, § 79). Dès lors, bien que la maladie en question ait été dépistée alors que le requérant était sous la responsabilité de l’État, la Cour ne peut pas en déduire que cette pathologie a résulté d’un manquement de l’État à ses obligations positives.
ii. Quant au suivi médical et au traitement dispensé en prison pour l’hépatite C
57. La Cour doit examiner à présent si l’État défendeur a satisfait à son obligation positive de fournir au requérant un traitement approprié pour la maladie dont il souffrait.
58. À ce sujet, elle rappelle avoir déjà jugé que, lorsqu’une personne détenue se voit établir un diagnostic d’hépatite C, les autorités doivent prendre le soin d’apprécier la nécessité de réaliser d’autres analyses appropriées qui, elles, permettront d’arrêter le traitement thérapeutique à suivre et d’apprécier les chances de guérison (Poghossian c. Géorgie, no 9870/07, § 57, 24 février 2009 ; concernant les symptômes de l’hépatite virale C, voir Testa c. Croatie, no 20877/04, § 10, 12 juillet 2007).
59. La Cour note en l’espèce que, une fois le diagnostic d’hépatite C établi, le requérant a été suivi par un médecin qualifié. Elle remarque qu’après avoir évalué son état de santé, le médecin a décidé, sur la base des examens médicaux réalisés, qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des examens supplémentaires et a prescrit au requérant un traitement médical à administrer en cas de besoin (paragraphe 17 ci-dessus).
60. Pour ce qui est notamment du suivi médical du requérant, la Cour observe qu’il devait consister principalement en des examens périodiques, à la suite desquels les médecins pouvaient analyser les données recueillies et adapter le cas échéant le traitement à administrer par les médecins des établissements pénitentiaires. Il ressort en effet du dossier médical que le requérant a été hospitalisé à quatre reprises à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava pour une réévaluation de son état de santé (paragraphes 20, 21, 24 et 26 ci-dessus). La Cour relève toutefois que le requérant n’a pas toujours collaboré avec les autorités pour la mise en œuvre du suivi médical nécessaire (voir, a contrario, Cirillo, précité, § 47). Cette absence de collaboration est prouvée en l’espèce par le dossier médical du requérant dans lequel figurent les refus de ce dernier de se soumettre à des examens médicaux recommandés par les médecins (paragraphes 19 et 23 ci‑dessus).
61. Concernant le traitement médical administré, la Cour observe que, lors des examens d’octobre 2012 et d’août 2013, le médecin avait prescrit au requérant une thérapie à administrer « en cas de besoin » et que des hépatoprotecteurs avait été fournis à l’intéressé (paragraphes 18, 21 et 22 ci‑dessus). La Cour note également que, lors de son hospitalisation en février 2014, le requérant s’était vu prescrire un traitement avec un hépatoprotecteur pendant un mois (paragraphe 27 ci-dessus), mais que le médicament en question lui avait été fourni avec un certain retard (paragraphe 28 ci-dessus). Néanmoins, la Cour relève que l’intéressé n’a pas été privé de médicaments pendant une longue période et qu’il n’a pas soutenu devant elle que son état de santé s’était dégradé pendant cette période en raison de l’absence de ce traitement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce, les autorités ont satisfait à leur obligation d’assurer au requérant le traitement médical adapté à sa pathologie.
62. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, à l’égard du requérant, en raison d’une contamination par l’hépatite C ou d’une défaillance dans le suivi médical en prison.
Simeonovi C. Bulgarie du 20 octobre 2015 requête n° 21980/04
Violation de l'article 3 : défaut d'hygiène et de contact avec les autres détenus.
88. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). La question principale qui se pose devant la Cour en la présente affaire est donc de savoir si les conditions matérielles de détention du requérant, combinées avec les modalités d’exécution de sa peine perpétuelle, ont dépassé le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention.
89. Le requérant est incarcéré depuis octobre 1999. Depuis cette date, il est passé par trois établissements pénitentiaires différents : le centre de détention provisoire de Burgas, la prison de Burgas et la prison de Sofia.
90. La Cour relève que les parties s’accordent sur le caractère inadéquat des conditions matérielles qui régnaient au centre de détention provisoire de Burgas entre octobre 1999 et avril 2000, période durant laquelle le requérant y était incarcéré (paragraphes 33-34 ci-dessus). Le rapport de visite du CPT de 1999 corrobore ce constat (paragraphe 54 ci-dessus).
91. Le requérant a été ensuite transféré à la prison de Burgas, où il est resté entre 2000 et 2004 (voir paragraphe 32 ci-dessus). Dans son rapport de visite de 2002, la délégation du CPT a indiqué que le quartier destiné aux prisonniers condamnés à la perpétuité à la prison de Burgas, où le requérant a séjourné, avait été récemment réaménagé, que les cellules individuelles avaient une superficie de 6 m2 et étaient pourvues d’une ventilation et d’un éclairage adéquats. Le problème principal constaté par la délégation du CPT était l’accès restreint aux équipements sanitaires communs et l’utilisation de seaux hygiéniques par les prisonniers (paragraphe 55 ci-dessus).
92. Le 25 février 2004, le requérant a été transféré à la prison de Sofia, où il continue de purger sa peine. Selon les rapports des visites de 2006, 2008 et 2014 du CPT dans cet établissement pénitentiaire, toutes les cellules dans le quartier de haute sécurité de la prison de Sofia avaient des équipements sanitaires intégrés (paragraphes 57-59 ci-dessus). Selon les informations présentées par le Gouvernement, cette partie de la prison a été rénovée en 2005 et 2006 et le requérant y est installé dans une cellule individuelle de superficie convenable (paragraphe 42 ci-dessus). Cependant, le rapport de visite du CPT de 2014 fait de nouveau état d’un délabrement général du quartier de la prison de Sofia destiné aux condamnés à perpétuité, de l’absence de lumière naturelle et de l’hygiène insuffisante des locaux (voir paragraphe 59 ci-dessus).
93. La Cour constate que tout au long de ces années, les modalités d’exécution de la peine perpétuelle du requérant, déterminées par le régime pénitentiaire appliqué à celui-ci, sont restées très contraignantes. Le requérant a été initialement placé sous le régime pénitentiaire dit « spécial » : il passait vingt-trois heures par jour enfermé dans sa cellule, la plupart du temps sur son lit ; son accès à la bibliothèque de la prison se limitait aux quelques minutes nécessaires pour choisir et emprunter un livre ; il pouvait aller à la chapelle de la prison deux fois par an, avec interdiction de rencontrer les autres prisonniers (voir paragraphes 38 et 40 ci-dessus). En 2008, il a bénéficié d’un allègement de son régime pénitentiaire (paragraphe 41 ci-dessus). Toutefois sa cellule continue à être fermée à clé pendant la journée et il continue à être isolé du reste de la population carcérale (ibidem). Les rapports successifs du CPT font apparaître que les prisonniers du quartier de haute sécurité de la prison de Sofia ont très peu d’activités en dehors de leurs cellules et sont isolés du reste des prisonniers (paragraphes 57-59 ci-dessus).
94. Au vu des éléments susmentionnés, et à l’instar de son constat dans le récent arrêt Harakchiev et Toloumov, précité, §§ 203-214, la Cour estime que les mauvaises conditions de détention du requérant, prises ensemble avec le régime restrictif d’exécution de sa peine perpétuelle et avec la longueur de la période d’incarcération concernée, ont soumis le requérant à une épreuve allant au-delà des souffrances inhérentes à l’exécution d’une peine privative de liberté. La Cour estime donc que le seuil de gravité nécessaire à l’application de l’article 3 de la Convention a été dépassé en l’occurrence. Le requérant a été mis dans une situation continue de méconnaissance de son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
95. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention.
SERGEYEV c. RUSSIE arrêt du 6 octobre 2015 requête n° 41090/05
Violation de l'article 3, détention à bref délai mais détention dans une cellule sans fenêtre et sans cour de promenade.
2. Les conditions de détention à l’IVS
48. La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les conditions de détention dans les prisons, elle n’applique pas uniquement le critère de l’espace attribué à chaque détenu, mais qu’elle prend en compte d’autres critères, tels que la possibilité d’utiliser des toilettes en privé, l’aération, la lumière naturelle, le chauffage central, le respect des règles d’hygiène, la possibilité de promenade, la durée de la détention ainsi que l’état physique et mental du détenu (Ananyev et autres, précité, § 149).
49. En l’espèce, la Cour note qu’entre le 29 août 2004 et le 17 février 2005 le requérant a été placé dix fois à l’IVS pour des durées allant de trois à quatorze jours. Elle constate que les parties s’accordent sur les dates des périodes de détention ainsi que sur les numéros des cellules occupées par l’intéressé. Elle rappelle avoir estimé à plusieurs reprises que la détention dans des lieux destinés, de par leur nature même, à accueillir des personnes pour de très courtes durées peut emporter une violation de l’article 3 (voir, parmi beaucoup d’autres, Shchebet c. Russie, no 16074/07, §§ 86-96, 12 juin 2008, Khristoforov c. Russie, no 11336/06, § 23, 29 avril 2010, Nedayborshch c. Russie, no 42255/04, § 32, 1er juillet 2010, Kuptsov et Kuptsova c. Russie, no 6110/03, § 69, 3 mars 2011, Ergashev c. Russie, no 12106/09, §§ 128-134, 20 décembre 2011, et Salikhov c. Russie, no 23880/05, §§ 89-93, 3 mai 2012).
50. La Cour note de surcroît que l’IVS ne disposait pas de cour pour l’exercice en plein air et que les cellules nos 1, 2 et 3 étaient dépourvues de fenêtre (paragraphe 33 ci-dessus). Elle en déduit que, durant la majeure partie de sa détention à l’IVS, le requérant n’a bénéficié ni de lumière naturelle ni d’exercice en plein air.
51. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’effet cumulé de la durée de détention du requérant à l’IVS et des manquements constatés a emporté violation de l’article 3 de la Convention.
SHISHANOV c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA du 15 septembre 2015 requête 11353/06
Violation de l'article 3 : la mauvaise nourriture et les toilettes à la turc dans les prisons sont une violation de la Convention.
PRISON 1
88. Dans la présente affaire, la Cour tient également compte des constats opérés dans le rapport de 2010 du CDH faisant état de la nature systémique du problème de la surpopulation carcérale dans ce pays (paragraphe 55 ci‑dessus). Dans ces conditions, elle considère comme véridique l’affirmation du requérant relative à la taille du dortoir du secteur no 12 et au nombre de personnes y détenues. Il s’ensuit que le requérant n’a disposé que de 1,63 mètres carrés d’espace personnel. Cette surpopulation flagrante soulève en soi un problème grave sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Nieciecki c. Grèce, no 11677/11, §§ 49-51, 4 décembre 2012, Ipati, précité, § 65, Logothetis et autres c. Grèce, no 740/13, §§ 44-47, 25 septembre 2014).
89. La Cour estime à titre surabondant que les allégations du requérant relatives aux conditions d’hygiène, à l’illumination et à la ventilation du dortoir ou à la qualité et à la quantité de la nourriture sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CDH dans son rapport de 2010, ainsi que par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons moldaves (paragraphes 55, 57-60 ci-dessus).
90. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les conditions de détentions subies par le requérant dans l’E.P. no 6 de Soroca ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
PRISON 2
93. Au vu de ce qui précède, la Cour accepte une fois de plus comme authentique la description donnée par le requérant relativement aux conditions de détention dans l’E.P. no 5 de Cahul entre le 11 octobre et le 20 décembre 2006. Elle considère notamment comme établi le fait que, dans la cellule no 3 de cette prison, le requérant disposait d’un espace individuel réduit, à savoir 1,87 mètres carrés, où il était confiné vingt-trois heures par jour. Il apparait donc que le requérant a vécu, durant la période évoquée, dans une grande promiscuité. La Cour rappelle que cet élément soulève à lui seul un problème grave sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir les références citées au paragraphe 88 in fine ci-dessus).
94. La Cour remarque de plus que les allégations du requérant visant la surpopulation carcérale dans l’E.P. no 5 de Cahul sont confortées par les constats concernant l’ensemble du système pénitentiaire moldave, opérés par le CPT et par le CDH dans leurs rapports respectifs (paragraphes 55, 57‑60 ci-dessus).
95. Les éléments exposés ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure que les conditions de détentions subies par le requérant dans l’E.P. no 5 de Cahul entre le 11 octobre et le 20 décembre 2006, indépendamment de la durée relativement courte de cette détention, n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Tadevossian c. Arménie, no 41698/04, § 55, 2 décembre 2008).
PRISON 3
97. En l’espèce, la Cour prend acte de la décision du juge d’instruction du tribunal de Taraclia du 18 juillet 2011 (paragraphe 42 ci-dessus) qui a estimé que l’absence de cuvette dans les toilettes de la prison de Taraclia empêchait le requérant, compte tenu du fait que celui-ci ne pouvait pas s’accroupir, de satisfaire ses besoins dans des conditions non dégradantes. Le juge en question a également relevé que le requérant ne pouvait pas se laver dans des conditions convenables en raison de l’absence de chaise ou d’un autre support dans les douches de cette prison.
98. La Cour note ensuite que, d’après le requérant, celui-ci a reçu un tabouret pour prendre la douche, mais qu’en revanche la cuvette dans les toilettes n’a jamais été installée (paragraphe 38 ci-dessus). Elle observe que le Gouvernement n’a pas contesté cette dernière affirmation du requérant et qu’il n’a pas non plus apporté la preuve qu’une telle cuvette a jamais été mise en place.
99. Force est donc de constater que le requérant a dû utiliser des toilettes turques tout au long de son séjour dans l’E.P. no 1 de Taraclia. Bien que les parties ne soient pas d’accord au sujet des dates exactes de détention du requérant dans les différentes prisons, il apparait que ce dernier a passé, en tout état de cause, plusieurs mois dans l’E.P. no 1 de Taraclia. À l’instar du juge d’instruction du tribunal de Taraclia, la Cour estime que le handicap du requérant l’empêchait de toute évidence d’utiliser les toilettes en question d’une manière qui ne le soumettait pas à une épreuve humiliante ou avilissante. Elle constate également que les autorités n’ont rien entrepris pour remédier à cela.
100. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les conditions de détentions subies par le requérant dans l’E.P. no 1 de Taraclia ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Semikhvostov, précité, § 81).
Muršić c. Croatie du 12 mars 2015 requête no 7334/13
Non violation de l'article 3 : Le manque d’espace d’un détenu en Croatie était compensé par son accès à des installations sportives et un temps suffisant passé hors de sa cellule
La Cour juge préoccupant le fait que l’espace personnel accordé au requérant ne respectait pas la recommandation du CPT de 4 m² d’espace personnel par détenu, mais à ses yeux cette situation n’a pas atteint un point extrême justifiant en soi un constat de violation de l’article 3 de la Convention.
En particulier, la Cour relève que le requérant a disposé d’un espace personnel variant entre 3 et 7,39 m² et que, occasionnellement, ce chiffre est tombé légèrement en-dessous de 3 m² pendant des périodes brèves et non consécutives, notamment pendant un intervalle de 27 jours, dont elle prend note avec préoccupation.
Toutefois, la Cour observe que le requérant était autorisé pendant trois heures par jour à circuler librement hors de sa cellule ; que celle-ci était pourvue d’une ouverture laissant passer sans entrave la lumière naturelle et l’air extérieur, ainsi que d’un point d’eau potable ; que l’intéressé disposait d’un lit individuel et que rien ne l’empêchait de circuler librement à l’intérieur de la cellule. De plus, la Cour relève l’existence de diverses activités à l’extérieur des cellules que les détenus à la prison de Bjelovar avaient à leur disposition, telles qu’une bibliothèque et l’accès à des loisirs.
Dans ces conditions, eu égard au fait que le requérant, pendant sa détention, jouissait d’une liberté de circulation suffisante et qu’il était détenu dans un établissement pour le reste tout à fait convenable, la Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour que le traitement qu’il a subi puisse passer pour inhumain ou dégradant au sens de l’article 3.
La Cour réaffirme les principes généraux exposés dans son arrêt en l’affaire Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 (requêtes nos 42525/07 et 60800/08), et précise sa jurisprudence sur la question du surpeuplement carcéral. Le critère exposé dans l’affaire pour décider s’il y a eu ou non violation de l’article 3 en ce qui concerne le manque d’espace personnel dont dispose un détenu est triple : chaque détenu doit disposer d’une possibilité de couchage individuel dans la cellule ; chaque détenu doit disposer d’au moins 3 m² d’espace au sol ; et la surface globale de la cellule doit être telle qu’elle autorise les détenus à circuler librement entre les meubles.
Si en général le fait qu’un détenu dispose de moins de 3 mètres carrés d’espace au sol donne lieu à une forte présomption que les conditions de détention équivalent à un traitement dégradant contraire à l’article 3, la Cour estime que dans certaines conditions cette forte présomption peut être renversée par les aspects cumulés des conditions de détention, tels que ceux établis dans l’affaire du requérant.
Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.
Vargas et autres contre Hongrie du 10 mars 2015
requêtes no 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 et 64586/13
Violation de l'article 3 : La Hongrie doit prendre des mesures pour résoudre le problème généralisé de la surpopulation carcérale dans des prisons aux mauvaises conditions sanitaires et d'hygiène.
La Cour rappelle les principes généraux de sa jurisprudence en matière de surpopulation carcérale.
Elle signale en particulier que, si le fait pour un détenu de disposer de moins de 3 m2 d’espace personnel laisse fortement présumer que la détention de celui-ci s’analyse en un mauvais traitement
au sens de l’article 3 de la Convention, cette présomption peut parfois être contrebalancé par les effets cumulatifs des conditions de détention, notamment la brièveté de l’incarcération du détenu, la liberté de mouvement dont il dispose (dans la cellule et dans le reste de la prison) et la possibilité de faire de l’exercice en plein air. À l’inverse, même lorsque l’espace personnel dont dispose un détenu paraît suffisant (de 3 à 4 m2 par personne), la Cour peut conclure à l’existence d’une violation de l’article 3 lorsque l’exiguïté de l’espace vital s’ajoute à l’insuffisance de la ventilation et de l’éclairage, au manque d’activités extérieures et à de mauvaises conditions sanitaires et d’hygiène.
Faute pour le gouvernement hongrois d’avoir contesté les faits exposés par les requérants ou d’avoir fourni des documents de nature à les réfuter, la Cour n’aperçoit aucune raison de mettre en doute les allégations formulées par les intéressés au sujet de l’espace personnel disponible dans leurs cellules respectives, et elle observe que les allégations en question coïncident avec les informations figurant dans des rapports établis par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») ainsi que par le commissaire hongrois aux droits fondamentaux, lesquels font état d’une surpopulation généralisée dans les prisons hongroises.
La Cour observe en particulier que l’exiguïté de l’espace personnel dont M. Pesti disposait – 2,86 m2 au maximum – est suffisamment grave pour s’analyser en un traitement dégradant aux fins de la Convention, compte tenu en particulier du fait que cette situation a duré trois ans. En ce qui concerne les autres requérants, elle observe que d’autres aspects de la détention que le grief principal de surpopulation carcérale sont à prendre en compte, notamment le caractère inapproprié des installations sanitaires, l’infestation des cellules par des insectes, l’insuffisance de la ventilation et du couchage, l’accès restreint aux douches et le manque de temps passé hors cellule.
En conséquence, la Cour conclut que l’exiguïté de l’espace personnel disponible pour chacun des six requérants, aggravée par les effets cumulatifs des autres aspects de leur détention, contrevient aux normes européennes fixées par le CPT et par la jurisprudence de la Cour. La détresse et les épreuves endurées par les requérants ont par conséquent excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et ont atteint le seuil de gravité requis pour être qualifiées de mauvais traitements.
TATISHVILI C. GRECE du 31 juillet 2014 requête n°26452/11
Violation de l'article 3 pour les conditions d'hygiène dans un centre de détention pour un étranger.
38. La Cour réaffirme tout d’abord que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
39. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003‑II). La Cour a ainsi jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales ; elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI).
40. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. Il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3. Cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudła, précité, §§ 92-94 ; Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006‑IX).
41. Si les Etats sont autorisés à placer en détention des candidats à l’immigration en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, CEDH 2005-XIII). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008).
42. En l’espèce, la Cour relève qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison du caractère inadéquat des conditions de détention prévalant aux centres de rétention faisant l’objet de la présente requête. S’agissant du centre de rétention de Petrou Ralli, elle a déjà jugé dans l’affaire Bygylashvili que les conditions de détention de la requérante, détenue de juillet 2010 à janvier 2011, n’étaient pas conformes à l’article 3 de la Convention, en raison notamment du surpeuplement qui prévalait dans ces locaux (Bygylashvili, précité, § 59). La Cour relève que la période concernée par l’arrêt précité coïncide en partie avec celle relative à la détention du requérant en l’espèce. De surcroît, les allégations du requérant quant au centre de rétention de Petrou Ralli pour la période d’août 2010 à janvier 2011 ainsi que des périodes postérieures aux faits, sont corroborées par plusieurs rapports concordants d’organes internationaux suite à des visites effectuées avant et après la période litigieuse.
43. En particulier, dans son rapport publié le 17 novembre 2010, suite à sa visite en Grèce du 17 au 29 septembre 2009, le CPT a relevé entre autres des problèmes relatifs à l’hygiène personnelle des détenus. De surcroît, dans son rapport de 2012, publié suite à sa visite en Grèce en janvier 2011, le CPT a constaté que la conception du centre de Petrou Ralli, parmi d’autres centres de rétention, était inappropriée pour la détention de migrants en situation irrégulière (voir paragraphe 27 ci-dessus). En outre, dans son rapport de novembre 2010, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés notait, parmi d’autres, une détérioration des conditions de détention à la Direction des étrangers à Petrou Ralli suite à l’entrée en vigueur en 2009 de la nouvelle loi sur la rétention des immigrés en situation irrégulière (voir paragraphe 29 ci-dessus). Enfin, la Cour note que le Gouvernement lui-même admet que le requérant a dû partager au centre de Petrou Ralli sa cellule d’une superficie de 12 m2 avec cinq autres détenus. Il disposait donc d’un espace personnel de moins de 3 m2 ce qui, en principe, justifie, à lui seul, le constat de violation de l’article 3 (voir paragraphe 21 ci-dessus, ainsi que Samaras et autres c. Grèce, no 11463/09, § 58, 28 février 2012 ; Aleksandr Makarov c. Russie, no 15217/07, § 93, 12 mars 2009).
44. Quant à la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique, la Cour relève que dans l’affaire Tabesh c. Grèce (no 8256/07, arrêt du 26 novembre 2009), elle a déjà considéré que le fait d’y maintenir l’intéressé pour une période de trois mois, au début de 2007, s’analysait en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. La Cour a notamment relevé des insuffisances quant aux activités récréatives et à la restauration appropriée de l’intéressé. Elle a ajouté que les locaux en cause n’étaient pas des lieux appropriés pour la détention que le requérant, mis en détention en vue de son expulsion administrative, avait dû subir (Tabesh, précité, § 43). La Cour note que ses considérations dans l’arrêt Tabesh sont corroborées, en ce qui concerne la période postérieure à cet arrêt, par le rapport d’Amnesty International de 2010 qui fait état au début de cette année de problème de surpeuplement, de l’impossibilité d’activités récréatives et de l’insuffisance des repas offerts (voir paragraphe 24 ci-dessus). En outre, la Cour note que dans sa déclaration publique de janvier 2011, le CPT a en général constaté que les commissariats de police et des gardes-frontière abritaient un nombre sans cesse plus important d’étrangers en situation irrégulière dans des conditions bien pires encore qu’auparavant (voir paragraphe 28 ci-dessus).
45. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions générales de vie prévalant dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique et de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli), qui ont constitué à l’endroit du requérant un traitement dégradant.
FLORIN ANDREI C. ROUMANIE du 15 avril 2014 requête 33228/05
NON ACCES AUX TOILETTES DES PERSONNES MISES EN GARDE A VUE
42. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que toute personne détenue le soit dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, qui ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être de la personne détenue sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI). Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
43. L’État est donc tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Choukhovoï c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008, et Benediktov c. Russie, no 106/02, § 37, 10 mai 2007). Cela peut impliquer l’obligation, à la charge de l’État, de prendre des mesures afin de protéger un détenu contre les effets nocifs du tabagisme passif lorsque, au vu des examens médicaux et des recommandations des médecins traitants, son état de santé l’exige (Elefteriadis c. Roumanie, no 38427/05, § 48, 25 janvier 2011, et Pavalache c. Roumanie, no 38746/03, § 88, 18 octobre 2011).
44. En l’espèce, s’agissant en particulier de l’espace personnel accordé au requérant, la Cour observe que d’après les informations fournies par le Gouvernement, le requérant partageait sa cellule avec neuf autres personnes. Ce faisant, il disposait d’un espace individuel inférieur à quatre mètres carrés, soit une superficie en deçà de la norme recommandée par le CPT pour les cellules collectives (Marin Vasilescu, précité, § 33).
45. La Cour note également que les autres allégations du requérant relatives aux conditions d’hygiène, notamment en ce qui concerne un manque d’accès au toilettes, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites tant par le CPT dans son rapport établi à la suite de sa visite de 2006 dans plusieurs locaux de détention de la police roumains que par l’organisation non gouvernementale APADOR-CH dans son rapport établi à la suite de sa visite du 22 novembre 2013 dans les locaux de détention de la police départementale de Constanţa où le requérant a séjourné.
46. La Cour estime que les conditions de détention en cause n’ont pas manqué de soumettre le requérant à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Retunscaia c. Roumanie, no 25251/04, § 77, 8 janvier 2013, Pop Blaga c. Roumanie, no 37379/02, § 46, 27 novembre 2012, Tadevosyan c. Arménie, no 41698/04, § 55, 2 décembre 2008, et Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).
47. En outre, elle constate que certains aspects de ces conditions étaient de nature humiliante pour le requérant. Il s’agit, en particulier, du fait que l’accès de l’intéressé aux toilettes se trouvant à l’extérieur de sa cellule était possible seulement lorsque les gardiens le permettaient et non chaque fois qu’il en éprouvait lui-même le besoin. Aussi lui arrivait-il de faire ses besoins dans un seau, en présence des autres détenus (Kehayov c. Bulgarie, no 41035/98, §§ 70-71, 18 janvier 2005). Qui plus est, aux dires du requérant, ce seau était de plus d’une contenance insuffisante, étant donné le nombre de personnes qui s’en servaient, situation qui pouvait être à l’origine de problèmes de santé liés à l’obligation de se retenir d’uriner. En outre, l’absence de distribution de produits élémentaires d’hygiène, dénoncée par les rapports du CPT, ne pouvait qu’augmenter les risques sanitaires auxquels le requérant a été exposé durant sa détention provisoire.
48. Au vu de ce qui précède, il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention.
CHKHARTISHVILI c. GRÈCE arrêt du 2 mai 2013 requête 22910/10
Dans cet arrêt, la CEDH définit les conditions d'exercice physique et la restauration
59. Cela étant, la Cour constate en l’espèce des manquements spécifiques sur deux points que le Gouvernement ne met pas en cause, à savoir les questions de qualité de la restauration et de possibilité d’exercice physique pour la requérante. Ces deux points ont déjà fait l’objet d’affaires relatives aux conditions de détention en Grèce, dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention (Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, § 36, 2 juillet 2009 ; Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, § 37, 29 octobre 2009 ; Tabesh, §§ 40-42, et Efremidze, § 38, précités).
60. Comme dans les affaires précitées, la Cour estime qu’en l’espèce le régime afférent à la possibilité de loisirs et à la restauration dans les locaux de police où la requérante a été détenue pendant six mois pose en soi problème au regard de l’article 3 de la Convention. En particulier, l’impossibilité de se promener ou de pratiquer une activité en plein air risquait de faire naître chez la requérante un sentiment d’isolement par rapport au monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur son bien-être physique et moral (Efremidze, précité, § 39).
61. En outre, la Cour a des doutes sérieux quant à l’adéquation de la somme allouée à la requérante pour garantir une restauration conforme aux exigences du CPT (paragraphes 36-37 ci-dessus). Il est à noter que le versement aux détenus d’un montant modique pour satisfaire leurs besoins alimentaires ne saurait être considéré en soi comme contraire à l’article 3, lorsqu’il s’agit d’une détention de très courte durée. Néanmoins, pour des détentions plus longues, semblables à celle de la requérante, les autorités compétentes doivent garantir une alimentation journalière adéquate et suffisante, le cas échéant par la mise en place d’une structure interne pour la restauration des détenus. La Cour rappelle sur ce point que le CPT se réfère explicitement dans son rapport de 2008 à la nécessité de garantir à des personnes détenues et se trouvant dans une situation semblable à celle de la requérante un plat cuisiné – chaud de préférence – au moins une fois par jour. Par ailleurs, dans son rapport de 2010, il souligne que l’allocation journalière de 5,87 euros ne permettait d’acheter que quelques sandwiches et une bouteille d’eau, ce qui était suffisant pour des prévenus en détention de courte durée, mais insuffisant pour des personnes détenues pour une longue durée.
62. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné cette question dans l’arrêt Tabesh (précité), où elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions dans lesquelles le requérant avait été détenu dans les mêmes locaux, à l’époque ceux de la police des étrangers de Thessalonique. En particulier, la Cour a considéré que les insuffisances quant aux activités récréatives et à la restauration appropriée du requérant résultaient du fait que ces locaux n’étaient pas des lieux appropriés pour la détention du requérant. Il s’agissait de lieux destinés, de par leur nature même, à accueillir des personnes pour de très courtes durées. Par conséquent, ils n’étaient en rien adaptés aux besoins d’une détention de trois mois et imposée, de plus, à une personne qui ne purgeait pas une peine pénale mais qui se trouvait en attente de l’application d’une mesure administrative (Tabesh, précité, § 43).
63. Or ces considérations s’appliquent d’autant plus dans la présente affaire où la requérante a été détenue près de six mois.
64. Dès lors, la Cour estime que le fait de maintenir la requérante en détention pendant six mois dans les locaux du service de la répression de l’immigration clandestine de Thessalonique dans de telles conditions s’analyse en un traitement dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
CANALI C. FRANCE arrêt du 25 avril 2013 requête 40119/09
Dans cet arrêt, la CEDH définit les conditions de promenade d'accès aux toilettes
50. Dans les affaires où la surpopulation n’est pas importante au point de soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour rappelle que d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, le mode d’aération, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Aussi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière (Moisseiev c. Russie, no 62936/00, 9 octobre 2008 ; Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70‑72, CEDH 2001-III). De plus, la Cour a souvent considéré qu’un exercice en plein air d’une durée très limitée constituait un facteur qui aggravait la situation du requérant, confiné dans sa cellule pour le reste de la journée sans aucune liberté de mouvement (Gladkiy c. Russie, no 3242/03, § 69, 21 décembre 2010 et Yevgeniy Alekseyenko c. Russie, no 41833/04, § 88, 27 janvier 2011).
51. S’agissant de la présente affaire, la Cour note que le requérant ne disposait que d’une possibilité très limitée de passer du temps à l’extérieur de la cellule. Ainsi, et le Gouvernement ne le conteste pas, l’intéressé affirme avoir été confiné la majeure partie de la journée dans sa cellule sans liberté de mouvement, la seule activité extérieure dont il bénéficiait étant la promenade du matin ou de l’après-midi à l’air libre (paragraphe 19 ci‑dessus) dans une cour de 50 m². Or, la Cour rappelle que selon les normes du (2ème rapport général d’activité (CPT/Inf (92) 3 du 13 avril 1992, cité dans l’arrêt Samaras précité), l’exigence d’après laquelle les prisonniers doivent être autorisés chaque jour à au moins une heure d’exercice en plein air est largement admise comme une garantie essentielle (de préférence, elle devrait faire partie intégrante d’un programme plus étendu d’activité) ; il faut aussi que les aires d’exercice extérieures soient raisonnablement spacieuses. Au regard de ces éléments, la Cour estime que les modalités et la durée très limitées des périodes que le requérant était autorisé à passer hors de la cellule qu’il occupait aggravaient sa situation (voir également, paragraphe 49 ci‑dessus).
52. Concernant l’installation sanitaire et l’hygiène, la Cour rappelle que l’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain et que les détenus doivent jouir d’un accès facile aux installations sanitaires et protégeant leur intimité (Ananyev, précité, §§ 156 et 157). La Cour observe en l’espèce que les toilettes se situaient dans la cellule, sans cloison, avec pour seules séparations un muret et, en l’absence de réparation de la porte, un rideau ; ainsi, le requérant et son compagnon de cellule devaient les utiliser en présence l’un de l’autre, en l’absence d’intimité, étant précisé que le lit était situé à 90 cm de celles-ci. Or, la Cour rappelle que selon le CPT, une annexe sanitaire qui n’est que partiellement cloisonnée n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu (CPT/Inf (2012) 13, précité, § 78). Les photographies fournies par l’administration pénitentiaire au juge d’instruction ne permettent pas de dire que l’installation sanitaire était délabrée ou en mauvais état de fonctionnement ; en revanche, elles démontrent qu’elle n’offrait aucune intimité réelle (voir, par exemple, Mustafayev c. Ukraine, no 36433/05, § 32, 13 octobre 2011 ; Veniosov c. Ukraine, no 30634/05, § 36, 15 décembre 2011). Par ailleurs, eu égard aux pièces du dossier, la Cour n’est pas en mesure de confirmer les allégations du requérant quant au délabrement des installations de douche et à la présence de cafards dans les cellules, mais les conditions d’hygiène décrites, notamment le manque de propreté, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par des magistrats et des hommes politiques dénonçant la vétusté de l’établissement (paragraphes 25 et 26 ci-dessus).
53. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère que l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles d’hygiène ont provoqué chez le requérant des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser. Dès lors, la Cour estime que ces conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
Melnītis c. Lettonie du 28 février 2012 Requête no 30779/05
La Cour considère que les toilettes, dans la cellule occupée par M. Melnītis, n’étaient pas séparées du reste de la pièce, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement. Les allégations de M. Melnītis selon lesquelles il devait utiliser les toilettes à la vue de ses compagnons de cellule et voyait ces derniers lorsqu’ils en faisaient autant sont claires et cohérentes. Sa version est d’ailleurs confirmée par des informations émanant tant de l’organe national chargé de surveiller le respect des droits de l’homme que du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), organe du Conseil de l’Europe.
En outre, pendant sa détention M. Melnītis – ainsi que l’a d’ailleurs concédé le Gouvernement – s’est trouvé dans l’incapacité de garder une bonne hygiène corporelle et dès lors a dû se sentir constamment sale et humilié pendant cinq mois. Cette situation a manifestement soumis l’intéressé à une détresse et à une épreuve ayant excédé le niveau de souffrance qui est inhérent à la détention. L’attitude clairement dédaigneuse des autorités internes face aux demandes légitimes du requérant, qui souhaitait des articles d’hygiène, est encore plus inacceptable.
En conséquence, la Cour conclut que les conditions dans lesquelles M. Melnītis a été détenu ont dû provoquer chez lui des sentiments d’angoisse, d’infériorité et d’humiliation propres à briser sa résistance physique ou morale, et que dès lors il y a eu violation de l’article 3.
KHUROSHVILI c. GRÈCE du 12 décembre 2013 requête 58165/10
79. La Cour réaffirme tout d’abord que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques et qu’il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
80. Elle rappelle ensuite que, si les Etats sont autorisés à placer en détention des candidats à l’immigration en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996‑III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). Elle rappelle également qu’elle doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008).
81. S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz, précité). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).
82. En matière de surpopulation dans les prisons, la Cour note que les rapports généraux établis par le CPT n’indiquent pas explicitement le minimum d’espace personnel dont devrait disposer chaque détenu placé dans des cellules partagées. Il ressort toutefois des rapports nationaux du CPT et recommandations qui y sont faites aux Etats que le standard minimum souhaitable devrait être fixé à 4 m² par détenu. De son côté, la Cour, saisie d’affaires où un requérant disposait de moins de 3 m² d’espace personnel, a considéré que cet élément, à lui seul, suffisait pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 144-145, 10 janvier 2012, avec d’autres références).
83. En revanche, dans des affaires où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Par ailleurs, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière (Moïsseïev c. Russie, no 62936/00, 9 octobre 2008 ; voir également Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008 ; Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007), d’un accès limité à la promenade en plein air (István Gábor Kovács c. Hongrie, no 15707/10, § 26, 17 janvier 2012) ou d’un manque total d’intimité dans les cellules (voir, mutatis mutandis, Belevitski c. Russie, no 72967/01, §§ 73-79, 1er mars 2007 ; Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 106-107, CEDH 2005-X ; et Novosselov c. Russie, no 66460/01, §§ 32 et 40-43, 2 juin 2005).
84. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été détenu, du 7 juillet au 23 octobre 2010, dans le centre de répression de l’immigration clandestine d’Aspropyrgos.
85. La Cour note aussi que les parties présentent des versions qui ne coïncident pas quant aux conditions de détention prévalant au centre d’Aspropyrgos.
86. La Cour relève que le requérant se plaint de la surpopulation, du manque d’argent pour se nourrir (la somme allouée par l’administration ne lui permettant que l’achat de deux sandwiches par jour), ainsi que du manque d’aération et d’éclairage, de sanitaires, d’infrastructures pour la restauration des détenus et d’espace pour l’activité physique (paragraphe 28 ci-dessus). De son côté, le Gouvernement prétend que le centre dispose de suffisamment de douches et de WC dont l’accès est libre, qu’à chaque étage il existe un espace de 20 m² où les détenus peuvent téléphoner et se renseigner sur leurs droits au moyen de brochures, que chaque dortoir a deux fenêtres, que la nourriture est fournie par le restaurant du quartier général de la police de l’Attique et que le nettoyage et la désinfection des lieux sont régulièrement assurés par une entreprise (paragraphes 36-42 ci-dessus).
87. La Cour relève que selon les affirmations du Gouvernement, pendant la période de détention du requérant, le centre accueillait 136 détenus sur une surface totale habitable de 240 m² (paragraphes 36 et 42 ci-dessus). Quelle que soit la superficie exacte de la cellule où le requérant passait l’essentiel de ses journées, l’espace qui, selon le Gouvernement, était attribué au requérant, était inférieur à celui qui, selon la jurisprudence rappelée dans l’arrêt Ananyev et autres, précité, suffit à conclure à la violation de l’article 3, sur cette seule base.
88. En outre, la Cour constate que dans ses rapports sur le centre d’Aspropyrgos, établis à la suite de deux visites consécutives en 2008 et 2011 (paragraphes 57-58 ci-dessus), le CPT relevait que la situation dans ce centre ne s’était pas sensiblement améliorée durant cette période : les cellules étaient sales et, au moment de leur admission, les détenus ne recevaient pas de produits d’hygiène personnelle ni de couvertures propres. L’endroit était infesté de cafards. L’accès aux toilettes pendant la nuit était toujours problématique et il n’était toujours pas possible aux détenus de faire de l’exercice physique à l’extérieur du bâtiment, faute de cour extérieure et en dépit du fait que le centre était entouré de terrains vagues.
89. Dans ces conditions, la Cour estime que du fait de sa détention de plus de trois mois au centre d’Aspropyrgos, le requérant a été soumis à un traitement dégradant incompatible avec l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
ARTIMENCO c. ROUMANIE Requête no 12534/04 du 30 juin 2009
31. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
32. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, § 162, série A no 25).
33. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
34. La Cour relève d’emblée que les faits décrits par la requérante au paragraphe 11 ci-dessus relatifs au manque de chauffage dans sa cellule à l’IGP ne peuvent pas être considérés comme étant établis, aucun élément du dossier ne venant les étayer. Tel n’est pas le cas s’agissant, en revanche, de ses allégations relatives au surpeuplement de ses cellules au dépôt de police de Galaţi et aux centres pénitentiaires de Rahova et de Târgsorul Nou, où, selon l’intéressée, le nombre de lits était inférieur au nombre de détenus qui y étaient incarcérés.
35. A cet égard, la Cour note que le Gouvernement n’a fourni de renseignements ni quant au nombre de codétenus avec lesquels la requérante a dû effectivement partager les cellules du dépôt de police de Galaţi ou des prisons de Rahova et Târgşorul Nou ni quant à la taille de la cellule où l’intéressée a été détenue au dépôt de police de Galaţi. La Cour renvoie à sa jurisprudence sur la manière dont, dans des affaires similaires, elle a fait application du principe affirmanti incumbit probatio lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant. (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X (extraits), et Seleznev, précité, § 41). Le fait invoqué, en l’occurrence, par le Gouvernement que les registres de la prison ne contiennent plus à ce jour de telles informations ne saurait constituer une raison suffisante pour écarter purement et simplement les allégations de l’intéressée en matière de surpeuplement de ses cellules. Il en est ainsi d’autant plus qu’en la présente espèce, les conditions décrites par la requérante sont similaires à celles relevées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) lors de ses visites dans les différents établissements pénitentiaires roumains, dont ceux de l’IGP et du dépôt de police de Galaţi, visites qu’il a rendues à l’époque où l’intéressée y était incarcérée (paragraphe 22 ci-dessus). Il ressort clairement du rapport du CPT que le taux d’occupation des cellules dans les établissements en question, ainsi que, de façon plus générale, dans la plupart des établissements pénitentiaires roumains, était extrêmement élevé et que de nombreux détenus étaient à l’époque obligés de partager un lit (paragraphe 22 ci-dessus).
36. Même à supposer, en l’absence d’informations du Gouvernement, que le taux d’occupation des cellules de la requérante correspondait au nombre de lits qu’il y avait dans chacune d’entre elles, la requérante ne disposait que d’un espace d’environ 1,9 m2 au centre pénitentiaire de Rahova et d’environ 2,15 m2 au centre pénitentiaire de Târgsorul Nou, ce qui était bien en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT dressé à l’issue de ses visites dans les établissements pénitentiaires roumains (paragraphe 23 in fine ci-dessus). A cela s’ajoute les conditions sanitaires dans lesquelles la requérante a dû, en plein hiver, prendre la douche, à savoir dans un autre bâtiment extérieur à celui où elle était hébergée, situation reconnue par les autorités pénitentiaires de Târgsorul Nou et qui, nonobstant le fait qu’elle ait été occasionnée par des louables travaux de réparation et d’entretien, n’était pas moins difficile. De plus, la Cour relève que l’intéressée a été à plusieurs reprises privée de nourriture pendant de nombreuses heures lors de ses transports en vue d’assister au jugement des demandes de prolongation de sa détention provisoire, fait que le Gouvernement ne conteste pas et qui semble de surcroît conforme aux pratiques nationales en vigueur à l’époque des faits, selon lesquelles les détenus n’avaient pas le droit de recevoir de la nourriture pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un autre ou pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un parquet ou à un tribunal si la durée de ce transport était inférieure à douze heures (paragraphe 20 in fine ci-dessus).
Cet état de choses, considéré dans son ensemble, soulève en soi une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
37. La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser la requérante. Toutefois, elle rappelle que, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (Peers précité). Elle estime que les conditions de détention relevées au paragraphe 36 ci-dessus que la requérante a dû supporter pendant près de vingt mois d’emprisonnement n’ont pas manqué de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Que l’intéressée eût accès aux livres et aux nombreux périodiques de la bibliothèque de la prison, qu’elle disposât d’un poste de radio et de télévision dans sa cellule et que les autorités aient entrepris des travaux de modernisation des bâtiments et des installations sanitaires de la prison, aussi louable que soit la chose, n’y change rien.
38. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention de la requérante, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule et les conditions dans lesquelles elle a été transportée, sans nourriture, en vue d’assister aux audiences auxquelles elle avait été citée par les juridictions qui ont connu de la cause pénale dirigée contre elle, s’analysent en un traitement dégradant.
39. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
IAMANDI c. ROUMANIE DU 1er JUIN 2010 REQUÊTE N° 25867/03
LA VETUSTE DE LA PRISON EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT
61. La Cour note également que dans le centre de détention de Giurgiu, les sanitaires situés dans les cellules, sans aucune séparation, ne satisfaisaient pas aux conditions normales d'hygiène et d'intimité (Kalachnikov précité, § 99). De plus, d'après les informations fournies par le Gouvernement, l'intéressé était confiné la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d'une promenade dans la cour de la prison que pendant une durée très réduite, à savoir trente minutes par jour (cf. § 23 ci-dessus). Cette situation est contraire aux normes du CPT qui recommandent un minimum d'une heure d'exercice en plein air. En renvoyant aux conditions de détention décrites par les parties, la Cour juge que de telles conditions, dans leur ensemble, sont particulièrement graves (cf. Viorel Burzo précité, § 99).
62. La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l'article 3 de la Convention en raison principalement du manque d'espace individuel suffisant (voir, entre autres, Petrea, précité, §§ 45 et suivants, Seleznev, précité, §§ 46-47, et Khoudoyorov, précité, §§ 104 et suivants). La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années, n'ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
DETENUS NON FUMEURS ENFERMES AVEC DES FUMEURS
Elefteriadis contre Roumanie du 25 janvier 2010 requête n° 38427/05
ENFERMER UN NON FUMEUR AVEC UN FUMEUR EST UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3
Le grief du requérant concernant la période de juin 1994 à décembre 2000 est rejeté comme tardif. Son grief relatif au manquement à recevoir des soins appropriés est rejeté pour non épuisement des voies de recours. La Cour examine les conditions de la détention du requérant au centre de Rahova et lors de ses transports entre la maison d’arrêt et les tribunaux.
La Cour rappelle que l’Etat est tenu, indépendamment des problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire pour assurer aux détenus le respect de leur dignité. Le requérant s’est trouvé enfermé entre février et novembre 2005 dans une cellule avec des détenus fumeurs, en dépit de ses demandes répétées d’être transféré dans une cellule non-fumeurs. Si son état de santé a connu une stabilisation entre 2003 et 2005, la fibrose pulmonaire pour laquelle il était en observation depuis plusieurs années était une maladie chronique. Les autorités étaient donc tenues de prendre des mesures pour sa santé en le séparant des fumeurs, ce qui était possible vu l’existence, dans la même maison d’arrêt, d’une cellule de détenus non-fumeurs.
La surcharge du centre de détention de Rahova – confirmée par le CPT2 dans ses rapports de visites – ne dispensait aucunement les autorités de leur obligation de protéger la santé du requérant. Les promenades quotidiennes dans la cour de la prison, les activités sportives et une cellule relativement grande, non surpeuplée et pourvue de lumière et de ventilation naturelles, ne suffisaient pas à pallier les effets nocifs du tabagisme passif que le requérant subissait en raison de sa cohabitation avec des détenus fumeurs.
Les certificats médicaux établis après 2005 par plusieurs médecins attestaient une détérioration de son état de santé au niveau de ses voies respiratoires et mentionnaient l’apparition chez lui d’une nouvelle maladie, la bronchite chronique obstructive, aggravée, selon le requérant, par le tabagisme passif subi dans les moyens de transport empruntés à destination des tribunaux ou dans les espaces d’attente avant sa comparution devant les juges nationaux.
Si rien ne permet d’indiquer avec précision que le requérant aurait subi les effets de la fumée de cigarette dans les moyens de transport, le fait qu’il ait été gardé dans les salles d’attente des tribunaux avec d’autres détenus fumeurs est amplement confirmé par le tribunal départemental de Bucarest dans son arrêt du 14 juin 2006. Même sans connaitre à quelle fréquence le requérant a été enfermé dans lesdits locaux, il est indéniable que cela s’est produit à plusieurs reprises dans le cadre des citations à comparaître devant les juridictions nationales. En admettant même qu’il s’agissait à chaque fois d’un court laps de temps, ces conditions étaient contraires aux recommandations des médecins d’éviter le tabagisme actif comme passif.
Le fait que le requérant ait ensuite été placé dans une cellule avec un non-fumeur et qu’il se trouve à présent seul dans une cellule dans le nouvel établissement pénitentiaire n’est pas lié à des critères objectifs dans la législation mais à un concours de circonstances (l’existence à un moment donné d’une capacité d’hébergement suffisante) et rien n’indique qu’en cas de surcharge future de l’établissement pénitentiaire, le requérant bénéficierait de conditions aussi favorables.
Enfin, les tribunaux ont rejeté la demande de réparation du requérant en raison de l’absence de preuves matérielles du préjudice allégué, et de l’amélioration des conditions ultérieures de son transfert. Le simple fait que la situation dénoncée par le requérant avait entre temps cessé en raison de son transfert dans des conditions plus favorables ne dispensait pas les juridictions internes de leur obligation d’examiner si celle-ci avait eu des effets nocifs sur lui. Il n’est pas raisonnable de faire peser sur le requérant l’obligation de fournir des éléments pour attester les souffrances occasionnées. Une approche aussi formaliste est de nature à exclure l’octroi d’une réparation dans de multiples cas dans lesquels la détention ne s’accompagne pas d’une détérioration objectivement perceptible de l’état physique ou psychique d’un détenu.
La Cour conclut à la violation de l’article 3.
VASILESCU c. BELGIQUE du 25 novembre 2014 requête 64682/12
Violation de l'article 3 : vétusté des prisons belges surpopulation carcérale et détenus non fumeurs enfermés avec des détenus fumeurs.
89. Revenant aux circonstances de l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a pas contesté les observations du Gouvernement desquelles il ressort que le requérant séjourna dans diverses cellules pendant des périodes plus ou moins longues et dans des conditions matérielles à chaque fois différentes.
i. La prison d’Anvers
90. Du 10 octobre au 17 octobre 2011, soit pendant huit jours, le requérant séjourna dans une cellule de 18,4 m² avec quatre autres détenus. Le requérant disposait donc d’un espace personnel de 3,68 m², réduit par les installations sanitaires et les meubles de la cellule. Un des détenus dut dormir sur un matelas posé à même le sol.
91. Entre le 17 octobre et le 2 novembre 2011, soit pendant quinze jours, le requérant intégra une cellule de 8,4 m² avec deux autres détenus. Le requérant disposait donc d’un espace personnel de 2,8 m², réduit par les installations sanitaires et les meubles de la cellule. Un des détenus dut dormir sur un matelas posé à même le sol.
92. Du 2 novembre au 11 novembre 2011, soit pendant dix jours, le requérant séjourna dans une cellule de 10,4 m² avec un autre détenu. Le requérant disposait donc d’un espace personnel de 5,2 m², réduit par les installations sanitaires et les meubles de la cellule. La toilette de la cellule se trouvait derrière un paravent.
93. Enfin, du 11 novembre au 23 novembre 2011, soit pendant douze jours, le requérant séjourna dans une cellule de 9,12 m² avec un autre détenu. Le requérant disposait donc d’un espace personnel de 4,56 m², réduit par les installations sanitaires et les meubles de la cellule.
94. Le requérant a en outre fait valoir que pendant une partie de sa détention dans la prison d’Anvers, il partageait sa cellule avec des détenus fumeurs.
ii. Le pavillon « cellules » de la prison de Merksplas
95. Le 23 novembre 2011, le requérant fut transféré vers la prison de Merksplas. Du 23 novembre 2011 au 2 janvier 2012, puis du 27 mars 2012 au 14 avril 2012, soit pendant un total de soixante jours, le requérant séjourna dans le pavillon « cellules » dans une cellule de 8,6 m² avec un autre détenu fumeur. Il disposait donc d’un espace personnel de 4,3 m², réduit par les installations sanitaires et les meubles de la cellule. La cellule ne disposait ni de toilette ni d’accès à l’eau courante.
96. D’après le Gouvernement, les cellules sont ouvertes toute la journée permettant un accès aux toilettes dans le couloir ; pendant la nuit, les cellules sont équipées de seaux hygiéniques. Le requérant quant à lui conteste le fait qu’il ait pu aller aux toilettes librement pendant la journée.
iii. Les pavillons « A » et « Abis » de la prison de Merksplas
97. Du 2 janvier au 11 juillet 2012, soit pendant plus de six mois, le requérant fut – pour la majeure partie de cette période – détenu dans une cellule de 18,4 m² avec trois autres détenus. Il disposait donc d’un espace personnel de 4,6 m², réduit par les installations sanitaires et les meubles de la cellule. D’après le requérant, ses codétenus étaient fumeurs. Le Gouvernement ne conteste pas l’allégation du requérant selon laquelle la cellule était éclairée par des néons allumés tous les jours entre 6h30 et 22h.
98. La Cour relève qu’aucune information n’est fournie par les parties quant aux conditions s’agissant des conditions de détention du requérant après le 11 juillet 2012. Celles-ci ne font en tout état de cause pas partie des griefs du requérant.
iv. Appréciation de la Cour
99. Tout d’abord, la Cour note qu’outre le problème du surpeuplement carcéral, les allégations du requérant quant aux conditions d’hygiène, notamment l’accès à l’eau courante et aux toilettes, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons belges (paragraphes 46-52, ci-dessus).
100. S’agissant en particulier de l’espace personnel accordé au requérant, la Cour observe que, pendant une partie de sa détention, l’intéressé a subi les effets d’une situation de surpopulation carcérale. Les parties s’accordent à dire que, pendant plusieurs semaines, le requérant disposait d’un espace individuel en-dessous de la norme recommandée par le CPT pour les cellules collectives, c’est-à-dire moins de 4 m² (Torreggiani et autres, précité, § 68). Pendant quinze jours, le requérant a même disposé d’un espace individuel de moins de 3 m², ce qui constitue, selon la jurisprudence de la Cour, un espace personnel qui, à lui seul, suffit pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention (Ananyev et autres, précité, § 145).
101. Ce manque d’espace de vie individuel a été aggravé en l’espèce par le fait que, selon le requérant, il dut dormir sur un matelas posé à même le sol pendant plusieurs semaines, ce qui n’est pas conforme à la règle élémentaire établie par le CPT : « un détenu, un lit » (paragraphe 48, ci‑dessus). À ce propos, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que, pour des personnes se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’État, telles les personnes détenues, le simple fait que la version du Gouvernement contredit celle fournie par le requérant ne saurait, en l’absence de tout document ou explication pertinents de la part du Gouvernement, amener la Cour à rejeter des allégations de l’intéressé comme non étayées (Torreggiani et autres, précité, §§ 72-73). En l’espèce, le Gouvernement affirme qu’un des détenus de la cellule devait effectivement dormir sur un matelas posé au sol, mais qu’il n’est pas possible de vérifier si c’était bien le requérant qui avait été amené à dormir par terre. Dans la mesure où le Gouvernement n’a pas apporté de preuve du contraire de la version du requérant, la Cour n’a pas de raison de douter, en l’espèce, des allégations de ce dernier selon lesquelles il dut dormir sur le matelas posé au sol. Ces allégations sont d’autant plus plausibles qu’il n’est pas contesté que le requérant souffre de problèmes de dos.
102. Concernant l’installation sanitaire et l’hygiène, la Cour relève que, d’après les informations fournies par le Gouvernement, le requérant n’a pas toujours disposé d’un accès à des toilettes conforme aux recommandations du CPT. En effet, dans une des cellules occupées par le requérant à la prison d’Anvers, la toilette se trouvait derrière un paravent. Or la Cour rappelle que, selon le CPT, une annexe sanitaire qui n’est que partiellement cloisonnée n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu (voir Canali c. France, no 40119/09, § 52, 25 avril 2013).
103. En outre, la Cour constate qu’au cours des soixante jours de détention dans le pavillon « cellules » de la prison de Merksplas, les cellules occupées par le requérant ne disposaient pas de toilette, ni d’accès à l’eau courante. Si les parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si le requérant avait, pendant la journée, accès libre aux toilettes dans le couloir de la prison, elles s’accordent à dire qu’en tout cas, pendant la nuit, le requérant ne disposait que d’un seau hygiénique pour satisfaire ses besoins naturels. Quoiqu’il en soit, l’utilisation dans les cellules d’un seau hygiénique a déjà été considéré par la Cour comme inacceptable (Iordan Petrov c. Bulgarie, no 22926/04, § 125, 24 janvier 2012). La situation dans le pavillon « cellules » de Merksplas a d’ailleurs été qualifiée de « médiocre » par le CPT, qui a appelé les autorités belges, depuis sa première visite à Merksplas en 1998, à prendre des mesures urgentes afin de remédier à l’absence d’accès aux toilettes et à l’eau courante dans ce pavillon (paragraphe 50, ci-dessus). Or la Cour constate que, seize ans plus tard, la situation ne semble pas s’être améliorée.
104. L’ensemble des conditions décrites ci-dessus a encore été aggravé par le fait que le requérant fut victime de tabagisme passif puisqu’il n’est pas contesté par le Gouvernement qu’il dut, pendant la majeure partie de sa détention, partager sa cellule avec des détenus fumeurs (paragraphes 6 et 13, ci-dessus). La Cour note à cet égard que le requérant ne bénéficiait que d’un temps relativement réduit en dehors de la cellule (paragraphes 12 et 17, ci‑dessus).
105. La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant pendant sa détention. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 101, CEDH 2002‑VI). Indépendamment des durées relativement courtes pendant lesquelles le requérant fut soumis aux conditions de détention susmentionnées, la Cour estime que les conditions de détention en cause, examinées dans leur ensemble, n’ont pas manqué de soumettre le requérant à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006, Tadevosyan c. Arménie, no 41698/04, § 55, 2 décembre 2008, et Pop Blaga c. Roumanie, no 37379/02, § 46, 27 novembre 2012).
106. Dès lors, la Cour estime que les conditions matérielles de détention du requérant dans les prisons d’Anvers et de Merksplas, prises dans leur ensemble, ont atteint le seuil minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention et s’analysent en un traitement inhumain et dégradant au sens de cette disposition.
107. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
COUR DE CASSATION FRANCAISE
UN DETENU QUI PROUVE SES CONDITIONS INHUMAINES DE DETENTION PEUT DEMANDER SA LIBERATIONIl appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte, sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires, de la décision de la Cour européenne des Droits de l’homme condamnant la France pour le défaut de recours préventif permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes.
Le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe à ce juge de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant.
La description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention doit être suffisamment crédible, précise et actuelle, pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne.
Il appartient alors à la chambre de l’instruction, dans le cas où le ministère public n’aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu’elle détient d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 19 août 2020 pourvoi n° 19-87.499 rejet
5. Pour confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de ce que la crise sanitaire justifiait la remise en liberté du demandeur en l’état de la surpopulation carcérale et de l’état de délabrement des établissements pénitentiaires français qui placent l’administration pénitentiaire dans l’incapacité de mettre en oeuvre les mesures de distanciation sociale prescrites par le Gouvernement, sauf à méconnaître le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, l’arrêt relève que la situation actuelle de risque sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui affecte tous les citoyens en France et dans le monde, ne saurait transformer, en soi, une mesure de sûreté et notamment la détention provisoire décidée en conformité avec les textes internes et les conventions qui lient la France en un traitement inhumain et dégradant ou une atteinte au droit la vie tel que visés par les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
6. Les juges ajoutent que la situation sanitaire d’un pays, si elle est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques, ne saurait constituer un obstacle légal au maintien en détention provisoire prévue par l’article 5, § 1, c), de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’il y a notamment, comme en l’espèce, des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction.
7. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. D’une part, le moyen pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est infondé, dès lors que, faute pour le demandeur d’avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein de la maison d’arrêt où il était détenu, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l’instruction n’était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l’intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.
9. D’autre part, l’argumentation développée par le requérant au visa de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait prospérer, l’intéressé n’ayant pas préalablement allégué que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.
10. Enfin, la seconde branche du moyen est inopérante comme portant sur des motifs surabondants de l’arrêt attaqué, tirés de l’article 147-1 du code de procédure pénale dont la mise en oeuvre n’avait pas été sollicitée.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 19 août 2020 pourvoi n° 20-81.739 rejet
13. Il découle des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale que le juge, pour apprécier la nécessité de placer ou maintenir une personne en détention provisoire, se détermine en tenant compte des impératifs de la procédure judiciaire, des exigences de préservation de l’ordre public et du caractère raisonnable de la durée de cette détention.
14. Jusqu’à présent, nonobstant l’article préliminaire III, alinéa 4, du code de procédure pénale, la Cour de cassation a posé en principe qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et au maintien en détention provisoire (Crim., 18 septembre 2019, pourvoi n°19-83.950, en cours de publication).
15. Ce n’est qu’en cas d’allégation d’éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, que la Cour de cassation a estimé que les juges du fond pouvaient se déterminer par des motifs étrangers aux seules exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale (Crim., 29 février 2012, pourvoi n°11-88.441, Bull. crim., n° 58). L’article 147-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, a consacré cette jurisprudence, en disposant qu’en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.
16. Cependant, le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans son arrêt JMB et autres, pour des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans diverses prisons françaises (req. n° 9671/15 et 31 autres).
17. Elle a également prononcé une condamnation sur la base de l’article 13 de la Convention.
18. Après avoir constaté qu’il n’existait aucun recours préventif en matière judiciaire, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé notamment que, si la saisine du juge administratif, en l’occurrence du juge du référé-liberté, avait permis la mise en oeuvre de mesures visant à remédier aux atteintes les plus graves auxquelles sont exposées les personnes détenues dans certains établissements pénitentiaires, le pouvoir d’injonction conféré à ce juge ne lui permet pas de mettre réellement fin à des conditions de détention contraires à la Convention.
19. Sur le fondement de l’article 46 de la Convention, elle a émis diverses recommandations, l’Etat français devant adopter des mesures générales aux fins de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention, d’établir un recours préventif et effectif, combiné avec le recours indemnitaire, permettant de redresser la situation dont les détenus sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée.
20. Les recommandations générales que contient cette décision s’adressent, par leur nature même, au Gouvernement et au Parlement. Cependant, il appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte de ladite décision sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires.
21. A ce titre, le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention.
22. En tant que gardien de la liberté individuelle, il lui incombe de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant.
23. Il résulte de ce qui précède que, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l’instruction, dans le cas où le ministère public n’aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu’elle détient d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.
24. Après que ces vérifications ont été effectuées, dans le cas où la chambre de l’instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n’a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne, en l’astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire.
25. Pour confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, l’arrêt attaqué relève notamment que, s’il est soutenu que la détention provisoire de M. X... le place dans des conditions indignes relevant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il s’agit d’une affirmation péremptoire reposant sur un article de presse et un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018 qui ne renseignent en rien, in concreto, sur la situation de l’intéressé, incarcéré depuis le 29 novembre 2019.
26. Les juges ajoutent que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si M. X... est dans une cellule double, triple, s’il est privé de lumière naturelle, de ventilation, qu’à supposer que ses conditions de détention relèvent effectivement de l’article 3 de la Convention, ce qui n’est pas démontré de manière effective, la sanction d’un tel traitement ne peut être la remise en liberté de l’intéressé au regard des droits constitutionnels imprescriptibles que garantit la détention provisoire par l’objectif de recherche d’auteurs d’infraction qu’elle poursuit en écartant la personne incarcérée de tout risque d’immixtion dans l’information judiciaire.
27. La cour retient qu’aucune décision de la Cour européenne des droits de l’homme n’a posé le principe selon lequel toute violation de l’article 3 de la Convention devait être sanctionnée par la mise en liberté de la personne concernée et que, dans un arrêt de principe (Crim. 18 septembre 2019, n° 19-83.950), la Cour de cassation a jugé qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et au maintien en détention provisoire.
28. Les juges concluent que la personne détenue dispose donc d’un recours compensatoire et qu’elle dispose également d’un recours préventif, par l’exercice, devant la juridiction administrative, d’un référé-liberté visé par l’article L. 521-2 du code de la justice administrative qui oblige le juge saisi à statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
29. Pour les raisons précisées aux paragraphes 16 à 24, c’est à tort que la chambre de l’instruction a jugé qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention ne saurait constituer un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire.
30. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que les allégations formulées par M. X... ne faisaient état que des conditions générales de détention au sein de la maison d’arrêt dans laquelle il est détenu, sans précisions sur sa situation personnelle, et notamment sur la superficie et le nombre des occupants de la cellule, son agencement intérieur et le nombre d’heures journalières d’occupation.
31. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
32. Par ailleurs l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
UNE DETENTION ILLÉGALE EST UN ACTE INHUMAIN ET DÉGRADANT
GOROBET C. MOLDAVIE REQUÊTE 30951/10 du 11 octobre 2011
Une détention illégale est un acte inhumain et dégradant
Le requérant, Iurie Gorobet, est un ressortissant moldave né en 1966 et résidant à Costeşti (Moldova).
Un soir de février 2008, la police vint le chercher à son domicile en le menaçant de poursuites pénales et le conduisit à un hôpital psychiatrique, où il fut enfermé pendant 41 jours contre son gré. Durant son séjour à l’hôpital, il ne fut pas autorisé à avoir des contacts avec sa famille ou un avocat et se vit injecter des substances qui lui causèrent des paralysies temporaires et des pertes de connaissance.
Une fois sorti de l’hôpital, il découvrit que son hospitalisation forcée n’avait pas été autorisée par les tribunaux, qui n’avaient même pas reçu de demande à cet effet. Il porta plainte et demanda l’ouverture d’une enquête. Il affirmait que son hospitalisation avait été rendue possible par un document officiel demandant un traitement forcé, qu’un psychiatre de l’hôpital avait délivré et signé sans l’avoir vu en personne. Par ailleurs, M. Gorobet obtint de l’établissement une attestation selon laquelle il n’avait présenté aucun trouble psychiatrique, signée notamment par le psychiatre même qui avait autorisé son hospitalisation.
Le procureur entendit un certain nombre de témoins. Le psychiatre en question soutint qu’il avait vu brièvement M. Gorobet le soir de son arrestation, avait estimé que celui-ci représentait un risque pour ses proches et avait ordonné son hospitalisation. Cependant, les policiers qui avaient effectué l’arrestation déclarèrent avoir conduit l’intéressé directement à l’hôpital psychiatrique. Le médecin de famille de M. Gorobet affirma que c’était la soeur de celui-ci qui avait obtenu le document auprès du psychiatre. La sœur de M. Gorobet assura que le psychiatre lui avait donné le document sans avoir vu
l’intéressé, lorsqu’elle lui avait confié qu’il avait un problème d’alcoolisme et se conduisait mal.
En 2009, le procureur écarta la plainte de M. Gorobet ; celui-ci forma des recours, en vain. Après communication au Gouvernement de la requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme, de nouvelles poursuites pénales ont été ouvertes.
Article 5 § 1
La Cour fait remarquer que l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale après communication de l’affaire au gouvernement moldave n’est pas une raison de considérer que la requête est prématurée. De plus, la nouvelle procédure ne semble nullement avoir avancé depuis son déclenchement.
Il y a lieu de vérifier si la détention de M. Gorobet à l’hôpital était justifiée en vertu de l’alinéa e) de l’article 5 §1, qui permet la détention régulière « d’un aliéné ». La Cour observe que la procédure prévue pour un traitement forcé, telle qu’établie par la législation moldave en vigueur à l’époque des faits, a été totalement négligée. Ainsi, selon les prescriptions légales, l’hôpital aurait dû s’adresser à un tribunal pour obtenir l’autorisation d’internement, indiquer les raisons pour lesquelles l’hospitalisation était souhaitée et joindre copie de la décision d’une commission de psychiatres ; or, il n’en a rien fait. Ce constat aurait suffi à lui seul pour amener la Cour à considérer qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.
La Cour ajoute que les déclarations du psychiatre selon lesquelles il aurait vu M. Gorobet avant d’autoriser son hospitalisation ne sont pas corroborées par les autres témoignages. De plus, les propos du psychiatre sont en contradiction avec ses propres actes, c'est-à-dire avec le fait qu’après la sortie de l’hôpital de M. Gorobet, il lui a délivré une attestation relative à sa santé mentale, sans faire nulle allusion au fait qu’à peine deux mois plus tôt l’intéressé avait été interné dans un hôpital psychiatrique. La Cour ne peut que conclure que, à l’époque de l’hospitalisation forcée de M. Gorobet, aucun médecin spécialisé n’a émis d’avis sur son état de santé ou sur la nécessité de le faire interner dans un établissement médical. Partant, le Gouvernement n’a pas établi de manière probante que l’intéressé était aliéné avant son hospitalisation. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1.
Article 3
La Cour ne voit aucune raison de ne pas souscrire à la thèse de M. Gorobet selon laquelle son internement et son traitement psychiatrique forcé lui ont causé une souffrance morale aiguë qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant. Elle observe, à la lumière de ses conclusions sous l’angle de l’article 5 § 1, que son traitement psychiatrique n'a été ni médicalement nécessaire, ni légal. La Cour souligne par ailleurs la durée considérable du traitement médical en question et le fait que durant son internement M. Gorobet n’a pas été autorisé à avoir des contacts avec le monde extérieur. Ce traitement illégal et arbitraire était de nature, à tout le moins, à faire naître chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité. En conséquence, le traitement psychiatrique litigieux constitue pour le moins un traitement dégradant contraire à l’article 3.
Kanagaratnam ET AUTRES C. BELGIQUE Requête 15297/09 du 13 décembre 2011
47. Se plaignant de leur détention pendant près de quatre mois dans un centre fermé pour illégaux, les requérants invoquent une violation de l’article 3 de la Convention, lequel énonce : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
48. Le Gouvernement excipe de deux exceptions d’irrecevabilité.
49. Premièrement, se référant à la décision de la Cour dans l’affaire Illiu et autres c. Belgique (déc., no 14301/08, 19 mai 2009), il soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et auraient dû déposer une plainte pénale sur base des articles 417 bis à 41 quinquies du code pénal qui répriment la torture et les traitements inhumains et dégradants, plainte éventuellement suivie d’une demande d’indemnisation sur pied de l’article 1382 du code civil. Le Gouvernement soutient également que les requérants ont tardé à invoquer l’article 3 de la Convention et n’ont fait valoir leurs conditions de détention que dans leur troisième requête de mise en liberté. De plus, les éléments liés à leur situation individuelle (âge des requérants, durée de la détention et incapacité de la mère à faire face à la situation) ont été invoqués pour la première fois devant la Cour.
50. Les requérants répliquent qu’ils ont utilisé la voie de recours la plus efficace et la plus directe pour mettre fin à la situation qu’ils dénonçaient, à savoir la requête de mise en liberté. Ils soutiennent que l’action en référé aurait eu le même résultat et que la plainte pénale n’était pas de nature à remédier de façon directe aux atteintes dénoncées et est, en toute hypothèse, une voie de droit ineffective.
51. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
52. Les requérants ont poursuivi avec diligence la procédure spécifique prévue en droit belge pour mettre fin à leur détention, à savoir la requête de remise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel, institué par l’article 71 de la loi sur les étrangers. Dans leur demande de mise en liberté du 28 mars 2009, ils se référaient à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précitée. La nouveauté de l’individualisation des griefs, invoquée par le Gouvernement, n’apparaît pas pertinente à la Cour. Elle est en effet d’avis que l’âge des requérants et la durée de la détention sont des données « objectives » et que l’incapacité de la première requérante à faire face à la situation était inhérente à la situation telle qu’elle était dénoncée par les requérants.
53. La Cour note que les requérants n’ont pas agi en référé devant le président du tribunal de première instance en demandant leur libération. Toutefois, elle rappelle que lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie, dont le but est pratiquement le même, n’est pas exigé (Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25 avril 2002 ; Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, 29 avril 2004). Faisant application de cette jurisprudence dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée (§ 49), elle a considéré que l’utilisation de la requête de mise en liberté pour mettre fin à la détention et dénoncer les conditions de cette détention suffisait à considérer que les requérants avaient épuisé les voies de recours internes.
54. De plus, en ce qui concerne l’omission des requérants de déposer une plainte pénale, la Cour souligne que les circonstances de l’espèce la distingue de l’affaire Illiu et autres (décision précitée), invoquée par le Gouvernement, dans laquelle les requérants avaient choisi d’utiliser cette voie et n’avaient poursuivi avec diligence ni la requête de mise en liberté ni l’action en référé ; le grief tiré de l’article 3 ayant du reste été rejeté au motif qu’il était prématuré.
55. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ont épuisé les voies de recours internes quant à ce grief.
56. Deuxièmement, le Gouvernement soutient qu’à défaut d’avoir concrétisé et individualisé leur grief tiré de la violation de l’article 3 en raison de leurs conditions de détention, les requérants n’ont pas la qualité de victimes et qu’en conséquence il y a lieu de considérer que leur libération a constitué une réparation adéquate.
57. La Cour estime toutefois que les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 3 du fait de leurs conditions de détention posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen au fond de la requête. Elle joint donc cette exception au fond.
58. Par ailleurs, cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé, elle doit être déclarée recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
59. Les requérants soutiennent que leur détention dans un centre pour illégaux non adapté aux besoins des enfants a constitué en soi un traitement inhumain et dégradant. Ils affirment que, du seul fait de ces conditions, l’enfermement d’un enfant dans un centre fermé provoque inévitablement, à court ou moyen terme, de sérieux troubles psychologiques en raison des sentiments d’angoisse et d’infériorité que la détention a générés et peut s’assimiler à de la maltraitance psychologique. Ils citent à l’appui de leurs allégations des rapports établis par plusieurs organisations internationales qui décrivent les conditions de séjour en centre fermé et les effets négatifs de la détention sur le développement des enfants. Ils se réfèrent aux circonstances et aux constats de violation de la Cour dans les arrêts Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga et Muskhadzhiyeva et autres précités. A cela s’ajoutent la durée particulièrement longue de la détention, l’âge des enfants qui leur a permis de prendre pleinement conscience de la situation, l’analphabétisme de leur mère et son incapacité à assumer son rôle de mère et à faire face aux évènements, y compris dans les relations avec leur conseil.
60. Le Gouvernement admet que la détention d’enfants mineurs même accompagnés est de nature à poser question sous l’angle de l’article 3. Toutefois, il soutient que les requérants ne font preuve d’aucune incidence concrète, précise et objectivement vérifiable quant aux effets de la détention des enfants sur leur état de santé. Ils se contentent de s’appuyer, en des termes stéréotypés, sur la seule foi de rapports généraux antérieurs à la détention des requérants. Or, selon le Gouvernement, pour évaluer le seuil minimum de gravité permettant de qualifier un traitement d’inhumain et dégradant, il faut avoir égard aux circonstances personnelles des requérants. Contrairement à l’affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga précitée, les enfants étaient accompagnés de leur mère et rien n’indique que celle-ci n’ait pas été en mesure d’assurer son rôle de parent pendant la détention. Selon le Gouvernement, l’affaire doit également être distinguée de l’arrêt Muskhadzhiyeva précité dans lequel la Cour avait tenu compte d’un ensemble de circonstances concrètes et, en particulier, du bas âge des enfants et de leur état de santé diagnostiqué par des certificats médicaux. En l’espèce, les enfants, sensiblement plus âgés, ne font pas état de troubles physiques ou psychologiques particuliers et il apparaît même, sur la base des rapports établis par le personnel enseignant, que leur développement s’est poursuivi grâce à leur scolarisation dans le centre et à la participation à des activités adaptées à leur âge. Le grief tiré de l’article 3 est a fortiori encore plus mal fondé en ce qui concerne la première requérante qui n’a, en tout état de cause, jamais allégué avoir été victime par ricochet du fait du traitement infligé à ses enfants.
2. L’appréciation de la Cour
a) En ce qui concerne les enfants requérants
61. La Cour rappelle que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, § 53).
62. La Cour rappelle également qu’elle a conclu à deux reprises à la violation par la Belgique de l’article 3 en raison de la détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accompagnés (Muskhadzhiyeva et autres précité, § 63) et d’une enfant mineure non accompagnée (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga précité, §§ 58-59). Dans ces deux affaires, la Cour a souligné qu’il convenait de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant était déterminante et prédominait sur la qualité d’étranger en séjour illégal (ibid. §§ 56 et 55).
63. La Cour observe que le Gouvernement reconnaît que l’enfermement des enfants pose un problème de principe sous l’angle de l’article 3 de la Convention et accueille positivement la décision prise par les autorités belges de ne plus procéder à la détention en centres fermés des familles en séjour illégal en Belgique (paragraphe 44 ci-dessus).
64. La Cour observe que les circonstances de la présente affaire sont comparables à celles de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée à plusieurs égards. Premièrement, elles concernent des enfants mineurs accompagnés par leur mère. A ce sujet, la Cour a précisé que si le degré de protection pouvait varier selon que les enfants sont accompagnés ou non (Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 63, 5 avril 2011), cet élément ne suffisait pas à exempter les autorités de protéger les enfants et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 (Muskhadzhiyeva et autres précité, § 58).
65. Deuxièmement, les requérants étaient enfermés au même endroit, le centre fermé 127 bis, que la Cour a déjà jugé inadapté à l’accueil des enfants au vu des conditions de détention telles qu’elles étaient établies dans plusieurs rapports nationaux et internationaux (ibid. §§ 25-35 et 55). Elle constate que d’autres rapports ont été publiés depuis l’arrêt rendu dans l’affaire précitée qui corroborent les constats antérieurs. Parmi ceux-ci figure un rapport émanant pour la première fois d’une instance belge officielle, le Médiateur fédéral, qui insiste sur le caractère particulièrement désastreux de l’enfermement des enfants dans les centres fermés sur leur équilibre et leur développement (paragraphes 41-43 ci-dessus).
66. La Cour ne perd pas de vue que la présente affaire se distingue de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée par l’absence de certificats médicaux attestant de troubles psychologiques ayant affecté les enfants durant leur détention et par le fait que les enfants étaient plus âgés.
67. Toutefois, de l’avis de la Cour, ces éléments ne sont pas déterminants. Comme elle l’a récemment souligné, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui doit prévaloir y compris dans le contexte d’une expulsion (Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 84, 28 juin 2011). Il faut donc partir de la présomption que les enfants étaient vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfants que de leur histoire personnelle. Sans aucun doute, avant d’arriver en Belgique, les enfants requérants avaient déjà vécu une situation traumatique. Séparés de leur père à la suite de son arrestation, ils ont quitté avec leur mère un pays en proie à une guerre civile dans un contexte d’angoisse de représailles de la part des autorités locales. Cette vulnérabilité a été reconnue par les autorités belges puisqu’elles ont finalement reconnu aux requérants le statut de réfugiés. Ensuite, à leur arrivée en Belgique, ils ont été arrêtés à la frontière et directement placés en centre fermé en vue de leur expulsion. La Cour est en désaccord avec le Gouvernement quand il tire argument de ce que rien ne prouve que la mère ait été en difficulté pour jouer son rôle de parent. Elle estime en effet, à la lumière des rapports précités (paragraphes 36-38) que l’incapacité de la première requérante à faire face à la situation et à assumer son rôle, accentuée en l’espèce par son analphabétisme, est un facteur objectif inhérent aux conditions de vie en centre fermé. Enfin, la Cour tient compte de la durée particulièrement longue de la détention : les requérants sont restés près de quatre mois dans le centre, soit une période bien plus longue que celle des requérants dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée qui avaient été détenus pendant un mois.
68. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en plaçant les enfants requérants en centre fermé, les autorités belges les ont exposés à des sentiments d’angoisse et d’infériorité et ont pris, en pleine connaissance de cause, le risque de compromettre leur développement.
69. La situation ainsi vécue par les enfants requérants a atteint, selon la Cour, le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention pour constituer des traitements inhumains et dégradants et a emporté violation de cet article.
b) En ce qui concerne la première requérante
70. La Cour rappelle que dans l’affaire Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précitée (§ 58), elle a jugé que la mère avait connu une souffrance et une inquiétude profonde du fait de la détention de sa fille, dont elle était seulement informée et à propos de laquelle la seule mesure prise par les autorités avait consisté à lui communiquer le numéro de téléphone auquel elle pouvait joindre sa fille. En revanche, dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée (§§ 64-66), la Cour considéra que si le sentiment d’impuissance à protéger ses enfants contre l’enfermement et les conditions de celui-ci ont pu lui causer angoisse et frustration, la présence constante des enfants auprès d’elle a dû apaiser quelque peu ce sentiment, de sorte qu’il n’a pas atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain.
71. De même, en l’espèce, la première requérante est restée auprès de ses enfants durant la détention. Par conséquent, et, tout en reconnaissant que la dilution de son rôle parental, sa déresponsabilisation ainsi que l’impuissance dans laquelle elle s’est trouvée de mettre fin à la souffrance de ses enfants ont certainement exposé la première requérante à un désarroi et à une inquiétude profonde, la Cour ne dispose pas d’élément suffisant pour s’écarter de l’approche suivie dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres rappelée ci-dessus.
72. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef de la première requérante.
II. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 § 1 f) DE LA CONVENTION
73. Se plaignant que leur maintien en détention n’a pas été effectué dans le respect des voies légales, les requérants invoquent une violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention : «1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...) f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
A. Arguments des parties
74. Les requérants soutiennent que le maintien de leur détention a été décidé au mépris des voies légales. Ils font valoir que la décision du 20 mars 2009 de les maintenir en détention ne résultait pas uniquement de leur refus de l’éloignement comme le prévoit la jurisprudence de la Cour de cassation pour la simple raison que la Cour a informé le Gouvernement belge de l’indication de la mesure provisoire préalablement au départ de l’avion sur lequel ils devaient embarquer pour Kinshasa. Selon les requérants, la non-exécution de l’éloignement résultait donc de l’intervention de la Cour, un motif non envisagé par le droit belge et qui ne pouvait donc constituer une base légale suffisante pour maintenir les requérants en détention. La deuxième décision de les maintenir en détention, prise le 23 mars 2009, était également sans base légale puisqu’elle ne constituait que la prolongation de la précédente. Les requérants en déduisent qu’au-delà du 20 mars 2009, du fait de l’intervention de la Cour, et après le dépôt de leur deuxième demande d’asile, il n’y avait en réalité plus de procédure d’expulsion en cours et le maintien en détention n’entrait donc plus dans le cadre prévu par l’article 5 § 1 f) de la Convention. Les requérants contestent au surplus la proportionnalité et la durée des mesures de détention notamment de la première décision de détention compte du fait qu’ils n’étaient prima facie pas des demandeurs d’asile économique et donc que leur demande d’asile n’était manifestement pas infondée.
75. Le Gouvernement souligne que les requérants ont développé devant les juridictions belges la même argumentation pour contester la légalité de la décision du 20 mars 2009 de les maintenir en détention, mais celle-ci fut toutefois rejetée sans que l’on puisse considérer qu’il y a eu erreur manifeste d’application de la législation ni d’arbitraire (Ntumba Kabongo c. Belgique, déc., no 52467/99, 2 juin 2005). La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a, en effet, considéré que cette deuxième mesure privative de liberté avait été prise de façon conforme à la suite du refus des requérants de partir vers Kinshasa et que la circonstance qu’après ce refus, l’éloignement fut suspendu par décision de la Cour n’affectait en rien la légalité de la mesure privative de liberté. De plus, comme l’a souligné la Cour de cassation, à la date de la deuxième mesure privative de liberté, les requérants étaient en tout état de cause encore détenus sur la base de la première décision. Le Gouvernement soutient qu’une erreur ultérieurement corrigée dans l’indication de la base légale d’une détention n’est pas de nature à vicier la conventionalité de celle-ci s’il s’avère que d’autres fondements, en droit interne, pouvaient la justifier.
76. Ensuite, s’agissant de la troisième mesure privative de liberté, du 23 mars 2009, le Gouvernement fait valoir qu’elle ne peut être jugée comme un renouvellement de la précédente mesure puisqu’elle reposait sur d’autres motifs de fait, à savoir l’introduction d’une nouvelle demande d’asile, faits qui entrent dans les prévisions de l’article 74/5, § 1, 2o de la loi sur les étrangers.
77. Enfin, s’agissant de l’objectif, de la proportionnalité et de la durée de la détention, le Gouvernement souligne que conformément à la jurisprudence de la Cour (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 41 et Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 64, CEDH 2008) les requérants ont fait l’objet de mesures privatives principalement en raison de leur carence à réunir les conditions d’entrée régulière dans le pays. La circonstance que les requérants n’étaient finalement pas des migrants économiques et ont été admis au statut de réfugié n’est pas de nature à vicier rétroactivement la légalité et la légitimité de la détention. Il souligne que la première demande d’asile avait été déclarée non fondée par le Conseil de contentieux des étrangers et que quand il s’est avéré que la deuxième demande d’asile ne pourrait intervenir rapidement, l’OE a mis spontanément les requérants en liberté. Enfin, les mesures de détention n’ont à aucun stade excédé les délais légaux.
B. Appréciation de la Cour
78. La Cour observe à titre préliminaire que les requérants ont été arrêtés à la frontière et qu’ils ont pu y déposer une demande d’asile. Ils firent l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement au motif qu’ils étaient en possession de faux passeports. Leur détention se rattache donc au premier volet de l’article 5 § 1 f) de la Convention qui permet l’arrestation ou la détention « régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire (...) ».
1. Rappel des principes généraux
79. La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental, la protection de toute personne contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Toute privation de liberté doit relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1. Ces exceptions sont énumérées de manière exhaustive et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (Saadi précité, § 43, Jusic c. Suisse, no 4691/06, § 67, 2 décembre 2010).
80. Parmi ces exceptions figure l’alinéa f) qui permet aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (Saadi précité, § 64). Si les Etats jouissent en effet du « droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 41) et ont, corollairement, la faculté de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile ou non - l’autorisation d’entrer dans le pays (Saadi précité, § 64), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Amuur précité, § 41) et la Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008).
81. La privation de liberté doit en outre être « régulière ». En cette matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en va autrement dans les matières où la Convention renvoie directement à ce droit : en ces matières, la méconnaissance du droit interne entraîne celle de la Convention, de sorte que la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions légales ou jurisprudence – a été respecté (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46, série A no 33, Jusic précité, § 68).
82. L’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 74, CEDH 2007-II, Saadi précité, § 67).
83. Pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit se faire de bonne foi et être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement. S’agissant de la première partie de l’article 5 § 1 f), elle doit donc être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire (Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74, Saadi précité, §§ 74 et 80).
84. En outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés (Saadi, précité, § 74, Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74). Un lien doit exister entre le motif invoqué pour la privation autorisée et le lieu et le régime de détention (Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 46, Recueil 1998-V, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga précité, § 53). La Cour ne perd pas de vue à cet égard que les mesures de détention s’appliquent à des ressortissants étrangers qui, le cas échéant, n’ont pas commis d’autres infractions que celles liées au séjour (Riad et Idiab précité, § 77). De plus, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ibidem).
85. Enfin, la Cour a indiqué que la mise en œuvre d’une mesure provisoire est, en elle-même, sans incidence sur la conformité à l’article 5 § 1 (Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74).
2. Application des principes en l’espèce
(a) En ce qui concerne les enfants requérants
86. Dans l’arrêt Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 1 f) dans le chef de l’enfant requérant au motif que :
« 103. La seconde requérante a été détenue dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal, dans les mêmes conditions que celles d’une personne adulte, lesquelles n’étaient par conséquent pas adaptées à sa situation d’extrême vulnérabilité liée à son statut de mineure étrangère non accompagnée.
104. Dans ces conditions, la Cour estime que le système juridique belge en vigueur à l’époque et tel qu’il a été appliqué dans la présente affaire n’a pas garanti de manière suffisante le droit de la seconde requérante à sa liberté. »
87. Dans l’arrêt Muskhadzhiyeva et autres précité, la Cour a jugé que la circonstance que les enfants requérants étaient accompagnés par leur mère n’était pas une raison se départir de cette conclusion (§ 75).
88. De la même manière, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef des trois enfants requérants.
(b) En ce qui concerne la première requérante
89. La Cour constate que la première privation de liberté a été décidée le 23 janvier 2009, jour de l’arrivée en Belgique de la première requérante, en application de l’article 74/5 § 1, 2o de la loi sur les étrangers au motif qu’elle tentait de pénétrer le territoire sans être porteuse des documents requis pour l’entrée sur ledit territoire et avait déposé une demande d’asile. La Cour constate que cette disposition autorisait l’OE à maintenir la requérante en centre fermé pendant deux mois et que la validité de cette première décision expirait le 22 mars 2009 à minuit.
90. La circonstance que l’OE prit la décision de maintenir la première requérante en détention le jour de l’indication de la mesure provisoire par la Cour, le 20 mars 2009, ne rend pas illégale sa détention même si la poursuite de la procédure de refoulement était provisoirement empêchée. De même, la Cour est d’accord avec le Gouvernement pour considérer que l’erreur quant aux faits à l’origine de l’ordonnance de réécrou n’affectait pas la légalité de la détention au sens de l’article 5, qui demeurait justifiée, comme l’a relevé la Cour de cassation, sur la base de la première mesure de détention (voir, mutatis mutandis, Slivenko c. Lettonie [GC] (no 48321/99, § 149, CEDH 2003-X).
91. Le 23 mars 2009, à l’issue de ce délai initial, l’OE adopta, sur la base de la même disposition législative, une nouvelle décision de privation de liberté, valable également pour une période de deux mois, au motif que la requérante avait déposé une deuxième demande d’asile. Le 25 mars 2009, la deuxième demande d’asile déposée par la requérante fut transmise pour examen au fond au CGRA. La requérante fut finalement libérée le 4 mai 2009.
92. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le placement et le maintien en détention de la première requérante ont été décidés « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ntumba Kabongo déc. précitée).
93. La Cour doit ensuite déterminer si la détention de la requérante n’était pas arbitraire. Comme elle l’a rappelé ci-dessus, plusieurs paramètres entrent en jeu dans cette évaluation. La Cour doit être convaincue que les autorités ont agi de bonne foi, qu’un lien suffisamment étroit existait entre le maintien en détention et l’objectif poursuivi, et que la requérante était détenue dans un lieu approprié et, ce, pendant une durée raisonnable.
94. En l’espèce, la Cour n’a aucun motif de douter de la bonne foi des autorités belges. Elle n’a a priori pas non plus d’objection à considérer que le placement de la requérante en détention corrélativement à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré « à la frontière » le 23 janvier 2009 entrait dans les circonstances envisagées par la jurisprudence relative à la première partie de l’article 5 § 1 f) telle que rappelée dans les principes généraux. En revanche, elle s’interroge, avec la requérante, sur la régularité du maintien de la détention après l’expiration du délai initial de deux mois prévu par l’article 74/5, §1 2o de la loi sur les étrangers et ce, jusqu’au 4 mai 2009, alors qu’elle avait déposé une deuxième demande d’asile et que celle-ci avait été prise en considération et transmise pour un examen au fond au CGRA le 25 mars 2009. En effet, la Cour est d’avis que, dans ces circonstances, le maintien de la requérante dans un lieu manifestement inapproprié au séjour d’une famille, dans des conditions que la Cour analyse elle-même, en ce qui concerne les enfants, comme étant contraires à l’article 3 et pendant une période particulièrement longue relève de l’arbitraire.
95. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le maintien en détention de la requérante n’était pas « régulier » au sens de l’article 5 §1 f) de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si la détention était justifiée au regard du deuxième volet de l’article 5 § 1 f) de la Convention.
HORSHILL c. GRÈCE du 1er août 2013 requête 70427/11
LA DETENTION DES ETRANGERS DANS DES CELLULES DE COMMISSARIAT DE POLICE TROP LONGTEMPS, EST UNE VIOLATION.
49. Il en ressort que le requérant a été détenu dans des conditions de surpopulation, selon la jurisprudence de la Cour, pendant quatre jours sur un total de quinze jours.
50. Quant aux onze jours restants, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté une violation de l’article 3 dans des requêtes dirigées contre la Grèce par des étrangers en voie d’expulsion qui se trouvaient détenus dans des commissariats de police (voir, en dernier lieu, Bygylashvili c. Grèce 58164/10, 25 septembre 2012 et
Chkhartishvili c. Grèce, no 22910/10, 2 mai 2013). Certes, les périodes de détention dans ces affaires étaient plus longues que celle en l’espèce.51. La Cour note, en outre, que les cellules du commissariat de Paramythia étaient situées au sous-sol et étaient ainsi privées de lumière naturelle. Qui plus est, dans les deux commissariats, les cellules ne disposaient d’aucune douche et il était impossible aux détenus de se promener en plein air ou de se livrer à une activité physique.
52. Sur ce point, la Cour relève que la pratique des autorités grecques de placer pour des périodes plus ou moins longues dans des commissariats de police les étrangers faisant l’objet d’une procédure d’expulsion a été clairement constatée par le CPT dans sa déclaration publique du 15 mars 2011, faite en vertu de l’article 10 § 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants. Dans cette déclaration, le CPT fait expressément état de la promesse non tenue par les autorités de mettre fin à l’utilisation des commissariats de police pour le placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière (paragraphe 33 ci-dessus). La Cour note aussi que la législation grecque elle-même, en l’article 66 § 6 du décret no 141/1991, interdit la détention des prévenus et des condamnés dans les commissariats de police excepté pendant le temps absolument nécessaire à leur transfert en prison (paragraphe 32 ci-dessus).
53. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a été soumis à un traitement dégradant incompatible avec l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
LA DÉTENTION D'UN INDIVIDU MALADE OU HANDICAPÉ
Pintus c. Italie du 1er septembre 2024 Requête no 35943/18
Art 2 (matériel) • Obligations positives • Maintien en détention ordinaire d’un homme souffrant de troubles psychiatriques s’étant blessé à l’avant-bras avec une lame de rasoir à trois reprises • Caractère certain et immédiat du risque pour la vie du requérant connu des autorités pénitentiaires qu’à partir du premier épisode et au plus tard lors du rapport du service de santé mentale ayant suivi • Accès de l’intéressé à un traitement psychiatrique continu sous le contrôle du personnel de la structure psychiatrique à l’intérieur du pénitencier, où il n’a pas pu être placé dans l’attente de trouver un établissement plus adapté à son état • Réaction appropriée du personnel pénitentiaire aux évènements • Examen médical et contrôle psychiatrique supplémentaire et constant après chacun des épisodes • Efforts des autorités pénitentiaires pour trouver une structure d’accueil spécialisée où le requérant fut transféré dès que possible et grâce à une décision du juge de l’application des peines ayant anticipé l’arrêt de la Cour constitutionnelle de février 2019 • Autorités ayant fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation du risque en question
Art 3 (matériel) • Absence de traitement inhumain et dégradant
CEDH
a) Principes généraux applicables
46. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, § 104, 31 janvier 2019, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 134, 25 juin 2019, et Jeanty c. Belgique, no 82284/17, § 70, 31 mars 2020). Cette disposition peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger un individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Renolde c. France, no 5608/05, § 80, CEDH 2008 (extraits), Fernandes de Oliveira, précité, § 108, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 136). En particulier, les personnes placées sous le contrôle des autorités sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001-III, et Mosendz c. Ukraine, no 52013/08, § 92, 17 janvier 2013). De même, les personnes atteintes de troubles mentaux sont considérées comme un groupe particulièrement vulnérable qu’il faut protéger des risques de suicide ou d’automutilation (Renolde, précité, § 84, et S.F. c. Suisse, no 23405/16, § 78, 30 juin 2020).
47. Dans le cas spécifique du risque de suicide en prison, toutefois, il n’y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’existait un risque réel et immédiat qu’un individu donné attente à sa vie (De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, § 69, 6 décembre 2011, Fernandes de Oliveira, précité, § 110, et Jeanty, précité, § 71). La Cour a pris en compte divers facteurs afin d’établir si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait pour la vie d’un individu donné un risque réel et immédiat (voir Fernandes de Oliveira, précité, § 115, et les références y citées).
48. Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient pallié ce risque Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, et Troubnikov c. Russie, no 49790/99, § 69, 5 juillet 2005). La Cour doit donc rechercher si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation de ce risque en prenant les mesures dont elles disposaient (Fernandes de Oliveira, précité, § 125). Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire (De Donder et De Clippel, précité, § 69, Fernandes de Oliveira, précité, § 126, et Jeanty, précité, § 72).
49. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ; il ne faut en effet pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Keenan, précité, § 90, Taïs c. France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006, Fernandes de Oliveira, précité, § 111, Jeanty, précité, § 73).
b) Application au cas d’espèce
50. La détention d’une personne souffrant de troubles psychiatriques dans un établissement carcéral ordinaire ne soulève pas en soi un problème sous l’angle de l’article 2 de la Convention (voir la jurisprudence citée au paragraphe 47 ci-dessus). À cet égard, la Cour constate, d’abord, que le premier rapport psychiatrique établi par le service de santé mentale du pénitencier de Rebibbia le 15 décembre 2017, avait exclu tout risque d’automutilation ou de suicide. Elle note, ensuite, que le rapport du 21 décembre 2017 avait même jugé l’état de santé compatible avec le régime pénitentiaire. De plus, le dossier ne contient aucun élément attestant que le requérant eût manifesté des pensées suicidaires ou tenté de se blesser avant le 9 avril 2018, date à laquelle l’intéressé s’infligea des légères entailles à l’avant-bras gauche avec une lame de rasoir. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le requérant a bénéficié d’un suivi psychiatrique soutenu, la Cour ne saurait relever aucune omission manifeste qui aurait empêché les autorités d’avoir un aperçu correct de la situation (voir, mutatis mutandis, Volk c. Slovénie, no 62120/09, § 91, 13 décembre 2012). La Cour est donc convaincue que, jusqu’au 9 avril 2018, les autorités pénitentiaires ne savaient ni n’auraient pu savoir que l’état mental du requérant était tel qu’il risquait d’attenter à son intégrité.
51. Il n’en va pas de même, en revanche, pour les actes commis le 23 avril et le 7 mai 2018. Suite à l’épisode du 9 avril, le service de santé mentale du pénitencier avait signalé, avec un nouveau rapport du 19 avril 2018, que les conditions de santé du requérant s’étaient sensiblement détériorées et que des sentiments d’angoisse et des délires de persécution avaient été observés, malgré le renforcement du traitement médicamenteux. Partant, à partir, au plus tard, de cette dernière date, les autorités pénitentiaires avaient ou devaient avoir pleinement connaissance de la fragilité psychologique du requérant. Il reste donc à déterminer si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le risque d’automutilation et de suicide.
52. La Cour note que, même si le requérant n’avait pas pu être placé dans l’ATSM, dans l’attente de trouver un établissement plus adapté à son état, comme l’avait préconisé le JAP dans l’ordonnance du 19 janvier 2018 (paragraphe 6 ci-dessus), l’administration pénitentiaire avait garanti l’accès aux services de l’ATSM de Rebibbia et, en particulier, un traitement psychiatrique continu sous le contrôle du personnel de la structure spécialisée (paragraphe 13 ci-dessus). Il est vrai que le requérant continua à disposer d’un rasoir avec lequel il s’infligea de nouveau des légères entailles au bras gauche. La Cour fait état de sa perplexité à cet égard. Néanmoins, faute d’informations factuelles déterminantes, elle constate que l’intervention du personnel pénitentiaire fut toujours immédiate et de nature à en contenir les effets de ces actes. Après chacun des deux épisodes, le requérant fut soumis à un examen médical et à un contrôle psychiatrique supplémentaire et constant pour lequel même le psychiatre qui l’avait suivi avant l’internement dans le pénitencier et qui connaissait son dossier fut consulté (Keenan, précité, § 99). Le dossier montre aussi les efforts déployés par les autorités pénitentiaires afin de trouver une communauté thérapeutique à l’extérieur du pénitencier où le requérant fut d’ailleurs transféré dès que possible et grâce à une décision qui anticipait les développements futurs de la jurisprudence constitutionnelle (voir paragraphes 30-32 ci-dessus). Ces faits, bien documentés par les rapports du personnel pénitentiaire, sanitaire et psychiatrique soumis par le Gouvernement, n’ont été contestés que d’une façon très vague, par les conseils du requérant.
53. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les autorités saisies de l’affaire ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation du risque pour la vie du requérant, dans la mesure où elles avaient connaissance du caractère certain et immédiat de ce risque.
54. Partant, au vu des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
ARTICLE 3
a) Principes généraux applicables
58. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative : elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, § 141, 31 janvier 2019, et les affaires qui y sont citées).
59. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 202, CEDH 2012, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 118).
60. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. Cela étant, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du détenu sont assurés de manière adéquate (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 99, 20 octobre 2016), notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peuvent engager la responsabilité de l’État au regard de l’article 3 (Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 57, CEDH 2009, Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, § 105, 26 avril 2016, et Rooman, précité, § 146).
61. Pour déterminer si la détention d’une personne malade est conforme à l’article 3 de la Convention, la Cour prend en considération la santé de l’intéressé et l’effet des modalités d’exécution de sa détention sur son évolution. Elle a dit que les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale. Elle a reconnu à ce sujet que les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et que certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque qu’ils se sentent en situation d’infériorité, et sont forcément source de stress et d’angoisse. Une telle situation entraîne la nécessité d’une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (W.D. c. Belgique, no 73548/13, §§ 114-115, 6 septembre 2016, et Rooman, précité, § 145). L’appréciation de la situation des individus en cause doit tenir compte de leur vulnérabilité et, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 82, série A no 244, Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, Murray, précité, § 106, et Sy c. Italie, no 11791/20, § 79, 24 janvier 2022).
62. La Cour tient également compte du caractère adéquat ou non des soins et traitements médicaux dispensés en détention. Cette question est la plus difficile à trancher. La Cour rappelle que le simple fait qu’un détenu ait été examiné par un médecin et qu’il se soit vu prescrire tel ou tel traitement ne saurait faire conclure automatiquement au caractère approprié des soins administrés. En outre, les autorités doivent s’assurer que les informations relatives à l’état de santé du détenu et aux soins reçus par lui en détention sont consignées de manière exhaustive, que le détenu bénéficie promptement d’un diagnostic précis et d’une prise en charge adaptée, et qu’il fasse l’objet, lorsque la maladie dont il est atteint l’exige, d’une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu’à traiter leurs symptômes. Par ailleurs, il incombe aux autorités de démontrer qu’elles ont créé les conditions nécessaires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi (Blokhin, précité, § 137, et Rooman, précité, § 147). La Cour en a conclu que l’absence d’une stratégie thérapeutique globale pour la prise en charge d’un détenu atteint de troubles mentaux peut s’analyser en un « abandon thérapeutique » contraire à l’article 3 (Strazimiri c. Albanie, no 34602/16, §§ 108-112, 21 janvier 2020, et Sy, précité, § 80).
63. Dans l’hypothèse où la prise en charge ne serait pas possible sur le lieu de détention, il faut que le détenu puisse être hospitalisé ou transféré dans un service spécialisé (Rooman, précité, § 148, et Sy, précité, § 81).
b) Application au cas d’espèce
64. La Cour rappelle que la décision de placer le requérant dans une annexe psychiatrique ou d’ordonner son hospitalisation auprès d’un centre thérapeutique externe au pénitencier relevait de la compétence du JAP. Il n’incombe pas à la Cour de décider si ce juge aurait dû prendre une autre décision, celui-ci étant mieux placé qu’elle pour juger du lieu et des conditions dans lesquelles la détention du requérant devait avoir lieu compte tenu de son état de santé mentale (Jeanty, précité, § 104). En revanche, il appartient à la Cour de vérifier si la manière dont le requérant a été traité au cours de sa détention était compatible avec les exigences découlant de l’article 3 de la Convention. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
65. S’agissant de la compatibilité de l’état de santé mentale du requérant avec son maintien en détention à la prison de Rebibbia, la Cour constate que selon les rapports des 15 et 21 décembre 2017, qui n’ont pas été contestés par le requérant, ce dernier avait renoncé à sa demande de transfert, exprimant son souhait de « se réinsérer dans le circuit de détention ordinaire » (paragraphe 6 ci-dessus). La Cour note aussi que, s’il est vrai que le requérant ne fut pas transféré dans l’ATSM faute de places disponibles, il ressort des documents versés au dossier qu’il bénéficia d’un programme thérapeutique individualisé de prise en charge de sa pathologie, comprenant des visites régulières de la part de psychologues et psychiatres et la prescription de médicaments, et visant à porter remède à ses problèmes de santé, aussi bien qu’à en prévenir l’aggravation (Blokhin, précité, § 137, et Rooman, précité, § 147).
66. Les documents produits par le Gouvernement mettent également en évidence que, dès le 9 avril 2018, date du premier acte d’automutilation, le requérant fit l’objet d’une assistance et d’un soutien psychiatrique renforcés, ce qui démontre que le personnel pénitentiaire fut dûment réactif (voir paragraphes 14, 18-20). Le dossier montre aussi les efforts continus déployés par les autorités pénitentiaires afin de trouver une structure d’accueil spécialisée. Au demeurant, la Cour souligne le caractère « pionnier » de l’ordonnance du JAP du 18 juin 2018 qui étendit l’application de l’article 47ter, § 1ter, de la loi sur l’administration pénitentiaire au bénéfice du requérant et ce bien avant l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 99/2019 (voir paragraphes 30 et 31).
67. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’a pas subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
68. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Violation de l'article 3 non violation de l'article 2 : Les autorités belges ont empêché les tentatives de suicide d’un détenu atteint de troubles psychiques, mais ont soumis l’intéressé à un traitement dégradant.
L’affaire concerne une personne atteinte de troubles psychiques et ayant tenté de se suicider à plusieurs reprises lors de ses placements en détention préventive dans la prison d’Arlon. La Cour estime que l’article 2 s’applique en l’espèce car la nature même de l’action de M. Jeanty (plusieurs tentatives de suicide) lui faisait courir un risque réel et imminent pour sa vie. La Cour juge ensuite que les mesures prises par les autorités ont effectivement permis d’empêcher que M. Jeanty se suicide. La Cour juge aussi que M. Jeanty a été soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, notamment en raison du manque d’encadrement et de suivi médical au cours de ses deux périodes de détention combiné avec l’infliction d’une sanction disciplinaire dans une cellule d’isolement pendant trois jours alors qu’il avait commis s plusieurs tentatives de suicide. Elle relève aussi que l’enquête menée à ce propos n’a pas été effective.
FAITS
Le requérant, Philippe Jeanty, est un ressortissant belge né en 1969 et résidant à Arlon (Belgique).
La période de détention entre le 26 juin et le 12 août 2011
En juin 2011, suspecté d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces et coups et blessures avec incapacité de travail sur son épouse, M. Jeanty fut arrêté et placé en garde à vue. Lors de son audition par la police, l’intéressé fit état de sa détresse psychologique et demanda à être interné, indiquant ses intentions de mettre fin à sa vie. Le lendemain, le juge d’instruction ordonna le placement en détention préventive de M. Jeanty et informa la prison d’Arlon des tendances suicidaires de l’intéressé. Dès son arrivée à la maison d’arrêt, M. Jeanty tenta de se suicider à trois reprises. Les agents pénitentiaires retirèrent tous les objets et ses effets personnels. Il fut placé dans une cellule d’isolement sécurisée et un médecin lui administra un tranquillisant. M. Jeanty fut maintenu sous surveillance spéciale pendant quelques jours. Il fut remis en liberté sous condition le 12 août 2011.
La période de détention entre le 21 octobre et le 2 décembre 2011
En octobre 2011, un second mandat d’arrêt fut délivré contre M. Jeanty, ce dernier n’ayant pas respecté les conditions de sa libération conditionnelle. M. Jeanty réintégra donc la maison d’arrêt d’Arlon où il demanda à plusieurs reprises de changer de cellule, se plaignant de ses codétenus. En novembre 2011, suite au refus de l’assistant pénitentiaire chef d’équipe de le changer à nouveau de cellule, M. Jeanty menaça de se suicider. Il fut alors placé en cellule d’isolement et soumis à une mesure de surveillance spéciale. Lors d’un contrôle, un agent pénitentiaire le retrouva perché sur les barreaux de la porte en train d’attacher son pantalon. Il fut arrêté avant de se lancer dans le vide. Puis, sur ordre du médecin, les agents lui mirent un casque et le menottèrent pour l’empêcher de se taper la tête contre le mur et de se blesser. Il resta ainsi entravé jusqu’au lendemain. Deux jours plus tard, M. Jeanty sortit de l’isolement et fut auditionné par le directeur de la prison qui décida de transformer en sanction disciplinaire le placement en cellule d’isolement de trois jours, estimant que les menaces de suicide visaient à faire pression sur le personnel pénitentiaire pour obtenir une mutation de cellule. M. Jeanty fut remis en liberté conditionnelle le 2 décembre 2011.
Les événements ultérieurs
En avril 2014, M. Jeanty porta plainte contre X, estimant avoir subi un traitement inhumain et dégradant au cours de ses deux périodes de détention et se plaignant d’avoir été placé dans des cellules ordinaires de la prison alors que son état de santé nécessitait un soutien psychologique. Cette plainte déboucha sur un non-lieu, confirmé en appel. Le pourvoi en cassation de M. Jeanty fut rejeté. Toujours en avril 2014, M. Jeanty fut condamné, en première instance, à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont la moitié avec sursis pour les faits d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces et coups et blessures avec incapacité de travail sur son épouse. En avril 2019, la cour d’appel réforma ce jugement et déclara M. Jeanty pénalement irresponsable de ses actes. Elle ordonna son internement et son arrestation immédiate.
Article 2 (droit à la vie)
L’article 2 s’applique-t-il en l’espèce ?
M. Jeanty n’est pas décédé suite à ses tentatives de suicide. Cette circonstance n’est cependant pas en soi de nature à exclure l’applicabilité de l’article 2 de la Convention. En effet, lorsque par nature l’activité en cause est dangereuse et propre à exposer la vie de la personne qui s’y livre à un risque réel et imminent, comme dans le cas d’actes de violence potentiellement mortels, la gravité des blessures subies peut ne pas être déterminante et, même en l’absence de toute blessure, un grief peut en pareil cas faire l’objet d’un examen sous l’angle de l’article 2. En l’espèce, M. Jeanty a tenté, à plusieurs reprises au cours de sa détention, de mettre fin à ses jours, et c’est du fait de l’intervention des agents pénitentiaires que ces tentatives n’ont pas abouti. Le fait que M. Jeanty n’ait pas subi de blessure potentiellement mortelle, voire qu’il ne semble pas avoir subi une quelconque blessure physique grave, n’est, dans ce cas, pas déterminant. En effet, la nature même de l’action du requérant lui faisait courir un risque réel et imminent pour sa vie. Par conséquent, l’article 2 s’applique en l’espèce.
Les autorités nationales ont-elles pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de M. Jeanty ?
La Cour estime que, dans l’ensemble, les autorités ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation du risque pour la vie de M. Jeanty, dans la mesure où elles avaient connaissance du caractère certain et immédiat de ce risque. Les mesures prises ont d’ailleurs effectivement permis d’empêcher que M. Jeanty se suicide. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)
M. Jeanty a-t-il subi un traitement contraire à l’article 3
La Cour estime que, compte tenu de l’état de santé mentale de M. Jeanty, le manque d’encadrement et de suivi médical au cours de ses deux périodes de détention combiné avec l’infliction d’une sanction disciplinaire dans une cellule d’isolement pendant trois jours alors qu’il avait commis plusieurs tentatives de suicide ont constitué une épreuve particulièrement pénible et ont soumis l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La Cour ne doute pas qu’un tel traitement a provoqué chez lui des sentiments d’arbitraire, d’infériorité, d’humiliation et d’angoisse. La circonstance qu’il n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser le requérant n’exclut pas qu’il soit qualifié de dégradant et tombe ainsi sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3. Il y a donc eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
L’enquête menée sur la plainte pénale déposée par M. Jeanty a-t-elle été effective ?
Il ressort de la motivation de l’arrêt de la chambre des mises en accusation que l’enquête menée sous l’autorité du juge d’instruction a permis d’établir avec une certaine précision les faits s’étant déroulés à la prison. Toutefois, plus de huit mois se sont écoulés entre le réquisitoire de mise à l’instruction du procureur du Roi (juillet 2014) et le moment où le juge d’instruction reçut le dossier (mars 2015). Un tel délai pendant lequel l’instruction n’a pas commencé n’est pas expliqué par le Gouvernement et apparaît difficilement compréhensible et acceptable lorsqu’a été déposée une plainte pénale pour des faits de traitements inhumains et dégradants et abstention coupable. De surcroît, une fois l’instruction entamée en mars 2015, le juge d’instruction se contenta de demander aux enquêteurs de récupérer et d’analyser le dossier pénitentiaire et le dossier médical de M. Jeanty. Aucun autre devoir ne fut ordonné. Aucune des personnes impliquées ou mises en cause ne furent entendues, ni les agents pénitentiaires, ni les médecins ayant vu M. Jeanty, ni le requérant lui-même. Moins de trois mois après la réception par le juge d’instruction du dossier, le procureur traça un réquisitoire de non-lieu. Une telle enquête n’est pas effective. Par conséquent, il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention
CEDH
Sur l’applicabilité de l’article 2
58. Le Gouvernement n’a pas soulevé d’exception d’incompatibilité ratione materiae avec la Convention. Ceci étant, l’applicabilité de la Convention définit l’étendue de la compétence de la Cour. Cette question doit donc être examinée d’office à chaque stade de la procédure (Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 67, CEDH 2006‑III, Pasquini c. Saint-Marin, no 50956/16, § 86, 2 mai 2019, et, mutatis mutandis, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 70, 5 juillet 2016).
59. Le requérant n’est pas décédé suite à ses tentatives de suicide qui font l’objet du grief. Cette circonstance n’est pas en soi de nature à exclure l’applicabilité de l’article 2 de la Convention. La Cour a en effet reconnu à de nombreuses reprises l’applicabilité de cette disposition même lorsque la personne qui se disait victime d’une atteinte à son droit à la vie n’était pas décédée, par exemple lorsque la force utilisée par la police n’avait pas été meurtrière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 49, CEDH 2004‑XI), lorsque la victime d’un accident de la route avait subi des lésions corporelles très graves (Nicolae Virgiliu Tănase, précité), ou encore lorsque la victime était atteinte d’une maladie potentiellement mortelle (G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, 1er décembre 2009).
60. Quoiqu’il n’existe pas de règle générale, il apparaît que si par nature l’activité en cause est dangereuse et propre à exposer la vie de la personne qui s’y livre à un risque réel et imminent, comme dans le cas d’actes de violence potentiellement mortels, la gravité des blessures subies peut ne pas être déterminante et, même en l’absence de toute blessure, un grief peut en pareil cas faire l’objet d’un examen sous l’angle de l’article 2 (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 140, et les références qui y sont citées).
61. Par ailleurs, la Cour a également reconnu l’applicabilité de l’article 2 de la Convention dans des affaires concernant des suicides en détention (parmi d’autres, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, CEDH 2001‑III, Troubnikov c. Russie, no 49790/99, 5 juillet 2005, Renolde c. France, no 5608/05, CEDH 2008 (extraits), et De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, 6 décembre 2011) ou dans un hôpital psychiatrique (Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, 31 janvier 2019).
62. En l’espèce, le requérant a tenté, à plusieurs reprises au cours de sa détention, de mettre fin à ses jours. Il ressort de l’établissement des faits que c’est du fait de l’intervention des agents pénitentiaires que ces tentatives n’ont pas abouti. Le fait que le requérant n’ait pas subi de blessure potentiellement mortelle, voire qu’il ne semble pas avoir subi une quelconque blessure physique grave, n’est, dans ce cas, pas déterminant. En effet, la nature même de l’action du requérant lui faisait courir un risque réel et imminent pour sa vie (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 140).
63. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’article 2 trouve à s’appliquer.
Conclusion sur la recevabilité
64. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
SUR LE FOND
a) Principes généraux applicables
70. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Fernandes de Oliveira, précité, § 104, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 134). Cette disposition peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger un individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Renolde, précité, § 80, Fernandes de Oliveira, précité, § 108, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 136).
71. Dans le cas spécifique du risque de suicide en prison, il n’y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’existait un risque réel et immédiat qu’un individu donné attente à sa vie (De Donder et De Clippel, précité, § 69, et Fernandes de Oliveira, précité, § 110). La Cour a pris en compte divers facteurs afin d’établir si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait pour la vie d’un individu donné un risque réel et immédiat (voir Fernandes de Oliveira, précité, § 115, et les références y citées).
72. Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient pallié ce risque (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, et Troubnikov, précité, § 69). La Cour doit donc rechercher si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour prévenir ce risque en prenant les mesures dont elles disposaient (Fernandes de Oliveira, précité, § 125). Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire (De Donder et De Clippel, précité, § 69, et Fernandes de Oliveira, précité, § 126).
73. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ; il ne faut en effet pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Keenan, précité, § 90, Taïs c. France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006, et Fernandes de Oliveira, précité, § 111).
b) Application au cas d’espèce
74. La Cour rappelle qu’elle a estimé opportun d’examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention les mesures prises par les autorités pénitentiaires pour empêcher que se matérialise le risque que le requérant attente effectivement à ses jours (paragraphe 56 ci-dessus). Les questions relatives à la manière dont le requérant a été traité par les autorités à la suite de ses tentatives de suicide et plus généralement pendant sa détention seront examinées sous l’angle de l’article 3 de la Convention (mutatis mutandis, Keenan, précité, § 101 ; voir paragraphes 83 et suivants ci-dessous).
Les tentatives de suicide du 26 juin 2011
75. En ce qui concerne les tentatives de suicide du 26 juin 2011, il n’a pas été contesté par le Gouvernement que les autorités pénitentiaires savaient, lors de l’arrivée du requérant à la maison d’arrêt d’Arlon, qu’il y avait un risque réel qu’il tente d’attenter à ses jours. Le juge d’instruction avait en effet informé les autorités pénitentiaires des tendances suicidaires du requérant qui les avait explicitement exprimées (paragraphes 4 et 6 ci‑dessus).
76. Ceci étant, compte tenu du très bref laps de temps s’étant écoulé entre le moment où le juge d’instruction informa les autorités pénitentiaires des tendances suicidaires du requérant et le moment de son arrivée à la maison d’arrêt (paragraphes 6 et 7 ci-dessus), il ne serait pas raisonnable d’exiger des autorités pénitentiaires que des mesures spéciales aient été mises en place préventivement pour éviter tout risque suicidaire lors de l’arrivée du requérant (voir, dans le même sens, Kayar c. Turquie (déc.), no 1751/06, § 31, 17 avril 2012).
77. Nonobstant ce très bref laps de temps, les autorités pénitentiaires sont intervenues rapidement et ont réussi à empêcher que le requérant mette fin à sa vie. Il a ensuite fait l’objet d’une surveillance spéciale et tous les objets potentiellement dangereux lui ont été retirés afin d’éviter tout autre passage à l’acte (paragraphes 8 à 10 ci-dessus).
La tentative de suicide du 13 novembre 2011
78. En ce qui concerne la tentative de suicide du 13 novembre 2011, eu égard aux antécédents du requérant et aux rapports médicaux le concernant, il doit être considéré que les autorités pénitentiaires avaient ou devaient avoir pleinement connaissance de sa fragilité psychologique. Le Gouvernement ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la tentative de suicide du requérant constituait une simple manœuvre de sa part pour obtenir ce qu’il voulait. Le dossier fait clairement apparaître la détresse psychologique dans laquelle il se trouvait lors de son arrestation initiale par la police et tout au long de sa détention préventive (voir, sur ce point, paragraphe 105 ci-dessous).
79. Cela étant dit, l’imprévisibilité du comportement humain doit être prise en compte (voir paragraphe 73 ci-dessus). Or il n’apparaît pas du dossier que, lors de son arrestation le 21 octobre 2011 et avant les événements du 13 novembre 2011, les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie du requérant. Le requérant n’avait manifesté aucun signe particulier tels que des pensées suicidaires ou des signes de détresse aiguë au cours des trois semaines de détention précédant le 13 novembre 2011. Ceci peut expliquer qu’aucune mesure particulière ne fut mise en place dans le but de protéger le requérant contre une éventuelle atteinte à son intégrité.
80. Dès que le risque de suicide s’est matérialisé par les menaces suicidaires du requérant, celui-ci fut placé dans une cellule d’isolement sécurisée et fit l’objet d’une surveillance spéciale toutes les 7 minutes (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Malgré cela, le requérant a tenté de se pendre avec son pantalon, ce qui fut arrêté par l’intervention immédiate des agents pénitentiaires (paragraphe 23 ci-dessus). Tous les objets potentiellement dangereux lui ont alors été retirés afin d’éviter tout autre passage à l’acte (paragraphe 24 ci-dessus).
Conclusion
81. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, dans l’ensemble, les autorités ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation du risque pour la vie du requérant, dans la mesure où elles avaient connaissance du caractère certain et immédiat de ce risque. Les mesures prises ont d’ailleurs effectivement permis d’empêcher que le requérant se suicide.
82. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
ARTICLE 3
VOLET MATERIEL
a) Principes généraux applicables
95. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000‑XI, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 116).
96. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 202, CEDH 2012, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 118).
97. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. Cela étant, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du détenu sont assurés de manière adéquate (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 99, 20 octobre 2016), notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła, précité, § 94). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peuvent engager la responsabilité de l’État au regard de l’article 3 (Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 57, CEDH 2009, Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, § 105, 26 avril 2016, et Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, § 146, 31 janvier 2019).
98. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan, précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003‑I, Troubnikov, précité, § 68, et Bamouhammad c. Belgique, no 47687/13, § 118, 17 novembre 2015). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné et de façon à diminuer les risques qu’une personne se nuise à elle-même, et ce sans empiéter sur l’autonomie individuelle (Fernandes de Oliveira, précité, § 112). Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. La Cour a en effet reconnu que des mesures excessivement restrictives pouvaient soulever des problèmes au regard des articles 3, 5 et 8 de la Convention. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (Keenan, précité, § 92, Younger, décision précitée, et Troubnikov, précité, § 70).
99. En ce qui concerne les malades mentaux, la Cour a estimé qu’il s’agissait de personnes particulièrement vulnérables (Renolde, précité, § 84). Lorsque les autorités décident de placer et de maintenir en détention une personne atteinte d’une maladie mentale, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques découlant de sa maladie (Fernandes de Oliveira, précité, § 113).
b) Application au cas d’espèce
100. La Cour examinera d’abord l’encadrement et le suivi médical dont le requérant bénéficia lors de ses périodes de détention à la maison d’arrêt d’Arlon puis les mesures de sécurité particulières dont il fit l’objet après ses tentatives de suicide.
L’encadrement médical du requérant
101. La Cour constate qu’au cours de ses deux périodes de détention préventive le requérant a été traité comme un simple détenu placé dans un environnement carcéral ordinaire.
102. À la différence d’autres affaires examinées par la Cour (De Donder et De Clippel, précité, § 80, et Tekın et Arslan c. Belgique, no 37795/13, § 103, 5 septembre 2017, affaires examinées sous l’angle de l’article 2 de la Convention), ni la mise en observation ni l’internement du requérant n’avaient été ordonnés à ce stade de l’instruction.
103. Le requérant soutient qu’il aurait dû être interné ou, à tout le moins, placé en observation dans une annexe psychiatrique de prison.
104. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. La décision de placer le requérant en observation dans une annexe psychiatrique ou d’ordonner son internement relevait respectivement de la compétence de juge d’instruction et des juridictions d’instruction (paragraphe 48 ci-dessus). En l’espèce, le juge d’instruction n’a pas jugé opportun de placer le requérant en observation puisqu’il rendit un simple mandat d’arrêt. Il n’incombe pas à la Cour de décider si le juge d’instruction aurait dû prendre une autre décision, celui-ci étant mieux placé que la Cour pour prendre une décision quant au lieu et aux conditions dans lesquelles la détention du requérant devait avoir lieu compte tenu de son état de santé mentale. En revanche, il appartient à la Cour de vérifier si la manière dont le requérant a été traité au cours de sa détention était compatible avec les exigences découlant de l’article 3 de la Convention.
105. Il ressort du dossier que, dès le jour de son arrestation par la police, le requérant avait explicitement formulé aux agents de police et au juge d’instruction sa détresse psychologique (paragraphe 4 ci-dessus). Ceci fut reconnu par le juge d’instruction qui mentionna la fragilité psychologique et les tendances suicidaires du requérant dans son mandat d’arrêt (paragraphe 5 ci-dessus) ainsi que dans le fax envoyé spécialement aux autorités pénitentiaires le 26 juin 2011 (paragraphe 6 ci-dessus). Aussi, au cours de la détention, le docteur Dl., médecin traitant, indiqua que le requérant était borderline, qu’il présentait une tendance bipolaire, un état de névrose obsessionnelle et une décompensation maniaque ou une psychose paranoïde (paragraphe 14 ci-dessus). Cette analyse fut confirmée par le rapport de l’expert-psychiatre docteur Dn. qui indiqua en septembre 2011 que le requérant présentait une personnalité paranoïaque qui pouvait déborder et devenir véritablement psychotique. Celui-ci concluait que l’internement du requérant était indiqué (paragraphe 19 ci-dessus).
106. La Cour estime que ces éléments sont suffisants pour considérer que l’état de santé mentale du requérant devait, au minimum, être pris en considération par les autorités dans le cadre de leurs décisions touchant à son régime pénitentiaire et à son maintien en détention (dans le même sens, Bamouhammad, précité, § 114). Faute pour les autorités d’ordonner le placement du requérant dans un établissement psychiatrique, elles devaient à tout le moins lui assurer des soins médicaux correspondant à son état (Renolde, précité, § 99). La Cour a en effet déjà indiqué que l’état d’un prisonnier dont il est avéré qu’il souffrait de graves problèmes mentaux et présentait des risques suicidaires appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement humain, quelle que soit la gravité des faits à raison desquels il a été condamné (Rivière c. France, no 33834/03, § 75, 11 juillet 2006) ou qu’il est soupçonné d’avoir commis.
107. Se tournant vers le suivi médical dont bénéficia le requérant en l’espèce, il ressort du dossier que, tel que le souligne le Gouvernement, le requérant a pu rencontrer à plusieurs reprises le médecin de la prison, qui est un médecin généraliste, notamment à la suite de ses tentatives de suicide des 26 juin et 13 novembre 2011. Il put également consulter son médecin traitant qui vint lui rendre visite à la prison le 27 juillet 2011 à sa propre demande (paragraphe 13 ci-dessus). Au cours de la deuxième période de détention, le requérant put également, à sa propre demande, consulter un psychologue à trois reprises (paragraphe 29 ci-dessus).
108. Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si le requérant a été vu par un psychiatre au cours de sa détention. Le Gouvernement allègue que tel a été le cas : le docteur W. aurait vu le requérant le 7 août 2011 et le 18 novembre 2011 (paragraphes 12 et 28 ci‑dessus). Le requérant conteste fermement cette allégation et a introduit une plainte pénale pour faux en écritures concernant le dossier médical de la prison (paragraphe 37 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, en tenant compte des dates fournies par le Gouvernement, la Cour note que ce psychiatre n’aurait rencontré le requérant que respectivement 10 jours et 5 jours après les tentatives de suicide de ce dernier.
109. La Cour considère que, compte tenu de la fragilité psychologique du requérant, de ses troubles comportementaux qui se sont manifestés tout de suite après son placement en détention préventive, et qui auraient pu mettre en danger la propre personne de l’intéressé, il appartenait aux autorités de le faire examiner par un médecin psychiatre afin de déterminer la compatibilité de son état psychologique avec la détention, ainsi que les mesures thérapeutiques à prendre dans son cas précis (dans le même sens, Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 170, 16 décembre 2008). Le traitement du requérant a été défini sans que soient consultés des spécialistes en psychiatrie, ce que la Cour a déjà jugé constitutif de graves lacunes dans les soins médicaux prodigués à un malade mental dont on connaissait les tendances suicidaires (Keenan, précité, § 116).
110. Les médecins de la prison ne semblent pas non plus s’être interrogés sur l’adéquation de la détention du requérant dans une cellule ordinaire de la prison avec son état de santé mentale (dans le même sens, Rupa, précité, § 175).
111. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que le directeur de la prison ait prit le soin d’informer le juge d’instruction des tentatives de suicide commises par le requérant, contrairement à ce qu’exigeait l’article 102 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires (paragraphe 50 ci-dessus), alors que le juge d’instruction était le seul qui, à ce moment-là, avait la compétence d’ordonner l’éventuelle mise en observation du requérant à l’annexe psychiatrique d’une prison.
112. En outre, la Cour relève que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a elle-même reconnu dans son arrêt prononçant un non-lieu que le requérant ne semblait pas avoir reçu des soins appropriés à son état durant les deux crises et que les mesures visant à protéger l’intégrité physique du requérant ne semblaient pas adéquates au regard des exigences de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 39 ci-dessus).
113. Il semble ainsi que le requérant a subi le manque structurel dans l’offre de soins psychiatriques qui a été mis en lumière, tant en ce qui concerne les personnes internées que les prisonniers ordinaires, par le Conseil central de surveillance pénitentiaire, institué au sein du service public fédéral Justice et ayant pour mandat de contrôler de manière indépendante les conditions de traitement des détenus, dans son rapport 2008-2010 (voir Claes c. Belgique, no 43418/09, § 71, 10 janvier 2013).
114. Enfin, en ce qui concerne l’allégation du Gouvernement selon laquelle le requérant serait resté en défaut de démontrer l’impact négatif des conditions de détention sur son état mental, la Cour rappelle qu’elle a souligné à de nombreuses reprises qu’il fallait, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient compatibles avec les exigences de l’article 3, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (voir, par exemple, Claes, précité, § 93, et la jurisprudence qui y est citée). De plus, en l’espèce, dans son rapport du 8 août 2011, le docteur Dl. dit explicitement que la détention aggravait la dépression sévère du requérant (paragraphe 16 ci-dessus).
Les mesures de sécurité particulières
115. En ce qui concerne les mesures de sécurité particulières prises par les autorités pénitentiaires juste après les tentatives de suicide du requérant, à savoir le placement en cellule d’isolement sécurisée, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la Convention, les autorités avaient le devoir de protéger le requérant en prenant des mesures de précaution générale afin de diminuer les risques d’automutilation tout en évitant d’empiéter sur l’autonomie individuelle (De Donder et De Clippel, précité, § 70). C’est au regard de cette obligation positive de l’État que les mesures de sécurité particulières qui furent ordonnées doivent être examinées.
116. En ce qui concerne les mesures prises suite aux tentatives de suicide du 26 juin 2011, le requérant ne conteste pas qu’elles visaient à le protéger contre tout risque d’automutilation. Le placement à l’isolement fut alors appliqué pendant une journée et il ressort du dossier que, dès que le requérant était plus calme, des vêtements lui furent donnés, il rencontra le médecin de la prison puis il fut replacé en cellule ordinaire (paragraphes 8 à 11 ci-dessus). Il n’apparaît donc pas que les mesures de sécurité particulières aient été prolongées au-delà du temps nécessaire à sa protection. Ces mesures prises le 26 juin 2011 ne sauraient dès lors pas être constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant.
117. En revanche, en ce qui concerne le placement à l’isolement le 13 novembre 2011, la Cour relève qu’il fut décidé à titre de mesure provisoire, puis confirmé comme sanction disciplinaire, du fait des menaces du requérant d’attenter à sa vie (paragraphe 22 ci-dessus). Cette sanction fut appliquée pendant une durée de trois jours. Pendant les premières 24 heures, le requérant resta nu, entravé par les menottes et casqué sans avoir aucune visite d’un médecin (paragraphes 22 à 27 ci-dessus). Certes, l’ordre du médecin de casquer et de menotter le requérant ainsi que le fait de lui retirer ses vêtements avaient pour but de le protéger contre lui-même, compte tenu de sa tentative de suicide. Ceci étant, cette mesure fut apparemment décidée sans prise en compte de l’état psychique du requérant (dans le même sens, Renolde, précité, § 124), et sans qu’il soit procédé à une réévaluation de la nécessité de maintenir les entraves et la nudité du requérant pendant 24 heures.
118. La Cour note que le CPT a déjà indiqué qu’il considère que maintenir un détenu nu en cellule s’apparente à un traitement dégradant (paragraphe 53 ci-dessus). Le CPT a en outre recommandé aux autorités belges d’abandonner l’utilisation des cellules disciplinaires dans le contexte de l’urgence psychiatrique. Ces cellules ne devraient, d’après le CPT, jamais être utilisées à des fins médicales (paragraphe 54 ci-dessus).
Conclusion sur le volet matériel de l’article 3
119. La Cour conclut de ce qui précède que, compte tenu de l’état de santé mentale du requérant, le manque d’encadrement et de suivi médical au cours de ses deux périodes de détention combiné avec l’infliction d’une sanction disciplinaire dans une cellule d’isolement pendant trois jours alors qu’il avait commis plusieurs tentatives de suicide ont constitué une épreuve particulièrement pénible et ont soumis le requérant a une détresse ou à une épreuve d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (dans le même sens, Rivière, précité, § 76). La Cour ne doute pas qu’un tel traitement a provoqué chez lui des sentiments d’arbitraire, d’infériorité, d’humiliation et d’angoisse. La circonstance qu’il n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser le requérant n’exclut pas qu’il soit qualifié de dégradant et tombe ainsi sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3.
120. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
SUR LE VOLET PROCEDURAL
a) Principes généraux applicables
123. Les principes généraux sont énoncés notamment dans les arrêts El‑Masri (précité, §§ 182-185), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09 et 2 autres, §§ 316-326, CEDH 2014 (extraits)), et Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015).
124. En particulier, la Cour rappelle qu’il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois qui interdisent la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués et de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des mauvais traitements survenus sous leur responsabilité (Bouyid, précité, § 117). L’enquête doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle doit également être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés (Bouyid, précité, § 119). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable en découle implicitement (Bouyid, précité, § 121). La victime doit être en mesure de participer effectivement à l’enquête (Bouyid, précité, § 122). Enfin, l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête (Bouyid, précité, § 123).
b) Application au cas d’espèce
125. Il ressort de la motivation de l’arrêt de la chambre des mises en accusation que l’enquête menée sous l’autorité du juge d’instruction a permis d’établir avec une certaine précision les faits s’étant déroulés à la prison.
126. Ceci étant, la Cour constate que plus de huit mois se sont écoulés entre le réquisitoire de mise à l’instruction du procureur du Roi le 8 juillet 2014 et le moment où le juge d’instruction reçut le dossier le 3 mars 2015 (paragraphe 32 ci-dessus). Un tel délai pendant lequel l’instruction n’a pas commencé n’est pas expliqué par le Gouvernement et apparaît difficilement compréhensible et acceptable lorsqu’a été déposée une plainte pénale pour des faits de traitements inhumains et dégradants et abstention coupable.
127. De surcroît, une fois l’instruction entamée en mars 2015, le juge d’instruction se contenta de demander aux enquêteurs de récupérer et d’analyser le dossier pénitentiaire et le dossier médical du requérant. Aucun autre devoir ne fut ordonné. Aucune des personnes impliquées ou mises en cause ne furent entendues, ni les agents pénitentiaires, ni les médecins ayant vu le requérant, ni le requérant lui-même. Moins de trois mois après la réception par le juge d’instruction du dossier, le procureur traça un réquisitoire de non-lieu (paragraphe 35 ci-dessus).
128. Une telle enquête ne saurait passer pour effective.
129. Par conséquent, il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
Gömi c. Turquie du 19 février 2019 requête n° 38704/11
Article 3 : Les autorités turques doivent assurer au requérant atteint de troubles mentaux des conditions adéquates de détention dans un établissement adapté
L’affaire concerne le maintien en détention du requérant qui présente des troubles psychotiques depuis 2003. La Cour relève que, depuis 2003, M. Gömi souffre toujours d’un trouble mental et qu’à l’heure actuelle, il ne peut passer pour être en mesure de prendre des décisions de manière éclairée et consciente. Il ne dispose pas de sa capacité d’apprécier les faits avec justesse et clairvoyance. Au vu des éléments du dossier, la Cour considère qu’en l’absence d’un suivi constant de l’évolution de sa maladie par une équipe spécialisée, les autorités n’ont pas prodigué au requérant un traitement médical approprié en milieu pénitentiaire. Eu égard aux circonstances particulières de la cause et au besoin urgent de mettre fin à la violation de l’article 3 de la Convention, la Cour considère qu’il incombe à l’Etat défendeur, en raison de l’application de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), d’assurer au requérant atteint d’un trouble mental des conditions adéquates de détention dans un établissement apte à lui fournir le traitement psychiatrique nécessaire, ainsi qu’un suivi médical constant.
CEDH
68. Le requérant soutient que, compte tenu de la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée lui ayant été infligée, sa détention en milieu carcéral pour le restant de ses jours est incompatible avec son état de santé mentale, et il demande son transfert vers un centre hospitalier.
69. Le Gouvernement réplique que le requérant a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu’il a bénéficié de soins appropriés, et, en se fondant sur divers rapports médicaux, que son état de santé s’est conséquemment amélioré. Il dit que l’intéressé continue à recevoir les traitements prescrits par les médecins et qu’il est désormais apte à purger sa peine en milieu carcéral.
1. Principes généraux
70. La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000‑XI, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 61, CEDH 2001‑III, Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 86, CEDH 2015).
71. Certes, la Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002‑IX, et Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004).
72. Ainsi, après s’être penchée sur l’état de santé du prisonnier et après avoir procédé à un examen des effets de la détention sur l’évolution de celui-ci, la Cour a considéré que certains traitements enfreignaient l’article 3 du fait qu’ils étaient infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111 à 115, CEDH 2001‑III). De même, la Cour a jugé que le fait d’avoir maintenu en détention un prisonnier présentant une infirmité physique dans des conditions inadaptées à son état de santé était constitutif d’un traitement dégradant (Price c. Royaume‑Uni no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII, affaire dans laquelle la requérante était handicapée des quatre membres).
73. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994, avis de la Commission, § 79, série A no 280‑A). La Cour a par la suite affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’était son bien-être qui devait être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (Kudła précité, § 94, et Mouisel, précité, § 40).
74. De plus, la Cour rappelle que, pour statuer sur l’aptitude ou non d’une personne à la détention au vu de son état, trois éléments particuliers doivent être pris en considération : a) son état de santé, b) le caractère adéquat ou non des soins et traitements médicaux dispensés en détention, et c) l’opportunité de son maintien en détention compte tenu de son état de santé (Mouisel, précité, §§ 40 à 42, et Rivière c. France, no 33834/03, § 63, 11 juillet 2006).
2. Application en l’espèce des principes énoncés ci-dessus
75. La Cour constate que, dans la présente affaire, se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant – qui purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée incompressible – avec son maintien en détention dans un milieu où il n’est pas encadré et suivi au quotidien par un personnel médical spécialisé, et celle du degré de gravité de la situation en cause au regard de la Convention – autrement dit celle de savoir si cette situation a atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
76. En ce qui concerne la peine infligée au requérant, la Cour note que l’intéressé a initialement été condamné à la peine capitale, et ce pour avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel du pays. À la suite de la promulgation d’une loi ayant abrogé la peine capitale et remplacé les sentences de ce type déjà prononcées par des peines de réclusion criminelle à perpétuité aggravée, la peine du requérant a été commuée, par décision de la cour d’assises appliquant les nouvelles dispositions légales, en une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée (paragraphe 8 ci-dessus). Pareille peine signifie que l’intéressé restera en prison pour le restant de ses jours, indépendamment de toute considération se rapportant à sa dangerosité et sans possibilité de libération conditionnelle même après une certaine période de détention (Öcalan c. Turquie (no 2), (nos 24069/03 et 3 autres, § 201, 18 mars 2014).
77. Même si le requérant ne se plaint pas explicitement de sa condamnation à perpétuité sans possibilité de libération, la Cour rappelle avoir affirmé à plusieurs reprises que l’exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée qualifiée d’incompressible ne respectait pas les exigences de l’article 3 de la Convention à raison de l’absence de perspective d’élargissement et de possibilité de réexamen (Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 66069/09 et 2 autres, §§ 119 à 122, CEDH 2013 (extraits), Öcalan c. Turquie (no 2), précité, §§ 193 à 207, Kaytan c. Turquie, no 27422/05, §§ 63 à 68, 15 septembre 2015, Gurban c. Turquie, no 4947/04, §§ 30 à 35, 15 décembre 2015, et Hutchinson c. Royaume-Uni [GC], no 57592/08, § 42, 17 janvier 2017). Or, dans la présente espèce, ce type de peine perpétuelle, dont l’incompatibilité avec les exigences de l’article 3 est déjà constatée, est exécutée par un individu atteint d’un trouble mental postérieurement à sa condamnation.
À cet égard, elle renvoie à l’affaire Murray c. Pays-Bas ([GC], no 10511/10, §§ 107-112, 26 avril 2016) et rappelle les obligations de l’État résultant de l’article 3 de la Convention, s’agissant des détenus à vie souffrant de déficiences mentales et/ou de troubles mentaux.
78. Pour ce qui est de l’état de santé mentale du requérant, la Cour constate que ce dernier a été diagnostiqué comme souffrant d’une schizophrénie. À partir de 2003, l’intéressé a été hospitalisé à plusieurs reprises et il s’est vu administrer divers médicaments pour le traitement de cette maladie (voir, notamment, le paragraphe 36 ci-dessus). Différents établissements spécialisés ont été interrogés pour déterminer si cette pathologie pouvait être qualifiée de maladie permanente au sens de l’article 104/b de la Convention, ce qui aurait offert au requérant la possibilité de bénéficier d’une grâce présidentielle, et si elle nécessitait une suspension de l’exécution de la peine sur le fondement de l’article 16 de la loi no 5725.
79. À cet égard, la Cour note que, d’après certains rapports médicaux, datant de 2007 et de 2010, il s’agissait d’une maladie permanente ou qualifiée de chronique (paragraphes 21, 23 et 25 ci-dessus). Elle note aussi que, ultérieurement, le 26 février 2014, l’institut médicolégal a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une maladie permanente, tout en précisant que l’intéressé devait être mis sous protection et sous traitement dans un établissement de santé du type de ceux visés par la législation pertinente applicable, en vertu de l’article 16 de la loi no 5275 (paragraphe 30 ci-dessus). Elle note également que, par la suite, dans un rapport daté du 19 février 2016, le même institut médicolégal a indiqué que le requérant souffrait de psychoses en rémission et qu’il pouvait purger sa peine en milieu carcéral à condition que ses suivis médicaux fussent assurés (paragraphe 35 ci‑dessus).
80. Cela étant, la Cour observe que, au cours de l’année 2016 et de l’année 2017, le requérant présentait des délires paranoïdes, a été diagnostiqué souffrir d’une psychose atypique et que, en outre, il a déclaré qu’il croyait à l’existence d’un double de lui-même, que ses pensées étaient diffusées, et qu’il les entendait être exprimées à voix haute. À la même période, l’intéressé recevait un traitement pour la schizophrénie, et le dernier avis médical préconisait de lui assurer un suivi rapproché contre le risque de suicide (paragraphe 36 ci-dessus).
81. S’agissant des conditions matérielles de détention du requérant, la Cour note que celui-ci est maintenu à ce jour dans le centre pénitentiaire de type F de Bolu, dans une cellule individuelle mesurant 10 m2, munie d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire, et permettant un accès à une cour de promenade d’environ 45 m2 (paragraphe 37 ci-dessus). Elle note aussi que le Gouvernement n’a pas donné plus de précisions quant à l’existence d’autres facilités éventuellement mises à la disposition de l’intéressé, et que les activités et autres droits pouvant être exercés par ce dernier sont régis par les dispositions de l’article 25 de la loi no 5275 prévoyant un régime spécifique pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée (paragraphe 41 ci-dessus).
82. Quant aux soins médicaux prodigués au requérant, la Cour observe que, en plus de s’être vu administrer des traitements durant ses internements, à son retour à l’établissement pénitentiaire, celui-ci a été examiné par les médecins de différents hôpitaux et a continué à recevoir des traitements médicaux (paragraphe 36 ci-dessus).
83. La Cour relève toutefois, à la consultation des mêmes rapports médicaux (paragraphes 31, 32 et 35 ci-dessus), que le requérant souffre toujours d’un trouble mental (paragraphes 36 et 80 ci-dessus). Ses lettres manuscrites révèlent qu’il ne dispose pas de la capacité à exprimer clairement sa volonté. D’ailleurs, nombre de rapports, du plus ancien au plus récent, rédigés par les médecins l’ayant examiné, mettent en exergue ses difficultés à faire la différence entre le réel et l’imaginaire et sa propension à présenter des hallucinations (paragraphe 36 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour observe que, à l’heure actuelle, le requérant ne peut pas passer pour être en mesure de prendre des décisions de manière éclairée et consciente, étant démuni de la capacité à apprécier les faits avec justesse et clairvoyance.
84. La Cour prend note, sur ce point, de la position du Gouvernement, qui se fonde sur les rapports médicaux récents pour soutenir que l’état de santé mentale du requérant s’est amélioré depuis 2003, année où le premier diagnostic a été posé. Elle observe toutefois que le Gouvernement n’a fourni aucun document médical attestant que le requérant est désormais en mesure de discerner le traitement qui lui est infligé.
Au contraire, la Cour observe que les rapports médicaux affirmaient que le requérant était atteint d’une schizophrénie chronique (paragraphes 20 et 21 ci-dessus) puis d’une schizophrénie résiduelle (paragraphe 25 ci-dessus) ou encore d’une schizophrénie paranoïde (paragraphes 27 et 36 ci-dessus) et des traitements médicaux furent prescrits en fonction du nouveau diagnostic. Par ailleurs, même si, dans le courant de l’année 2014, l’intéressé présentait des symptômes d’un désordre affectif atypique ou d’un désordre schizo-affectif en rémission (paragraphes 31 et 32 ci-dessus), le diagnostic de délires paranoïdes posé en juin 2016 et celui de psychose atypique en 2017 suggèrent une rechute. Autrement dit, en l’absence d’un suivi constant de l’évolution de sa maladie par une équipe spécialisée, les autorités ne peuvent pas passer pour avoir prodigué au requérant un traitement médical approprié en milieu pénitentiaire.
85. La Cour ne sous-estime pas les efforts déployés par les autorités en ce qui concerne les soins médicaux prodigués au requérant. Toutefois au regard du tableau clinique tel que décrit par les rapports médicaux, il est question du maintien dans un centre pénitentiaire d’un individu souffrant toujours d’une insanité d’esprit (voir, notamment, paragraphe 36 ci-dessus).
86. En tout état de cause, la Cour estime que le fait que le requérant se trouve dans l’incapacité de se plaindre de sa détention en milieu pénitentiaire de façon claire et précise, en raison de l’insanité d’esprit qu’il présente, ne saurait justifier ses conditions de détention actuelles. Admettre le contraire reviendrait à vider de son sens la notion de dignité humaine qui se trouve au cœur même de la Convention (Bouyid c. Belgique [GC], précité, § 89).
87. Il convient de souligner que les détenus atteints de troubles mentaux risquent incontestablement de se sentir davantage en situation d’infériorité et d’impuissance. C’est pourquoi une vigilance accrue s’impose dans le contrôle du respect de la Convention. S’il appartient aux autorités médicales de décider – sur la base des règles reconnues de leur science – des moyens thérapeutiques à employer pour préserver la santé physique et mentale des malades qui sont entièrement incapables d’autodétermination et dont elles ont donc la responsabilité, ceux-ci n’en demeurent pas moins protégés par l’article 3 de la Convention.
En l’espèce, la Cour reconnaît que la nature même de son état de santé mentale rend le requérant plus vulnérable que le détenu moyen et que sa détention en milieu pénitentiaire, à l’exception des périodes correspondant à son transfert en milieu médical, a pu contribuer à l’aggravation de ses troubles mentaux. À cet égard, elle considère que le défaut de placement du requérant par les autorités, pendant la plus grande partie de sa détention, dans un établissement psychiatrique adapté ou dans un centre pénitentiaire doté d’un pavillon psychiatrique spécialisé a forcément exposé l’intéressé à un risque pour sa santé et a dû être source pour lui de stress et d’angoisse (Sławomir Musiał, précité, § 96).
Au demeurant, la Cour note que le requérant s’est vu appliquer un régime identique à celui des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée saines d’esprit, et ce malgré la spécificité de son état de santé. Or à cet égard, elle rappelle que les recommandations pertinentes du Comité des ministres aux États membres, à savoir la Recommandation R (98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire et la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, préconisent de placer et de soigner les détenus souffrant de troubles mentaux graves dans un service hospitalier disposant d’un équipement adéquat et d’un personnel qualifié. Elle rappelle avoir justement attiré l’attention des États membres sur l’importance de ces recommandations, fussent-elles non contraignantes pour les États membres, dans les arrêts Naoumenko c. Ukraine (no 42023/98, § 94, 10 février 2004), Rivière (précité, § 72), Dybeku c. Albanie (no 41153/06, § 48, 18 décembre 2007), Sławomir Musiał (précité, § 96) et Ţicu c. Roumanie, no 24575/10, § 67, 1er octobre 2013).
88. Eu égard aux faits de l’espèce dans leur ensemble, et aux effets cumulatifs de la nature de la peine infligée au requérant et de la maladie dont celui-ci souffre, la Cour conclut que les exigences de l’article 3 de la Convention en la matière n’ont pas été respectées dans le chef de l’intéressé. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.
Ebedin Abi c. Turquie du 13 mars 2018 requête n° 10839/09
Article 3 et détention : Repas inadaptés au régime alimentaire médicalement prescrit à un détenu
L’affaire concerne principalement le régime d’alimentation en milieu carcéral de M. Abi pendant sa détention dans l’établissement pénitentiaire d’Erzurum entre 2008 et 2009. M. Abi se plaignait de ne pas se voir servir des repas conformes au régime alimentaire qui lui avait été médicalement prescrit et de la détérioration de sa santé de ce fait. La CEDH juge en particulier que les autorités internes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour la protection de la santé et du bien-être de M. Abi et qu’elles ont manqué à assurer à ce dernier des conditions de détention adéquates et respectueuses de la dignité humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la Convention
CEDH
28. Le requérant dénonce le refus des autorités de lui procurer une alimentation conforme aux prescriptions médicales et une détérioration de son état de santé. Il estime que cette situation a emporté violation de l’article 3 de la Convention.
29. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il explique que, à l’instar des autres détenus, le requérant avait la possibilité de s’approvisionner auprès de la cantine, laquelle aurait offert un large choix de nourriture diversifiée, dont des fruits et légumes, et qu’il pouvait également s’adresser à un fournisseur externe pour se procurer les aliments recommandés par les médecins.
30. La Cour rappelle les principes qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière.
Comme elle l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 3 de la Convention doit être considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49, CEDH 2002‑III). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, l’article 3 est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et, d’après l’article 15 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation (voir, entre autres, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
31. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Mikadzé c. Russie, no 52697/99, § 108, 7 juin 2007, et Dybeku c. Albanie, no 41153/06, § 36, 18 décembre 2007). Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance doit en tout cas aller au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime.
32. S’agissant en particulier des personnes privées de liberté, l’article 3 de la Convention impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002‑IX, et Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, § 71, 10 novembre 2005). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates peuvent en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000‑VII, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001‑VII, et Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). L’État est tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (voir, mutatis mutandis, Benediktov c. Russie, no 106/02, § 37, 10 mai 2007, et Soukhovoï c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008).
33. Ainsi, les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. L’article 3 de la Convention impose à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. En particulier, la Cour estime que l’obligation des autorités nationales d’assurer la santé et le bien-être général d’un détenu implique, entre autres, l’obligation de nourrir convenablement celui-ci (voir, mutatis mutandis, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 451, CEDH 2004‑VII, et Moisejevs c. Lettonie, no 64846/01, § 78, 15 juin 2006).
34. En l’espèce, la Cour observe qu’il n’est pas contesté par les parties que l’état de santé du requérant nécessitait que celui-ci fût soigné pour ses différentes maladies. Elle devra donc examiner, au regard des principes énoncés ci‑dessus, si le requérant a bénéficié de soins médicaux suffisants et adéquats pendant sa détention au centre pénitentiaire d’Erzurum et si le refus des autorités de lui procurer une alimentation conforme aux prescriptions médicales était compatible avec l’article 3 de la Convention.
35. La Cour note d’abord avec satisfaction que le requérant a été hospitalisé dans différents établissements de santé quand cela s’est avéré nécessaire (paragraphes 8 et 13 ci-dessus).
36. Elle constate ensuite que le requérant souffrait d’un diabète de type 2 et d’une maladie des artères coronaires, ce qui ressort de deux rapports médicaux, concordants sur ce point (paragraphes 6 et 9). D’après ces rapports, l’intéressé devait suivre un régime alimentaire pour diabétique, hypocalorique, et pauvre en viande bovine et en graisses saturées.
37. Or, ayant examiné les éléments dont elle dispose, la Cour relève que le requérant s’est vu servir des plats principalement à base de viande bovine et de féculents dans l’établissement pénitentiaire en question (paragraphe 22 ci-dessus), qu’il s’en est plaint auprès de l’administration pénitentiaire et que celle-ci a refusé de donner une suite favorable à sa demande de mise en conformité de son alimentation avec les exigences du régime médicalement prescrit (paragraphes 10 et 11 ci-dessus).
38. Elle observe également que l’intéressé a dénoncé l’attitude de l’administration pénitentiaire à son égard devant le juge d’application des peines. Ce juge a relevé que l’administration pénitentiaire procurait au requérant, ainsi qu’à trente-sept autres détenus malades, les mêmes repas que ceux qui étaient servis aux détenus en bonne santé à la seule différence que ces repas étaient réduits en sel et en épices. Il a favorablement accueilli la demande de l’intéressé, considérant qu’il n’était pas établi en quoi ces repas servis sans sel et sans épices étaient conformes au régime médicalement prescrit à celui-ci et que l’administration pénitentiaire n’avait pas précisé si les repas contenaient des matières grasses ou non (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
39. Ensuite, la Cour observe que le procureur a attaqué la décision du juge d’application des peines devant la cour d’assises au motif que l’administration pénitentiaire était dans l’impossibilité de préparer et de fournir un menu spécifique en raison d’une insuffisance de moyens financiers, le montant de l’indemnité journalière accordée aux détenus étant de 3 TRY. Dans le cadre de l’opposition ainsi formée par lui, le procureur a indiqué que la préparation de menus conformes aux régimes médicalement prescrits serait envisageable uniquement en cas d’augmentation du montant de ladite indemnité. La cour d’assises a donné raison au procureur, confirmant que le requérant se voyait proposer des repas sans matières grasses, sans sel et sans épices par le centre pénitentiaire.
40. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence relative aux exigences en matière d’adéquation des sommes allouées aux détenus, selon laquelle, pour des détentions longues, semblables à celle du requérant, les autorités compétentes doivent garantir une alimentation journalière adéquate et suffisante, le cas échéant par la mise en place d’une structure interne pour la restauration des détenus (voir, mutatis mutandis, Chkhartishvili c. Grèce, no 22910/10, § 61, 2 mai 2013, et De los Santos et de la Cruz c. Grèce, nos 2134/12 et 2161/12, § 44, 26 juin 2014).
41. Elle relève que, en l’espèce, l’établissement pénitentiaire où le requérant était incarcéré à l’époque pertinente était bien doté d’une structure de restauration et que les plats y étaient préparés sur place par le personnel affecté à cet effet. Toutefois, elle constate que, eu égard au montant de l’indemnité journalière allouée aux détenus, l’établissement en question n’était pas en mesure de fournir des repas conformes aux exigences spécifiques des régimes alimentaires des détenus malades, nonobstant les prescriptions médicales y afférentes.
42. À cet égard, la Cour note que, d’après la réglementation interne, les détenus malades avaient droit aux produits alimentaires indiqués par les médecins des établissements pénitentiaires. Le montant de l’indemnité journalière qui devait être accordée aux détenus malades dépendait des prescriptions médicales les concernant (paragraphe 21 ci-dessus).
43. Dans ces circonstances, la Cour estime que le refus de mettre l’alimentation du requérant en conformité avec les prescriptions médicales faites à ce dernier ne peut aucunement être justifié par des motifs économiques, étant donné que la loi en vigueur à l’époque des faits prévoyait un budget à part pour les détenus malades.
44. Par ailleurs, la Cour note que ni le procureur ni la cour d’assises n’ont cherché à savoir si l’administration pénitentiaire avait sollicité les autorités compétentes en vue d’une augmentation de l’indemnité journalière pour subvenir aux besoins alimentaires des détenus malades, conformément à la loi.
45. En tout état de cause, les tribunaux internes ayant refusé de chercher à savoir si les produits alimentaires servis au requérant étaient conformes au régime médicalement prescrit à celui-ci, la Cour ne voit pas comment ils ont pu estimer que la pratique suivie par le centre pénitentiaire était compatible avec l’état de santé de l’intéressé.
46. Ce constat s’impose d’autant plus que, d’après les pièces versées au dossier, le requérant n’était pas le seul à être concerné par cette pratique. En effet, il ressort desdites pièces que celle-ci était indistinctement suivie, nonobstant les spécificités des maladies dont souffraient les détenus. Or, aux yeux de la Cour, une telle pratique s’analyse en un manque de précaution, de la part de l’établissement pénitentiaire en question, pour la sauvegarde de la santé des individus concernés (paragraphe 18 ci-dessus).
47. Par ailleurs, la Cour ne saurait partager l’avis du Gouvernement selon lequel le requérant aurait pu se procurer des repas adaptés à son régime alimentaire en les commandant auprès d’un fournisseur externe ou en s’approvisionnant auprès de la cantine de l’établissement pénitentiaire. Dans cette hypothèse, l’intéressé aurait dû lui-même supporter le coût de sa consommation. Or l’état de santé du requérant ne devrait pas faire peser sur ce dernier un fardeau économique plus lourd que celui supporté par les détenus en bonne santé. Partant, la Cour est d’avis qu’une solution onéreuse n’est pas compatible avec le devoir de l’État d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine, nonobstant les problèmes logistiques et financiers (voir, mutatis mutandis, Soukhovoï, précité, § 31, et Benediktov, précité, § 37).
48. Aussi, en premier lieu, pour les raisons susvisées, la Cour constate‑t‑elle que, en agissant de la manière susmentionnée, les autorités ont omis de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé du requérant.
49. En second lieu, et quant à la question de la détérioration de l’état de santé du requérant consécutivement à l’impossibilité pour celui-ci de suivre le régime médicalement prescrit, la Cour rappelle que les allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269, Erdagöz c. Turquie, 22 octobre 1997, § 40, Recueil 1997‑VI, Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 121, 2 novembre 2004, et Hüsniye Tekin c. Turquie, no 50971/99, § 43, 25 octobre 2005). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume‑Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000‑IV).
50. Cela dit, la Cour reconnaît qu’il peut être effectivement difficile pour un individu en détention d’obtenir des preuves médicales de ce qu’il avance (Ayan c. Turquie, no 24397/03, § 55, 12 octobre 2010) et que les difficultés rencontrées par un requérant pour étayer sa cause peuvent également résulter de l’omission par les autorités de réagir effectivement aux griefs formulés devant elles (idem, § 56).
51. La Cour prend note à cet égard de la position du Gouvernement, qui soutient que la preuve de la détérioration de l’état de santé du requérant n’a pas été apportée, que celui-ci ne s’est pas plaint d’une quelconque aggravation de sa maladie après le prononcé de l’arrêt de la cour d’assises et que l’absence de suivi du régime médicalement prescrit n’a pas causé à l’intéressé une souffrance allant au-delà de celle inévitablement inhérente à la détention.
52. En l’occurrence, la Cour observe que, à l’époque pertinente, le requérant a fait usage de tous les recours disponibles pour présenter aux autorités nationales ses griefs relatifs à une non-conformité des repas servis à son régime et à une détérioration de son état de santé liée à son alimentation. Elle note qu’il a par la suite soulevé ces questions devant elle, postérieurement à la décision rendue en dernier ressort en droit interne. La Cour ne voit pas à quelle occasion, ou devant quelle autorité, l’intéressé aurait pu formuler davantage ses griefs. Elle constate que les autorités nationales ont manqué de réactivité face aux multiples demandes que le requérant déclare avoir soumises pour la mise en conformité de son alimentation avec les exigences de son état de santé (paragraphes 10 à 12 et 14 ci-dessus).
53. Eu égard à l’impossibilité pour une personne détenue de se faire prendre médicalement en charge à tout moment et dans un hôpital de son choix, la Cour considère qu’il revenait aux autorités internes de faire examiner le menu standard proposé par l’établissement pénitentiaire en cause par un spécialiste et de soumettre le requérant, par la même occasion, à un examen médical spécifiquement en rapport avec ses griefs.
54. En effet, comme il a été précédemment souligné, les autorités n’ont pas cherché à savoir si l’alimentation procurée au requérant était convenable ni si le non-respect du régime médicalement prescrit à celui-ci a eu des effets néfastes sur son état de santé, l’intéressé ayant d’ailleurs été transféré le 24 novembre 2008 au service des urgences de l’hôpital d’Erzurum pour des douleurs dans la poitrine (paragraphe 13 ci-dessus).
55. La Cour observe en outre que le Gouvernement n’a apporté aucune explication spécifique quant aux effets de la pratique suivie par l’établissement pénitentiaire sur l’état de santé du requérant et que les autorités internes ne se sont pas non plus penchées sur cette question.
56. Partant, la Cour estime que, par leur carence, les autorités internes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour la protection de la santé et du bien-être du requérant et qu’elles ont manqué, pour cette raison, à assurer à ce dernier des conditions de détention adéquates et respectueuses de la dignité humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la Convention.
57. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure au rejet de l’exception préliminaire soulevé par le Gouvernement (paragraphe 27 ci-dessus) et à la violation de cette disposition.
Dorneanu c. Roumanie du 28 novembre 2011 requête n o 55089/13
Article 3 : La détention d’une personne souffrant d’un cancer en phase terminale doit être adaptée en vertu de considérations humanitaires.
i. Principes généraux
75. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative : elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé d’un requérant (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001‑VII, et Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX).
76. S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 de la Convention impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La souffrance due à une maladie qui survient naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3 de la Convention si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables. La santé et le bien-être du prisonnier doivent être assurés de manière adéquate compte tenu des exigences pratiques de l’emprisonnement, notamment par l’administration des soins médicaux requis. Ainsi, la détention d’une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (Gülay Çetin, précité, § 101, avec les références qui y sont citées).
77. Pour déterminer si la détention d’une personne malade est conforme à l’article 3 de la Convention, la Cour prend en considération trois éléments (voir, par exemple, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 39, 15 janvier 2004, Gülay Çetin, précité, § 102, Bamouhammad c. Belgique, no 47687/13, §§ 120-123, 17 novembre 2015, et Rywin c. Pologne, nos 6091/06, 4047/07 et 4070/07, § 139, 18 février 2016, ainsi que les références qui y figurent).
78. Le premier élément est l’état de santé de l’intéressé et l’effet des modalités d’exécution de la détention sur son évolution. Les conditions de détention ne peuvent en aucun cas soumettre une personne privée de liberté à des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier, à l’avilir et éventuellement à briser sa résistance physique et morale. Ainsi, la détention d’une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
79. Le deuxième élément à prendre en considération est le caractère adéquat ou non des soins et traitements médicaux dispensés en détention. Il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi ; il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic soit établie et une surveillance médicale adéquate soit également mise en œuvre.
80. Le troisième et dernier élément est l’opportunité du maintien en détention de l’intéressé compte tenu de son état de santé. Certes, la Convention n’impose aucune « obligation générale » de libérer un détenu pour raisons de santé, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner. Il n’en demeure pas moins que la Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises.
ii. Application de ces principes en l’espèce
81. La Cour observe tout d’abord que le requérant n’a pas fourni de détails précis concernant les conditions matérielles de sa détention. Cependant, il qualifiait ces conditions d’« inhumaines » et reprochait aux autorités les transferts incessants entre divers lieux de détention, y compris pendant la phase terminale de sa maladie. Le Gouvernement soutient que, dans les hôpitaux civils et ceux de l’administration pénitentiaire, le requérant avait bénéficié de conditions de détention conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention. Quant aux transferts, ils auraient été justifiés par des raisons médicales.
82. La Cour observe qu’il ressort des documents fournis par l’administration pénitentiaire que le requérant avait subi les effets d’une situation de surpopulation carcérale sévère dans la prison de Vaslui, où il aurait disposé d’un espace individuel inférieur à 3 m² (paragraphe 33 ci‑dessus).
83. À cet égard, la Cour rappelle que l’exigence de 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective est la norme minimale pertinente aux fins de l’appréciation des conditions de détention au regard de l’article 3 de la Convention. Un espace personnel inférieur à ce minimum est à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 110 et 124, CEDH 2016).
84. Cette présomption peut être réfutée si les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont de courte durée, occasionnelles et mineures, si elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante et si les conditions de détention sont décentes et que le requérant n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (Muršić, précité, § 138).
85. En l’espèce, vu que l’incarcération du requérant dans la prison de Vaslui s’est étalée sur huit jours au total (paragraphe 33 ci-dessus), la Cour est prête à considérer cette période comme étant courte, occasionnelle et mineure au sens de sa jurisprudence. Toutefois, elle souligne que l’absence d’espace personnel suffisant à la prison de Vaslui était exacerbée par la détention dans des cellules ordinaires, inadaptées à l’état de santé du requérant, alors que les capacités physiques de celui-ci déclinaient constamment, au point qu’il était devenu, vers la fin de sa détention, aveugle, sourd et souffrant de douleurs osseuses extrêmement fortes. Par ailleurs, la Cour rappelle que les mauvaises conditions de détention et la surpopulation carcérale dans la prison de Vaslui l’ont déjà amenée à conclure à une violation de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Todireasa c. Roumanie (no 2), no 18616/13, §§ 56-63, 21 avril 2015).
86. La Cour parvient donc à la conclusion qu’en dépit de la courte durée de l’incarcération du requérant dans un espace personnel inférieur à 3 m², l’intéressé a été soumis à des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention. Elle constate par ailleurs que le Gouvernement n’a pas avancé des arguments pertinents pour réfuter la forte présomption de violation de l’article 3 concernant la détention du requérant dans la prison de Vaslui.
87. Quant à la prison de Iași, où le requérant aurait disposé d’un espace individuel compris entre 3 et 4 m² (paragraphe 33 ci-dessus), bien que cette superficie ne crée pas une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention, la Cour ne saurait ignorer que les cellules ordinaires de cette prison n’étaient pas adaptées au lourd handicap dont le requérant était porteur. De surcroît, les conditions précaires d’hygiène dans cette prison, déjà constatées par la Cour (voir, par exemple, Mazalu c. Roumanie, no 24009/03, §§ 52-54, 12 juin 2012, Olariu c. Roumanie, no 12845/08, § 31, 17 septembre 2013, et Axinte c. Roumanie, no 24044/12, § 49, 22 avril 2014), constituent en l’espèce un facteur aggravant compte tenu de l’état de santé du requérant.
Dès lors, la Cour considère que les conditions de détention dans la prison de Iași ont également soumis le requérant à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
88. La Cour note ensuite que, du 4 mars au 25 juin 2013 et du 31 août au 24 décembre 2013, date du décès du requérant à l’hôpital de Bacău, l’intéressé avait fait l’objet de dix-sept transferts d’un établissement pénitentiaire à l’autre et de sept transferts à destination des établissements de santé de Bacău, de Iaşi et de Bucarest (paragraphes 12, 18, 21, 22, 24 et 28 ci-dessus).
89. La Cour relève que, si la majorité de ces transferts étaient justifiés par des raisons médicales, elle ne saurait ignorer que ces établissements étaient éloignés les uns des autres et distants pour certains de plusieurs centaines de kilomètres.
90. Eu égard à l’état de santé du requérant, de plus en plus dégradé, la Cour estime que les changements d’établissement répétés imposés à l’intéressé ont eu des conséquences néfastes sur son bien-être. Aux yeux de la Cour, ces transferts étaient de nature à créer et à exacerber chez lui des sentiments d’angoisse quant à son adaptation dans les différents lieux de détention, à la mise en œuvre du protocole médical du traitement et au maintien de contacts avec sa famille.
91. La Cour admet que, en l’espèce, rien n’indique qu’il y ait eu intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 de la Convention (voir, entre autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999‑IX, Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 68 et 74, CEDH 2001‑III, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 160, CEDH 2016).
92. À la lumière des circonstances particulières de l’espèce, la Cour, rappelant qu’elle a déjà jugé qu’il serait souhaitable d’épargner aux détenus malades des trajets très longs et pénibles (Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 102, 30 juin 2009, et Flamînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, § 96, 12 avril 2011), estime que les nombreux transferts du requérant n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
93. S’agissant de la qualité des soins et de l’assistance fournis, la Cour rappelle d’abord que nul ne conteste la gravité de l’état de santé du requérant ni le fait que cet état n’a cessé d’empirer au fil du temps. En effet, comme il a d’ailleurs été noté par le Gouvernement dans ses observations, le requérant souffrait déjà, lors de son incarcération, le 4 mars 2013, d’une maladie fatale à court terme en raison de l’extension de celle-ci au système osseux (paragraphes 9 et 73 ci-dessus). La Cour a déjà constaté que, à l’exception des défaillances signalées par le médecin-chef du service d’oncologie de l’hôpital de Bacău, le requérant avait été traité conformément aux prescriptions des médecins (paragraphe 53 ci-dessus). Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités internes aient à aucun moment envisagé la possibilité de regrouper ces soins dans un même lieu, ce qui aurait permis d’épargner au requérant un certain nombre de transferts ou, du moins, d’en limiter le nombre et les conséquences préjudiciables pour le bien-être du malade. Par ailleurs, la Cour a déjà exprimé l’avis selon lequel, pendant les derniers stades de la maladie, où plus aucun espoir de rémission n’est permis, le stress inhérent à la vie en milieu carcéral peut avoir des répercussions sur l’espérance de vie et sur l’état de santé du détenu (voir, mutatis mutandis, Gülay Çetin, précité, § 110).
94. La Cour observe ensuite qu’il est arrivé un moment où le requérant était très sérieusement affaibli et diminué, tant physiquement que psychiquement (paragraphes 19, 20, 21 et 24 ci-dessus), de sorte qu’il ne pouvait plus accomplir les actes élémentaires de sa vie quotidienne sans assistance et qu’un détenu a été nommé pour l’assister (paragraphe 19 ci‑dessus). Or la Cour rappelle qu’elle a déjà dit douter du caractère adéquat de solutions consistant à confier à des personnes non qualifiées la responsabilité de surveiller un individu gravement malade (Gülay Çetin, précité, § 112, avec les références qui y sont citées). En l’espèce, rien ne permet de vérifier que le détenu qui avait accepté d’assister le requérant était qualifié pour accompagner un malade en fin de vie ni que l’intéressé avait reçu un véritable soutien moral ou social. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de supposer que le requérant avait bénéficié de conseils psychologiques adéquats lors de ses séjours à l’hôpital ou en prison, alors qu’il présentait un syndrome dépressif (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
95. La Cour constate donc que, au fur et à mesure que sa maladie progressait, le requérant ne pouvait plus y faire face en milieu carcéral. Il appartenait alors aux autorités nationales de prendre des mesures particulières sur le fondement de considérations humanitaires (Gülay Çetin, précité, § 113).
96. À ce dernier égard et plus particulièrement quant à l’opportunité de maintenir le requérant en détention, la Cour ne saurait substituer son point de vue à celui des juridictions internes. Cependant, force est de constater que la cour d’appel, qui a rejeté la demande d’interruption de l’exécution de la peine, n’a avancé aucun motif lié à l’éventuelle menace pour la protection sociale que la remise en liberté du requérant aurait pu présenter, eu égard à son état de santé (paragraphe 17 ci-dessus ; voir également, mutatis mutandis, Gülay Çetin, précité, § 122). Par ailleurs, la Cour note que le requérant avait été condamné pour la première fois à une peine de prison relativement faible, dont il avait exécuté un tiers (paragraphe 15 ci-dessus). Elle relève également que le requérant avait fait preuve de bonne conduite au cours du procès, qu’il avait bénéficié du régime de détention le plus favorable (paragraphes 15 et 23 ci-dessus) et que, en raison de son état de santé, le risque de récidive ne pouvait qu’être minime.
97. La Cour rappelle également que le tableau clinique d’un détenu fait désormais partie des éléments à prendre en compte dans les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment en ce qui concerne le maintien en détention des personnes atteintes d’une pathologie engageant leur pronostic vital ou dont l’état est durablement incompatible avec la vie carcérale (Gülay Çetin, précité, § 102, et la jurisprudence y citée). Or, en l’espèce, d’après le dossier, les autorités appelées à intervenir n’ont pas tenu véritablement compte des réalités imposées par le cas personnel du requérant et n’ont pas examiné l’aptitude concrète de l’intéressé à demeurer incarcéré dans les conditions de détention en cause. Bien que, dans son arrêt du 29 août 2013, la cour d’appel ait constaté que le traitement prescrit pouvait être administré au requérant en détention (paragraphe 17 ci-dessus), elle ne s’est pas penchée sur les conditions et les modalités concrètes de l’administration de ce traitement lourd dans la situation propre à l’intéressé. En effet, elle n’a pas examiné les conditions matérielles dans lesquelles le requérant était détenu et n’a pas vérifié si, compte tenu de son état de santé, celles-ci étaient satisfaisantes eu égard aux besoins spécifiques de celui-ci. De même, elle n’a pas non plus pris en compte les conditions des transferts vers les différents prisons et hôpitaux, les distances à parcourir entre ces établissements ou le nombre d’hôpitaux fréquentés par le requérant pour recevoir son traitement, ni l’impact de ces éléments combinés sur l’état déjà très vulnérable de ce dernier. Or, lorsque les circonstances sont exceptionnelles, comme l’étaient celles de la présente espèce, ces éléments auraient dû, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, être examinés par la cour d’appel pour apprécier la compatibilité de l’état de santé du requérant avec les conditions de sa détention. Aucun argument n’a été avancé selon lequel les autorités nationales étaient dans l’impossibilité de faire face à ces circonstances exceptionnelles en tenant dûment compte des considérations humanitaires impérieuses en jeu en l’espèce. En revanche, la Cour estime que les décisions des autorités nationales montrent que les procédures en cause ont été appliquées en privilégiant les formalités plutôt que les considérations humanitaires et qu’elles ont ainsi empêché le requérant, alors mourant, de vivre ses derniers jours dans la dignité (voir, mutatis mutandis, Gülay Çetin, précité, §§ 120-124).
98. En outre, la Cour a déjà constaté que la durée de la procédure engagée par le requérant afin d’obtenir l’interruption de l’exécution de sa peine pour des raisons de santé avait été trop longue compte tenu de la maladie en phase terminale dont l’intéressé souffrait (paragraphe 67 ci-dessus). De même, elle note que les réponses données par les autorités pénitentiaires, à qui le requérant avait demandé de l’aide pour obtenir sa libération, se caractérisaient par leur peu de considération pour la situation de l’intéressé (paragraphes 25 et 27 ci‑dessus).
99. La Cour rappelle enfin que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir, mutatis mutandis, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 101, CEDH 1999‑V). En l’espèce, le requérant était incarcéré alors qu’il était en fin de vie et qu’il subissait les effets d’un traitement médical lourd dans des conditions carcérales difficiles. Selon la Cour, dans un tel contexte, le manque de diligence des autorités rend la personne encore plus vulnérable et la place dans l’impossibilité de conserver sa dignité face à l’issue vers laquelle sa maladie progressait fatalement et inévitablement (voir, mutatis mutandis, Gülay Çetin, précité, § 122).
100. Après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas assuré au requérant un traitement compatible avec les dispositions de l’article 3 de la Convention et qu’elles ont infligé à l’intéressé, malade terminal, un traitement inhumain en raison de sa détention dans les conditions examinées ci-dessus.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à cet égard.
D.M. c. GRECE du 16 février 2017Requête no 44559/15
Non violation de l'article 3 car le détenu handicapé n'a pas souffert et ne s'est pas plaint des difficultés spécifiques à son handicap, en plus il y a eu une remise de la moitié de sa peine. En revanche, il n'existe en Grèce aucune juridiction pour examiner les doléances des détenus. Il y a violation de l'article 3 combiné à l'article 13.
1. Sur l’article 3 de la Convention
29. Se référant à sa version des conditions de détention, le requérant insiste sur le caractère inapproprié, à ses yeux, de ces conditions eu égard à son invalidité et à son état de santé général.
30. Renvoyant à sa version des conditions de détention, le Gouvernement réitère sa position selon laquelle les infrastructures de la prison de Nigrita et les conditions de vie du requérant sont propices à la bonne exécution de la peine de celui-ci. Selon lui, ces conditions ne dépassent pas le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention, permettant de qualifier le traitement en cause d’inhumain ou de dégradant.
31. En ce qui concerne les principes généraux d’application de l’article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente cause, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, en dernier lieu, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96‑141, 20 octobre 2016).
32. La Cour précise d’emblée qu’il lui faut limiter son examen au seul grief concernant les conditions générales de détention du requérant à la prison de Nigrita, les griefs relatifs à l’état de santé de l’intéressé ayant été rejetés au stade de la communication de l’affaire pour non-épuisement des voies de recours internes.
33. La Cour relève que, selon les informations fournies par le Gouvernement, non démenties par le requérant, la prison de Nigrita se compose de cinq ailes ayant chacune une capacité de 120 détenus. Actuellement seules trois de ces ailes sont opérationnelles et, d’après le Gouvernement, aucune d’entre elles ne connaît de dépassement de sa capacité. La Cour ne saurait mettre en doute cette affirmation. À cet égard, elle note que, selon le document adressé au Parlement par le ministère de la Justice, dans le cadre du contrôle parlementaire, relativement à la capacité de toutes les prisons sur le territoire grec et au nombre de détenus au 1er avril 2014 – date à laquelle le requérant était déjà incarcéré à la prison de Nigrita –, cet établissement, d’une capacité de 360 détenus, en accueillait 362 à cette date (paragraphe 21 ci-dessus). Elle note aussi que selon les constats du CPT, la prison de Nigrita fonctionnait à la moitié de sa capacité (paragraphe 22 ci-dessus).
34. De même, la Cour prend note des informations suivantes, également fournies par le Gouvernement : le requérant a été placé, dès le début de sa détention, dans la cellule no 9 de l’aile C, d’une superficie de 14 m², avec un autre détenu ; cette superficie inclut un espace douche/WC de 2 m² séparé par une porte ; chaque cellule est chauffée au moyen d’un chauffage central ; la lumière naturelle est assurée par une fenêtre mesurant 1 m x 1,20 m ; l’eau chaude est fournie trois fois par jour pendant une heure ; le matin, les cellules restent ouvertes de 8 heures à 12 h 30 et les cours de 8 h 30 à 12 h 15, et l’après-midi toutes restent ouvertes de 15 heures à 19 h 45.
35. La Cour constate que le requérant n’a contesté aucun de ces éléments : ses doléances, liées à son état de santé, ont trait à la compatibilité de la nourriture reçue avec ses pathologies ou à l’assistance médicale fournie.
36. Quant aux assertions du requérant concernant l’état de sa cellule et une situation de surpopulation, elle relève que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à réfuter les allégations du Gouvernement.
37. La Cour note par ailleurs qu’il ressort des documents fournis par le Gouvernement que le requérant a été transporté à plusieurs reprises à l’hôpital et a subi de nombreux examens.
38. Enfin, et à titre surabondant, la Cour observe que, alors que le requérant a demandé un nouveau calcul de sa peine le 22 août 2014, sur le fondement de l’article 105 § 7 du CP (paragraphe 7 ci-dessus), en raison de ses problèmes orthopédiques, il n’a pas sollicité sa mise en liberté conditionnelle sur le fondement de l’article 110A § 2 du CP tel que modifié par la loi no 4356/2015 (paragraphe 20 ci-dessus).
39. Eu égard à ce qui précède, la Cour n’est pas en mesure de considérer que le requérant a été détenu dans des conditions qui auraient constitué à son égard un traitement dégradant.
40. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
2. Sur l’article 13 de la Convention
41. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également d’une absence de recours effectif pour dénoncer ses conditions de détention.
42. Le Gouvernement soutient que le requérant avait à sa disposition les recours prévus par l’article 6 du code pénitentiaire (saisines du procureur superviseur de la prison et du conseil disciplinaire de la prison) et par l’article 572 du CPP (saisine du procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité). Il affirme aussi que l’intéressé pouvait se prévaloir de l’article 25 § 1 de la loi no 1756/1988 portant code des tribunaux, et il précise à cet égard que, d’après cette disposition, le procureur adjoint près la cour d’appel détaché à la prison de Trikala est chargé de veiller au respect des règles concernant le traitement des détenus et les conditions de détention en prison. Enfin, le Gouvernement ajoute que l’article 110A du CP permet à un détenu ayant un taux d’invalidité supérieur à 67 % de demander sa mise en liberté sous condition.
43. La Cour rappelle que le constat de violation d’une autre disposition de la Convention n’est pas une condition préalable pour l’application de l’article 13 (Sergey Denisov c. Russie, no 21556/13, § 88, 8 octobre 2015, et les références qui y sont citées). Dans la présente affaire, même si la Cour a finalement conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 40 ci-dessus), elle n’a pas estimé que le grief du requérant à cet égard était à première vue indéfendable (paragraphes 31 et suivants ci‑dessus). La Cour est parvenue à cette conclusion seulement après avoir examiné le bien-fondé de l’affaire. Elle considère dès lors que le requérant a soulevé un grief défendable aux fins de l’article 13 de la Convention.
44. La Cour rappelle aussi que l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. Toutefois, le recours exigé par cette disposition doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens qu’il aurait pu empêcher la survenance de la violation alléguée ou remédier à la situation incriminée, ou aurait pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 157-158, CEDH 2000‑XI).
45. En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement réitère pour l’essentiel ses arguments exposés au sujet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, notamment en ce qui concerne les recours prévus par l’article 6 du code pénitentiaire et par l’article 572 du CPP. Quant à l’article 110A du CP mentionné par le Gouvernement, la Cour relève qu’il concerne la mise en liberté sous condition, entre autres, des détenus présentant un certain taux d’invalidité, et non l’amélioration des conditions de détention de ceux-ci.
46. Partant, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue au paragraphe 27 ci-dessus, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention (voir aussi, dans ce sens, Kagia, précité, § 57).
26. S’agissant des conditions de détention, la Cour rappelle avoir conclu, dans certaines affaires (Vaden c. Grèce, no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007, et Tsivis c. Grèce, no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007), que les requérants qui n’avaient pas utilisé les recours respectivement prévus à l’article 572 du CPP et à l’article 6 du code pénitentiaire n’avaient pas épuisé les voies de recours internes. Dans ces affaires, les requérants se plaignaient de circonstances particulières qui les affectaient personnellement en tant qu’individus et auxquelles ils estimaient que les autorités pénitentiaires pouvaient mettre un terme en prenant les mesures appropriées.
La Cour rappelle cependant avoir affirmé à plusieurs reprises que, pour autant que les requérants alléguaient être personnellement affectés par les conditions générales de détention en prison – à l’instar du requérant dans la présente espèce –, l’exercice des recours fondés sur les dispositions susmentionnées n’était d’aucune utilité (voir, parmi beaucoup d’autres, Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014).
27. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter dans la présente affaire de sa jurisprudence constante à cet égard, et elle rejette donc l’exception du Gouvernement (voir, en dernier lieu, Alexopoulos et autres c. Grèce, no 41804/13 §§ 29-30, 6 octobre 2016, et Kagia c. Grèce, no 26442/15, §§ 55-56, 30 juin 2016).
GENGOUX c. BELGIQUE du 17 janvier 2017 requête 76512/11
Non violation de l'article 3 : le père du requérant a été soigné durant son incarcération et a pu rejoindre l'hôpital rapidement. Son décès n'a pas de lien avéré avec son incarcération ! Un appel devant la Grande Chambre semble nécessaire dans cette affaire.
48. En l’espèce, le Gouvernement ne conteste pas la gravité de l’état de santé du père du requérant ni le fait que cet état n’a cessé d’empirer au fil du temps jusqu’à son décès. C’est donc la question de la compatibilité de cet état de santé avec le maintien en détention de l’intéressé jusqu’au jour de son décès que pose la présente affaire (voir, par exemple, Mouisel c. France, no 67263/01, § 42, CEDH 2002‑IX, et Matencio c. France, no 58749/00, § 80, 15 janvier 2004).
49. À la lumière des principes généraux de sa jurisprudence relatifs à la détention des personnes souffrant de problèmes de santé au regard de l’article 3 de la Convention (voir notamment, Mozer, précité, §§ 177-178, et références citées) et des circonstances particulières de l’espèce, la Cour doit tenir compte notamment de trois éléments : les conditions de détention du père du requérant, la qualité des soins qui lui ont été dispensés, et l’opportunité de le maintenir en détention eu égard à son état de santé et à l’évolution qu’il pouvait présenter (Bamouhammad c. Belgique, no 47687/13, §§ 121‑123, 17 novembre 2015, et références citées).
50. La Cour constate que le requérant ne se plaint pas des modalités de la détention de son père en tant que telles. Celui-ci a été détenu la grande majorité du temps dans une cellule qu’il occupait seul et a bénéficié à partir du 24 janvier 2011 d’une cellule médicalisée.
51. En ce qui concerne le caractère adéquat ou non des soins et traitements médicaux dispensés en détention, le requérant ne conteste pas que le médecin traitant de son père, le Dr G. et le service médical de la prison ont entretenu des contacts réguliers et que l’intéressé a rencontré son médecin traitant sur une base régulière en plus des visites auprès du service médical de la prison et des hospitalisations de jour pour les cures de chimiothérapie. Il a également pu faire appel à un médecin extérieur qui a pu l’examiner et donner son point de vue.
52. Le père du requérant a bénéficié des cures de chimiothérapie prescrites entre son incarcération le 10 décembre 2010 et son décès le 16 mai 2011. Le Gouvernement reconnaît que la première cure du 30 décembre 2010 dut être reportée d’une semaine à la demande de la police qui ne pouvait pas assurer l’escorte en raison d’un mouvement de grève des agents pénitentiaires. Pour le reste, les cures qui ont suivi ont eu lieu aux dates prévues.
53. La Cour observe que le requérant n’allègue aucune conséquence particulière sur l’état de santé de son père qui aurait résulté du report d’une semaine de la cure de chimiothérapie le 30 décembre 2010 et que l’état général de son père s’est même amélioré à la suite de la chimiothérapie dont il bénéficia le 7 janvier 2011.
54. Les parties sont en désaccord sur le suivi de l’administration des médicaments prescrits au requérant pour le mois de décembre. Il semble toutefois avéré, à défaut de contestation de l’affirmation du Gouvernement à cet égard, que la distribution des médicaments était assurée nuit et jour, weekends compris, et que les médicaments prescrits le 17 décembre 2010 à visée cardiologique n’ont pas été administrés au père du requérant pour des raisons médicales. Toutefois, les autres médicaments prescrits à cette date n’ont été administrés que de manière partielle. La Cour rappelle à ce sujet l’obligation d’assurer des soins médicaux appropriés ne se limite pas à la prescription d’un traitement adéquat, il faut aussi que les autorités pénitentiaires surveillent que celui-ci soit correctement administré et suivi (Renolde c. France, no 5608/05, §§ 100-104, CEDH 2008 (extraits), et Jasińska c. Pologne, no 28326/05, § 78, 1er juin 2010).
55. Cela étant dit, en l’espèce, force est de constater que la non‑administration desdits médicaments n’a pas compromis l’effet positif des cures de chimiothérapie de décembre et janvier et qu’il n’a été fait état d’aucune infection en conséquence de l’immunodépression associée aux cures. Ce n’est qu’à partir du mois d’avril 2011 que l’état du père du requérant a commencé clairement à se dégrader. La Cour est convaincue que les autorités pénitentiaires ont fait, en réaction à cette situation, tout ce qu’il était raisonnable d’attendre d’elles, à savoir prendre contact avec le médecin traitant et transférer l’intéressé dans une structure hospitalière mieux équipée.
56. Enfin, la Cour estime déterminant, avec le Gouvernement, de constater que le père du requérant n’a pas été emporté des suites d’une infection ou d’une déficience immunitaire mais en raison des métastases provoquées par son cancer et qui préexistaient à son incarcération (voir paragraphe 39, ci-dessus).
57. En ce qui concerne enfin la question de l’opportunité de maintenir le père du requérant en détention malgré son état de santé et l’évolution qui se présentait, la Cour constate que les juridictions internes ont examiné les arguments que le père du requérant faisait valoir sur ce point. Elles sont parvenues à la conclusion qu’en raison de sa dangerosité et du risque de récidive, aucune mesure alternative n’était envisageable (voir paragraphes 28-31, ci-dessus).
58. L’intéressé s’appuyait quant à lui sur le compte rendu du 11 janvier 2011 du Dr G., son médecin traitant, et sur l’avis du 2 mars 2011 par le Dr R., médecin choisi par lui pour le consulter. Selon ce dernier avis, le maintien en détention constituait une perte de chance voire de guérison pour le requérant (voir paragraphe 19, ci-dessus). Cela étant, la Cour relève qu’aucun de ces rapports n’a fait état de contre-indication médicale s’opposant formellement au maintien du père du requérant en détention. Pendant le mois de mars 2011, celui-ci fut encore vu plusieurs fois par le Dr G., qui ne critiquait pas le maintien en détention (voir paragraphe 20, ci‑dessus). Par ailleurs, comme la Cour l’a déjà constaté ci-dessus (voir paragraphe 39), le père du requérant a reçu en prison les soins nécessités par son état et, malgré les difficultés inhérentes à la détention, les cures de chimiothérapie ont permis d’améliorer son état dans un premier temps et de le stabiliser dans un second (voir paragraphes 15 et 20, ci-dessus).
59. La Cour constate que, le 28 avril 2011, le Dr N., responsable médical de la maison d’arrêt, prit contact avec l’hôpital en signalant une altération générale de la santé du père du requérant. Le 9 mai 2011, suite à une visite d’urgence de sa collaboratrice à la prison, le Dr R. indiqua qu’eu égard à l’évolution « catastrophique » de l’état de santé du père du requérant, il était « médicalement inacceptable » qu’il restât incarcéré et qu’il devait être placé dans une structure correctement équipée (voir paragraphe 23, ci‑dessus). Le même jour, le père du requérant fut transféré à l’hôpital (voir paragraphe 24, ci-dessus). La Cour en conclut que dès le moment où la situation du père du requérant était devenue telle qu’une hospitalisation s’imposait, les autorités pénitentiaires ont pris une mesure dans ce sens.
60. Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle n’a pas de raison de se départir de l’appréciation faite par les juridictions internes. Se livrant à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, elle estime que l’on n’était pas en présence d’une situation où une bonne administration de la justice pénale commandait que soient prises d’autres mesures que celles qui furent adoptées (voir, a contrario, Raffray Taddei c. France, no 36435/07, § 59, 21 décembre 2010, G. c. France, no 27244/09, §§ 77-82, 23 février 2012, Gülay Çetin c. Turquie, no 44084/10, § 102, 5 mars 2013, et Bamouhammad, précité, §§ 124-155).
61. Partant, la Cour estime que le maintien en détention du père du requérant, nonobstant l’état de santé et l’évolution de celle-ci, n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
62. En conséquence, il n’y a pas eu violation de cette disposition en l’espèce.
W.D. c. BELGIQUE du 6 septembre 2016 requête 73548/16
Violation de l'article 3 : la détention d'un détenu qui subit des troubles psychiatriques, sans lui apporter de soins correspondants à sa maladie est un acte inhumain et dégradant qui l'empêche de retrouver une place dans la société.
101. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à la responsabilité des États de fournir des soins de santé aux personnes en détention en général et aux personnes détenues présentant des troubles mentaux en particulier énoncés dans les arrêts Bamouhammad c. Belgique (no 47687/13, §§ 115-123, 17 novembre 2015) et Murray c. Pays-Bas, [GC], no 10511/10, §§ 105-106, 26 avril 2016), respectivement.
102. En l’espèce, la Cour constate que nul ne conteste l’existence des problèmes de santé mentale du requérant, à savoir des troubles de la personnalité et une déviance sexuelle diagnostiqués par un médecin psychiatre dès 2006 et confirmés par la suite (voir paragraphes 10 et 13, ci‑dessus). Le requérant présente d’importantes déficiences mentales et est considéré par les autorités comme souffrant d’un « handicap mental » (voir paragraphe 12, ci-dessus).
103. Interné de façon continue depuis 2007 à la section de défense sociale de la prison de Merksplas, le requérant explique qu’en dehors de l’accès au service psychiatrique de la prison, aucune thérapie ni surveillance médicale particulière personnalisée ne fut entreprise à son égard. De plus, en raison des refus opposés par les établissements du circuit résidentiel et les hôpitaux psychiatriques, il subit sa détention sans perspective réaliste d’une quelconque prise en charge thérapeutique extérieure et donc sans espoir d’une réinsertion dans la société.
104. Le Gouvernement fait valoir que le requérant est placé à la section de défense sociale de Merksplas dans le pavillon De Haven où une équipe médicale est présente et où des soins sont dispensés et qu’il y bénéficie d’un encadrement approprié. Il affirme que le requérant est resté en défaut d’apporter des éléments de preuve matériels de ses allégations que ce soit dans les procédures internes ou dans le cadre de la procédure devant la Cour.
105. La Cour note que le requérant s’est référé précisément devant les instances de défense sociale et la Cour de cassation au défaut de prise en charge thérapeutique et à l’impact sur son état de l’absence de toute perspective de voir sa situation évoluer (voir paragraphes 23 et 28, ci‑dessus). Elle observe que ce constat ressort, entre autres, de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2014 qui a annulé la décision de la CSDS du 22 mai 2014 au motif que cette décision ne constituait pas une réponse suffisante aux éléments concrets apportés par le requérant à l’appui de son allégation de ne pas bénéficier d’une thérapie adaptée (voir paragraphe 26, ci-dessus).
106. De plus, la Cour rappelle avoir déjà écarté une approche formaliste (Elefteriadis c. Roumanie, no 38427/05, § 54, 25 janvier 2011) et souligné à de multiples reprises qu’il fallait, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient compatibles avec les exigences de l’article 3 dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (Claes, précité, § 93, et Murray, précité, § 106).
107. En tout état de cause, la thèse selon laquelle le requérant n’a bénéficié d’aucun traitement adapté à ses troubles mentaux pendant son internement trouve appui sur le constat unanime de l’insuffisante prise en charge des personnes délinquantes atteintes de troubles mentaux fait tant au niveau national qu’international (voir paragraphes 71-73, ci-dessus). Est dénoncée l’inadéquation des ailes psychiatriques, y compris les sections de défense sociale, comme lieu de détention des personnes atteintes de troubles mentaux en raison de l’insuffisance généralisée de personnel, de la mauvaise qualité et de l’absence de continuité des soins, de la surpopulation ainsi que du manque structurel de capacité d’accueil dans le circuit psychiatrique extérieur. La commission de surveillance de la prison de Merksplas a récemment confirmé cette analyse (voir paragraphe 76, ci‑dessus). Le CPT, le Comité contre la torture des Nations Unies et l’Observatoire international des prisons ont également réitéré, récemment, leurs préoccupations à l’égard de cette situation (voir paragraphes 73-75, ci‑dessus).
108. La thèse du requérant est en outre clairement corroborée par la circonstance que les rapports établis par les médecins et le service psychosocial n’étayent pas la nature de l’encadrement thérapeutique dont le requérant bénéficierait au pavillon De Haven et qui correspondrait au diagnostic établi. De même, devant elle, le Gouvernement reste en défaut de démontrer qu’un traitement approprié à la pathologie du requérant lui ait été prodigué. Les seuls éléments concrets dont dispose la Cour sont le suivi d’une pré-thérapie ainsi que le nombre et la fréquence des consultations en psychiatrie qui ont consisté pour la plupart à la prescription de médicaments antidépresseurs et antipsychotiques. Or, la Cour rappelle qu’il n’est guère suffisant que le détenu soit examiné et un diagnostic établi et qu’il est par contre primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mis en œuvre (Raffray Taddei c. France, no 36435/07, § 59, 21 décembre 2010, Claes, précité, § 95, et Murray, précité, § 106).
109. Le Gouvernement invite la Cour à distinguer la présente espèce des affaires Claes et Lankester précitées au motif que les conditions d’internement n’auraient pas eu d’impact sur l’état de santé du requérant.
110. À cet égard, la Cour observe qu’en 2008 le requérant suivit une pré-thérapie et que les résultats furent évalués par le service psychosocial de manière positive sur le plan de la prise de conscience de ses actes et de sa problématique (voir paragraphe 11, ci-dessus). De plus, à partir de 2010, il bénéficia de permissions de sortie qui furent aussi jugées comme ayant eu un effet positif (voir paragraphe 17, ci-dessus). Par ailleurs, la Cour observe que si, dès 2009, le requérant put bénéficier de la participation aux activités proposées par l’association ‘t Zwart Goor, il refusa de s’impliquer dans un projet dont il ne semble pas avoir compris la finalité à son égard (voir paragraphe 14, ci-dessus). La Cour relève également dans deux rapports relatifs à la problématique sexuelle du requérant établis en 2013 et 2014 que celui-ci continuait de présenter un risque de récidive très élevé étant donné ses capacités intellectuelles insuffisantes en terme de conscience de la faute et d’empathie pour les victimes (voir paragraphe 16, ci-dessus). Enfin, un récent rapport psychosocial établi le 26 octobre 2015 recommandait de supprimer les permissions de sortie après avoir constaté une rechute dans l’entretien de la correspondance avec des mineurs (voir paragraphe 18, ci‑dessus).
111. L’ensemble de ces éléments sont révélateurs, aux yeux de la Cour, de l’impact négatif d’un internement sans prise en charge thérapeutique et sans perspective de réinsertion sur l’état psychique du requérant, lequel n’a manifestement pas évolué dans la compréhension de ses problèmes et qui semble nécessiter, de manière manifestement encore plus aigüe qu’au début de la détention, un suivi particulier.
112. La Cour ne sous-estime pas les démarches entreprises par les autorités pour trouver une prise en charge externe du requérant. Ces démarches, recommandées par les professionnels qui étaient en contact avec le requérant et les instances de défense sociale (voir paragraphes 12 et 18, ci-dessus), ont été effectuées régulièrement depuis 2011 (voir paragraphes 32-34, ci-dessus). Elles n’ont toutefois donné aucun résultat en raison des refus opposés par les établissements contactés. La Cour note que cette situation, dont est victime le requérant, résulte, en réalité, d’un problème structurel. D’une part, l’encadrement médical des internés dans les ailes psychiatriques des prisons n’est pas suffisant et, d’autre part, le placement à l’extérieur des prisons s’avère souvent impossible soit en raison du manque de place ou de place adaptée au sein des hôpitaux psychiatriques soit du fait du dispositif législatif qui ne permet pas aux instances de défense sociale d’imposer le placement dans une structure extérieure qui considèrerait l’interné comme indésirable (voir paragraphes 71-73, ci‑dessus).
113. Contrairement à ce que suggère le Gouvernement, la Cour n’envisage pas d’appliquer par analogie à la situation des personnes jugées irresponsables de leurs actes la jurisprudence énoncée dans l’arrêt Vinter, et confirmé récemment dans l’arrêt Murray, précités, à propos des personnes condamnées à une peine à perpétuité. Cette jurisprudence renforce toutefois l’approche que la Cour entend faire valoir dans le contexte de l’espèce, à savoir que l’obligation découlant de la Convention ne s’arrête pas à celle de protéger la société contre les dangers que peuvent représenter les personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux mais impose également de dispenser à ces personnes une thérapie adaptée visant à les aider à se réinsérer le mieux possible dans la société. Cette double finalité est d’ailleurs au cœur du nouveau dispositif légal dont la mise en œuvre est prévue pour le 1er octobre 2016 (voir paragraphe 81, ci-dessus).
114. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter de se trouver dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention. Son maintien en aile psychiatrique sans espoir réaliste d’un changement, sans encadrement médical approprié et pendant une période significative constitue une épreuve particulièrement pénible l’ayant soumis à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
115. Quelles que soient les entraves, soulignées par le Gouvernement, que le requérant ait pu lui-même provoquer par son comportement, la Cour estime que celles-ci ne dispensaient pas l’État de ses obligations vis-à-vis du requérant. Elle rappelle que la situation d’infériorité et d’impuissance qui caractérise les patients internés dans des hôpitaux psychiatriques exige une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 82, série A no 244, et Claes, précité, § 101). Il en est d’autant plus ainsi de personnes souffrant de troubles de la personnalité et placées en milieu carcéral.
116. La Cour conclut, en l’espèce, à un traitement dégradant en raison du maintien en détention du requérant depuis plus de neuf ans dans un environnement carcéral sans thérapie adaptée à son état de santé mentale et sans perspective de réinsertion. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention
Wenner C. Allemagne du 1er septembre 2016 requête 623013/13
Violation de l'article 3 : pas de substitut d'héroïne durant son incarcération pour trafic de drogue, les autorités nationales n’ont pas étudié avec soin quelle thérapie convenait à un détenu héroïnomane de longue date
En juin 2011, alors en détention, M. Wenner sollicita auprès des autorités pénitentiaires un traitement à base de substitut à l’héroïne pour soigner sa dépendance. Il demanda, à titre subsidiaire, que la question de la nécessité d’un tel traitement de substitution fût étudiée par un spécialiste en matière de toxicomanie. M. Wenner allégua que, comme le suggérait en particulier un médecin extérieur spécialiste de la médecine interne qui l’avait examiné à la demande des autorités pénitentiaires, un tel traitement pourrait considérablement soulager ses vives douleurs chroniques d’origine neurologique, comme ce fut le cas du précédent traitement de ce type qu’il avait suivi. Les autorités pénitentiaires lui opposèrent un refus, arguant qu’un traitement de substitution n’était ni nécessaire aux fins de la loi pénitentiaire bavaroise, ni adapté à sa désintoxication. Elles avancèrent en particulier que pendant les cinq mois qu’il avait passés dans le centre de désintoxication, il n’avait pas reçu de traitement de substitution, et qu’après trois années de détention, il ne souffrait plus des symptômes physiques du sevrage.
M. Wenner attaqua cette décision, soutenant que les autorités pénitentiaires n’avaient pas examiné, en se fondant sur les critères pertinents établis dans les directives de l’ordre des médecins allemands relatives au traitement de substitution de la dépendance aux opiacés, si une thérapie de substitution était nécessaire dans son cas. En mars 2012, le tribunal régional d’Augsbourg rejeta l’appel de M. Wenner, faisant siennes les raisons qui avaient été exposées par les autorités pénitentiaires. La cour d’appel de Munich confirma cette décision et, le 10 avril 2013, la Cour constitutionnelle fédérale refusa, par une décision non motivée, d’examiner son recours constitutionnel (dossier no 2 BvR 2263/12).
Après sa remise en liberté en décembre 2014, M. Wenner fut examiné par un médecin qui lui prescrivit un traitement de substitution.
Article 3
Les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir si, dans le cas de M. Wenner, la thérapie de substitution devait être considérée comme un traitement médicalement nécessaire devant être délivré pour que l’État puisse être réputé avoir honoré son obligation, découlant de l’article 3, de veiller à ce que la santé du requérant fût assurée de manière adéquate pendant sa détention. La Cour admet que les États disposent d’une certaine marge de manoeuvre (« marge d’appréciation ») pour le choix à opérer entre différentes catégories de traitement appropriées aux pathologies des détenus. Cette marge d’appréciation vaut en principe également pour le choix entre thérapie fondée sur l’abstinence et thérapie de substitution s’agissant du traitement des toxicomanes.
La Cour a pour tâche de déterminer non pas si M. Wenner avait effectivement besoin d’une thérapie de substitution, mais si l’Allemagne a produit des éléments convaincants montrant que l’état de santé de l’intéressé ainsi que le traitement à lui administrer avaient été correctement appréciés et s’il avait par conséquent reçu un traitement médical adéquat pendant sa détention. Un certain nombre d’éléments probants montrent que le traitement de substitution pouvait être considéré comme le traitement à prescrire dans le cas de M. Wenner. Ce dernier présentait de longue date une accoutumance manifeste aux opioïdes. Comme les juridictions allemandes l’ont elles-mêmes confirmé au moment de statuer sur le recours qu’il avait formé contre la décision de le retransférer depuis le centre de désintoxication vers la prison, on ne pouvait pas escompter avec une probabilité suffisante qu’il serait possible de le guérir de sa dépendance aux stupéfiants ou de l’empêcher pour longtemps de retomber dans la toxicomanie. Avant sa détention, son accoutumance aux stupéfiants avait été traitée pendant dix-sept ans par une thérapie de substitution délivrée sur prescription médicale.
La Cour note également que selon une étude commandée par le ministère allemand de la Santé, le traitement de substitution constitue la meilleure thérapie possible pour les dépendances manifestes aux opiacés. Sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe, 41 ont mis en place des programmes de thérapie de substitution aux opioïdes et 30 procurent également ce type de traitement aux détenus. En Allemagne, cette forme de thérapie est en principe disponible en prison et elle est fournie en pratique aux détenus dans plusieurs Länder autres que la Bavière. Cette pratique est conforme aux principes énoncés par le Conseil de l’Europe sur les services de santé dans les prisons.
Tant les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) que les Règles pénitentiaires européennes posent le principe de l’équivalence des soins, qui garantit aux détenus un traitement médical dispensé dans des conditions comparables à celles dont bénéficie la population en milieu libre.
De plus, dans le cas de M. Wenner, un médecin extérieur sollicité par les autorités pénitentiaires a suggéré au service de santé pénitentiaire de reconsidérer la possibilité de lui délivrer le traitement de substitution qu’il recevait avant son incarcération. Le fait que ce type de traitement lui a été de nouveau délivré après sa remise en liberté indique également qu’il s’agissait bien de la thérapie qui lui convenait.
La Cour n’est pas convaincue par l’argument exposé par les autorités allemandes, selon lequel, au moment où M. Wenner sollicita un traitement de substitution, il n’avait pas pris ce type de traitement depuis plusieurs mois et il ne souffrait plus des symptômes physiques du sevrage. Sur ce point, la Cour note en particulier que l’état de santé de M. Wenner pendant sa détention se caractérisait par des douleurs chroniques qui étaient indépendantes des symptômes physiques du sevrage qu’il avait connus auparavant, et que la thérapie de substitution qu’il suivait précédemment avait été interrompue contre sa volonté. De plus, étant donné que de l’avis même des autorités allemandes, la thérapie fondée sur l’abstinence avait échoué, les autorités avaient à évaluer une nouvelle fois quelle thérapie convenait au cas de M. Wenner. Dans ces conditions, le refus d’un traitement de substitution ne pouvait être fondé sur l’objectif inatteignable que le requérant surmonte sa dépendance aux stupéfiants. Afin de s’assurer qu’il avait reçu le traitement médical dont il avait besoin pendant sa détention, les autorités allemandes, et en particulier les tribunaux, étaient donc tenus de vérifier promptement et avec l’aide d’un médecin indépendant qualifié pour le traitement de l’accoutumance aux stupéfiants si l’état de santé de M. Wenner était encore correctement traité sans une telle thérapie.
La Cour est par ailleurs convaincue qu’en principe, l’épreuve physique et mentale que M. Wenner a traversée du fait de son état de santé peut à elle seule satisfaire aux critères de l’article 3.
Malgré la situation et en dépit de l’obligation qu’avaient les autorités d’apprécier correctement quel était le traitement adéquat à prescrire pour la pathologie de M. Wenner, les autorités n’ont pas cherché à déterminer avec un soin particulier et en s’appuyant sur les conseils d’un médecin expert indépendant, dans l’optique d’un éventuel changement du traitement médical de M. Wenner, quelle thérapie pouvait être considérée comme adaptée à son cas. Il y a donc eu violation de l’article 3.
MEKRAS c. GRÈCE du 9 juin 2016 requête 12663/16
Violation de l'article 3, les soins médicaux ordonnés à l'hôpital, n'ont pas été donnés en prison.
30. La Cour rappelle que l’article 3 impose à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX, et Khoudobine c. Russie, no 59696/00, § 93, CEDH 2006‑XII)). Aussi la Cour a-t-elle a jugé à maintes reprises que le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, M.S. c. Royaume-Uni, précité, §§ 44 à 46, Wenerski c. Pologne, no 44369/02, §§ 56 à 65, 20 janvier 2009, et Popov c. Russie, no 26853/04, §§ 210 à 213 et 231 à 237, 13 juillet 2006).
31. En la matière, la Cour rappelle aussi que le simple fait qu’un détenu ait été examiné par un médecin et qu’il se soit vu prescrire tel ou tel traitement ne saurait faire conclure automatiquement au caractère approprié des soins administrés. En outre, les autorités doivent s’assurer que le détenu bénéficie promptement d’un diagnostic précis et d’une prise en charge adaptée, et qu’il fasse l’objet, lorsque la maladie dont il est atteint l’exige, d’une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu’à traiter leurs symptômes. Par ailleurs, il incombe aux autorités de démontrer qu’elles ont créé les conditions nécessaires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi. En outre, les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c’est-à-dire d’un niveau comparable à celui que les autorités de l’état se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population. Toutefois, cela n’implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral (Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, §§ 136-137, 23 mars 2016 avec la jurisprudence y mentionnée).
32. La Cour note d’emblée qu’à la date de son arrestation et sa mise en détention, le requérant souffrait de pancréatite aigüe (depuis 2006) et d’une hernie ombilicale et était en surpoids. Examiné par le médecin de la prison à la date de son admission, le 9 avril 2013, il a été transféré pour de plus amples examens à l’hôpital de Larissa où il a été hospitalisé du 2 au 16 juin 2013. Le 25 juin 2013, il a été transféré à la clinique chirurgicale de l’hôpital « Aghios Dimitrios » de Thessalonique, où il a été soumis, le 16 juillet 2013, à une intervention pour son hernie ombilicale. À nouveau, le 25 août 2013, suite à un malaise, il a été admis à la clinique neurologique de l’hôpital « Ippokrateio » de Thessalonique où on lui a diagnostiqué une attaque cérébrale et y est resté hospitalisé jusqu’au 30 août 2013. À sa sortie, dans une note établie par les médecins de l’hôpital, ceux-ci recommandaient un traitement pharmaceutique, des séances de physiothérapie et un contrôle régulier de sa tension artérielle et de sa glycémie. Il y était aussi précisé qu’une prescription avait été donnée au requérant pour la fourniture d’une canne spéciale à trois pieds afin de lui permettre de marcher de manière plus stable. Enfin, il ressort de la carte de santé du requérant dans la prison que du 9 septembre 2013 au 22 janvier 2014, on lui mesura la tension artérielle à 27 reprises et la glycémie à 18 reprises.
33. Il ressort donc de l’historique médical du requérant que les autorités pénitentiaires ont été réactives face à l’état de santé du requérant et ont pris des mesures afin d’assurer sa prise en charge médicale tant au moment de son admission à la prison qu’ultérieurement, pour un problème lié à son hernie, et plus tard encore, lorsqu’il a fait l’objet d’une attaque cérébrale. La Cour n’est pas en mesure d’apprécier par elle-même si la privation de liberté du requérant et les conditions de celle-ci dans la prison ont contribué à la manifestation de l’attaque du requérant. Rien dans le dossier ne permet non plus de l’affirmer.
34. Le seul point de divergence entre le Gouvernement et le requérant consiste en l’administration à ce dernier du traitement pharmaceutique prescrit par le médecin, la fourniture de la canne spéciale ainsi que des repas adaptés à sa pathologie.
35. Avant de tirer sa conclusion en ce qui concerne la qualité des soins reçus par le requérant en prison, la Cour réitère que l’article 3 ne saurait être interprété comme exigeant que chaque détenu reçoive des soins d’un niveau équivalent à celui offert « dans les meilleures cliniques privées » (Mirilashivili c. Russie (déc.), no 6293/04, 10 juillet 2007). Elle a aussi affirmé qu’elle est « prête à accepter qu’en principe, les moyens des dispensaires dans le système pénitentiaire sont limités comparés à ceux des cliniques privées » (Grishin c. Russie, no 30983/02, § 76, 15 novembre 2007).
36. D’un autre côté, elle relève que les constats du CPT concernant la prison de Diavata, lors de ses visites en 2013 et 2015 (paragraphes 24-25 ci‑dessus), ont mis en évidence les carences en encadrement médical dans cette prison depuis 2011 et qui persistent encore. En outre, elle relève aussi les commentaires quant à l’état du requérant, inscrits dans un document interne de l’hôpital « Ippokrateio » par le médecin qui devait l’examiner le 29 août 2013 (paragraphe 9 ci-dessus).
37. La Cour est consciente qu’il est difficile d’organiser pour les détenus des séances de physiothérapie au sein de la prison, d’autant plus que les carences dans la prison de Diavata se situent à un niveau d’urgence important. Il n’en reste pas moins que les séances en question étaient indispensables au requérant, ainsi qu’il ressort de la note établie par les médecins à sa sortie de l’hôpital, le 30 août 2013 (voir ci-dessus paragraphe 10). Par ailleurs, l’Etat ne saurait s’exonérer de son obligation de dispenser aux détenus le traitement pharmaceutique requis et adapté à la situation particulière de chacun. Les détenus ne doivent pas être réduits à espérer que leurs proches leur fournissent les médicaments dont ils ont besoin.
38. Quoi qu’il en soit, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant, dès son retour de l’hôpital « Ippokrateio », recevait le traitement pharmaceutique prescrit par les médecins de cet hôpital tel qu’il était indiqué dans la note informative (paragraphe 11 ci-dessus). Si le Gouvernement fournit la carte de santé du requérant qui démontre que des mesures de la tension artérielle et de la glycémie avaient lieu régulièrement, il ne donne aucune information quant à l’administration du traitement. Or, l’allégation de cette omission était aussi faite dans la demande de mise en liberté sous condition déposée par le requérant le 23 octobre 2013, dans laquelle il soulignait par ailleurs que la prison de Diavata manquait de médicaments (paragraphe 16 ci-dessus). De son côté, le procureur fondait sa proposition d’accueillir la demande du requérant sur la nécessité pour le requérant de suivre un traitement pharmaceutique, de faire des séances de physiothérapie et de se voir fournir une canne spéciale (paragraphe 17 ci-dessus). Il est donc évident que les autorités de la prison ne se sont pas conformées à toutes les recommandations des médecins ayant examiné le requérant et qui étaient aussi relevées par le procureur.
39. En conséquence de l’absence de soins médicaux adéquats, la Cour conclut que le requérant a été exposé à des souffrances mentales et physiques qui ont porté atteinte à sa dignité humaine. Le fait que les autorités ne lui ont pas dispensé une partie importante des soins médicaux dont il avait besoin et prescrits par les médecins de l’hôpital « Ippokrateio » s’analyse donc en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
RYWIN c. POLOGNE du 18 février 2016, requête 6091/06, 4047/07 et 4070/07
non violation de l'article 3, l'état de santé est compatible vec la détention alors qu'il a été incarcéré dans une prison avec une unité hospitalière et qu'ila pu sortir pour subir des opérations à l'extérieur et pour voir des spécialistes. Dès qu'il a pu avoir une libération anticipée, il l'a eue.
35. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé d’un requérant (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX).
Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peines légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, CEDH 2006-IX).
136. S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
137. Les autorités nationales doivent faire en sorte que les diagnostics et les soins médicaux dans les lieux de détention, y compris les hôpitaux de prison, répondent à l’urgence et soit effectués de manière fiable. En outre, lorsque l’état de santé l’exige, le suivi médical doit se faire à des intervalles régulières et comporter un traitement adapté, destiné à le guérir ou du moins empêcher la dégradation de cet état (Khatayev c. Russie, no 56994/09, § 85, 11 octobre 2011 ; Sakhvadze c. Russie, no 15492/09, § 83, 10 janvier 2012).
De manière générale, la Cour se reconnaît une grande souplesse pour définir le niveau requis des soins médicaux, en procédant à une appréciation au cas par cas (Lavrentiadis c. Grèce, no 29896/13, § 67, 22 décembre 2015). Ce niveau devrait être « compatible avec la dignité humaine » de chaque détenu (Papastavrou c. Grèce, no 63054/13, § 88, 16 avril 2015), mais devrait aussi prendre en considération « les exigences pratiques de l’incarcération » (Aleksanyan c. Russie, no 46468/06, § 140, 22 décembre 2008). La Cour se doit de rechercher si les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles vu la gravité de la maladie du requérant (Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 53, 12 juin 2008).
138. Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de la santé du prisonnier, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel, précité, § 40), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
139. La Cour rappelle que dans l’affaire Sakkopoulos, elle a tenu compte de trois éléments pour examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant : a) l’état de l’intéressé, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention dans ce contexte.
La Cour estime que ces critères sont pertinents dans la présente affaire.
140. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que l’incarcération du requérant, intervenue à la suite de sa condamnation par la cour d’appel de Varsovie à une peine de deux ans d’emprisonnement, se divise en deux périodes, à savoir celle du 18 avril au 31 mai 2005, d’environ un mois et demi, et celle du 2 novembre 2005 au 14 novembre 2006, d’environ une année.
141. La Cour note que, selon les rapports et certificats médicaux recueillis par les autorités, le requérant souffrait des pathologies suivantes : hypertension artérielle improprement suivie, diabète de type 2, maladie cardiaque ischémique stable (stabilna choroba wieńcowa), hernie discale, troubles du métabolisme, avec une importante obésité.
Tout au long de son incarcération, le requérant a été suivi par des médecins. À aucun moment ceux-ci n’ont suggéré que son état de santé était durablement incompatible avec la vie carcérale.
Sur la base de ces éléments, la Cour n’estime pas que les problèmes de santé susmentionnés, quoique préoccupants, fussent par principe incompatibles avec l’incarcération (Shishmanov c. Bulgarie, no 37449/02, § 44, 8 janvier 2009).
142. Quant à l’opportunité du maintien en détention, compte tenu notamment de son état de santé, la Cour note qu’à la suite des recours exercés par l’intéressé au sujet de l’application de sa peine, cette question a été examinée à plusieurs occasions par les autorités nationales. Les décisions en la matière ont été rendues sur la base des rapports médicolégaux et des certificats médicaux établis par les spécialistes extérieurs à la prison et par les membres du personnel de santé pénitentiaire.
143. La Cour observe à cet égard que, avant sa mise sous écrou, le requérant avait formulé une demande de report de peine, au motif que son incarcération présentait un risque pour sa vie et sa santé. Sa demande a été rejetée par le tribunal régional de Varsovie, au motif qu’un rapport d’expertise constatait qu’il pouvait être incarcéré dans un établissement pénitentiaire doté d’une unité hospitalière. Environ un mois et demi plus tard, la cour d’appel de Varsovie a annulé cette décision, au motif que, au vu des interventions médicales réalisées dans l’intervalle, une nouvelle évaluation de son état de santé s’imposait. La cour d’appel a ordonné que le requérant soit libéré dans l’attente de l’évaluation en cause.
Or, la Cour note qu’environ cinq mois plus tard, le requérant a été réincarcéré sans que l’on eût procédé à l’évaluation préalable, exigée par la cour d’appel, de la compatibilité de son état avec l’incarcération. Les experts appelés à se prononcer en la matière ont estimé ne pas pouvoir le faire sans coronarographie préalable. Malgré les reports subséquents par les tribunaux du délai imparti au requérant pour la présentation des résultats dudit examen, les éléments en cause n’ont pas été versés au dossier. Le requérant étant resté à plusieurs reprises en défaut de produire les éléments médicaux demandés, les juridictions ont estimé qu’il cherchait à entraver la procédure relative à l’établissement de la compatibilité de son état avec l’incarcération. Pour ordonner sa réincarcération, le tribunal a mis l’accent sur le fait que la prise en charge du requérant par les services de santé pénitentiaires permettrait l’évaluation de son état de santé.
144. La Cour relève que les rapports d’expertise et les avis médicaux recueillis par les autorités après la réincarcération du requérant indiquaient tous de façon concordante que son état de santé n’était pas incompatible avec la détention. En outre, après être initialement parvenus à la conclusion inverse, les membres du collège ont estimé qu’un examen coronarographique n’était pas nécessaire à l’évaluation de la compatibilité de son état avec l’incarcération. Les médecins pénitentiaires ont également confirmé que des soins adaptés à son état de santé lui étaient prodigués en prison.
Force est de constater que le requérant n’a produit aucun élément médical laissant apparaître une détérioration de son état de santé consécutive aux défaillances alléguées de son suivi et des soins qui lui étaient dispensés en milieu carcéral.
La Cour relève par ailleurs qu’après avoir purgé une partie de sa peine, le requérant a été admis au bénéfice de la libération anticipée.
145. Quant aux soins dispensés au requérant, la Cour note qu’en milieu carcéral, il a fait l’objet d’un suivi par le personnel de santé pénitentiaire, y compris par des spécialistes. Rien dans le dossier ne fait apparaître que les soins prodigués au requérant dans le cadre du réseau de santé pénitentiaire auraient été inadaptés à son état de santé. La Cour note plus particulièrement qu’il a subi divers examens médicaux dans le cadre du suivi de ses problèmes cardiovasculaires et de son diabète, et qu’il a été traité conformément aux prescriptions médicales des spécialistes de la clinique civile.
146. La Cour relève que, outre le traitement lui ayant été administré dans le réseau de santé pénitentiaire, le requérant a bénéficié d’un suivi par des spécialistes extérieurs à la prison. Dans ce cadre, il a subi des interventions médicales dans une clinique spécialisée dans les soins cardiovasculaires. Après son hospitalisation dans une structure de soins externe pour son angioplastie coronaire, le requérant a été admis à l’hôpital pénitentiaire.
147. Pour autant que le requérant se plaint d’avoir été surveillé par les gardiens pendant son hospitalisation hors milieu carcéral, il n’apparaît pas que ce grief ait été soulevé auprès des autorités internes.
148. En définitive, les éléments du dossier permettent de conclure que les autorités ont été attentives à l’état du requérant et que les conditions générales de sa détention ne prêtent pas à critique.
149. Compte tenu des éléments susmentionnés, la Cour rappelle qu’elle ne peut pas substituer son point de vue à celui des juridictions internes quant au maintien ou non de la détention, en particulier lorsque, comme en l’espèce, leurs décisions ont été rendues sur le fondement d’avis d’experts et que les autorités nationales ont satisfait en général à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant (Sakkopoulos, précité, § 44, Hajoł, précité, § 68).
150. Après s’être livrée à l’appréciation globale de la situation du requérant sur la base des éléments produits devant elle, la Cour conclut que les conditions de son incarcération n’ont pas constitué un traitement inhumain ou dégradant.
151. Partant, l’article 3 de la Convention n’a pas été violé.
KARAMBELAS c. GRÈCE du 15 octobre 2015 requête 50369/14
Non violation de l'article 3 la libération d'un individu malade qui doit être hospitalisé sous réserve de caution même importante est conforme à la cedh.
41. En ce qui concerne la détention de personnes malades et les soins médicaux dont elles ont besoin, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’elle les a récemment rappelés dans ses arrêts Koutalidis c. Grèce (no 18785/13, §§ 68-69, 27 novembre 2014) et Papastavrou c. Grèce (no 2) (no63054/13, §§ 87-90, 16 avril 2015).
42. La Cour note d’emblée que jusqu’en juillet 2014, la législation interne grecque ne prévoyait pas la possibilité pour les prévenus atteints de graves problèmes de santé ayant entraîné un grand taux d’invalidité de bénéficier d’une clause expresse du code de procédure pénale permettant le remplacement de la détention provisoire par des mesures moins restrictives. En juillet 2014, un amendement de l’article 282 § 4 de ce code a prévu cette possibilité.
43. Incarcéré le 10 janvier 2014, le requérant, qui souffrait d’une maladie incurable et avait une espérance de vie de six à douze mois environ selon les médecins spécialistes, fit l’objet de deux expertises médicales à la demande du juge d’instruction. Les rapports d’expertise, rendus en mars 2014, constataient l’état du requérant et considéraient que la maladie, quoique mortelle, était encore à un stade précoce et ses symptômes pouvaient être traités notamment par chimiothérapie. C’est sur le fondement de ces rapports ainsi que sur la possibilité pour le requérant de se faire traiter à l’hôpital psychiatrique de Korydallos que le juge d’instruction d’abord, et la chambre d’accusation statuant en appel par la suite, ont rejeté la demande de mise en liberté du requérant et prolongé le 7 juillet 2014 de six mois sa détention provisoire. La possibilité pour le requérant de se faire traiter à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique de Korydallos servit encore de base pour le rejet, le 6 août 2014, d’une nouvelle demande de levée de la détention.
44. Les 11 mars, 22 et 28 avril et 23 juillet 2014, le requérant a été transféré pour son suivi médical périodique, à l’hôpital Sotiria, l’hôpital où il avait subi le premier cycle de sa chimiothérapie jusqu’en mars 2014.
45. À cet égard, la Cour note que jusqu’en juillet 2014, les autorités pénitentiaires ont prodigué des soins au requérant et ont suivi les recommandations des médecins pour contrôler l’évolution de sa maladie. Quant aux expertises de juillet 2014 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour relève que les experts n’ont exigé ni que le requérant soit immédiatement soumis à une nouvelle chimiothérapie, ni qu’il soit transféré vers des hôpitaux publics extérieurs à la prison, arguant que le risque d’infections nosocomiales était aussi présent dans ces hôpitaux. Ils préconisaient, en la qualifiant de solution idéale, la levée de la détention et le retour du requérant à son domicile, solution qui n’était pas permise par le droit interne pertinent de l’époque. Deux nouveaux transferts à l’hôpital Sotiria ont eu lieu les 11 et 20 août 2014 pour des scanners du thorax et de l’abdomen.
46. Aussitôt après l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’article 282 § 4, le requérant – dont le taux d’invalidité était officiellement évalué à 85% –, sollicita (le 27 août 2014) sa mise en liberté. Sa demande fut accueillie le 2 octobre 2014 par le juge d’instruction sous condition du versement d’une caution de 150 000 euros et de l’assignation à résidence. Le requérant fit appel contre cette décision en se plaignant du montant de la caution, mais la chambre d’accusation rejeta l’appel le 19 novembre 2014, en se fondant notamment sur des considérations liées à la capacité du requérant de payer. Ce dernier n’avait d’ailleurs soulevé dans son appel aucun argument lié à son état de santé.
47. Le requérant voit dans le montant de la caution fixé une volonté du juge d’instruction de contourner l’article 282 § 4 afin de le maintenir en détention.
48. Toutefois, et dans la mesure où cet argument relève de l’article 3, la Cour observe que dans sa décision no 110/2014, la chambre d’accusation a justifié de manière détaillée et convaincante le choix du montant de la caution litigieuse. En effet, la décision précisait qu’il avait été tenu compte de la situation financière du requérant, telle qu’elle résultait des documents saisis à son domicile, des versements d’argent que celui-ci avait fait aux autres membres de son organisation criminelle, qui ne se justifiaient pas par la relation contractuelle et salariale qui les unissait, ainsi que du degré du dommage financier causé à l’Etat. La décision précisait, en outre, que le requérant n’apportait aucun élément de preuve pour démontrer son incapacité de payer cette somme ; en revanche, il ressortait du dossier qu’il n’était pas dans une telle incapacité et qu’il continuait à cacher ses revenus provenant des contrats qu’il avait conclus avec les municipalités de Pyrgos et de Kalamata. Or, la Cour note, de surcroît, que le requérant n’a apporté ni devant elle, ni devant la chambre d’accusation, aucun élément de nature à réfuter les affirmations de cette dernière. Il n’a non plus soutenu qu’il y avait détérioration de son état de santé.
49. La Cour relève subsidiairement que si l’article 282 § 4 a pour but d’éviter la dégradation de l’état de santé des prévenus gravement malades et d’écarter tout danger pour leur vie, elle accorde la discrétion au juge compétent de fixer les conditions moins restrictives que la détention qui lui paraissent appropriées à chaque cas particulier. Le versement d’une caution en fait partie. Il appartient à l’intéressé de contester son montant ou même la nécessité de l’imposer. Ce que le requérant a fait dans la présente affaire par sa demande du 16 janvier 2015, et qui a abouti à sa mise en liberté le 17 mars 2015.
50. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que les autorités ont satisfait à leur obligation positive de fournir au requérant une assistance médicale adéquate. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
LAVRENTIADIS c. GRÈCE arrêt du 22 septembre 2015 requête 22896/13
Violation de l'article 3 : La détention d'un individu cardiaque et ankylosé sans soins adéquats est incompatible avec la CEDH. Le simple fait de faire donner des médicaments par un médecin n'est pas un traitement adéquat.
i. Principes généraux
66. S’agissant de personnes privées de liberté, la Cour rappelle que l’article 3 impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis. Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, ou, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peuvent en principe constituer un traitement contraire à l’article 3. Qui plus est, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX, Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004 et Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, § 68, 27 novembre 2014)).
67. La Cour a aussi jugé que les autorités nationales doivent faire en sorte que les diagnostics et les soins médicaux dans les lieux de détention, y compris les hôpitaux de prison, répondent à l’urgence et soit effectués de manière fiable. En outre, lorsque l’état de santé l’exige, le suivi médical doit se faire à des intervalles régulières et comporter un traitement adapté, destiné à le guérir ou du moins empêcher la dégradation de cet état (Khatayev c. Russie, no 56994/09, § 85, 11 octobre 2011 ; Sakhvadze c. Russie, no 15492/09, § 83, 10 janvier 2012). De manière générale, la Cour se reconnaît une grande souplesse pour définir le niveau requis des soins médicaux, en procédant à une appréciation au cas par cas. Ce niveau devrait être « compatible avec la dignité humaine » de chaque détenu (Papastavrou c. Grèce, no 63054/13, § 88, 16 avril 2015), mais devrait aussi prendre en considération « les exigences pratiques de l’incarcération » (Aleksanyan c. Russie, no 46468/06, § 140, 22 décembre 2008).
68. Le seul fait qu’un détenu a été examiné par un médecin et s’est vu prescrire un certain type de traitement ne peut pas conduire automatiquement au constat que la prise en charge médicale a été adéquate (Hummatov c. Azerbaijan, no 9852/03 et 13413/04, § 116, 29 novembre 2007). Lorsqu’un suivi médical est rendu nécessaire par l’état de santé de l’intéressé, les autorités doivent veiller à ce que ce suivi soit régulier et systématique et soit accompagné d’une stratégie thérapeutique adéquate tendant à guérir le détenu de sa maladie ou à en prévenir l’aggravation, plutôt qu’à n’en traiter que les symptômes (ibid. §§ 109 et 114).
69. Il ne peut y avoir violation de l’article 3 du seul fait de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais qu’une telle violation peut en revanche découler de lacunes dans les soins médicaux (voir, dans ce sens, Melnik c. Ukraine, nº 72286/01, §§ 104-106, 28 mars 2006, Sakkopoulos c. Grèce, nº 61828/00, § 41, 15 janvier 2004, et Keenan c. Royaume-Uni, nº 27229/95, § 116, CEDH 2001-III). Ainsi, la Cour se doit de rechercher si les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles vu la gravité de la maladie du requérant (Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 53, 12 juin 2008).
70. La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3. La souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI).
ii. Application des principes dans le cas d’espèce
71. La Cour relève d’emblée que le requérant souffre depuis 1988 d’arthrite rhumatismale dégénérative, une maladie inflammatoire et évolutive rare, qui attaque les articulations, les os et les organes vitaux situés entre le thorax et le bassin. Elle se manifeste notamment par la déformation des os, ce qui provoque des dommages aux organes intérieurs, tels que les poumons, les reins, le pancréas et la rate. Afin de stabiliser la progression de la maladie et de limiter l’invalidité imminente, le requérant s’est soumis à plusieurs traitements entraînant divers effets secondaires.
72. En 1994, la maladie du requérant a eu une phase d’aggravation atteignant particulièrement les membres supérieurs et inférieurs. En 1995, elle avait endommagé toutes les articulations de manière irréversible, ce qui a rendu nécessaire le traitement permanent avec des médicaments cytostatiques et un suivi médical continu en raison des effets secondaires. En 2011, il a été admis à l’hôpital public Asklipieio où il a été constaté qu’il avait subi des dommages irréversibles à la colonne vertébrale et aux articulations provoquant l’impossibilité de se tenir débout et de marcher. En décembre 2012, lorsqu’il a été mis en détention provisoire dans la prison de Korydallos, le requérant présentait un taux d’infirmité permanent de 67 %.
73. La Cour reconnaît que dans le but d’assurer au requérant un environnement plus approprié à son état de santé que les cellules ordinaires de la prison, les autorités ont décidé de le placer dans l’hôpital psychiatrique de la prison, où les conditions de détention seraient, affirme le Gouvernement, meilleurs non seulement par rapport à celles de toutes les prisons du pays mais même par rapport à celles de l’hôpital de la prison de Korydallos.
74. La Cour souligne que non seulement la santé d’un détenu malade mais aussi son bien-être doivent être assurés de manière adéquate par les autorités. Toutefois, plusieurs éléments du dossier amènent la Cour à considérer que les conditions dans lesquelles le requérant a séjourné pendant dix-huit mois étaient en réalité incompatibles avec son handicap physique.
75. S’agissant de la santé et des soins médicaux, la Cour note que le Gouvernement lui-même admet que l’hôpital psychiatrique ne disposait pas d’un personnel soignant spécialisé pour faire face à des cas comme celui du requérant. Le psychiatre de l’hôpital psychiatrique de la prison, dans son rapport établi à la demande du Gouvernement, relevait que les pathologies dues à la polyarthrite rhumatoïde constituaient un problème complexe et soulignait que les diagnostics des médecins spécialistes étaient particulièrement inquiétants (paragraphe 28 ci-dessus). Si le conseil de la prison approuvait les visites des médecins extérieurs, ces derniers ne pouvaient pas faire entrer dans la prison les appareils nécessaires au traitement du requérant, tels des appareils de kinésithérapie, d’hyperthermie et de balnéothérapie. Tous les certificats médicaux établis par ces médecins attestaient de l’aggravation de sa maladie et de son état de santé en raison de nombreuses crises inflammatoires poly-articulaires et de l’impossibilité de les traiter dans l’environnement de cet hôpital et dans des conditions de détention (paragraphe 27 ci-dessus).
76. En deuxième lieu, la Cour note que le requérant ne disposait pas de son propre lieu de stockage pour les injections servant à son traitement, mais devait partager ce stock avec les détenus séropositifs de la prison de Korydallos qui étaient placés dans l’hôpital psychiatrique et dont certains tentaient d’utiliser des seringues pour s’injecter des produits toxiques. La Cour note, en outre, que les médicaments prescrits au requérant étaient des modificateurs du système immunitaire destinés à bloquer le développement des inflammations et, à ce titre, leur administration devait se faire dans un environnement protégé non partagé par des personnes ayant des maladies virales ou infectieuses.
77. S’agissant du bien-être, la Cour constate que, placé dans une cellule au troisième étage, le requérant était obligé pour faire ses besoins et se tenir propre d’être transféré aux toilettes pour handicapés qui se trouvaient au rez-de-chaussée de l’hôpital et à la salle de bain adaptée qui était située au premier étage. Or, ce transfert devait être effectué chaque fois par la cage d’escalier, sur les épaules de ses codétenus, l’ascenseur de l’hôpital lui étant inaccessible. Comme l’affirme du reste la directrice même de l’hôpital psychiatrique, « en l’absence de personnel soignant, les déplacements de l’intéressé par la cage d’escalier du bâtiment se [faisaient] sur les épaules de ses codétenus, qui l’assist[ai]ent dans la mesure du possible pour chacun d’entre eux. L’hôpital ne dispos[ait] pas de personnel pour faire face à une telle situation » (paragraphe 29 ci-dessus).
78. Dans ces conditions, la Cour considère qu’en l’espèce, les conditions de détention que le requérant a eu à endurer doivent lui avoir causé des souffrances aussi bien mentales que physiques et avoir amoindri sa dignité humaine. Ces conditions s’analysent donc en un « traitement dégradant ». Rien n’indique qu’il y ait eu de la part des autorités compétentes une intention positive d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, ainsi qu’elle l’a déjà relevé (paragraphe 70 ci-dessus), l’absence de pareille intention ne saurait exclure tout constat de violation de l’article 3.
79. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention à raison du fait que le requérant a été détenu pendant dix-huit mois dans des conditions incompatibles avec la gravité de son état de santé et de ses handicaps et n’a pas bénéficié d’une assistance adéquate et spécialisée pour pouvoir effectuer ses besoins les plus élémentaires.
MARTZAKLIS ET AUTRES c. GRÈCE arrêt du 9 juillet 2015 requête 20378/13
Violation de l'article 3 + Violation de l'article 3 et 14 : l'hôpital d'une prison est devenu un lieu de stockage des détenus qui ont le VIH et toute autre maladie considérée comme contagieuse. Cet hôpital a 60 places pour 200 détenus.
60. Le Gouvernement admet que pendant la période septembre-décembre 2011, il y a eu dans l’hôpital de la prison de Korydallos une pénurie de médicaments pour séropositifs en raison, d’une part, de l’augmentation de ce type de détenus, et d’autre part, du manque de fonds suffisants pour l’achat de ces médicaments qui sont très onéreux. Toutefois, ce problème a été résolu au début de 2012. Le suivi des détenus séropositifs se fait à des intervalles réguliers, les malades ayant besoin d’hospitalisation sont transférés dans les hôpitaux publics et les examens biologiques des séropositifs sont envoyés aux laboratoires spécialisés.
61. Le Gouvernement n’admet pas le terme de « ghettoïsation » utilisé par les requérants et explique le fait du placement des séropositifs au deuxième étage de l’hôpital Aghios Pavlos par la nécessité de mieux les suivre et les traiter, de les protéger des maladies infectieuses, de leur fournir des repas améliorés, de leur assurer de plus longues périodes de promenade et un accès à une cuisine et à des laveries réservées pour eux.
62. Les requérants se prévalent des conclusions du récent rapport du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants du 5 juillet 2013, et qui concernent plus spécifiquement les conditions de détention générales dans la prison de Korydallos et dans d’autres prisons, notamment par rapport à la surpopulation et la ségrégation dont faisaient l’objet les détenus porteurs du virus VIH. Concernant les conditions plus spécifiques régnant dans l’hôpital Aghios Pavlos de Korydallos, ils se prévalent de nombreux articles de la presse grecque qui décrivent la situation dans cet hôpital et dont l’écho a dépassé les frontières du pays. Les représentants de plusieurs partis politiques ayant effectué de nombreuses visites sur les lieux ont qualifié de choquantes les conditions qu’ils ont constatées. Même le personnel de l’hôpital avait déclaré publiquement que ces conditions étaient problématiques. Une vidéo sur les conditions de détention ayant fait l’objet d’une fuite en novembre 2014 a poussé le procureur près la Cour de cassation d’ordonner une enquête qui est actuellement en cours.
63. Les requérants produisent plusieurs articles de presse récents datant de 2013 et 2014, qui font état d’une aggravation des conditions de vie dans l’hôpital, et, en particulier, d’une augmentation du nombre de porteurs du virus VIH (128 détenus sur 209) et de nouveaux retards et interruptions dans l’administration des traitements.
64. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 3 ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier. Néanmoins, cet article impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI).
65. La Cour rappelle aussi que les autorités nationales doivent s’assurer que les diagnostics et les soins dans les prisons, y compris les hôpitaux des prisons, interviennent rapidement et soient appropriés. Elles doivent aussi s’assurer que lorsqu’il est rendu nécessaire par l’état de santé du détenu, le suivi intervienne à des intervalles réguliers et inclut une stratégie thérapeutique complète tendant à obtenir le rétablissement du détenu ou, du moins, éviter que son état ne s’aggrave (Pitalev c. Russie, no 34393/03, § 54, 30 juillet 2009). Tout en étant consciente des exigences pratiques de la détention, la Cour se reconnait suffisamment de flexibilité pour décider, au cas par cas, si les carences dans les soins médicaux ont été compatibles avec la dignité humaine du détenu (Aleksanyan c. Russie, no 46468/06, § 140, 22 décembre 2008).
66. Enfin, la Cour réitère que les informations concernant les conditions de détention, y compris les questions de soins médicaux, sont bien connues des autorités nationales. Or, les requérants peuvent rencontrer des difficultés à produire des éléments de preuve de nature à étayer leurs griefs à cet égard. Ce qui est attendu des requérants en général dans ces cas est de soumettre au moins une liste détaillée des faits dont ils se plaignent. Il incombera alors au Gouvernement de fournir des explications et des documents à l’appui de celles-ci (Salakhov et Islyamova c. Ukraine, no 28005/08, § 132, 14 mars 2013).
67. En l’espèce, la Cour note qu’il ressort des allégations des requérants notamment que ceux-ci séjourneraient dans des chambrées qui sont tellement surpeuplées que l’espace personnel de chaque détenu est de moins de 2 m², superficie incluant les lits et la toilette. Les salles d’eau ne rempliraient pas le standard minimum d’hygiène et la propreté des lieux est laissée à la discrétion de quelques détenus. La nourriture est tellement pauvre en valeur nutritionnelle que les séropositifs risquent de déclarer la maladie en raison de l’affaiblissement de leur organisme. Les lieux ne seraient pas suffisamment chauffés et les détenus seraient exposés à de basses températures surtout pendant la nuit.
68. Selon eux, les diagnostics seraient faits de manière automatique et les médecins prescriraient toujours les mêmes médicaments sans procéder à un examen individuel de chaque patient. Il n’y aurait pas de médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital, de sorte que les détenus séropositifs encourraient des risques suite à des diagnostics établis par des non-spécialistes en la matière. Les transferts vers les hôpitaux externes, en cas de besoin, seraient toujours faits avec beaucoup de retard et la distribution des médicaments prescrits à certains requérants serait souvent interrompue sans explication pour des périodes variant entre une semaine et un mois. D’autres requérants n’auraient pas encore entamé leur traitement et ce retard serait justifié par les médecins qui leur affirmeraient que « la limite [du virus dans le sang] pour rendre nécessaire le commencement du traitement aurait été augmentée ».
69. La Cour note aussi que de son côté, à part quelques affirmations générales concernant l’hôpital Aghios Pavlos de la prison de Korydallos, le Gouvernement ne réfute pas vraiment les allégations particulières des requérants.
70. La Cour ne saurait mettre en cause l’intention initiale des autorités pénitentiaires de transférer les détenus séropositifs, comme les requérants, à l’hôpital de la prison, dans le but de leur procurer un meilleur confort et un suivi régulier dans leur traitement. Elle prend note des arguments du Gouvernement selon lesquels on ne saurait qualifier la situation des requérants de « ghettoïsation » car le placement de ceux-ci à l’hôpital psychiatrique était justifié par la nécessité de mieux les suivre et les traiter, de les protéger des maladies infectieuses, de leur fournir des repas améliorés, de leur assurer de plus longues périodes de promenade et un accès à une cuisine et à des laveries réservées pour eux.
71. Si donc différence de traitement il a eu à leur égard, elle poursuivait un « but légitime » : leur offrir des conditions de détention plus favorables par rapport aux détenus ordinaires. Toutefois, une différence de traitement manque de justification objective et raisonnable si, de surcroît, il n’existe pas un « rapport raisonnable de proportionnalité » entre les moyens employés et le but visé. Si un détenu séropositif devait être séparé des autres détenus, il devrait être placé dans un endroit en adéquation avec ses besoins médicaux et son bien-être.
72. A cet égard, la Cour relève d’emblée que les requérants étaient de simples séropositifs n’ayant pas déclaré la maladie et, en tant que tels, ils n’avaient pas à être placés en isolement pour éviter la propagation d’une maladie ou pour empêcher la contamination d’autres détenus. D’autre part, la Cour attache beaucoup d’importance tant aux les constats du Médiateur de la République et aux interventions du ministre de la Justice et de la procureure près la Cour de cassation, qu’à ceux de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et du CPT (paragraphes 40-46 ci-dessus). Ces constats démontrent que les bonnes intentions des autorités ne pouvaient pas se concrétiser compte tenu de la situation régnant dans la section psychiatrique de l’hôpital de la prison. Dans son rapport du 26 octobre 2012, le Médiateur de la République relevait l’irrégularité avec laquelle les requérants recevaient leur traitement, ainsi que la difficulté de les traiter dans un endroit où le risque de transmission de maladies infectieuses était très élevé. Dans un communiqué de presse du 6 mars 2014, le Médiateur rappelait que les infrastructures étaient vétustes et totalement inadaptées, que le personnel médical était insuffisant et que la concentration des séropositifs dans une aile avait créé des conditions de « ghettoïsation et de stigmatisation » (paragraphes 40-41 ci-dessus). Pour sa part, le CPT soulignait qu’il n’y avait aucune justification relevant de la santé publique pour isoler des détenus seulement sur le fondement qu’ils étaient séropositifs.
73. Quant à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, elle relevait, en mars 2014, que l’hôpital, conçu pour 60 personnes, accueillait 200 détenus dont la plupart étaient séropositifs ou souffraient de maladies contagieuses comme la tuberculose et l’hépatite et que dans de telles conditions, il était impossible d’assurer aux détenus des soins de santé appropriés (paragraphes 44-45 ci-dessus).
74. Selon les allégations des requérants, fondées sur des articles de presse joints au dossier et non réfutées par le Gouvernement, en janvier 2014 le nombre de détenus dans l’hôpital Aghios Pavlos avait atteint 209 personnes, dont 128 porteurs du virus VIH. Les articles relevaient de nouveau des interruptions et des retards dans l’administration des médicaments.
75. Dans ces conditions, la Cour estime avérées les mauvaises conditions matérielles et sanitaires de détention à l’hôpital Aghios Pavlos ainsi que des irrégularités dans l’administration des traitements adéquats. Elle considère que les requérants ont été - et sont peut-être encore pour certains d’entre eux - exposés à une souffrance physique et mentale allant au-delà de celle inhérente à la détention. Elle conclut alors qu’ils ont subi un traitement inhumain et dégradant et que la ségrégation dont ils ont fait l’objet manque de justification objective et raisonnable car elle n’était pas nécessaire compte tenu des circonstances. Il y a donc eu violation de l’article 3 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
PAPASTAVROU c. GRÈCE du 16 avril 2015 requête 63054/13
Non Violation de l'article 3 : Le requérant ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été soigné durant sa détention !
91. La Cour relève à titre liminaire que le 10 mai 2011, alors qu’il était en détention, le requérant a subi une intervention chirurgicale de revascularisation du myocarde à l’hôpital Evangelismos d’Athènes. Dans le cadre de son suivi postopératoire – et jusqu’à la décision no 178/2013 du 9 janvier 2013 ordonnant la suspension de sa peine à condition qu’il soit hospitalisé à l’hôpital Evangelismos –, il a été soumis à plusieurs examens : le 16 octobre 2012 à l’hôpital Evangelismos, le 29 décembre 20012 à l’hôpital de Khalkida, et le 2 janvier 2013 à l’hôpital de la prison de Korydallos. Les résultats de ces examens, et notamment ceux de la scintigraphie du myocarde, n’avaient pas démontré de détérioration de son état. Aussi, seul un traitement pharmaceutique lui a été prescrit, et les médecins qui l’ont examiné n’ont pas estimé nécessaire de procéder en sus à une coronarographie comme celui-ci le demandait.
92. La décision no178/2013 du 9 janvier 2013 précitée se fondait pour l’essentiel sur le certificat établi le 5 décembre 2012 par les médecins traitants du requérant à l’hôpital Evangelismos, dont elle empruntait les termes, en indiquant que l’opération avait provisoirement pallié la maladie qui mettait la vie du requérant en danger mais que si les facteurs qui influençaient l’évolution de la maladie (alimentation, environnement stressant) n’étaient pas mis sous contrôle, le pronostic vital de celui-ci serait gravement engagé, malgré la réussite de l’opération.
93. La Cour note que cette décision – qui en tant que telle n’a fait l’objet d’aucun recours – n’a pu être exécutée, à tout le moins jusqu’au 8 août 2014, en raison des objections soulevées d’abord par les autorités pénitentiaires, puis par le procureur compétent, qui a contesté devant le tribunal correctionnel la pertinence de la référence faite par cette décision à certains jugements de condamnation comme fondement de son incarcération à l’époque concernée.
94. Toutefois, la Cour constate qu’en dépit de la non-exécution de cette décision, le requérant n’a pas été privé des soins nécessaires. Il a en effet été transféré à de nombreuses reprises vers plusieurs hôpitaux – soit des hôpitaux du système pénitentiaire, soit des hôpitaux publics, y compris parfois l’hôpital Evangelismos – dans le cadre de son suivi postopératoire et chaque fois que lui-même l’a demandé auprès des autorités.
95. Ainsi, le requérant a été admis le 2 février 2013 à l’hôpital de Khalkida ; le 12 février dans le même hôpital ; le 18 février 2013 à l’hôpital de la prison de Korydallos ; le 19 février 2013 à l’hôpital Atticon ; le 21 février 2013 à l’hôpital Thriasio ; le 22 février 2013 à l’hôpital de Nikaia ; le 12 mars 2013 à l’hôpital Evangelismos ; le 12 avril 2013 à l’hôpital Aghia Varvara ; le 21 mai 2013 à l’hôpital Evangelismos ; le 29 mai 2013 à l’hôpital de Patras ; le 30 mai 2013 au dispensaire de la prison de Patras ; le 5 juin à l’hôpital de Patras ; le 17 juin 2013 dans un hôpital de garde ; le 27 juin 2013 à l’hôpital de Patras ; le 23 juillet à l’hôpital de Patras ; le 21 août 2013 à l’hôpital Tzaneio ; le 23 août 2013 à l’hôpital Evangelismos ; le 20 novembre 2013 à l’hôpital de Patras ; le 1er décembre 2013 à un hôpital de garde ; le 10 décembre 2013 à l’hôpital de Patras ; le 12 février 2014 à l’hôpital de Patras ; le 5 mars 2014 à l’hôpital de Patras ; le 6 mai 2014 à l’hôpital Tzaneio. La Cour note que le requérant a été transféré dans l’écrasante majorité des cas dans des hôpitaux publics, extérieurs au système hospitalier pénitentiaire, hôpitaux dans lesquels il a subi des examens cardiologiques et où des traitements lui ont été administrés. Dans aucun de ces hôpitaux, les médecins qui l’ont examiné n’ont préconisé son hospitalisation au-delà du temps nécessaire pour la réalisation des examens.
96. La Cour relève en outre que le requérant a refusé à plusieurs reprises soit de poursuivre le traitement qui lui était prescrit, soit d’être transféré dans certains hôpitaux. Il en a été ainsi les 11 et 19 février 2013, les 21 et 31 mai 2013, les 10 et 11 juin 2013, le 19 juillet 2013 et les 6 mars et 29 mai 2014. Il ressort du dossier que ces refus étaient motivés non pas par des considérations médicales, mais par l’insistance du requérant pour être transféré à l’hôpital Evangelismos.
97. La Cour considère que ni la vie ni même la santé du requérant n’ont été mises en danger pendant toute la période de la non-exécution de la décision précitée. Rien ne donne à penser que son état s’était détérioré en raison de son maintien en détention ou de l’impossibilité de se faire hospitaliser pendant cinq mois à l’hôpital Evangelismos. À cet égard, la Cour relève que le 23 août 2013, le médecin traitant du requérant dans cet hôpital a affirmé, après l’avoir examiné, que son état d’appelait pas d’intervention chirurgicale.
98. En conclusion, la Cour estime que les autorités n’ont pas manqué à l’obligation de fournir au requérant une assistance médicale conforme aux exigences de son état de santé.
99. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
SANDU VOICU c. ROUMANIE du 3 mars 2015 Requête 45720/11
Violation de l'article 3 : Un détenu malade n'avait pas les soins nécessaires en prison. C'est un acte inhumain et dégradant.
SUR LA RECEVABILITÉ
32. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est du grief du requérant relatif à la qualité de l’eau et de la nourriture au sein de la prison. À cet égard, il indique que le requérant n’a jamais soulevé ce problème ni auprès de l’administration de la prison ni auprès du juge délégué chargé de la surveillance de l’exécution des peines ni auprès des autres autorités judiciaires compétentes.
33. Le requérant soutient que, en demandant l’interruption de l’exécution de sa peine au motif que son état de santé était incompatible avec l’emprisonnement, il s’est plaint aussi de toutes les insuffisances des conditions de sa détention, d’autant plus insupportables pour lui qu’il aurait souffert de différentes maladies.
34. La Cour note que, à la différence des affaires dans lesquelles les requérants dénoncent les seules conditions matérielles de détention, la présente requête porte principalement sur l’inadéquation des conditions matérielles de détention aux maladies du requérant. De ce fait, il convient d’examiner dans leur ensemble tous les aspects relevant de l’article 3 que le requérant a dénoncés (V.D. c. Roumanie, no 7078/02, § 86, 16 février 2010).
35. La Cour observe par ailleurs que le Gouvernement n’a pas indiqué de quelle manière les voies de recours qu’il a évoquées auraient pu remédier aux insuffisances que le requérant a dénoncées et qui concernent pour l’essentiel les conditions de son accueil en prison en tant que personne handicapée souffrant de plusieurs maladies invalidantes.
36. En revanche, elle observe que le requérant a bien épuisé les voies de recours susceptibles d’apporter un redressement aux problèmes soulevés par lui en formant des demandes d’interruption de l’exécution de sa peine et de prolongation de cette interruption. Estimant sa prise en charge médicale en prison insuffisante, il a de plus saisi le juge délégué chargé de la surveillance de l’exécution des peines au sujet des aspects essentiels de la requête qu’il a portée par la suite devant la Cour (voir, a contrario, la décision Matei, précitée, §§ 37-38).
37. Partant, il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
38. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
SUR LE FOND
42. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime. Elle rappelle également que, si les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrances et d’humiliations, on ne saurait toutefois considérer qu’un placement en détention pose en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention. De même, cette disposition ne peut être interprétée comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 93, CEDH 2000-XI).
43. Cela étant, l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être de la personne privée de liberté sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła, précité, § 94, et Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, §§ 55-64 et 75, 24 février 2009).
44. En l’espèce, la Cour note que, près de deux ans après son incarcération en exécution d’une peine de sept ans de prison, il a été diagnostiqué que le requérant souffrait d’un certain nombre de maladies dont une épilepsie, une hernie lombaire opérée en 2009 avec récidive en 2011, une polydiscopathie vertébrale cervicale, une gonarthrose et un diabète, et qu’il avait également été victime d’un accident vasculaire cérébral en septembre 2010.
45. S’il est vrai que ces maladies n’ont été diagnostiquées que deux ans après son placement en détention, il n’en reste pas moins qu’aucune expertise médicale qui aurait conclu à l’existence d’un lien de causalité entre l’altération de l’état de santé du requérant et des conditions de sa détention ou un traitement médical n’a été soumise à la Cour. Dès lors, eu égard aux éléments de fait figurant dans le dossier médical du requérant, la Cour ne peut ni conclure que le handicap de celui-ci a résulté de son placement en détention ni considérer que les autorités détiennent une responsabilité à cet égard (Flămînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, § 84, 12 avril 2011). Cela étant, elle examinera le respect par les autorités de leur obligation positive de garantir le suivi et le traitement médical prescrits par les médecins au requérant ainsi que des conditions de détention compatibles avec l’état de santé de l’intéressé.
46. La Cour note que le requérant, dont la colonne vertébrale nécessitait une intervention chirurgicale, a demandé et obtenu deux fois, pendant dix mois au total et, la dernière fois, de mai à août 2010, l’interruption de l’exécution de sa peine pour raisons de santé. Par la suite, ses demandes de reconduction de l’interruption et ses contestations relatives à une insuffisance des soins médicaux en prison ont été rejetées au motif qu’il n’avait pas saisi l’opportunité de l’interruption de l’exécution de sa peine qui lui avait déjà été accordée pour se faire opérer. Or la Cour note qu’il ressort du dossier médical du requérant que l’opération n’a pas pu être réalisée pour une raison qui ne lui était pas imputable, à savoir le fait qu’il n’était pas suffisamment remis de l’opération précédente. Elle estime dès lors qu’il s’agissait d’une impossibilité objective de pratiquer cette intervention chirurgicale pendant la dernière période d’interruption de sa peine.
47. La Cour constate, au demeurant, qu’il ressort des documents présentés par le Gouvernement que le requérant n’a été hospitalisé pour recevoir les soins recommandés par les médecins – notamment des soins de rééducation après son opération chirurgicale de la colonne vertébrale – que pendant l’année 2011, alors que sa première intervention chirurgicale à la colonne vertébrale remontait à 2009 et qu’elle aurait dû être suivie par des séances de rééducation.
48. Qui plus est, il ressort également du dossier qu’en raison de son invalidité les médecins lui ont prescrit une aide permanente à la personne, mais qu’il n’a reçu qu’une aide ponctuelle pour le déplacement de ses effets personnels. La Cour ne peut se satisfaire des explications avancées par le Gouvernement à cet égard (paragraphe 41 ci-dessus). Elle estime que les autorités responsables de la prison auraient dû réagir promptement afin de pallier les défaillances physiques du requérant en respectant les recommandations des médecins et en lui assurant une prise en charge appropriée eu égard à son état de santé.
49. En outre, la Cour observe que les souffrances du requérant liées à sa pathologie ne pouvaient qu’être exacerbées par les conditions de sa détention dans les cellules de la prison de Jilava qu’il partageait avec une vingtaine de personnes et dans lesquelles chaque détenu ne disposait que d’un espace compris entre 1,70 et 2,30 m² selon les informations du Gouvernement (paragraphe 7 ci-dessus).
50. La Cour estime que ces conditions, réputées inadéquates pour toute personne privée de sa liberté, ne pouvaient l’être que davantage encore pour une personne malade comme l’était le requérant (Parascineti c. Roumanie, no 32060/05, § 53, 13 mars 2012).
51. De plus, la Cour estime que sa détention dans des cellules ordinaires et non pas dans une infirmerie ou dans une pièce plus adaptée à son état de santé a pu concrètement mettre le requérant en situation de dépendance et d’infériorité par rapport à ses codétenus en bonne santé, et qu’elle a porté atteinte à sa dignité et constitué une épreuve considérable, source d’angoisses et de souffrances allant au‑delà de celles que comporte inévitablement toute privation de liberté (Kaprykowski c. Pologne, no 23052/05, §§ 71-76, 3 février 2009, et Vincent c. France, no 6253/03, §§ 100-103, 24 octobre 2006).
52. Eu égard à la situation particulière du requérant, la Cour considère que celui-ci n’a pas bénéficié des conditions matérielles de détention adaptées à son handicap. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention.
HELHAL c. FRANCE du 19 février 2015 requête 10401/12
Article 3 : Les centres de détention français doivent être adaptés pour recevoir les handicapés. Le manque d'adaptation a fait subir au requérant des actes dégradants et inhumains au delà de la souffrance occasionnée par une détention.
a) Principes généraux
i. Obligations de soins
47. La Cour renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle le devoir de soigner la personne malade au cours de sa détention met à la charge de l’État les obligations particulières suivantes : veiller à ce que le détenu soit capable de purger sa peine, lui administrer les soins médicaux nécessaires et adapter, le cas échéant, les conditions générales de détention à la situation particulière de son état de santé. Ces obligations sont rappelées très clairement dans son arrêt Xiros c. Grèce (no 1033/07, § 73, 9 septembre 2010 ; voir, plus récemment, l’arrêt Ürfi Çetinkaya c. Turquie, no 19866/04, §§ 87 à 92, 23 juillet 2013) et peuvent être ainsi résumées.
48. Quant à la première obligation, dans un État de droit, la capacité à subir une détention est la condition pour que l’exécution de la peine puisse être poursuivie. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner, la Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer. Partant, dans des cas exceptionnels où l’état de santé du détenu est absolument incompatible avec sa détention, l’article 3 peut exiger la libération de la personne concernée sous certaines conditions (Xiros, précité, § 74).
Concernant la deuxième obligation, le manque de soins médicaux appropriés peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3. La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière. La diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3. En particulier, ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état particulier de santé du détenu. En général, la dégradation de la santé du détenu ne joue pas en soi un rôle déterminant quant au respect de l’article 3 de la Convention. La Cour examine dans chaque cas si la détérioration de l’état de santé de l’intéressé était imputable à des lacunes dans les soins médicaux dispensés (idem, § 75).
Pour ce qui est de la troisième obligation, la Cour exige que l’environnement carcéral soit adapté, si nécessaire, aux besoins spéciaux du détenu afin de lui permettre de purger sa peine dans des conditions qui ne portent pas atteinte à son intégrité morale (idem, § 76).
ii. Détenus handicapés
49. Un lourd handicap physique est une situation, à l’instar de l’état de santé et de l’âge, pour laquelle la question de la capacité à la détention est posée au regard de l’article 3 de la Convention (Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002‑IX ; Matencio, précité, § 76).
50. Lorsque les autorités nationales décident de placer ou de maintenir en détention une personne invalide, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques de son infirmité (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 25, CEDH 2001‑VII ; Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 56, 2 décembre 2004 ; Zarzycki c. Pologne, no 15351/03, § 102, 12 mars 2013).
51. La détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer par ses propres moyens, et en particulier quitter sa cellule, et qui a duré longtemps, constitue un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention (Vincent, précité, § 103 ; Cara-Damiani c. Italie, no 2447/05, § 72, 7 février 2012).
52. S’il est vrai que la Convention ne garantit pas en soi un droit à une assistance sociale, l’Etat ne peut s’exonérer de son obligation d’assurer des conditions de détention devant répondre aux besoins spécifiques des détenus handicapés en transférant la responsabilité de leur surveillance ou de leur assistance à des codétenus (Kaprykowski c. Pologne, no 23052/05, § 74, 3 février 2009 ; Grimailovs c. Lettonie, no 6087/03, § 161, 25 juin 2013 ; voir enfin, l’arrêt Semikhvostov c. Russie, no 2689/12, § 85, 6 février 2014, dans lequel il est fait mention du risque de stigmatisation des détenus handicapés en cas d’assistance dans les activités de la vie quotidienne par des codétenus). Dans certains cas, dépendre de l’aide de codétenus pour aller aux toilettes, se laver, s’habiller ou se déshabiller peut s’avérer rabaissant ou humiliant (voir, la jurisprudence citée dans l’arrêt Zarzycki, précité, § 104; D.G. c. Pologne, no 45705/07, § 147, 12 février 2013). L’accès aux installations sanitaires soulève un problème particulier sous l’angle de l’article 3 de la Convention (D.G, précité, §§ 147 et 150 ; Semikhvostov, précité, § 81).
b) Application en l’espèce
53. La Cour observe tout d’abord qu’il n’est pas contesté que le requérant présente un handicap qui le contraint à se déplacer principalement en chaise roulante même s’il semble qu’il puisse parfois se déplacer avec des cannes ou un déambulateur (paragraphe 10 ci-dessus). Il y a donc lieu d’examiner le grief du requérant à la lumière des principes rappelés ci-dessus, régissant les obligations de soins de l’Etat à l’égard des personnes handicapées, eu égard à leur vulnérabilité face aux difficultés de la détention.
i. Le maintien en détention
54. La Cour rappelle que les experts désignés dans le cadre de la demande de suspension de peine ont considéré que l’état de santé du requérant était compatible avec la détention à condition qu’il puisse bénéficier des soins de kinésithérapie au quotidien. L’un d’eux a précisé dans ses conclusions qu’une prise en charge kinésithérapique n’était pas possible au centre de détention d’Uzerche (paragraphe 10 ci-dessus). Par la suite, les juridictions de l’application des peines ont considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une suspension de peine tout en prenant soin d’indiquer que le centre de détention dans lequel il se trouvait n’était pas adapté à sa situation. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi du requérant non admis.
55. Au vu de ce qui précède, la Cour constate qu’il n’a pas été exclu que
le requérant puisse bénéficier des soins de kinésithérapie en milieu carcéral (voir, a contrario, Cara-Damiani précité, § 74). La Cour observe qu’il a été tenu compte du handicap du requérant dans l’appréciation de sa demande de suspension de peine. En effet, celle-ci a été refusée sur le fondement de rapports d’expertise concluant de manière concordante que l’état de santé du requérant n’était pas durablement incompatible avec la détention sous réserve qu’il puisse bénéficier des soins kinésithérapiques et accéder à une salle de sport. En outre, le tribunal a relevé que le centre de détention d’Uzerche ne correspondait manifestement pas aux critères requis pour un régime de détention du requérant, tant sur le plan des locaux que sur celui des soins para médicaux (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). La Cour note à cet égard les évolutions du droit national et de la réflexion d’organes officiels sur la nécessaire prise en compte du handicap dans les demandes de suspension de peine (paragraphes 27, 28, 29 et 30 ci-dessus). Enfin, elle relève qu’il ne ressort pas du dossier que la santé du requérant se soit détériorée durant sa détention ou que son incapacité se soit aggravée du fait des conditions de détention. A la lumière notamment du rapport de visite au centre de détention d’Uzerche établi par le CGLPL (paragraphe 33 ci‑dessus), qui n’est pas consacré à la situation des personnes handicapées, il n’apparaît pas que ces conditions sont telles qu’elles ont pu rendre le maintien en détention du requérant incompatible avec l’article 3 de la Convention. De plus, si l’état de santé du requérant venait à s’aggraver, le droit français lui offre la possibilité de faire une nouvelle demande de suspension de peine pour motif médical, mécanisme que le législateur a récemment assoupli afin d’en faciliter l’usage (voir paragraphes 27 et 28 ci‑dessus).
Ce n’est donc pas la question de la capacité du requérant à purger sa peine que pose la présente affaire mais celle de la qualité des soins dispensés, et notamment celle de savoir si les autorités nationales ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour lui prodiguer la rééducation dont il avait besoin et lui offrir une chance de voir son état s’améliorer.
ii La qualité des soins
56. La Cour observe qu’il n’y a pas de désaccord entre les parties sur la diligence et la fréquence des soins médicaux apportés au requérant depuis son transfert au centre de détention d’Uzerche, comprenant l’accès à des consultations spécialisées (paragraphes 16 et 19 ci-dessus), y compris sur la fourniture du matériel médical, à l’exception de l’appareil d’électro stimulation que le requérant affirme ne pouvoir acquérir en raison du blocage de l’administration. Sur ce seul point, la Cour ne dispose pas d’allégation étayée, en particulier sur la raison opposée au requérant par les autorités compétentes pour refuser qu’il se procure lui-même cet appareil, ce qu’il semble pouvoir faire (paragraphes 16 et 22 ci-dessus) en l’absence de doléance de sa part quant à la prise en charge de cet appareil par la Sécurité sociale (a contrario, voir, par exemple, V.D. c. Roumanie, no 7078/02, §§ 94 à 96, 16 février 2010). Compte tenu de ces circonstances, la Cour n’est pas en mesure de prendre position sur ce point.
57. Quant aux soins de kinésithérapie prescrits par l’ensemble des médecins ayant examiné le requérant, la Cour observe qu’ils ont tous préconisé une rééducation journalière et un accès à une salle de sport. Or, le requérant n’a pu bénéficier d’aucun soin paramédical de ce type jusqu’en septembre 2012, soit pendant plus de trois ans à compter de son incarcération au centre de détention d’Uzerche, faute de personnel qualifié au sein de l’établissement. En outre, l’accès à la salle de sport lui était malaisé, celle-ci étant inaccessible en fauteuil roulant comme le précise le Gouvernement. La Cour rappelle que la demande de suspension de peine a été rejetée sous réserve de la délivrance de soins de kinésithérapie appropriés à l’état de santé du requérant, et qu’il a été précisé à ce moment‑là par les juridictions nationales que ces soins ne pouvaient être prodigués au centre de détention d’Uzerche, mais dans d’autres établissements pénitentiaires (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). Les médecins de l’UCSA ont souligné que la rééducation devait se faire dans un milieu spécialisé (paragraphe 21 ci‑dessus). La Cour n’est pas en mesure d’apprécier l’adéquation ou non du milieu carcéral ordinaire, hors hospitalisation (paragraphe 31 ci-dessus), à la thérapie préconisée mais elle se doit de vérifier que des mesures ont été prises par les autorités pénitentiaires pour offrir au requérant les soins prescrits par les médecins.
58. À cet égard, elle rappelle tout d’abord qu’aucun kinésithérapeute n’est intervenu au sein du centre de détention d’Uzerche de 2009 à septembre 2012. Il ressort des informations données par le Gouvernement que la directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire a alerté à plusieurs reprises les autorités de santé compétentes pour qu’elles mettent fin à la carence des soins de kinésithérapie au sein de ce centre (paragraphe 17 ci-dessus), mais force est de constater que cet appel est resté sans réponse pendant plus de trois ans. La Cour observe que si la responsabilité d’assurer la présence d’un kinésithérapeute au sein de cette prison relève d’une administration différente de l’administration pénitentiaire, cela ne peut justifier un tel délai d’inertie et n’exonère en tout état de cause pas l’État de ses obligations à l’égard du requérant.
Par ailleurs, la Cour observe que le Gouvernement n’a pas démontré qu’une solution ait été recherchée pour que le requérant puisse être transféré dans une autre prison ou en milieu spécialisé. Elle ne saurait valider l’argument du Gouvernement selon lequel l’absence d’un tel transfert, en particulier vers le centre de détention de Roanne, serait entièrement imputable au requérant. Certes, l’affirmation de ce dernier selon laquelle il n’aurait pu y bénéficier des soins nécessaires ne peut être regardée que comme une spéculation ; les observations des parties sur ce point diffèrent sensiblement puisqu’elles évoquent la situation de cet établissement à des époques différentes (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). De même, il est exact que le requérant n’a pas formellement demandé son transfert, mais, selon le Gouvernement, renoncé à en faire la demande, d’abord parce que, en juin 2010, « sa principale motivation concernait la jurisprudence des autorités judiciaires s’agissant des demandes d’aménagement des peines et non les soins dont il pourrait bénéficier », ensuite pour des raisons confuses en août 2011 (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, la Cour estime que ce renoncement n’est pas synonyme d’un renoncement aux soins : elle rappelle que le requérant attendait en août 2011 l’aboutissement de son recours judiciaire pour obtenir une suspension de peine, ce qui peut expliquer qu’il n’ait pas entamé de démarches auprès des autorités pénitentiaires à ce moment-là. Par ailleurs, si l’article D. 360 du CPP énonce que le détenu peut solliciter un transfert vers un centre de détention plus adapté à son état de santé, il prévoit avant tout que la responsabilité d’un tel transfert incombe au directeur interrégional de l’administration pénitentiaire qui procède à l’intérieur de sa région à « tout transfèrement vers un établissement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d’être pris en charge dans de meilleures conditions » (paragraphe 32 ci-dessus). Or, il ne ressort pas du dossier qu’une mesure spécifique quelconque ait été prise pendant tout ce laps de temps ou qu’une solution ait été cherchée pour que le requérant puisse bénéficier de séances de kinésithérapie adaptées à son état, malgré les recommandations répétées des médecins de l’UCSA de le prendre en charge dans un environnement spécialisé (paragraphe 21 ci‑dessus). Le seul comportement du requérant, qui semble avoir été réticent à un éventuel transfert, en raison notamment de l’éloignement familial (paragraphe 25 ci-dessus), ne saurait justifier l’inertie des autorités pénitentiaires et sanitaires qui n’ont pas su coopérer (paragraphe 31 ci‑dessus) pour lui assurer les soins dont l’exigence avait été formulée par les médecins qui l’avaient examiné. La Cour relève d’ailleurs que ceux dont il a bénéficié depuis le mois de septembre 2012 se limitent à une séance hebdomadaire de quinze minutes (paragraphe 21 ci-dessus).
iii Les conditions de détention
59. Le centre pénitentiaire d’Uzerche dispose d’une cellule pour les détenus invalides, située au rez-de-chaussée, à proximité de l’unité de consultation et de soins, de la cantine, des parloirs, de l’accès à la promenade et du secteur socio-éducatif. La Cour relève qu’elle n’est pas saisie de doléances sur l’aménagement de la cellule du requérant et que celle-ci permet le passage d’un fauteuil roulant (a contrario, Vincent précité, §§ 101 et 102). De même, le requérant n’exprime pas de souffrance quant à ses déplacements dans les différentes ailes du bâtiment et la Cour observe que celui-ci est équipé d’un ascenseur qu’il peut utiliser à l’occasion (voir, a contrario, Arutyunyan c. Russie, no 48977/09, §§ 78-79, 10 janvier 2012). Même s’il ne ressort pas du dossier que le requérant sorte souvent de sa cellule, la Cour ne peut déceler dans ses écritures de problèmes particuliers concernant ses déplacements dans l’établissement qui atteignent le seuil de gravité nécessaire pour que l’article 3 entre en jeu, y compris quant à l’accès à la promenade et à l’air libre.
60. La Cour doit encore examiner la partie du grief concernant les fouilles auxquelles le requérant a été soumis ainsi que les mesures prises lors des extractions médicales qui constituent, selon le requérant, des humiliations à répétition, ainsi que l’accès aux douches et l’organisation de la dépendance du requérant.
61. S’agissant en premier lieu des fouilles corporelles, et des mesures de sécurité imposées lors des transferts du requérant à l’hôpital, la Cour souligne que le requérant ne s’en était pas plaint dans son formulaire de requête initiale et que cette question n’a été soulevée que dans ses observations, auxquelles le Gouvernement a répliqué en apportant des précisions sur leur fréquence et leur motif (paragraphe 20 ci-dessus). Elle a déjà reconnu que des mesures de cette nature peuvent atteindre le seuil de gravité requis par l’article 3 pour constituer un traitement dégradant ou inhumain (Khider, précité; El Shennawy c. France, no 51246/08, 20 janvier 2011 ; Duval, précité), mais elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort en effet des observations complémentaires du Gouvernement sur ce point que les fouilles n’ont pas été systématiques mais qu’elles ont été pratiquées à des moments précis de la détention du requérant et, pour certaines d’entre elles, ont concerné l’ensemble de la population carcérale de l’établissement. Par ailleurs, seules deux décisions de fouilles lors d’extractions médicales sont produites au dossier. Eu égard aux justifications apportées par le Gouvernement sur ces mesures ponctuelles (paragraphe 20 ci-dessus), qui ne visaient pas toujours le seul requérant, la Cour est d’avis, malgré leur caractère éprouvant, qu’elles n’apparaissent pas atteindre le seuil de gravité nécessaire pour que l’article 3 entre en jeu. La Cour observe à ce titre que les conditions de transfert et les modalités des fouilles dénoncées en l’espèce n’ont pas de commune mesure avec celles observées dans d’autres affaires comparables (Duval et El Shenawy précités ; Mouisel, précité, §§ 46 et 47 ; Henaf c. France, no 65436/01, §§ 54 à 58, CEDH 2003‑XI).
62. S’agissant en second lieu de l’accès aux sanitaires, et plus précisément à la douche, celle-ci ne se situant pas dans la cellule, la Cour relève que le requérant se plaint de ne pouvoir y accéder seul, mais uniquement avec l’aide d’un codétenu, et que cette dépendance l’expose à des situations humiliantes vis-à-vis de cet auxiliaire et des autres détenus du fait de son incontinence. La Cour ne dispose pas d’information sur la situation exacte des douches, ni sur la fréquence avec laquelle le requérant peut s’y rendre. Toutefois, il n’est pas contesté par le Gouvernement que celui-ci ne peut s’y rendre seul (paragraphe 23 ci-dessus) et qu’elles ne sont pas aménagées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. En outre, il se déduit de l’état du requérant que le détenu en charge de l’assister quotidiennement selon le Gouvernement (paragraphe 42 ci-dessus) doit l’aider à réaliser sa toilette. Cette situation, où l’accès aux douches n’est pas adapté à l’utilisation d’un fauteuil roulant, et où le requérant doit compter sur un détenu auxiliaire pour se laver, a été jugée inacceptable par le CGLPL (paragraphe 29 ci-dessus). Par ailleurs, si le législateur a ouvert en 2009 la possibilité à toute personne détenue se trouvant dans une situation de handicap de désigner un aidant de son choix (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour observe qu’une telle mesure, à supposer que les conditions de ce choix aient été remplies en l’espèce, n’est pas suffisante en l’espèce pour répondre aux besoins du requérant qui vit difficilement le moment de la douche, compte tenu de son incontinence, du manque d’intimité et du rôle d’assistance confié au codétenu (voir, mutatis mutandis, D.G, précité, § 177). Il ne ressort en effet du dossier ni que cette aide constitue un complément à la prise en charge du requérant par des professionnels de santé ni que le détenu désigné pour l’assister ait reçu la formation nécessaire à la pratique des gestes requis pour une personne invalide. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a, à plusieurs reprises, estimé que l’assistance d’un codétenu, même volontaire, ne signifie pas que les besoins spéciaux du requérant sont satisfaits et que l’Etat s’est acquitté à cet égard des obligations lui incombant au titre de l’article 3 de la Convention. Elle a souligné qu’elle ne pouvait approuver une situation dans laquelle le personnel d’une prison se dérobe à son obligation de sécurité et de soins vis-à-vis des détenus les plus vulnérables en faisant peser sur leurs compagnons de cellule la responsabilité de leur fournir une assistance quotidienne ou, le cas échéant, des soins d’urgence ; cette situation engendre de l’angoisse et les place dans une position d’infériorité vis-à-vis des autres détenus (Farbtuhs, précité, § 60 ; D.G. précité, § 147).
iv. Conclusion
63. En définitive, la Cour est d’avis que le maintien en détention du requérant n’est pas incompatible en soi avec l’article 3 de la Convention mais que les autorités nationales ne lui ont pas assuré une prise en charge propre à lui épargner des traitements contraires à cette disposition. Compte tenu de son grave handicap, et du fait qu’il souffre d’incontinence urinaire et anale, la période de détention qu’il a vécue sans pouvoir bénéficier d’aucun traitement de rééducation, et dans un établissement où il ne peut prendre des douches que grâce à l’aide d’un codétenu, sont des circonstances qui l’ont soumis à une épreuve d’une intensité qui a dépassé le niveau inévitable de souffrances inhérentes à une privation de liberté. Ces circonstances constituent un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention et emportent violation de cette disposition. L’absence d’éléments laissant penser que les autorités aient agi dans le but d’humilier ou de rabaisser le requérant ne change en rien ce constat (Farbtuhs, précité, §§ 50 et 60).
ARRÊT VINCENT c. FRANCE du 24 octobre 2006 Requête no 6253/03
"94. La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III, et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004).
95. La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (arrêts Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002-IX et Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004).
96. Ainsi, en procédant à l’examen de l’état de santé du prisonnier et aux effets de la détention sur son évolution, la Cour a considéré que certains traitements enfreignent l’article 3 du fait qu’ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (arrêt Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Dans l’arrêt Price c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que le fait d’avoir maintenu en détention la requérante, handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII).
97. En recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera notamment si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (arrêts Peers c. Grèce, précité, §§ 67-68 et 74, CEDH 2001-III et Price c. Royaume-Uni, précité, § 24).
98. La Cour a par ailleurs affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94, et Mouisel c. France, précité, § 40).
99. Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 94, CEDH 2000-VII,, Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004, § 112 et Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004).
100. Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention pendant quatre mois dans un établissement où il ne pouvait circuler seul et celle de savoir si cette situation a atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
101. La Cour constate que requérant et Gouvernement s’accordent sur le fait que la maison d’arrêt de Fresnes, établissement fort ancien, est particulièrement inadaptée à la détention de personnes handicapées physiques, tel le requérant qui ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant.
Si des cellules ont été aménagées au plan du mobilier et des sanitaires, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le requérant ne pouvait ni quitter sa cellule, ni se déplacer dans l’établissement par ses propres moyens.
102. Le fait que, pour passer des portes, le requérant ait été contraint d’être porté pendant qu’une roue de son fauteuil était démontée, puis remontée après que le fauteuil eut été passé l’embrasure de la porte peut en effet être considéré comme rabaissant et humiliant, outre le fait que le requérant était entièrement à la merci de la disponibilité d’autres personnes.
En outre, le requérant a vécu dans ces conditions pendant quatre mois, alors que la situation avait été constatée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et un médecin (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus), que de nombreux autres établissements pénitentiaires existent dans la région parisienne et que le Gouvernement ne soutient pas que des raisons impérieuses nécessitaient son maintien à Fresnes.
103. En l’espèce, rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, la Cour estime que la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer et en particulier quitter sa cellule, par ses propres moyens constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention. Dès lors, elle conclut pour cette raison à la violation de cette disposition en l’espèce, les autres griefs du requérant relatifs à ses conditions de détention dans la maison d’arrêt de Fresnes n’apparaissant pas aux yeux de la Cour, pour leur part, comme atteignant le seuil de gravité nécessaire pour que l’article 3 entre en jeu."
ARRET XIROS CONTRE GRECE DU 09/09/2010 REQUETE 1033/2007
Le requérant, Savvas Xiros, est un ressortissant grec né en 1962 et actuellement incarcéré à la prison de Korydallos (Grèce). En 2002, il fut grièvement blessé par l’explosion d’une bombe qu’il tenait entre ses mains, lors des préparatifs d’un attentat. Après avoir été hospitalisé 65 jours en soins intensifs, il fut placé en détention provisoire. Les 8 et 17 décembre 2003, la Cour d’Assises d’Athènes le condamna six fois à la réclusion à perpétuité et à 25 ans de prison ferme pour appartenance à un groupe terroriste nommé « 17 novembre » et participation à ses actes criminels. Il conserve diverses séquelles de l’explosion, dont une main amputée, des problèmes graves de vue, d’ouïe et kinésiques.
Des soins médicaux sont prodigués à M. Xiros depuis le début de sa détention. Concernant sa vue, il a subi quatre opérations entre 2002 et 2004. En 2005, le directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital de Penteli constata une dégradation de son acuité visuelle et estima qu’un suivi médical systématique, fréquent et global était nécessaire pour empêcher une dégradation dramatique de la vue de l’intéressé, ce qui exigeait son hospitalisation en centre ophtalmologique spécialisé. Des examens pratiqués à l’Hôpital général d’Athènes en 2005 et 2006 conclurent en revanche que sa vue était stable. Concernant ses autres problèmes de santé, M. Xiros bénéficia de divers examens et traitements, n’exigeant pas d’hospitalisation prolongée.
Pendant les six premiers mois de sa détention et en raison de son état de santé, M. Xiros partagea sa cellule avec son frère, également condamné pour appartenance à l’organisation terroriste « 17 novembre ». Ce dernier l’assistait dans l’accomplissement de ses besoins quotidiens. Depuis la fin de cette période, M. Xiros est incarcéré dans une cellule individuelle de 12 m² environ. Il est assisté au quotidien, le cas échéant, par le personnel de la prison et des codétenus. Il bénéficie de toilettes et douches séparées dans sa cellule, par ailleurs équipée de chauffages. Il a accès à une cour intérieure pour huit à neuf heures par jour.
M. Xiros exerça plusieurs recours contre sa détention, motivés par son état de santé. En particulier, en mai 2006 il saisit le tribunal correctionnel du Pirée d’une demande de suspension de sa détention, afin d’être hospitalisé dans en centre ophtalmologique spécialisé. Le tribunal demanda à deux médecins légistes de délivrer une expertise sur le point de savoir si une telle hospitalisation était nécessaire, ce à quoi ils répondirent par la positive. Le tribunal refusa cependant d’accorder une suspension de détention, au motif que M. Xiros était déjà « hospitalisé en substance » à la prison de Korydallos, et que ses examens à l’Hôpital général d’Athènes n’ont pas conclu à une nécessité d’hospitalisation.
LA CEDH EDICTE TROIS PRINCIPES
a) Principes généraux
70. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Les difficultés que rencontrent les Etats à notre époque pour protéger leurs populations de la violence terroriste sont réelles. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 116, 4 juillet 2006 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 127, CEDH 2008-...).
71. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Dybeku c. Albanie, no 41153/06, § 36, 18 décembre 2007 ; Mikadzé c. Russie, no 52697/99, § 108, 7 juin 2007). Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance doit en tout cas aller au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir, par exemple, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004-VII et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).
72. S’agissant des personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Soukhovoy c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008 ; Benediktov c. Russie, no 106/02, § 37, 10 mai 2007). Cette obligation positive requiert que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX).
LES TROIS OBLIGATIONS IMPOSEES A L'ETAT
73. Il ressort de la jurisprudence que le devoir de soigner la personne malade au cours de sa détention met à la charge de l’Etat les obligations particulières de veiller à ce que le détenu soit capable de purger sa peine, de lui administrer les soins médicaux nécessaires et d’adapter, le cas échéant, les conditions générales de détention à la situation particulière de son état de santé.
74. Quant à la première obligation, dans un Etat de droit, la capacité à subir une détention est la condition pour que l’exécution de la peine puisse être poursuivie. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel, précité, loc.cit.), la Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004). Partant, dans des cas exceptionnels où l’état de santé du détenu est absolument incompatible avec sa détention, l’article 3 peut exiger la libération de la personne concernée sous certaines conditions (Rojkov c. Russie, no 64140/00, § 104 19 juillet 2007).
75. Concernant la deuxième obligation, le manque de soins médicaux appropriés peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Gennadiy Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière. L’efficacité du traitement dispensé présuppose ainsi que les autorités pénitentiaires offrent au détenu les soins médicaux prescrits par des médecins compétents (voir Soysal c. Turquie, no 50091/99, § 50, 3 mai 2007 ; Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 91, 24 mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3. En particulier, ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état particulier de santé du détenu (Serifis c. Grèce, no 27695/03, § 35, 2 novembre 2006; Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 106, 21 juillet 2005 ; Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, § 85, 11 mars 2004; Sediri c. France (déc.), no 4310/05, 10 avril 2007). En général, la dégradation de la santé du détenu ne joue pas en soi un rôle déterminant quant au respect de l’article 3 de la Convention. La Cour examinera à chaque fois si la détérioration de l’état de santé de l’intéressé était imputable à de lacunes dans les soins médicaux dispensés (voir Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 53, 12 juin 2008).
76. En dernier lieu, pour ce qui est de la troisième obligation, la Cour exige que l’environnement carcéral soit adapté, si nécessaire, aux besoins spéciaux du détenu afin de lui permettre de purger sa peine dans des conditions qui ne portent pas atteinte à son intégrité morale. A ce jour, la Cour a déjà examiné des affaires portant sur la nécessité d’adopter des mesures particulières en prison afin de permettre à des détenus souffrant de handicaps physiques importants de satisfaire au quotidien leurs besoins personnels de manière conforme à la dignité humaine (Vincent c. France, no 6253/03, §§ 104-114, 24 octobre 2006 ; Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, §§ 190-191, CEDH 2005-IX ; Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 29, CEDH 2001-VII).
b) Application en l’espèce
77. Dans le cadre de la présente affaire, la Cour devra examiner, au regard des principes énoncés ci-dessus, en premier lieu, la compatibilité du maintien en détention du requérant avec les exigences de l’article 3 de la Convention. Ensuite, la Cour se penchera sur la qualité des soins médicaux dispensés à l’intéressé et, enfin, sur le besoin d’adaptation des conditions de détention à son état de santé.
i. Sur la capacité du détenu à purger sa peine
78. En ce qui concerne la capacité du requérant à purger sa peine, la Cour constate qu’il ressort de l’état actuel du dossier et, tout particulièrement, des rapports et certificats médicaux produits par les parties, que le requérant souffre de séquelles très importantes, causées par l’explosion d’une bombe qu’il tenait entre ses mains : sa vue est gravement atteinte, il rencontre des problèmes auditifs sérieux, il souffre d’asthme et du syndrome pyramidal, ce qui complique ses déplacements dans la prison. De plus, le requérant a perdu sa main droite, lors de l’explosion de la bombe, rendant ainsi difficile pour lui l’accomplissement des besoins de la vie quotidienne.
79. La Cour note que tout au long de son incarcération, les médecins ayant assuré le suivi médical du requérant n’ont pas suggéré qu’il était incapable de purger sa peine. Concernant tout particulièrement l’état de sa vue, qui a fait l’objet de la plupart des examens médicaux effectués après sa mise en détention, l’Hôpital général d’Athènes, établissement auquel le requérant a été fréquemment transféré soit en urgence soit pour subir des opérations chirurgicales programmées ou lorsque il y avait besoin de vérifier sa vue par une clinique externe spécialisée, n’a jamais conclu qu’il était incapable de continuer à purger sa peine. Certes, la Cour note que le directeur de la clinique ophtalmologique de l’hôpital public de Penteli, qui avait aussi examiné le requérant à plusieurs reprises, a suggéré dans un rapport médical délivré à une date non précisée que la mise en liberté de l’intéressé était nécessaire en vue de son hospitalisation « systématique ». Or, la Cour note que ledit avis médical ne préconisait pas dans l’abstrait la mise en liberté du requérant parce qu’il était incapable de purger sa peine mais, en revanche, le sursis à l’exécution de la peine pour rendre possible son hospitalisation de manière « systématique ». Cela est confirmé par les conclusions des médecins légistes qui ont été mandatés par l’autorité judiciaire compétente pour dresser un rapport sur la nécessité de sursoir à l’exécution de sa peine. En effet, le rapport soumis à la juridiction de l’exécution des peines ne concluait pas à l’incapacité du requérant de purger sa peine, mais à l’opportunité de son hospitalisation au sein d’un centre ophtalmologique spécialisé.
80. Quoi qu’il en soit, il est à noter que le droit interne met en place la procédure prévue par l’article 557 du code de procédure pénale, à travers laquelle le requérant peut toujours réitérer sa demande de sursis à exécution de sa peine ou même d’élargissement au cas où son état de santé se détériorerait davantage.
81. Au vu de ce qui précède, la Cour ne considère pas que la situation du requérant fait partie des cas exceptionnels dans lesquels l’état de santé du détenu est absolument incompatible avec son maintien en détention.
ii. Sur la qualité des soins médicaux dispensés
82. Etant donné l’état particulièrement préoccupant de la santé du requérant, ce dont conviennent les parties, la Cour estime que la pertinence du traitement médical dispensé à l’intéressé revêt une importance particulière dans le cadre de la présente affaire.
83. La Cour observe tout d’abord qu’en général le requérant a fait l’objet d’un traitement médicalement encadré et effectué par un personnel médical spécialisé. En particulier, s’agissant de ses problèmes auditifs, neurologiques et respiratoires, la Cour estime que les autorités compétentes lui ont dispensé des soins médicaux appropriés à son état de santé. En ce qui concerne son ouïe, le requérant a subi une tympanoplastie qui, selon l’attestation médicale du 3 octobre 2006 délivrée par l’Hôpital général de Nikaia, a amélioré, dans la mesure du possible, son état auditif. De surcroît, les TDM et IRM effectuées, même avec un certain retard, pour examiner l’état auditif et neurologique du requérant n’ont pas révélé d’anomalies. Enfin, quant à l’asthme chronique dont souffre le requérant, il ressort du dossier que celui-ci suit le traitement pharmaceutique prescrit pas ses médecins.
84. Concernant les problèmes de vue, la Cour note que tout au long de son incarcération, le requérant a fait l’objet de divers examens médicaux effectués par le personnel médical du dispensaire de la prison de Korydallos, de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital général d’Athènes, de l’Hôpital général de Nikaia, de la clinique ophtalmologique de l’hôpital public de Penteli ainsi que du médecin pathologiste G.M. De plus, il a subi plusieurs opérations pour limiter la dégradation de sa vue : en 2002, il a été opéré à deux reprises pour décollement de la rétine, traitement de la cataracte et ablation de l’huile de silicone. En 2003, il a subi une kératoplastie et en 2004, il fut à nouveau opéré pour ablation de silicone. Il ressort de son dossier médical que les autorités pénitentiaires ont réagi avec diligence chaque fois que les médecins traitants ont demandé son transfert dans un hôpital externe. Ainsi, à titre d’exemple, le requérant a été transféré à l’Hôpital général d’Athènes pour subir une opération en raison d’un décollement de la rétine le 24 décembre 2002, à savoir trois jours après son diagnostic par le médecin attaché au dispensaire de la prison de Korydallos.
85. Il n’en reste pas moins qu’au cours de l’incarcération du requérant, divers médecins spécialistes ont souligné la nécessité de son hospitalisation dans un centre ophtalmologique spécialisé afin de faire l’objet d’un suivi médical « systématique », à savoir être admis à l’hôpital pour le temps nécessité par la nature de son traitement. Ainsi, le directeur de la clinique ophtalmologique de Penteli a observé en 2005 qu’un « suivi médical systématique, fréquent et global [était] nécessaire pour empêcher la dégradation dramatique de la vue du requérant ». Le même médecin a réitéré cette conclusion le 8 mars 2006, en demandant l’admission du requérant dans un « centre médical spécialisé et son suivi médical adéquat et continu ». De surcroît, les médecins légistes I.B. et D.T. ont soumis le 9 août 2006 au tribunal de l’exécution des peines un rapport, ordonné par le procureur près le tribunal correctionnel du Pirée sur l’état de santé du requérant et la nécessité de l’hospitaliser « systématiquement ». Après avoir passé en revue les avis médicaux délivrés par les ophtalmologues ayant examiné le requérant, le rapport a conclu à la nécessité d’hospitaliser l’intéressé dans un centre ophtalmologique spécialisé afin de faire l’objet d’un suivi médical systématique et continu. Pour sa part, le tribunal correctionnel du Pirée, se fondant sur l’expertise médicale soumise par les médecins I.B. et D.T., a rejeté, sur la base de l’article 557 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale, la demande de sursis à exécution introduite par le requérant. Il a considéré que le médecin M.M., directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital général d’Athènes, qui suivait régulièrement le requérant, n’avait jamais suggéré son hospitalisation systématique, à savoir son séjour dans un centre ophtalmologique pour le temps nécessité par la nature de son traitement.
86. La Cour estime qu’il ne lui incombe pas de se prononcer, dans l’abstrait, sur la manière dont le tribunal de l’exécution des peines aurait dû trancher la demande introduite par le requérant. Elle considère pour autant que la question de savoir si l’autorité judiciaire compétente a pris suffisamment en compte tous les éléments qui étaient à sa disposition revêt une importance particulière dans le cadre de l’article 3 de la Convention ; elle est en effet directement liée à la qualité des soins dispensés au requérant, car son admission dans un centre médical spécialisé pour le temps nécessité par la nature de son traitement pourrait s’avérer déterminante quant à l’évolution de son état de santé.
87. Dans ce contexte, la Cour observe que, pour rejeter la demande de sursis à exécution, le tribunal correctionnel a principalement pris en compte les avis émis par quatre médecins spécialisés, à savoir ceux du directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital général d’Athènes, du directeur de la clinique ophtalmologique de Penteli et des médecins légistes I.B. et D.T. Ainsi, il apparaît clairement que, si le directeur de l’Hôpital général d’Athènes n’avait pas jugé nécessaire l’hospitalisation « systématique » du requérant, les trois autres médecins l’ont explicitement fait. Plus spécialement, I.B. et D.T. avaient été spécifiquement nommés par le tribunal correctionnel d’Athènes pour établir une expertise sur le sujet et, si le tribunal correctionnel a fait référence à l’expertise médicale qu’ils avaient soumise, il n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il s’est écarté de leur avis pour se rallier à celui du médecin M.M., au seul motif que ce dernier suivait régulièrement le requérant. Aux yeux de la Cour, si la juridiction interne ne souhaitait pas entériner les conclusions I.B. et D.T., il aurait été préférable qu’elle demande une expertise médicale supplémentaire sur ce sujet controversé, au lieu de se prononcer elle-même sur cette question de nature fondamentalement médicale, qui constituait le point essentiel des modalités de la prise en charge de la santé du requérant.
88. De surcroît, la Cour relève que le tribunal correctionnel du Pirée a considéré que la suspension de la détention du requérant ne s’imposait pas du fait que celui-ci était « hospitalisé en substance » au sein de la prison de Korydallos, ce qui signifie que ses conditions de détention équivalaient pratiquement à une hospitalisation. Or, cet élément ne ressort pas du dossier de l’affaire. Il convient tout d’abord de rappeler que les parties s’accordent à dire que le requérant purge sa peine dans sa cellule au sein de la prison de Korydallos. De plus, à supposer même que l’intéressé ait été transféré au dispensaire de la prison de Korydallos, il ressort des rapports dressés par des organes nationaux et internationaux que les services médicaux dispensés étaient loin d’être comparables à ceux normalement administrés par un hôpital et qu’ils ne pouvaient donc pas être assimilés à une hospitalisation dans un centre ophtalmologique telle que celle préconisée par les médecins légistes I.B. et D.T. En particulier, selon le rapport dressé en 2007 par un comité constitué de médecins affiliés tant à la Direction des contrôles et de la police sanitaires de la Préfecture du Pirée qu’à l’Ordre des Médecins du Pirée, le nombre des médecins traitants affectés au dispensaire de la prison était insuffisant et le service de garde était, en général, assuré par des internes (paragraphe 54 ci-dessus). En outre, le CPT, à la suite de la visite qu’il effectua également en 2007 dans la prison de Korydallos, a conclu que la qualité des soins médicaux dispensés était inacceptable et que le service du dispensaire était principalement assuré par des détenus, qui tenaient le registre médical et secondaient le personnel médical (paragraphe 55 ci-dessus).
89. En dernier lieu, la Cour estime que ses considérations précédentes doivent être associées à la gravité incontestable de l’état de santé du requérant et, en particulier, à la dégradation de son acuité visuelle tout au long de son incarcération. Il convient sur ce point de relever qu’à l’exception du directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital général, tous les médecins traitants ont fait état d’une dégradation importante de la vue du requérant. A la lumière de cet élément, la Cour conclut que les divers rapports médicaux préconisant l’hospitalisation « systématique » du requérant dans une clinique spécialisée auraient dû être pris en compte de manière plus approfondie par l’autorité judiciaire compétente. En outre, vu la piètre qualité des soins médicaux administrés par le dispensaire de la prison de Korydallos, la Cour émet des doutes quant à la capacité du personnel qui y travaillait en permanence à faire face à une situation d’urgence, par exemple à une détérioration soudaine et imprévisible de l’état de santé du requérant (voir en ce sens Khoudobine c. Russie, no 59696/00, § 95, CEDH 2006-XII (extraits) ; Sarban c. Moldova, no 3456/05, § 86, 4 octobre 2005).
90. Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que, sur ce point précis, les autorités compétentes ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles vu les exigences de l’article 3 de la Convention.
iii. Sur le caractère adapté de l’environnement carcéral du requérant avec son état de santé
91. L’adaptation des conditions de détention aux besoins particuliers du requérant revêt une importance particulière dans le cas d’espèce, pour deux raisons principales : en premier lieu, le requérant souffre de handicaps physiques importants qui affectent considérablement ses aptitudes sensorielles et motrices. En second lieu, il est condamné à la réclusion à perpétuité, ce qui signifie qu’en principe, il sera soumis, pour le restant de son existence, aux conditions de vie qui lui sont imposées actuellement.
92. La Cour considère d’emblée que les conditions générales de détention du requérant ne prêtent pas à critique. En particulier, celui-ci est détenu dans une cellule suffisamment grande, d’une superficie de 12 m2, où il séjourne seul (paragraphe 57 ci-dessus, et Ramirez Sanchez, arrêt précité, §§ 12 et 127) et qu’il a en outre la possibilité de se promener huit à neuf heures par jour dans une cour intérieure (voir, en ce sens, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, §§ 103 et 107, CEDH 2001-VIII et Nurmagomedov c. Russie (déc.), no 30138/02, 16 septembre 2004). Par ailleurs, la cellule est pourvue d’une fenêtre recevant de la lumière naturelle, ce qui permet aussi son aération. De surcroît, elle dispose de toilettes individuelles, séparées par un mur du reste de la cellule, et du chauffage central et halogène. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les conditions matérielles de la détention du requérant ne sont pas contraires à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Sotiropoulou c. France (déc.), no 40225/02, 18 janvier 2007).
93. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le requérant est obligé de rester seul dans sa cellule sans assistance pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne. En effet, la gravité des problèmes sensoriels et moteurs dont il souffre et le fait qu’il ait aussi perdu sa main droite, rendent la satisfaction de ses besoins personnels, en l’absence d’une personne chargée de l’assister au quotidien, particulièrement compliquée. Il convient de rappeler à cet égard que, lors des six premiers mois de sa détention, les autorités pénitentiaires avaient ordonné que le requérant partageât sa cellule avec son frère, lui aussi condamné pour appartenance au groupe terroriste « 17 novembre », pour l’assister dans ses besoins quotidiens. Or, il ressort du dossier que le requérant n’a, à ce jour, pas demandé aux autorités pénitentiaires de partager sa cellule avec un codétenu ou de recevoir l’assistance d’un accompagnateur. La Cour considère donc que les autorités pénitentiaires ne sauraient être tenues pour responsables du fait que le requérant se trouve dans sa cellule sans assistance pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne. A cet égard, elle relève par ailleurs qu’il ne ressort ni des conditions générales de détention du requérant ni du dossier que le requérant se trouve à la merci du bon vouloir de ses codétenus ou du personnel pénitentiaire, ce qui aurait pu provoquer chez lui des sentiments de rabaissement, d’humiliation et, a fortiori, une atteinte supplémentaire à son intégrité morale (voir, a contrario, Vincent, précité, § 102).
iv. Conclusion
94. Au vu de ce qui précède, la Cour reconnaît, d’une part, que les autorités pénitentiaires ont fait preuve de leur volonté d’offrir au requérant un traitement médicalement encadré et effectué par un personnel médical spécialisé. D’autre part, elle relève que les autorités judiciaires compétentes n’ont pas suffisamment pris en compte les rapports médicaux du directeur de la clinique ophtalmologique de Penteli et des médecins légistes I.B. et D.T., préconisant le besoin d’hospitalisation du requérant dans un centre médical spécialisé pour le temps jugé nécessaire par la nature de son traitement. Cet élément combiné avec la gravité de l’état de santé du requérant et la qualité insuffisante des soins médicaux offerts par le dispensaire de la prison de Korydallos suffit à la Cour pour constater l’existence d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
Arrêt Rivière contre France du 11 juillet 2006; requête 33834/03
Cet arrêt de condamnation concerne la détention après condamnation d'un individu malade
"59. La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła c. Pologne, précité, § 91, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III, et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004).
60. La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (arrêts Mouisel c. France et Matencio c. France précités, §§ 38 et 76 respectivement).
61. Ainsi, en procédant à l’examen de l’état de santé du prisonnier et aux effets de la détention sur son évolution, la Cour a considéré que certains traitements enfreignent l’article 3 du fait qu’ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (arrêt Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Dans l’arrêt Price c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que le fait d’avoir maintenu en détention la requérante, handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII).
62. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Hurtado c. Suisse, arrêt du 28 janvier 1994, série A no 280-A, avis de la Commission, pp. 15-16, § 79). La Cour a par la suite affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94, et Mouisel c. France, précité, § 40).
63. En particulier, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (voir, par exemple, l’arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, § 66, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 111, CEDH 2001-III). Il convient également, au sein de la vaste catégorie des maladies mentales, de distinguer celles, telles que la psychose, qui comportent, pour les personnes qui en souffrent, des risques particulièrement élevés.
64. Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention dans un milieu où il n’est pas encadré et suivi au quotidien par un personnel médical spécialisé et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
65. La Cour relève que, par un certificat rédigé le 20 août 2002, le psychiatre du SMPR de Val de Reuil a indiqué que le requérant était psychotique et présentait « des troubles du comportement de type suicidaire en relation avec une situation pénale difficile à envisager ». Il ajoutait qu’un séjour en milieu hospitalier était nécessaire.
Suite à ce certificat, le requérant fut hospitalisé d’office pendant un mois.
66. Trois experts ayant examiné le requérant notèrent en octobre 2003 qu’« une pathologie psychiatrique [était] apparue en détention et que le requérant [était] désormais un malade mental chronique, qui, sans la lourdeur de ses antécédents, relèverait évidemment plus d’une prise en charge psychiatrique que d’un maintien en milieu pénitentiaire ».
Les experts notaient encore que certains des comportements du requérant, comme une compulsion d’auto-strangulation, constituaient des indices inquiétants.
67. Par ailleurs, un nouveau certificat délivré le 25 avril 2005 par le chef de service du SMPR de Val de Reuil indiquait que le requérant avait bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique pendant toute la durée de son incarcération, soit d’octobre 2001 à septembre 2004.
68. La Cour note encore que le Gouvernement apporte des précisions quant au suivi médical dont bénéficie le requérant. Il indique par ailleurs que celui-ci a fait l’objet de deux hospitalisations d’office en août et en novembre 2002, en raison de tendances suicidaires rendant son maintien en détention dangereux. Il précise encore que, depuis que le requérant est incarcéré à Riom, soit depuis janvier 2005, il rencontre le psychiatre une fois par mois et l’infirmière psychiatrique une fois par semaine. La Cour est consciente, dans ces conditions (non contestées par le requérant), que les autorités pénitentiaires ne sont pas demeurées passives et se sont efforcées de pallier sur le plan médical la gravité de l’affection mentale dont souffre le requérant.
69. Pour ce qui est, plus particulièrement, des demandes de mise en liberté conditionnelle, la Cour constate que toutes deux ont été examinées successivement par la JRLC et la JNLC.
Il ressort de ces décisions que les demandes du requérant ont été rejetées précisément en raison de ses problèmes psychiatriques et du manque d’encadrement prévu en cas de libération.
70. La Cour constate que les problèmes psychiatriques du requérant sont connus des autorités depuis au plus tard le mois d’août 2002.
71. Par ailleurs, aux termes de l’article D398 du code de procédure pénale, les détenus atteints des troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire mais doivent être hospitalisés d’office sur décision préfectorale.
Cette disposition est confirmée par l’article L3214-1 du code de la santé publique, qui précise que l’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée.
72. La Cour relève en outre que la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire (voir paragraphe 31 ci-dessus) prévoit que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié. La Cour a déjà eu l’occasion de citer cette recommandation (voir par exemple l’arrêt Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004), et elle y attache un grand poids, même si elle admet qu’elle n’a pas en soi valeur contraignante à l’égard des Etats membres.
73. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a relevé à plusieurs reprises que le suicide ou la mort d’un détenu pouvait constituer une violation par l’Etat défendeur de l’article 3 de la Convention (voir les arrêts précités Keenan c. le Royaume-Uni et, a contrario, Kudła c. Pologne ; voir aussi l’arrêt McGlinchey c. le Royaume-Uni, Rec. CEDH. 2003–V).
74. Elle réitère que, si l’on ne peut déduire de l’article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner, cet article impose en tout cas à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (arrêt Kudła précité, § 94 ; arrêt Mouisel précité, § 40 et arrêt Gelfmann, précité, § 50).
Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, Gennadi Naoumenko c. Ukraine, précité, § 112, 10 février 2004 et Farbtuhs, précité, § 51).
75. Au vu de cette jurisprudence, la Cour considère que l’état d’un prisonnier dont il est avéré qu’il souffrait de graves problèmes mentaux et présentait des risques suicidaires, même si jusqu’à présent ceux-ci ne se sont pas réalisés, appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement humain, quelle que soit la gravité des faits à raison desquels il a été condamné.
76. En définitive, la Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas, en l’espèce, et malgré des efforts d’adaptation non niables et qu’elle se garde de sous-estimer, assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Son maintien en détention, sans encadrement médical actuellement approprié constitue dès lors une épreuve particulièrement pénible et l’a soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans les conditions examinées ci-dessus.
77. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour parvient en définitive à la conclusion qu’il y a violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce."
Arrêt RENOLDE c. FRANCE du 16 octobre 2008. Requête no 5608/05
La CEDH constate qu'incarcérer un malade mental au lieu de le transférer vers un centre de soins est un acte inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
119. La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła précité, § 91, Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004 et Rivière précité, § 9).
120. La Cour a également affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94). En particulier, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (cf. notamment Aerts précité, p. 1966, § 66, Keenan précité § 111 et Rivière précité, § 63).
121. En effet, le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l’article 3 s’agissant de la protection de la dignité humaine, même si cette personne n’est pas en mesure, ou pas capable, d’indiquer des effets néfastes précis (Keenan précité, § 113).
122. Dans le cas d’espèce, la Cour rappelle que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques aigus qui se sont manifestés par une tentative de suicide le 2 juillet 2000. Dans les jours suivants, bien que son état se soit amélioré en raison du traitement neuroleptique, il a continué à manifester un comportement préoccupant, notamment en agressant une surveillante. Le surveillant qui a mené l’enquête sur cet incident a indiqué qu’il tenait des propos incohérents et a noté dans son rapport qu’il s’agissait d’un détenu « très perturbé ».
123. La Cour a également relevé le témoignage du surveillant R, selon lequel Joselito Renolde entendait son fils lui parler la nuit, ainsi qu’un rapport d’incident de la nuit précédent son décès, où il était mentionné qu’il secouait les barreaux de sa cellule et demandait à sortir.
124. Bien qu’elle soit consciente des difficultés auxquelles se heurtent les autorités pénitentiaires et de la nécessité de sanctionner les agressions visant les personnels de surveillance, la Cour est frappée par le fait que Joselito Renolde se soit vu infliger la sanction maximale pour une faute du premier degré, sans aucune prise en compte de son état psychique et alors qu’il s’agissait d’un premier incident.
125. La Cour observe que ce type de mesure entraîne la privation de toute visite et de tout contact avec les autres détenus.
126. Il ressort du dossier que Joselito Renolde a éprouvé angoisse et détresse pendant cette période, comme en témoigne la lettre écrite à sa sœur le 6 juillet 2000, où il disait être à bout et comparait sa cellule à une tombe, en se représentant crucifié. Cela est confirmé par le témoignage de son codétenu N. (paragraphe 32 ci-dessus), auquel il disait être mal dans sa peau et avoir le « cafard » car il n’avait pas l’habitude de rester seul, et qui l’entendait pleurer.
127. La Cour observe d’ailleurs que l’état de Joselito Renolde a inspiré suffisamment d’inquiétude à son avocate, qui l’a vu le 12 juillet 2000 (soit huit jours avant son décès) pour qu’elle demande immédiatement au juge d’instruction une expertise psychiatrique en vue d’évaluer la compatibilité de son état avec la détention, particulièrement en cellule disciplinaire.
128. La Cour rappelle que l’état d’un prisonnier dont il est avéré qu’il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement humain (Rivière précité, § 75). Dans l’affaire Keenan précitée, la Cour a considéré que le fait d’infliger à Mark Keenan une sanction disciplinaire qualifiée de lourde, à savoir sept jours d’isolement en cellule disciplinaire et vingt-huit jours de détention supplémentaire, constituait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
129. Or, dans le cas d’espèce, Joselito Renolde s’est vu infliger une sanction nettement plus lourde, à savoir quarante-cinq jours de cellule disciplinaire, ce qui était susceptible d’ébranler sa résistance physique et morale. La Cour estime qu’une telle sanction n’est pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’un malade mental et que cette sanction constitue un traitement et une peine inhumains et dégradants (Keenan précité, § 116 et Rivière précité, § 76 ; voir a contrario Kudła précité, § 99 et Aerts précité, p. 1966, § 66),
130. La Cour conclut en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 3.
Arrêt Raffay Taddei c. FRANCE du 21 décembre 2010. Requête no 36435/07
La France ne fournit pas de soins médicaux adéquats à une détenue anorexique et atteinte du syndrome de Münchhausen qui consiste à simuler une maladie inexistante. La France est condamnée pour soins non adéquate en cours de détention.
LES FAITS
La requérante, Virginie Raffray Taddei, est une ressortissante française née en 1962, actuellement incarcérée à Roanne (France). Elle purge différentes peines correctionnelles prononcées entre 1997 et 2007, notamment pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, recel, ou vol (son casier judiciaire mentionne 20 condamnations depuis 1994).
Elle déposa régulièrement des demandes de suspension de peine et/ou de libération conditionnelle pour raisons médicales, alléguant des problèmes sérieux de santé. Les expertises médicales réalisées mirent en doute certaines de ses prétentions mais attestèrent clairement de l’existence de pathologies, dont un asthme grave et une insuffisance respiratoire chronique, l’anorexie et le syndrome de Munchausen (une pathologie psychiatrique caractérisée par le besoin de simuler une maladie).
Les expertises médicales abordèrent la question de la possibilité du maintien de Mme Raffray Taddei en détention, vu son état de santé. Le 3 mars 2008, un expert conclut à l’incompatibilité de la détention compte tenu de « l’altération de l’état général » de l’intéressée tandis qu’un médecin, un mois plus tôt, demandait des examens complémentaires sur les « antécédents lourds avant de déterminer les possibilités d’incarcération ». En avril 2008, un compte rendu d’hospitalisation indiquait que « les pathologies sont nombreuses et intriquées » et que « son maintien en détention, dans les conditions qui sont les siennes, sont a priori délétères ». A l’été 2008, deux expertises conclurent à la parfaite compatibilité de l’état de santé de Mme Raffray Taddei. Un certificat de février 2009 conclut « qu’il était souhaitable d’envisager les possibilités d’aménagements de peine compte tenu (...) de l’absence d’affectation adaptée pour la requérante ». En mars 2009, une expertise précisa que « l’état de la détenue n’[était] pas (...), stricto sensu, compatible avec la détention ordinaire ou hospitalière », constata son « état précaire », et conclut que « le retour à la détention ordinaire » était à ce moment-là « exclu ». Il estima également que « les troubles respiratoires et métaboliques (dénutrition) [étaient] inquiétants et nécessit[aient] une prise en charge spécialisée dans un centre hospitalier de renutrition ». Une autre expertise en mars 2009 conclut que l’état de santé de la requérante était « durablement compatible avec le maintien en détention » mais que « néanmoins la requérante nécessit[ait] une réalimentation adaptée ». En avril 2009, une expertise psychiatrique fit valoir que l’état de Mme Raffray Taddei nécessitait un suivi spécialisé pour le traitement de son anorexie et du syndrome de Munchausen. La nécessité d’un tel traitement fut confirmée par un médecin psychiatre de Roanne en charge de la requérante, et par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, en décembre 2009 et mars 2010.
Plusieurs expertises médicales mirent également en exergue que l’emprisonnement de la requérante loin de sa famille (originaire de Corse, elle fut emprisonnée à partir de 1998 à Rennes, Fresnes puis Roanne) était psychologiquement problématique pour elle, et que son refus de s’alimenter avait commencé à compter de son transfert à Rennes.
Concernant ses problèmes respiratoires, Mme Raffray Taddei fut hospitalisée à plusieurs reprises à l’occasion de crises. Elle bénéficia d’un suivi médical régulier, d’un traitement médicamenteux et avait à sa disposition un extracteur d’oxygène.
Concernant son anorexie (l’intéressée étant passée de 54 kg en juin 2008 à 35 kg en avril 2009, et serait tombée à 30/31 kg selon ses dernières indications), hormis une brève prise en charge à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes, elle n’a pas fait l’objet de traitement spécifique malgré les recommandations médicales en ce sens.
En dernier lieu, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Lyon confirma le refus de libération conditionnelle de Mme Raffray Taddei le 19 mai 2010. Son emprisonnement se poursuit sous le régime de détention ordinaire et le Gouvernement précise qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale et psychologique hebdomadaire.
GRIEFS INVOQUES
Invoquant l’article 3, Mme Raffray Taddei se plaignait de son maintien en détention et de l’insuffisance de soins adaptés à ses problèmes de santé.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 août 2007.
Maintien en détention
La Cour observe que Mme Raffray Taddei a demandé à plusieurs reprises que sa peine soit suspendue pour raisons médicales, mais n’a pas soutenu que son état de santé serait « durablement incompatible avec la détention » ordinaire. En outre, à aucun moment les conditions posées par le droit français pour conclure à l’impossibilité d’un maintien en détention pour raisons de santé n’ont été réunies (deux expertises médicales concordantes concluant à une telle impossibilité ou, selon des dispositions législatives récentes, une expertise concluant à une pathologie engageant le pronostic vital).
La Cour ne peut donc pas conclure que le maintien en détention de la requérante était, en soi, contraire à l’article 3.
Insuffisance alléguée des soins
La Cour doit examiner si Mme Raffray Taddei - dont il est établi qu’elle souffrait au moins de problèmes respiratoires graves, d’anorexie et du syndrome de Munchausen - a bénéficié de soins médicaux appropriés. En effet, l’absence de tels soins peut le cas échéant constituer un traitement contraire à l’article 3.
Concernant les problèmes respiratoires, la Cour prend note de l’hospitalisation, des soins et du suivi médical régulier qui ont été fournis à Mme Raffray Taddei (en particulier à Fresnes). Elle considère que les autorités n’ont pas manqué à leur devoir de protéger les affections respiratoires de l’intéressée.
Concernant l’anorexie en revanche, la Cour constate que si celle-ci a dans un premier temps été prise en charge à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes, force est de constater que la maladie n’a pas été maîtrisée, à défaut notamment d’avoir obtenu une « affectation adaptée ». Face à cette dénutrition sévère, les médecins ont indiqué en mars-avril 2009 l’urgence d’une réalimentation et préconisé un séjour dans un service spécialisé incluant une psychothérapie pour le traitement du syndrome de Munchausen qui lui est lié. Or, aucune des mesures préconisées par les médecins n’a été suivie d’effet. Au contraire, Mme Raffray Taddei est retournée en détention ordinaire en juin 2009, à un moment critique de l’évolution de sa maladie, et depuis lors son état de santé se dégrade encore, le médecin qui la suit à Roanne ayant indiqué « qu’un suivi médical en milieu spécialisé est justifié ». La Cour est frappée par la discordance entre les soins préconisés par les médecins et les réponses qui y sont apportées par les autorités nationales, celles-ci n’ayant pas envisagé un aménagement de peine qui eût pu concilier l’intérêt général et l’amélioration de l’état de santé de la requérante.
La Cour note encore qu’il ne lui appartient pas de se prononcer dans l’abstrait sur la manière dont le juge de l’application des peines aurait dû trancher la demande de remise en liberté de Mme Raffray Taddei, mais que de toute évidence la recommandation répétée d’une hospitalisation dans un environnement spécialisé n’a pas été prise en compte par le juge, qui s’est borné à retenir que la requérante n’avait pas faits d’efforts sérieux de réadaptation sociale. Selon la Cour, il s’agit là d’une condition rigoureuse, si l’on tient compte de l’état mental et physique de la requérante et du fait qu’elle a eu pour conséquence l’absence d’examen des possibilités de soins adaptés.
Mme Raffray Taddei s’est donc vu transférer dans un établissement dont rien n’indique qu’il dispose des infrastructures nécessaires pour le traitement de sa maladie.
Qui plus est, ce transfert a eu pour effet de la placer en connaissance de cause loin de son domicile et de ses enfants, alors que les médecins ont relevé que cet éloignement constituait une souffrance pour elle et une des causes de son anorexie.
En outre, la Cour relève des délais procéduraux longs et inappropriés dans cette affaire impliquant l’examen de pathologie engageant le pronostic vital ou d’un état de santé incompatible avec la détention (en particulier, la requérante a demandé une demande de suspension de peine en mars 2008 et n’a obtenu une décision définitive sur cette question qu’en octobre 2009).
La Cour conclut que l’absence de prise en compte suffisante par les autorités nationales de la nécessité d’un suivi spécialisé dans une structure adaptée que requiert l’état de Mme Raffray Taddei, conjuguée avec les transferts de l’intéressée – particulièrement vulnérable – et l’incertitude prolongée qui en a résulté quant à sa demande de suspension de peine, ont pu provoquer chez elle une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
La Cour en conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3.
Cara-Damiani c. Italie requête no 2447/05 Arrêt du 7 février 2012
Détenu handicapé soumis à un traitement inhumain et dégradant en raison de son maintien dans des locaux inadaptés et de l’absence de suivi médical approprié
Article 3
La Cour rappelle que s’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 impose notamment à l’État l’obligation positive de s’assurer que les détenus bénéficient de soins médicaux appropriés, qui, sans devoir atteindre le niveau des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral, soient comparables à ceux que les autorités se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population.
Le requérant, âgé de 58 ans au moment de l’introduction de sa requête, et en fauteuil roulant, n’a plus marché depuis au moins 1997. L’aménagement de la prison ne lui permettait pas de se rendre seul aux toilettes, de se déplacer en déambulateur ou en fauteuil roulant et ses sorties étaient limitées par le régime de haute sécurité auquel il était soumis. Si la Cour salue la création d’une unité pour handicapés à la prison de Parme, elle relève le problème de financement qui a entravé son fonctionnement.
La Cour estime que la détention d’une personne handicapée pendant une longue période dans un établissement où elle ne peut se déplacer de façon autonome n’est pas compatible avec les exigences de l’article 3. Le tribunal d’application des peines de Bologne a à cet égard souligné que la réincarcération du requérant en quartier de détention ordinaire entre le 1er octobre et le 23 novembre 2010 exposait l’Italie à une condamnation pour violation de l’article 3 de la Convention.
Le Gouvernement n’a pas indiqué quels soins adaptés à l’état de santé du requérant lui auraient été prodigués en détention. La Cour relève l’admission tardive de M. Cara-Damiani au bénéfice de la détention domiciliaire, ainsi que l’inadéquation systématique dénoncée par les médecins du milieu carcéral à sa pathologie et l’inaction des autorités à cet égard.
La Cour constate que la détention prolongée du requérant handicapé dans un établissement où il ne peut pas se déplacer par ses propres moyens et où il ne bénéficie pas d’un suivi médical approprié a atteint le degré de gravité pour constituer un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.
L'Arrêt de la Cour
(a) Principes généraux
65. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé d’un requérant (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX). Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peines légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, CEDH 2006-IX).
66. S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI ; Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ces soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c’est-à-dire d’un niveau comparable à celui que les autorités de l’Etat se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population. Toutefois cela n’implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral (Mirilashivili c. Russie (déc.), no 6293/04, 10 juillet 2007). Par ailleurs, s’agissant de fournir les soins médicaux appropriés, il faut avoir égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (Alexanian c. Russie, no 46468/06, § 140, 22 décembre 2008). Le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII). Qui plus est, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (Mouisel précité, § 40).
67. Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de la santé du prisonnier, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel précité, § 40), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004). Dans une affaire donnée, la détention d’une personne atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l’état est durablement incompatible avec la vie carcérale peut poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, § 72, 10 novembre 2005).
En appliquant les principes susmentionnés, la Cour a déjà conclu que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, et de surcroît malade, peut entrer dans le champ de protection de l’article 3 (Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI, Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI, et Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). De plus, la Cour a jugé que maintenir en détention une personne tétraplégique ou en tout cas gravement handicapée, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (Price précité, § 30 ; Vincent c. France, no 6253/03, § 103, 24 octobre 2006 ; Hüseyin Yıldırım c. Turquie, no 2778/02, § 83, 3 mai 2007).
68. Cela étant, la Cour rappelle que dans l’affaire Sakkopoulos c. Grèce précitée elle a tenu compte de trois éléments pour examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant : (a) la condition du détenu, (b) la qualité des soins dispensés et (c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant. La Cour estime que ces critères sont également pertinents dans la présente affaire.
(b) Application de ces principes au cas d’espèce
69. Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
70. Agé de 58 ans au moment de l’introduction de la requête, souffrant de pathologies cardiaques, et opéré à plusieurs reprises à l’abdomen, le requérant n’a plus marché depuis au moins 1997 et il ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant. Cette situation semble être en rapport avec l’hernie discale récidivante et dégénérative qui a été constatée à cette époque-là, soit lorsque le requérant était détenu dans un autre établissement pénitentiaire.
Arrivé à la prison de Parme, il fut placé dans un quartier de détention dans lequel des obstacles architecturaux rendaient ses déplacements très difficiles. Le mobilier et les sanitaires n’étant pas aménagés, le requérant ne pouvait se rendre aux toilettes tout seul et devait se faire aider par un planton. En outre, les espaces ne lui permettaient pas de se déplacer avec le déambulateur qui lui avait été fourni. Par ailleurs, même après que le requérant eut été équipé d’un fauteuil roulant, la circulation dans les espaces non aménagés restait difficile. Enfin, les sorties dans le couloir – espace où les déplacements étaient plus faciles – lui étaient limitées en raison du régime de haute surveillance auquel il était soumis. En décembre 2005, le requérant fut placé dans l’unité pour handicapés de la prison de Parme, dans laquelle les espaces sont aménagés en fonction des besoins de cette catégorie de détenus.
71. La Cour salue la décision des autorités italiennes de mettre sur pied à la prison de Parme, déjà équipée d’un centre clinique, une unité pour handicapés. Toutefois, il ressort du dossier que l’ouverture de l’unité pour handicapés fut retardée en raison d’importantes coupures budgétaires. En outre, il apparaît que le nombre de places prévues dans cette unité spécialisée est insuffisant par rapport au nombre de détenus souffrants de pathologies handicapantes comme celle du requérant. Enfin, même après l’ouverture, l’exploitation de l’unité pour handicapés resta soumise à la mise à disposition effective des fonds pour le recrutement du personnel spécialisé et pour la mise en fonction de la piscine.
72. En l’espèce, rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, mais l’article 3 de la Convention peut être enfreint par une inaction ou un manque de diligence de la part des autorités publiques. Cependant la Cour estime que la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer par ses propres moyens, comme dans le cas d’espèce, et qui a duré aussi longtemps, constitue un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention.
73. Quant à la réincarcération du requérant du 1er octobre au 23 novembre 2010, et à son placement dans un quartier de détention ordinaire de la prison de Parme, au mépris de son handicap et de ses conditions générales de santé, les autorités nationales ne sauraient passer pour avoir réagi en conformité avec les exigences de l’article 3 de la Convention.
D’ailleurs, cette situation inadaptée a été soulignée par le tribunal d’application des peines de Bologne à propos de la période de détention allant du 1er octobre au 23 novembre 2010. En effet, dans sa décision du 23 novembre 2010, se référant à l’affaire Scoppola c. Italie précité, ce tribunal a reconnu que cette situation violait le droit à la santé du requérant et a estimé qu’elle exposerait l’Italie à une condamnation pour violation de l’article 3 de la Convention si le requérant n’était pas immédiatement placé en détention domiciliaire, faute de place dans l’unité pour handicapés.
74. S’agissant de la prise en charge médicale par les autorités compétentes, la Cour constate que, contrairement aux arguments du Gouvernement, les médecins de la prison ont relevé et noté dans le dossier du requérant qu’il était impossible de lui prodiguer en milieu carcéral la rééducation qu’il nécessitait. Ils ont par ailleurs formulé à plusieurs reprises des avis sur le danger d’une détérioration de la motricité que le manque de rééducation appropriée entraînerait. L’expert commis par le tribunal d’application des peines de Bologne a, quant à lui, constaté une détérioration des conditions du requérant et a également préconisé son placement dans un environnement idoine, garantissant un suivi médical approprié.
Malgré les recommandations de placer le requérant dans une structure extérieure à la prison, spécialisée dans la rééducation et en mesure de fournir l’assistance continue que celui-ci nécessitait, ce dernier est resté à la prison de Parme jusqu’en mars 2008 pour des raisons qui ne sauraient être imputées à l’intéressé.
Ce n’est en effet que par la décision du tribunal d’application des peines de Bologne du 18 mars 2008 que le requérant a été admis au bénéfice de la détention domiciliaire en milieu hospitalier afin de lui prodiguer le traitement de rééducation en plus de l’intervention chirurgicale qu’il nécessitait.
Aux yeux de la Cour, la décision ci-dessus confirme que la thérapie de la rééducation dont le requérant avait besoin n’était possible qu’en dehors de la prison, dans un lieu spécialisé. D’ailleurs, il convient de souligner que le Gouvernement n’a pas été en mesure d’étayer la nature et l’adéquation de la thérapie de rééducation qui aurait été prodiguée au requérant dans la période litigieuse.
75. Par ailleurs, la Cour relève que le requérant a lui-même effectué les démarches pour trouver un établissement disposé à l’accueillir pour sa rééducation. Pour la Cour l’inadéquation, systématiquement dénoncée par les médecins, du milieu carcéral à la pathologie présentée par le requérant aurait dû conduire l’Etat soit à transférer ce dernier dans un établissement de soins adaptés afin d’exclure tout risque de traitements inhumains, soit à suspendre l’exécution d’une peine qui s’analysait désormais en traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
76. En outre, quelles que soient les entraves, soulignées par le Gouvernement, au bon déroulement du programme d’examens et des consultations médicales que le requérant ait pu lui-même provoquer par ses déplacements, la Cour estime que celles-ci ne dispensent aucunement l’Etat de ses obligations face aux détenus malades. D’une part, ces déplacements ont été autorisés ; d’autre part, même déplacé dans un autre établissement pénitentiaire, le requérant restait détenu et donc devait être médicalement pris en charge par les autorités.
77. En conclusion, les soins dont l’intéressé avait besoin ne pouvant pas être prodigués en prison, son maintien à la prison de Parme malgré l’avis contraire des médecins a atteint le minimum de gravité pour constituer un traitement inhumain et enfreindre l’article 3 de la Convention.
78. Compte tenu des éléments ci-dessus et des conclusions auxquelles elle est parvenue (paragraphes 72, 73 et 77 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du traitement inhumain et dégradant subi par le requérant.
CG. FRANCE requête 27244/09 du 23 Fevrier 2012
Les détenus souffrant de graves troubles mentaux doivent pouvoir être placés et soignés en service hospitalier
71. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III). Bien que le but du traitement soit un élément à prendre en compte, pour ce qui est de savoir en particulier s’il visait à humilier ou rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers, précité, § 74). La Cour renvoie également aux principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats quant aux soins de santé des personnes en détention tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans l’arrêt Sławomir Musiał c. Pologne (no 28300/06, §§ 85-88, 20 janvier 2009). Dans cet arrêt, elle a conclu, à propos d’un détenu souffrant de troubles mentaux graves et chroniques, dont la schizophrénie, que si le maintien de celui-ci en détention n’était pas incompatible en lui-même avec son état de santé, son placement en revanche dans un établissement inapte à l’incarcération des malades mentaux posait de graves problèmes au regard de la Convention. Elle releva en outre que ce détenu ne bénéficiait pas d’un traitement spécialisé, en particulier d’une surveillance psychiatrique constante, et que ces faits combinés à des conditions matérielles de détention inappropriées, avaient « manifestement » nui à sa santé et à son bien-être et constituaient un traitement inhumain et dégradant (§ 97).
72. La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur la compatibilité du maintien en détention des personnes souffrant de pathologies graves, tant physiques (Mouisel c. France, no 67263/01, § 42, CEDH 2002-IX) que mentales (Rivière c. France, nº 33834/03, § 64, 11 juillet 2006). La question centrale posée dans ces affaires est de déterminer si le milieu carcéral est en soi inadapté à la condition d’un individu souffrant de pathologies invalidantes et si l’épreuve de la détention en tant que telle s’avère particulièrement pénible en raison de l’incapacité de l’individu d’endurer une telle mesure (Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 50, 12 juin 2008). Dans le cas des malades mentaux, il faut tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (Sławomir Musiał, précité, § 87).
73. La Cour renvoie également au constat fait à l’échelle nationale de l’insuffisance de la prise en charge psychiatrique en détention et de l’urgence à faire en sorte que les détenus qui souffrent de graves troubles mentaux soient hospitalisés (paragraphes 36, 38 et 40 ci-dessus ; voir également l’arrêt Rivière précité).
74. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le problème doit être distingué de celui de la comparution devant la cour d’assises. Elle observe que la gravité de la maladie dont est atteint le requérant est incontestée. Il souffre de troubles mentaux importants et chroniques, notamment sa schizophrénie (délires psychotiques, hallucinations), maladie de longue durée qui nécessite un traitement au long cours (Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 36, CEDH 2001-I) et qui engendre un risque de suicide connu et élevé (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 94, CEDH 2001-III). Elle relève également que l’intéressé a été au cours de sa détention, à de nombreuses reprises, victime de rechutes comme en témoignent ses nombreuses hospitalisations d’office (paragraphes 18, 22, 26, 28 et 30 ci-dessus). Or, la Cour a déjà jugé, certes dans d’autres circonstances, que les souffrances qui accompagnent les rechutes d’un malade schizophrène pourraient en principe relever de l’article 3 (Bensaid, précité, § 37).
75. La Cour relève encore que tout au long de ces quatre années, les médecins ne cessèrent de recommander, outre un traitement médicamenteux « essentiellement à visée thérapeutique par rapport aux troubles que [le requérant] présente » (paragraphe 23 ci-dessus) un suivi psychiatrique spécialisé, durable et soutenu y compris en unité pour malades difficiles (paragraphes 11, 12 et 30) au motif que ses troubles pouvaient compromettre la sûreté des personnes en raison de l’imprévisibilité de ses passages à l’acte.
76. A cet égard, la Cour observe que le requérant a été soigné fréquemment et qu’il a bénéficié de soins et de traitements médicaux dispensés en détention. Les rapports des médecins indiquent en effet que le requérant était régulièrement traité à l’aide de médicaments (paragraphes 23 et 30 ci-dessus) et qu’il était placé au sein du SMPR de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait dès que sa détention ordinaire dans la prison n’était pas compatible avec son état de santé. Il fut ainsi placé en SMPR plus de douze fois pour des séjours de quelques semaines entrecoupés par des retours en détention normale au sein de la maison d’arrêt des Baumettes (paragraphes 11, 18, 22, 26 et 29 ci-dessus). Il fit par ailleurs l’objet d’hospitalisations d’office en application de l’article D. 398 du CPP à sept reprises (paragraphes 30 et 70 ci-dessus). Ces hospitalisations d’office furent ordonnées alors que l’intéressé se trouvait en proie à de nombreuses périodes d’anxiété difficilement compatibles avec la détention, y compris dans le service régional de psychiatrie pénitentiaire, en 2007, 2008 et 2009 (paragraphes 18, 22, 26 et 28 ci-dessus). Ainsi, en 2008, l’expert précisa que les séjours psychiatriques avaient été ordonnés « par rapport à des moments de décompression anxio-délirante à thème notamment persécutoire, et pour des séjours de décompression par rapport aux nombreux séjours qu’il a déjà effectués aux Baumettes dans le cadre d’un SMPR » (paragraphe 23 ci-dessus). Début 2009, le requérant présenta « une recrudescence anxieuse avec mise en avant de ses idées délirantes et anciennes (délire de grandeur et de paternité) ». Le 4 septembre 2009, veille de son procès en appel et de la reconnaissance de son irresponsabilité pénale, il fut également admis en hospitalisation d’office pour « état fluctuant, avec des épisodes d’excitation psychique à tonalité délirante alternant avec des périodes d’affaissement thymique et des ruminations anxieuses » (paragraphe 30 ci-dessus).
77. Si les hospitalisations d’office ponctuelles du requérant ont permis d’éviter la survenance d’incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité physique et mentale ainsi que celle d’autrui, l’extrême vulnérabilité du requérant appelait cependant, aux yeux de la Cour, des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que n’ont pas permis les nombreux allers-retours de celui-ci entre la détention ordinaire et ses hospitalisations (voir, par exemple, a contrario Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, §§ 65-66, Recueil des arrêts et décisions 1998-V ; voir également paragraphe 36 ci-dessus).
78. En premier lieu, la Cour est frappée par la répétition et la fréquence des hospitalisations de l’intéressé. Les nombreuses périodes de soins délivrés à la fois hors du milieu carcéral dans le cadre des hospitalisations d’office et au sein du SMPR (paragraphe 76 ci-dessus) soulignaient le caractère grave et chronique des troubles mentaux du requérant. Les décisions d’hospitalisations dans un établissement de santé prises à l’égard du requérant conformément à l’article D. 398 du code de procédure pénale en 2007, 2008 et 2009 étaient ordonnées chaque fois que son état de santé n’était plus compatible avec la détention. Il retournait ensuite soit au sein du SMPR de la prison soit en cellule ordinaire jusqu’à ce que son état se dégrade à nouveau. Dans ces conditions, il était vain d’alterner les séjours à l’hôpital psychiatrique et en prison, les premiers étant trop brefs et aléatoires, les seconds incompréhensibles et angoissants pour le requérant, dangereux pour lui-même et autrui (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). La cour observe ainsi que l’alternance des soins, en prison et dans un établissement spécialisé, et de l’incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à la détention au regard de l’article 3 de la Convention.
79. En second lieu, la Cour relève que les conditions matérielles de détention du requérant au sein du SMPR des Baumettes où il a séjourné à de nombreuses reprises ont été sévèrement critiquées par les autorités nationales, dont la Cour des comptes qui n’a pas hésité à les qualifier de conditions indignes (paragraphe 39 ci-dessus ; voir également, paragraphes 38 et 40 ci-dessus). Combinées à la rudesse du milieu carcéral (paragraphe 20 ci-dessus), ces conditions n’ont pu qu’aggraver son sentiment de détresse, d’angoisse et de peur.
80. Ensemble, et tout en étant consciente des efforts déployés par les autorités pour prendre en charge les troubles mentaux de l’intéressé et de la difficulté d’organiser des soins aux détenus souffrant de troubles mentaux (paragraphes 38, 40 et 41 ci-dessus), la Cour estime que ces éléments conduisent à considérer que le maintien en détention du requérant dans les conditions décrites ci-dessus, et sur une longue période, de 2005 à 2009, a entravé le traitement médical que son état psychiatrique exigeait et lui a infligé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (mutatis mutandis, Sławomir Musiał, précité, § 96).
81. La Cour rappelle que selon les Règles pénitentiaires européennes de 2006 (Recommandation REC(2006)2), les détenus souffrant de troubles mentaux graves doivent pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié (Point 12.1 de l’annexe à la Recommandation Rec (2006)2). Dans un arrêt récent, elle a attiré l’attention des autorités sur l’importance de ces recommandations, fussent-elles non contraignantes pour les Etats membres (Sławomir Musiał, précité, § 96).
82. Partant, la Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant et à la violation de l’article 3 de la Convention.
Arrêt SCOPPOLA c. ITALIE (No 4) du 17 juillet 2012 Requête no 65050/09
L'incompatibilité entre l'Etat du requérant et les moyens de la clinique de la prison de Parme est une violation de la Convention.
(a) Principes généraux
46. Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, 11 juillet 2006).
47. S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Riviere c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII). Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002‑IX).
48. Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel, précité, § 40), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76,15 janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
49. En appliquant les principes susmentionnés, la Cour a déjà conclu que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, et de surcroît malade, peut entrer dans le champ de protection de l’article 3 (Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI ; Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI, et Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). De plus, la Cour a jugé que maintenir en détention une personne tétraplégique, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001‑VII). Elle a aussi considéré que certains traitements peuvent enfreindre l’article 3 du fait qu’ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Cela étant, la Cour doit tenir compte, notamment, de trois éléments afin d’examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant, à savoir : a) la condition du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant (Sakkopoulos, précité, § 39).
(b) Application de ces principes au cas d’espèce
50. La Cour observe que la prison de Parme est dotée d’un centre clinique et d’une section pour handicapés, ce qui fait d’elle une structure pénitentiaire adaptée aux exigences des détenus atteints de pathologies dégénératives. Dans son arrêt du 10 juin 2008, la Cour avait salué le choix des autorités nationales de transférer le requérant dans cet établissement, compte tenu de l’impossibilité de le placer en détention à domicile (voir arrêt Scoppola, précité, § 49).
51. Cependant, force est de constater que cette structure s’est rapidement relevée inadaptée pour prendre en charge de façon adéquate le requérant, dont l’état de santé est particulièrement grave. La Cour rappelle que le requérant, qui n’a plus marché depuis 1987 et a subi, en avril 2006, une fracture du fémur, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Il manque de toute autonomie et est contraint de passer toutes ses journées au lit. Âgé de 72 ans, il souffre de pathologies cardiaques et du métabolisme, de diabète, d’un affaiblissement de sa masse musculaire empêchant la position assise, d’hypertrophie de la prostate et de dépression.
52. Ainsi, l’incompatibilité de la détention du requérant dans la prison de Parme avec son état de santé a été affirmée à plusieurs reprises par les juges de l’application des peines, lesquels se sont appuyés sur les conclusions des médecins de la prison.
53. Le 4 août 2009, le TAP de Bologne ordonna le placement du requérant dans un milieu extérieur à la prison. Selon la Cour, c’est à compter de cette date au moins que les autorités compétentes auraient dû tout mettre en œuvre pour garantir au requérant le placement dans un environnement idoine garantissant un suivi médical approprié. Or, malgré plusieurs sollicitations du tribunal (voir paragraphes 11-14 ci-dessus), et en dépit de l’indication d’une mesure provisoire de la part de la Cour (voir paragraphe 13 ci-dessus), celles-ci n’ont pas été en mesure de trouver un lieu d’accueil qui garantisse la santé et le bien-être du requérant. Ce n’est que le 7 janvier 2010 que le requérant quitta le milieu pénitentiaire, le TAP ayant décidé en dernier ressort d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine du requérant afin de permettre son placement à domicile dans un environnement hospitalier spécialisé.
54. La Cour ne sous-estime pas les difficultés liées à la prise en charge de détenus atteints de pathologies telles que celles souffertes par le requérant. Néanmoins, elle considère que les raisons avancées par le Gouvernement pour justifier le maintien du requérant dans la prison de Parme dans des conditions portant atteinte à sa dignité humaine pendant plusieurs mois en dépit des avis contraires des experts et des juges de l’application des peines, ne sauraient ni dispenser l’Italie de ses obligations face aux détenus malades ni être imputées au comportement de l’intéressé.
55. A ce dernier égard, concernant notamment le refus du requérant d’être transféré a l’hôpital civil de Parme, il est difficile pour la Cour de concevoir que ce refus ait été en mesure, en lui-même, d’entraver les efforts des autorités de trouver une structure adéquate. Il suffit à ce propos d’observer que ladite hospitalisation avait été envisagée par le TAP à titre provisoire, dans l’attente que le service sanitaire national trouve une solution définitive convenable, et dans le but de sortir d’une impasse installée depuis plusieurs mois.
56. En l’espèce, rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Cependant, s’agissant de l’obligation positive de l’État de protéger la santé des prisonniers de manière adéquate, qui comporte également une obligation de célérité, l’intentionnalité du comportement reproché à l’État défendeur ne saurait constituer un élément décisif. Ainsi, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III).
57. La Cour estime que la continuation du séjour du requérant au pénitencier de Parme dans les circonstances mentionnées plus haut n’a pu que le placer dans une situation susceptible de susciter, chez lui, des sentiments constants d’angoisse suffisamment forts pour constituer un « traitement inhumain ou dégradant », au sens de l’article 3 de la Convention. De surcroît, bien que la Cour soit appelée dans le cadre de la présente requête à se prononcer exclusivement sur la détention du requérant à Parme, elle ne saurait ignorer le fait que le requérant avait déjà été détenu dans des conditions jugées incompatibles avec la Convention. Cette circonstance n’a pu qu’aggraver ultérieurement le sentiment d’angoisse éprouvé par le requérant.
58. Compte tenu des éléments ci-dessus, la Cour estime que l’exception du Gouvernement tirée du défaut de la qualité de victime du requérant doit être rejetée et conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du traitement inhumain et dégradant subi par le requérant.
Arrêt KETREB c. FRANCE du 19 juillet 2012 Requête no 38447/09
La France continue d'incarcérer des malades mentaux au lieu de les soigner
108. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000‑XI, Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004, Rivière précité, § 9, et Renolde, précité, § 119).
109. La Cour a également affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (Kudła, précité, § 94). En particulier, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (voir notamment Aerts, précité, p. 1966, § 66, Keenan, précité § 111, Rivière, précité, § 63, et Renolde, précité, § 120).
110. Le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l’article 3 s’agissant de la protection de la dignité humaine, même si cette personne n’est pas en mesure, ou pas capable, d’indiquer des effets néfastes précis (Keenan, précité, § 113, et Renolde, précité, § 120).
111. Par ailleurs, le Comité européen de prévention contre la torture (CPT) a récemment souligné que, compte tenu des effets potentiels très dommageables de l’isolement, le principe de proportionnalité exige qu’il soit utilisé à titre de sanction disciplinaire seulement dans des cas exceptionnels, en tout dernier recours et pour la période de temps la plus brève possible. Le CPT considère que cette durée maximale ne devrait pas excéder quatorze jours pour une infraction donnée, et devrait de préférence être plus courte. Il a également souligné que le personnel de santé devait fournir aux détenus placés en isolement une assistance et une prise en charge médicales promptes, telles que nécessaires, et devait rendre compte au directeur de la prison dès lors que la santé d’un détenu est gravement mise en danger du fait de son placement à l’isolement (paragraphe 60 ci-dessus).
112. En l’espèce, la Cour renvoie à ses constats factuels dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 2, s’agissant notamment d’un trouble ancien de la personnalité, aggravé par une polytoxicomanie, dont souffrait Kamel Ketreb, de la mention de ses deux tentatives de suicide en quartier disciplinaire en janvier 1999 (paragraphe 13 ci-dessus), de la violence de sa réaction, pour le moins alarmante, lors de son placement en cellule disciplinaire le 20 mai 1999 (paragraphe 23 ci-dessus), ainsi que de ses blessures aux avant-bras (paragraphe 25 ci-dessus). Le comportement de Kamel Ketreb pendant cette période témoignait manifestement d’un profond mal être et d’une grande détresse, aggravés par le prononcé de sa condamnation et son placement en quartier disciplinaire. Sa lettre adressée à l’imam de la maison d’arrêt de la Santé, découverte près de son corps, en témoigne également (paragraphe 29 ci-dessus). Aux yeux des experts, cette lettre confirmait que Kamel Ketreb présentait un état dépressif ou un état profond de désarroi (paragraphe 37 ci-dessus).
113. Bien qu’elle soit consciente des difficultés auxquelles se heurtent les autorités pénitentiaires et de la nécessité de sanctionner les agressions visant les personnels de surveillance ou les codétenus, la Cour est frappée de voir qu’un placement en quartier disciplinaire de quinze jours a été prononcée à l’égard de Kamel Ketreb et que cette mesure a été maintenue, malgré l’aggravation préoccupante de son état psychique.
114. Certes, pour les experts, Kamel Ketreb ne souffrait pas d’un trouble mental chronique ou de troubles psychotiques aigus, à la différence respectivement de Mark Keenan et de Joselito Renolde (Keenan et Renolde, précités). Cependant, la Cour estime que ses antécédents suicidaires, son état psychique diagnostiqué par les médecins comme « borderline » ainsi que son comportement d’une extrême violence requéraient de la part des autorités une vigilance toute particulière et, à tout le moins, une consultation avec son psychiatre avant son placement en quartier disciplinaire et un suivi adapté durant son séjour. Ce type de mesure aurait permis de vérifier la compatibilité de l’état de santé mentale de Kamel Ketreb avec son placement en quartier disciplinaire et de lui dispenser les soins nécessaires et adéquats à son état. La Cour rappelle que, dans l’affaire Keenan, elle a constaté de graves lacunes dans les soins médicaux prodigués à un malade mental dont on connaissait les tendances suicidaires, dès lors que le requérant n’avait pas été surveillé de manière effective et que son état avait été apprécié et son traitement défini sans consultation de spécialistes en psychiatrie (Keenan, précité, § 116).
115. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le placement en cellule disciplinaire de Kamel Ketreb pendant quinze jours n’était pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’une personne atteinte de tels troubles mentaux. Cette sanction a constitué un traitement et une peine inhumains et dégradants (Keenan, précité, § 116 et Rivière, précité, § 76).
116. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Arrêt Cirillo C Italie du 29 janvier 2010, Requête 36276/10
UN DETENU QUI N'A PAS SES SEANCES DE KINESITHERAPIE SUBIT UNE VIOLATION DE l'ARTICLE 3
34. La Cour rappelle que pour qu’une peine ou un traitement puissent être qualifiés d’« inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation infligées à la victime doivent aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, CEDH 2006-IX).
35. Lorsqu’il s’agit en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, et Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
36. Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre le détenu en liberté ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne peut exclure que, dans des conditions particulièrement graves, on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que soient prises des mesures de nature humanitaire (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
37. La Cour note que le manque de soins médicaux appropriés peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Gennadiy Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière. L’efficacité du traitement dispensé présuppose ainsi que les autorités pénitentiaires offrent au détenu les soins médicaux prescrits par des médecins compétents (voir Soysal c. Turquie, no 50091/99, § 50, 3 mai 2007 ; Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 91, 24 mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3. En particulier, ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état particulier de santé du détenu (Serifis c. Grèce, no 27695/03, § 35, 2 novembre 2006; Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 106, 21 juillet 2005 ; Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, § 85, 11 mars 2004 ; Sediri c. France (déc.), no 4310/05, 10 avril 2007). En général, la dégradation de la santé du détenu ne joue pas, en soi, un rôle déterminant quant au respect de l’article 3 de la Convention. La Cour examinera à chaque fois si la détérioration de l’état de santé de l’intéressé était imputable à des lacunes dans les soins médicaux dispensés (voir Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 53, 12 juin 2008).
2. Application au cas d’espèce
38. Les doléances du requérant portent sur la qualité des soins qui lui sont dispensés à la prison de Foggia pour le traitement de sa pathologie.
La Cour observe que le requérant a demandé à plusieurs reprises que sa peine soit suspendue pour raisons médicales. Cependant, ni les médecins, ni les juges qui se sont occupés du cas du requérant n’ont conclu que l’état de santé de celui-ci est incompatible avec la détention ordinaire, affirmant au contraire que les soins nécessaires peuvent être administrés en milieu carcéral (a contrario, Scoppola c. Italie (no 4), no 65050/09, § 52, 17 juillet 2012). Dans ces conditions, la Cour ne peut pas conclure que le maintien en détention du requérant est incompatible en soi avec l’article 3 de la Convention.
39. En revanche, il est incontesté que le requérant souffre d’une pathologie invalidante qui nécessite un suivi médical intensif et régulier. Ainsi, la Cour se doit de rechercher si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration de soins médicaux appropriés.
40. Le requérant est atteint d’une paralysie subtotale du bras gauche accompagnée d’une limitation fonctionnelle sévère. En outre, il souffre de troubles anxieux et dépressifs. Les éléments du dossier démontrent que l’ensemble des médecins ayant examiné le requérant n’a cessé d’affirmer que la soumission à des cycles réguliers de kinésithérapie est nécessaire pour soulager les souffrances du requérant et pour empêcher la paralysie totale du tendon du bras. Les juges d’application des peines ont par ailleurs invité à deux reprises l’Administration pénitentiaire à tout mettre en œuvre pour garantir à M. Cirillo des séances continues de kinésithérapie (paragraphes 15 et 19 ci-dessus).
41. Le Gouvernement, qui ne conteste pas la gravité de l’état de santé du requérant et la nécessité de recevoir des soins réguliers, maintient que celui-ci a bénéficié depuis le début de sa détention d’un suivi adéquat et suffisant. Il en veut pour preuve devant la Cour le calendrier des séances de kinésithérapie administrées au cours des années 2010 et 2011. Par ailleurs, le Gouvernement estime qu’il appartiendrait au requérant d’indiquer les périodes pendant lesquelles il n’aurait pas eu accès aux soins et considère que l’État n’est pas tenu de se défendre de doléances formulées de manière imprécise.
42. Tout d’abord, concernant cette dernière affirmation du Gouvernement, la Cour, sensible à la vulnérabilité particulière des personnes se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’État, telles les personnes détenues, estime utile de rappeler ici que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). Lorsque le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant, le fait que, sans donner de justification satisfaisante, un gouvernement s’abstienne de fournir les informations en sa possession peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations en question (voir, entre autres, Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, § 426, 6 avril 2004 ; Flamînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, § 90, 12 avril 2011).
43. Quoi qu’il en soit, se bornant en l’espèce à l’examen des éléments présents dans le dossier et au-delà de toute autre considération, la Cour observe que le requérant a été soumis à dix séances de kinésithérapie en 2010 et à vingt séances en 2011 (voir paragraphes 20 et 31 ci-dessus). Or, la Cour n’est pas du même avis que le Gouvernement et considère que ces informations incontestées prouvent, contrairement aux affirmations du Gouvernement, que le requérant n’a pu accéder que de manière sporadique aux soins dont il aurait besoin de façon assidue et constante.
44. S’il est vrai que le dossier médical du requérant démontre que celui-ci a été examiné à maintes reprises par les médecins, comme le fait valoir le Gouvernement, la Cour rappelle qu’il n’est guère suffisant que le détenu soit examiné et un diagnostic établi. En vue de la sauvegarde du prisonnier, il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mis en œuvre (Poghossian c. Géorgie, no 9870/07, § 59, 24 février 2009 ; Raffray Taddei c. France, no 36435/07, § 59, 21 décembre 2010).
45. La Cour observe ensuite que l’affirmation du requérant concernant l’insuffisance des soins médicaux appropriés semble être confirmée également par le certificat de la direction sanitaire de la prison de Foggia du 6 avril 2011, reconnaissant la difficulté pour le requérant d’avoir accès aux soins en raison du grand nombre de demandes et du surpeuplement régnant dans l’établissement (voir paragraphe 17 ci-dessus).
La Cour ne sous-estime pas les difficultés de garantir aux personnes détenues des soins spécialisés intensifs et réguliers, notamment dans une situation de surpeuplement carcéral. Cependant, elle estime que les dysfonctionnements structurels du système pénitentiaire ne dispensent pas l’État de ses obligations face aux détenus malades.
46. Aux yeux de la Cour, la pathologie présentée par le requérant et l’inadéquation de la prison de Foggia auraient dû pour le moins conduire les autorités à transférer ce dernier dans un établissement garantissant des soins adaptés afin d’exclure tout risque de traitements inhumains, conformément aux recommandations émises par les juges d’application des peines.
47. Enfin, concernant l’argument selon lequel le requérant aurait empêché les démarches des autorités par son manque de collaboration, la Cour note que le Gouvernement s’est borné à faire référence de manière vague à certains refus que l’intéressé aurait opposés aux traitements, sans préciser la portée desdits refus ni produire de documents à l’appui de son affirmation. D’ailleurs, rien dans le dossier ne prouve que le comportement du requérant ait entravé l’action des autorités compétentes et ait été la cause du dysfonctionnement dans son suivi médical.
48. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce, les autorités ont failli à leur obligation d’assurer au requérant le traitement médical adapté à sa pathologie. Elle considère que l’épreuve que le requérant a subie de ce fait a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et a constitué un « traitement inhumain ou dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention. A cet égard, la Cour ne perd pas de vue que le requérant est atteint également de troubles psychologiques.
La Cour admet qu’en l’espèce, rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (mutatis mutandis, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III).
49. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
CONTRADA C. ITALIE (N°2) Requête 7509/08 du 11 février 2014
Le requérant est resté trop longtemps en détention alors que sa santé ne le permettait plus.
a) Principes généraux
75. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, § 30). Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », en considérant toutefois qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
76. Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, 11 juillet 2006).
77. S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, et Riviere c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Gennadi Naumenko précité, § 112).
78. La Cour doit tenir compte, notamment, de trois éléments afin d’examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant, à savoir : a) la condition du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant (voir Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 53, 2 décembre 2004, et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 39, 15 janvier 2004).
b. Application de ces principes au cas d’espèce
79. Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
80. La Cour note tout d’abord qu’il ne fait pas de doute que le requérant était affecté par plusieurs pathologies graves et complexes (voir paragraphes 33, 36, 38 et 51 ci-dessus).
81. Elle relève ensuite que le requérant a introduit une première demande afin d’obtenir la suspension de l’exécution de sa peine ou sa détention à domicile le 24 octobre 2007. Sept autres demandes suivirent ; tout comme la première, elles furent à chaque fois rejetées. Ce n’est que le 24 juillet 2008 que le tribunal de l’application des peines accorda au requérant la détention au domicile.
82. La Cour relève que, au cours de la procédure, dix rapports ou certificats médicaux, rédigés par des médecins désignés par le requérant aussi bien que par des praticiens du centre sanitaire de l’établissement pénitentiaire où le requérant était détenu, ont été déposés devant les instances compétentes. Ces documents concluaient, de manière constante et univoque, à l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec le régime de détention auquel il était soumis.
83. Tout en prenant note du fait que le requérant a finalement obtenu le régime de la détention à domicile en 2008, la Cour relève que celle-ci n’a été octroyée que neuf mois après sa première demande.
84. La Cour note en outre que les conclusions des autorités internes selon lesquelles les pathologies du requérant n’étaient, d’une part, pas graves (voir la décision du juge d’application des peines du 12 décembre 2007) et, d’autre part, pas « impossible[s] ou extrêmement difficile[s] » à traiter en prison (voir les décisions du juge du 28 décembre 2007 et du 7 janvier 2008) semblent être sujettes à caution, compte tenu notamment des résultats des examens médicaux auquel le requérant a été soumis à maintes reprises.
85. La Cour en conclut que, au vu du contenu des certificats médicaux dont les autorités disposaient, du temps s’étant écoulé avant l’obtention de la détention à domicile et des motifs des décisions de rejet des demandes introduites par le requérant, le maintien en détention de ce dernier était incompatible avec l’interdiction des traitements inhumains et dégradants établie par l’article 3 de la Convention (voir Farbtuhs, précité, §§ 55-61 ; Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, §§ 71-72, 10 mars 2009 ; Scoppola c. Italie, no 50550/06, §§ 45-52, 10 juin 2008 et Cara-Damiani c. Italie, no 2447/05, §§ 69-78, 7 février 2012). Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Arrêt CG C. Italie du 22 avril 2014 requête 73869/10
Violation de l'article 3 de la Convention : Les soins ont été apportés avec un retard de plusieurs mois à une personne d'âge avancée détenue en Italie. La CEDH prévient que cette condamnation est de sa part un "service minimum".
i. Principes généraux
51. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001‑VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002‑IX, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV).
52. Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, 11 juillet 2006).
53. S’agissant en particulier des personnes privées de liberté, l’article 3 de la Convention impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, et Riviere c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000‑VII, et Gennadi Naoumenko, précité, § 112). Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (Mouisel, précité, § 40).
54. Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel, précité, § 40, et Tellissi c. Italie (déc.), no 15434/11, § 27, 5 mars 2013), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
55. Faisant application des principes susmentionnés, la Cour a déjà conclu que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, et de surcroît malade, peut entrer dans le champ de protection de l’article 3 de la Convention (Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001‑VI, Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001‑VI, et Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). De plus, elle a jugé que le maintien en détention d’une personne tétraplégique dans des conditions inadaptées à son état de santé était constitutif d’un traitement dégradant (Price, précité, § 30). Elle a aussi considéré que certains traitements peuvent enfreindre l’article 3 de la Convention en raison de leur infliction à une personne souffrant de troubles mentaux (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001‑III). Cela étant, la Cour doit tenir compte, notamment, de trois éléments afin d’examiner la compatibilité du maintien en détention d’un requérant avec un état de santé préoccupant, à savoir la condition du détenu, la qualité des soins dispensés et l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant (Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 53, 2 décembre 2004, et Sakkopoulos, précité, § 39).
ii. Application de ces principes à la présente espèce
56. La Cour relève tout d’abord que devant elle le requérant n’a pas soutenu que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention. La seule question posée en l’espèce est celle de savoir si les soins administrés en prison ont été adéquats, compte tenu de l’exigence de protéger l’intégrité physique de l’intéressé (Tellissi, décision précitée, § 29).
57. À cet égard, la Cour note que le requérant affirme avoir informé l’administration du pénitencier de sa pathologie (relâchement du sphincter anal et problèmes d’incontinence) dès son arrivée à la prison de Bellizzi Irpino, le 8 octobre 2009 (paragraphe 7 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, elle estime que la gravité de la situation aurait dû être claire pour les autorités au plus tard à partir du 20 novembre 2009, date de la première tentative de suicide du requérant (paragraphe 12 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, ce geste, qui était directement lié à un épisode d’incontinence survenu lors d’un cours scolaire, ne pouvait que montrer le désarroi, l’angoisse et l’humiliation que le requérant ressentait à cause de sa pathologie et de ses manifestations en public.
58. En dépit de cela, la Cour constate que la manométrie du sphincter anal et l’examen des selles, qui auraient permis de tester les conditions de santé du requérant et qui avaient été ordonnés le 30 octobre 2009, n’ont été effectués que le 10 février 2010 (paragraphe 9 ci-dessus) et qu’un examen gastroentérologique prévu pour le 2 février 2010 n’a été réalisé que le 3 juillet 2010 (paragraphe 20 ci-dessus). Elle observe que dix mois et demi se sont ensuite écoulés avant l’accomplissement d’une nouvelle manométrie du sphincter (le 20 mai 2011) et que, à cette occasion, un médecin de l’hôpital public avait répété la recommandation faite par le médecin de la prison le 5 avril 2011, à savoir la soumission du requérant à un traitement de rééducation pelvi-périnéale dit « biofeedback ». Elle note aussi que les parties s’accordent à considérer que ce traitement a amélioré l’état de santé du requérant et a permis de traiter de manière significative ses problèmes d’incontinence, mais elle relève qu’il n’a été suivi par l’intéressé que du 23 août au 13 novembre 2012 (paragraphe 23 ci-dessus), soit un an et trois mois après avoir été ordonné par le médecin de l’hôpital public.
59. À ce titre, la Cour note que le Gouvernement affirme que ce dernier retard ne saurait être imputé à l’administration pénitentiaire, mais à celle de l’hôpital public d’Avellino (paragraphe 45 ci-dessus). Elle considère qu’elle n’a pas à se pencher sur cette question puisque, en tout état de cause, il appartenait à l’État d’organiser ses différents services et branches de manière à protéger de façon adéquate et efficace l’intégrité physique et psychique du requérant.
60. Par ailleurs, la Cour ne sous-estime pas certains des efforts faits par les autorités internes aux fins d’assurer un suivi de la situation du requérant, à savoir notamment son placement occasionnel dans des cellules individuelles et, avec son consentement, à l’infirmerie, ainsi que la possibilité qui lui a été accordée de prendre une douche par jour, de même que l’intervention du personnel de la prison en temps utile et de manière efficace afin d’éviter toute séquelle consécutive aux tentatives de suicide de l’intéressé. Elle note qu’il n’en demeure pas moins qu’il a fallu attendre plus de deux ans et neuf mois entre la première tentative de suicide (le 20 novembre 2009) et le début du cycle de rééducation qui a finalement pu résoudre les problèmes d’incontinence du requérant (le 23 août 2012). À supposer même que, comme le soutient le Gouvernement, la participation du requérant à ce traitement demandait une certaine organisation, au vu notamment de la nécessité d’assurer le transport de l’intéressé de la prison à l’hôpital public, la Cour estime qu’un tel délai ne saurait passer pour raisonnable et ne saurait être accepté dans les circonstances particulières de la présente affaire, compte tenu notamment de la nature de la pathologie du requérant ainsi que de l’état psychologique en découlant et ressortant de ses deux tentatives de suicide avérées (voir, a contrario, Tellissi, décision précitée, §§ 31-36). Elle rappelle par ailleurs qu’une violation de l’article 3 de la Convention peut subsister même en l’absence de l’intention d’humilier ou de rabaisser le requérant (Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001‑III, et Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 118, CEDH 2006‑IX).
61. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le manque prolongé de soins adaptés à la pathologie du requérant a placé ce dernier dans une situation susceptible de susciter, chez lui, des sentiments constants d’angoisse, d’infériorité et d’humiliation suffisamment forts pour constituer un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention. Bien que dans une lettre du 31 mai 2013 l’intéressé lui-même ait admis être « guéri » (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour relève qu’aucune mesure de réparation ne lui a été offerte pour la longue période au cours de laquelle il est resté dans l’attente d’un traitement médical adéquat. Par conséquent, elle estime que la demande du Gouvernement visant à l’obtention de la radiation de l’affaire du rôle (paragraphe 50 ci-dessus) au motif que le litige aurait été résolu ne saurait être acceptée.
62. Ces constats suffisent pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
63. Cette conclusion dispense la Cour de se pencher sur la question de savoir si cette disposition a également été violée en raison du placement du requérant dans un secteur d’isolement de la prison de Bellizzi Irpino et du refus de l’administration de lui fournir gratuitement des couches.
CARRELLA C. ITALIE du 9 septembre 2014 requête 33955/07
Non violation de l'article 3 : Le requérant détenu a été soigné, bon d'accord il a été soigné en retard, mais il est détenu. Il a déjà bien de la chance d'avoir été soigné. Bon d'accord il est mort mais il serait mort dehors quelques années plus tard !
i. Principes généraux
65. La Cour renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001‑VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002‑IX, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV).
66. La Cour rappelle que, pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, 11 juillet 2006).
67. S’agissant en particulier des personnes privées de liberté, elle rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, et Riviere c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates peuvent en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000‑VII, et Gennadi Naoumenko, précité, § 112). Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (Mouisel, précité, § 40).
68. La Cour rappelle de plus que les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel, précité, § 40, et Tellissi c. Italie (déc.), no 15434/11, § 27, 5 mars 2013), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
69. Quant à l’étendue de la protection de l’intégrité d’un détenu atteint d’une maladie, l’article 3 de la Convention exige l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière. L’efficacité du traitement dispensé présuppose ainsi que les autorités pénitentiaires offrent au détenu les soins médicaux prescrits par des médecins compétents (Soysal c. Turquie, no 50091/99, § 50, 3 mai 2007, et Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 91, 24 mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3 de la Convention. En particulier, ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état de santé du détenu concerné (Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, § 85, 11 mars 2004, Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 106, 21 juillet 2005, Serifis c. Grèce, no 27695/03, § 35, 2 novembre 2006, et Sediri c. France (déc.), no 4310/05, 10 avril 2007). En général, la dégradation de la santé du détenu ne joue pas, en soi, un rôle déterminant quant au respect de l’article 3 de la Convention. La Cour examinera à chaque fois si la détérioration de l’état de santé de l’intéressé était imputable à des lacunes dans les soins médicaux dispensés (Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 53, 12 juin 2008).
La Cour estime que les critères ainsi rappelés sont également pertinents dans la présente affaire.
ii Application de ces principes à la présente espèce
70. La Cour relève tout d’abord que le requérant n’a pas soutenu devant elle que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention. La seule question posée en l’espèce est celle de savoir si les soins administrés en prison ont été adéquats, compte tenu de l’exigence de protéger l’intégrité physique de l’intéressé (Tellissi, décision précitée, § 29).
71. À cet égard, la Cour constate que, dans son rapport du 17 juillet 2006, l’expert nommé par la cour d’appel a indiqué comme très souhaitable de soumettre le requérant à un examen coronarographique dans une structure hospitalière externe si les médecins en service dans le pénitencier estimaient aussi que cela était nécessaire et possible. Elle note que le service médical de la prison a programmé une visite cardiologique et un électrocardiogramme pour le 21 juillet 2006 à la clinique universitaire de Naples, que le requérant n’a pas été conduit à la clinique le 21 juillet comme prévu mais le 21 août suivant et qu’ensuite une nouvelle visite cardiologique avec un nouvel électrocardiogramme ont été programmés pour le 15 novembre 2006. Entre-temps, une coronarographie a été programmée pour le 13 octobre 2006.
72. La Cour observe aussi que, à la veille de l’examen coronarographique, la structure hospitalière a été jugée inadéquate à l’accueil du requérant pour des raisons de sécurité, qu’une autre structure hospitalière a été choisie et que la date de l’examen a été fixée au 6 février 2007. Elle note ces retards dans le déroulement de l’examen du requérant. Cependant, elle estime que ces inconvénients ne sauraient, à eux seuls, être constitutifs d’un traitement interdit par l’article 3 de la Convention, d’autant plus que le 17 juillet 2006, les conditions médicales du requérant n’étaient pas inquiétantes, l’examen indiqué n’était pas urgent et le retard n’a pas eu des conséquences négatives pour sa santé.
73. A cet égard, elle note également que la cour d’appel a décidé de se prononcer sur la demande de suspension de la détention pour raisons de santé après le déroulement de la coronoragrophie et que, le 6 novembre 2006, le requérant a bénéficié de la détention à domicile.
74. Elle observe en outre que le 27 novembre 2006, en raison de son état de santé, le requérant a passé l’examen coronarographique dans une structure hospitalière privée et qu’à l’issue de cet examen il a été soumis à une intervention chirurgicale d’angioplastie des coronaires.
75. La Cour note que le dossier médical du requérant démontre que depuis 2005 celui-ci a été examiné par les médecins à l’intérieur et à l’extérieur de la prison et qu’il a été constamment soumis à des contrôles médicaux. De plus, il a été assigné à domicile en raison de son état de santé et a pu choisir une structure hospitalière où se soumettre audit examen.
76. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis qu’en dépit de certains retards, les autorités ont satisfait à l’obligation qui est la leur de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration des contrôles médicaux appropriés.
77. Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que le traitement dont le requérant a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, il n’y a pas eu violation de cette disposition en son volet matériel.
FRANCE
UN CHANGEMENT DE CELLULE POUR NE PAS LIBERER
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 13 avril 2021, pourvoi n° 21-80.728 Rejet
25. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, en cours de publication) que le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’il incombe à ce juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.
26. Pour rejeter le moyen pris de conditions indignes de détention de M. X..., l’arrêt attaqué énonce, au vu d’un rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Seysses du 11 janvier 2021, transmis suite à l’arrêt avant dire droit de la chambre de l’instruction en date du 5 janvier 2021 ayant ordonné des vérifications sur ce point, que celui-ci est affecté dans une cellule de 10,7 m², soit 4,45 m² par détenu, hors sanitaire, occupée par deux personnes et dont l’état général est globalement très correct, hormis la dégradation d’une partie des joints du haut de la fenêtre.
27. Les juges ajoutent que ce rapport fait état d’une température conforme à la température exigée dans les lieux d’habitation collectifs (au moins 19°) et de ce que le détenu dispose normalement d’eau chaude, de deux couvertures et de vêtements qu’il a reçus en septembre et décembre 2020.
28. Ils relèvent, encore, d’une part, que M. X... est hébergé dans l’aile travailleur depuis le 10 juillet 2020 avec un codétenu dont il ne s’est jamais plaint et, d’autre part, qu’il participe aux activités sportives et bénéficie d’un promenade quotidienne d’une heure.
29. Ils précisent, en outre, que l’intéressé n’a jamais évoqué la présence de nuisibles, faisant , au contraire, état de l’hygiène irréprochable de sa cellule.
30. Les juges en concluent que les conditions de détention de M. X... ne peuvent être considérées comme indignes et justifier sa mise en liberté.
31. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a appliqué les principes et normes définis par la Cour européenne des droits de l’homme, en a exactement déduit que les conditions de détention de l’intéressé ne caractérisaient pas un traitement inhumain ou dégradant, les deux griefs tirés, d’une part, du caractère ponctuel et non contradictoire du relevé de température effectué dans la cellule de M. X..., et, d’autre part, de l’inondation que provoquerait la pluie en raison de la défectuosité du joint de fenêtre, inondation dont il n’est pas allégué qu’elle ait été signalée à l’administration, n’étant pas de nature à remettre en cause l’appréciation des conditions de détention de l’intéressé prise dans sa globalité.
32. Ainsi, le moyen doit être écarté.
33. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
UN INDIVIDU MALADE DOIT ÊTRE LIBERE.
Article. 147-1 du Code de Procédure Pénale
En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction,
la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale
établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le
maintien en détention. La mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.
En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans
laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en
détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies.
Recommandations en urgence du 1er février 2018 de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté relatives au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (Loire)
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté : Avis du 16 juin 2015 relatif à la prise en charge des personnes détenues au sein des établissements de santé.
LAISSER UN INDIVIDU SANS RESSOURCES FINANCIERES
APRES UNE DETENTION EST UNE VIOLATION
L'arrêt MSS C. Grèce et Belgique prévoit que laisser un individu dans le dénuement est une violation de l'article 3.
Cet arrêt est malheureusement resté une exception due à des circonstances particulières. Même après une détention arbitraire, laisser un individu sans ressources n'est pas une violation de l'article 3. Les États européens restent à l'état sauvage, pour cause de crise.
L'arrêt N.T.P et autres c. France du 24 mai 2018 requête 68862/13 prévoit que le seuil de dénuement n'a pas été atteint pour considérer qu'il y a violation de l'article 3.
L'arrêt F H C. GRÈCE requête 78456/11 du 31 juillet 2014 revient à la solution de l'arrêt MSS C. Grèce et Belgique
ARRÊT DE LA GRANDE CHAMBRE M.S.S contre Grèce et Belgique requête 30696/09 du 21 janvier 2011
Contre la Grèce
On ne peut tirer de l’article 3 un devoir général pour les Etats membres de fournir aux réfugiés une assistance financière afin qu’ils puissent maintenir un certain niveau de vie. La Cour considère cependant que la situation dans laquelle s’est trouvé le requérant est d’une particulière gravité. En dépit des obligations qui pesaient sur les autorités grecques, en vertu des termes mêmes de la législation nationale et de la directive Accueil de l’UE, il a vécu pendant des mois dans le dénuement le plus total, sans pouvoir faire face à ses besoins les plus élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. A cela s’ajoutait la crainte d’être attaqué et volé. Le récit de l’intéressé est corroboré par les rapports de plusieurs organes et organisations internationaux, notamment du Commissaire aux Droits de l’homme du Conseil de l’Europe et du HCR.
Les autorités n’ont pas dûment informé le requérant d’éventuelles possibilités de logement. La notification qu’il a reçue, par laquelle il était informé de l’obligation de se rendre à la préfecture de police pour déclarer son adresse de résidence, ne peut raisonnablement être considérée comme une indication qu’il lui fallait déclarer aux autorités qu’il n’avait nulle part où aller. En toute hypothèse, la Cour ne voit pas comment les autorités pouvaient ne pas supposer qu’il était sans domicile. Le Gouvernement reconnaît lui-même disposer de moins de 1 000 places dans des centres d’accueil pour faire face à l’hébergement de dizaines de milliers de demandeurs d’asile. Ces données relativisent considérablement l’argument du gouvernement grec selon lequel la passivité du requérant est à l’origine de sa situation.
La situation dont se plaint le requérant dure depuis son transfert en Grèce en juin 2009 et elle est liée à son statut de demandeur d’asile. Si elles avaient examiné promptement sa demande d’asile, les autorités auraient pu lui éviter bon nombre de souffrances. Il s’ensuit que, par leur fait, le requérant s’est trouvé dans une situation contraire à l’article 3. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
L'Arrêt de la CEDH
249. La Cour a déjà rappelé les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence relative à l'article 3 de la Convention et qui s'appliquent en l'espèce (paragraphes 216-222 ci-dessus). Elle estime également nécessaire de rappeler que l'article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (Chapman, précité, § 99). Il ne saurait non plus être tiré de l'article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 85, 26 avril 2005).
250. La Cour est cependant d'avis que la question à trancher en l'espèce ne se pose pas en ces termes. A la différence de l'affaire Müslim (précitée, §§ 83 et 84), l'obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes aux demandeurs d'asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités grecques en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit communautaire, à savoir la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (dite « directive Accueil », paragraphe 84 ci-dessus). Ce que le requérant reproche aux autorités grecques en l'espèce, c'est l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, de par leur action ou leurs omissions délibérées, de jouir en pratique de ces droits afin de pourvoir à ses besoins essentiels.
251. La Cour accorde un poids important
au statut du requérant qui est demandeur d'asile et appartient de ce fait à
un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable qui a
besoin d'une protection spéciale (voir, mutatis mutandis, Oršuš et autres
c. Croatie [GC],
no
15766/03, § 147, CEDH 2010-...). Elle note que ce besoin d'une protection
spéciale fait l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et
européenne comme cela ressort de la Convention de Genève, du mandat et des
activités du HCR ainsi que des normes figurant dans la directive Accueil de
l'Union européenne.
252. Ceci étant dit, la Cour doit déterminer si une situation de dénuement matériel extrême peut soulever un problème sous l'angle de l'article 3.
253. La Cour rappelle qu'elle n'a pas exclu « la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'article 3] par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l'aide publique serait confronté à l'indifférence des autorités alors qu'il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine » (Budina c. Russie, déc., no45603/05, CEDH 2009 -...).
254. Elle constate que la situation dans laquelle s'est trouvé le requérant est d'une particulière gravité. Il explique avoir vécu pendant des mois dans le dénuement le plus total et n'avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. A cela s'ajoutait, l'angoisse permanente d'être attaqué et volé ainsi que l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer. C'est pour en finir avec cette situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique qu'il a tenté à plusieurs reprises de quitter la Grèce.
255. La Cour note dans les observations du Commissaire européen aux Droits de l'Homme et du HCR ainsi que dans les rapports des organisations non gouvernementales (paragraphe 160 ci-dessus) que la situation décrite par le requérant est un phénomène à grande échelle et correspond à la réalité pour un grand nombre de demandeurs d'asile présentant le même profil que le requérant. Pour cette raison, la Cour ne met pas en doute les allégations de celui-ci.
256. Le Gouvernement grec soutient toutefois que le requérant est responsable de sa situation, que les autorités ont agi avec toute la diligence nécessaire et qu'il lui appartenait de se montrer proactif pour améliorer sa situation.
257. Une controverse existe entre les parties au sujet de la remise au requérant de la brochure d'information destinées aux demandeurs d'asile. La Cour n'en aperçoit toutefois pas la pertinence puisque cette brochure n'indique pas que les demandeurs d'asile ont la possibilité de déclarer à la police qu'ils sont sans domicile et ne contient aucune information sur l'hébergement. Quant à la notification reçue par le requérant l'informant de l'obligation de se rendre à la préfecture de police de l'Attique pour déclarer son adresse de résidence (paragraphe 35 ci-dessus), la Cour est d'avis qu'elle est ambigüe et ne peut raisonnablement être considérée comme une information suffisante. Elle constate que le requérant n'a, à aucun moment, été dûment informé des possibilités de logement qui s'offraient à lui, à supposer qu'elles existent réellement.
258. La Cour n'aperçoit de toute façon pas comment les autorités pouvaient ignorer ou ne pas supposer que le requérant était sans domicile en Grèce. Elle relève que, selon le Gouvernement, il y a à ce jour moins de 1 000 places dans des centres d'accueil pour faire face à l'hébergement de dizaines de milliers de demandeurs d'asile. Elle note également que, selon le HCR, il est notoire qu'à ce jour un demandeur d'asile de sexe masculin et d'âge adulte n'a à peu près aucune chance de recevoir une place dans un centre d'accueil et que d'après une étude menée de février à avril 2010, tous les demandeurs d'asile « Dublin » interrogés par le HCR étaient sans-abri. Ceux-ci vivent donc en grand nombre, à l'instar du requérant, dans des parcs ou des immeubles désaffectés (paragraphe 169, 244 et 245 ci-dessus).
259. Bien que la Cour ne soit pas en mesure de vérifier l'exactitude des propos du requérant quand il soutient avoir informé à plusieurs reprises les autorités grecques de sa situation avant décembre 2009, les données précitées sur la capacité d'accueil relativisent l'argument du Gouvernement selon lequel la passivité du requérant est à l'origine de sa situation. En tout état de cause, étant donné la précarité et la vulnérabilité particulières et notoires des demandeurs d'asile en Grèce, la Cour est d'avis que les autorités grecques ne pouvaient se contenter d'attendre que le requérant prenne l'initiative de s'adresser à la préfecture de police pour pourvoir à ces besoins essentiels.
260. La circonstance selon laquelle un hébergement en centre d'accueil aurait entre-temps été trouvé ne change pas la situation du requérant puisqu'à ce jour, aucune voie de communication n'a été établie par les autorités pour l'en informer. Cette situation est d'autant plus préoccupante que cette information figurait déjà dans les observations du Gouvernement soumises à la Cour le 1er février 2010 et que, devant la Grande Chambre, le Gouvernement a indiqué avoir rencontré le requérant le 21 juin 2010 et lui avoir remis en mains propres une convocation sans toutefois l'informer qu'un logement avait été trouvé.
261. Il n'apparaît pas non plus à la Cour que la possession d'une carte rose ait été ou ait pu être d'une quelconque utilité en pratique au requérant. La loi prévoit certes que, munis de la carte rose, les demandeurs d'asile ont accès au marché du travail, ce qui aurait permis au requérant d'essayer de mettre un terme à sa situation et de pourvoir à ses besoins essentiels. Là encore, il ressort des rapports consultés, que pratiquement, l'accès au marché du travail comporte tant d'obstacles administratifs qu'il ne peut être considéré comme une alternative réaliste (paragraphes 160 et 172 ci-dessus). A cela s'ajoutent les difficultés personnelles dues à l'absence de connaissance de la langue grecque par le requérant et à l'absence de tout réseau de soutien ainsi que le contexte général de crise économique.
262. Enfin, la Cour note que la situation dans laquelle se trouve le requérant dure depuis son transfert en Grèce en juin 2009, qu'elle est liée à son statut de demandeur d'asile et au fait que sa demande d'asile n'a pas encore été examinée par les autorités grecques. En d'autres termes, la Cour est d'avis que ces dernières auraient pu, si elles avaient agi avec célérité dans l'examen de la demande d'asile du requérant, abréger substantiellement ses souffrances.
263. Au vu de ce qui précède et compte tenu des obligations reposant sur les autorités grecques en vertu de la directive européenne Accueil (paragraphe 84 ci-dessus), la Cour est d'avis qu'elles n'ont pas dûment tenu compte de la vulnérabilité du requérant comme demandeur d'asile et doivent être tenues pour responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles il s'est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d'aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels. La Cour estime que le requérant a été victime d'un traitement humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez lui des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère que de telles conditions d'existence, combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention.
264. Il s'ensuit que le requérant a s'est retrouvé, par le fait des autorités, dans une situation contraire à l'article 3 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
Contre la Belgique
La Cour a déjà conclu au caractère dégradant des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu et a vécu en Grèce. Ces faits étaient bien connus et aisément vérifiables à partir de nombreuses sources avant le transfert de l’intéressé. Dès lors, la Cour considère qu’en expulsant le requérant vers la Grèce, les autorités belges l’ont exposé en connaissance de cause à des conditions de détention et d’existence constitutives de traitements dégradants, en violation de l’article 3.
Arrêt de la CEDH
362. Le requérant allègue qu'en le renvoyant en Grèce en application du règlement « Dublin » les autorités belges l'ont exposé, en raison des conditions de détention et d'existence réservées aux demandeurs d'asile, à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention précité.
363. Le Gouvernement conteste cette thèse de la même manière qu'il s'oppose à voir une violation de l'article 3 du chef de l'expulsion du requérant et du risque subséquent résultant de la défaillance de la procédure d'asile.
364. La Cour considère que le requérant formule sur le terrain de l'article précité de la Convention des allégations posant des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées qu'après un examen au fond de la requête. Il s'ensuit que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé, elle doit être déclarée recevable.
365. Sur le fond, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'expulsion d'un demandeur d'asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité de l'État en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ce cas, l'article 3 implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, §§ 90-91, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 125, § 103, H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, § 34, Jabari précité, § 38, Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 135, CEDH 2007-I (extraits), no 1948/04, Saadi précité, § 152).
366. En l'espèce, la Cour a déjà conclu
au caractère dégradant des conditions de détention qu'a subies le requérant
et les conditions dans lesquelles il a vécu en Grèce (paragraphes 233, 234,
263 et 264 ci-dessus). Elle relève que, avant le transfert du requérant, ces
faits étaient notoires et faciles à vérifier à partir d'un grand nombre de
sources (paragraphes
162-164 ci-dessus). Elle tient également à souligner qu'il ne saurait
d'aucune manière être reproché au requérant de ne pas avoir informé les
autorités administratives belges des raisons pour lesquelles il ne
souhaitait pas être transféré en Grèce. Elle a en effet constaté que la
procédure devant l'Office des étrangers ne permettait pas d'en faire état et
que les autorités belges appliquaient le règlement « Dublin » de façon
automatique (paragraphe 352 ci-dessus).
367. Se fondant sur ces conclusions et les devoirs qui pèsent sur les Etats en vertu de l'article 3 de la Convention en matière d'expulsion, la Cour considère qu'en expulsant le requérant vers la Grèce, les autorités belges l'ont exposé en pleine connaissance de cause à des conditions de détention et d'existence constitutives de traitements dégradants.
368. Dès lors il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
N.T.P et autres c. France du 24 mai 2018 requête 68862/13
Article 3 : situation de dénuement après une rétention administrative. Les requérants n'étaient pas dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3. Ils pouvaient répondre aux besoins essentiels, se nourrir, le laver, se loger.
a) Principes généraux
42. La Cour a dit à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (M.S.S., précité, § 219, Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 114, 17 juillet 2014, et Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, § 94, CEDH 2014 (extraits).
43. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M.S.S., précité, § 220, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 202, CEDH 2012, et Svinarenko et Slyadnev, précité, § 115).
44. Dans les affaires relatives à l’accueil d’étrangers mineurs, accompagnés ou non accompagnés, il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, no 41442/07, § § 55 et 63, 19 janvier 2010, Kanagaratnam c. Belgique, no 15297/09, § 62, 13 décembre 2011, et Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 91, 19 janvier 2012).
b) Application des principes en l’espèce
45. La Cour note tout d’abord qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été hébergés du 21 août 2013 au 21 novembre 2013, dans un foyer géré par une association, exclusivement financée par des fonds publics. Les conditions d’hébergement (voir paragraphe 36 ci‑dessus), incluent un repas du soir et un petit déjeuner. La Cour ne néglige pas le fait que le foyer des Creusots ne pouvait offrir qu’un hébergement de nuit et que les première et quatrièmes requérantes ne disposaient pas d’un logement en journée mais cherchaient à trouver refuge dans les locaux d’une association (voir paragraphe 36 ci‑dessus). Pour autant, la Cour constate que les deuxième et troisième requérants ont été scolarisés en école maternelle, déjeunaient à la cantine et ont pu bénéficier des activités extra‑scolaires organisées par la commune de Dijon. La Cour note, également que les requérants ont également perçu l’aide d’autres organisations non‑gouvernementales comme les Restaurants du cœur et la Croix‑Rouge (voir paragraphe 15 ci‑dessus). Les requérants ne contestent par ailleurs pas avoir bénéficié d’un suivi médical, financé par les autorités publiques (voir paragraphe 41 ci‑dessus).
46. La Cour ne saurait donc assimiler la situation des requérants à celle de l’arrêt Rahimi c. Grèce (no 8687/08, 5 avril 2011). Dans cette dernière affaire, le requérant était un mineur non accompagné, abandonné à lui‑même après sa libération et dont l’« hébergement et, en général, [la] prise en charge ont été assurés uniquement par des organisations non gouvernementales locales à Lesbos ou à Athènes (...) (Rahimi, précité, §92). La Cour avait conclu dans cette affaire « qu’en raison du comportement des autorités qui ont fait preuve d’indifférence à l’égard du requérant, celui-ci a dû subir une angoisse et une inquiétude profondes» (même arrêt, § 92).
47. La Cour constate qu’il ne saurait être reproché aux autorités françaises, en l’espèce, d’être restées indifférentes à la situation des requérants qui ont pu faire face à leurs besoins élémentaires : se nourrir, se laver et se loger (M.S.S, précité, § 254, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 283, 28 juin 2011, F.H. c. Grèce, no 78456/11, § 107, 31 juillet 2014, Amadou c. Grèce, no 37991/11, § 58, 4 février 2016).
48. En tout état de cause, la Cour constate également que, contrairement à d’autres affaires (voir notamment M.S.S., précité, § § 254‑263 et Sufi et Elmi, précité, § 291), les requérants n’étaient pas dénués de perspective de voir leur situation s’améliorer. En effet, la première requérante avait été convoquée par la préfecture de la Côte d’Or afin qu’il soit statué sur son admission au séjour et qu’elle dépose son dossier de demande d’asile (voir paragraphe 6 ci‑dessus).
49. La Cour est d’avis qu’il ressort de ce qui vient d’être exposé que les requérants n’étaient pas dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Partant, il n’y a pas de violation de l’article 3 de la Convention.
F H C. GRÈCE requête 78456/11 du 31 juillet 2014
Violation de l'article 3 pour les conditions de détention dans les locaux de la police lors de la garde à vue. Laisser un individu dans le dénuement après une détention est un acte inhumain et dégradant.
98. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003‑II). La Cour a ainsi jugé qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI).
99. La Cour rappelle également que les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. Il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul, n’emporte pas violation de l’article 3 de la Convention. Cette disposition impose néanmoins à l’État de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudła, précité, §§ 92-94, et Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006‑IX).
100. La Cour rappelle de même qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention, à plusieurs reprises, dans des affaires contre la Grèce relatives aux conditions de détention dans des locaux de police de personnes mises en détention provisoire ou détenues en vue de leur expulsion (Siasios et autres c. Grèce, no 30303/07, 4 juin 2009, Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, 2 juillet 2009, Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, 29 octobre 2009, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, 26 novembre 2009, Efremidze c. Grèce, no 33225/08, 21 juin 2011). Elle note qu’elle a aussi conclu à la violation de cette même disposition dans des affaires relatives aux conditions de détention d’étrangers dans les centres de rétention de Feres, Venna et Soufli (S.D. c. Grèce, no 53541/07, 11 juin 2009, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, R.U. c. Grèce, no 2237/08, 7 juin 2011, A.F. c. Grèce, no 53709/11, 13 juin 2013, B.M. c. Grèce, précité, et C.D. et autres c. Grèce, nos 33441/10, 33468/10 et 33476/10, 19 décembre 2013).
101. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été détenu du 16 décembre 2010 au 17 juin 2011 successivement dans les centres de rétention de Feres, Venna, Soufli, et Fylakio, soit pendant une période de six mois.
102. Compte tenu des constats auxquels elle est parvenue dans les arrêts précités et de ceux contenus dans les rapports des différentes institutions nationales et internationales qui se sont rendues dans ces centres au cours de la période en cause (paragraphes 65-90 ci-dessus), la Cour considère que le requérant a été détenu dans des conditions de surpopulation et d’hygiène déplorables, incompatibles avec l’article 3 de la Convention et qui ont constitué à son endroit un traitement dégradant.
LAISSER UN INDIVIDU SANS RESSOURCES APRES UNE DETENTION EST UNE VIOLATION
106. Le requérant indique que l’État a l’obligation, de par le décret présidentiel no 220/207 relatif à l’accueil des demandeurs d’asile, d’offrir des conditions d’accueil convenables aux demandeurs d’asile nécessiteux, mais qu’il n’existe en Grèce que mille places d’hébergement, y compris selon lui celles destinées aux mineurs, et pas de crédits à cet effet. Il affirme qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pendant un an pour améliorer sa condition, mais qu’il n’a pu avoir accès ni à un hébergement, ni au système de santé, ni au marché du travail.
107. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà penchée sur les conditions d’existence en Grèce des demandeurs d’asile, livrés à eux-mêmes et vivant de longs mois dans une situation de dénuement extrême, dans l’arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce (précité). Dans cet arrêt (ibidem, § 263), la Cour s’est prononcée ainsi :
« (...) compte tenu des obligations reposant sur les autorités grecques en vertu de la directive européenne Accueil (...), la Cour est d’avis qu’elles n’ont pas dûment tenu compte de la vulnérabilité du requérant comme demandeur d’asile et doivent être tenues pour responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles il s’est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels. La Cour estime que le requérant a été victime d’un traitement humiliant témoignant d’un manque de respect pour sa dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec l’incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. »
108. La Cour estime que ces considérations sont également pertinentes dans les circonstances de la présente espèce. Elle note ainsi que, après avoir été mis en liberté le 17 juin 2011, le requérant s’est rendu à Athènes où il a séjourné soit comme un sans-abri, soit en squattant divers bâtiments désaffectés. Elle constate également que celui-ci a demandé le 9 septembre 2011 à retirer sa demande d’asile et à rendre sa carte rose afin de passer en Turquie pour y poursuivre sa démarche de demande d’asile dans ce pays et que cette demande n’a pas été accueillie par les autorités grecques. Elle observe aussi que l’intéressé a obtenu un renouvellement conditionnel de sa carte rose pour trois mois supplémentaires, mais qu’il s’est heurté à des difficultés pour faire renouveler par la suite ce document, notamment du 15 mars au 15 octobre 2012, en raison de problèmes liés au fonctionnement de la direction des étrangers de l’Attique (paragraphes 34-37 ci-dessus).
109. Par ailleurs, la Cour a des doutes quant à l’utilité, en pratique, de la possession d’une carte rose valide. Elle note que le porteur d’une telle carte peut, en théorie, prétendre à un hébergement en structure d’accueil ou avoir accès au marché du travail. Or, elle relève, d’une part, qu’il existe en Grèce peu de places dans les centres d’accueil pour faire face à l’hébergement de dizaines de milliers de demandeurs d’asile et, d’autre part, que l’accès au marché du travail comporte des obstacles administratifs mais aussi pratiques dus à l’absence de tout réseau de soutien et au contexte général de crise économique (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 258 et 261).
110. La Cour estime que, dans ces conditions, seul un examen diligent de la demande d’asile du requérant aurait pu mettre un terme à la situation dans laquelle il s’est trouvé, et se trouve encore probablement, depuis le 17 juin 2011. Or, elle observe que le recours de l’intéressé introduit le 6 juin 2011 devant la commission d’appel était pendant encore au moins jusqu’au 3 septembre 2013, date du dépôt de ses observations devant la Cour.
111. Il s’ensuit que le requérant s’est retrouvé, par le fait des autorités, dans une situation dégradante contraire à l’article 3 de la Convention. Dès lors, il y a eu également violation de cette disposition au regard de ce grief.
VIOLATION ARTICLE 3 ET 13 DE LA CONVENTION
116. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 13 de la Convention garantit l’existence de recours internes permettant l’examen de tout « grief défendable » fondé sur la Convention et l’octroi d’un redressement approprié. À ce titre, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition, et la portée de cette obligation varie en fonction de la nature du grief que le requérant tire de la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 de la Convention doit être « effectif » en pratique comme en droit (McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 62, CEDH 2003‑V).
117. En premier lieu, la Cour note qu’à la date à laquelle le tribunal administratif a rejeté les objections du requérant, à savoir le 6 mai 2011, les lois qui, selon le Gouvernement, ont étendu l’ampleur du contrôle opéré par le juge administratif pour y inclure les conditions de détention, étaient déjà en vigueur : il s’agit de la loi no 3900/2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, et de la loi no 3907/2011, entrée en vigueur le 21 janvier 2011.
118. En deuxième lieu, la Cour note que, dans sa décision du 6 mai 2011, le tribunal administratif ne s’est livré à aucune analyse des conditions de détention du requérant. Elle relève que cette juridiction s’est contentée de déclarer, de manière lapidaire, que le requérant n’avait pas déposé de demande de transfert au centre de rétention de Fylakio où les conditions de détention étaient selon elle meilleures. Or, de l’avis de la Cour, une telle approche revient à se désengager de la responsabilité d’examiner les conditions de détention en question et à la transmettre à un organe de l’exécutif – à savoir les autorités de police qui auraient été appelées à décider si le transfert du requérant était justifié compte tenu des conditions régnant au centre de Soufli. La Cour s’interroge d’ailleurs sur la base sur laquelle le juge administratif a conclu que les conditions de détention au centre de Fylakio étaient meilleures. En effet, ce centre était non seulement mentionné dans les nombreux rapports des institutions internationales relatifs aux conditions de détention dans la région d’Evros mais également expressément critiqué dans la déclaration publique du CPT relative à la Grèce.
119. Dès lors, la Cour considère que le recours exercé par le requérant sur le fondement de l’article 76 § 3 de la loi no 3386/2005 ne lui a pas assuré, en l’espèce, un redressement approprié.
120. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3.
LES PREVENUS DETENUS DURANT L'AUDIENCE DE JUGEMENT
Korneykova et Korneykov c. Ukraine du 24 mars 2016 requête no 56660/12
Le placement de Mme Korneykova dans une cage de métal lors des audiences. La Cour observe que Mme Korneykova a été placée dans une cage de métal pendant les six audiences tenues lors de son procès. Pendant les deux premières audiences, elle se trouvait à un stade très avancé de sa grossesse ; pendant les quatre autres audiences, elle était une mère allaitante qui dans le prétoire était séparée de son bébé par des barreaux métalliques. La Cour a dit dans un récent arrêt de Grande Chambre (dans l’affaire Svinarenko et Slyadnev. Russie que l’enfermement d’une personne dans une cage de métal pendant son procès constituait en soi un affront à la dignité humaine. Dès lors, la Cour constate une quatrième violation de l’article 3 de la Convention.
GRANDE CHAMBRE SVINARENKO ET SLYADNEV c. RUSSIE
du 17 juillet 2014 requêtes n° 32541/08 et 43441/08
Violation de l'article 3 : Faire comparaître les requérants dans une cage de verre et de métal devant leurs juges pénaux est un acte inhumain et dégradant.
122. La Cour est appelée à se prononcer en l’espèce sur une pratique consistant à placer dans une cage de métal les accusés en détention provisoire lorsqu’ils comparaissent devant un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale. Cette pratique, courante au lendemain de l’éclatement de l’Union soviétique dans certains États contractants qui sont d’anciennes Républiques soviétiques, a depuis lors été en grande partie abandonnée. Même les rares États contractants à l’avoir maintenue, comme l’État défendeur, ont entamé un processus d’élimination des cages de métal de leurs prétoires (paragraphes 75 et 101 ci-dessus).
123. En Russie, tout suspect ou accusé en détention provisoire comparaît en salle d’audience enfermé dans une cage de métal (paragraphes 57 et 93 ci-dessus). Cette pratique est toujours autorisée dans la Russie d’aujourd’hui et l’État russe ne s’est aucunement engagé à y renoncer (paragraphes 65-66 et 101 ci-dessus). Les conditions de mise en détention provisoire (paragraphes 67 à 69 ci-dessus) et les statistiques du Gouvernement – 17,7 % des accusés, soit 241 111 personnes, étaient sous le régime de la détention provisoire en 2007 et 12,8 %, soit 134 937 personnes, en 2012 (paragraphe 94 ci-dessus) – montrent à quel point cette pratique est répandue.
124. La Cour note, en particulier, que cette pratique est réglementée par un arrêté ministériel non publié (paragraphes 57 et 61 ci-dessus), ce qui est éminemment problématique en soi vu l’importance fondamentale que revêt le principe de prééminence du droit dans une société démocratique, lequel présuppose l’accessibilité aux règles de droit (voir, par exemple, Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, §§ 86-87, série A no61).
125. La Cour observe, à partir de photographies d’une salle d’audience de la cour régionale de Magadan, que les requérants étaient enfermés dans un espace délimité des quatre côtés par des barreaux de métal et surmonté d’un grillage (paragraphe 48 ci-dessus), que l’on peut qualifier de cage. Les requérants étaient gardés par des policiers d’escorte armés postés à côté de la cage (paragraphe 49 ci-dessus).
126. Les requérants ont été encagés dans le cadre de leur procès avec jury devant la cour régionale de Magadan en 2008-2009 ; ils étaient accusés de vols avec violence commis en bande et d’autres infractions perpétrées en 2001-2002 (paragraphes 9, 10 et 19 ci-dessus). Le Gouvernement soutient que le caractère violent des infractions dont les intéressés étaient accusés, ainsi que leurs antécédents criminels, les références négatives provenant de leur lieu de résidence et la crainte d’un comportement illégal de leur part exprimée par les témoins suffisaient à attester de leur prédisposition à la violence et de l’existence de risques réels pour la sécurité dans le prétoire nécessitant le recours à une cage afin que le procès se déroule dans de bonnes conditions. Récusant cette thèse, les requérants estiment en particulier que l’acquittement total du premier requérant et l’acquittement du second requérant de la plupart des chefs d’accusation qui pesaient sur lui, notamment de ceux de banditisme et de vol aggravé, confirment que les charges retenues contre eux étaient infondées. Ils ajoutent qu’eu égard au principe de la présomption d’innocence, l’invocation de celles-ci est en tout état de cause dépourvue de pertinence.
127. La Cour convient avec le Gouvernement que, indispensables à la bonne administration de la justice, l’ordre et la sécurité dans le prétoire revêtent une grande importance. La Cour n’a point pour tâche de discuter des questions concernant l’architecture des salles d’audience ni de donner des indications sur les mesures de contrainte physique précises qui peuvent s’y imposer. Toutefois, on ne saurait assurer l’ordre et la sécurité dans le prétoire en adoptant des mesures de contrainte qui, par leur gravité (paragraphe 114 ci-dessus) ou par leur nature même, tomberaient sous le coup de l’article 3. En effet, comme la Cour l’a dit à maintes reprises, l’article 3 prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, ce pourquoi rien ne peut les justifier.
128. Partant, la Cour recherchera tout d’abord si, au vu des circonstances, le minimum de gravité évoqué au paragraphe 127 ci-dessus a été atteint. Ce faisant, elle tiendra compte des conséquences que la mesure de contrainte dénoncée a eues pour les requérants.
129. À cet égard, la Cour observe que les requérants ont été jugés par un tribunal composé de douze jurés, deux suppléants étant en outre présents, et du président de l’instance de jugement. Elle observe également que d’autres participants au procès étaient présents dans la salle d’audience, dont un grand nombre de témoins – plus de 70 ont déposé au procès – et de candidats qui s’étaient présentés au tribunal aux fins du processus de constitution du jury (paragraphe 38 ci-dessus), et que les audiences étaient ouvertes au public. Elle considère que l’exposition des requérants dans une cage aux regards du public n’a pu que nuire à leur image et susciter en eux des sentiments d’humiliation, d’impuissance, de peur, d’angoisse et d’infériorité.
130. La Cour observe en outre que les requérants ont été soumis au traitement litigieux pendant la totalité de leur procès avec jury devant la cour régionale, qui a duré plus d’une année, avec plusieurs audiences tenues presque chaque mois.
131. De plus, le fait que le traitement dénoncé a été infligé aux requérants dans la salle d’audience pendant leur procès fait entrer en jeu le principe de la présomption d’innocence en matière pénale, qui constitue l’un des attributs du procès équitable (voir, mutatis mutandis, Allen c. Royaume‑Uni [GC], no 25424/09, § 94, CEDH 2013), et l’importance que revêt l’apparence d’une bonne administration de la justice (voir Borgers c. Belgique, 30 octobre 1991, § 24, série A no 214‑B, Zhuk c. Ukraine, no 45783/05, § 27, 21 octobre 2010, et Atanasov c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 22745/06, § 31, 17 février 2011). Il y va de la confiance que les juridictions d’une société démocratique doivent inspirer au public et surtout, dans un procès pénal, à l’accusé (voir, mutatis mutandis, De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 26, série A no 86).
132. La Cour note que, récemment, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a dit qu’enfermer un accusé menotté dans une cage de métal au cours de son procès public s’analyse en un traitement dégradant qui compromet également l’équité de son procès (paragraphe 70 ci-dessus). l’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus et les règlements de procédure des juridictions pénales internationales prévoient, relativement à certains instruments de contrainte, que ceux-ci ne peuvent être employés que par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, et à condition qu’ils soient enlevés dès que l’accusé comparaît devant un tribunal (paragraphes 71 et 72 ci‑dessus). Le manuel d’Amnesty International intitulé « Pour des procès équitables » dit que l’enfermement de l’accusé « dans une cellule dans l’enceinte du prétoire » peut heurter la présomption d’innocence (paragraphe 74 ci-dessus).
133. La Cour estime que les requérants devaient avoir des raisons objectives de craindre que leur exposition dans une cage lors des audiences de leur procès ne donnât d’eux à leurs juges, appelés à statuer sur des questions touchant à leur responsabilité pénale et à leur liberté, une image négative propre à créer l’impression qu’ils étaient dangereux au point de nécessiter une mesure de contrainte physique aussi extrême et à porter ainsi atteinte à la présomption d’innocence. Cela n’a pu que faire naître en eux des sentiments d’angoisse et de détresse eu égard à la gravité de l’enjeu pour eux de ce procès.
134. La Cour ajoute qu’une mesure d’enfermement dans le prétoire peut (même si ce n’est pas le cas en l’espèce) faire entrer en jeu d’autres considérations afférentes à l’équité du procès, notamment le droit pour l’accusé d’être effectivement associé à la procédure (Stanford c. Royaume‑Uni, 23 février 1994, §§ 27-32, série A no 282‑A) et celui de bénéficier d’une assistance juridique pratique et effective (Insanov c. Azerbaïdjan, no 16133/08, §§ 168-170, 14 mars 2013, et Khodorkovskiy et Lebedev, précité, §§ 642-648).
135. Enfin, la Cour estime qu’il n’y a pas d’arguments convaincants pour considérer qu’il soit nécessaire de nos jours, dans le cadre d’un procès, d’enfermer un accusé dans une cage (comme il est décrit au paragraphe 125 ci-dessus) pour le contraindre physiquement, empêcher son évasion, remédier à un comportement agité ou agressif de sa part, ou le protéger d’agressions extérieures. Le maintien d’une telle pratique ne peut dès lors guère se concevoir autrement que comme un moyen d’avilir et d’humilier la personne mise en cage. La finalité de l’enfermement d’une personne dans une cage pendant son procès – la rabaisser et l’humilier – apparaît donc clairement.
136. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’enfermement des requérants dans une cage à l’intérieur du prétoire pendant leur procès n’a pu que les plonger dans une détresse d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à leur détention lorsqu’ils comparaissent en justice et que ce traitement a atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3.
137. La Cour estime que jamais le recours aux cages (tel que décrit ci‑dessus) dans ce contexte ne peut se justifier sur le terrain de l’article 3 (paragraphe 138 ci-dessous), contrairement à ce que le Gouvernement soutient dans ses observations en alléguant une menace pour la sécurité (paragraphe 126 ci-dessus). En tout état de cause, sur ce dernier point, elle ne reconnaît pas que l’existence d’une telle menace ait été étayée. Elle constate que jamais la cour régionale de Magadan n’a recherché si la mise sous contrainte physique des requérants était nécessaire de quelque manière que ce fût pendant les audiences. De plus, leur encagement n’était pas motivé. On ne trouve pas davantage de motivation dans les décisions judiciaires concernant la détention provisoire des intéressés, alors que le Gouvernement soutient que les requérants représentaient une menace pour des témoins et que c’est celle-ci qui justifiait l’adoption de cette mesure. Si le premier requérant se trouvait en détention provisoire, c’est non pas pour la durée du troisième procès mais dans le cadre d’une autre procédure, distincte, pour des raisons qui ne sont pas connues (paragraphes 34 et 46 ci‑dessus). La détention du second requérant fut ordonnée par les mêmes décisions de justice que celles que la Cour a examinées dans le cas du coaccusé des requérants et dont elle a jugé qu’elles ne contenaient pas des motifs « pertinents et suffisants » pour rendre la détention provisoire compatible avec l’article 5 § 3, relevant notamment qu’elles ne comportaient pas de motifs propres à démontrer l’existence d’un risque de représailles ou de pressions sur les témoins tels que celui aujourd’hui invoqué par le Gouvernement (Mikhail Grishin, précité, §§ 149-150). Cette conclusion vaut tout autant en l’espèce et rien dans les observations présentées par le Gouvernement devant la Grande Chambre ne permet de s’en écarter. De plus, ni les accusations faisant état d’infractions avec violence commises par les requérants ni leurs condamnations antérieures, parfois à des peines avec sursis, six ans voire plus avant le procès en question, ni la condamnation ultérieure du premier requérant ne peuvent raisonnablement être considérées comme confortant la thèse avancée par le Gouvernement à cet égard. Quant aux références négatives évoquées par le Gouvernement (paragraphe 96 ci-dessus), rien ne permet d’en conclure que la personnalité des requérants nécessitait de leur appliquer une contrainte physique au cours de leur procès. De plus, le second requérant pouvait se prévaloir de références positives de l’administration de son centre de détention et de celle de sa maison d’arrêt (paragraphe 44 ci-dessus).
138. Indépendamment des circonstances concrètes de l’espèce, la Cour rappelle que le respect de la dignité humaine est au cœur même de la Convention et que l’objet et le but de ce texte, instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives. C’est pourquoi elle estime que l’enfermement d’une personne dans une cage de métal pendant son procès constitue en soi, compte tenu de son caractère objectivement dégradant, incompatible avec les normes de comportement civilisé qui caractérisent une société démocratique, un affront à la dignité humaine contraire à l’article 3.
139. Par conséquent, l’enfermement des requérants dans une cage de métal à l’intérieur du prétoire s’analyse en un traitement dégradant prohibé par l’article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition.
JURISPRUDENCE FRANCAISE
Cet arrêt de la Cour de Cassation mérite un recours international
Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire, ayant refusé la comparution de la personne mise en examen hors d’un box vitré, par une motivation dont il ressort que cette comparution, qui n’est contraire ni à la dignité humaine ni à la présomption d’innocence, était nécessaire à la sécurité de l’audience. La motivation démontre que le prévenu est considéré comme dangereux.
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 18 novembre 2020 pourvoi n° 20-84.893 rejet
VIII. Pour refuser la demande de comparution du mis en examen hors du box sécurisé, la chambre de l’instruction, après avoir précisément décrit l’installation en cause et indiqué qu’elle répondait aux normes de sécurité prônées par le ministère de la justice, énonce que l’avocat peut s’entretenir efficacement et en toute confidentialité avec son client, le microphone pouvant être coupé par la juridiction sur simple demande. La disposition géographique de ce box dans la salle et le microphone qui y est installé permettent au comparant de s’exprimer de manière tout à fait claire et audible, de suivre les débats, de voir et d’ être vu de la juridiction. Ainsi, ce box assure tant la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur que de celles présentes dans la salle d’audience.
IX. Les juges ajoutent que l’utilisation du box n’est contraire, ni à la dignité humaine, ni au principe de la présomption d’innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil avec le comparant.
X. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait déjà été condamné à sept ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et est mis en examen des chefs de meurtre, tentative de meurtre en bande organisée, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, à la suite d’une fusillade s’analysant en une véritable exécution de la victime en pleine rue, ce dont il ressort que la comparution derrière un box vitré était nécessaire à la sécurité de l’audience, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans violer les dispositions conventionnelles alléguées.
XI. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
LE DÉLAI POUR SE PLAINDRE EST FORCLOS 4 MOIS APRÈS SA LIBÉRATION
La nouvelle obligation de 4 mois au lieu de 6 s'impose aussi en matière de détention arbitraire.
IAMANDI c. ROUMANIE du 1er JUIN 2010 REQUÊTE N° 25867/03
La CEDH ne considère pas les conditions de transfèrement car la requête est déposée trop tard par rapport au délai de 6 mois.
49. S'agissant de l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours, la Cour observe que le grief du requérant porte sur les conditions de détention, dont la surpopulation carcérale. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans une affaire récente relative à un grief similaire et dirigée contre la Roumanie, qu'au vu de la particularité de ce grief, il n'y avait pas de recours effectif à épuiser par le requérant (Petrea précitée § 37, 29 avril 2008). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'espèce à une conclusion différente. La Cour observe que le Gouvernement n'a pas indiqué de quelle manière les voies de recours invoquées pouvaient remédier au problème du surpeuplement en particulier, et n'a pas fourni de décisions définitives pertinentes à cet égard.
50. La Cour constate que le requérant s'est plaint des conditions de détention par lettres des 24 mars 2008 et 12 février 2009. Elle doit vérifier si ces griefs du requérant respectent les conditions de recevabilité, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, notamment le délai de six mois.
51. La Cour note qu'elle a déjà examiné la manière dont il convient d'appliquer la règle des six mois dans les affaires de ce type (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 35, 26 juin 2008). Renvoyant à la jurisprudence pertinente, elle a ainsi indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer des conditions de détention comme une situation continue dans la mesure où le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement, ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention identifiée ; au contraire, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux et des conditions de détention qui sont restés sensiblement similaires malgré le transfert du requérant (Seleznev, précité, § 36).
52. A la différence de l'affaire précitée, la Cour observe qu'en l'espèce les griefs du requérant portent exclusivement sur les conditions de détention dans les centres de détention de Rahova et Giurgiu. Or, tel qu'il ressort des données relatives aux transferts du requérant, celui-ci fut incarcéré, plusieurs fois, dans les centres de détention de Jilava et Colibaşi, dont il ne conteste pas les conditions de détention (cf. § 18 ci-dessus).
53. Dans ces conditions, compte tenu du fait que les griefs du requérant concernent les conditions de détention dans le cadre des centres de détention de Rahova et Giurgiu et que celui-ci a séjourné dans les deux centres, sans interruption, à partir du 19 septembre 2003 (date de son transfert à Rahova depuis le centre de détention de Jilava) et jusqu'au 4 mai 2009 (date de son transfert vers le centre de détention de Jilava), la Cour décide qu'il s'agit d'une situation continue et que cette période est à prendre en considération dans le calcul du délai de six mois. La Cour décide que la même conclusion s'applique aux périodes du 14 mai 2009 au 1er juin 2009 et du 15 juin 2009 au 21 septembre 2009 (cf. §§ 16 et 18 ci-dessus). En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la jurisprudence en la matière, la Cour conclut qu'il ne s'agit pas d'une situation continue dans le cas des transferts du requérant dans les centres de détention de Jilava et Colibaşi (cf. mutatis mutandis Brânduşe, précité, § 42).
54. Partant, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, il convient de rejeter pour tardiveté le restant du grief concernant les conditions de détention en dehors des périodes précitées.
55. S'agissant des griefs relatifs aux périodes mentionnées au § 53 ci-dessus, la Cour constate qu'ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre que cette partie du grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
PAPAKONSTANTINOU c. GRÈCE du 13 novembre 2011 requête 50765/11Pour se plaindre des conditions de détention, le délai est de six mois, après la libération, même si la procédure d'accusation pénale continue.
1. Délai de six mois
47. La Cour relève que la détention du requérant dans la prison de Korydallos a pris fin en avril 2008 et se trouve donc en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il convient donc de rejeter cette partie du grief, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
EN BELGIQUE, IL FAUT FAIRE UN RECOURS INTERNE COMPENSATOIRE AVANT LA CEDH
TRABELSI C. BELGIQUE du 4 septembre 2014 Requête n°140/10
155. Le requérant allègue en substance que ses conditions de détention en Belgique ont constitué des traitements contraires à l’article 3 de la Convention précité. Il se plaint des transferts incessants d’une prison à l’autre, des conditions dans lesquelles ces transferts se sont effectués ainsi que des mesures de sécurité particulières dont il a fait l’objet pendant son incarcération. Il fournit à l’appui de ce grief plusieurs rapports établis par des psychiatres attestant des effets négatifs de cette situation sur son état de santé mentale.
156. Le Gouvernement fait observer que le requérant n’a pas introduit la moindre action judiciaire pour contester ses conditions de détention et les transferts.
157. En l’absence de tout recours devant les juridictions internes pour faire valoir ce grief, la Cour considère qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
158. Il s’ensuit cette partie de la requête est irrecevable au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
LES DÉTENUS DOIVENT FAIRE CHACUN,
UNE REQUÊTE INDIVIDUELLE ET NON COLLECTIVE
KONSTANTINOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE du 28 janvier 2016 requête 69781/13
Non violation de l'article 3 : Si les griefs justifient une condamnation, les requérants ont présenté une requête collective sans individualiser pour chacun d'entre eux, les griefs reprochés.
41. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont non fondées. Il renvoie à cet égard à sa version concernant les conditions de détention dans la prison et souligne que si la Cour considérait que celles-ci n’atteignent pas totalement le niveau exigé par le CPT et le code pénitentiaire, elle devait prendre en considération les éléments positifs qui font de la prison de Grevena une prison modèle et conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3. Il se réfère à cet égard à l’arrêt Sergey Chebotarev c. Russie (no 61510/09, § 45, 7 mai 2014).
42. Les requérants affirment qu’il ressort des menus hebdomadaires de la prison, fournis à titre d’exemple par le Gouvernement, que les repas sont de quantité et de qualité nutritionnelle insuffisante. En outre, les aliments dégagent une odeur et ne peuvent pas être consommés en toute sécurité. Les « certifications » mentionnées par le Gouvernement n’ont pas été inclues dans le dossier. Il existe ainsi une discrimination entre les détenus qui ont les moyens de s’acheter de la nourriture du supermarché et de la rôtisserie et ceux qui sont obligés, faute de moyens, de consommer le « menu de la prison » et courir le risque de tomber malade.
43. Les requérants se réfèrent aussi aux constats du Médiateur de la République en ce qui concerne les visites et la surpopulation et soulignent qu’aucun hôpital n’existe à proximité de la prison qui accueille 800 détenus.
44. En ce qui concerne les conditions matérielles de détention et notamment la surpopulation dans les prisons, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu’elle les a répétés dans ses arrêts Ananyev et autres (précité, §§ 139 à 159) et Tzamalis et autres c. Grèce (no 15894/09, §§ 38-40, 4 décembre 2012). Elle rappelle aussi que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
45. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, il s’agissait de cas où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque d’espace n’était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d’autres aspects concernant les conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Ainsi, même dans les cas où un requérant disposait dans une cellule d’un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², la Cour a néanmoins conclu à la violation de l’article 3 en prenant en compte l’exiguïté combinée avec, par exemple, l’absence établie de ventilation et d’éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001‑III).
46. En l’espèce, la Cour note que la prison de Grevena dispose de 200 cellules de 12 m² chacune et où sont placés 3 à 4 détenus. D’une capacité de 600 détenus, la prison en accueillait 732 à la date de l’inspection du médiateur de la République (1er juillet 2013) et 786 le 30 octobre 2013 selon le document établi par la direction de la prison à l’intention du Gouvernement. Á supposer même que toutes les cellules de la prison accueillaient en permanence 4 détenus, l’espace personnel de chaque détenu s’élevait à 3 m², ce qui correspondrait aux exigences fixées par la jurisprudence de la Cour. Sur ce point-là, le médiateur de la République concluait que le grand nombre des détenus rendait difficile leur cohabitation dans la prison et que les exigences du droit interne et international n’étaient pas respectées en ce qui concernait le minimum requis d’espace personnel pour chaque détenu.
47. La Cour va alors se pencher sur les autres aspects des conditions de détention pour apprécier leur conformité à l’article 3 et notamment sur l’alimentation des détenus au sein de la prison, seul aspect autre que la surpopulation générale réellement mise en cause par les requérants dans leurs observations.
48. D’une part, la Cour prend note des affirmations du Gouvernement selon lesquelles la prison dispose d’un supermarché qui vend des produits alimentaires de grande qualité à des prix raisonnables, d’une rôtisserie où les détenus peuvent acheter quotidiennement des poulets rôtis, des brochettes, des frites à des prix très bas, d’une boulangerie qui fabrique toutes sortes de produits et d’une cantine qui vend des produits laitiers, des gâteaux et des légumes et de fruits. Toutefois, la Cour relève que ces produits étant à la vente, seule une catégorie de détenus ayant les moyens peut se les procurer. Á cet égard, les détenus soutenaient dans leur plainte au procureur de la prison que la nourriture était peu variée et de très mauvaise qualité. Ils se plaignaient aussi des prix exorbitants des produits vendus dans la prison et exposaient d’avoir dépensé 200-300 euros par mois pour survivre.
49. D’autre part, la Cour note que dans son rapport, le Médiateur de la République soulignait que l’alimentation des détenus était problématique en raison du montant insuffisant du budget accordé (2,20 euros par détenu). Le menu hebdomadaire comprenait petit-déjeuner (thé ou lait), déjeuner (pâtes : deux fois ; légumes secs : deux fois ; viande : deux fois ; légumes frais et salade : une fois) et dîner. Selon la description faite par les requérants (paragraphe 8 ci-dessus), les menus du dîner différaient peu de ceux du déjeuner.
50. Par ailleurs, le Médiateur de la République épinglait aussi la question des visites en raison de la situation éloignée de la prison des centres urbains et recommandait que la difficulté objective pour les proches des détenus de leur rendre visite imposait que des facilités soient accordées lorsque celles-ci avaient lieu et que la communication téléphonique soit améliorée.
51. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’effet cumulatif des problèmes concernant la surpopulation et l’alimentation des détenus, allégués par les requérants et relevés aussi par le Médiateur de la République, pourraient rendre les conditions de détention inadéquates et atteindre le seuil de gravité requis permettant de les qualifier de traitement dégradant.
52. Toutefois, la Cour note que les requérants dont il s’agit, s’ils évoquent les conditions générales régnant dans la prison, ils ne précisent pas s’ils étaient effectivement concernées par celles-ci. Plus particulièrement, ils n’indiquent pas qui parmi eux était détenu dans des cellules accueillant 3 détenus et qui étaient dans celles accueillant 4 détenus ; qui parmi eux dormaient sur un matelas par terre. S’agissant de l’alimentation, aucun d’entre eux n’a précisé s’il avait ou non les moyens de se procurer des produits alimentaires ou autres au supermarché ou à la rôtisserie de la prison.
53. Compte tenu de l’état général de la prison de Grevena, décrit par les requérants et le Médiateur, et faute pour les requérants d’avoir individualisé leur cas et précisé s’ils étaient effectivement concernés par les défaillances relevées par le Médiateur dans le fonctionnement de cette prison, la Cour ne saurait conclure que les conditions de détention des requérants excédaient le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et constituait un traitement dégradant.
54. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
LES RECOURS INTERNES DOIVENT ÊTRE EPUISES QUAND ILS EXISTENT
Dîrjan et Ştefan c. Roumanie du 28 mai 2020 requêtes nos 14224/15 et 50977/15
irrecevabilité article 3 : Le recours compensatoire en application de la loi roumaine a accordé une réparation suffisante et appropriée aux détenus ayant subi de mauvaises conditions de détention entre juillet 2012 et décembre 2019
L’affaire concerne des plaintes concernant de mauvaises conditions de détention. La Cour note que les requérants ont bénéficié tous les deux d’une réduction de leur peine d’emprisonnement au titre de compensation pour les mauvaises conditions de détention, en application de la loi roumaine n° 169/2017. Ils ont ainsi pu être libérés de manière anticipée. La Cour juge, en particulier, que cette loi vaut reconnaissance en substance, par les autorités nationales, de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour juge également le mécanisme de compensation mis en œuvre, consistant en une réduction de peine, suffisant et approprié. Les deux requérants ne peuvent donc plus se prétendre victimes des mauvaises conditions de détention.
LES FAITS
Les requérants, Ghiorghe-Marius Dîrjan et Marian-Valentin Ştefan, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1966 et 1992, et résidant à Brașov et Bucarest (Roumanie). M. Dîrjan a été incarcéré à la prison de Miercurea Ciuc, de septembre 2013 à avril 2015 pour y purger une peine de sept ans d’emprisonnement. M. Ştefan fut d’abord placé en détention provisoire dans les locaux du dépôt central de police de Bucarest en novembre 2013. Il fut ensuite incarcéré successivement dans les prisons de Rahova (2013-2015), de Colibasi (2015), de Jilava (2015-2016) et de Giurgiu (2016-2018) pour y purger une peine d’emprisonnement de cinq ans, quatre mois et quinze jours. Les deux requérants firent l’objet de réductions automatiques de peine en vertu de la loi n°169/2017 portant modification de la loi n o 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. Celle-ci prévoit un mécanisme de compensation sous la forme d’une réduction de peine pour les détenus ayant été incarcérés dans des mauvaises conditions. En application de cette loi, M. Dîrjan bénéficia d’une mesure anticipée de libération conditionnelle en novembre 2017. M. Ştefan fut, quant à lui, libéré de manière anticipée en avril 2018, date à laquelle sa peine fut considérée comme intégralement purgée
Article 3
La Cour observe tout d’abord que la loi n° 169/2017, en vigueur du 19 octobre 2017 au 20 décembre 2019, portant modification de la loi n o 253/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, a instauré un recours compensatoire sous la forme d’une réduction de peine. Une commission d’évaluation, instaurée par la loi, a été chargée de déterminer les établissements pénitentiaires et / ou dépôts de police éligibles au mécanisme de compensation. La commission a pris en compte plusieurs critères, établis par la loi n° 169/2017, tels que l’espace vital, la possibilité de pratiquer des activités en dehors des cellules, la lumière, la ventilation et la température des cellules, l’utilisation des groupes sanitaires et le respect de l’hygiène, ainsi que l’état des murs des cellules. Le résultat de l’analyse permettant ensuite de calculer le nombre de jours de réduction de peine. La Cour note ensuite que la loi a prévu une réduction automatique de peine de six jours pour chaque période de 30 jours de détention dans de mauvaises conditions, soit une réduction trois fois plus importante que ce qu’elle a pu juger conformément à sa jurisprudence. De plus, la loi avait pour effet direct la libération anticipée des détenus. En l’espèce, la Cour observe que, en application de la loi n° 169/2017, les requérants ont bénéficié de réductions de peine, respectivement de 324 jours et 318 jours et ont été libérés avant la date prévue. Les autorités nationales ont ainsi reconnu en substance la violation de l’article 3 et l’ont réparé de manière suffisante et appropriée. Ainsi, les compensations en l’espèce, explicitement octroyées pour réparer la violation de l’article 3, ont empêché la continuation de la violation alléguée. Par conséquent, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes de leurs mauvaises conditions de détention. La Cour déclare les requêtes irrecevables
CEDH
a) Principes généraux
22. La Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, elle réaffirme que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)). Elle rappelle, en outre, qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 180 et 193, CEDH 2006-V, et Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, § 83, 26 avril 2016). Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête (Albayrak c. Turquie, no 38406/97, § 32, 31 janvier 2008).
b) Application de ces principes en l’espèce
23. En l’espèce, la Cour note que les deux requérants ont bénéficié d’une libération anticipée (paragraphes 8 et 9 ci-dessus) à la suite de l’adoption, par les autorités nationales, de la loi no 169/2017 portant modification de la loi no 253/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté (paragraphe 10 ci-dessus). Afin de déterminer si les requérants en l’espèce peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention, la Cour doit d’abord analyser s’il y a eu, dans les affaires en l’espèce, une reconnaissance explicite ou en substance de la violation de la Convention (paragraphe 22 ci-dessus).
24. La Cour note tout d’abord que la loi no 169/2017 instaurait une compensation sous la forme d’une réduction de la peine à exécuter expressément accordée aux détenus qui, comme les requérants, étaient exposés à de mauvaises conditions de détention, pendant la période allant du 24 juillet 2012 et jusqu’au 20 décembre 2019, dans différents établissements pénitentiaires et/ou dépôts de police (articles 551 alinéas 1-3 de la loi no 254/2013 et article IV, cinquième alinéa, de la loi no 169/2017, cités au paragraphe 10 ci-dessus).
25. Afin d’identifier les établissements pénitentiaires et/ou les dépôts de police qui exposaient les détenus à de mauvaises conditions de détention, ce mécanisme de compensation prévoyait plusieurs critères à analyser par une commission d’évaluation spécialement instaurée par le législateur : l’espace vital, la possibilité de pratiquer des activités en dehors des cellules, la lumière, la ventilation et la température des cellules, l’utilisation des groupes sanitaires et le respect de l’hygiène, ainsi que l’état des murs des cellules (article 551, troisième alinéa, lettres a-f, de la loi no 253/2013, cité au paragraphe 10 ci-dessus). Le résultat de l’analyse permettait au bureau de la gestion de la détention d’effectuer le calcul des jours de réduction de peine pour les personnes détenues dans de mauvaises conditions de détention (articles II-IV de la loi no 169/2017, cités au paragraphe 10 ci‑dessus).
26. De surcroît, la Cour note que l’analyse de la situation des détenus se faisait conformément aux normes découlant de la jurisprudence en matière d’article 3 de la Convention (voir en ce sens la jurisprudence citée dans Neshkov et autres c. Bulgarie (nos 36925/10 et 5 autres, §§ 187 et 225-243, 27 janvier 2015) et les normes minimales en matière de conditions de détention citées dans l’affaire Rezmiveș et autres c. Roumanie (nos 61467/12 et 3 autres, §§ 42-43 et 48-50, 25 avril 2017)).
27. En l’espèce, compte tenu des spécificités du mécanisme de compensation instauré par le législateur, la Cour en conclut que la première condition pour la perte de la qualité de victimes des requérants a été remplie. Elle note que la reconnaissance de la violation de l’article 3 de la Convention a été faite en substance, par le biais de la loi no 169/2017, dont le but était d’indemniser les requérants pour la période d’incarcération ayant eu lieu dans de conditions contraires à cette disposition.
28. La Cour doit ensuite analyser si la deuxième condition permettant de conclure à la perte de la qualité de victime, à savoir la réparation appropriée et suffisante de la violation de la Convention, a été remplie (paragraphe 22 ci-dessus). À ce titre, la Cour constate que la loi no 169/2017 a introduit une compensation sous forme d’une réduction de peine égale à six jours pour chaque période de trente jours de détention dans de mauvaises conditions (article 551, premier alinéa, de la loi no 253/2013, cité au paragraphe 10 ci‑dessus). Elle rappelle, à cet égard, avoir déjà jugé qu’une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec la Convention constituait un redressement adéquat dans la mesure où, entre autres, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée était mesurable (voir, en particulier, Stella et autres c. Italie (déc.), nos 49169/09, §§ 58-60, 16 septembre 2014). Ces considérations ne peuvent que s’appliquer à plus forte raison en la présente espèce, où les dispositions législatives de l’État défendeur offraient une réduction de peine trois fois plus importante.
29. De plus, la reconnaissance de cette réduction était effectuée par les bureaux de gestion de la détention (article V, troisième alinéa de la loi no 169/2017, cité au paragraphe 10 ci-dessus), et le bénéfice direct de la réduction était la libération anticipée des détenus. La Cour note également que, en droit roumain, la procédure de libération conditionnelle est initiée soit par les personnes intéressées, soit par les commissions de libération (article 97 de la loi no 254/2013, cité au paragraphe 11 ci-dessus) et que l’analyse des demandes de libération conditionnelle se fait, en principe, à intervalle hebdomadaire (article 205 du règlement d’application de la loi no 254/2013, cité au paragraphe 12 ci-dessus).
30. En l’espèce, contrairement aux arguments avancés par le deuxième requérant (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour relève que l’intéressé s’est vu octroyer, en vertu de la loi no 169/2017, une réduction automatique de peine de 318 jours en compensation de la durée totale de son incarcération dans de mauvaises conditions de détention (paragraphe 9 ci-dessus). Elle relève également que le premier requérant a bénéficié, dans les mêmes conditions, d’une réduction de peine de 324 jours (paragraphe 8 ci-dessus).
31. La Cour constate en outre que les compensations en l’espèce, explicitement octroyées pour réparer la violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 27 ci-dessus), ont eu pour effet direct la libération anticipée des requérants, et ont donc empêché la continuation de la violation alléguée (voir, mutatis mutandis, Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 97, 10 janvier 2012).
32. Bien que le recours compensatoire instauré en l’espèce par les autorités nationales n’ait connu qu’une application temporaire, la Cour relève qu’il a reçu une évaluation positive de la part du Comité des Ministres. À ce titre, la Cour renvoie à l’analyse du secrétariat du Comité des Ministres qui confirme que la réduction de peine avait un impact mesurable sur le quantum de la peine et contribuait à la réduction du surpeuplement carcéral (paragraphe 13 ci-dessus). Au même titre, le Comité des Ministres a souligné le caractère effectif de la compensation instaurée par la loi no 169/2017 pour les personnes incarcérées dans de mauvaises conditions (paragraphe 14 ci-dessus).
33. En l’espèce, compte tenu de ce que les autorités nationales ont reconnu en substance la violation en cause et l’ont réparée de manière appropriée et suffisante (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour considère que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes des faits qu’ils dénoncent, à savoir les mauvaises conditions de leurs détentions respectives.
34. Il s’ensuit que les requêtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35 § 4.
Shmelev et autres c. Russie du 9 avril 2020 requêtes nos 41743/17 et 16 autres
Recours interne : Le nouveau mécanisme russe d’indemnisation d’anciens détenus ayant subi des conditions de détention inadéquates est effectif, mais les recours visant à l’amélioration d’une situation en cours doivent encore être évalués
Dans sa décision, la Cour européenne déclare, à l’unanimité, irrecevables six des dix-sept requêtes dont elle a été saisie dans cette affaire. Celles-ci avaient été introduites par des requérants dont la détention provisoire ou la peine d’emprisonnement avaient déjà pris fin. La Cour juge le nouveau recours compensatoire effectif lorsqu’aucun autre recours n’est nécessaire, notamment dans tous les cas où la détention provisoire a pris fin et dans certaines situations où la peine d’emprisonnement a été exécutée en violation des dispositions internes. Six requérants, qui relèvent de ces deux catégories, doivent donc exercer la nouvelle voie de recours interne avant de pouvoir saisir la Cour. Celle-ci déclare leurs griefs irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. La décision sur la recevabilité est définitive. La Cour souligne qu’elle appliquera la même interprétation à toutes les requêtes analogues dont elle sera saisie. Les requérants qui relèvent de l’une des deux catégories indiquées ci-dessus et dont les requêtes étaient pendantes devant la Cour lorsque la nouvelle loi est entrée en vigueur ont jusqu’au 27 juillet 2020 pour demander réparation au titre du nouveau régime. La Cour décide par ailleurs, également à l’unanimité, d’ajourner l’examen des onze autres requêtes et demande aux parties de produire des observations supplémentaires afin de clarifier la question de l’effectivité des recours compensatoires existants pour d’autres types de peines d’emprisonnement déjà purgées, ainsi que celle des autres types de recours ouverts pour permettre à ceux qui sont encore incarcérés de voir s’améliorer leurs conditions de détention.
LES FAITS
Les requérants sont 17 ressortissants russes qui sont ou ont été détenus dans divers établissements de détention russes, avant ou après condamnation dans le cadre de poursuites pénales. Sept des requérants (requêtes nos 66806/17, 75804/17, 77181/17, 77265/17, 19294/18, 31682/18 et 32545/18) sont ou étaient détenus dans des centres de détention provisoire, et les dix autres (requêtes nos 41743/17, 60185/17, 74497/17, 1249/18, 9152/18, 14988/18, 17991/18, 19837/18, 21542/18 et 29155/18) sont ou ont été détenus dans des colonies pénitentiaires après avoir été condamnés. Tous les requérants ont introduit des requêtes auprès de la Cour européenne des droits de l’homme pour se plaindre de mauvaises conditions de détention, en particulier de surpopulation. Certains d’entre eux n’étaient plus en détention au moment de l’échange des observations entre les parties dans l’affaire soumise à la Cour européenne, tandis que d’autres l’étaient encore. Environ 1 450 requêtes analogues concernant la détention provisoire et près de 3 600 requêtes concernant la détention en établissement pour peine, toutes dirigées contre la Russie, étaient pendantes devant la Cour européenne en mars 2020.
Une nouvelle loi, la loi fédérale no 494–FZ (« la loi d’indemnisation ») a été adoptée en décembre 2019 et elle est entrée en vigueur le 27 janvier 2020. Elle dispose que tout détenu qui allègue que ses conditions de détention enfreignent ou ont enfreint les normes nationales ou internationales peut solliciter une indemnité auprès d’un tribunal. La loi d’indemnisation a été adoptée en réponse aux arrêts de principe que la Cour européenne a rendus dans l’affaire Ananyev et autres c. Russie en 2012 (requêtes nos 42525/07 et 60800/08) et dans l’affaire Sergey Babushkin c. Russie en 2013 (no 5993/08) relativement à de mauvaises conditions de détention, dans les contextes respectifs de la détention provisoire et de la détention après condamnation. Le gouvernement russe a soumis des informations sur la nouvelle loi et d’autres évolutions pertinentes du droit interne visant à atténuer les mauvaises conditions de détention. Il a demandé à la Cour européenne de considérer que la nouvelle loi offre un nouveau recours permettant de se plaindre de conditions de détention. Les requérants concernés ont marqué leur désaccord avec ces observations ou n’ont pas fait de commentaires à leur sujet.
Articles 3 et 13 (conditions de détention inadéquates)
La Cour rappelle premièrement les réformes entreprises dans plusieurs États membres pour remédier à des conditions de détention inadéquates. Elle réaffirme que deux types de redressement sont possibles : l’amélioration des conditions de la détention en cours (recours préventif) et la réparation de tout préjudice qui en a résulté (recours compensatoire). Elle souligne que les recours préventifs et les recours compensatoires sont étroitement liés et qu’ils doivent être combinés pour être effectifs. Ils peuvent néanmoins être examinés séparément. La Cour limite ainsi la portée de ses conclusions relatives à la loi d’indemnisation aux périodes de détention achevées et estime que l’effectivité de tout recours préventif doit encore être évaluée.
Elle juge en particulier que la loi d’indemnisation est, en principe, une voie de recours compensatoire adéquate et effective dans les cas où les mauvaises conditions de détention concernent une période de détention provisoire achevée et dans certaines situations où la peine d’emprisonnement a été exécutée en violation des dispositions internes.
Elle considère que cette voie de recours présente les garanties procédurales requises associées à une procédure judiciaire contradictoire, qu’elle est directement accessible aux personnes concernées et qu’elle leur offre des perspectives raisonnables de succès. Elle ne voit par ailleurs aucune raison de penser que les griefs soulevés dans le cadre de pareille procédure ne seraient pas examinés dans un délai raisonnable, que la réparation octroyée serait incompatible avec les normes de la Convention ou qu’elle ne serait pas versée rapidement. La Cour relève que la loi d’indemnisation a, en outre, été assortie d’un vaste ensemble d’explications et de directives de la Cour suprême. Elle observe également l’évolution récente de la législation et des pratiques nationales mises en œuvre pour atténuer les mauvaises conditions de détention, notamment l’entrée en vigueur d’un nouveau code de procédure administrative en 2015 et les modifications apportées au code pénal, lequel prévoit désormais que le temps passé en détention provisoire est pris en compte pour réduire la longueur de la peine d’emprisonnement de nombreuses catégories de détenus. La Cour conclut que le nouveau recours compensatoire doit être considéré comme un recours effectif à utiliser pour les périodes de détention achevées dès lors que la législation russe fixe une norme d’espace personnel par détenu compatible avec les exigences découlant de l’article 3 de la Convention européenne en la matière (à savoir trois mètres carrés d’espace personnel par détenu, comme le recommande l’arrêt rendu en 2016 par la Grande Chambre dans l’affaire Muršić c. Croatie, requête no 7334/13) ou lorsque la détention en établissement pour peine n’a pas respecté la norme nationale. La Cour estime que tel était le cas de six des requérants (requêtes nos 66806/17, 17991/18, 19294/18, 21542/18, 31682/18 et 32545/18). Ceux-ci avaient formulé des griefs fondés, tirés de la violation de leurs droits à raison des conditions de détention inadéquates qu’ils avaient subies pendant la période, désormais achevée, de leur détention provisoire ou de leur emprisonnement pour peine.
La Cour juge qu’ils peuvent maintenant recourir à la loi d’indemnisation pour obtenir réparation et déclare donc leurs griefs fondés sur les articles 3 et 13 irrecevables pour non-épuisement des nouvelles voies de recours internes. Conformément aux dispositions transitoires de la loi d’indemnisation, tous ceux dont les requêtes étaient pendantes devant la Cour lorsque la loi est entrée en vigueur, ou ont été déclarées irrecevables à raison du non-épuisement des voies de recours internes, doivent exercer ledit recours dans un délai de 180 jours.
Dans ce contexte, la Cour décide d’étendre cette interprétation à toutes les requêtes analogues, c’est-à-dire celles dans le cadre desquelles les requérants se plaignent d’une période achevée de détention provisoire ou d’emprisonnement pour peine qui s’est déroulée en violation des normes internes. Lorsque la norme fixée par la législation nationale est apparemment incompatible avec les exigences de la Convention – c’est-à-dire lorsqu’elle se situe entre 2 et 2,5 mètres carrés d’espace personnel par détenu en établissement pour peine – l’effectivité du nouveau recours compensatoire est toutefois incertaine, même lorsque la période de détention est achevée. Tel est le cas de trois des requérants (requêtes nos 41743/17, 60185/17 et 14988/18).
La Cour décide donc d’ajourner ces requêtes et de demander aux parties de produire des observations écrites supplémentaires afin de clarifier la question de l’effectivité des recours compensatoires en pareilles situations.
Elle décide également d’ajourner les huit autres requêtes concernant des situations où la détention se poursuit (requérants dont la période de détention provisoire ou d’emprisonnement pour peine est encore en cours : requêtes nos 74497/17, 75804/17, 77181/17, 77265/17, 1249/18, 9152/18, 19837/18 et 29155/18) car elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier l’effectivité des recours préventifs ouverts. Il reste en effet à apprécier l’effectivité des recours judiciaires prévus par le code de procédure administrative, en particulier eu égard au caractère généralisé de la surpopulation dans les établissements pour peine. Les parties sont invitées à produire des observations écrites supplémentaires sur ce point également.
Dans l’attente de l’examen par la Cour de l’effectivité de ces recours internes, le traitement de toutes les requêtes nouvellement introduites qui soulèvent des questions analogues sera suspendu. La Cour continuera à traiter les affaires qui ont déjà été notifiées (« communiquées ») aux parties en examinant les propositions de règlement amiable, les déclarations unilatérales ou autres.
Albert ŽIROVNICKÝ c. République tchèque irrecevabilté du 15 décembre 2016 requêtes nos 60439/12 et 73999/12
article 3 : les recours internes tchèques contre les conditions de détention sont effectifs, réels et concrets au sens de la Conv EDH puisqu'ils offrent un espoir raisonnable de gain de cause. Par conséquent, ils doivent être épuisés.
95. La Cour rappelle que, dans l’appréciation de l’effectivité des remèdes concernant des allégations de mauvaises conditions de détention, la question décisive est de savoir si la personne intéressée peut obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, et pas simplement une protection indirecte de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. Ainsi, un recours exclusivement en réparation ne saurait être considéré comme suffisant s’agissant des allégations de conditions d’internement ou de détention prétendument contraires à l’article 3, dans la mesure où il n’a pas un effet « préventif » puisqu’il n’est pas à même d’empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre aux détenus d’obtenir une amélioration de leurs conditions matérielles de détention. En ce sens, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire (Shishanov c. République de Moldova, no 11353/06, § 74, 15 septembre 20152015 avec la référence à Mandić et Jović c. Slovénie, nos 5774/10 et 5985/10, § 107, 20 octobre 2011, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 116, 22 octobre 2009, Parascineti c. Roumanie, no 32060/05, § 38, 13 mars 2012, Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 50, 8 janvier 2013 et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012).
α) Voies de recours indemnitaires
96. S’agissant des recours que le droit tchèque offre à un requérant après qu’il a été libéré, la Cour a jugé dans l’affaire Jirsák précitée, que, pour ce qui est de mauvaises conditions de détention ou d’une blessure résultant de celles-ci, une procédure en dommages-intérêts contre l’État pouvait être considérée comme une voie de recours effective. Dans ce contexte, la Cour a noté que le requérant avait à l’époque le choix entre une action civile en dommages-intérêts fondée sur l’article 420 et suivants du code civil, une action en protection des droits de la personnalité fondée sur l’article 13 du même code et une action en dommages-intérêts en vertu de la loi no 82/1998.
97. Dans la présente affaire, la Cour n’a pas de raison de s’écarter de son raisonnement adopté dans l’affaire Jirsák précitée. Elle observe, d’une part, que le requérant lui-même a en l’espèce soulevé ses différents griefs tirés de l’article 3 de la Convention par le biais d’une demande en protection des droits de la personnalité fondée sur l’article 11 de l’ancien code civil, en 2006, et par le biais d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998, en 2010. Il ressort du dossier que les tribunaux examinent ces demandes au fond ; en l’espèce, dans les deux cas, les jugements non définitifs ont été adoptés en première instance, dont un faisant droit au requérant. D’autre part, d’autres exemples de décisions cités par le Gouvernement confirment qu’il s’agit de moyens disponibles susceptibles de mener à l’ouverture d’une procédure portant sur le bien-fondé des griefs tirés des mauvaises conditions de détention et, le cas échéant, à l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice subi de ce fait. La Cour observe dans ce contexte que, à la lumière de l’arrêt no II. ÚS 1191/08 adopté par la Cour constitutionnelle le 14 avril 2009 (cité dans la décision Bureš précitée), les justiciables devraient dorénavant plutôt se prévaloir, lorsqu’il s’agit de leur relation verticale avec l’État, de la voie offerte par la loi no 82/1998.
98. La Cour ne peut d’ailleurs accepter l’argument du requérant selon lequel la durée des procédures portant sur ses deux demandes, qui est certes inquiétante, rendrait ces recours ineffectifs en l’espèce. La Cour note à cet égard que le requérant est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce et que, par conséquent, les recours indemnitaires doivent être considérés comme étant seulement complémentaires aux recours préventifs, puisqu’ils ne peuvent pas mener à l’amélioration de sa situation. De plus, le requérant dispose du recours prévu par la loi no 82/1998 qui lui permet d’obtenir une indemnisation au titre de la durée de ces procédures, dont il a d’ailleurs tiré parti. Dans ces circonstances, davantage d’explications auraient été nécessaires de la part du requérant quant à la question de savoir pourquoi la durée des procédures qu’il avait engagées priverait les recours en question de leur caractère effectif (voir, mutatis mutandis, Merzaļijevs c. Lettonie, (déc.), no 1088/10, § 75, 13 novembre 2014).
99. Enfin, la Cour ne partage pas l’avis du requérant selon lequel ces recours seraient ineffectifs en raison des règles procédurales applicables en l’espèce, dont celles régissant la répartition de la charge de la preuve.
β) Voies de recours préventives
100. En l’espèce, la Cour observe que, si le requérant dispose de recours compensatoires pouvant mener, le cas échéant, à l’octroi d’une indemnisation pécuniaire en raison de ses mauvaises conditions de détention, ces recours ne sont pas susceptibles d’améliorer ces conditions. Il convient donc d’examiner si le requérant disposait également d’un recours préventif effectif, qui est des plus utile et indispensable pour une protection effective dans ces circonstances (Ananyev et autres, précité, §§ 97-98). Pour ce faire, la Cour va examiner les recours mentionnés par le Gouvernement pour vérifier s’ils étaient adéquats, effectifs et de nature à permettre un redressement direct et approprié des conditions de détention dénoncées par le requérant.
101. Le Gouvernement soutient notamment que le requérant devait en premier lieu s’adresser au procureur compétent en matière de surveillance.
102. La Cour note en effet que, en vertu de l’article 78 de la loi no 169/1999, il incombe aux procureurs régionaux de veiller au respect de la réglementation juridique lors de l’exécution des peines privatives de liberté ; à ce titre, il convient de noter que l’ordre juridique tchèque contient tant les règles relatives à la protection contre le tabagisme passif en prison que les règles relatives à l’espace personnel des détenus. Aux fins de cette surveillance, les procureurs peuvent, entre autres, effectuer des visites dans les prisons et s’entretenir avec les détenus. L’article 26 de la même loi donne à ces derniers le droit de saisir le procureur directement et de solliciter un entretien avec lui. Conformément à l’article 16a § 5 de la loi no 283/1993, introduit à la suite des instructions générales du Procureur suprême, les procureurs ont l’obligation d’examiner de telles plaintes et demandes. Le cas échéant, les procureurs émettent des ordres qui s’imposent aux services pénitentiaires et doivent être immédiatement mis en œuvre (voir, mutatis mutandis, Sakin c. Turquie (déc.), no 20616/13, § 33, 28 juin 2016, et, a contrario, Ananyev et autres, précité, § 104).
103. La Cour observe par ailleurs que la compétence des procureurs pour se pencher sur des griefs concernant les différents aspects de l’exécution d’une peine privative de liberté a été confirmée par la Cour constitutionnelle qui a jugé que de tels griefs devaient d’abord être soulevés devant le procureur en vertu de l’article 78 de la loi no 169/1999 (paragraphe 56 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis, Sakin, décision précitée, § 34).
104. La Cour note enfin qu’il ne ressort ni des informations publiées par les autorités nationales ni des rapports du CPT pertinents en l’espèce que la surpopulation carcérale constitue un problème structurel en République tchèque auquel le parquet n’est pas en mesure de remédier (voir, a contrario, Ananyev et autres, précité, § 111, et, a contrario, Varga et autres c. Hongrie, nos 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, et 64586/13, § 63, 10 mars 2015).
105. À la lumière des considérations susmentionnées et des informations fournies par le Gouvernement, dont des exemples d’ordres visant à l’amélioration ou à la modification des conditions matérielles de détention (paragraphe 69 ci-dessus), la Cour considère que le recours devant le procureur fondé sur la loi no 169/1999 était accessible au requérant et pouvait a priori mener au redressement de sa situation. Elle souligne à cet égard que le requérant n’a pas présenté d’arguments permettant de conclure qu’un tel recours se serait révélé ineffectif ni expliqué pourquoi il ne s’en est pas prévalu, à l’exception de ses demandes concernant deux aspects de sa détention dans la prison de Plzeň-Bory (paragraphe 36 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant aurait d’abord dû soulever ses griefs relatifs au tabagisme passif et aux mauvaises conditions de détention devant les procureurs compétents (voir, mutatis mutandis, Kokavecz v. Hungary ((déc.), no 27312/95, 20 avril 1999). Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Stoian c. Roumanie, no 33038/04, § 101, 8 juillet 2014, et la jurisprudence qui y est citée). Au contraire, il y a intérêt à saisir l’autorité compétente, afin de lui permettre de développer les droits existants (voir, mutatis mutandis, Ciupercescu c. Roumanie, no 35555/03, § 169, 15 juin 2010).
106. La Cour estime ensuite que les requérants qui ne seraient pas satisfaits de l’issue de leur recours devant le procureur doivent soumettre leurs griefs à la Cour constitutionnelle. Il incombe en effet à cette juridiction d’examiner les actes ou les omissions que les requérants estiment contraires à l’article 3 de la Convention à travers le prisme des principes et des standards dégagés par la Cour dans sa jurisprudence (Shishanov, précité, § 77). La Cour constitutionnelle peut non seulement constater une violation des droits fondamentaux mais aussi adopter des mesures provisoires et ordonner à l’autorité compétente de mettre fin à la violation en question. Or le requérant n’a en l’espèce jamais dénoncé les conditions matérielles de sa détention devant la Cour constitutionnelle, même après le rejet par le procureur des demandes qu’il lui avait adressées (paragraphe 36 ci-dessus).
γ) Conclusion
107. Pour ce qui est des recours préventifs, la Cour considère donc que le recours devant le procureur fondé sur la loi no 169/1999 et le recours constitutionnel qui le requérant pourrait introduire par la suite constituent en droit tchèque des moyens effectifs à épuiser pour une personne détenue qui souhaite contester les conditions matérielles de sa détention. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si l’action administrative mentionnée par le Gouvernement revêt également un caractère effectif.
Pour ce qui est de la réparation du préjudice subi du fait des conditions de détention, le droit tchèque permet de réclamer des dommages-intérêts à l’État, notamment par le biais de la demande fondée sur la loi no 82/1998.
Ce constat est sans préjudice de la possibilité pour la Cour de réévaluer le caractère effectif de ces recours à la lumière des informations qui lui auront été fournies plus tard, entre autres quant au point de savoir si les autorités compétentes prennent en compte l’effet cumulatif des conditions de détention et si elles accordent du poids au principe général de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.
108. En l’espèce, étant donné que les recours préventifs n’ont pas été dûment exercés et que les recours indemnitaires sont pendants, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les recours dont il disposait en droit interne et qu’il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement.
109. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
1. Article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention
110. Le Gouvernement argue tout d’abord que les allégations formulées par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention ne sont pas défendables. Il renvoie ensuite à son argumentation relative au non‑épuisement des voies de recours internes, rappelant que le requérant disposait de recours effectifs pour ses griefs relatifs aux conditions de détention.
111. Le requérant soutient que sa demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998 ne constitue pas un recours effectif à l’égard de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention, notamment parce qu’il doit supporter la charge de la preuve et parce que la procédure accuse des retards. Il indique également que toutes ses actions dirigées contre les manquements à l’article 3 de la Convention ont été rejetées, souvent sur les seules affirmations de l’administration pénitentiaire et sans aucune vérification de ses allégations.
112. Indépendamment de la question de savoir si les griefs du requérant formulés sur le terrain de l’article 3 peuvent être considérés comme « défendables », la Cour rappelle que l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. En l’occurrence, elle a constaté que le droit tchèque offrait aux requérants, tant aux détenus qu’à ceux ayant retrouvé leur liberté, des recours préventifs et indemnitaires effectifs (paragraphe 107 ci-dessus). Ce faisant, elle a déjà rejeté les arguments que le requérant lui soumet à présent sur le terrain de l’article 13 de la Convention (paragraphes 98-99 ci-dessus).
113. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Article 13 combiné avec l’article 6 de la Convention
114. Le requérant soutient que le recours prévu par la loi no 82/1998, censé mener à une indemnisation pour durée excessive de la procédure, en l’occurrence des procédures no 34 C 112/2007 et no 21 C 152/2010, n’est pas effectif car il accuse en l’espèce une lenteur abusive. Il a observé à cet égard que les procédures indemnitaires no 14 C 29/2011 et no 23 C 83/2013 restaient pendantes.
115. Le Gouvernement estime que même si la durée des procédures indemnitaires peut donner à penser que des retards s’y produisent, ce fait ne signifie pas en soi que le recours en question est ineffectif en tant que tel (Hanzl et Špadrna c. République tchèque (déc.), no 30073/06, 15 janvier 2013).
116. La Cour rappelle avoir jugé que le recours indemnitaire introduit dans le système juridique tchèque en avril 2006 par un amendement à la loi no 82/1998 doit être considéré comme effectif et accessible pour dénoncer un dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (Vokurka c. République tchèque (déc.), no 40552/02, § 65, 16 octobre 2007, et Golha c. République tchèque, no 7051/06, § 70, 26 mai 2011). La Cour a eu aussi l’occasion de dire que la durée excessive de l’examen d’un recours indemnitaire ne remet pas nécessairement en cause l’effectivité d’un tel recours (Belperio et Ciarmoli c. Italie, no 7932/04, § 53, 21 décembre 2010, Golha, précité, § 73, et Hajrudinović c. Slovénie, no 69319/12, § 58, 21 mai 2015) ), bien qu’elle ait été plus stricte dans son appréciation dans l’affaire Xynos c. Grèce (no 30226/09, § 45, 9 octobre 2014).
117. En l’espèce, la Cour observe que les procédures indemnitaires no 14 C 29/2011 et no 23 C 83/2013 étaient pendantes depuis peu au moment de l’introduction des présentes requêtes et que, depuis la production de leurs observations en 2014, les parties ne l’ont pas informée des éventuels développements de ces procédures.
118. Dans ces circonstances particulières qui diffèrent de l’affaire Xynos susmentionnée, la Cour estime que la durée des procédures indemnitaires menées en l’espèce ne semble suffisamment importante ni pour entraîner une violation de l’article 6 de la Convention sur ce point, ni pour remettre en cause à elle seule, sur le terrain de l’article 13, l’effectivité du recours prévu par la loi no 82/1998 (voir, mutatis mutandis, Hanzl et Špadrna, décision précitée).
119. Au regard de son grief tiré des procédures no 34 C 112/2007 et no 21 C 152/2010, le requérant doit donc être considéré comme disposant d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
120. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
121. Pour autant que le requérant entend se plaindre de la durée des procédures no 34 C 112/2007 et no 21 C 152/2010, dans lesquelles il demande une indemnisation pour la violation alléguée de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention, la Cour estime qu’il convient d’examiner cette partie de la requête sur le terrain de l’article 6.
122. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, pour ce qui est des griefs tirés de la durée excessive des procédures judiciaires, l’ordre juridique tchèque offre à la fois un recours préventif et un recours indemnitaire. En effet, depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, de l’amendement à la loi no 6/2002 sur les juges et les tribunaux, la demande tendant à la fixation d’un délai pour l’accomplissement d’un acte procédural, prévue à l’article 174a de cette loi, doit être considérée comme un recours effectif. Le Gouvernement soumet, à l’appui de cette thèse, onze décisions judiciaires rendues entre 2009 et 2013 par lesquelles les tribunaux tchèques ont accueilli de telles demandes (Bergmann c. République tchèque, no 8857/08, § 49, 27 octobre 2011). Or, selon le Gouvernement, le requérant ne s’en est pas prévalu.
S’agissant du recours indemnitaire, le Gouvernement indique à nouveau que le requérant dispose d’un recours effectif prévu par la loi no 82/1998, dont il a fait usage à l’égard de la durée des deux procédures litigieuses. À ses yeux, les procédures indemnitaires no 14 C 29/2011 et no 23 C 83/2013 étant pendantes, le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
123. Le requérant déclare que, si les procédures litigieuses sont encore pendantes, ce n’est ni de son fait ni en raison de leur prétendue complexité (paragraphe 47 ci-dessus). Il soutient que ces recours devraient être traités rapidement dans la mesure où il est quotidiennement soumis aux violations qu’il dénonce.
124. En ce qui concerne le recours préventif envisagé par l’article 174a de la loi no 6/2002 dans sa version en vigueur après le 1er juillet 2009, la Cour rappelle que, après avoir refusé de juger de son effectivité en l’absence d’exemple concret démontrant son fonctionnement (Prodělalová c. République tchèque, no 40094/08, § 52, 20 décembre 2011), elle a considéré, à la lumière de tels exemples fournis par le Gouvernement, que ce recours doit être considéré comme effectif dans le contexte des procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale (Drenk c. République tchèque, no 1071/12, § 70, 4 septembre 2014). Prenant maintenant en compte les décisions rendues sur le fondement de l’article 174a de la loi no 6/2002 dans toutes sortes de procédures, civiles ou pénales (paragraphe 122 ci-dessus), la Cour estime que rien ne l’empêche à présent de conclure que ce recours peut déboucher sur l’accélération de la procédure ou l’empêcher de durer plus que de raison (Holzinger (no 1) c. Autriche, no 23459/94, § 22, CEDH 2001-I, et Grzinčič c. Slovénie, no 26867/02, § 95, 3 mai 2007). Elle est donc d’avis qu’il satisfait au critère d’« effectivité » tel que l’a forgé la jurisprudence récente.
125. En ce qui concerne le recours indemnitaire, la Cour renvoie à sa conclusion ci-dessus (paragraphe 119 ci-dessus).
126. La Cour ne peut donc que constater que, pour ce qui est de la durée des procédures litigieuses, le requérant disposait d’un recours préventif effectif, qu’il est resté en défaut d’exercer, et que les recours indemnitaires qu’il a intentés restent pendants. Dès lors, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées en l’espèce et il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement.
127. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.