ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Pour plus de sécurité, fbls expulsion est sur : https://www.fbls.net/3expulsion.htm
"Une expulsion vers un Etat qui applique des châtiments corporels,
est un acte inhumain et dégradant"
Frédéric Fabre docteur en droit.
ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"
Cliquez
sur un bouton comme à droite ou un lien bleu pour accéder aux informations juridiques gratuites sur :
- LE DEVOIR D'ACCUEIL DES MIGRANTS AVANT QUE LEUR DEMANDE NE SOIT TRAITEE
- L'INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES ET AUTORISATION DES EXPULSIONS INDIVIDUELLES
- LES PRINCIPES POUR EXAMINER UNE EXPULSION INDIVIDUELLE
- LES ÉTATS DANGEREUX POUR INTERDIRE UNE EXPULSION INDIVIDUELLE
- LES EXTRADITIONS ET LE MANDAT D'ARRÊT EUROPEEN AU SEIN DE L'UE
- LA LOI ET LA JURISPRUDENCE INTERNE FRANÇAISE.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
DEVOIR D'ACCUEIL DES MIGRANTS AVANT QUE LEUR DEMANDE NE SOIT TRAITÉE
N.H. et autres c. France du requêtes n° 28820/13, 75547/13 et 13114/15
Article 3 : Conditions d’existence inhumaines et dégradantes de demandeurs d’asile vivant dans la rue, isolés et privés de moyens de subsistance : violation de la Convention
Les présentes requêtes concernent cinq demandeurs d’asile majeurs isolés en France. Ils affirment ne pas avoir pu bénéficier d’une prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national et avoir, dès lors, été contraints de dormir dans la rue dans des conditions inhumaines et dégradantes pendant plusieurs mois. La Cour observe que le requérant N.H. a vécu dans la rue sans ressources financières, de même que les requérants K.T. et A.J. qui n’ont perçu l’Allocation temporaire d’attente (ATA) qu’après des délais de 185 et de 133 jours. De plus, avant de pouvoir faire enregistrer leur demande d’asile, N.H., K.T. et A.J. ont été soumis à des délais pendant lesquels ils n’étaient pas en mesure de justifier de leur statut de demandeur d’asile. La Cour considère que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations prévues par le droit interne. Elles doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles les requérants se sont trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente d’être attaqués et volés. Les requérants ont été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité. La Cour juge que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate des autorités françaises et le fait que les juridictions internes leur ont systématiquement opposé le manque de moyens des instances compétentes au regard de leurs conditions de jeunes majeurs isolés ont atteint le seuil de gravité fixé par l’article 3 de la Convention. Les trois requérants N.H., K.T. et A.J. se sont retrouvés, par le fait des autorités françaises, dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention.
Principaux faits
Requête n° 28820/13 – N.H.
Le requérant N.H., né en 1993, est un ressortissant afghan résidant à Paris. Arrivé en France en mars 2013, il obtient une domiciliation postale auprès de l’association France Terre d’Asile. Le 4 avril 2013, il se présenta à la préfecture de police de Paris pour déposer une demande d’asile et reçut une convocation pour le 9 juillet 2013.. Le 18 avril 2013, il forma un recours en référé devant le Tribunal administratif (TA) de Paris, afin qu’il soit enjoint à l’administration d’examiner sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le juge des référés rejeta sa demande. N.H. fit appel de cette décision devant le Conseil d’Etat. Le juge des référés du Conseil d’Etat rejeta sa requête. Le 3 octobre 2013, N.H. fut informé que sa demande d’asile serait examinée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) mais qu’il n’était pas admis au séjour au titre de l’asile dans la mesure où il avait déjà déposé une demande d’asile au Danemark. Le même jour, N.H. se rendit à Pôle emploi pour solliciter l’ouverture de ses droits à l’Allocation temporaire d’attente (ATA). Cette allocation lui fut refusée au motif qu’il n’avait pas présenté la lettre l’informant que l’OFPRA avait enregistré sa demande d’asile. Le requérant vécut dans la rue, ne bénéficiant d’aucune prise en charge matérielle comme financière. Le 13 novembre 2013, l’OFPRA refusa de lui octroyer le statut de réfugié, mais lui accorda le bénéfice de la protection subsidiaire en raison du contexte de violence dans sa province d’origine. Le 17 décembre 2013, l’association Corot entraide Auteuil, subventionnée à hauteur de 60 % par l’Etat, lui proposa un hébergement.
Requête n° 75547/13 – S.G., K.T. et G.I.
Le requérant S.G., né en 1987, est un ressortissant russe, résidant à Carcassonne. Il arriva en France le 15 juillet 2013 et déposa le lendemain une demande d’asile auprès de la préfecture. Il reçut à cette occasion une offre d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), l’acceptation de cette offre conditionnant le bénéfice de l’ATA. Aucune place n’étant disponible, il dut vivre dans une tente prêtée par des particuliers sur les berges de l’Aude. Le 2 août 2013, l’OFPRA enregistra sa demande d’asile. Le 18 septembre 2013, il obtint le bénéfice de l’ATA. Le 7 octobre 2013, il saisit le juge des référés du TA de Montpellier d’un recours en référé liberté pour qu’il soit enjoint à l’Etat de lui accorder un logement en sa qualité de demandeur d’asile. Le juge des référés rejeta sa requête. Le 13 octobre 2014, l’OFPRA rejeta sa demande. Le préfet de l’Hérault prit à son encontre trois arrêtés successifs portant obligation de quitter le territoire. S.G. fit des recours pour en obtenir l’annulation. Le requérant G.I., né en 1988, est un ressortissant géorgien, résidant à Carcassonne. Il arriva en France le 25 mai 2013 et déposa, le 28 mai 2013, une demande d’asile auprès de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon. Il vécut dehors. L’OFPRA enregistra sa demande d’asile le 19 juin 2013 et G.I. obtint le bénéfice de l’ATA le 23 août 2013. Le 7 octobre 2013, G.I. forma devant le juge des référés du TA de Montpellier un recours analogue à celui introduit par S.G. Le juge des référés rejeta la requête pour les mêmes motifs que pour S.G. Le 11 avril 2014, G.I. se désista de sa demande d’asile et sollicita une aide au retour volontaire dans son pays d’origine. Le requérant K.T., né en 1990, est un ressortissant russe, résidant à Carcassonne. Il arriva en France le 7 janvier 2013 et déposa une demande d’asile auprès de la préfecture. Sa demande d’asile fut enregistrée le 14 juin 2013 par l’OFPRA et il perçut l’ATA à compter du 15 juillet 2013. Il fut contraint de vivre dans une tente sur les berges de l’Aude. Le 7 octobre 2013, il forma devant le juge des référés du TA de Montpellier un recours analogue à celui de S.G. Le juge des référés rejeta la requête.
A plusieurs reprises, K.T. essaya d’obtenir, en vain, un titre de séjour.
Requête n° 13114/15 – A.J.
Le requérant A.J., ressortissant iranien, est né en 1974 et réside à Paris. A.J. exerçait la profession de journaliste en Iran. Il parvint à fuir l’Iran et gagna la France le 9 septembre 2014. Il fut domicilié le 14 octobre 2014, par l’association France Terre d’Asile. A.J. se présenta à la préfecture de police de Paris le 23 octobre 2014 pour déposer sa demande d’asile qui ne fut pas enregistrée et où il reçut une convocation pour le 7 janvier 2015. Le 4 novembre 2014 il sollicita un hébergement auprès du préfet de la région Ile-de-France qui lui répondit ne pas pouvoir répondre favorablement à sa demande en raison de la saturation du dispositif national d’accueil. Le 13 novembre 2014, A.J. déposa une requête en référé liberté devant le juge des référés du TA de Paris afin qu’il soit enjoint au préfet d’examiner sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui indiquer un centre d’accueil ou d’hébergement. Le juge des référés rejeta sa demande. Le Conseil d’Etat, rejeta également la requête. Lors du rendez-vous à la préfecture du 7 janvier 2015, A.J. reçut un formulaire de demande d’admission au séjour au titre de l’asile qu’il déposa complété le 22 janvier 2015, date à laquelle il obtint une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français. Le 28 janvier 2015, A.J. se rendit à Pôle emploi pour solliciter l’ouverture de ses droits à l’ATA. Pôle emploi refusa d’enregistrer sa demande au motif qu’A.J. n’était pas en mesure de présenter un récépissé constatant le dépôt de sa demande d’asile. L’OFPRA enregistra la demande d’asile le 5 février 2015. Le 12 février 2015, A.J. obtint l’ouverture de ses droits à l’ATA. A compter du 14 avril 2015, A.J. fut logé dans un hôtel dans le cadre de l’hébergement en hôtel des adultes isolés. Le 23 avril 2015, l’OFPRA lui reconnut la qualité de réfugié et au mois de juin 2015, A.J. obtint un hébergement à Paris au sein de la maison des journalistes en chambre individuelle. Il bénéficia également de tickets-restaurants journaliers et de titres de transport.
Article 3
La Cour juge approprié d’examiner les allégations des requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention uniquement. La Cour constate que l’avocat de G.I. (n° 75547/13) l’a informée ne pas avoir pu contacter son client, malgré plusieurs tentatives et des recherches infructueuses. Elle conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête et qu’il y a donc lieu de radier l’affaire du rôle en ce qui le concerne. La Cour note que les requérants reprochent aux autorités françaises, d’une part, l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de bénéficier en pratique de la prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national afin de pourvoir à leurs besoins essentiels et, d’autre part, l’indifférence des autorités à leur encontre. La Cour doit déterminer si les requérants étaient confrontés à une situation de dénuement matériel extrême pouvant soulever un problème sous l’angle de l’article 3. La Cour relève que les requérants, majeurs isolés sur le territoire français, se trouvaient dans une situation de dénuement matériel. Pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, ils dépendaient entièrement de la prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national qui devait leur être accordée tant qu’ils étaient autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile. Selon le système français alors en vigueur, les étrangers en situation irrégulière souhaitant obtenir l’asile en France, devaient demander leur admission au séjour au titre de l’asile. La Cour remarque que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixait en principe aux autorités un délai de 15 jours, à compter du moment où le demandeur se présentait à la préfecture muni des pièces requises, pour enregistrer sa demande d’asile et l’autoriser à séjourner régulièrement. A l’époque des faits, dans la pratique, ce délai se portait en moyenne de 3 à 5 mois selon les préfectures. La Cour constate qu’entre le moment où N.H. et K.T. se sont présentés à la préfecture pour solliciter l’asile et la date à laquelle ils ont obtenu l’enregistrement de leur demande d’asile par la préfecture, se sont écoulés 95 jours pour N.H. et 131 jours pour K.T. La Cour remarque que A.J. a été muni d’une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, 90 jours après avoir sollicité l’asile auprès des services de la préfecture. Enfin, la Cour relève que S.G. a obtenu un récépissé constatant le dépôt de sa demande d’asile 28 jours après son premier rendez-vous à la préfecture. N.H., K.T. et A.J. font ainsi valoir que, pendant ces périodes, ils n’avaient pas le statut de demandeurs d’asile et qu’en conséquence ils ne pouvaient prétendre ni à un hébergement ni à l’ATA et qu’ils vivaient en situation irrégulière en France. La Cour constate qu’avant l’enregistrement de leur demande d’asile, les requérants ne pouvaient en effet pas justifier de leur statut. Pour ce motif, N.H. et A.J. ont saisi le juge administratif d’un recours en référé liberté pour qu’il soit enjoint au préfet de police d’examiner leur demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de leur délivrer une Autorisation provisoire de séjour (APS). Ces procédures n’ont pas abouti. Par ailleurs, la Cour relève que le droit interne conditionnait la perception de l’ATA à la production devant Pôle emploi, d’une autorisation de séjour au titre de l’asile et d’une preuve de dépôt effectif de la demande devant l’OFPRA. N.H., K.T. et A.J. exposent que, faute de pouvoir justifier de leur qualité de demandeurs d’asile, ils ont vécu respectivement pendant 95 jours, 131 jours et 90 jours dans la peur d’être arrêtés et expulsés vers leur pays d’origine. La Cour constate qu’avant d’obtenir une APS, les demandeurs d’asile risquaient d’être expulsés vers leur pays d’origine. La Cour, qui se fonde sur les observations des tierces parties intervenantes et sur des rapports officiels des autorités françaises, ne met pas en doute les craintes d’être expulsé vers leur pays d’origine que nourrissaient N.H., K.T. et A.J.
La Cour note que, pendant l’ensemble de la procédure d’asile qui a débuté avec la domiciliation par une association ou par le premier rendez-vous à la préfecture, les requérants ont tous vécu dans la rue, soit sous les ponts à Paris, soit sur les berges d’une rivière (l’Aude) dans une tente prêtée par des particuliers. En outre, elle constate que N.H. n’a jamais perçu l’ATA malgré ses démarches auprès des autorités. Il a vécu sous les ponts du canal Saint Martin dans une situation d’extrême précarité du 26 mars au 17 décembre 2013, soit pendant 262 jours. De la même façon, A.J. a vécu dans la rue dans des conditions analogues. Il y est resté 170 jours, du 23 octobre 2014 au 14 avril 2015. Malgré les démarches et recours d’A.J., ses droits à l’ATA n’ont été ouverts que le 12 février 2015 et il a effectivement perçu l’allocation le 5 mars 2015. A.J. est donc resté sans ressources du 23 octobre 2014 au 5 mars 2015, soit 133 jours. La Cour relève enfin que S.G. et K.T. ont vécu au minimum 9 mois sur les berges de l’Aude, chacun dans une tente individuelle. La Cour remarque que K.T., qui n’était plus en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 21 mai 2013, a effectivement bénéficié de l’ATA le 15 juillet 2013. A compter de sa première présentation à la préfecture, K.T. est donc resté 185 jours sans ressources. S.G. a perçu l’ATA 63 jours après sa première présentation en préfecture. La Cour prend donc acte que N.H. a vécu dans la rue sans ressources financières et que K.T. et A.J. ont vécu dans les mêmes conditions, n’ont perçu l’ATA qu’après des délais respectivement de 185 et de 133 jours. La Cour tient à souligner qu’elle est consciente de l’augmentation continue du nombre de demandeurs d’asile depuis 2007 et de la saturation du Dispositif national d’accueil (DNA) qui en est graduellement résulté. La Cour relève que les faits qui lui sont soumis s’inscrivent dans une hausse progressive et ne se sont pas déroulés dans un contexte d’urgence humanitaire qualifiable d’exceptionnelle. La Cour constate les efforts consentis par les autorités françaises pour créer des places d’hébergement supplémentaires et pour raccourcir les délais d’examen des demandes d’asile. Toutefois, ces circonstances n’excluent pas que la situation des demandeurs d’asile ait pu être telle qu’elle est susceptible de poser un problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention. La Cour souligne avant tout qu’avant de pouvoir faire enregistrer leur demande d’asile, N.H., K.T. et A.J. ont été soumis à des délais pendant lesquels ils n’ont pas été en mesure de justifier de leur statut de demandeur d’asile. N.H. a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire 229 jours après son arrivée en France, que 188 jours se sont écoulés entre la première convocation à la préfecture de police d’A.J. et la reconnaissance de son statut de réfugié par l’OFPRA et que les demandes d’asile de S.G. et de K.T. ont été rejetées respectivement par l’OFPRA au bout de délais de 448 jours et de 472 jours. En conclusion, la Cour constate que les autorités françaises ont manqué à l’encontre des requérants à leurs obligations prévues par le droit interne. En conséquence, elles doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles les requérants se sont trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente d’être attaqués et volés. Les requérants ont été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité. Cette situation a suscité chez eux des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité, propres à conduire au désespoir. La Cour juge que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate des autorités françaises et le fait que les juridictions internes leur ont systématiquement opposé le manque de moyens des instances compétentes au regard de leurs conditions de jeunes majeurs isolés ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. N.H., K.T. et A.J. se sont retrouvés, par le fait des autorités françaises, dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention. Concernant le requérant S.G., la Cour note qu’il a obtenu un récépissé constatant le dépôt de sa demande d’asile 28 jours après son premier rendez-vous à la préfecture et que – s’il a effectivement vécu sous une tente – il a perçu l’ATA 63 jours après sa première présentation à la préfecture. Aussi difficile que cette période ait pu être pour lui, il a disposé ensuite de moyens lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. La Cour considère donc que ces conditions d’existence n’ont pas atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 en ce qui le concerne.
CEDH
a) Principes généraux
155. La Cour rappelle que, ni la Convention, ni ses Protocoles, ne consacrent le droit à l’asile politique (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 188, 13 février 2020) et que les États contractants ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non‑nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 167).
156. Toutefois les États doivent notamment prendre en considération l’article 3 de la Convention, qui consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, parmi d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). L’interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée par l’article 3 de la Convention est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 158, 15 décembre 2016).
157. Par ailleurs, la Cour ne peut que réitérer sa jurisprudence bien établie, selon laquelle, vu le caractère absolu de l’article 3 de la Convention, les facteurs liés à un afflux croissant de migrants ne peuvent pas exonérer les État contractants de leurs obligations au regard de cette disposition (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 223 ; Khlaifia et autres, précité, § 184). Or, si les contraintes inhérentes à une crise migratoire ne sauraient, à elles seules, justifier une méconnaissance de l’article 3, la Cour estime qu’il serait pour le moins artificiel d’examiner les faits des espèces qui lui sont soumises en faisant abstraction du contexte général dans lequel ils se sont déroulés (Khlaifia et autres, précité, § 184).
158. La Cour a dit à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, un traitement inhumain ou dégradant doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 219, Khlaifia et autres, précité, § 159 et Tarakhel c. Suisse, précité, § 94).
159. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 220, Khlaifia et autres, précité, § 159 et Svinarenko et Slyadnev c. Russie, [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 115, 17 juillet 2014).
160. La Cour estime nécessaire de rappeler que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 99, CEDH 2001‑I). Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 85, 26 avril 2005).
161. La Cour a cependant considéré, dans une affaire concernant un autre État membre de l’Union européenne, que la question à trancher s’agissant de demandeurs d’asile se plaignant de leur situation de dénuement total ne se posait pas en ces termes. Ainsi qu’il ressort du cadre juridique décrit ci‑dessus, l’obligation de fournir un hébergement ou des conditions matérielles décentes aux demandeurs d’asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités de l’État défendeur concerné en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union européenne, à savoir la « directive Accueil » (voir paragraphe 95 ci‑dessus) (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 250).
162. La Cour rappelle ensuite que les demandeurs d’asile peuvent être considérés comme vulnérables du fait de leur parcours migratoire et des expériences traumatiques qu’ils peuvent avoir vécues en amont (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 232 ; Ilias et Ahmed c. Hongrie, ([GC], no 47287/15, § 192, 21 novembre 2019). La Cour note que le besoin de protéger les demandeurs d’asile fait l’objet d’un large consensus à l’échelle internationale et européenne, comme cela ressort de la Convention de Genève, du mandat et des activités du Haut‑Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que des normes figurant dans la « directive Accueil » de l’Union européenne (voir M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 251).
163. Elle rappelle qu’elle n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (Budina c. Russie (déc.), no 45603/05, 18 juin 2009).
164. La Cour a déjà jugé que la gravité de la situation de dénuement dans laquelle s’était trouvé un requérant, demandeur d’asile, resté plusieurs mois dans l’incapacité à répondre à ses besoins les plus élémentaires, entendus comme se nourrir, se laver et se loger, dans l’angoisse permanente d’être attaqué et volé, dans l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 254) et combinée à l’inertie des autorités compétentes en matière d’asile avaient emporté violation de l’article 3 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 262‑263 ; voir postérieurement à M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité : Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, no 8319/07 et no 11449/07, § 283, 28 juin 2011, et F.H. c. Grèce, no 78456/11, §§ 107‑111, 31 juillet 2014).
b) Application des principes en l’espèce
165. Les requérants reprochent aux autorités françaises, d’une part, l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison de l’action ou des omissions délibérées de ces autorités, de bénéficier en pratique de la prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national afin de pourvoir à leurs besoins essentiels et, d’autre part, l’indifférence de ces mêmes autorités à leur encontre.
166. La Cour souligne que, aux termes des articles 19 et 32 § 1 de la Convention, elle n’est pas compétente pour appliquer les règles de l’Union européenne ou pour en examiner les violations alléguées, sauf si et dans la mesure où ces violations pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. D’une manière plus générale, il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, si nécessaire en conformité avec le droit de l’UE, le rôle de la Cour se bornant à déterminer si les effets de leurs décisions sont compatibles avec la Convention (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 110, 3 octobre 2014). En l’espèce, la Cour doit seulement déterminer si les requérants, alors âgés de 20, 23, 26 et 40 ans, célibataires, en bonne santé et sans enfant à charge, étaient confrontés à une situation de dénuement matériel extrême pouvant soulever un problème sous l’angle de l’article 3 (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 252).
167. La Cour retient tout d’abord, ainsi que le soutiennent les requérants, qu’au regard du droit interne, les demandeurs d’asile n’étaient pas autorisés à exercer une activité professionnelle pendant la durée de la procédure, sauf dans les conditions restrictives énoncées par l’article R. 742‑2 du CESEDA (voir paragraphe 72 ci‑dessus). En outre, la Cour relève que les requérants, majeurs isolés sur le territoire français, étaient en situation de dénuement. Elle en déduit que pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, ils dépendaient entièrement de la prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national (voir paragraphes 77 à 82 ci‑dessus) qui devait leur être accordée tant qu’ils étaient autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile (voir paragraphes 95 à 97 ci‑dessus).
168. La Cour relève ensuite que selon le système français alors en vigueur (voir paragraphes 70 à 72, 146 et 150 ci‑dessus), les étrangers en situation irrégulière souhaitant obtenir l’asile en France devaient, dans un premier temps, demander leur admission au séjour au titre de l’asile. La Cour remarque que l’article R. 742‑1 du CESEDA (voir paragraphe 72 ci‑dessus) fixait en principe aux autorités un délai de quinze jours à compter du moment où un demandeur se présentait à la préfecture avec une domiciliation et les pièces requises (voir paragraphe 72 ci‑dessus) pour enregistrer sa demande d’asile et l’autoriser à séjourner régulièrement.
169. La Cour note qu’à l’époque des faits, dans la pratique, ce délai était en moyenne de trois à cinq mois selon les préfectures (voir paragraphes 146 et 150 ci‑dessus). En l’espèce, la Cour constate qu’entre le moment où N.H. (requête no 28820/13) et K.T. (requête no 75547/13) se sont présentés à la préfecture pour solliciter l’asile et la date à laquelle ils ont obtenu l’enregistrement de leur demande d’asile par la préfecture se sont écoulés, pour le premier, 95 jours et pour le second, 131 jours. La Cour remarque par ailleurs qu’A.J. (requête no 13114/15) a été muni d’une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile 90 jours après avoir sollicité l’asile auprès des services de la préfecture. La Cour note que le Gouvernement a reconnu que le délai auquel N.H. (requête no 28820/13) avait été soumis pour procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile « n’est pas satisfaisant ». Enfin, la Cour relève que S.G. (requête no 75547/13) a obtenu un récépissé constatant le dépôt de sa demande d’asile 28 jours après son premier rendez-vous à la préfecture.
170. La Cour souligne toutefois qu’il ne lui appartient aucunement de se prononcer sur ces délais (voir paragraphe 169 ci‑dessus) mais qu’il lui revient en revanche d’examiner leur incidence sur la situation des requérants afin de déterminer si le seuil de gravité prévu par l’article 3 de la Convention était atteint. À ce titre, N.H. (requête no 28820/13), K.T. (requête no 75547/13) et A.J. (requête no 13114/15) font valoir que, pendant ces périodes (voir paragraphe 169 ci‑dessus), ils n’avaient pas le statut de demandeur d’asile et qu’en conséquence, ils ne pouvaient prétendre ni à un hébergement ni à l’ATA et vivaient en situation irrégulière en France.
171. La Cour constate qu’avant l’enregistrement de leur demande d’asile (voir paragraphe 169 ci‑dessus), les requérants ne pouvaient en effet pas justifier de leur statut. La Cour note d’ailleurs que pour ce motif, N.H. (requête no 28820/13) et A.J. (requête no 13114/15) ont saisi le juge administratif d’un recours en référé liberté pour qu’il soit enjoint au préfet de police d’examiner leur demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de leur délivrer une APS (voir paragraphes 7 à 9 et 53 à 54 ci‑dessus). Ces procédures n’ont pas abouti (voir paragraphes 7 à 9 et 53 à 54 ci‑dessus). Par ailleurs, la Cour relève que le droit interne conditionnait la perception de l’ATA à la production devant Pôle emploi, d’une autorisation de séjour au titre de l’asile et d’une preuve de dépôt effectif de la demande devant l’OFPRA (voir paragraphe 79 ci‑dessus). La Cour observe que Pôle emploi comme les juridictions internes ont opposé cette règle à A.J. (requête no 13114/15) (voir paragraphes 56 et 57 ci‑dessus).
172. N.H. (requête no 28820/13), K.T. (requête no 75547/13) et A.J. (requête no 13114/15) exposent tout d’abord que faute de pouvoir justifier de leur qualité de demandeur d’asile, ils ont vécu respectivement pendant 95 jours, 131 jours et 90 jours dans la peur d’être arrêtés et expulsés vers leur pays d’origine. Si le Gouvernement soutient qu’ils étaient protégés d’une mesure d’éloignement depuis leur première présentation en préfecture grâce à la convocation à un rendez‑vous ultérieur, la Cour constate toutefois que, dans des rapports publiés en avril 2013 et en avril 2014, l’Inspection générale des finances, l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’administration, d’une part, et le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée Nationale, d’autre part, ont souligné qu’avant d’obtenir une APS, les demandeurs d’asile risquaient d’être expulsés vers leur pays d’origine (voir paragraphes 83 et 84 ci‑dessus). La Cour relève, que si le premier de ces deux rapports précise que la présentation de la convocation à un entretien écartait tout risque d’être éloigné, le second ne mentionne pas que les autorités internes auraient adopté une pareille conduite. En outre, la Cour remarque que le CFDA et le Défenseur des droits (voir paragraphes 145, 146 et 152 ci‑dessus), qui décrivent dans leurs observations la situation à Paris, soulignent que les primo‑demandeurs d’asile en attente de leur premier rendez‑vous à la préfecture de police n’étaient pas munis d’un document les mettant à l’abri, en cas d’interpellation, d’un placement en centre de rétention. La Cour, qui se fonde sur les observations des tierces parties intervenantes et sur des rapports officiels ne met donc pas en doute les craintes d’être expulsés vers leur pays d’origine que nourrissaient N.H. (requête no 28820/13), K.T. (requête no 75547/13) et A.J. (requête no 13114/15).
173. La Cour remarque par ailleurs qu’après l’obtention du statut de demandeurs d’asile par les requérants, leur situation s’est quelque peu améliorée. En effet, ils pouvaient justifier de la régularité de leur séjour et bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues par le droit national.
174. La Cour note toutefois que le Gouvernement ne conteste pas que pendant l’ensemble de la procédure d’asile qui a débuté avec la domiciliation par une association (voir article R. 741‑2 du CESEDA, paragraphe 72 ci‑dessus) ou par le premier rendez‑vous à la préfecture, les requérants ont tous vécu dans la rue, soit sous les ponts à Paris, soit sur les berges d’une rivière (l’Aude) dans une tente prêtée par des particuliers. À la lumière des pièces aux dossiers et en raison de la saturation du dispositif national d’accueil (DNA) à l’époque des faits à Paris et en région Languedoc‑Roussillon (voir paragraphes 125, 128 et 129 ci‑dessus), la Cour ne voit aucun motif de remettre en cause les récits des requérants. Par ailleurs, il saurait difficilement être reproché aux requérants, alors âgés de 20, 23, 26 et 40 ans, célibataires et sans enfant à charge, de ne pas avoir sollicité plus fréquemment le « 115 » pour obtenir un hébergement d’urgence. En effet, l’offre en la matière était très largement insuffisante et appeler le « 115 » était presque systématiquement voué à l’échec, s’agissant notamment de demandeurs d’asile présentant le profil des requérants (voir paragraphes 147 et 153 ci‑dessus). Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît lui‑même que l’hébergement d’urgence était destiné à accueillir de façon prioritaire des demandeurs d’asile en raison de leur âge, de leur santé ou de leur situation familiale (familles avec enfants mineurs) et qualifiés pour ces raisons, par les autorités, de « particulièrement vulnérables ».
175. La Cour relève en outre plusieurs éléments caractérisant les conditions de vie à la rue des requérants.
176. Elle constate tout d’abord que N.H. (requête no 28820/13) n’a jamais perçu l’ATA malgré ses démarches auprès des autorités pour l’obtenir (voir paragraphes 12, 13 et 15 ci‑dessus). En outre, il a vécu sous les ponts du canal Saint‑Martin dans une situation d’extrême précarité du 26 mars au 17 décembre 2013, soit pendant 262 jours. Il précise, que, victime d’une agression et d’un vol commis de nuit, il a ensuite craint de subir à nouveau de tels actes (voir paragraphe 18 ci‑dessus). Si le requérant indique qu’il a pu être pris en charge, une à deux fois par semaine par le « bus Atlas » entre les mois de mars et d’août 2013 (voir paragraphe 18 ci‑dessus), cette possibilité d’hébergement, au demeurant très ponctuelle et destinée à l’origine aux personnes sans abri, a pris fin au mois de septembre 2013 en raison de l’obligation faite aux demandeurs d’asile d’appeler le « 115 » pour y accéder (voir paragraphe 19 ci‑dessus). De la même façon, A.J. (requête no 13114/15) a vécu dans la rue dans des conditions analogues à celles décrites par N.H. (requête no 28820/13). Il y est ainsi resté 170 jours, du 23 octobre 2014 au 14 avril 2015. Pendant cette période, il n’a été logé que les nuits des 5, 12, 13 et 14 novembre 2014 dans un centre d’hébergement d’urgence (voir paragraphe 51 ci‑dessus). La Cour observe que malgré les démarches et recours d’A.J. (requête no 13114/13) à cette fin (voir paragraphes 55, 56, 57 et 59 ci‑dessus) ses droits à l’ATA n’ont été ouverts que le 12 février 2015 et il a effectivement perçu l’allocation le 5 mars 2015. La Cour en conclut qu’à compter de sa première présentation en préfecture, A.J. est resté sans ressources du 23 octobre 2014 au 5 mars 2015, soit 133 jours.
177. La Cour relève ensuite que S.G. et K.T. (requête no 75547/13) ont vécu au minimum neuf mois sur les berges de l’Aude, chacun dans une tente individuelle prêtée par des particuliers. Elle remarque que le Gouvernement, qui ne produit devant elle que le règlement intérieur du centre d’hébergement d’urgence, n’établit ni que S.G. ait été effectivement hébergé du 5 au 9 novembre 2013 ni qu’il ait volontairement quitté le centre d’hébergement le 10 novembre 2013. En outre, ni son exclusion du centre qui serait survenue le 22 novembre 2013 ni les motifs de cette exclusion ne sont documentés. La Cour dresse le même constat s’agissant de K.T. Rien au dossier n’établit en effet qu’il aurait bénéficié d’un hébergement d’urgence du 7 au 23 janvier 2013, qu’il aurait quitté le centre de son plein gré à cette date et qu’il y serait revenu le 21 novembre 2013 avec S.G. pour en être exclu deux jours plus tard en raison de problèmes de comportement. En l’absence de tout élément permettant de déterminer si les requérants ont effectivement été hébergés et expulsés du centre, la Cour ne tirera aucune conséquence des allégations respectives des parties sur ce point.
178. La Cour remarque que K.T. (requête no 75547/13), qui n’était plus en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 21 mai 2013, a effectivement bénéficié de l’ATA le 15 juillet 2013. À compter de sa première présentation à la préfecture, le requérant est donc resté 185 jours sans ressources. La Cour note que S.G. (requête no 75547/13) a perçu l’ATA 63 jours après sa première présentation en préfecture, soit le 18 septembre 2013 avec des droits ouverts à partir du 12 août 2013.
179. La Cour prend donc acte que N.H. (requête no 28820/13) a vécu dans la rue sans ressources financières et que K.T. (requête no 75547/13) et A.J. (requête no 13114/15), qui ont vécu dans les mêmes conditions, n’ont perçu l’ATA qu’après des délais, respectivement, de 185 et de 133 jours. De telles conditions matérielles accréditent leurs craintes d’être agressés et d’être victimes de vol ainsi que les difficultés qu’ils disent avoir eues pour se nourrir et se laver. De façon générale, pour répondre à leurs besoins fondamentaux, ils n’ont pu, pendant les périodes où ils vécurent à la rue sans ressources financières, que s’en remettre à la générosité de particuliers ou à l’aide d’associations caritatives fondées sur le bénévolat. À ce titre, N.H. (requête no 28820/13) expose que l’Armée du Salut lui servait son seul repas quotidien les soirs de semaine et que le week‑end, il était contraint de jeûner. La Cour note également que le Gouvernement ne conteste pas que N.H. ne pouvait se laver aux bains douches municipaux qu’une fois par semaine et qu’il n’était ni en mesure de laver convenablement son linge ni d’obtenir des vêtements (voir paragraphe 19 ci‑dessus).
180. La Cour constate que si les requérants font état de problèmes de santé dont ils imputent la survenance ou l’aggravation à leurs conditions de vie, les certificats médicaux versés aux débats, non circonstanciés, n’établissent pas un tel lien de causalité, ainsi que le relève le Gouvernement.
181. Enfin, le Gouvernement défendeur insiste tout particulièrement sur le fait que les présentes affaires sont à distinguer de la situation décrite par la Cour dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (précité) dès lors que les autorités nationales, pourtant confrontées à une augmentation conséquente du nombre de demandeurs d’asile entre 2007 et 2014 (voir paragraphes 124 à 127 ci‑dessus), n’ont pas montré de passivité. En outre, selon le Gouvernement, les requérants n’étaient pas dépourvus de perspective de voir leur situation s’améliorer dès lors que leurs demandes d’asile étaient en cours de traitement.
182. La Cour tient tout d’abord à souligner qu’elle est consciente de l’augmentation continue du nombre de demandeurs d’asile depuis 2007 et de la saturation du DNA qui en est graduellement résultée. La Cour relève que les faits qui lui sont soumis s’inscrivent dans une hausse progressive et ne se sont donc pas déroulés dans un contexte d´urgence humanitaire engendré par une crise migratoire majeure, qualifiable d´exceptionnelle, à l’origine de très importantes difficultés objectives de caractère organisationnel, logistique et structurel (Khlaifia et autres c. Italie, précité, §§ 178-185). La Cour constate les efforts consentis par les autorités françaises pour créer des places d’hébergement supplémentaires et pour raccourcir les délais d’examen des demandes d’asile (voir paragraphes 125 et 126 ci‑dessus). Toutefois, ces circonstances n’excluent pas que la situation des demandeurs d’asile ait pu être telle qu’elle est susceptible de poser un problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
183. La Cour souligne avant tout qu’avant de pouvoir faire enregistrer leur demande d’asile, N.H. (requête no 28820/13), K.T. (requête no 75547/13) et A.J. (requête no 13114/15) ont été soumis à des délais pendant lesquels ils n’ont pas été en mesure de justifier de leur statut de demandeur d’asile (voir paragraphes 167, 169 et 170 ci‑dessus). Elle constate en outre que N.H. (requête no 28820/13) a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire 229 jours après son arrivée en France, que 188 jours se sont écoulés entre la première convocation à la préfecture de police d’A.J. (requête no 13114/15) et la reconnaissance de son statut de réfugié par l’OFPRA et que les demandes d’asile de S.G. et de K.T. (requête no 75547/13) ont été rejetées respectivement par l’OFPRA au bout de délais de 448 jours et de 472 jours.
c) Conclusion
En ce qui concerne N.H. (requête no 28820/13), K.T. (requête no 75547/13) et A.J. (requête no 13114/15)
184. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les autorités françaises ont manqué à l’encontre des requérants à leurs obligations prévues par le droit interne. En conséquence, la Cour considère qu’elles doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles ils se sont trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente d’être attaqués et volés. La Cour estime que les requérants ont été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez eux des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate des autorités françaises qu’ils ont alertées à maintes reprises sur leur impossibilité de jouir en pratique de leurs droits et donc de pourvoir à leurs besoins essentiels, et le fait que les juridictions internes leur ont systématiquement opposé le manque de moyens dont disposaient les instances compétentes au regard de leurs conditions de jeunes majeurs isolés, en bonne santé et sans charge de famille, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
185. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que N.H. (requête no 28820/13), K.T. (requête no 75547/13) et A.J. (requête no 13114/15) se sont retrouvés, par le fait des autorités, dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention.
186. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui les concerne.
En ce qui concerne S.G. (requête no 75547/13)
187. Au regard de ce qui précède, la Cour constate que S.G. a obtenu un récépissé constatant le dépôt de sa demande d’asile 28 jours après son premier rendez‑vous à la préfecture et que, s’il a effectivement vécu sous une tente, il a perçu l’ATA 63 jours après sa première présentation à la préfecture. Pour difficile que cette période a pu être pour le requérant, il a ensuite disposé de moyens lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Par conséquent, la Cour considère que ces conditions d’existence n’ont pas atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
188. Partant, il y n’a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le requérant.
A.E.A. c. GRÈCE du 15 mars 2018 requête 39034/12
Article 3 combiné à l'article 13 : le requérant n'a pas déposé une demande d'asile pour ne pas être expulsé vers le Soudan malgré un rapport du HCR. Le droit de demander asile est une droit fondamental
a) Principes généraux
68. La Cour rappelle avoir précisé que, dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, elle se gardait d’examiner elle‑même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissaient leurs obligations découlant de la Convention de Genève. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui (voir, parmi d’autres, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 286, T.I. c. Royaume-Uni (déc.), no 43844/98, CEDH 2000-III, et Müslim c. Turquie, no 53566/99, §§ 72-76, 26 avril 2005).
69. Toutefois, compte tenu de l’importance que la Cour attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005‑III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000‑VIII), ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV) ; elle requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002‑I, et Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007‑II).
70. L’effectivité du recours voulu par l’article 13 de la Convention s’entend d’un niveau suffisant d’accessibilité et de réalité de celui-ci : pour être effectif, le recours exigé par cette disposition doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (I.M. c. France, no 9152/09, § 130, 2 février 2012, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 112, CEDH 1999‑IV). Au sujet des recours ouverts aux demandeurs d’asile en Grèce, la Cour a également réaffirmé que l’accessibilité « en pratique » d’un recours est déterminante pour évaluer son effectivité (Sharifi et autres c. Italie et Grèce, no 16643/09, § 167, 21 octobre 2014, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 318).
71. La Convention ayant pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, dans le chef de toute personne relevant de la juridiction des Hautes Parties contractantes, la Cour ne saurait procéder à l’évaluation de l’accessibilité pratique d’un recours en faisant abstraction des obstacles linguistiques, de la possibilité d’accès aux informations nécessaires et à des conseils éclairés, des conditions matérielles auxquelles peut se heurter l’intéressé et de toute autre circonstance concrète de l’affaire (I.M. c. France, précité, §§ 145-148, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 301-318, et Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 79, 5 avril 2011).
b) Application à la présente espèce
72. Pour déterminer si l’article 13 de la Convention s’applique en l’espèce, la Cour doit rechercher si le requérant peut, de manière défendable, faire valoir que son éloignement vers le Soudan porterait atteinte à l’article 3 de la Convention.
73. La Cour note que, lors de l’introduction de la requête, le requérant a exposé en détail les raisons pour lesquelles il a été obligé de quitter le Soudan et qu’en outre il a produit, à l’appui de ses craintes dans son pays d’origine, la copie d’une lettre du HCR attestant, entre autres, de son obtention du statut de réfugié relevant du mandat de cette organisation. Elle observe à cet égard que le HCR a déjà reconnu le risque que l’intéressé courait et court toujours dans son pays d’origine. La Cour a également à sa disposition la copie de l’attestation de l’organisation non gouvernementale grecque Metadrasi selon laquelle le requérant avait subi des tortures, ainsi que des copies de deux certificats qui témoignent de la participation active de l’intéressé à l’Association des étudiants soudanais des monts Nouba et pour la protection des droits de l’homme au Soudan.
74. Pour la Cour, ces éléments montrent qu’il existait prima facie des risques sérieux et avérés que le requérant pourrait subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi au Soudan. Elle estime dès lors que le requérant a un grief défendable sous l’angle de cette disposition.
75. Cela dit, dans la présente affaire, la Cour n’a pas à se substituer aux autorités nationales et à évaluer les risques courus par le requérant en cas de renvoi au Soudan. Il lui importe seulement de savoir s’il existait en l’espèce des garanties effectives qui protégeaient le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine.
76. La Cour relève d’emblée que le grief du requérant concerne l’impossibilité alléguée d’introduire une demande d’asile. Le requérant décrit à cet égard les conditions qui régnaient, à l’époque des faits, à proximité du bâtiment de la direction des étrangers de l’Attique et les difficultés rencontrées par les demandeurs d’asile.
77. La Cour note que les allégations du requérant sont corroborées par les observations du HCR. En effet, dans ses constats relatifs à la situation des réfugiés en Grèce du 16 juin 2011 ainsi que dans un communiqué de presse du 23 mars 2012, intitulé « Des centaines [de personnes] font la queue chaque semaine à Athènes pour demander l’asile », le HCR a relevé que l’enregistrement des demandes d’asile restait l’un des problèmes majeurs, en particulier à la direction des étrangers de l’Attique, que l’accès aux personnes qui souhaitaient introduire une demande d’asile était extrêmement limité, que certains migrants avaient essayé d’introduire une demande d’asile pendant des mois et qu’un nombre important de demandeurs d’asile se trouvaient dans l’impossibilité de faire enregistrer leurs demandes (paragraphes 42-43 ci-dessus). La Cour note aussi que, dans son rapport établi le 25 janvier 2011 à la suite de sa visite à la direction des étrangers de l’Attique, le médiateur de la République a constaté que des défaillances structurelles continuaient à « se manifester lors de la procédure d’examen des demandes relatives à la protection internationale » et que les personnes qui avaient besoin de protection internationale étaient, « à cause des spécificités de la situation en Grèce, privées même de l’accès à la procédure d’asile ».
78. La Cour observe encore que le rapport de quatorze associations, organisations non gouvernementales et groupes travaillant dans le domaine de la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile en Grèce, établi à l’issue de visites effectuées à la direction des étrangers de l’Attique du 16 février au 7 avril 2012, décrit la situation de la même manière (paragraphes 36-39 ci-dessus).
79. La Cour rappelle que, dans son arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (précité), elle a relevé les carences du système grec d’asile, tel qu’il était en place à l’époque de l’application du décret présidentiel no 81/2009, et notamment celles liées à l’accès à la procédure d’examen des demandes d’asile (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 300-302, 315, 318 et 320). À cet égard, elle a notamment constaté les défaillances suivantes : l’information insuffisante des demandeurs d’asile sur les procédures à suivre ; les difficultés d’accès aux bâtiments de la préfecture de police de l’Attique ; l’absence d’un système de communication fiable entre les autorités et les demandeurs d’asile ; la pénurie d’interprètes et le manque d’expertise du personnel pour mener les entretiens individuels ; le défaut d’assistance judiciaire empêchant en pratique les demandeurs d’asile d’être accompagnés d’un avocat ainsi que la longueur excessive des délais pour obtenir une décision.
80. La Cour observe que certaines de ses considérations dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (précité) sur la procédure d’asile en Grèce sont confirmées par les faits de la présente cause. Qui plus est, en l’espèce, le Conseil grec pour les réfugiés avait à plusieurs reprises, à savoir les 30 mars, 6, 12 et 20 avril et 15 juin 2012, informé les autorités, par écrit, de la volonté du requérant de déposer une demande d’asile (paragraphe 20 ci‑dessus) – ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement. Or cette demande n’a été enregistrée que le 25 juillet 2012, soit après l’introduction de la présente requête devant la Cour.
81. Ainsi, il ressort des rapports disponibles en l’espèce que, en ce qui concerne l’accès à la procédure d’asile, la situation était, à l’époque des faits, la même que celle décrite dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (précité). La Cour observe à cet égard que la procédure d’asile a été modifiée par l’adoption du décret présidentiel no 114/2010. Pour autant, même si les demandeurs d’asile avaient désormais la possibilité d’introduire un recours avec effet suspensif contre le rejet de leur demande en première instance, et ce depuis l’entrée en vigueur dudit décret, il n’en reste pas moins que la procédure d’enregistrement des demandes d’asile à la direction des étrangers de l’Attique était restée inchangée.
82. La Cour relève aussi que le Gouvernement ne conteste pas la description de la situation dénoncée par le requérant lors de l’enregistrement des demandes d’asile. En effet, le Gouvernement soutient uniquement : que le requérant présente un grief général et ne précise pas en quoi consistent les problèmes auxquels il dit avoir personnellement fait face ; qu’il n’a pas démontré qu’il a essayé, pendant trois ans, d’introduire une demande d’asile ; qu’il aurait pu introduire une demande d’asile pendant sa détention ou dans une autre région du pays ; qu’il n’avait pas informé les autorités internes de l’obtention par lui du statut de réfugié relevant du mandat du HCR ; que ses assertions ne sont pas crédibles ; et que l’examen de sa demande d’asile a eu lieu conformément aux dispositions du droit interne et aux exigences de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3.
83. La Cour rappelle en outre que tant le droit international, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme, que le droit interne reconnaissent un droit de « chercher asile » (paragraphes 34 et 40 ci‑dessus). À cet égard, elle observe que l’article 4 du décret présidentiel no 114/2010, qui transpose dans l’ordre juridique grec l’article 6 de la directive du Conseil no 2005/85/CE du 1er décembre 2005 (sur les normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres) et qui est applicable en l’espèce, dispose que les autorités compétentes pour recevoir les demandes d’asile veillent à ce que « tout adulte puisse exercer le droit de présenter une demande ».
84. La Cour constate que, malgré cette obligation explicite, découlant du droit interne et du droit international, le requérant a été confronté à l’impossibilité d’introduire une demande d’asile pendant une longue période. Elle relève aussi que, entre la date à laquelle il s’est rendu à Athènes, en avril 2009, et la date à laquelle le Conseil grec pour les réfugiés a commencé à le représenter, en mars 2012, il n’avait aucune possibilité de signaler aux autorités sa situation ou le fait qu’il relevait du mandat du HCR, car, selon les rapports disponibles en l’espèce, l’accès au bâtiment de la direction des étrangers de l’Attique était très limité, voire impossible.
85. De l’avis de la Cour, la possibilité dans la pratique d’introduire une demande d’asile est une condition sine qua non aux fins de la protection effective des étrangers nécessitant la protection internationale. En effet, si l’accès sans entraves à la procédure d’asile n’est pas assuré par les autorités internes, les demandeurs d’asile ne peuvent nullement bénéficier des garanties procédurales liées à cette procédure et ils peuvent être arrêtés et placés en détention à tout moment. Force est de constater que, même si l’examen de la demande d’asile présente les garanties d’une procédure effective, fiable et sérieuse, ces dernières n’ont aucun sens si l’intéressé ne peut avoir au préalable la possibilité de voir sa demande enregistrée pendant une longue période. Étant donné les conditions dans lesquelles l’enregistrement des demandes d’asile avait lieu à l’époque des faits et les problèmes structurels susmentionnés, la Cour estime que le requérant a suffisamment établi devant elle les problèmes auxquels il a dû personnellement faire face. Elle note en outre que le fait que le requérant a quitté la Grèce pour la France ne saurait influer sur la situation.
86. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des défaillances de la procédure d’asile, à l’époque des faits.
V.M. ET AUTRES c. BELGIQUE du 7 juillet 2015 requête 60125/11
Violation de l'article 3 : Les conditions d'accueil des migrants en Belgique le temps que leur demande ne soit traitée, sont inhumaines et dégradantes.
139. Le Gouvernement fait valoir que les autorités belges ont agi avec toute la diligence nécessaire pour assurer l’accueil des requérants, sachant que dès le dépôt de leur demande d’asile, le 1er avril 2011, ils ont bénéficié de l’accueil dans un centre d’hébergement où la couverture de leurs besoins de base fut assurée jusqu’au 26 septembre 2011.
140. La Cour observe que cela n’est pas contesté par les requérants. Ce que ceux-ci reprochent aux autorités belges, c’est l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés durant la période qui a suivi leur éviction, le 26 septembre 2011, du centre d’hébergement jusqu’à leur départ pour la Serbie, le 25 octobre 2011, de jouir de l’accueil afin de pourvoir à leurs besoins essentiels. L’examen de la Cour portera donc uniquement sur cette dernière période.
141. La Cour prend note de la controverse qui existe entre les parties sur le point de savoir si une obligation de continuer à fournir un logement et des conditions matérielles décentes aux requérants faisait partie du droit positif belge et pesait sur les autorités belges en vertu du droit de l’Union européenne, à savoir, la directive Accueil (voir paragraphes 71, 75 et 103, ci-dessus ; voir pour la pertinence de la question, M.S.S., précité, §§ 250 et 263, et S.H.H. c. Royaume-Uni, no 60367/10, § 90, 29 janvier 2013).
142. La Cour note qu’en vertu de l’article 6 de la loi « accueil » du 12 janvier 2007, l’aide matérielle devait être octroyée pendant toute la procédure d’asile et prendre fin lorsque le délai pour l’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d’asile était expiré. À l’époque des faits, dans le contexte de la « crise de l’accueil », Fedasil avait interprété cette disposition de manière restrictive à l’égard des demandeurs d’asile qui, comme les requérants, étaient sous procédure Dublin. Les intéressés se voyaient privés de l’aide matérielle dès l’expiration du délai pour donner suite à l’ordre de quitter le territoire accompagnant la décision de refus d’examiner leur demande au motif qu’un autre État en était responsable, et ce même si un recours était pendant contre cette décision (voir ci-dessus, paragraphe 84).
143. La Cour constate, d’après la description de la situation en droit belge faite par les parties, qu’il ne peut en être déduit que les requérants, en tant que famille accompagnée d’enfants mineurs, dont une enfant gravement malade, n’avaient pas de possibilité, au regard du droit belge, de continuer à bénéficier de toute forme d’aide matérielle et médicale. Comme le Gouvernement plaide lui-même, l’ensemble du dispositif législatif formé par la loi « accueil » du 12 janvier 2007 ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS était conçu pour que, dans des situations exceptionnelles, comme celle des requérants, l’aide matérielle et médicale ait pu, en théorie, être prolongée.
144. Le Gouvernement reproche d’ailleurs aux requérants de ne pas avoir sollicité ces autres dispositifs. Ils auraient pu et dû, selon lui, demander l’aide sociale au CPAS compétent ou demander à Fedasil une prolongation de l’aide matérielle sur pied de l’article 7 de la loi « accueil » (voir paragraphe 85, ci-dessus). Les requérants font valoir, quant à eux, qu’en pratique, en raison de la saturation du réseau d’accueil pendant la période litigieuse, ces possibilités étaient vouées à l’échec.
145. La Cour constate que les allégations des requérants sont confortées par les constats dressés tant par les acteurs qui travaillaient sur le terrain à l’époque des faits, y compris l’organisation tierce-intervenante, que par les juridictions internes et les autorités administratives compétentes, notamment le CPAS de la ville de Bruxelles et Fedasil (voir paragraphes 92-95, ci-dessus). Toutes les décisions et rapports consultés convergent sur ce point : à l’époque des faits, le réseau d’accueil des demandeurs d’asile était arrivé à saturation en raison d’un trop grand nombre de demandeurs d’asile ; dans ce contexte, la politique suivie par le CPAS de la ville de Bruxelles, dont dépendaient les requérants, ainsi que par Fedasil était d’exclure de l’accueil les familles accompagnées d’enfants mineurs qui se trouvaient dans la situation des requérants, c’est-à-dire se trouvant en séjour illégal du fait de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire et dans l’attente d’une décision finale dans le cadre de leur procédure d’asile. La majorité des familles concernées se sont retrouvées privées d’hébergement et de toute forme d’aide que ce soit sur la base de la loi « accueil » ou sur celle de la loi organique des CPAS.
146. À cela s’ajoute qu’en l’espèce, contrairement à la thèse soutenue par le Gouvernement, des démarches ont été accomplies auprès des autorités compétentes, par la représentante des requérants et par le délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant afin qu’une solution urgente soit trouvée pour héberger la famille requérante (voir paragraphes 44 et 46, ci-dessus).
147. Dans ces circonstances, il saurait difficilement être reproché aux requérants de ne pas avoir cherché à trouver une solution pour assurer leur existence à la suite de l’éviction du centre d’hébergement.
148. Cette conclusion n’est pas mise à mal par le fait, souligné par le Gouvernement, que les requérants n’ont pas introduit de recours devant les juridictions du travail contre l’absence de décision prise par Fedasil en matière d’accueil. Une telle procédure, qui aurait pu être mise en mouvement par la voie du référé ou de la requête unilatérale, ne répond en effet pas aux exigences d’effectivité requises par la Convention. Les requérants et le Ciré, tiers-intervenante, démontrent que, dans le contexte de la crise de l’accueil, les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles refusaient l’usage de la procédure sur requête unilatérale aux familles se trouvant dans la même situation que les requérants. Quant à la procédure en référé, il n’est pas contesté que si les requérants avaient saisi le président du tribunal du travail de Bruxelles en référé, outre les difficultés pratiques liées à la désignation d’un avocat et aux délais impartis, ils auraient dû à l’époque des faits attendre environ dix jours pour obtenir une ordonnance. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des décisions examinées par la Cour (voir paragraphes 95-96, ci-dessus) qu’à cette époque, la jurisprudence des juridictions du travail était encore hétéroclite face à la reconnaissance du droit d’accueil aux familles « séjour illégal » et sous procédure Dublin. Enfin, à supposer même que les requérants aient pu saisir les juridictions du travail et obtenir une condamnation sous astreinte de Fedasil à les héberger, encore eût-il fallu qu’ils en obtiennent l’exécution, ce qui, à l’époque des faits, pouvait prendre plusieurs semaines (voir paragraphe 96, ci-dessus).
149. Dans ces conditions, face à une telle incertitude, la Cour est d’avis qu’on ne peut pas non plus reprocher aux requérants de ne pas avoir saisi les juridictions du travail. Elle estime qu’au vu de leur situation particulière et des circonstances spécifiques du réseau d’accueil à l’époque des faits, les requérants étaient dispensés d’épuiser cette voie de recours.
150. Le Gouvernement considère enfin que les requérants se seraient rendus en partie responsables de leur situation en ne se rendant pas au centre d’hébergement qui leur fut désigné après l’accueil en centre de transit les 5 et 6 octobre 2011, c’est-à-dire au centre de Bovigny. Les requérants affirment s’être rendus au centre désigné et s’être faits renvoyés au dispatching de Fedasil au motif que leur ordre de quitter le territoire n’était pas valable.
151. La Cour n’est à l’évidence pas en mesure de vérifier ce qui s’est réellement passé. Cela étant, la Cour n’a pas de difficulté à concevoir, au vu des circonstances, que les requérants, qui n’étaient pas familiers avec la procédure à suivre, se soient trouvés dépassés par la situation et n’aient pas fait preuve de toute la diligence possible pour bénéficier d’un hébergement situé à plus de 150 km de Bruxelles. La Cour estime que cette éventualité ne doit pas être retenue à leur détriment et qu’il appartenait au contraire aux autorités belges de se montrer davantage diligentes dans la recherche d’une solution d’hébergement.
152. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement, tirée du non-épuisement des voies de recours internes (voir paragraphe 114, ci-dessus).
153. La Cour observe ensuite qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, bien qu’ils aient reçu un ordre de quitter le territoire, les requérants avaient demandé l’asile aux autorités belges et étaient en cours de procédure à propos de la détermination de l’État responsable de l’examen desdites demandes. Sous peine de priver une telle procédure de toute efficacité par le refus de protéger les droits les plus élémentaires, il y a lieu de considérer que les requérants appartenaient, au même titre que le requérant dans l’affaire M.S.S. (§ 251), à « un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable qui a besoin d’une protection spéciale ». Comme la Cour l’a souligné dans l’affaire Tarakhel précitée (§ 119), cette exigence de « protection spéciale » est d’autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants. Elle est encore renforcée en l’espèce, aux yeux de la Cour, par la présence d’enfants en bas âge, dont un nourrisson, et d’une enfant handicapée, eux-mêmes intrinsèquement fragiles et plus vulnérables que les adultes face à la privation de leurs besoins élémentaires.
154. La circonstance qu’en l’espèce, les requérants étaient en attente d’une décision définitive quant à la détermination de l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile ne les plaçait pas dans une situation différente de celle des requérants dans les affaires précitées au regard de la Convention étant donné que, dans aucune de ces affaires, les autorités de l’État de renvoi ne s’étaient pas prononcées sur le bien-fondé des craintes qu’avaient les intéressés de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans le pays qu’ils avaient fui. Le fait qu’en l’espèce, les autorités françaises avaient précédemment examiné des demandes d’asile déposées par les requérants pour les rejeter ne saurait pas davantage entrer en ligne de compte puisque ceux-ci alléguaient devant les instances belges qu’ils étaient arrivés en Belgique après avoir quitté le territoire de l’UE pendant plus de trois mois et avaient demandé la protection des autorités belges sur la base d’une situation nouvelle.
155. Enfin, et à titre surabondant, la Cour relève que la CJUE s’est prononcée, par des arrêts du 27 septembre 2012 et du 27 février 2014, rendus certes après les faits litigieux dans la présente espèce, sur la portée des exigences de la directive Accueil dans la situation dans laquelle se sont trouvés les requérants en l’espèce. Selon la CJUE, la directive Accueil exige des États membres qu’ils octroient pendant toute la durée de la procédure de détermination de la responsabilité quant à l’examen de leur demande d’asile une aide matérielle suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance et le logement des intéressés. Les États d’accueil doivent également prendre en compte la situation des personnes ayant des besoins particuliers ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant (voir paragraphes 105-106, ci-dessus).
156. La Cour doit ensuite se prononcer, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir paragraphes 130-138, ci-dessus), sur le point de savoir si les conditions dans lesquelles les requérants ont vécu en Belgique entre le 26 septembre et le 25 octobre 2011 engagent la responsabilité de l’État belge sous l’angle de l’article 3.
157. S’agissant de la réalité des conditions d’existence vécues par les requérants, la Cour note qu’elles n’ont pas fait l’objet de débat devant elle. Le Gouvernement reconnaît en effet que les requérants étaient entièrement dépendants des structures d’accueil et qu’ils ont été contraints de quitter leur hébergement, le 26 septembre 2011, en application de la loi belge. Il ne conteste pas non plus qu’ils se sont trouvés, à partir de cette date, sans moyen de subsistance et sans logement, à l’exception des deux nuits en centre de transit.
158. La Cour constate que la situation vécue par les requérants a été d’une particulière gravité. Ils expliquent qu’à leur sortie du centre d’hébergement le 26 septembre 2011, ils se sont retrouvés à la rue et se sont installés sur une place publique au centre de Bruxelles où d’autres sans-abri issus de la minorité rom de Serbie se trouvaient déjà. Ils restèrent là – sans aide pour faire face à leurs besoins les plus élémentaires : se nourrir, se laver et se loger – jusqu’au 5 octobre 2011. La circonstance qu’un hébergement en centre d’accueil leur a été proposée par les autorités n’a rien changé à la situation des requérants. Après deux nuits en centre de transit et de retour à Bruxelles le 7 octobre 2011, les requérants débarquèrent à la gare du Nord de Bruxelles où ils restèrent encore près de trois semaines avant que leur retour vers la Serbie soit organisé via une organisation caritative.
159. La Cour observe que ce constat de gravité est également celui du Comité européen des droits sociaux, organe de contrôle du respect des droits de l’homme garantis par la Charte sociale européenne, qui a conclu, par une décision du 23 octobre 2012, qu’une situation de ce type ne respectait pas le droit des enfants à la protection énoncé par l’article 17 § 1 de la Charte révisée (affaire Défense des Enfants International (DEI) c. Belgique, réclamation no 69/2011, paragraphes 108-109, ci-dessus).
160. Certes, comme le fait valoir le Gouvernement, cette décision est intervenue postérieurement aux faits de l’espèce. Toutefois, elle repose sur le même postulat que celui de la Cour quand elle interprète l’article 3 de la Convention, à savoir que les droits liés à l’interdiction de tout traitement inhumain et dégradant sont accordés aux personnes en raison de la dignité attachée à la personne humaine.
161. Enfin, la Cour note que la situation dans laquelle se sont trouvés les requérants aurait pu être évitée ou à tout le moins abrégée si la requête en annulation et en suspension des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire qu’ils avaient introduite le 16 juin 2011 avait été traitée plus rapidement par le CCE. Ce dernier ne se prononça en effet que le 29 novembre 2011, soit plus de deux mois après que les requérants aient été exclus de la structure d’accueil et plus d’un mois après leur départ de Belgique.
162. Au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que la situation vécue par les requérants appelle la même conclusion que dans l’affaire M.S.S. Elle considère que les autorités belges n’ont pas dûment tenu compte de la vulnérabilité des requérants comme demandeurs d’asile et de celle de leurs enfants. Nonobstant le fait que la situation de crise était une situation exceptionnelle, la Cour estime que les autorités belges doivent être considérées comme ayant manqué à leur obligation de ne pas exposer les requérants à des conditions de dénuement extrême pendant quatre semaines, à l’exception de deux nuits, les ayant laissés dans la rue, sans ressources, sans accès à des installations sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels. La Cour estime que les requérants ont ainsi été victimes d’un traitement témoignant d’un manque de respect pour leur dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez eux des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de perspective de voir leur situation s’améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention et constituent un traitement dégradant.
163. Il s’ensuit que les requérants se sont retrouvés, par le fait des autorités, dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
FRANCE : Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme : Avis sur la situation des migrants à Calais et dans le Calaisis.
INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES
AUTORISATION DES EXPULSIONS INDIVIDUELLES
La CEDH et le FRA ont publié un MANUEL DE DROIT EUROPEEN AN MATIERE D'ASILE DE FRONTIERES ET D'IMMIGRATION au format PDF.
LES EXPULSIONS COLLECTIVES SONT INTERDITES
UN CAS D'EXPULSION COLLECTIVE D'ETRANGERS DE LA RUSSIE VERS LA GEORGIE
Arrêt de Grande Chambre GEORGIE C. RUSSIE du 3 Juillet 2014 Requête 13255/07
L'affaire porte essentiellement sur l’existence alléguée d’une pratique administrative relative à l’arrestation, la détention et l’expulsion collective de 2300 ressortissants géorgiens suivie par la Fédération de Russie à partir de la fin septembre 2006 à fin janvier 2007. 2300 autres géorgiens avaient quitté le territoire avant que les forces russes n'interviennent.
Le gouvernement géorgien soutient qu’il s’agissait de mesures de rétorsion à la suite de l’arrestation de quatre officiers russes à Tbilissi le 27 septembre 2006, événement qui porta les tensions entre les deux pays à leur paroxysme.
Dans son arrêt de Grande Chambre, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à la majorité :
à la violation de l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) à la Convention européenne des droits de l’homme ;
à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)
à la violation de l’article 5 § 4 (droit à un contrôle juridictionnel de sa détention)
à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)
à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 5 § 1 et avec l’article 3 et à la violation de l’article 38 (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace des enquêtes).
La Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 (droit au respect à la vie privée et familiale), de l’article 1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) et des articles 1 et 2 du Protocole n° 1 (protection de la propriété et droit à l’éducation).
Eu égard aux observations des parties, aux déclarations de 21 témoins entendus lors d’une audition à Strasbourg et aux rapports de diverses organisations internationales, la Cour estime qu’à l’automne 2006 les autorités russes ont mené une politique coordonnée d’arrestation, de détention et d’expulsion de ressortissants géorgiens qui s’analyse en une pratique administrative contraire à la Convention. Lisez le communiqué de Presse de la CEDH.
LES EXPULSIONS INDIVIDUELLES SONT AUTORISÉES
Tout dépend de l'Etat destinataire qui accueille l'individu expulsé ou réclamé. Au sens de l'article 13 de la Convention, les Etats doivent laisser le temps et les moyens aux demandeurs d'asiles, de discuter les risques de meurtre et de torture au sens des articles 2 et 3 de la convention.
A.C. ET AUTRES c. ESPAGNE du 22 avril 2014 requêtes 6528/11 et 29 autres
Violation de l'article 13 combiné aux articles 2 et 3 de la Convention : Le requérant et
29 autres ont saisi la CEDH contre le Royaume d’Espagne. Se déclarant d’origine sahraouie, ils se plaignent que les procédures de renvoi
des requérants vers le Sahara occidental, ne leur ont pas permis de présenter les risques d'assassinat et de torture au sens des articles 2 et 3 de la
Convention. La CEDH confirme le grief.
90. La Cour relève que la question
qui se pose en l’espèce est celle de l’effectivité des recours exercés par les
requérants, visés par une mesure d’éloignement, pour faire valoir leurs griefs
tirés des articles 2 et 3 de la Convention. Si l’accès à ces voies de recours
n’est pas en cause en tant que tel, le fait qu’elles n’aient été assorties d’un
effet suspensif que pendant une durée limitée, et non jusqu’à la décision
définitive sur le bien-fondé des demandes de protection internationale, est
susceptible de porter atteinte à leur effectivité.
91. À cet égard, la Cour estime nécessaire de souligner qu’en ce qui concerne les requêtes relatives à l’asile et à l’immigration, telles que celles des requérants, elle se consacre et se limite, dans le respect du principe de subsidiarité, à évaluer l’effectivité des procédures nationales et à s’assurer que ces procédures fonctionnent dans le respect des droits de l’homme (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 286 et 287).
92. Dans les présentes affaires, la Cour relève que le fait que les juridictions internes poursuivent à ce jour l’examen des demandes de protection internationale présentées par les requérants ne permet pas de conclure au caractère non défendable de leurs griefs.
93. Cela dit, en l’occurrence, la Cour n’a pas à se prononcer sur la violation de ces dispositions si les requérants devaient être expulsés. Il appartient en effet en premier lieu aux autorités espagnoles, responsables en matière d’asile, d’examiner elles-mêmes les demandes des requérants ainsi que les documents produits par lui et d’évaluer les risques qu’ils encourent au Maroc. La préoccupation essentielle de la Cour est de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui protègent les requérants contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers leur pays d’origine (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 298), dès lors que les recours sur le fond des requérants sont pendants devant les juridictions nationales.
94. On ne saurait exclure que, dans un système où la suspension est accordée sur demande, au cas par cas, elle puisse être incorrectement refusée, notamment s’il devait s’avérer ultérieurement que l’instance statuant au fond doive quand même annuler la décision d’expulsion litigieuse pour non-respect de la Convention, par exemple parce que l’intéressé aurait subi des mauvais traitements dans le pays de destination. En pareil cas, le recours exercé par l’intéressé n’aurait pas présenté l’effectivité voulue par l’article 13 (Čonka, précité, § 82). Dans ce contexte, l’exception du Gouvernement selon laquelle les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes doit être rejetée. La Cour rappelle à cet égard que lorsqu’un individu se plaint de manière défendable que son renvoi l’exposerait à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, les recours sans effet suspensif ne peuvent être considérés comme effectifs au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
95. Il convient de souligner que les exigences de l’article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique. C’est là une des conséquences de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique inhérents à l’ensemble des articles de la Convention (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999‑II).
96. En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont exercé les voies de recours disponibles dans le système espagnol pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention : ils ont déposé des demandes de protection internationale auprès de l’Office de l’asile et des réfugiés du ministère de l’Intérieur, qui furent rejetées, tout comme leurs demandes de réexamen. Les requérants présentèrent par la suite des recours de contentieux administratif contre les décisions leur faisant tort, en demandant en même temps la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion, sur la base de l’article 135 de la loi no 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction du contentieux administratif.
97. Les craintes exprimées par les requérants relatives à des mauvais traitements susceptibles de leur être infligés en cas de retour dans leur pays d’origine ne sont pas, à première vue et sans aucunement préjuger l’appréciation des juridictions espagnoles quant à leur bien-fondé, irrationnelles ou manifestement dépourvues de fondement, tant en raison de la situation générale au Maroc dérivée du démantèlement du campement de Gdeim Izik au Sahara occidental (paragraphes 47 à 59 ci-dessus) que des situations particulières alléguées par les requérants.
98. Bien que les autorités espagnoles soient les seules compétentes pour se prononcer en dernier ressort sur l’existence ou non des motifs pouvant faire obstacle aux expulsions décrétées à l’égard des requérants, l’on ne saurait exclure qu’il existe suffisamment d’éléments pour surseoir à l’exécution des décision prises par l’Administration tant que les juridictions internes n’ont pas examiné de façon détaillée et en profondeur le bien-fondé des demandes de protection internationale présentées par les requérants. Certes, la Cour est consciente de la nécessité pour les États confrontés à un grand nombre de demandeurs d’asile de disposer des moyens nécessaires pour faire face à un tel contentieux, ainsi que des risques d’engorgement du système.
99. La Cour reconnaît que les procédures d’asile accélérées, dont se sont dotés de nombreux États européens, peuvent faciliter le traitement des demandes clairement abusives ou manifestement infondées. Elle a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’estimer que le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne privait pas l’étranger en rétention d’un examen circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale (Sultani c. France, no 45223/05, §§ 64-65, CEDH 2007‑IV (extraits)). En l’espèce, se penchant tout particulièrement sur le cas des treize premiers requérants exposé au paragraphe 44 ci-dessus, la Cour observe toutefois que l’Audiencia Nacional avait ordonné le 27 janvier 2011 à l’Administration de surseoir provisoirement aux expulsions, le temps d’examiner les demandes de mesures provisoires présentées. Le lendemain, l’Audiencia Nacional décida toutefois de rejeter lesdites demandes de suspension des ordres d’expulsion pris à l’encontre desdits requérants, considérant que les moyens formulés à l’appui de leurs recours ne permettaient de conclure ni à l’existence dans leur chef de situations d’urgence spéciale susceptibles de justifier une suspension de toute expulsion du territoire national ni à la perte d’objet de la procédure au fond en cas d’exécution des mesures d’expulsion en cause.
100. La Cour constate qu’en l’espèce le caractère accéléré de la procédure n’a pas permis aux requérants d’apporter des précisions sur ces points, dans le cadre de leur seule possibilité de surseoir aux expulsions, la procédure quant au bien-fondé n’ayant pas en soi de caractère suspensif. Si la Cour reconnaît l’importance de la rapidité des recours, elle considère que celle-ci ne devrait pas être privilégiée aux dépens de l’effectivité de garanties procédurales essentielles visant à protéger les requérants contre un refoulement vers le Maroc (I.M. c. France, précité, §§ 147).
101. Elle souligne que seule l’application de l’article 39 de son règlement a pu suspendre l’éloignement des requérants. En effet, à la suite du rejet de leurs demandes de mesures provisoires devant l’Audiencia Nacional, rien ne pouvait plus faire obstacle à la mise à exécution de leur éloignement.
102. Si l’effectivité des recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend certes pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant, la Cour ne peut manquer d’observer que, sans son intervention, les requérants auraient été refoulés vers le Maroc sans que le bien-fondé de leurs recours ait fait l’objet d’un examen aussi rigoureux et rapide que possible (voir, mutatis mutandis, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 388), les recours du contentieux administratif qu’ils avaient déposés n’ayant pas, en tant que tels, d’effet suspensif automatique susceptible de surseoir à l’exécution des ordres d’expulsion prononcés à leur encontre.
103. En outre, la Cour constate que les requérants sont arrivés en Espagne entre janvier 2011 et aout 2012 et que, depuis, ils ont été dans une situation provisoire d’incertitude juridique et de précarité matérielle dans l’attente des décisions définitives sur leurs recours. Nul doute qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte et qu’il n’est pas exclu que la durée excessive d’une procédure puisse la rendre inadéquate. La Cour estime que dès lors qu’un recours n’a pas d’effet suspensif ou que la demande de suspension est rejetée, il est essentiel que dans les affaires d’expulsion où sont en cause les articles 2 et 3 de la Convention et lorsque la Cour a fait application de l’article 39 de son règlement, les juridictions fassent preuve d’une diligence de célérité particulière et statuent sur le fond dans des délais rapides. Si tel n’était pas le cas, les recours perdraient leur efficacité.
104. La Cour est consciente de la nécessité pour les États confrontés à un grand nombre de demandeurs d’asile de disposer des moyens nécessaires pour faire face à un tel contentieux, ainsi que des risques d’engorgement du système. Toutefois, tout comme l’article 6 de la Convention, l’article 13 astreint les États contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Süßmann c. Allemagne, 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 55).
105. En conclusion, les requérants ne disposaient pas d’un recours remplissant les conditions de l’article 13 pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3.
PRINCIPES POUR EXAMINER UNE EXPULSION INDIVIDUELLE
Melouli c. France requête no 42011/19
La Cour confirme l’appréciation des juridictions françaises en jugeant que le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français opposé à un ressortissant algérien n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale
L’affaire concerne un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, opposé à un ressortissant algérien. La Cour relève tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont expressément effectué, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée par les mesures litigieuses au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La Cour constate ensuite que le requérant n’a pas été à même d’établir devant les juridictions internes qu’il aurait vécu de façon habituelle en France depuis 2007, qu’il n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence dont il avait été titulaire dix ans avant sa nouvelle demande de titre de séjour, ni démontré l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France, qui auraient nécessité sa présence auprès d’eux. Eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu et compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales en la matière, la Cour estime que l’arrêté préfectoral litigieux, rejetant la demande du requérant d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
FAITS
Le requérant, M. Farouk Melouli, est un ressortissant algérien né en 1968 et résidant à Wittenheim. M. Melouli arriva en France au titre du regroupement familial en 1977, soit à l’âge de 9 ans. Le 23 novembre 2016, M. Melouli fut placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol commis en 2006. Le 13 avril 2017, le préfet du Haut Rhin prit un arrêté rejetant sa demande d’admission au séjour, portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l’Algérie comme pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg rejeta le recours en annulation de M. Melouli dirigé contre l’arrêté du 13 avril 2017. La cour administrative d’appel de Nancy confirma le jugement. Le 30 avril 2019, le Conseil d’État décida de ne pas admettre le pourvoi en cassation du requérant.
Article 8
La présente affaire se distingue de celles qui concernent des « immigrés établis », au sens de la jurisprudence de la Cour, c’est-à-dire des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d’accueil et qui y résident régulièrement. La situation d’un immigré « établi » et celle d’un étranger sollicitant l’admission au séjour sur le territoire national étant, en fait et en droit, différentes, les critères que la Cour a élaborés au fil de sa jurisprudence pour apprécier si le retrait du permis de séjour d’un immigré établi est compatible avec l’article 8 ne peuvent être transposés automatiquement à la situation du requérant alors même qu’il avait auparavant résidé régulièrement sous couvert de certificats de résidence. En effet si le requérant a sollicité, à plusieurs reprises, un titre de séjour, ce ne fut que dix ans après l’expiration de son dernier certificat de résidence. La Cour doit donc déterminer si les autorités françaises étaient ou non tenues, en vertu de l’article 8, d’octroyer au requérant un certificat de résidence afin de lui permettre de mener sa vie privée et familiale en France. La Cour rappelle que les rapports entre des parents et des enfants adultes ou entre des frères et sœurs adultes ne bénéficient pas de la protection de l’article 8 de la Convention sous le volet de la « vie familiale » à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. Ces liens peuvent cependant être pris en considération sous le volet de la « vie privée », selon l’article 8 de la Convention. S’agissant du cas d’espèce, la Cour relève tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont expressément effectué, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La Cour observe que, devant les juridictions internes, le requérant n’a pas été à même d’établir qu’il aurait vécu de façon habituelle en France depuis 2007. Il n’a pas non plus expliqué pour quelles raisons il n’avait pas demandé, dès 2004, un duplicata du certificat de résidence valable jusqu’en 2007, ni n’avait sollicité son renouvellement à cette date. Il n’a pas été en mesure de démontrer l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France, tels qu’ils impliqueraient nécessairement sa présence auprès d’eux. En outre, célibataire et sans enfant, le requérant ne justifie d’aucune insertion dans la société française
Eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu dans la présente affaire, la Cour estime que l’arrêté litigieux du préfet du Haut Rhin rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Le grief du requérant, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Moustahi c. France du 25 juin 2020 requête n° 9347/14
L'arrêt est lisible ici au format pdf
Violation article 3 : Rétention administrative puis renvoi expéditif de deux enfants entrés illégalement à Mayotte vers les Comores : plusieurs violations de la Convention
à l’unanimité, violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), dans le chef des deuxième et troisième requérants ;
à la majorité, violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention), dans le chef des deuxième et troisième requérants ;
à la majorité, violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), dans le chef de l’ensemble des requérants ;
à l’unanimité, violation de l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction de expulsions collectives d’étrangers), dans le chef des deuxième et troisième requérants ;
à l’unanimité, non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3 s’agissant du grief tiré de l’absence de recours effectif contre les modalités du renvoi des deuxième et troisième requérants ;
à la majorité, violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 et de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole n° 4, s’agissant du grief tiré de l’absence de recours effectif contre le renvoi des deuxième et troisième requérants
L’affaire concerne les conditions dans lesquelles les enfants, appréhendés lors de leur entrée irrégulière sur le territoire français à Mayotte, ont été placés en rétention administrative en compagnie d’adultes, rattachés arbitrairement à l’un d’eux et renvoyés expéditivement vers les Comores sans examen attentif et individualisé de leur situation. La Cour est convaincue que le rattachement des deux enfants à un adulte n’a pas été opéré dans le but de préserver l’intérêt supérieur des enfants, mais dans celui de permettre leur expulsion rapide vers les Comores. Leur placement en rétention n’a pu qu’engendrer une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes pour leur psychisme. Les autorités françaises n’ont pas veillé à une prise en charge effective des enfants et n’ont pas tenu compte de la situation que ceux-ci risquaient d’affronter lors de leur retour dans leur pays d’origine.
La Cour observe également qu’aucun recours n’a été ouvert aux enfants afin de faire vérifier la légalité de leur placement en rétention. La Cour rappelle que le fait d’enfermer certains membres d’une famille dans un centre de rétention alors même que d’autres membres de cette famille sont laissés en liberté s’analyse comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale quelle que soit la durée de la mesure en cause.
L’ensemble des circonstances particulières conduit la Cour à juger que l’éloignement des deux enfants, d’un très jeune âge (5 et 3 ans à l’époque des faits) qu’aucun adulte ne connaissait ni n’assistait, a été décidé et mis en oeuvre sans leur accorder la garantie d’un examen raisonnable et objectif de leur situation et a violé l’article 4 du Protocole n o 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers).
LES FAITS
Les requérants, Mohamed Moustahi, le père des enfants Nadjima Moustahi et Nofili Moustahi, âgés de 5 et 3 ans au moment des faits, sont des ressortissants comoriens, nés en 1982, 2008 et 2010 et résident à Mayotte. M. Moustahi entra sur le territoire de Mayotte en 1994, y réside de manière régulière et continue sous couvert d’une carte de séjour temporaire renouvelée. Les deux enfants naquirent à Mayotte d’une mère comorienne en situation irrégulière. En 2011, la mère fit l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, fut renvoyée aux Comores avec les deux enfants ; elle les confia à leur grand-mère paternelle et retourna à Mayotte. Le 13 novembre 2013, les deux enfants voyagèrent à bord d’une embarcation de fortune en vue de rejoindre Mayotte. Les 17 personnes présentes sur l’embarcation furent interpelées en mer par les autorités françaises le matin du 14 novembre 2013. A 9 heures, elles firent l’objet d’un contrôle d’identité sur une plage, puis d’un contrôle sanitaire à l’hôpital de Dzaoudi et enfin d’une procédure administrative de reconduite à la frontière dans la même journée durant laquelle elles furent placées en rétention durant une heure quarante-cinq environ dans les locaux de la gendarmerie de Pamandzi. Les deux enfants furent rattachés administrativement à M. M.A., une des personnes présentes sur l’embarcation qui aurait déclaré accompagner les enfants. Leur nom fut inscrit sur l’arrête de reconduite à la frontière de M.A. ; en revanche leur placement en rétention fut opéré sans aucune inscription sur un arrêté de placement en rétention M. Moustahi fut prévenu de la présence de ses enfants à la gendarmerie placés dans le local de rétention, mais il ne put prendre contact avec eux. Le même jour à 15 heures, il saisit le préfet d’un recours demandant la suspension de l’arrêté d’éloignement et à 17h30, il saisit le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Mayotte. Les deux enfants furent placés à 16h30 à bord d’un navire et renvoyés aux Comores.
Le 18 novembre 2013, soit deux jours après l’écoulement du délai fixé par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Mayotte rejeta la demande de M. Moustahi. Le 3 décembre 2013, il fit appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’Etat. Le Défenseur des droits, le GISTI et la CIMADE intervinrent pour soutenir le requérant. Le 10 décembre 2013, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Le 13 janvier 2014, M. Moustahi saisit les autorités consulaires aux Comores d’une demande de regroupement familial. Au mois d’août 2014, des visas long séjour furent délivrés aux deux enfants qui vivent depuis lors avec leur père depuis le mois de septembre 2014.
Article 3 (dans le chef des deuxième et troisième requérants)
La Cour considère les deuxième et troisième requérants comme étant des mineurs non accompagnés et que leur rattachement à M.A. a été arbitraire. La Cour est convaincue que ce rattachement n’a pas été opéré dans le but de préserver l’intérêt supérieur des enfants, mais dans celui de permettre leur expulsion rapide vers les Comores. La Cour observe que les conditions de rétention de ces deux enfants étaient les mêmes que celles des personnes adultes appréhendées en même temps qu’eux. Eu égard à l’âge des enfants et au fait qu’ils étaient livrés à eux-mêmes, la Cour conclut que leur placement en rétention n’a pu qu’engendrer une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes pour leur psychisme.
La Cour considère que les autorités n’ont pas assuré aux enfants un traitement compatible avec les dispositions de la Convention et que celui-ci a dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3. Il y a donc eu violation de cet article. Par ailleurs, les autorités françaises n’ont pas veillé à une prise en charge effective des enfants et n’ont pas tenu compte de la situation que ceux-ci risquaient d’affronter lors de leur retour dans leur pays d’origine. La Cour estime que le refoulement des deux enfants dans de telles conditions, leur a nécessairement causé un sentiment d’extrême angoisse et a constitué un manque flagrant d’humanité envers leur personne du fait de leur âge et de leur situation de mineurs non accompagnés, de sorte qu’il atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain. La Cour estime également que ce refoulement constitue un manquement aux obligations positives de l’Etat français, qu’i s’est abstenu de prendre les mesures et précautions requises. Il y a eu violation de l’article 3 du fait des conditions dans lesquelles le renvoi des enfants vers les Comores s’est déroulé.
Article 3 (dans le chef du premier requérant)
La Cour ne doute pas que le premier requérant, en tant que père, ait subi souffrance et inquiétude. Toutefois, la Cour relève que le placement en rétention des enfants a été de courte durée. La Cour relève aussi que le voyage des enfants entre les Comores et Mayotte a été réalisé à l’initiative du premier requérant qui a commandité la traversée irrégulière et périlleuse de ses enfants sur une embarcation de fortune sans s’assurer qu’ils fussent accompagnés d’un responsable. Par contraste, le voyage de retour s’est effectué dans des conditions satisfaisantes, à bord d’un ferry appartenant à une compagnie réalisant fréquemment la liaison entre Mayotte et les Comores. En outre, le requérant savait que sa propre mère s’en occuperait à l’arrivée. Dans ces conditions, la Cour juge que le seuil de gravité exigé par l’article 3 n’a pas été atteint et qu’il n’y a donc pas violation de l’article 3.
Article 5 § 1 (dans le chef des deuxième et troisième requérants)
La Cour relève que le placement des enfants en rétention n’a pas été opéré dans le but de ne pas les séparer d’un membre de leur famille. Au contraire, les enfants ont été arbitrairement rattachés à M.A. dans le but de permettre un placement en rétention puis une expulsion que ne permettait pas le droit interne applicable au moment des faits et dont le juge des référés du TA de Mayotte a d’ailleurs relevé le caractère manifestement illégal. La Cour ne décèle donc aucun fondement juridique propre à justifier la privation de liberté subie par les deux enfants. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1.
Article 5 § 4 (dans le chef des deuxième et troisième requérants)
La Cour relève que les deux enfants n’ont pas fait l’objet d’un arrêté prévoyant leur placement en rétention administrative ou d’un arrêté prévoyant leur expulsion, mais que leur nom a simplement été mentionné dans l’arrêté portant reconduite à la frontière de M.A. Les enfants n’ont pas été placés en rétention avec un membre de leur famille, mais ont été rattachés arbitrairement par les autorités à un tiers. La Cour conclut que les enfants accompagnant un tiers inconnu sont tombés dans un vide juridique ne leur permettant pas d’exercer le recours garanti à ce tiers. Les enfants n’ont pas été retenus en compagnie d’une tierce personne disposant de l’autorité juridique pour agir en leur nom devant les juridictions internes et ayant leur intérêt à coeur. La Cour considère en conséquence que les deuxième et troisième requérants ne se sont pas vu garantir la protection requise par cet article, dès lors qu’aucun recours ne leur était ouvert afin de faire vérifier la légalité de leur placement en rétention. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4.
Article 8 (les trois requérants)
La Cour considère que le fait d’enfermer certains membres d’une famille dans un centre de rétention alors même que d’autres membres de cette famille sont laissés en liberté peut s’analyser comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale quelle que soit la durée de la mesure en cause. Eu égard au constat de violation de l’article 5 § 1 auquel elle est parvenue, la Cour constate que l’ingérence dans la vie familiale des requérants n’était pas prévue par la loi. Cela suffit à justifier en soi un constat de violation de l’article 8. Cette violation du droit au respect de la vie familiale a été aggravée du fait que les autorités nationales ont rattaché arbitrairement les enfants à un tiers dépourvu d’autorité sur eux, sans mener aucune recherche quant à d’éventuels liens les unissant. La Cour est convaincue que le refus de réunir les requérants ne visait pas au respect de l’intérêt supérieur des enfants, mais que les autorités ont cherché à assurer l’expulsion des enfants dans les meilleurs délais et contrairement au droit interne. La Cour ne saurait admettre là un but légitime conforme à l’article 8 § 2.
Article 4 du Protocole n° 4 (dans le chef des deuxième et troisième requérants)
La Cour considère que lorsqu’un enfant est accompagné par un parent ou un proche, les exigences de l’article 4 du Protocole n o 4 peuvent être satisfaites si cette tierce personne est en mesure d’invoquer de manière réelle et effective les arguments s’opposant à leur expulsion. L’ensemble des circonstances particulières conduit la Cour à juger que l’éloignement des deux enfants, d’un très jeune âge (5 et 3 ans à l’époque des faits) qu’aucun adulte ne connaissait ni n’assistait, a été décidé et mis en oeuvre sans leur accorder la garantie d’un examen raisonnable et objectif de leur situation. La Cour conclut que l’éloignement de ces enfants a violé l’article 4 du Protocole n o 4.
Article 13 combiné avec les articles 3 et 8 ainsi qu’avec l’article 4 du Protocole n° 4 (dans le chef des deuxième et troisième requérants)
Article 13 combiné avec l’article 3
La Cour souligne que le présent grief concerne les modalités pratiques du renvoi, soit l’absence d’accompagnement des enfants, le défaut d’organisation de leur arrivée et leur heure tardive de débarquement. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats varie en fonction de la nature du grief. La Cour a conscience que les modalités pratiques du renvoi des étrangers vers des pays tiers ne sont souvent connues de l’administration que dans les heures précédant l’exécution du renvoi et qu’elles ne sont le plus souvent pas susceptibles d’être en soi constitutives d’une violation de l’article 3. La Cour considère que l’article 13 n’impose pas que les recours disposent d’un caractère suspensif. La possibilité d’un recours, exercé a posteriori par le requérant, suffit donc au respect de cette disposition et il ne résulte pas des échanges entre les parties qu’un tel recours était inexistant ou ineffectif dans les circonstances de l’espèce. La Cour conclut donc à l’absence de violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.
Article 13 combiné avec les articles 8 et 4 du Protocole n° 4
Compte tenu du déroulement des faits, la Cour constate qu’aucun examen judiciaire des demandes des requérants ne pouvait avoir lieu. Si la procédure en référé pouvait, en théorie, permettre au juge d’examiner les arguments exposés et prononcer, si nécessaire, la suspension de l’éloignement, toute possibilité a été anéantie par le caractère excessivement bref du délai. Le juge des référés du TA de Mayotte n’a pu que rejeter pour défaut d’urgence la demande introduite par le premier requérant, alors même qu’il relevait que la décision en cause était « manifestement illégale ». Ainsi, l’éloignement des requérants a été effectué sur la seule base de la décision prise par l’autorité préfectorale au sujet d’un tiers dépourvu de liens avec eux. Par conséquent, la Cour estime que la hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en oeuvre a eu pour effet de rendre les recours existants inopérants et donc indisponibles. La Cour constate que les requérants n’ont pas disposé de recours effectifs leur permettant de faire valoir le bien fondé des griefs tirés des articles 8 et 4 du Protocole n° 4 alors que leur éloignement était en cours. Cela n’a pu être réparé par la délivrance ultérieure d’un titre de séjour. La Cour conclut en conséquence à la violation de l’article 13 combiné aux articles 8 et 4 du Protocole n° 4.
Articles 41 et 46
La Cour constate des évolutions législatives et jurisprudentielles positives ayant eu lieu depuis les faits de l’espèce. Le juge des référés du Conseil d’Etat a précisé que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier l’identité des étrangers mineurs placés en rétention administrative et éloignés en conséquence de la mesure d’éloignement adoptée à l’encontre d’un tiers, de même que la nature exacte des liens qu’ils entretiennent. Il a en outre souligné que l’autorité administrative doit vérifier les conditions de la prise en charge des étrangers mineurs dans le lieu à la destination duquel ils sont éloignés. Le respect par les autorités de ces exigences prétoriennes est de nature à prévenir la répétition, pour des tiers, de la plupart des constats de violation auxquels la Cour est parvenue dans la présente affaire. La Cour dit que la France doit verser aux requérants 22 500 euros (EUR) pour dommage moral, se décomposant en 2 500 EUR pour le premier requérant et 10 000 EUR pour chacun des deux autres requérants.
Grande Chambre JK C. Suède, du 23 août 2015 requête n°59166/12
violation de l'article 3, après avoir rappelé tous les principes d'examen, l'Irak est considéré comme un pays dangereux pour le requérant.
a) Le caractère général des obligations découlant de l’article 3
77. Dans l’arrêt Labita c. Italie ([GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV), la Cour a déclaré ce qui suit :
« L’article 3 de la Convention, la Cour l’a dit à maintes reprises, consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79) (...) »
b) Le principe de non-refoulement
78. La Cour a maintes fois reconnu l’importance du principe de non‑refoulement (voir, par exemple, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 286, CEDH 2011, et M.A. c. Chypre, no 41872/10, § 133, CEDH 2013 (extraits)). La préoccupation essentielle de la Cour dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile « est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui » (voir, entre autres, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 286, Müslim c. Turquie, no 53566/99, §§ 72-76, 26 avril 2005, et T.I. c. Royaume-Uni (déc.), no 43844/98, CEDH 2000-III).
c) Principes généraux concernant l’application de l’article 3 dans les affaires d’expulsion
79. Les principes généraux concernant l’article 3 dans les affaires d’expulsion sont exposés dans l’arrêt Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008) et dans le très récent arrêt F.G. c. Suède ([GC], no 43611/11, CEDH 2016). Les paragraphes pertinents de ce dernier arrêt se lisent ainsi :
« 111. La Cour rappelle que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, par exemple, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 113, CEDH 2012, Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006‑XII, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94, et Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI). Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008).
112. Pour établir s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court ce risque réel, la Cour ne peut éviter d’examiner la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005‑I). Au regard de ces exigences, pour tomber sous le coup de l’article 3, le mauvais traitement auquel le requérant affirme qu’il serait exposé en cas de renvoi doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 60, CEDH 2001‑II). »
d) Risque de mauvais traitements émanant de groupes privés
80. En raison du caractère absolu du droit garanti, l’article 3 de la Convention s’applique non seulement au danger émanant d’autorités publiques mais aussi au danger émanant de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 110, 17 juillet 2008, F.H. c. Suède, no 32621/06, § 102, 20 janvier 2009, et H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III).
81. Dans ce contexte, la possibilité de protection ou de réinstallation du requérant dans le pays d’origine est également un élément pertinent. La Cour rappelle que l’article 3 n’empêche pas en soi les États contractants de prendre en considération l’existence d’une possibilité de fuite interne lorsqu’un individu allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine l’exposerait à un risque réel de subir des traitements proscrits par cette disposition (Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 141, 11 janvier 2007, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 98, Recueil 1996‑V, et Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, §§ 67-68, CEDH 2001‑II).
82. La Cour a dit cependant que le fait de tenir compte d’une possibilité de fuite interne n’enlève rien à la responsabilité de l’État contractant expulsant de veiller à ce que l’intéressé ne se trouve pas exposé, du fait de son expulsion, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (Salah Sheekh, précité, § 141, et T.I. c. Royaume-Uni, décision précitée). Dès lors, pour qu’un État puisse valablement invoquer l’existence d’une possibilité de fuite interne, certaines garanties doivent être réunies : la personne dont l’expulsion est envisagée doit être en mesure d’effectuer le voyage vers la zone concernée et d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer et de s’y établir, faute de quoi il peut y avoir un problème sous l’angle de l’article 3, surtout si en l’absence de pareilles garanties la possibilité existe que la personne concernée échoue dans une partie de son pays d’origine où elle risque de subir des mauvais traitements (Salah Sheekh, précité, § 141, et Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 266, 28 juin 2011).
e) Le principe d’une évaluation ex nunc des circonstances
83. Le principe de l’évaluation ex nunc des circonstances se trouve établi dans un certain nombre d’affaires qui ont été tranchées par la Cour. Très récemment, il a été exposé ainsi dans l’arrêt F.G. c. Suède (précité) :
« 115. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal, précité, § 86). Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (voir, par exemple, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, §§ 87-95, CEDH 2008, et Sufi et Elmi, précité, § 215). Pareille situation se produit généralement lorsque, comme dans la présente affaire, l’expulsion est retardée en raison de l’indication par la Cour d’une mesure provisoire au titre de l’article 39 du règlement. Dès lors que la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les États contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. L’appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (voir, par exemple, Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 136, 11 janvier 2007, et Vilvarajah et autres, précité, §§ 107 et 108). »
f) Le principe de subsidiarité
84. Dans l’arrêt F.G. c. Suède (précité), la Cour a décrit comme suit la nature de son examen dans les affaires concernant l’expulsion de demandeurs d’asile :
« 117. Dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, la Cour se garde d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui. En vertu de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce sont en effet les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286-287, CEDH 2011). La Cour doit toutefois estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, comme par exemple d’autres États contractants ou des États tiers, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales réputées pour leur sérieux (voir, notamment, N.A. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 119, 17 juillet 2008).
118. De plus, lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir, notamment, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 179‑180, CEDH 2011 (extraits), Nizomkhon Dzhurayev c. Russie, no 31890/11, § 113, 3 octobre 2013, et Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, § 155, CEDH 2013 (extraits)). En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (voir, par exemple, R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010). »
g) Appréciation de l’existence d’un risque réel
85. Dans l’arrêt Saadi c. Italie (précité, § 140), la Cour a déclaré :
« (...) pour qu’un éloignement forcé envisagé soit contraire à la Convention, la condition nécessaire – et suffisante – est que le risque pour l’intéressé de subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 3 soit réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés (...) »
86. Dans l’arrêt F.G. c. Suède (précité), la Cour a dit ce qui suit au sujet de l’appréciation de l’existence d’un risque réel :
« 113. Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil 1996‑V, et Saadi, précité, § 128). Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, Saadi, précité, § 129, et N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). (...)
114. L’appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 108, série A no 215). À cet égard, et s’il y a lieu, la Cour examinera s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination (Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 216, 28 juin 2011).
(...)
116. Dans une affaire d’expulsion, il appartient à la Cour de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause portée devant elle, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Si l’existence d’un tel risque est établie, l’expulsion du requérant emporterait nécessairement violation de l’article 3, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux. Il est clair néanmoins que toute situation générale de violence n’engendre pas un tel risque. Au contraire, la Cour a précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence (Sufi et Elmi, précité, §§ 216 et 218 ; voir aussi, notamment, L.M. et autres c. Russie, nos 40081/14, 40088/14 et 40127/14, § 108, 15 octobre 2015, et Mamazhonov c. Russie, no 17239/13, §§ 132‑133, 23 octobre 2014). »
87. Pour ce qui est de l’appréciation des éléments de preuve, il est établi dans la jurisprudence de la Cour que « l’existence [du] risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion » (F.G. c. Suède, précité, § 115, cité au paragraphe 83 ci-dessus). L’État contractant a donc l’obligation de tenir compte non seulement des éléments de preuve soumis par le requérant, mais aussi de toute autre circonstance pertinente pour l’affaire examinée.
88. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour apprécier l’importance à accorder aux données sur le pays en question, il convient de prendre en compte leur source, en particulier l’indépendance, la fiabilité et l’objectivité de celle-ci. En ce qui concerne les rapports, l’autorité et la réputation de l’auteur, le sérieux des enquêtes à leur origine, la cohérence de leurs conclusions et leur confirmation par d’autres sources sont autant d’éléments pertinents (Saadi, précité, § 143, NA. c. Royaume-Uni, précité, § 120, et Sufi et Elmi, précité, § 230).
89. La Cour reconnaît également qu’il convient de prendre en considération la présence de l’auteur des données dans le pays en question et sa capacité à rendre compte (Sufi et Elmi, précité, § 231). La Cour est consciente des nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les gouvernements et les ONG pour recueillir des informations dans des situations dangereuses et instables. Elle admet qu’il n’est pas toujours possible de mener des enquêtes au plus près d’un conflit et qu’en pareil cas il peut être nécessaire de s’appuyer sur des informations fournies par des sources ayant une connaissance directe de la situation (Sufi et Elmi, précité, § 232).
90. Pour apprécier le risque, la Cour peut se procurer d’office les éléments pertinents. Ce principe se trouve solidement établi dans la jurisprudence de la Cour (H.L.R. c. France, précité, § 37, Hilal, précité, § 60, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 116, CEDH 2012). Pour ce qui est des éléments qu’elle se procure d’office, la Cour estime que, compte tenu du caractère absolu de la protection offerte par l’article 3, elle doit estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, comme par exemple d’autres États contractants ou non contractants, des agences des Nations unies et des organisations non gouvernementales réputées pour leur sérieux (F.G. c. Suède, précité, § 117, cité au paragraphe 84 ci-dessus). Dans l’exercice de la mission de contrôle que lui confie l’article 19 de la Convention, la Cour adopterait une approche par trop étroite au regard de l’article 3 dans les affaires concernant des étrangers menacés d’expulsion ou d’extradition si, en sa qualité de juridiction internationale chargée de contrôler le respect des droits de l’homme, elle ne devait prendre en considération que les éléments fournis par les autorités internes de l’État contractant en question, sans comparer ces éléments avec ceux provenant d’autres sources fiables et objectives (Salah Sheekh, précité, § 136).
h) La répartition de la charge de la preuve
91. Concernant la charge de la preuve dans les affaires d’expulsion, la jurisprudence constante de la Cour dit qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 ; et que lorsque de tels éléments sont soumis, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (F.G. c. Suède, précité, § 120, Saadi, précité, § 129, NA. c. Royaume‑Uni, précité, § 111, et R.C. c. Suède, précité, § 50).
92. Selon la jurisprudence de la Cour, il incombe aux personnes qui allèguent que leur expulsion emporterait violation de l’article 3 de produire dans toute la mesure du possible des pièces et informations permettant aux autorités de l’État contractant concerné ainsi qu’à la Cour d’apprécier le risque allégué (Said c. Pays-Bas, no 2345/02, § 49, CEDH 2005‑VI). La Cour reconnaît toutefois que pour les demandes de reconnaissance du statut de réfugié il peut être difficile, voire impossible, pour la personne concernée de produire des preuves à bref délai, spécialement si pareilles preuves doivent être obtenues dans le pays qu’elle dit avoir fui. L’absence de preuves documentaires directes ne peut donc en soi être déterminante (Bahaddar c. Pays-Bas, 19 février 1998, § 45, Recueil 1998‑I, et, mutatis mutandis, Said, précité, § 49).
93. Eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui-ci de fournir une explication satisfaisante pour les inexactitudes contenues dans ces déclarations (F.G. c. Suède, précité, § 113, Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007, et S.H.H. c. Royaume-Uni, no 60367/10, § 71, 29 janvier 2013). La Cour a estimé que même lorsque certains détails dans le récit d’un requérant apparaissent quelque peu invraisemblables, cela n’est pas forcément de nature à nuire à la crédibilité générale des allégations de l’intéressé (Said, précité, § 53, et, mutatis mutandis, N. c. Finlande, no 38885/02, §§ 154-155, 26 juillet 2005).
94. En règle générale, on ne peut considérer que le demandeur d’asile s’est acquitté de la charge de la preuve tant qu’il n’a pas fourni, pour démontrer l’existence d’un risque individuel, et donc réel, de mauvais traitements qu’il courrait en cas d’expulsion, un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existant dans le pays de destination.
95. De plus, même si certains facteurs individuels peuvent ne pas constituer un risque réel quand on les examine séparément, ils sont néanmoins susceptibles d’engendrer un risque réel lorsqu’ils sont pris cumulativement et considérés dans le cadre d’une situation de violence générale et de sécurité renforcée (NA. c. Royaume-Uni, précité, § 130). Les éléments suivants peuvent représenter de tels facteurs de risque : l’existence d’antécédents judiciaires et/ou d’un mandat d’arrêt, l’âge, le sexe et l’origine de la personne à éloigner, le fait qu’elle ait auparavant été enregistrée comme membre présumé ou effectif d’un groupe persécuté, et l’existence d’une autre demande d’asile, déposée à l’étranger (NA. c. Royaume-Uni, précité, §§ 143-144 et 146).
96. La Cour note que l’obligation d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents de la cause pendant la procédure d’asile est partagée entre le demandeur d’asile et les autorités chargées de l’immigration. Le demandeur d’asile est normalement la seule partie à pouvoir fournir des informations sur sa situation personnelle. Sur ce point, la charge de la preuve doit donc en principe reposer sur l’intéressé, lequel doit présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qui sont nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Cette obligation est formulée dans les documents du HCR (paragraphes 6 de la Note du HCR et 196 du Guide du HCR, cités aux paragraphes 53-54 ci‑dessus), à l’article 4 § 1 de la « directive qualification » de l’UE ainsi que dans la jurisprudence ultérieure de la CJUE (paragraphes 47 et 49-50 ci‑dessus).
97. Toutefois, les règles relatives à la charge de la preuve ne doivent pas vider de leur substance les droits des requérants protégés par l’article 3 de la Convention. Il est également important de tenir compte de toutes les difficultés qu’un demandeur d’asile peut rencontrer à l’étranger pour recueillir des éléments de preuve (Bahaddar, précité, § 45, et, mutatis mutandis, Said, précité, § 49). Tant les critères élaborés par le HCR (paragraphes 12 de la note et 196 du guide, cités aux paragraphes 53-54 ci‑dessus) que l’article 4 § 5 de la « directive qualification » reconnaissent, explicitement ou implicitement, qu’il faut accorder le bénéfice du doute à une personne en quête de protection internationale.
98. La Cour observe qu’il faut adopter une approche différente pour l’évaluation de la situation générale régnant dans un pays donné. À cet égard, les autorités nationales qui examinent une demande de protection internationale ont pleinement accès aux informations. Pour cette raison, la situation générale dans un autre pays, notamment la capacité de ses pouvoirs publics à offrir une protection, doit être établie d’office par les autorités nationales compétentes en matière d’immigration (voir, mutatis mutandis, H.L.R. c. France, précité, § 37, Hilal, précité, § 60, et Hirsi Jamaa et autres, précité, § 116). Le paragraphe 6 de la Note du HCR précitée préconise une approche similaire, selon laquelle les autorités statuant sur une demande d’asile doivent tenir compte d’office de « la situation objective qui règne dans le pays d’origine en question ». De même, l’article 4 § 3 de la « directive qualification » requiert la prise en considération de « tous les faits pertinents concernant le pays d’origine ».
i) Mauvais traitements antérieurs, un indice de l’existence d’un risque
99. Des questions particulières se posent lorsqu’un demandeur d’asile allègue qu’il a fait l’objet par le passé de mauvais traitements, car cela peut être pertinent pour évaluer le risque que l’intéressé subisse de tels traitements à l’avenir. Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour évaluer pareil risque, il faut tenir dûment compte du fait que l’intéressé a indiqué de manière plausible avoir par le passé été soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Ainsi, dans R.C. c. Suède, affaire dans laquelle le requérant avait déjà été torturé par le passé, la Cour a considéré qu’« il incomb[ait] à l’État de dissiper les doutes éventuels concernant le risque que l’intéressé [fût] à nouveau soumis à un traitement contraire à l’article 3 en cas de mise en œuvre de son expulsion » (R.C. c. Suède, précité, § 55). Dans R.J. c. France, tout en partageant les doutes du gouvernement français quant aux allégations du requérant – un Tamoul sri-lankais – sur ses conditions de détention et son soutien financier au mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), la Cour a estimé que le gouvernement défendeur n’avait pas réfuté la forte présomption de traitement contraire à l’article 3 qui découlait du certificat médical (R.J. c. France, no 10466/11, § 42, 19 septembre 2013). Dans l’affaire D.N.W. c. Suède, tout en admettant que le requérant avait par le passé subi détention et mauvais traitements aux mains des autorités éthiopiennes, la Cour a conclu que « l’intéressé n’a[vait] pas rendu plausible l’allégation selon laquelle il serait exposé à un risque réel d’être tué ou soumis à des mauvais traitements en cas de retour en Éthiopie » (D.N.W. c. Suède, no 29946/10, §§ 42 et 45, 6 décembre 2012).
100. La question des mauvais traitements antérieurs est également évoquée dans la « directive qualification » de l’UE et dans les documents du HCR. Ainsi, l’article 4 § 4 de la « directive qualification » (paragraphe 47 ci‑dessus) énonce – en ce qui concerne l’appréciation d’une demande d’octroi du statut de réfugié ou d’un autre besoin de protection internationale par les autorités des États membres de l’UE – que « [l]e fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».
101. Par ailleurs, cette question, qui est étroitement liée aux aspects généraux de l’appréciation des preuves, est abordée au paragraphe 19 de la Note du HCR, qui traite des éléments permettant d’apprécier le caractère fondé d’une crainte d’être persécuté, et énonce : « Si des persécutions ou mauvais traitements passés pèsent lourdement en faveur d’une appréciation positive du risque de persécution à venir, leur absence ne constitue pas un facteur décisif. De même, l’existence de persécutions passées n’est pas forcément concluante quant à l’éventualité de nouvelles persécutions, en particulier s’il y a eu de grands changements dans la situation du pays d’origine » (paragraphe 53 ci-dessus). La Cour considère que l’approche générale du HCR concernant la charge de la preuve présente aussi un intérêt en l’occurrence : si la charge de la preuve pèse sur le demandeur d’asile, l’agent de l’État qui examine la demande partage avec l’intéressé la tâche « d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents » (paragraphes 6 de la Note du HCR et 196 du Guide du HCR – cités aux paragraphes 53 et 54 ci‑dessus). En outre, concernant l’appréciation de la crédibilité générale d’une demande d’asile, le paragraphe 11 de la Note du HCR indique que la crédibilité est établie dès lors que l’intéressé a présenté une demande cohérente et plausible qui ne contredit pas les faits largement connus et peut donc en définitive être crue (paragraphe 53 ci-dessus).
102. La Cour considère que l’existence de mauvais traitements antérieurs fournit un indice solide d’un risque réel futur qu’un requérant subisse des traitements contraires à l’article 3, dans le cas où il a livré un récit des faits globalement cohérent et crédible qui concorde avec les informations provenant de sources fiables et objectives sur la situation générale dans le pays concerné. Dans ces conditions, c’est au Gouvernement qu’il incombe de dissiper les doutes éventuels au sujet de ce risque.
j) L’appartenance à un groupe ciblé
103. L’exigence susmentionnée selon laquelle un demandeur d’asile doit pouvoir faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existant dans le pays de destination est toutefois assouplie dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’intéressé allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements (Salah Sheekh, précité, § 148, S.H. c. Royaume-Uni, no 19956/06, §§ 69‑71, 15 juin 2010, et NA. c. Royaume-Uni, précité, § 116).
104. Par ailleurs, dans Saadi (précité), la Cour a déclaré ce qui suit :
« 132. Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, éventuellement à l’aide des sources mentionnées au paragraphe précédent, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (voir, mutatis mutandis, Salah Sheekh, précité, §§ 138-149). »
105. Dans ces conditions, la Cour n’insiste donc pas pour que le requérant démontre l’existence d’autres caractéristiques distinctives particulières si cette exigence doit avoir pour effet de rendre illusoire la protection offerte par l’article 3. Elle se prononce sur ce point à la lumière du récit du requérant et des informations sur la situation du groupe en question dans le pays de destination (Salah Sheekh, précité, § 148, et NA. c. Royaume-Uni, précité, § 116).
2. Application de ces principes au cas des requérants
a) Le moment à prendre en considération pour l’appréciation du risque
106. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion (F.G. c. Suède, précité, § 115, cité au paragraphe 83 ci-dessus). Toutefois, si le requérant n’a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour (Saadi, précité, § 133, Chahal, précité, §§ 85-86, et Venkadajalasarma c. Pays-Bas, no 58510/00, § 63, 17 février 2004).
107. Les requérants en l’espèce n’ayant pas été expulsés, la question de savoir s’ils seraient exposés à un risque réel de persécution après un renvoi en Irak doit être examinée à la lumière de la situation actuelle. La Cour considérera donc la situation des requérants telle qu’elle se présente aujourd’hui, en tenant compte des événements du passé pour autant qu’ils éclairent la situation actuelle.
b) La situation générale en matière de sécurité en Irak
108. La Cour note que tant l’office des migrations que le tribunal des migrations ont conclu, en 2011 et en 2012 respectivement, que la situation du point de vue de la sécurité en Irak n’était pas de nature à créer un besoin général de protection internationale pour les demandeurs d’asile. Ce constat a plus tard été confirmé par la chambre dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’espèce en juin 2015.
109. Le Gouvernement a indiqué dans ses observations écrites que, selon les dernières informations fournies par l’office des migrations, l’intensité de la violence à Bagdad ne présentait pas alors un risque réel que des individus subissent des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il s’est référé notamment au rapport du ministère britannique de l’Intérieur d’avril 2015 et aux rapports de Landinfo Norvège de 2014 et 2015. Quant aux requérants, ils ont simplement dit dans leurs observations que la situation en matière de sécurité en Irak se détériorait, sans s’appuyer sur aucun document.
110. La Cour accepte la position du Gouvernement sur la situation générale en matière de sécurité en Irak, position qu’elle estime étayée. Du reste, les derniers rapports du ministère britannique de l’Intérieur, qui datent de novembre 2015, viennent corroborer cette position. Bien que la situation en matière de sécurité se soit dégradée dans la ville de Bagdad, l’intensité de la violence n’a pas atteint un niveau qui présenterait en soi un risque réel que des individus subissent des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En outre, aucun des récents rapports émanant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme cités aux paragraphes 32 à 34 ci-dessus ne contient d’informations permettant d’aboutir à une telle conclusion.
111. Dès lors que la situation générale en matière de sécurité en Irak n’empêche pas en soi l’éloignement des requérants, la Cour doit rechercher si leur situation personnelle est telle qu’ils se trouveraient exposés à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 s’ils étaient expulsés vers l’Irak.
c) La situation personnelle des requérants
112. La Cour relève tout d’abord qu’en l’espèce les menaces en cause auraient visé plusieurs membres de la famille requérante, notamment la fille des premier et deuxième requérants et le frère du premier requérant. Ces menaces ayant résulté essentiellement des activités du premier requérant, la Cour se concentrera donc sur la situation de celui-ci. L’intéressé soutient qu’il courrait un risque réel de subir des mauvais traitements s’il était renvoyé en Irak, et ce d’après lui en raison, d’une part, des persécutions qu’Al-Qaïda lui aurait infligées du fait de ses relations commerciales avec les forces américaines jusqu’en 2008, et, d’autre part, des persécutions que les autorités irakiennes pourraient lui faire subir à cause d’un débat public télévisé auquel il avait participé.
113. La Cour rappelle qu’elle apprécie la situation des requérants du point de vue des conditions d’aujourd’hui. La principale question qui se pose est non pas de savoir comment les autorités suédoises chargées de l’immigration ont évalué le dossier à l’époque (lorsque l’office des migrations et le tribunal des migrations ont adopté leurs décisions, le 22 novembre 2011 et le 23 avril 2012 respectivement), mais de savoir si dans le contexte actuel les requérants seraient encore confrontés à un risque réel d’être persécutés pour les motifs indiqués ci-dessus s’ils étaient renvoyés en Irak (F.G. c. Suède, précité, § 115).
114. Il apparaît d’emblée à la Cour qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute le constat de l’office des migrations que, de 2004 à 2008, la famille a été exposée aux formes les plus graves de violence (ytterst allvarliga övergrepp) de la part d’Al‑Qaïda (paragraphe 17 ci-dessus ; voir aussi F.G. c. Suède, précité, §§ 117-118, cités au paragraphe 84 ci‑dessus), constat qui ne paraît avoir été remis en cause ni dans les observations que l’office a adressées au tribunal des migrations ni dans les conclusions de ce dernier, et qui ne semble pas prêter à controverse dans la procédure devant la Cour. Celle-ci relève par ailleurs que les requérants ont allégué dans le cadre de la procédure devant l’office des migrations qu’il y avait encore eu après 2008 des menaces indirectes à leur endroit et des attaques contre le stock commercial du premier requérant, qu’ils n’étaient parvenus à échapper à de nouvelles exactions qu’en se cachant, et qu’ils n’avaient pas pu se prévaloir de la protection des autorités irakiennes parce que celles-ci étaient selon eux infiltrées par Al-Qaïda. La Cour ne voit pas de motif de remettre en cause cette version. Ainsi, elle constate de manière générale que le récit des requérants quant aux faits survenus de 2004 à 2010 est globalement cohérent et crédible. Il est compatible avec les informations pertinentes sur le pays d’origine provenant de sources fiables et objectives (paragraphe 39 ci‑dessus). Dès lors que les requérants ont subi des mauvais traitements de la part d’Al‑Qaïda, la Cour estime qu’il existe un indice solide montrant qu’en Irak ils demeureraient exposés à un risque émanant d’acteurs non étatiques (paragraphe 102 ci‑dessus).
115. C’est donc au Gouvernement qu’il incombe de dissiper les doutes éventuels au sujet de ce risque. À cet égard, la Cour relève que le Gouvernement a soutenu devant elle que l’office des migrations avait estimé devant le tribunal des migrations que les documents soumis par les requérants concernant les faits censément survenus en septembre et en novembre 2011 avaient un caractère sommaire et une faible valeur probante, et que le Gouvernement a par ailleurs demandé pourquoi les requérants n’avaient pas, à un stade antérieur de la procédure d’asile, présenté des observations plus précises sur la poursuite des exactions après 2008. Le Gouvernement a argué que la crédibilité des requérants avait été amoindrie par cette circonstance, de même que par la date et la manière choisies pour se prévaloir du DVD contenant l’enregistrement audiovisuel du débat télévisé auquel le premier requérant avait participé (paragraphe 71 ci‑dessus). Les requérants ont quant à eux contesté cet argument (paragraphe 61 ci-dessus). Or la Cour observe que l’office des migrations n’a fait de commentaires ni sur la crédibilité des requérants ni sur le DVD. Le raisonnement du tribunal des migrations n’aborde pas non plus spécifiquement ces questions.
L’office et le tribunal des migrations n’ayant pas tenu dans leurs conclusions respectives un raisonnement concret plus poussé sur ces points, la Cour ne bénéficie pas de leur appréciation à cet égard.
Elle estime cependant qu’il n’y a pas lieu de résoudre le désaccord des parties sur ces questions puisque, quoi qu’il en soit, les décisions internes ne semblent pas exclure totalement l’existence d’un risque persistant émanant d’Al-Qaïda.
En fait, ces décisions semblent confirmer que – à la date de leur adoption – la capacité d’Al-Qaïda à opérer librement avait décliné, de même que l’infiltration des autorités par ce groupe, et qu’à l’inverse la capacité des autorités à protéger les requérants avait augmenté (paragraphes 17 et 19 ci‑dessus).
116. D’après divers rapports émanant de sources fiables et objectives, les personnes qui ont collaboré d’une façon ou d’une autre avec les autorités des puissances occupantes en Irak après la guerre ont été et continuent d’être prises pour cible par Al-Qaïda et d’autres groupes. Le document d’information sur l’Irak du ministère britannique de l’Intérieur (« Country of Origin Information Report: Iraq ») de décembre 2009 indiquait que les civils employés par la force multinationale en Irak, ou d’une autre manière liés à celle-ci, étaient susceptibles d’être pris pour cible par des acteurs non étatiques. De même, il ressort de la directive du ministère britannique de l’Intérieur de 2014 que les personnes qui sont perçues comme collaborant ou qui ont collaboré avec le gouvernement irakien actuel et ses institutions, les anciennes forces américaines ou multinationales ou les sociétés étrangères sont exposées au risque de subir des persécutions en Irak. Les rapports en question désignent certains groupes particulièrement ciblés, comme les interprètes, les ressortissants irakiens employés par des entreprises étrangères, et les membres de certaines professions comme les juges, les universitaires, les enseignants, et des professions juridiques (paragraphes 39‑42 ci-dessus).
117. Le premier requérant appartient à un groupe de personnes qui sont systématiquement prises pour cible en raison de leurs liens avec les forces armées américaines. La Cour est consciente que le niveau et la forme de la « collaboration » avec des troupes et autorités étrangères sont variables et qu’en conséquence le niveau de risque peut lui aussi varier dans une certaine mesure. Il convient à cet égard de garder à l’esprit qu’il est déjà établi que le premier requérant a subi des mauvais traitements jusqu’en 2008. En outre, un autre facteur revêt de l’importance, à savoir que les contacts de l’intéressé avec les forces américaines étaient particulièrement visibles, puisque son bureau se trouvait à la base militaire américaine désignée par les requérants sous le nom de « Victoria Camp ». Les rapports susmentionnés ne corroborent guère, voire nullement, l’hypothèse – ressortant des décisions nationales – que les menaces d’Al‑Qaïda avaient dû cesser lorsque le premier requérant avait mis fin à ses relations commerciales avec les forces américaines. Compte tenu des circonstances propres à cette affaire, la Cour estime que le premier requérant et les deux autres membres de sa famille qui sont aussi requérants en l’espèce, s’ils étaient renvoyés en Irak, seraient exposés à un risque réel de continuer à subir des persécutions de la part d’acteurs non étatiques.
118. Se pose une question connexe, à savoir si les autorités irakiennes seraient à même de fournir une protection aux requérants. Les intéressés le contestent, tandis que le Gouvernement soutient qu’il existe à Bagdad un système judiciaire fonctionnant convenablement.
119. La Cour observe à cet égard que, selon les normes du droit de l’UE, l’État ou l’entité qui assure une protection doit répondre à certaines exigences spécifiques : cet État ou cette entité doit en particulier « dispose[r] d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave » (article 7 de la « directive qualification », cité au paragraphe 48 ci-dessus).
120. Les sources internationales objectives les plus récentes en matière de droits de l’homme indiquent des déficiences au niveau de la capacité comme de l’intégrité du système de sécurité et de droit irakien. Le système fonctionne toujours, mais les défaillances se sont accrues depuis 2010 (paragraphe 43 ci-dessus).
Par ailleurs, le Département d’État américain a relevé qu’une corruption à grande échelle, présente à tous les niveaux de l’État et de la société, avait exacerbé le défaut de protection effective des droits de l’homme et que les forces de sécurité n’avaient fourni que des efforts limités pour prévenir la violence sociétale ou y faire face (paragraphe 44 ci-dessus). La situation s’est donc manifestement détériorée depuis 2011 et 2012, époque où l’office des migrations et le tribunal des migrations respectivement avaient apprécié la situation, et où le tribunal avait conclu que, si des menaces devaient persister, il était probable que les services répressifs irakiens auraient non seulement la volonté mais aussi la capacité d’offrir aux demandeurs la protection nécessaire (paragraphe 19 ci‑dessus). Enfin, cette question doit être envisagée dans le contexte d’une dégradation générale de la sécurité, marquée par un accroissement de la violence interconfessionnelle ainsi que par les attentats et les avancées de l’EIIL, si bien que de vastes zones du territoire échappent au contrôle effectif du gouvernement irakien (paragraphe 44 ci‑dessus).
121. À la lumière des informations ci-dessus, notamment sur la situation générale complexe et instable en matière de sécurité, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer que la capacité des autorités irakiennes à protéger les citoyens est amoindrie. Si le niveau actuel de protection est peut-être suffisant pour la population générale de l’Irak, il en va autrement pour les personnes qui, à l’instar des requérants, font partie d’un groupe pris pour cible. Dès lors, compte tenu des circonstances propres à la cause des requérants, la Cour n’est pas convaincue que, dans la situation actuelle, l’État irakien serait à même de fournir aux intéressés une protection effective contre les menaces émanant d’Al-Qaïda ou d’autres groupes privés. Les effets cumulatifs de la situation personnelle des requérants et de la capacité amoindrie des autorités irakiennes à les protéger doivent donc être considérés comme engendrant un risque réel de mauvais traitements dans l’éventualité de leur renvoi en Irak.
122. La capacité des autorités irakiennes à protéger les requérants devant être tenue pour amoindrie dans l’ensemble du pays, la possibilité d’une réinstallation interne en Irak n’est pas une option réaliste dans le cas des requérants.
123. Dès lors, la Cour considère qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que les requérants, s’ils sont renvoyés en Irak, y courront un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En conséquence, la Cour estime que la mise en œuvre de la décision d’expulsion visant les requérants emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
Cliquez sur l'un des boutons ci-dessous pour accéder aux actes inhumains et dégradants.


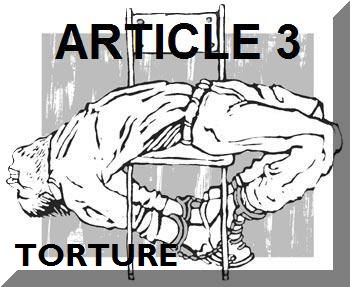
LES ÉTATS CONSIDERÉS COMME DANGEREUX
ITALIE -SLOVENIE - SERBIE - ARABIE SAOUDITE - IRAN - IRAK - SYRIE - LIBYE - SOUDAN - ÉGYPTE - ALGÉRIE - MAROC - TUNISIE - ERITHREE - TCHAD - CONGO GAMBIE - NIGERIA - SOMALIE - GUINÉE - RWANDA
USA - CHINE - SRI LANKA - PAKISTAN - AFGHANISTAN - RUSSIE - GEORGIE - TCHÉCHÉNIE - TURKMÉNISTAN - BELARUS - TADJIKISTAN - OUZBÉKISTAN
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ A.M.E C. Pays Bas du 5 février 2015 requête 51428/10
Irrecevabilité de la requête d’un demandeur d’asile somalien tentant d’éviter son renvoi des Pays-Bas vers l’Italie. Il n'y a aucun danger qu'il soit renvoyé.
En ce qui concerne l’âge du requérant, qui représente l’un des éléments pertinents pour apprécier si les mauvais traitements en question atteignaient le degré minimum de gravité requis pour tomber sous l’empire de l’article 3, la Cour estime que rien n’indique que les autorités italiennes n’ont pas agi de bonne foi concernant les informations personnelles indiquées par A.M.E., étant donné que l’intéressé lui-même leur a délibérément menti en leur disant qu’il était adulte afin de ne pas être séparé du groupe de personnes avec lesquelles il était arrivé en Italie. La Cour relève à cet égard que c’est à bon droit que les autorités chargées du traitement des demandes d’asile se fondent sur les informations personnelles données par les demandeurs eux-mêmes, sauf s’il existe une anomalie flagrante de quelque sorte que ce soit ou que les autorités ont été par ailleurs averties d’un besoin spécial de protection.
L’existence de risques de traitement contraire à l’article 3 devant être appréciée au moment du renvoi ou, dans le cas où le renvoi n’a pas encore eu lieu, au moment de l’examen de l’affaire par la Cour, celle-ci doit déterminer si le requérant, qui doit à présent être considéré comme un demandeur d’asile adulte en Italie, pourrait, en cas de renvoi vers ce pays, se retrouver dans une situation incompatible avec l’article 3, eu égard à sa situation en tant que demandeur d’asile appartenant à un groupe particulièrement défavorisé et vulnérable ayant besoin d’une protection spéciale.
La Cour note que le requérant s’est vu octroyer un permis de séjour en Italie valable jusqu’au 23 août 2012, et observe qu’il n’a pas étayé son allégation selon laquelle il aurait été forcé de quitter le centre d’accueil. Elle relève en outre que, contrairement aux requérants dans l’affaire Tarakhel c. Suisse qui formaient une famille avec six enfants mineurs, le requérant est un jeune homme en pleine possession de ses moyens, sans personne à charge. Par ailleurs, les dispositions concernant les transferts vers l’Italie en vertu du règlement de Dublin ont été définies par les autorités néerlandaises en consultation avec leurs homologues italiens. De plus, la situation actuelle en Italie pour les demandeurs d’asile ne peut en aucun cas se comparer à la situation en Grèce à l’époque de l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce. En conséquence, la structure et la situation générale en ce qui concerne les dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays.
C’est pourquoi la Cour estime que A.M.E. n’a pas établi que, s’il était renvoyé vers l’Italie, il courrait, d’un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l’empire de l’article 3. Rien n’indique que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d’asile ou que, en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée.
Dès lors, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et le déclare irrecevable. Il convient également de rejeter les autres griefs de la requête puisqu’ils ne dénotent aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention ou ses protocoles.
GRANDE CHAMBRE TARAKHEL c. SUISSE
du 4 novembre 2014 requête 29217/12
Article 3 non appliqué par la Suisse : Si la Suisse renvoie une famille en Italie, la Convention ne serait pas appliquée puisqu'en Italie, l'accueil des familles demandeuses d'Asile est en parfaite violation avec la Convention. Les enfants sont séparés des familles.
87. À titre liminaire, la Cour relève que, d’après le gouvernement suisse, en cas de renvoi vers l’Italie, les requérants seraient hébergés à Bologne, dans une structure appartenant au réseau financé par le FER (paragraphe 75 ci-dessus). À supposer même que cette circonstance soulève une question sous l’angle de l’article 37 § 1 b) ou c) de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de l’inclure dans son examen sur le fond de la requête (paragraphe 121 ci-dessous).
1. Sur la responsabilité de la Suisse au regard de la Convention
88. La Cour note que, dans la présente affaire, la responsabilité de la Suisse au regard de l’article 3 de la Convention n’est pas contestée.
Toutefois, la Cour juge utile de rappeler que, dans l’affaire Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande ([GC], no 45036/98, § 152, CEDH 2005‑VI), elle a conclu que la Convention n’interdit pas aux Parties contractantes de transférer des pouvoirs souverains à une organisation internationale à des fins de coopération dans certains domaines d’activité. Les États demeurent néanmoins responsables au regard de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d’observer les obligations juridiques internationales (ibidem, § 153). Une mesure de l’État prise en exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention. Toutefois, un État demeure entièrement responsable au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de ses obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’il a exercé un pouvoir d’appréciation (ibidem, §§ 155-157 ; voir également Michaud c. France, no 12323/11, §§ 102-104, CEDH 2012).
Il est vrai que, contrairement à l’Irlande dans l’affaire Bosphorus, la Suisse n’est pas un État membre de l’Union européenne. Cependant, en vertu de l’accord d’association du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, la Suisse est liée par le règlement Dublin (paragraphes 34 et 36 ci-dessus) et participe au système mis en place par cet instrument.
89. Or, la Cour relève que l’article 3 § 2 du règlement Dublin prévoit que, par dérogation à la règle générale inscrite à l’article 3 § 1, chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il s’agit de la clause dite de « souveraineté » (paragraphe 32 ci-dessus). Dans ce cas, cet État devient l’État membre responsable, au sens du règlement, de l’examen de la demande d’asile et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (M.S.S., précité, § 339). Par l’effet de l’accord d’association, ce mécanisme s’applique aussi à la Suisse.
90. La Cour en déduit que les autorités suisses peuvent, en vertu du règlement Dublin, s’abstenir de transférer les requérants vers l’Italie si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention. En conséquence, elle estime que la décision de renvoyer les requérants vers l’Italie ne relève pas strictement des obligations juridiques internationales qui lient la Suisse dans le cadre du système mis en place par le règlement Dublin et que, dès lors, la présomption de protection équivalente ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce (voir, mutatis mutandis, M.S.S., précité, § 340).
91. Dès lors, dans la présente affaire, la Suisse doit être considérée comme responsable au regard de l’article 3 de la Convention.
2. Sur la recevabilité
92. Constatant que cette partie la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
3. Sur le fond
a) Rappel des principes généraux
93. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’expulsion d’un demandeur d’asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 152, CEDH 2008 ; M.S.S., précité, § 365 ; Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 90-91, série A no 161 ; Vilvarajah et autres c. Royaume‑Uni, 30 octobre 1991, § 103, série A no 125 ; H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 34, Recueil 1997-III ; Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 38, CEDH 2000‑VIII ; Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 135, CEDH 2007‑I).
94. La Cour a dit à de nombreuses reprises que, pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, le traitement doit présenter un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI ; M.S.S., précité, § 219).
95. La Cour a également considéré que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 99, CEDH 2001‑I). Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 85, 26 avril 2005 ; M.S.S., précité, § 249).
96. Dans l’arrêt M.S.S. (§ 250), la Cour a cependant estimé que la question à trancher dans l’affaire en question ne se posait pas en ces termes. À la différence de la situation dans l’affaire Müslim (précitée, §§ 83 et 84), l’obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes aux demandeurs d’asile démunis faisait partie du droit positif et pesait sur les autorités grecques en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transposait le droit de l’Union européenne, à savoir la directive Accueil. Ce que le requérant reprochait aux autorités grecques dans cette affaire, c’était l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé, de par leur action ou leurs omissions délibérées, de jouir en pratique de ces droits afin de pourvoir à ses besoins essentiels.
97. Dans ce même arrêt (§ 251), la Cour a accordé un poids important au statut du requérant, qui était demandeur d’asile et appartenait de ce fait à un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable, ayant besoin d’une protection spéciale, et a noté que ce besoin d’une protection spéciale faisait l’objet d’un large consensus à l’échelle internationale et européenne, comme cela ressortait de la Convention de Genève, du mandat et des activités du HCR ainsi que des normes figurant dans la directive Accueil de l’Union européenne.
98. Toujours dans M.S.S. (§§ 252 et 253), devant déterminer si une situation de dénuement matériel extrême pouvait soulever un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a rappelé qu’elle n’avait pas exclu « la possibilité que la responsabilité de l’État [fût] engagée [sous l’angle de l’article 3] par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine » (Budina c. Russie, (déc.), no 45603/05, 18 juin 2009).
99. Concernant plus particulièrement les mineurs, la Cour a établi qu’il convenait de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant était déterminante et prédominait sur la qualité d’étranger en séjour illégal (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 55, CEDH 2006‑XI ; Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 91, 19 janvier 2012). En effet, les enfants ont des besoins spécifiques dus notamment à leur âge et à leur dépendance mais aussi à leur statut de demandeur d’asile. La Cour a rappelé d’ailleurs que la Convention relative aux droits de l’enfant incite les États à prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire, qu’il soit seul ou accompagné de ses parents (voir dans ce sens Popov, précité, § 91).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
100. Les requérants estiment en substance qu’en cas de renvoi vers l’Italie, « sans garantie individuelle de prise en charge », ils seraient victimes d’un traitement inhumain et dégradant lié à l’existence de « défaillances systémiques » dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile.
101. Pour examiner ce grief, la Cour estime devoir suivre une approche similaire à celle qu’elle avait adoptée dans l’arrêt M.S.S., précité, où elle avait examiné la situation individuelle du requérant à la lumière de la situation générale existant en Grèce à l’époque des faits.
102. Elle rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle l’expulsion d’un demandeur d’asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 lorsqu’il y a des « motifs sérieux et avérés de croire » que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un « risque réel » d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (paragraphe 93 ci-dessus).
103. Il ressort également de l’arrêt M.S.S. que la présomption selon laquelle un État participant au système « Dublin » respecte les droits fondamentaux prévus par la Convention n’est pas irréfragable. Pour sa part, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne était renversée en cas de « défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, des demandeurs d’asile transférés vers le territoire de cet État membre » (paragraphe 33 ci-dessus).
104. Dans le cas d’un renvoi « Dublin », la présomption selon laquelle un État contractant « de destination » respecte l’article 3 de la Convention peut donc être valablement réfutée en présence de « motifs sérieux et avérés de croire » que la personne objet de la mesure de renvoi courra un « risque réel » de subir des traitements contraires à cette disposition dans l’État de destination.
L’origine du risque encouru ne modifie en rien le niveau de protection garanti par la Convention et les obligations que celle-ci impose à l’État auteur de la mesure de renvoi. Elle ne dispense pas cet État d’examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne objet de la mesure et de surseoir au renvoi au cas où le risque de traitements inhumains ou dégradants serait avéré.
La Cour note d’ailleurs que cette approche a été suivie par la Cour suprême du Royaume-Uni dans son arrêt du 19 février 2014 (paragraphe 52 ci-dessus).
105. Dans le cas d’espèce, la Cour doit donc rechercher si, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et de la situation particulière des requérants, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants risqueraient de subir des traitements contraires à l’article 3.
i. La situation générale du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie
106. En ce qui concerne la situation générale, dans sa décision Mohammed Hussein (précitée, § 78) la Cour a relevé que les recommandations du HCR et le rapport du Commissaire aux droits de l’homme, publiés en 2012, faisaient état d’un certain nombre de défaillances. Selon les requérants, ces défaillances seraient « systémiques » et tiendraient aux lenteurs de la procédure d’identification, aux capacités réduites des structures d’accueil et aux conditions de vie qui régneraient dans les structures disponibles (paragraphes 56-67 ci-dessus).
α) Les lenteurs de la procédure d’identification
107. Pour ce qui est des difficultés qui seraient liées aux lenteurs de la procédure d’identification, la Cour note que les requérants ont déjà été identifiés et que les autorités suisses et italiennes disposent désormais de toutes les informations pertinentes les concernant. Elle relève au surplus qu’il n’a fallu que dix jours aux autorités italiennes pour les identifier à leur arrivée à Stignano, bien qu’ils eussent fourni à la police de fausses identités (paragraphe 10 ci-dessus). Dès lors, cet aspect du grief des requérants n’est plus directement pertinent pour l’examen de l’affaire et la Cour n’estime pas utile de s’y arrêter plus longuement.
β) Les capacités d’hébergement des structures d’accueil
108. Concernant les capacités d’accueil des structures d’hébergement pour demandeurs d’asile, les requérants s’appuient sur des études détaillées réalisées par des organisations non gouvernementales, selon lesquelles le nombre de demandes d’asile en Italie était de 34 115 en 2011 et de 15 715 en 2012, avec des chiffres en hausse pour 2013. Selon le rapport OSAR, le nombre de réfugiés vivant en Italie en 2012 s’élevait à 64 000. Or, en 2012 il n’y aurait eu que 8 000 places dans les CARA, avec des listes d’attente si longues que pour la majorité des postulants il n’aurait existé aucune perspective réaliste d’accès. Pour ce qui est des structures appartenant au SPRAR, le rapport OSAR indiquerait que le nombre de places s’élevait à 4 800 et que 5 000 personnes étaient inscrites sur liste d’attente. Le même rapport relèverait que, d’après deux autres organisations, Caritas et JRS, seulement 6 % des personnes admises dans les structures du SPRAR, où l’accueil serait par ailleurs limité à une durée de six mois, parviennent à trouver un emploi et à s’intégrer professionnellement dans la société italienne. Quant aux centres d’hébergement communaux, accessibles non seulement aux demandeurs d’asile mais aussi à toute personne démunie, le nombre de places y serait également nettement inférieur aux besoins. Selon le rapport OSAR, la ville de Rome comporterait 1 300 places, avec une liste d’attente de 1 000 personnes, et le délai moyen d’attribution y serait de trois mois. À Milan, il n’y aurait que 400 places et les familles seraient systématiquement séparées.
109. La Cour note que ces chiffres ne sont pas contestés par le gouvernement suisse, qui se limite à mettre l’accent sur les efforts déployés par les autorités italiennes afin de faire face comme elles le peuvent au flux ininterrompu de demandeurs d’asile que connaît le pays depuis plusieurs années. Dans ses observations, le gouvernement italien indique en effet que les actions entreprises par les autorités italiennes vont dans le sens d’un renforcement des capacités d’accueil des demandeurs d’asile. En particulier, il a été décidé en septembre 2013 de porter la capacité totale du système SPRAR à 16 000 places au cours de la période 2014-2016 ; 1 230 places auraient déjà été affectées, portant le total des places disponibles à 9 630 (paragraphe 78 ci-dessus).
110. La Cour relève que les méthodes utilisées pour calculer le nombre de demandeurs d’asile privés d’hébergement en Italie sont contestées. Sans entrer dans le débat sur l’exactitude des données chiffrées disponibles, il suffit à la Cour de constater la disproportion flagrante entre le nombre de demandes d’asile présentées en 2013, qui selon le gouvernement italien s’élevaient à 14 184 au 15 juin 2013 (paragraphe 78 ci-dessus), et le nombre de places disponibles dans les structures du réseau SPRAR (9 630 places) qui, toujours selon le gouvernement italien, sont celles susceptibles d’accueillir les requérants (paragraphe 76 ci-dessus). De surcroît, considérant que le nombre de demandes indiqué ne se réfère qu’aux six premiers mois de l’année 2013, il est vraisemblable que le chiffre pour la totalité de l’année soit bien plus élevé, ce qui fragiliserait d’avantage la capacité d’accueil du système SPRAR.
Par ailleurs, la Cour observe que ni le gouvernement suisse ni le gouvernement italien n’ont affirmé que la capacité combinée du système SPRAR et des CARA serait en mesure d’absorber, si ce n’est la totalité, au moins une part prépondérante de la demande d’hébergement.
γ) Les conditions d’accueil dans les structures disponibles
111. Pour ce qui est des conditions de vie dans les structures disponibles, les études citées par les requérants font état de certains centres d’hébergement où prévaudraient promiscuité, insalubrité et situations de violence généralisée (paragraphes 66-67 ci-dessus). Les requérants indiquent d’ailleurs avoir eux-mêmes assisté à des épisodes de violence lors de leur bref séjour au sein du CARA de Bari. Ils soutiennent également que, dans certains centres, les familles de demandeurs d’asile seraient systématiquement séparées.
112. La Cour note que, dans ses recommandations pour 2013, le HCR décrit effectivement un certain nombre de difficultés, tenant notamment à la disparité des services disponibles, suivant la taille des structures, et à un manque de coordination sur le plan national. Toutefois, tout en relevant une certaine dégradation des conditions d’accueil, notamment en 2011, ainsi qu’un problème de surpopulation dans les CARA, le HCR ne fait pas état de situations généralisées de violence ou d’insalubrité, saluant même les efforts accomplis par les autorités italiennes afin d’améliorer la qualité de l’accueil des demandeurs d’asile. Quant au Commissaire aux droits de l’homme, dans son rapport 2012 (paragraphe 49 ci-dessus), il relève lui-aussi l’existence de certains problèmes dans « certains centres d’accueil », exprimant une inquiétude particulière en ce qui concerne l’assistance juridique, les soins et l’aide psychologique dans les centres d’accueil d’urgence, le délai d’identification des personnes vulnérables et la nécessité de préserver l’unité familiale pendant les transferts.
113. Enfin, la Cour note que lors de l’audience du 12 février 2014, le gouvernement italien a, d’une part, confirmé que des épisodes de violence étaient survenus au CARA de Bari peu avant l’arrivée des requérants et, d’autre part, nié que les familles de demandeurs d’asile fussent systématiquement séparées, si ce n’est dans quelques cas et pendant des périodes très brèves, notamment pendant les procédures d’identification.
114. Au vu de ce qui précède, la situation actuelle de l’Italie ne saurait aucunement être comparée à la situation de la Grèce à l’époque de l’arrêt M.S.S., précité, où la Cour avait relevé en particulier que les centres d’accueil disposaient de moins de 1 000 places, face à des dizaines de milliers de demandeurs d’asile, et que les conditions de dénuement le plus total décrites par le requérant étaient un phénomène de grande échelle. Force est donc de constater que l’approche dans la présente affaire ne saurait être la même que dans l’affaire M.S.S.
115. Si donc la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d’asile vers ce pays, les données et informations exposées ci-dessus font toutefois naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il en résulte, aux yeux de la Cour, que l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence.
ii. La situation individuelle des requérants
116. S’agissant de la situation individuelle des requérants, la Cour note que, d’après les constats de la police italienne et les fiches signalétiques qui se trouvent joints aux observations du gouvernement italien, le couple et ses cinq premiers enfants ont débarqué sur les côtes de Calabre le 16 juillet 2011 et ont immédiatement fait l’objet d’une procédure d’identification, après avoir fourni de fausses identités. Le même jour, les requérants ont été placés dans une structure d’accueil mise à disposition par la commune de Stignano, où ils sont demeurés jusqu’au 26 juillet 2011, date à laquelle, une fois établie leur véritable identité, ils ont été transférés au CARA de Bari. Le 28 juillet 2011, ils ont quitté ce centre, sans autorisation, pour une destination inconnue.
117. Aussi, de même que la situation générale des demandeurs d’asile en Italie n’est pas comparable à celle des demandeurs d’asile en Grèce, telle qu’elle a été analysée dans l’arrêt M.S.S. (paragraphe 114 ci-dessus), la situation particulière des requérants dans la présente affaire est différente de celle du requérant dans l’affaire M.S.S. : alors que les premiers ont été immédiatement pris en charge par les autorités italiennes, le second avait été d’abord placé en détention et ensuite abandonné à son sort, sans aucun moyen de subsistance.
118. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, le traitement doit présenter un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (paragraphe 94 ci-dessus). Elle rappelle également que, en tant que catégorie de la population « particulièrement défavorisée et vulnérable », les demandeurs d’asile ont besoin d’une « protection spéciale » au regard de cette disposition (M.S.S., précité, § 251).
119. Cette exigence de « protection spéciale » pour les demandeurs d’asile est d’autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité. Cela vaut même lorsque, comme en l’espèce, les enfants demandeurs d’asile sont accompagnés de leurs parents (Popov, précité, § 91). Les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent « engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme » (voir, mutatis mutandis, Popov, précité, § 102), faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 de la Convention.
120. En l’espèce, comme la Cour l’a constaté plus haut (paragraphe 115 ci-dessus), compte tenu de la situation actuelle du système d’accueil en Italie, et bien que cette situation ne soit pas comparable à celle de la Grèce, que la Cour a examinée dans le cadre de l’affaire M.S.S., l’hypothèse qu’un nombre significatif de demandeurs d’asile renvoyés vers ce pays soient privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, n’est pas dénuée de fondement. Il appartient dès lors aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu’à leur arrivée en Italie les requérants seront accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge des enfants, et que l’unité de la cellule familiale sera préservée.
121. La Cour note que, selon le gouvernement italien, les familles avec enfants sont considérées comme une catégorie particulièrement vulnérable et sont normalement prises en charge au sein du réseau SPRAR. Ce système leur garantirait l’hébergement, la nourriture, l’assistance sanitaire, des cours d’italien, l’orientation vers les services sociaux, des conseils juridiques, des cours de formation professionnelle, des stages d’apprentissage et une aide dans la recherche d’un logement autonome (paragraphe 86 ci-dessus). Cela étant, dans ses observations écrites et orales, le gouvernement italien n’a pas fourni plus de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des requérants.
Il est vrai qu’à l’audience du 12 février 2014 le gouvernement suisse a indiqué que l’ODM avait été informé par les autorités italiennes qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants seraient hébergés à Bologne, dans l’une des structures financées par le FER (paragraphe 75 ci-dessus). Toutefois, en l’absence d’informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d’hébergement et à la préservation de l’unité familiale, la Cour considère que les autorités suisses ne disposent pas d’éléments suffisants pour être assurées qu’en cas de renvoi vers l’Italie, les requérants seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants.
122. Il s’ensuit que, si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention.
COUR DE CASSATION FRANCAISE
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 26 mars 2019, pourvoi n° 19-81731 cassation
Vu les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble 4, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 593 et 695-33 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’avant-dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs
propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu par ailleurs qu’il se déduit de la combinaison des autres de ces textes
que, lorsque les informations contenues dans le mandat d’arrêt sont
insuffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la
remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux,
cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’État d’émission ;
Attendu que, pour écarter les moyens de la personne réclamée tirés du risque de violation de ses droits fondamentaux en raison notamment des conditions de détention dans les prisons slovènes, l’arrêt énonce que l’intéressé n’est pas demandé pour l’exécution d’une peine et qu’il n’est pas démontré qu’il serait susceptible de subir dans les prisons de Slovénie des traitements inhumains et dégradants ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans analyser les éléments produits par la personne réclamée, tirés d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de documents établis par les organes du Conseil de l’Europe, qui faisaient état d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l’État membre d’émission en raison des conditions générales de détention, et de carences des mécanismes de contrôle desdites conditions, afin d’évaluer si ces informations, objectives et fiables, étaient précises et dûment actualisées, et si elle devait, le cas échéant, solliciter des informations supplémentaires des autorités de l’État d’émission, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
ILIAS ET AHMED c. HONGRIE du 21 novembre 2019 requête n° 47287/15
Sur la responsabilité de la Hongrie relativement à l’expulsion des requérants
123. Pour autant que le Gouvernement soutient que les requérants ont quitté la zone de transit de leur plein gré, ce qui peut être interprété comme un argument consistant à dire que la Hongrie n’est pas responsable de leur expulsion, la Cour observe que les autorités ont rendu une décision d’expulsion contraignante à l’égard des intéressés. Elle considère en outre que les conditions dans lesquelles ceux-ci sont retournés en Serbie montrent qu’ils ne l’ont pas fait de leur plein gré (paragraphe 40 ci‑dessus).Partant, l’expulsion des requérants du territoire hongrois est attribuable à l’État défendeur.
Les principes pertinents
a) Les principes généraux applicables dans les affaires d’expulsion
124. L’interdiction des traitements inhumains ou dégradants que consacre l’article 3 de la Convention est l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Elle est également une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie no 16483/12, § 158, 15 décembre 2016).
125. Les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94, et Mohammadi c. Autriche, no 71932/12, § 58, 3 juillet 2014). Ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent un droit à l’asile politique (Sharifi c. Autriche, no 60104/08, § 28, 5 décembre 2013).
126. L’expulsion, l’extradition ou toute autre mesure d’éloignement d’un étranger par un État contractant peut néanmoins soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3. En pareil cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser ou extrader la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 90-91, série A no 161, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 103, série A no 215, H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 135, 11 janvier 2007, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 114, CEDH 2012).
127. Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant courrait un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3, la Cour doit appliquer des critères rigoureux (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil 1996‑V) et il faut nécessairement que les autorités nationales compétentes, puis la Cour, procèdent à une appréciation de la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005‑I). Ces exigences impliquent que, pour tomber sous le coup de l’article 3, le mauvais traitement auquel le requérant affirme qu’il serait exposé en cas de renvoi doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 60, CEDH 2001‑II).
b) Les obligations incombant à l’État lorsqu’il ordonne l’expulsion d’un demandeur d’asile vers un pays tiers sans procéder à un examen au fond de la demande d’asile
128. Dans le cadre d’affaires ayant trait à l’expulsion de demandeurs d’asile, la Cour a eu à connaître de diverses situations, notamment de décisions d’expulsion du requérant vers son pays d’origine et des risques que l’intéressé disait y courir (voir, par exemple, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, 23 mars 2016), ou encore d’expulsions vers des pays tiers et des risques connexes (voir, par exemple, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, et Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, CEDH 2014 (extraits)). Si les principes fondamentaux évoqués dans les trois paragraphes précédents s’appliquent dans tous les cas, les questions sous-jacentes et, partant, la teneur des obligations découlant de la Convention pour l’État à l’origine de la mesure d’expulsion peuvent, elles, différer selon le contexte.
129. Chaque fois qu’elle a été saisie d’affaires où les autorités avaient décidé d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers, la Cour a considéré que l’État contractant restait tenu par l’obligation de ne pas expulser l’intéressé lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire qu’une expulsion l’exposerait, directement (c’est-à-dire dans le pays tiers en question) ou indirectement (par exemple dans son pays d’origine ou dans un autre pays), à un risque de subir des traitements contraires, en particulier, à l’article 3 (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 342, 343 et 362 à 368, et les références citées).
130. Cela étant, lorsqu’un État contractant décide d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers sans examiner au fond sa demande d’asile, il ne s’acquitte pas de l’obligation de ne pas exposer l’intéressé à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la même façon que lorsqu’il ordonne le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine.
131. Si, dans le deuxième cas, les autorités à l’origine de la mesure d’expulsion examinent la demande d’asile au fond et, partant, apprécient les risques que le demandeur d’asile dit courir dans son pays d’origine, dans le premier cas, elles doivent principalement chercher à déterminer si l’intéressé aura ou non accès à une procédure d’asile adéquate dans le pays tiers de destination. En effet, l’État à l’origine de la mesure d’expulsion part du principe que ce sera au pays tiers de destination qu’incombera la tâche d’examiner au fond la demande d’asile si pareille demande lui est présentée. Outre cette question centrale, lorsque le demandeur d’asile allègue être exposé à un risque de subir des traitements contraires à l’article 3, l’État à l’origine de la mesure d’expulsion doit également apprécier ce risque dès lors qu’il concerne, par exemple, les conditions de détention ou de vie de l’intéressé dans le pays tiers de destination.
132. La directive européenne relative aux procédures d’asile, en ses articles 33, 38 et 43, interprétés à la lumière de ses considérants 38 à 48 (paragraphes 47, 49, 53 et 55 ci-dessus), offre aux Parties contractantes auxquelles elle s’applique la possibilité d’adopter une législation interne qui permet aux autorités, dans certaines conditions, de se dispenser d’un examen au fond des demandes de protection internationale (autrement dit, de ne pas chercher à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale et, par conséquent, de ne pas examiner les risques auxquels l’intéressé est exposé dans son pays d’origine) et de se livrer plutôt à un examen de la recevabilité au sens de la directive susmentionnée de l’Union européenne, c’est-à-dire à un examen visant à déterminer, en particulier, si l’on peut raisonnablement considérer qu’un autre pays procédera à l’examen de la demande au fond ou accordera une protection au demandeur d’asile. Dans les cas où la deuxième option est choisie et où la demande est jugée irrecevable, le pays à l’origine de cette décision n’examine pas la demande au fond.
133. Ainsi que la Cour l’a dit dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Mohammadi (précitée, § 60), qui concernait l’expulsion d’un demandeur d’asile depuis un État membre de l’Union européenne vers un autre et l’application du règlement Dublin II, l’État à l’origine de la mesure d’éloignement doit s’assurer que la procédure d’asile du pays intermédiaire offre des garanties suffisantes pour éviter que le demandeur d’asile concerné ne soit expulsé directement ou indirectement vers son pays d’origine sans une évaluation appropriée, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, des risques auxquels il serait exposé (voir aussi M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 358, Sharifi, précité, § 30, T.I. c. Royaume-Uni (déc.), no 43844/98, CEDH 2000‑III, et K.R.S. c. Royaume-Uni (déc.), no 32733/08, 2 décembre 2008).
134. La Cour ajoute que dans tous les cas où un État contractant ordonne l’expulsion d’un demandeur d’asile vers un pays tiers intermédiaire sans examiner au fond la demande de l’intéressé, que le pays tiers de destination soit ou non un État membre de l’Union européenne ou un État partie à la Convention, il doit procéder à un examen approfondi visant à déterminer s’il existe un risque réel que l’intéressé se voie refuser, dans le pays tiers de destination, l’accès à une procédure d’asile adéquate qui le protège contre le refoulement. Dès lors qu’il est établi que les garanties à cet égard sont insuffisantes, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser le demandeur d’asile vers le pays tiers concerné.
135. Le gouvernement défendeur, appuyé par les gouvernements bulgare et russe, considère apparemment que l’obligation évoquée ci-dessus est inexistante lorsque – ce qu’il estime être le cas en l’espèce – les personnes concernées sont non pas de véritables demandeurs d’asile mais des migrants qui ne risquent pas de subir des mauvais traitements dans leur pays d’origine (paragraphes 108 à 111, 118 et 120 ci-dessus).
136. La Cour observe que les États contractants sont libres, sous réserve du respect de leurs engagements internationaux, de rejeter une demande d’asile et de renvoyer un demandeur d’asile vers son pays d’origine ou vers un pays tiers acceptant de le recevoir lorsque la demande d’asile en question est dénuée de fondement ou, a fortiori, lorsque l’intéressé ne peut prétendre de manière défendable qu’il court un risque nécessitant l’octroi d’une protection. La forme que doit prendre l’examen du bien-fondé de la demande dépend naturellement de la gravité des griefs soulevés et des éléments de preuve présentés.
137. Cela étant, il importe de ne pas perdre de vue que lorsqu’un État contractant ordonne l’expulsion d’un demandeur d’asile vers un pays tiers sans examiner sa demande au fond, il est impossible de savoir si l’intéressé risque de subir des traitements contraires à l’article 3 dans son pays d’origine ou s’il s’agit simplement d’un migrant économique. C’est uniquement à l’issue d’une procédure judiciaire donnant lieu à une décision que les autorités peuvent formuler à cet égard un constat sur lequel elles peuvent s’appuyer. En l’absence de pareil constat, l’expulsion vers un pays tiers doit être précédée d’un examen approfondi de la question de savoir si la procédure d’asile du pays tiers de destination offre des garanties suffisantes pour éviter que le demandeur d’asile ne soit expulsé directement ou indirectement vers son pays d’origine sans une évaluation appropriée des risques auxquels pareille mesure l’exposerait sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Contrairement à ce que soutient le gouvernement défendeur, le fait de constater a posteriori, dans le cadre d’une procédure interne ou internationale, que l’intéressé ne courait pas de risques dans son pays d’origine, ne peut servir à exonérer rétrospectivement l’État de l’obligation procédurale décrite ci-dessus. S’il en allait autrement, des demandeurs d’asile exposés à un péril mortel dans leur pays d’origine pourraient être expulsés sommairement, en toute légalité, vers des pays tiers « non sûrs ». Concrètement, l’interdiction des mauvais traitements se verrait ainsi vidée de son sens dans les cas d’expulsion de demandeurs d’asile.
138. La Cour reconnaît que, comme l’affirme le gouvernement défendeur, il arrive que des personnes qui n’ont pas besoin de protection dans leur pays d’origine abusent du droit d’asile. Elle estime néanmoins que les États peuvent faire face à ce problème sans mettre à mal les garanties contre les mauvais traitements consacrées par l’article 3. S’ils choisissent d’ordonner des mesures d’expulsion vers un pays tiers sûr sans examiner au préalable les demandes d’asile au fond, il leur suffit de procéder à un examen approfondi du système d’asile du pays en question afin de déterminer si celui-ci traitera les demandes d’asile de manière appropriée. Ils peuvent par ailleurs choisir, ainsi que la Cour l’a dit plus haut, de rejeter à l’issue d’un examen au fond les demandes d’asile dénuées de fondement lorsque les risques pertinents n’ont pas été établis dans le pays d’origine des demandeurs.
c) Nature et teneur de l’obligation de vérifier que le pays tiers est un pays « sûr »
139. S’appuyant sur les principes bien établis qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention en matière d’expulsion de demandeurs d’asile, la Cour considère que de l’obligation énoncée ci‑dessus découle celle, pour les autorités internes appliquant la notion de « pays tiers sûr », de procéder à un examen minutieux des conditions applicables dans le pays tiers concerné et, en particulier, de l’accessibilité et de la fiabilité de son système d’asile (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 344-359 et §§ 365-368). Les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les lignes directrices adoptées par cet organe (paragraphes 61 à 63 ci-dessus) et la Résolution 1471 (2005) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (paragraphe 64 ci‑dessus) peuvent être pertinentes à cet égard.
140. En outre, un certain nombre de principes développés dans la jurisprudence de la Cour concernant l’appréciation des risques auxquels un demandeur d’asile serait exposé en cas d’expulsion vers son pays d’origine s’appliquent également, mutatis mutandis, à l’examen par les autorités internes de la question de savoir si un pays tiers par lequel un demandeur d’asile est arrivé est « sûr » (voir la démarche suivie dans M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 346-352 et 358-359).
141. En particulier, s’il incombe à la personne qui sollicite l’asile d’invoquer, justificatifs à l’appui, les éléments de sa situation personnelle, dont les autorités internes ne peuvent avoir connaissance, les autorités doivent quant à elles procéder d’office, sur la base des conditions du moment, à une appréciation, notamment, de l’accessibilité et du fonctionnement du système d’asile du pays de destination ainsi que des garanties qu’il offre dans la pratique. Les autorités internes doivent se livrer à cet exercice en s’appuyant principalement sur les faits connus d’elles au moment de l’expulsion, mais elles ont également l’obligation de rechercher à cet effet toutes les informations pertinentes généralement disponibles (Sharifi, précité, §§ 31 et 32). Elles sont en principe réputées avoir connaissance des défaillances générales abondamment décrites dans des rapports fiables émanant notamment du HCR, du Conseil de l’Europe et des organes de l’Union européenne (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 346-350 ; voir également, mutatis mutandis, F.G. c. Suède, précité, §§ 125-127). L’État à l’origine de la mesure d’expulsion ne peut pas simplement présumer que le demandeur d’asile, une fois dans le pays tiers de destination, sera traité conformément aux standards conventionnels. Il doit au contraire s’enquérir de la manière dont les autorités de ce pays appliquent en pratique la législation en matière d’asile (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 359).
La tâche incombant à la Cour à la lumière des principes énoncés ci‑dessus et des circonstances de l’espèce
142. Ainsi qu’il a été noté ci-dessus, la teneur des obligations découlant de l’article 3 pour l’État ordonnant l’expulsion n’est pas la même selon que le pays de destination est le pays d’origine du demandeur d’asile ou un pays tiers, et, dans ce deuxième cas, selon que l’État ordonnant l’expulsion a ou non procédé à un examen au fond de la demande d’asile. Partant, la tâche de la Cour varie en principe en fonction de ces différents types de cas, sous réserve des griefs soulevés par le requérant concerné.
143. En l’espèce, s’appuyant sur l’article 51 de la loi hongroise relative à l’asile (paragraphe 41 ci-dessus), qui prévoyait l’irrecevabilité des demandes d’asile dans certains cas et reflétait les choix opérés par la Hongrie dans le cadre de la transposition du droit applicable de l’Union européenne, les autorités internes n’ont pas procédé à un examen au fond des demandes d’asile des requérants – c’est-à-dire qu’elles n’ont pas cherché à déterminer si les intéressés risquaient d’être soumis à des mauvais traitements dans leur pays d’origine, le Bangladesh –, mais elles ont déclaré ces demandes irrecevables au motif que les requérants arrivaient de Serbie qui, d’après elles, était un pays tiers sûr et pouvait donc se charger de l’examen au fond des demandes d’asile des intéressés (paragraphes 23, 34 et 36 ci-dessus).
144. En conséquence, le grief fondé par les requérants sur l’article 3 (paragraphe 100 ci-dessus) consiste en substance à dire qu’ils ont été expulsés en dépit de la présence d’éléments montrant clairement qu’en Serbie ils n’auraient pas accès à une procédure d’asile adéquate apte à les protéger contre un refoulement. En l’espèce, la Cour a avant tout pour tâche d’examiner ce grief principal (pour une approche similaire, voir Babajanov c. Turquie, no 49867/08, § 43 in fine, 10 mai 2016, et Sharifi, précité, § 33).
145. Les autorités hongroises ayant pris la décision litigieuse d’expulser les requérants vers la Serbie sans tenir compte de la situation au Bangladesh et sans examiner au fond les demandes d’asile des intéressés, la Cour n’a pas à rechercher si ceux-ci risquaient de subir des mauvais traitements dans leur pays d’origine. Pareille analyse serait en effet sans rapport avec la question de savoir si, en l’espèce, l’État défendeur s’est acquitté de ses obligations procédurales découlant de l’article 3.
146. À cet égard, la Cour ne perd pas de vue que dans certaines affaires dans lesquelles des demandeurs d’asile avaient été expulsés vers des pays tiers intermédiaires sans que leurs demandes d’asile n’eussent été examinées au fond par l’État à l’origine de la mesure, elle a dit que le grief des requérants relatif aux risques qu’ils affirmaient courir dans leur pays d’origine était défendable, ce qui pourrait être interprété comme une prise de position de la Cour, dans le contexte de l’article 3 de la Convention, sur la question du caractère défendable ou non des allégations concernant l’existence de risques dans le pays d’origine (voir, parmi d’autres, T.I. c. Royaume-Uni, décision précitée, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 344, mais aussi, a contrario, la démarche suivie dans Mohammadi, précité, §§ 64-75, Sharifi, précité, §§ 26-39, Tarakhel, précité, §§ 93-122, et Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie (déc.), no 27725/10, §§ 62-79, 2 avril 2013).
147. En l’espèce, la Grande Chambre, qui a eu l’avantage de prendre connaissance des observations des parties consacrées spécifiquement à cette question, considère que la Cour n’a pas à agir comme une juridiction de première instance et à examiner des aspects du fond des demandes d’asile là où l’État défendeur a décidé – légitimement – de ne pas se pencher dessus et qu’il s’est appuyé pour prendre la décision d’expulsion litigieuse sur l’application de la notion de « pays tiers sûr ». La question de savoir s’il existait ou non une allégation défendable selon laquelle le demandeur d’asile courait un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 dans son pays d’origine est pertinente dès lors que l’État à l’origine de la mesure d’expulsion a examiné le risque en question.
148. Il s’ensuit que, eu égard aux faits de la cause et aux griefs que les requérants soulèvent relativement à la démarche des autorités hongroises, qu’ils estiment défaillante, la Cour doit chercher à déterminer : 1) si les autorités ont tenu compte, d’office et de manière appropriée, des informations générales disponibles sur la Serbie et son système d’asile et 2) si les requérants se sont vu offrir une possibilité suffisante de démontrer que la Serbie n’était pas un pays tiers sûr dans leur cas.
149. Enfin, la Cour pourra également être amenée à examiner le grief des requérants selon lequel les autorités hongroises n’ont pas tenu compte des conditions d’accueil, inadéquates selon eux, des demandeurs d’asile en Serbie (voir, par exemple, Tarakhel, précité, § 105).
150. L’examen par la Cour de ces questions doit être guidé par le principe, découlant de l’article 1 de la Convention, selon lequel ce sont les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales. Elle doit cependant estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives (voir, mutatis mutandis, F.G. c. Suède, précité, §§ 117 et 118).
Sur la question de savoir si les autorités hongroises ont respecté leur obligation procédurale découlant de l’article 3
151. La Cour observe que, dans le cas des requérants, les autorités hongroises se sont appuyées sur une liste de « pays tiers sûrs » qui avait été établie par voie de décret gouvernemental (no 191/2015. (VII.21.)) (paragraphe 44 ci-dessus) et qui a eu pour effet d’instaurer une présomption selon laquelle les pays y figurant étaient « sûrs ».
152. La Convention n’interdit pas aux États contractants d’établir des listes de pays présumés sûrs pour les demandeurs d’asile. Les États membres de l’Union européenne le font, notamment, conformément aux conditions énoncées aux articles 38 et 39 de la directive relative aux procédures d’asile (paragraphes 53 et suiv. ci-dessus). La Cour considère toutefois qu’une présomption qu’un pays donné est « sûr », dès lors qu’elle sert de fondement à une décision concernant un demandeur d’asile, doit être suffisamment étayée en amont par une analyse de la situation qui règne dans le pays et, en particulier, du système d’asile qui y est en vigueur.
153. La présomption dont il s’agit en l’espèce fut instaurée en juillet 2015, lorsque la Hongrie révisa sa position et déclara que la Serbie était un pays tiers sûr.Les arguments avancés par le Gouvernement devant la Grande Chambre paraissent confirmer que ce changement était exclusivement motivé par la considération que la Serbie était liée par les traités internationaux pertinents, qu’en sa qualité de candidat à l’adhésion à l’Union européenne, elle bénéficiait d’une aide destinée à lui permettre d’améliorer son système d’asile, et que, pour faire face à une vague migratoire sans précédent, les autorités devaient prendre des mesures (paragraphe 112 ci-dessus).
154. La Cour note toutefois que, dans les observations qu’il lui a communiquées, le gouvernement défendeur n’a présenté aucun élément démontrant que, dans le cadre du processus décisionnel qui a conduit en 2015 à l’instauration de cette présomption, les autorités ont procédé à un examen approfondi du risque pour les demandeurs d’asile visés par une décision d’expulsion vers la Serbie de ne pas avoir dans ce pays un accès effectif à une procédure d’asile et, notamment, du risque de refoulement.
155. La Cour ne perd pas de vue les difficultés auxquelles les autorités hongroises ont dû faire face en 2015 lorsqu’un très grand nombre de ressortissants étrangers cherchant à bénéficier d’une protection internationale ou à passer en Europe de l’Ouest sont arrivés à la frontière hongroise. Néanmoins, la nature absolue de l’interdiction des mauvais traitements consacrée par l’article 3 de la Convention impose de procéder à un examen adéquat des risques auxquels les intéressés seraient exposés dans le pays tiers concerné.
156. Se penchant sur l’appréciation individuelle à laquelle l’autorité compétente en matière d’asile et la juridiction interne se sont livrées dans le cas des requérants, la Cour observe que dans leurs décisions respectives les deux instances se sont référées à la présomption évoquée ci-dessus mais aussi à des informations largement disponibles concernant l’existence alléguée de certains risques en Serbie, et qu’elles ont cherché à déterminer si les requérants étaient exposés à un risque particulier compte tenu de leur situation personnelle (paragraphes 34 et 36 ci-dessus).
157. La Cour observe en outre qu’au cours de la procédure, les requérants, qui étaient tous deux assistés d’un avocat, ont eu la possibilité d’exposer des arguments contre les première et deuxième décisions de l’autorité compétente en matière d’asile. Leurs avocats ont d’ailleurs présenté des observations écrites et orales détaillées devant la juridiction interne. Tout au long de la procédure d’asile, les requérants ont pu communiquer avec les autorités et le tribunal par l’intermédiaire d’un interprète en langue ourdoue, qu’ils comprenaient (paragraphes 26 à 28 et 30 à 35 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour n’est pas disposée à accorder beaucoup d’importance aux allégations formulées par les requérants relativement à la question du respect des délais et de l’existence de déficiences d’ordre technique.
158. La Cour n’est cependant pas convaincue par l’argument du gouvernement défendeur selon lequel les autorités administratives et la juridiction interne ont examiné de manière approfondie les informations générales à leur disposition concernant le risque pour les requérants d’être automatiquement refoulés de Serbie, sans accès effectif à une procédure d’asile. En particulier, il apparaît que les autorités n’ont pas suffisamment tenu compte d’informations générales qui tendaient à montrer qu’au moment des faits les demandeurs d’asile expulsés vers la Serbie couraient un risque réel de faire l’objet d’un refoulement arbitraire vers la République de Macédoine du Nord puis vers la Grèce, et qu’ils risquaient donc d’être soumis en Grèce à des conditions incompatibles avec l’article 3.
159. S’il est vrai, comme l’affirme le gouvernement défendeur, que les statistiques relatives au taux de demandes d’asile ayant abouti en Serbie ou d’autres données similaires sont faussées par le fait qu’un grand nombre de demandeurs ne restent pas en Serbie mais cherchent à gagner l’Europe de l’Ouest, il apparaît que d’autres éléments fiables n’ont pas été pris en compte par les autorités hongroises. En particulier, les conclusions du rapport publié par le HCR en août 2012 (confirmées par le rapport de mai 2016) (paragraphe 73 ci-dessus) et d’autres sources disponibles (paragraphes 69 et 77 ci-dessus) montrent qu’il existait un risque important de refoulement de Serbie : insuffisance dans ce pays, à l’époque des faits, des capacités et ressources administratives propres à permettre un examen des demandes d’asile conforme aux standards internationaux et à protéger les demandeurs contre les risques de refoulement ; récits de cas où des étrangers revenus en Serbie après être passés en Hongrie furent directement conduits en autocar jusqu’à la frontière avec la Macédoine du Nord ; récits de cas où des personnes réadmises en Serbie après un passage en Hongrie se virent refuser le droit d’y déposer une demande d’asile ; informations selon lesquelles les autorités serbes appliquaient automatiquement la liste des pays tiers sûrs dans le cas des demandeurs passés, entre autres, par la Macédoine du Nord et la Grèce. Les informations concernant les risques importants évoqués ci-dessus furent confirmées ultérieurement (paragraphes 68 et 75 ci-dessus).
160. D’après la Cour, l’autorité compétente en matière d’asile et la juridiction interne se sont bornées à évoquer brièvement le rapport du HCR et les autres informations pertinentes, sans traiter sur le fond ou de manière suffisamment approfondie les risques concrets qui y étaient recensés, et, en particulier, le risque d’expulsion arbitraire que couraient les requérants en l’espèce (paragraphes 34 et 36 ci-dessus). Certes, ceux-ci ont eu la possibilité de déposer des observations détaillées au cours de la procédure interne et ils étaient tous deux assistés d’un avocat. Néanmoins, la Cour n’est pas convaincue que cela signifie que les autorités internes ont prêté une attention suffisante aux risques de déni d’accès à une procédure d’asile effective en Serbie.
161. Il importe également de noter que le risque de refoulement arbitraire de Serbie vers d’autres pays aurait pu être atténué dans le cas particulier des requérants si leur retour avait été organisé de manière ordonnée par les autorités hongroises ou s’il avait fait l’objet de négociations entre les autorités serbes et les autorités hongroises. Or, les requérants n’ont pas été renvoyés en Serbie sur le fondement d’un accord avec les autorités serbes : ils ont été forcés à traverser la frontière pour retourner en Serbie, sans qu’aucun effort n’eût été fait pour obtenir des garanties (voir le paragraphe 40 ci-dessus, ainsi que le critère « d » des lignes directrices, citées au paragraphe 63 ci-dessus, adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en 2009). Cette façon de procéder a eu pour effet d’accroître le risque pour les requérants de se voir refuser l’accès à la procédure d’asile en Serbie et, partant, le risque de refoulement arbitraire de Serbie vers la Macédoine du Nord puis vers la Grèce (voir, par exemple, Tarakhel, précité, §§ 120 à 122, où, dans les circonstances de la cause, la Cour a jugé déterminante pour la violation potentielle de l’article 3 la question de l’obtention par les autorités suisses de garanties de la part des autorités italiennes).
162. Enfin, pour autant que le Gouvernement soutient que toutes les parties à la Convention, dont la Serbie, la Macédoine du Nord et la Grèce, sont soumises aux mêmes obligations, et que la Hongrie ne devrait pas avoir à supporter une charge supplémentaire pour pallier les déficiences des systèmes d’asile de ces pays, la Cour considère que cet argument ne suffit pas à justifier le non-respect par la Hongrie, qui a choisi de ne pas examiner au fond les demandes d’asile des requérants, de son obligation procédurale découlant du caractère absolu de l’interdiction des mauvais traitements énoncée à l’article 3 de la Convention (voir la démarche adoptée par la Cour dans M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité ; voir aussi Tarakhel, précité, §§ 104 et 105, et Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, § 193, 13 décembre 2016).
163. En résumé, étant donné notamment que la décision du Gouvernement d’instituer la présomption générale que la Serbie était un pays tiers sûr n’était pas suffisamment étayée, que les décisions d’expulsion rendues en l’espèce ne tenaient pas compte des constats fiables du HCR concernant un risque réel de déni d’accès à une procédure d’asile effective en Serbie et de refoulement arbitraire de Serbie vers la Macédoine du Nord puis vers la Grèce, et que les autorités hongroises ont accru le risque auquel les requérants étaient exposés en les incitant à entrer illégalement sur le territoire serbe plutôt que de négocier leur retour de manière ordonnée, la Cour estime que l’État défendeur, avant d’expulser les requérants, ne s’est pas acquitté de son obligation procédurale découlant de l’article 3 de la Convention d’évaluer les risques pour les requérants de subir un traitement contraire à cette disposition.
164. Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
165. À la lumière de ce constat, la Cour juge inutile de rechercher s’il y a également eu violation de l’article 3 au motif que les autorités hongroises n’auraient pas tenu compte du risque pour les requérants d’être soumis en tant que demandeurs d’asile à des conditions d’accueil inadéquates en Serbie (paragraphe 149 ci-dessus).
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 RELATIVEMENT AUX RECOURS INTERNES FORMÉS PAR LES REQUÉRANTS CONTRE LEUR EXPULSION VERS LA SERBIE
166. Les requérants allèguent que les recours internes formés par eux contre leur expulsion étaient ineffectifs, en violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. L’article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
167. Concernant ce grief, la chambre a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’en examiner la recevabilité ou le fond (paragraphes 126 et 127 de l’arrêt de la chambre).
168. En conséquence, il semble qu’il y ait controverse entre les parties sur la question de savoir si, bien que n’ayant pas été déclaré recevable par la chambre, ce grief fait partie de l’objet du litige déféré à la Grande Chambre. Les requérants considèrent que rien n’empêche la Grande Chambre de l’examiner. Dans ses observations écrites, le Gouvernement s’est borné à traiter les griefs déclarés recevables par la chambre. Dans ses observations orales, il a indiqué que le grief en question ne lui avait jamais été communiqué.
169. La situation en l’espèce est particulière en ce que la chambre ne s’est pas prononcée sur la recevabilité de ce grief. Se pose donc la question de savoir si un grief qui n’a été ni déclaré irrecevable ni déclaré recevable par la chambre relève de l’objet de l’affaire telle que déférée à la Grande Chambre dans le cadre de la procédure prévue par l’article 43 de la Convention.
170. Dans le contexte du système de la Convention antérieur à l’entrée en vigueur du Protocole no 11, lorsqu’un organe distinct, l’ancienne Commission, examinait la recevabilité des requêtes, le raisonnement de la Cour quant à l’objet de l’affaire dont elle était saisie était exposé dans les termes suivants (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 106, série A no 39) :
« [L]’étendue de l’« affaire » (...) se trouve (...) délimitée (...) par la décision de recevabilité. Sous réserve de son article 29 [dans sa version en vigueur au moment des faits] et de l’hypothèse d’une radiation partielle du rôle, la Convention ne laisse place à aucun rétrécissement ultérieur du champ du litige de nature à déboucher sur un règlement judiciaire. À l’intérieur du cadre ainsi tracé, la Cour peut connaître de toute question de fait ou de droit surgissant pendant l’instance engagée devant elle ; seul échappe à sa compétence l’examen des griefs jugés irrecevables par la Commission. »
171. Après l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention, la question de l’étendue de l’affaire déférée à la Grande Chambre dans le cadre de la procédure prévue à l’article 43 s’est posée pour la première fois dans l’affaire K. et T. c. Finlande ([GC], no 25702/94, §§ 137 à 141, CEDH 2001‑VII), dans laquelle les parties estimèrent que la Grande Chambre devait uniquement connaître de griefs ayant fait l’objet d’une demande de renvoi. La Grande Chambre a conclu que « « l’affaire » renvoyée devant la Grande Chambre [en vertu de l’article 43 de la Convention] englobe (...) tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt, pas uniquement la « question » grave qui a motivé le renvoi ». (ibidem, § 140). Elle a également ajouté « dans un souci de clarification » que l’affaire renvoyée devant la Grande Chambre « est la requête telle qu’elle a été déclarée recevable » (ibidem, § 141).
172. Cette formulation a été reprise dans plusieurs arrêts ultérieurs (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 41, CEDH 2006‑XII, D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 109, CEDH 2007‑IV, et Kovačić et autres c. Slovénie [GC], nos 44574/98 et 2 autres, § 194, 3 octobre 2008). La Cour a également dit que l’étendue de l’affaire renvoyée devant la Grande Chambre se trouve « délimitée par la décision de la chambre sur la recevabilité » (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 35 à 37, CEDH 2002‑V, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, §§ 23 et 24, CEDH 2003‑V, et Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 32, CEDH 2004‑III).
173. Dans un nombre important d’affaires qui lui ont été déférées sur renvoi, la Grande Chambre a été saisie de demandes de réexamen de griefs déclarés irrecevables par une chambre. Dans les arrêts qu’elle a rendus dans le cadre de pareilles affaires, la Grande Chambre a souvent ajouté un libellé plus spécifique pour préciser qu’elle « ne peut pas examiner les parties de la requête qui ont été déclarées irrecevables » (Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 234, CEDH 2012 (extraits), et Murray, précité, § 86). Dans certains arrêts, elle a également dit que « la Grande Chambre peut se pencher sur la totalité de l’affaire dans la mesure où elle a été déclarée recevable » (Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 61, CEDH 2007‑I, Kurić et autres, précité, § 235, et Herrmann c. Allemagne [GC], no 9300/07, § 38, 26 juin 2012) ou qu’elle « ne peut se pencher sur l’affaire que dans la mesure où elle a été déclarée recevable » (Gillberg c. Suède [GC], no 41723/06, §§ 53 à 55, 3 avril 2012, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], no 5809/08, § 78, 21 juin 2016, et Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 56, 5 avril 2018).Il convient toutefois de noter que cette formulation a été utilisée relativement à des griefs déclarés irrecevables par la chambre (dans presque tous les cas) ou à une demande de réexamen d’une décision de renvoi prise par le collège (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 27, 24 octobre 2002). Il apparaît qu’elle n’a pas été employée relativement à des griefs dont la chambre n’avait pas examiné la recevabilité.
174. Il ressort de l’analyse de la jurisprudence exposée ci-dessus que le fait que la Cour ait maintes fois considéré la décision de recevabilité de la chambre comme l’acte délimitant l’étendue de l’affaire déférée à la Grande Chambre dans le cadre de la procédure de renvoi s’explique en partie par le système de la Convention tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du Protocole no 11 et en partie par le fait que, dans la grande majorité des arrêts pertinents, la Grande Chambre a eu à statuer sur des demandes de réexamen de griefs déclarés irrecevables. On ne saurait dire que par ce libellé la Cour entendait affirmer que la Grande Chambre ne peut connaître de griefs n’ayant été ni déclarés irrecevables ni déclarés recevables par une chambre.
175. La Cour relève également que le fait d’exclure du champ de l’affaire déférée à la Grande Chambre des griefs déclarés irrecevables peut être considéré comme découlant de la jurisprudence bien établie selon laquelle une décision d’irrecevabilité est définitive (voir, par exemple, Budrevich c. République tchèque, no 65303/10, § 73, 17 octobre 2013). Il n’existe en revanche aucune décision définitive ayant pour effet de clore l’examen d’un grief qui n’a pas été déclaré irrecevable.
176. La Cour rappelle en outre qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil 1998‑I, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars 2018) et, de surcroît, qu’elle peut décider de ne pas examiner séparément un grief donné, au motif qu’il se confond ou a des liens étroits avec un grief sur lequel elle a déjà statué. C’est en effet sur ce principe que se fonde en l’espèce la décision de la chambre de n’examiner ni la recevabilité ni le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 3 relativement aux recours internes formés par les requérants contre leur expulsion vers la Serbie.
177. La Cour estime par conséquent qu’une approche trop rigide de la délimitation de l’étendue de l’affaire déférée à la Grande Chambre pourrait nuire à sa qualité de maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause relativement aux griefs qui n’ont pas été déclarés irrecevables. En outre, considérer qu’un grief qui n’a pas été déclaré irrecevable par la chambre ne relève pas de l’objet de l’affaire déférée à la Grande Chambre reviendrait de facto à le rejeter comme irrecevable. La Cour ne peut accepter pareille issue, qui aurait pour effet d’empêcher la Grande Chambre d’apprécier la recevabilité du grief en question dans une situation où la chambre, sans indiquer pourquoi, s’est abstenue d’examiner ce point.
178. La Cour estime par conséquent que le grief fondé sur l’article 13 combiné avec l’article 3 relativement aux déficiences procédurales que les requérants estiment avoir entaché l’examen de leurs demandes d’asile et des recours formés par eux contre les décisions de l’autorité compétente en matière d’asile relève de l’objet du litige porté devant la Grande Chambre.
179. Dès lors, toutefois, qu’elle a constaté une violation de l’article 3 de la Convention (paragraphes 163 et 164 ci-dessus), la Grande Chambre considère avec la chambre qu’étant donné que les allégations des requérants relatives aux déficiences procédurales qu’ils estiment avoir entaché l’examen de leurs demandes d’asile et des recours formés par eux contre les décisions de l’autorité compétente en matière d’asile ont fait l’objet d’un examen suffisant sur le terrain de l’article 3, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le fond du grief formulé sous l’angle de l’article 13 relativement à ces déficiences alléguées.
Kebe et autres c. Ukraine du 12 janvier 2017 requête n o 12552/12
Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif), en combinaison avec l’article 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ; et Non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention Des gardes-frontières ont illégalement entravé une demande d’asile.
L’affaire concernait les démarches faites par les requérants afin d’obtenir l’asile en Ukraine. Ces derniers soutenaient que, à l’arrivée de leur navire arrivé au port de Mykolayiv, des gardesfrontières les avaient empêchés d’entrer sur le territoire ukrainien et de former leurs demandes d’asile, et les avaient exposés ainsi à un risque de mauvais traitements dans leur pays d’origine en s’assurant qu’ils demeurent à bord du navire (censé faire voile vers l’Arabie Saoudite). Ils estimaient également n’avoir eu aucune possibilité d’user de voies de droit internes pour s’y opposer. La Cour a rayé la requête de son rôle à l’égard de deux des requérants : l’un était décédé au cours de la procédure (et aucun membre de sa famille n’avait demandé à poursuivre la requête) et l’autre avait cessé tout contact avec son avocat depuis 2014. Pour ce qui est du requérant restant, la Cour a rejeté son grief de mauvais traitement. Elle a jugé que, après l’indication par elle d’une mesure provisoire en mars 2012, ce requérant avait été autorisé à quitter le navire et à former une demande d’asile en Ukraine. Il n’était donc plus exposé à un risque immédiat de mauvais traitements dans son pays d’origine. Cependant, la Cour a estimé qu’il y avait eu violation de son droit à un recours effectif garanti par l’article 13. Avant l’intervention de la Cour, les gardes-frontières l’avaient empêché de débarquer, et il risquait ainsi d’être expulsé d’Ukraine à tout moment sans que son grief de mauvais traitements soit examiné par les autorités.
Les requérants sont M. Solomon Alemu Kebe et M. Efrem Tadese Girma, de nationalité érythréenne, et M. Tesfaye Welde Adane, de nationalité éthiopienne, nés en 1984, 1988 et 1987, respectivement. M. Kebe habite actuellement à Odessa. M. Adane a quitté l’Ukraine pour l’Éthiopie le 23 novembre 2014. On ignore actuellement où il se trouve. M. Girma est décédé le 6 mars 2015. Au cours des années 2000 ou vers celles-ci, les trois requérants quittèrent tous l’Éthiopie ou l’Érythrée pour Djibouti. Selon eux, ils séjournèrent à Djibouti illégalement, craignant de revenir dans leurs pays d’origine de peur d’y être persécutés. Aussi, en janvier 2012, ils s’embarquèrent clandestinement sur un navire commercial battant pavillon maltais. Ils auraient eu pour intention de demander l’asile dans tout autre pays que Djibouti ou leurs pays d’origine. En février 2012, le navire mouilla au port de Mykolayiv, en Ukraine. Des gardes-frontières ukrainiens et une juriste d’une ONG locale montèrent à bord pour y rencontrer des requérants. Ces derniers disent qu’ils ont déclaré aux gardes-frontières qu’ils souhaitaient demander l’asile en Ukraine et commencé à rédiger leurs demandes à cette fin, mais que les gardes-frontières leur ont dit qu’ils ne pouvaient accepter ces demandes, le navire dans lequel ils étaient arrivés battant pavillon étranger. Les gardes-frontières se seraient appuyés sur le même motif pour empêcher les requérants de quitter le navire et la juriste de l’ONG aurait été priée de débarquer. Selon le Gouvernement, les requérants n’ont formé aucune demande d’asile et n’ont pas exprimé l’intention d’en présenter une. Le navire était censé partir le 3 mars 2012 à destination de l’Arabie Saoudite. La veille du départ, la juriste de l’ONG introduisit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. Elle demandait l’adoption de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement, par lesquelles la Cour indiquerait au Gouvernement que les requérants devaient être autorisés à quitter le navire et avoir accès à un avocat et à une assistance juridique. Elle soutenait que, si les requérants devaient être contraints de se rendre en Arabie Saoudite, il y avait un risque réel que les autorités leur ordonnent de retourner dans leurs pays d’origine, où ils subiraient de mauvais traitements. La demande fut accueillie ce jour même et, le 3 mars 2012, les requérants furent autorisés à quitter le navire et à entrer sur le territoire ukrainien. Les requérants formèrent à ce moment-là des demandes d’asile, mais les parties n’ont pas informé la Cour de ce qu’il en est advenu. Il apparaît que les requérants ont formé de nouvelles demandes d’asile en 2014. Cependant, elles furent toutes rejetées par le département régional du service des migrations à Odessa. M. Adane ne forma aucun recours contre la décision le concernant et regagna l’Éthiopie en novembre 2014. M. Girma attaqua la décision le concernant mais il fut mis fin à la procédure après son décès en mars 2015. M. Kebe forma lui aussi un recours et le tribunal administratif d’Odessa en demeure saisi.
Radiation du rôle
La Cour raye de son rôle la requête de M. Girma au motif qu’il est décédé en mars 2015 et qu’aucun de ses proches n’a avisé la Cour qu’il souhaitait poursuivre cette requête. Elle en fait de même à l’égard de la requête de M. Adane au motif que celui-ci ne souhaitait plus poursuivre sa requête étant donné qu’il avait mis fin à tout contact avec son avocat après son départ d’Ukraine en 2014.
Juridiction (article 1)
Le Gouvernement soutient que M. Kebe ne se trouvait pas sous la juridiction de l’Ukraine au moment des faits puisqu’il était à bord d’un navire battant pavillon maltais. La Cour rejette cette exception. Elle conclut que M. Kebe était passé sous la juridiction de l’Ukraine au sens de l’article 1 par l’effet du contrôle exercé sur lui par les gardes-frontières ukrainiens, pour autant que celui-ci eût pour objet son éventuelle entrée sur le territoire ukrainien et l’exercice de ses droits garantis par la Convention.
Article 3 (interdiction des mauvais traitements) M. Kebe avait initialement tiré grief de mauvais traitements contraires à l’article 3, en l’occurrence le refus par les autorités ukrainiennes de l’autoriser à débarquer en Ukraine ou de former une demande d’asile, et le risque pour lui de mauvais traitements à raison de son départ imminent vers l’Arabie Saoudite. Cependant, après l’indication par la Cour d’une mesure provisoire au titre de l’article 39 du règlement, il a été autorisé à quitter le navire et à former une demande d’asile en Ukraine. Bien que ce litige ne soit pas encore tranché (parce qu’il est encore en cours d’examen), il n’est plus exposé à un risque immédiat d’expulsion. Au vu de ces éléments, il n’a plus qualité de « victime » eu égard à son grief de mauvais traitement fondé sur l’article 3. La Cour rejette donc ce volet de la requête.
Article 13 (droit à un recours effectif) en combinaison avec l’article 3
Bien que M. Kebe ait finalement eu accès à une procédure d’asile, ce n’avait pas été le cas antérieurement à la mesure provisoire indiquée par la Cour. Celle-ci estime que les gardes-frontières ne lui ont offert aucune possibilité de demander une demande d’asile alors qu’il se trouvait à bord du navire. En particulier, ils ne lui ont donné aucune information sur les procédures d’asile en Ukraine, ils n’ont tenu aucun compte de son besoin de protection internationale et ils lui ont dit qu’ils ne pouvaient accepter des demandes d’asile. De plus, leur décision interdisant à M. Kebe d’entrer en Ukraine était immédiatement exécutoire, celui-ci risquant alors d’être expulsé à tout moment sans que son grief de mauvais traitement soit examiné par les autorités. Ainsi, il ne s’est vu offert aucun recours effectif eu égard à ses griefs tirés du risque d’expulsion du territoire ukrainien, en violation de l’article 13 en combinaison avec l’article 3.
G.S. c. Bulgarie du 4 avril 2019 requête n° 36538/17
Violation de l'article 3 : Le fouet n'est pas une sanction acceptable dans un Etat démocratique. La Cour constate en particulier que les tribunaux bulgares se sont contentés de supposer que la seule peine dont le requérant était passible en Iran était l’emprisonnement. Or, l’infraction dont il était accusé, à savoir le vol, était également punissable de 74 coups de fouet.
D’après les rapports internationaux et d’autres éléments indiquant que le fouet est courant en Iran et considéré par les autorités iraniennes comme une forme légitime de châtiment, le requérant risquait d’être condamné à recevoir jusqu’à 74 coups de fouet.
De plus, contrairement aux autorités bulgares, la Cour est très réticente à donner foi à des assurances contre la torture données par un État où un tel traitement est endémique ou persistant.
LES FAITS
En décembre 2016, alors qu’il arrivait en Bulgarie en provenance de Géorgie, M. G.S. fut arrêté à l’aéroport de Sofia en vertu d’un bulletin rouge d’Interpol. Selon ce bulletin, il avait dérobé 50 000 euros en 2016 dans un bureau de change à Téhéran, une infraction punissable d’emprisonnement en vertu de l’article 656 du code pénal iranien. Il fut mis en détention en attente d’une demande formelle d’extradition des autorités iraniennes. La demande fut présentée en janvier 2017. Elle précisait que, selon le texte de l’article 656 § 4 du code pénal iranien, la peine envisagée était l’emprisonnement. En avril 2017, le tribunal de Sofia fit droit à la demande d’extradition au motif qu’elle satisfaisait à toutes les conditions de forme et qu’il était possible d’invoquer la réciprocité de facto existant entre la Bulgarie et l’Iran. Il releva également que les autorités iraniennes avaient donné des assurances que le requérant ne serait pas exposé à la torture ou à un traitement inhumain et que le droit iranien ne prévoyait qu’une peine d’emprisonnement pour l’infraction en cause. La décision fut confirmée en appel. Cependant, en mai 2017, le sursis à l’extradition du requérant fut prononcé sur la base d’une mesure provisoire accordée par la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 39 de son règlement, indiquant au gouvernement bulgare que le requérant ne devait pas être extradé pendant la durée de la procédure conduite devant elle.
CEDH
Il ne fait guère de doute que le châtiment corporel qui attendrait le requérant en Iran, c’est-à-dire jusqu’à 74 coups de fouet, est contraire à l’article 3 de la Convention européenne. La Cour constate d’emblée que l’infraction dont le requérant demeure accusé en Iran est également punissable du fouet.
Bien que ni le bulletin rouge ni la demande d’extradition n’évoque le fouet comme type de peine, des sites Internet tenus par le législateur iranien et la justice iranienne confirment que l’article 656 § 4 du code pénal iranien, sur la base duquel le requérant est poursuivi, prévoit jusqu’à 74 coups de fouet à titre de châtiment. D’autres sources publiques le confirment. Les décisions des tribunaux bulgares ne permettent en aucun cas de déterminer s’il existait un risque que le requérant se voie infliger une telle peine ou qu’une telle peine soit exécutée puisqu’ils se sont contentés de supposer que la seule peine imposable au requérant en Iran était la prison.
Or la Cour estime que le fouet était un risque réel. Elle tient compte des différents rapports internationaux indiquant que la peine du fouet est courante en Iran. Elle prend en considération aussi des informations assez récentes montrant que de telles peines ont été imposées et exécutées dans un certain nombre d’affaires de vol.
De plus, la Cour a de sérieux doutes quant aux assurances données par les autorités iraniennes. Premièrement, la demande d’extradition omettait de préciser que l’article 656 § 4 du code pénal iranien prévoyait non seulement la prison mais aussi le fouet. Deuxièmement, les autorités iraniennes avaient récemment déclaré publiquement, en réponse à un rapport de l’ONU, qu’elles considéraient le fouet comme une forme légitime de châtiment, qui selon elles avait été « mal interprété, par l’Occident, comme (...) étant dégradant ».
En effet, l’Iran voit apparemment dans le fouet et dans d’autres formes de châtiment corporel un élément important de sa souveraineté et de sa tradition juridique. Surtout, il faut prendre avec prudence les assurances contre la torture donnée par un État où un tel traitement est endémique ou persistant.
Il est clair que l’extradition du requérant vers l’Iran, si elle venait à être exécutée, emporterait violation de l’article 3 de la Convention puisque ce dernier y est passible du fouet.
Grande Chambre FG contre Suède du 23 mars 2015 requête 43611/11
Violation de l'article 3 : Le renvoi du requérant vers l'Iran alors qu'il est un musulman converti à l'église chrétienne le mettrait en danger.
1. Introduction
110. La Cour observe d’emblée que, dans le contexte de l’expulsion, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’un individu, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à la peine capitale, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, tant l’article 2 que l’article 3 impliquent que l’État contractant ne doit pas expulser la personne en question. La Cour examinera donc les deux articles simultanément (voir, notamment, mutatis mutandis, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 314, CEDH 2014, T.A. c. Suède, no 48866/10, § 37, 19 décembre 2013, K.A.B. c. Suède, no 886/11, § 67, 5 septembre 2013, Kaboulov c. Ukraine, no 41015/04, § 99, 19 novembre 2009, et F.H. c. Suède, no 32621/06, § 72, 20 janvier 2009).
2. Principes généraux relatifs à l’appréciation des demandes d’asile au regard des articles 2 et 3 de la Convention
a) L’évaluation du risque
111. La Cour rappelle que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, par exemple, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 113, CEDH 2012, Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006‑XII, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94, et Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI). Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008).
112. Pour établir s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court ce risque réel, la Cour ne peut éviter d’examiner la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005‑I). Au regard de ces exigences, pour tomber sous le coup de l’article 3, le mauvais traitement auquel le requérant affirme qu’il serait exposé en cas de renvoi doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 60, CEDH 2001‑II).
113. Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil 1996‑V, et Saadi, précité, § 128). Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, Saadi, précité, § 129, et N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Sur ce point, la Cour reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui-ci de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, no 23505/09, 20 juillet 2010, Hakizimana c. Suède (déc.), no 37913/05, 27 mars 2008, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007).
114. L’appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 108, série A no 215). À cet égard, et s’il y a lieu, la Cour examinera s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination (Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 216, 28 juin 2011).
115. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal, précité, § 86). Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (voir, par exemple, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, §§ 87-95, CEDH 2008, et Sufi et Elmi, précité, § 215). Pareille situation se produit généralement lorsque, comme dans la présente affaire, l’expulsion est retardée en raison de l’indication par la Cour d’une mesure provisoire au titre de l’article 39 du règlement. Dès lors que la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les États contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. L’appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (voir, par exemple, Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 136, 11 janvier 2007, et Vilvarajah et autres, précité, §§ 107 et 108).
116. Dans une affaire d’expulsion, il appartient à la Cour de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause portée devant elle, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Si l’existence d’un tel risque est établie, l’expulsion du requérant emporterait nécessairement violation de l’article 3, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux. Il est clair néanmoins que toute situation générale de violence n’engendre pas un tel risque. Au contraire, la Cour a précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence (Sufi et Elmi, précité, §§ 216 et 218 ; voir aussi, notamment, L.M. et autres c. Russie, nos 40081/14, 40088/14 et 40127/14, § 108, 15 octobre 2015, et Mamazhonov c. Russie, no 17239/13, §§ 132-133, 23 octobre 2014).
b) La nature de l’examen de la Cour
117. Dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, la Cour se garde d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui. En vertu de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce sont en effet les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286-287, CEDH 2011). La Cour doit toutefois estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, comme par exemple d’autres États contractants ou des États tiers, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales réputées pour leur sérieux (voir, notamment, N.A. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 119, 17 juillet 2008).
118. De plus, lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir, notamment, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 179-180, CEDH 2011 (extraits), Nizomkhon Dzhurayev c. Russie, no 31890/11, § 113, 3 octobre 2013, et Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, § 155, CEDH 2013 (extraits)). En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (voir, par exemple, R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010).
c) Les obligations procédurales dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile
119. Dans le contexte de l’expulsion, la Cour a énoncé à plusieurs reprises les obligations qui découlent pour les États du volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention (voir, notamment, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 198, M.E. c. Danemark, no 58363/10, § 51, 8 juillet 2014, et Sufi et Elmi, précité, § 214).
120. Concernant la charge de la preuve, la Cour a dit dans l’arrêt Saadi (précité, §§ 129-132 ; voir aussi, notamment, Ouabour c. Belgique, no 26417/10, § 65, 2 juin 2015, et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 261, CEDH 2012 (extraits)) qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 ; et que lorsque de tels éléments sont soumis, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (Saadi, précité, § 129). Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé (ibidem, § 130). Lorsque les sources dont on dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (ibidem, § 131). Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, éventuellement à l’aide des sources susmentionnées, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (ibidem, § 132).
121. Quant aux procédures d’asile, la Cour observe que l’article 4 § 1 de la « directive qualification » (paragraphe 48 ci-dessus) énonce que les États membres de l’Union européenne peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le paragraphe 67 du Guide du HCR (paragraphe 53 ci-dessus) est ainsi libellé :
« C’est à l’examinateur qu’il appartient, lorsqu’il cherche à établir les faits de la cause, de déterminer le ou les motifs pour lesquels l’intéressé craint d’être victime de persécutions et de décider s’il satisfait à cet égard aux conditions énoncées dans la définition de la Convention de 1951. Il est évident que souvent les motifs de persécution se recouvriront partiellement. Généralement, plusieurs éléments seront présents chez une même personne. Par exemple, il s’agira d’un opposant politique qui appartient en outre à un groupe religieux ou national ou à un groupe présentant à la fois ces deux caractères, et le fait qu’il cumule plusieurs motifs possibles peut présenter un intérêt pour l’évaluation du bien-fondé de ses craintes. »
122. La Cour note également que le HCR a déclaré dans ses observations de tiers intervenant (paragraphe 109 ci-dessus) que, bien que la charge de la preuve incombe généralement à celui qui affirme, il y a une obligation partagée entre l’intéressé et l’examinateur de vérifier et d’évaluer l’ensemble des faits pertinents, et que pour remplir leur part de l’obligation, les examinateurs peuvent dans certaines affaires avoir besoin de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour recueillir les éléments nécessaires à l’appui de la demande.
123. En ce qui concerne les activités sur place, la Cour a reconnu qu’il est généralement très difficile d’apprécier si une personne s’intéresse sincèrement à l’activité en question – qu’il s’agisse d’une cause politique ou d’une religion – ou si elle ne s’y est engagée que pour justifier après coup sa fuite (voir, par exemple, A.A. c. Suisse, no 58802/12, § 41, 7 janvier 2014). Ce raisonnement s’inscrit dans le droit fil des Principes directeurs du HCR sur la protection internationale relatifs aux demandes d’asile fondées sur la religion (28 avril 2004), qui indiquent ce qui suit : « [Dans les cas de demande « sur place »], des préoccupations particulières en terme de crédibilité ont tendance à émerger et un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de la sincérité de la conversion sera nécessaire (...) Des activités soi-disant « intéressées » ne créent pas de crainte fondée de persécution pour un motif de la Convention dans le pays d’origine du demandeur si la nature opportuniste de ces activités est évidente pour tous, y compris pour les autorités du pays, et que le retour de l’intéressé n’aurait pas des conséquences négatives graves » (paragraphe 52 ci-dessus – voir également les conclusions de la Cour en ce sens, par exemple, dans Ali Muradi et Selma Alieva c. Suède (déc.), no 11243/13, §§ 44-45, 25 juin 2013).
124. En outre, la Cour observe que, dans un arrêt (A, B, C c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, précité) portant sur une décision de première instance relative aux conditions d’octroi de la protection nationale, la CJUE a dit notamment que l’article 4 § 3 de la directive 2004/83 et l’article 13 § 3 a) de la directive 2005/85 devaient être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans le cadre de l’examen en cause, les autorités nationales compétentes concluent au défaut de crédibilité des déclarations du demandeur d’asile concerné au seul motif que sa prétendue orientation sexuelle n’a pas été invoquée par ce demandeur à la première occasion qui lui a été donnée d’exposer les motifs de persécution (paragraphe 51 ci‑dessus).
125. Il appartient en principe à la personne qui demande une protection internationale dans un État contractant de présenter, dès que possible, sa demande d’asile accompagnée des motifs qui la sous-tendent et de produire des éléments susceptibles d’établir l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que son expulsion vers son pays d’origine impliquerait pour elle un risque réel et concret d’être exposée à une situation de danger de mort visée par l’article 2 ou à un traitement contraire à l’article 3.
126. Concernant toutefois les demandes d’asile fondées sur un risque général bien connu, lorsque les informations sur un tel risque sont faciles à vérifier à partir d’un grand nombre de sources, les obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention dans les affaires d’expulsion impliquent que les autorités évaluent ce risque d’office (voir, par exemple, Hirsi Jamaa et autres, précité, §§ 131-133, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], précité, § 366).
127. En revanche, dans le cas d’une demande d’asile fondée sur un risque individuel, il incombe à la personne qui sollicite l’asile d’évoquer et d’étayer pareil risque. Dès lors, si un requérant décide de ne pas invoquer ou dévoiler tel ou tel motif d’asile individuel et particulier et s’abstient délibérément de le mentionner – qu’il s’agisse de croyances religieuses ou de convictions politiques, d’orientation sexuelle ou d’autres motifs –, l’État concerné n’est aucunement censé découvrir ce motif par lui-même. Eu égard toutefois au caractère absolu des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, et à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, si un État contractant est informé de faits, relatifs à un individu donné, propres à exposer celui-ci à un risque de mauvais traitements contraires auxdites dispositions en cas de retour dans le pays en question, les obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention impliquent que les autorités évaluent ce risque d’office. Cela vaut spécialement pour les situations où il a été porté à la connaissance des autorités nationales que le demandeur d’asile fait vraisemblablement partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements et qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (paragraphe 120 ci-dessus).
3. Application de ces principes en l’espèce
128. Appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, la Cour estime approprié de diviser en deux parties l’examen de l’affaire : elle se penchera tout d’abord sur les activités politiques du requérant en Iran, puis sur la conversion de celui-ci au christianisme en Suède.
a) Les activités politiques du requérant
i. La situation générale en Iran
129. Le requérant ne prétend pas que, en soi, la situation générale existant en Iran empêcherait son retour dans ce pays. La Cour note par ailleurs qu’en principe une situation générale de violence n’est pas à elle seule de nature à entraîner une violation de l’article 3 en cas d’expulsion vers le pays en question (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 41, Recueil 1997‑III). Toutefois, elle n’a jamais exclu que la situation générale de violence dans le pays de destination pût être d’une intensité telle que tout renvoi vers ce pays emporterait nécessairement violation de l’article 3 de la Convention. Il demeure que la Cour n’adopterait pareille approche que dans les cas de violence générale les plus extrêmes où il existe un risque réel de mauvais traitements du simple fait que l’intéressé sera exposé à cette violence dans le pays en question (Sufi et Elmi, précité, § 218, et N.A. c. Royaume-Uni, précité, § 115).
130. En l’espèce, bien qu’ayant connaissance de rapports faisant état de graves violations des droits de l’homme en Iran (paragraphes 55-58 ci‑dessus), la Cour estime que ceux-ci ne sont pas en soi de nature à démontrer qu’il y aurait violation de la Convention si le requérant était renvoyé vers ce pays (voir aussi S.F. et autres c. Suède, no 52077/10, § 64, 15 mai 2012). La Cour s’attachera donc à vérifier si la situation personnelle du requérant est telle que son renvoi en Iran serait contraire aux articles 2 et 3 de la Convention.
ii. Les circonstances propres au cas du requérant
131. La Cour note que le requérant a exposé son cas le 24 mars 2010, en présence de son avocat et d’un interprète, lors d’un entretien de deux heures à l’office des migrations, puis le 16 février 2011 devant le tribunal des migrations. Son dossier a été examiné au fond par deux organes, et l’autorisation d’interjeter appel lui a été refusée par la cour d’appel des migrations.
132. Il ressort du dossier que l’office des migrations aussi bien que le tribunal des migrations ont tenu compte du fait qu’à partir de 2007 le requérant avait travaillé avec des personnes liées à différentes universités et connues pour leur opposition au régime. Pour l’essentiel, son activité avait consisté à créer et publier des pages web. Son ordinateur avait été saisi dans ses locaux professionnels pendant son emprisonnement en septembre-octobre 2009. Des documents critiques à l’égard du régime en place étaient alors stockés dans son ordinateur. Il n’avait pas personnellement critiqué le régime, le président Ahmadinejad ou les plus hauts dirigeants mais avait visité certains sites web et reçu par courriel des dessins satiriques. Aux yeux de l’intéressé, il existait donc suffisamment d’éléments prouvant qu’il était un opposant au régime, éléments qui auraient été assez semblables au matériel que contenait son ordinateur en 2007. Les autorités nationales ont considéré que les informations relatives aux activités politiques du requérant étaient vagues et imprécises. Elles ont de plus relevé que l’intéressé n’avait pas signalé ou étayé l’existence de quelconques pages web censées avoir été créées par lui sur une période de deux ans. Par ailleurs, elles ont jugé que si les autorités iraniennes étaient réellement au courant des activités du requérant en 2007, il était surprenant que celui-ci eût été en mesure de continuer à publier des documents critiques à l’égard du régime, de 2007 jusqu’aux élections de 2009.
133. Les autorités suédoises ont également tenu compte de l’arrestation du requérant en avril 2007 pendant vingt-quatre heures.
134. Elles n’ont pas remis en cause le fait que, la veille du scrutin du 12 juin 2009, ses amis et lui avaient été arrêtés, interrogés et détenus au bureau de vote, jusqu’au lendemain.
135. Elles ont aussi jugé établi que le requérant avait manifesté et avait été arrêté à nouveau en septembre 2009 et emprisonné pendant vingt jours, qu’il avait subi des mauvais traitements et qu’en octobre 2009 il avait été traduit devant le tribunal révolutionnaire, lequel l’avait remis en liberté.
136. Les autorités nationales ont également pris en considération le fait que l’intéressé avait soumis l’original d’une convocation l’invitant à se présenter devant le tribunal révolutionnaire le 2 novembre 2009. Elles ont toutefois jugé que la citation à comparaître ne pouvait en soi étayer un besoin de protection, et souligné que cette pièce était une simple convocation qui n’exposait aucune raison expliquant pourquoi le requérant devait se présenter.
137. Procédant à une appréciation globale, les autorités nationales ont estimé que les activités politiques du requérant en Iran pouvaient être considérées comme marginales, ce qui selon elles était corroboré par le fait que depuis 2009 l’intéressé n’avait plus été convoqué devant le tribunal révolutionnaire et qu’aucun de ses proches demeurés en Iran n’avait subi de représailles de la part des autorités iraniennes.
138. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du requérant selon lequel les autorités suédoises n’ont pas adéquatement tenu compte des mauvais traitements subis par lui pendant ses vingt jours de détention en septembre 2009, de sa description détaillée de l’audience d’octobre 2009 devant le tribunal révolutionnaire ou du fait qu’il a soumis l’original de la convocation l’invitant à comparaître à nouveau le 2 novembre 2009.
139. Le dossier ne contient pas non plus d’éléments indiquant que les autorités suédoises n’auraient pas dûment pris en considération que le requérant s’exposait à une détention à l’aéroport lorsqu’elles ont apprécié globalement les risques encourus par lui.
140. Pour la Cour, on ne peut pas non plus conclure que la procédure menée devant les autorités suédoises a été inadéquate et insuffisamment étayée par des données internes ou par celles provenant d’autres sources fiables et objectives.
141. En outre, et en ce qui concerne l’évaluation du risque, aucun élément ne corrobore l’affirmation selon laquelle les autorités suédoises ont conclu à tort que le requérant n’était pas un militant notoire ou un opposant politique. Cette affaire se distingue donc, notamment, de l’affaire S.F. et autres c. Suède (arrêt précité), dans laquelle le requérant avait pris part à des activités politiques importantes et avait été placé sous surveillance par le régime iranien, de l’affaire K.K. c. France (no 18913/11, 10 octobre 2013), dans laquelle le requérant était un ancien membre des services de renseignement iraniens, et de l’affaire R.C. c. Suède (arrêt précité), qui concernait entre autres le risque de détention à l’aéroport en cas de retour.
142. Concernant enfin l’allégation formulée par le requérant devant la Grande Chambre, selon laquelle les autorités iraniennes pourraient l’identifier à partir de l’arrêt de la chambre et, plus tard, de l’arrêt de la Grande Chambre, la Cour souligne que l’intéressé s’est vu octroyer l’anonymat lorsque sa demande de mesure fondée sur l’article 39 du règlement a été accueillie en octobre 2011, et que d’après les éléments dont elle dispose il n’y a pas d’indice sérieux quant à un risque d’identification (voir, a contrario, S.F. et autres c. Suède, précité, §§ 67-70, et N.A. c. Royaume-Uni, précité, § 143).
143. Il s’ensuit que le passé politique du requérant ne constitue pas un élément justifiant que la Cour conclue qu’il y aurait violation des articles 2 et 3 de la Convention si l’intéressé était expulsé vers l’Iran.
b) La conversion du requérant
144. En l’espèce, les autorités suédoises se sont trouvées confrontées à une conversion sur place. Au départ, elles ont donc dû vérifier si la conversion du requérant était sincère et avait atteint un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance (voir, notamment, S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 55, CEDH 2014 (extraits), Eweida et autres c. Royaume-Uni, nos 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10, § 81, CEDH 2013, et Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 110, CEDH 2011), avant de rechercher si le requérant serait exposé au risque de subir un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention en cas de retour en Iran.
145. La Cour observe que dans les affaires d’asile, selon le Gouvernement (paragraphe 104 ci-dessus), les autorités suédoises se conforment généralement au Guide du HCR et aux Principes directeurs du HCR sur la protection internationale relatifs aux demandes d’asile fondées sur la religion, et apprécient au cas par cas si un étranger a établi de façon plausible que sa conversion sur place est sincère en ce sens qu’elle repose sur des convictions religieuses réelles et personnelles. Cela passe par une appréciation des circonstances dans lesquelles la conversion est intervenue et du point de savoir si l’on peut s’attendre à ce que le demandeur vive sa nouvelle foi à son retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, le 12 novembre 2012, le directeur général des affaires juridiques de l’office suédois des migrations a publié un « avis juridique général » (paragraphe 46 ci-dessus) sur les demandes d’asile fondées sur des motifs religieux, notamment une conversion. Cet avis, qui s’appuie sur un arrêt de la cour d’appel des migrations (MIG 2011:29), sur les Principes directeurs du HCR et sur l’arrêt rendu le 5 septembre 2012 par la CJUE dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland c. Y (C-71/11) et Z (C-99/11), indique qu’il faut procéder à une appréciation minutieuse de la crédibilité d’une conversion afin de s’assurer de son authenticité. Il ajoute qu’une personne qui s’est sincèrement convertie ou qui risque de se voir attribuer ses nouvelles convictions religieuses et s’expose ainsi à la persécution ne doit pas être contrainte de cacher sa foi dans le seul but d’échapper à un tel traitement. En outre, le 10 juin 2013, le directeur général des affaires juridiques a émis un « avis juridique général » (paragraphe 47 ci-dessus) sur la méthodologie à suivre pour apprécier la fiabilité et la crédibilité des demandes de protection internationale, avis qui s’inspire notamment du rapport du HCR sur l’appréciation de la crédibilité dans les dispositifs d’asile de l’Union européenne (« Beyond Proof; Credibility Assessment in EU Asylum Systems », mai 2013).
146. Dans le cadre de la première procédure d’asile, devant l’office des migrations, le requérant n’avait pas souhaité invoquer sa conversion. La question avait été évoquée par l’office, mais l’intéressé avait expliqué qu’il considérait sa religion comme une question d’ordre privé et « [ne voulait pas] tirer parti de sa récente et précieuse foi pour acheter l’asile ». Avec le recul, il pense qu’il n’a pas bénéficié à l’époque de suffisamment de conseils et d’assistance juridiques pour saisir les risques associés à sa conversion.
147. La Cour note que le requérant a passé pratiquement toute sa vie en Iran, qu’il s’exprime bien en anglais (paragraphe 97 ci-dessus) et qu’il a une grande expérience de l’informatique, des pages web et d’Internet. Par ailleurs, il a été critique vis-à-vis du régime. Il est donc difficile d’admettre que, de lui-même ou sensibilisé par la paroisse où il a été baptisé peu après son arrivée en Suède, ou encore par le pasteur qui lui a fourni l’attestation du 15 mars 2010 destinée à l’office des migrations, il n’ait pas pris conscience du risque auquel sont exposés les convertis en Iran. La Cour n’est pas non plus convaincue que le requérant n’ait pas bénéficié de suffisamment de conseils et d’assistance juridiques pour saisir les risques associés à sa conversion. Elle observe que le requérant n’a soulevé ces questions à aucun stade de la procédure interne. Lors de l’audition du 24 mars 2010 devant l’office des migrations, l’agent de l’office a même interrompu l’entretien pour permettre à l’intéressé d’échanger avec son avocat sur ce point précis. Le requérant a déclaré que sa conversion était une question d’ordre privé, mais ne semble pas avoir estimé que cela l’empêchait de parler de sa religion (paragraphe 13 ci‑dessus). En outre, dans son recours devant le tribunal des migrations, il a invoqué sa conversion à l’appui de sa demande d’asile et soumis le certificat de baptême du 31 janvier 2010, expliquant que si au départ il n’avait pas souhaité invoquer sa conversion, c’était parce qu’il n’avait pas voulu banaliser le sérieux de sa foi. Par ailleurs, devant le tribunal des migrations, le 16 février 2011, s’il a répété qu’il ne souhaitait pas invoquer sa conversion à l’appui de sa demande d’asile, il a bien ajouté que « toutefois [cette conversion lui] causerait clairement des problèmes en cas de retour ».
148. Quant aux autorités suédoises, la Cour note qu’elles se sont rendu compte qu’elles étaient face à un cas de conversion sur place le 24 mars 2010, jour où l’office des migrations a procédé à un entretien avec l’intéressé, en présence de son avocat et d’un interprète. Plus précisément, l’office a pris connaissance de cet élément lorsque le requérant a remis l’attestation établie le 15 mars 2010 par un pasteur de sa paroisse, certifiant qu’il était membre de celle-ci depuis décembre 2009 et qu’il avait été baptisé. L’agent de l’office des migrations a donc interrogé le requérant de manière approfondie au sujet de sa conversion et a encouragé celui-ci et son avocat à s’entretenir à ce propos, puis a été informé par eux que le requérant ne souhaitait pas invoquer sa conversion à l’appui de sa demande d’asile (paragraphe 13 ci-dessus).
149. Le 29 avril 2010, l’office des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant. Concernant la conversion de celui-ci au christianisme, il a estimé que l’attestation établie par le pasteur de la paroisse concernée ne pouvait s’analyser qu’en une demande à l’office des migrations d’octroyer l’asile au requérant. Il a relevé que celui-ci n’avait pas souhaité au départ invoquer sa conversion à l’appui de sa demande d’asile et avait déclaré que sa nouvelle confession était une question d’ordre privé. L’office a conclu que l’exercice par le requérant de sa foi dans un cadre privé ne constituait pas une raison plausible de penser qu’il risquait d’être persécuté à son retour et que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il avait pour cette raison besoin de protection en Suède.
150. Dès lors, la Cour constate que, bien que le requérant n’ait pas souhaité invoquer sa conversion, l’office des migrations a bel et bien évalué le risque auquel cette circonstance était susceptible de l’exposer en cas de retour en Iran.
151. Elle relève par ailleurs que dans son recours devant le tribunal des migrations le requérant a invoqué sa conversion et expliqué pourquoi il n’avait pas souhaité le faire auparavant.
152. Lors de l’audience devant ledit tribunal, il a toutefois décidé de ne pas invoquer sa conversion à l’appui de sa demande d’asile, mais a ajouté que « toutefois [cette conversion lui] causerait clairement des problèmes en cas de retour ». Le point de vue de l’office des migrations a aussi été examiné. Celui-ci n’a pas remis en cause le fait que le requérant professait la foi chrétienne à l’époque, mais a estimé que cela ne suffisait pas en soi pour que l’on pût considérer qu’il avait besoin de protection et s’est référé à la directive opérationnelle du ministère britannique de l’Intérieur de janvier 2009.
153. Cependant, le tribunal des migrations ne s’est pas penché plus avant sur la conversion du requérant, sa manière de manifester sa foi chrétienne en Suède à l’époque, la façon dont il entendait la manifester en Iran si la décision d’éloignement était mise en œuvre, ou les « problèmes » que sa conversion risquait de lui causer en cas de retour. Dans sa décision du 9 mars 2011 rejetant le recours, le tribunal des migrations a relevé que l’intéressé n’évoquait plus ses conceptions religieuses comme motif de persécution. En conséquence, il n’a pas évalué les risques que le requérant courrait du fait de sa conversion en cas de retour en Iran.
154. Dans sa demande d’autorisation de saisir la cour d’appel des migrations, le requérant a allégué avoir invoqué sa conversion devant le tribunal des migrations. De plus, il a soutenu que sa crainte que sa conversion fût parvenue à la connaissance des autorités iraniennes avait augmenté. Jugeant ces arguments insuffisants pour justifier qu’elle accordât l’autorisation de faire appel, la cour d’appel des migrations a écarté la demande du requérant le 8 juin 2011, de sorte que la décision d’éloignement est devenue exécutoire.
155. Le 6 juillet 2011, le requérant a demandé à l’office des migrations de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion. Il a invoqué sa conversion. Sa demande a été rejetée par l’office des migrations et le tribunal des migrations, qui ont estimé que la conversion de l’intéressé ne pouvait passer pour un « fait nouveau » propre à justifier le réexamen de sa cause. Le 17 novembre 2011, la cour d’appel des migrations a refusé au requérant l’autorisation de la saisir.
156. Ainsi, tout en sachant que l’intéressé s’était converti en Suède de l’islam au christianisme et qu’il était dès lors susceptible d’appartenir à un groupe de personnes qui, pour diverses raisons, pouvaient être exposées à un risque de subir un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention en cas de retour en Iran, l’office des migrations et le tribunal des migrations, en raison du refus du requérant d’invoquer sa conversion à l’appui de sa demande d’asile, ne se sont pas livrés à un examen approfondi de sa conversion, du sérieux de ses convictions, de sa manière de manifester sa foi chrétienne en Suède et de la façon dont il entendait la manifester en Iran si la décision d’éloignement était mise en œuvre. De plus, dans le cadre de la nouvelle procédure, la conversion du requérant n’a pas été considérée comme un « fait nouveau » susceptible de justifier le réexamen de sa cause. Les autorités suédoises n’ont donc à aucun stade évalué le risque que le requérant courrait, du fait de sa conversion, en cas de retour en Iran. Or, eu égard au caractère absolu des articles 2 et 3 de la Convention, une renonciation à la protection qui en résulte pour l’individu concerné est peu concevable. Il s’ensuit que, indépendamment de l’attitude du requérant, les autorités nationales compétentes ont l’obligation d’évaluer d’office tous les éléments portés à leur connaissance avant de se prononcer sur l’expulsion de l’intéressé vers l’Iran (paragraphe 127 ci-dessus).
157. En outre, le requérant a soumis à la Grande Chambre divers documents qui n’ont pas été présentés aux autorités nationales, par exemple sa déclaration écrite du 13 septembre 2014 (sur sa conversion, la manière dont il manifeste actuellement sa foi chrétienne en Suède et dont il entend le faire en Iran si la décision d’expulsion est mise en œuvre) et l’attestation écrite du 15 septembre 2014 que lui a fournie l’ancien pasteur de sa paroisse (§§ 96-97 ci-dessus). À la lumière des éléments qui lui ont été présentés et de ceux précédemment soumis par le requérant aux autorités nationales, la Cour conclut que l’intéressé a démontré à suffisance que sa demande d’asile fondée sur sa conversion mérite d’être examinée par lesdites autorités. C’est à celles-ci qu’il appartient de prendre en considération ces éléments, ainsi que toute évolution pouvant intervenir dans la situation générale en Iran et les circonstances propres au cas du requérant.
158. Il s’ensuit qu’il y aurait violation des articles 2 et 3 de la Convention si le requérant était renvoyé en Iran en l’absence d’une appréciation ex nunc par les autorités suédoises des conséquences de sa conversion.
KK C FRANCE arrêt du 10 octobre 2013 requête 18913/11
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
46. La Cour rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 114, 23 février 2012).
47. L’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 130, CEDH 2008).
48. La Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution de la mesure incriminée, à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129 ; NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 111, 17 juillet 2008). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, à propos de l’article 3). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles‑ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, no 23505/09, § 53, 20 juillet 2010, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits (Mo.P. c. France (déc.), no 55787/09, § 53, 30 avril 2013).
49. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, § 86, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
50. Concernant la situation générale en Iran, la Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Iran, la situation dans ce pays n’était pas telle que tout renvoi constituerait une violation de la Convention (R.C. c. Suède, précité, § 49, et S.F. et autres c. Suède, no 52077/10, § 64, 15 mai 2012). Au vu des rapports internationaux consultés, la Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion. Ainsi, elle doit déterminer si le renvoi du requérant vers l’Iran entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
51. Le requérant allègue avoir fui en raison des mauvais traitements subis du fait de ses prises de position contre les abus commis par les Bassidjis, il invoque principalement le risque qu’il court d’être interpellé dès son arrivée à l’aéroport de Téhéran. Selon lui, il serait immédiatement identifié par les autorités iraniennes d’une part, parce qu’il ne serait pas en mesure de prouver qu’il est légalement sorti du territoire, d’autre part, parce qu’il fait l’objet de poursuites du fait de sa démission des services de renseignements.
52. La Cour constate, tout d’abord, que le requérant présente un récit assez circonstancié et étayé par plusieurs pièces documentaires, dont deux convocations du tribunal révolutionnaire. Elle relève que les documents produits tendent à corroborer les faits exposés. Elle note toutefois les réserves émises par le Gouvernement, au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, quant à la crédibilité du récit du requérant et quant à l’authenticité des documents produits, ainsi que l’argument selon lequel l’anonymat imposé dans cette affaire l’aurait empêché d’engager plus d’investigations. La Cour écarte d’emblée la justification fondée sur l’anonymat puisque, si l’identité du requérant est dissimulée dans les documents publics de l’affaire, cela n’empêche pas le Gouvernement, qui a accès à cette information confidentielle, d’effectuer toute enquête nécessaire (voir, en ce sens, P.I. c. France (déc.), no 37180/10, § 49, 12 juin 2012). La Cour relève, par ailleurs, qu’en l’espèce, les éléments apportés par le requérant – tant son récit que les preuves documentaires – furent écartés par les autorités au moyen de motivations succinctes. L’OFPRA, en premier lieu, rejeta la demande du requérant par la seule affirmation que ses déclarations écrites et orales n’auraient pas permis d’établir la réalité de son parcours professionnel et les persécutions dont il aurait été victime en 2006. En second lieu, la CNDA, statuant en appel, s’est limitée à juger trop peu circonstanciées les déclarations du requérant et en a conclu qu’elle n’était convaincue ni de sa qualité d’informateur des Bassidjis, ni des critiques qu’il aurait exprimées à l’égard de cette milice à partir de 2005, ni de la réalité des persécutions invoquées de ce fait. S’agissant plus spécifiquement des convocations du tribunal révolutionnaire d’Ouroumieh communiquées par le requérant au soutien de son récit, la CNDA les déclara dénuées de garanties suffisantes d’authenticité, sans indiquer les motifs fondant ses suspicions. Il en résulte que la Cour ne trouve pas d’éléments suffisamment explicites dans ces motivations des instances nationales pour écarter le récit du requérant et rejeter sa demande. La Cour observe, par ailleurs, qu’aucun élément mettant manifestement en doute l’authenticité des documents produits ne lui a été soumis. Le Gouvernement reconnaît par ailleurs ne pas disposer d’éléments lui permettant de réfuter de façon catégorique cette authenticité. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas apporté d’informations pertinentes donnant des raisons suffisantes de douter de la véracité des déclarations du requérant et, partant, qu’il n’existe aucune raison de douter de la crédibilité de ce dernier. Dès lors, il ne saurait être attendu du requérant qu’il prouve plus avant ses dires et l’authenticité des éléments de preuve par lui fournis.
53. La Cour estime, enfin, important de prendre en compte les risques spécifiques encourus par les Iraniens qui retournent dans leur pays sans pouvoir prouver qu’ils ont quitté légalement le territoire. Il ressort des rapports internationaux consultés (voir paragraphes 33 et 34) que ces personnes sont fréquemment interpellées et interrogées quant aux conditions de leur départ du pays. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a quitté illégalement l’Iran et qu’il est détenteur d’un laissez-passer délivré par les autorités consulaires iraniennes en France et non d’un passeport. Par conséquent, il est probable que celui-ci, à son arrivée à l’aéroport de Téhéran, attire l’attention des autorités et que son passé de Bassidji et ses anciennes prises de position contre les abus commis par les membres de cette milice soient révélés. L’effet cumulé de ces différents facteurs constitue un risque supplémentaire pour le requérant (voir, mutatis mutandis, R.C. c. Suède, précité, § 56, et NA. c. Royaume-Uni, précité, §§ 134-136).
54. En conséquence, la Cour considère que, faute pour le Gouvernement de parvenir à mettre sérieusement en doute la réalité des craintes du requérant, elle ne peut qu’admettre que le renvoi du requérant vers l’Iran l’exposerait, au vu des circonstances de l’espèce, à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention.
II SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3
a) Principes généraux
62. Les principes généraux relatifs à l’effectivité des recours et des garanties fournies par les États contractants en cas d’expulsion d’un demandeur d’asile en vertu des articles 13 et 3 combinés de la Convention sont résumés dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286-293, CEDH 2011. Dans cet arrêt, la Cour a d’abord rappelé le caractère subsidiaire que revêt, par rapport aux systèmes nationaux, le mécanisme de plainte devant elle, puisqu’elle se garde d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire vers le pays qu’il a fui (§§ 286 et 287).
63. Ensuite, la Cour a réitéré les principes inhérents à l’article 13 de la Convention, qui « garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit » (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 288).
64. La Cour reconnaît une marge d’appréciation aux États contractants puisque « l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul » (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 53, CEDH 2007‑II, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 289).
65. L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005‑III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000‑VIII) ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV (extraits)). Lorsqu’il s’agit d’un grief selon lequel l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu de l’importance que la Cour attache à cette disposition et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002‑I ; Gebremedhin, précité, § 66, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 290-293).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
66. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié en droit français d’un recours effectif pour faire valoir son grief sous l’article 3, au mépris de l’article 13 de la Convention, en raison du traitement de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire
67. La Cour est consciente de la nécessité pour les États confrontés à un grand nombre de demandeurs d’asile de disposer des moyens nécessaires pour faire face à un tel contentieux. Elle ne remet pas en cause l’intérêt et la légitimité de l’existence d’une procédure prioritaire, en plus de la procédure normale de traitement des demandes d’asile, pour les demandes dont tout porte à croire qu’elles sont infondées ou abusives. Elle note d’ailleurs que la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres donne aux Etats membres de l’Union européenne la possibilité d’appliquer une procédure accélérée notamment lorsque des éléments clairs et évidents permettent aux autorités de considérer que le demandeur ne pourra pas bénéficier d’une protection internationale, lorsque la demande paraît frauduleuse ou lorsque, sans motif valable, elle n’a pas été présentée dans les délais les plus brefs suivant la date d’entrée sur le territoire.
68. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la compatibilité de la procédure d’asile dite prioritaire appliquée aux demandeurs en rétention et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Dans l’arrêt I.M. c. France (précité, §§ 49-63 et §§ 64-74), la Cour a jugé, quant à l’effectivité du système de droit interne pris dans son ensemble, que si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles, leur accessibilité en pratique avait été limitée par plusieurs facteurs, liés pour l’essentiel au classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours à sa disposition et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves alors que le requérant se trouvait en détention ou en rétention (ibid., § 154). La Cour a conclu à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 après avoir constaté qu’il s’agissait d’une première demande d’asile et que le requérant, gardé à vue puis détenu, n’avait pas eu la possibilité de se rendre en personne à la préfecture pour introduire une demande d’asile comme l’exige le droit français (ibid., §§ 141 et 143). Dans l’arrêt Sultani c. France (no 45223/05, §§ 64-65, CEDH 2007‑IV (extraits)), la Cour a, au contraire, estimé que le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne privait pas l’étranger en rétention d’un examen circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale. Le simple fait qu’une demande d’asile soit traitée en procédure prioritaire et donc dans un délai restreint ne saurait en conséquence, à lui seul, permettre à la Cour de conclure à l’ineffectivité de l’examen mené.
69. En l’espèce, la Cour observe que, comme dans l’arrêt I.M. précité, le requérant est un primo-demandeur d’asile en France et que, du fait du classement en procédure prioritaire, il a bénéficié de délais de recours réduits pour préparer une demande d’asile complète et documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées selon la procédure normale. La Cour relève cependant qu’à la différence de l’arrêt I.M., le requérant a particulièrement tardé à former une demande d’asile en France. En effet, il n’a demandé l’asile que deux ans après sa première venue en France et plus de dix mois après avoir fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. La Cour en déduit que le requérant a donc disposé de deux années pour présenter une demande d’asile, laquelle aurait bénéficié d’un examen complet dans le cadre de la procédure normale, ou, à tout le moins, pour se procurer les documents de nature à étayer une telle demande d’asile. La Cour note que le requérant a volontairement omis de préciser aux autorités françaises qu’il avait auparavant vainement sollicité l’asile auprès des autorités britanniques et grecques, ce qui a justifié le traitement de sa demande selon la procédure prioritaire. Ces précédentes demandes d’asile montrent que le requérant savait comment formuler une demande d’asile et avait conscience de la nécessité de documenter celle-ci.
70. La Cour souligne que le requérant, alors qu’il était libre et non en rétention, a pu former une demande d’asile devant l’OFPRA et un recours suspensif devant le tribunal administratif contre le second arrêté de reconduite à la frontière, bien que ces recours soient enfermés dans des délais brefs de, respectivement, cinq jours et quarante-huit heures. Eu égard aux précédentes demandes d’asile, au caractère particulièrement tardif de la demande d’asile présentée en France et, partant, à la possibilité qu’il avait de rassembler, au préalable, toute pièce utile pour documenter une telle demande, le requérant ne peut valablement soutenir que l’accessibilité des recours disponibles a été affectée par la brièveté des délais dans lesquels ils devaient être exercés et par les difficultés matérielles rencontrées pour obtenir les preuves nécessaires (voir, mutatis mutandis, M.E. c. France, no 50094/10, §§ 65-70, 6 juin 2013).
71. Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.
D ET AUTRES c. ROUMANIE du 14 janvier 2020 requête n° 75953/16
Arts 2 et 3 • Expulsion (Irak) • Ressortissant irakien condamné en Roumanie pour trafic de migrants et interdit du territoire national • Risque de subir en Irak des traitements contraires aux articles 2 et 3 non établi
Art 13 (+ 2 et 3) • Recours effectif • Effectivité du recours compromise par son absence de caractère suspensif
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 et 3 DE LA CONVENTION
a) Principes généraux
61. Les principes généraux applicables en la matière ont été résumés dans l’arrêt F.G. c. Suède ([GC] no 43611/11, §§ 110-127, 23 mars 2016). En particulier, dans le contexte de l’expulsion, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’un individu, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à la peine capitale, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, tant l’article 2 que l’article 3 impliquent que l’État contractant ne doit pas expulser la personne en question. La Cour a donc souvent examiné les deux articles simultanément (ibid., § 110).
62. De même, si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour. Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (ibid, § 115). Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits, mais plus particulièrement la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (ibid., § 118). La Cour doit toutefois estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, comme par exemple d’autres États contractants ou des États tiers, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales réputées pour leur sérieux (ibid., § 117, et X c. Pays-Bas, no 14319/17, § 72, 10 juillet 2018).
63. Enfin, il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux articles 2 et 3. En règle générale, on ne peut considérer que le demandeur d’asile s’est acquitté de la charge de la preuve tant qu’il n’a pas fourni, pour démontrer l’existence d’un risque individuel, et donc réel, de mauvais traitements qu’il courrait en cas d’expulsion, un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existant dans le pays de destination. Cette exigence est toutefois assouplie dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’intéressé allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements (J.K. et autres c. Suède, précité, §§ 91, 94 et 103).
b) Application des principes généraux à la présente affaire
64. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que le premier requérant soutient que sa condamnation en Roumanie pour des faits liés au terrorisme l’exposerait, en cas d’expulsion vers l’Irak, à la peine de mort ou à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Elle réaffirme qu’elle a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte anti-terroriste. La Cour considère qu’il est légitime, devant une telle menace, que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, actes qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner (M.A. c. France, no 9373/15, § 53, 1er février 2018).
65. La Cour note ensuite que ledit requérant s’est vu infliger par les juridictions roumaines, en sus de la peine d’emprisonnement, une peine complémentaire d’interdiction de l’exercice du droit de séjourner sur le territoire national pendant cinq ans (paragraphe 21 ci-dessus). Cette peine complémentaire – qui est applicable une fois que l’étranger visé a purgé la peine d’emprisonnement – est à l’origine de la décision des autorités nationales de procéder à l’expulsion du premier requérant (paragraphe 30 ci‑dessus). La Cour observe que, compte tenu de ces spécificités de la peine complémentaire, les autorités nationales ont examiné les griefs du requérant susmentionné en deux étapes : dans un premier temps, dans le cadre de la procédure pénale au fond, lorsque l’expulsion n’était pas encore susceptible d’exécution puisque l’intéressé devait d’abord purger sa peine d’emprisonnement (paragraphe 29 ci-dessus), et, dans un second temps, dans le cadre des procédures afférentes à la contestation à l’exécution et à la demande d’asile (paragraphes 35 et 38 ci‑dessus), lorsque l’exécution de la peine complémentaire était devenue imminente en raison de la libération conditionnelle du premier requérant (paragraphe 43 ci-dessus).
66. La Cour note que, dans son arrêt définitif du 26 janvier 2016, la Haute Cour a jugé que le premier requérant n’avait pas prouvé l’existence d’un risque de mauvais traitements en cas d’exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire national (paragraphe 29 ci‑dessus). Si cet examen semble sommaire, la Cour ne saurait ignorer qu’à ce stade de la procédure interne la perspective de l’expulsion du premier requérant était encore éloignée dans le temps puisque celui-ci devait d’abord purger la peine d’emprisonnement et la situation était encore susceptible d’évoluer. Elle observe que c’est plutôt dans le cadre des procédures afférentes à la contestation à l’exécution et à la demande d’asile que les tribunaux internes se sont livrés à un examen plus précis des griefs du premier requérant (paragraphes 35 et 38 ci‑dessus).
67. Ainsi, s’agissant de la contestation à l’exécution, la Cour note que, dans son arrêt du 10 novembre 2017, la Haute Cour a jugé que les preuves versées au dossier aux fins de l’établissement de l’existence d’un risque de torture ou de mauvais traitements avaient un caractère général et que les allégations du premier requérant relatives aux peines applicables en Irak en cas d’infractions liées au terrorisme n’étaient pas pertinentes en l’affaire puisque l’intéressé n’était pas visé par une procédure d’extradition en vue de poursuites pénales pour de tels faits (paragraphe 35 ci-dessus). Quant à la demande d’asile, la Cour observe que le tribunal de première instance de Bucarest a conclu, dans son jugement définitif du 11 avril 2018, que l’intéressé n’était pas concerné par la politique anti-terroriste de l’Irak puisqu’il avait été condamné dans un autre État et que l’Irak faisait application du principe non bis in idem. Le tribunal a relevé en outre qu’aucun élément versé au dossier n’indiquait que la peine capitale avait été appliquée en Irak à des personnes condamnées par un autre État (paragraphe 38 ci-dessus).
68. La Cour estime que l’analyse opérée par les autorités nationales est en adéquation avec sa jurisprudence. En effet, elle rappelle avoir conclu, en août 2016, dans l’affaire J.K. et autres c. Suède (précitée, § 111) que la situation générale en matière de sécurité en Irak n’empêchait pas en soi l’éloignement des étrangers vers ce pays. Elle a ensuite confirmé cette conclusion dans la décision A.S. c. Belgique ((déc.), no 68739/14, § 60, 19 septembre 2017). Puisqu’elle doit prendre en compte les éléments disponibles à la date de son examen (F.G. c. Suède, précité, § 115), la Cour observe qu’aucun élément n’indique que la situation en Irak a considérablement changé depuis ces dates. Elle estime qu’il convient plutôt de rechercher si la situation personnelle du premier requérant est telle qu’il se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention s’il était expulsé vers l’Irak. Elle relève que, sur le plan interne, tant la Haute Cour que le tribunal de première instance de Bucarest ont jugé que l’intéressé n’avait pas prouvé qu’il courait un risque réel en raison de sa situation individuelle en cas de retour en Irak (paragraphes 35 et 38 ci‑dessus).
69. La Cour note que l’argument principal du premier requérant consiste à dire que c’est sa condamnation en Roumanie pour des faits liés au terrorisme qui l’exposerait à des mauvais traitements, à la torture ou à la peine capitale s’il retournait en Irak (paragraphe 59 ci‑dessus). À l’appui de sa thèse, ledit requérant se réfère à la situation générale en Irak telle qu’établie par des rapports provenant d’organisations internationales ou d’ONG.
70. La Cour note cependant que les éléments généraux indiqués au paragraphe précédent sont accompagnés de peu d’éléments propres à la situation individuelle de l’intéressé. En effet, elle estime que les éléments soumis par le premier requérant devant elle ne montrent pas concrètement qu’il existe un lien direct en l’espèce entre la condamnation de l’intéressé en Roumanie et le risque de subir en Irak des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. S’ils font état de défaillances du système irakien de répression du terrorisme, ces éléments indiquent que ces défaillances ont été constatées dans le cadre de procédures pénales menées à l’encontre des personnes soupçonnées de faits de terrorisme commis sur le sol irakien dans le cadre du conflit militaire ayant opposé l’EIIL aux forces militaires irakiennes et aux forces affiliées (paragraphes 47-51 ci‑dessus). Or les faits pour lesquels le premier requérant a été condamné en Roumanie n’ont pas eu lieu sur le territoire irakien et n’ont pas de lien direct avec le terrorisme. À cet égard, la Cour note que l’intéressé a été condamné pour avoir facilité l’entrée sur le territoire roumain des personnes impliquées dans des activités terroristes (paragraphes 22 et 28 ci-dessus), et donc pour une infraction liée au trafic de migrants. L’intéressé n’a jamais été accusé, en Roumanie ou en Irak, de s’être lui-même livré à des actes de nature terroriste. La Cour en conclut qu’aucun élément probant ne suggère que le premier requérant est exposé à un risque réel de subir un nouveau procès en Irak ou de s’y voir infliger une nouvelle peine.
71. À cet égard, la Cour note également que, selon les conclusions du tribunal de première instance de Bucarest (paragraphe 38 ci-dessus) ainsi que selon les observations du Gouvernement (paragraphe 60 ci-dessus), l’Irak fait application du principe non bis in idem, ce qui permet d’emblée d’écarter l’éventualité d’un nouveau procès pour les mêmes faits. Or le premier requérant n’a apporté aucune preuve établissant que ce principe n’est pas respecté en pratique par les autorités irakiennes (voir, mutatis mutandis et en relation à l’absence de preuve quant au non-respect du même principe par les autorités judiciaires du Royaume du Maroc, X c. Pays-Bas, no 14319/17, § 80, 10 juillet 2018).
72. La Cour prend également en considération le fait que le premier requérant indique qu’il est un musulman sunnite (paragraphe 59 ci‑dessus). Pour autant que cette indication viserait à démontrer que ledit requérant relève d’une catégorie vulnérable en raison d’un risque d’être soupçonné de faits de terrorisme du seul fait de son affiliation religieuse (voir, en ce sens, le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile, mentionné au paragraphe 52 ci-dessus), la Cour note que rien dans le dossier n’indique que les autorités irakiennes perçoivent l’intéressé comme soupçonné de tels faits ni qu’elles sont à sa recherche, en l’espèce, pour des faits de terrorisme ou pour d’autres infractions perpétrés sur le sol irakien ou ailleurs.
73. Les éléments présentés devant la Cour montrent plutôt que le premier requérant entretient une relation normale avec les autorités de son pays, puisque celles-ci lui ont délivré sur sa demande un document attestant qu’il n’était ni recherché ni poursuivi en Irak et qu’il n’était pas lié à des groupements militaires ou terroristes (paragraphe 19 ci-dessus). Les mêmes autorités irakiennes ont également délivré audit requérant au moins deux laissez‑passer (paragraphe 41 ci-dessus) – des documents de voyage dont l’utilisation ne requiert pas le respect de formalités spéciales et qui, dans le cas des ressortissants irakiens, permettent à ceux-ci de rentrer dans leur pays d’origine sans devoir fournir aux autorités des explications ou des informations supplémentaires (paragraphe 53 ci‑dessus).
74. La Cour estime dès lors que, lorsqu’elles ont jugé que le premier requérant n’avait pas prouvé qu’il courait un risque réel en raison de sa situation individuelle en cas de retour en Irak, les juridictions nationales n’ont pas imposé une charge probatoire exorbitante à l’intéressé. Ce dernier n’a d’ailleurs pas allégué avoir rencontré des difficultés particulières pour se procurer des éléments de preuve. L’analyse opérée par les juridictions nationales étant en outre raisonnée et dépourvue d’arbitraire, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Elle conclut qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que le premier requérant, s’il était renvoyé en Irak, y courra un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention.
75. En conséquence, la Cour estime que la mise en œuvre de la décision d’expulsion visant l’intéressé n’emporterait pas violation des articles 2 et 3 de la Convention.
83. La Cour note d’abord qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement que, si le premier requérant était expulsé par les autorités roumaines, il y aurait ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale (paragraphe 77 ci-dessus). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8 ; il convient donc de rechercher si, en l’espèce, elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
84. La Cour prend note des arguments du Gouvernement selon lesquels la peine complémentaire d’interdiction de l’exercice du droit de rester sur le territoire national était prévue par le code pénal et visait la préservation de la sécurité nationale (paragraphe 77 ci-dessus). En l’absence d’arguments contraires convaincants présentés par les requérants, la Cour souscrit à la thèse du Gouvernement.
85. Reste à déterminer si la mesure en cause était « nécessaire dans une société démocratique » et, plus précisément, si, en décidant l’expulsion du premier requérant, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les droits des requérants au regard de la Convention, d’un côté, et les intérêts de la société, de l’autre côté (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003‑X). La Cour rappelle que les principes généraux applicables dans des affaires d’expulsion ont été résumés dans les arrêts Udeh c. Suisse (no 12020/09, §§ 43-45, 16 avril 2013) et Ndidi c. Royaume‑Uni (no 41215/14, §§ 75-76, 14 septembre 2017). La Cour a eu l’occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires dans l’arrêt Üner (précité, §§ 57-58). Les critères pertinents ainsi définis sont les suivants :
- la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
- la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
- le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
- la nationalité des diverses personnes concernées ;
- la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
- la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
- la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
- la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
- l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
86. L’exigence d’un « contrôle européen » ne signifie pas cependant que, au moment de déterminer si la mesure en cause a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, la Cour doive nécessairement en réexaminer la proportionnalité à l’aune de l’article 8 de la Convention. Au contraire, dans les affaires portées devant elle sur le terrain de cette disposition, la Cour considère en général qu’il découle de la marge d’appréciation que, lorsque des juridictions internes indépendantes et impartiales ont soigneusement examiné les faits, en appliquant les normes pertinentes en l’espèce des droits de l’homme d’une manière conforme à la Convention et à sa propre jurisprudence, et qu’elles ont dûment mis en balance les intérêts personnels du requérant et l’intérêt général du public, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation (notamment en ce qui concerne les détails factuels relatifs à la proportionnalité) à celle des autorités nationales compétentes. Il n’en va autrement que lorsqu’il est démontré qu’il y a des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis au leur (Ndidi, précité, § 76).
87. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que les juridictions nationales ont procédé à un contrôle en deux étapes : dans un premier temps, dans le cadre de la procédure pénale au fond (paragraphe 29 ci-dessus), et, dans un second temps, dans le cadre de la contestation à l’exécution (paragraphe 35 ci‑dessus). La Cour note que seul le premier requérant a été partie à ces procédures internes ; elle estime toutefois que l’issue de ces procédures a également eu des conséquences pour les quatre autres requérants. Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas soutenu devant elle que les quatre autres requérants pouvaient intervenir à titre personnel dans ces procédures ou qu’ils avaient un recours interne à leur disposition qu’ils étaient tenus d’exercer.
88. S’agissant de la procédure pénale au fond, la Cour note que la Haute Cour a accordé un poids important au divorce survenu entre le premier requérant et la cinquième requérante en 2009, laquelle s’était alors vu attribuer la garde des trois autres requérants (paragraphes 8 et 29 ci‑dessus). La Cour estime elle aussi que cet élément a un poids certain en l’espèce, puisque le divorce témoigne de l’altération de la vie familiale des requérants (voir, mutatis mutandis, Üner, précité § 62). Devant les tribunaux internes et devant la Cour, le premier requérant n’a pas soutenu avoir participé de manière directe et constante à la vie familiale des quatre autres requérants après le divorce, et il n’a pas non plus plaidé que ces derniers étaient dépendants de son soutien. La Cour prend en compte l’allégation du premier requérant selon laquelle celui-ci envisage de se remarier avec la cinquième requérante (paragraphe 81 ci-dessus). Elle estime cependant que les intéressés ne peuvent plus passer pour ignorer la situation juridique du premier requérant.
89. Ensuite, la Cour note que le premier requérant a saisi les tribunaux internes d’une contestation à l’exécution après avoir été remis en liberté conditionnelle. Dans ses arguments relatifs à sa vie privée et familiale, l’intéressé indiquait que sa famille d’origine se trouvait en Roumanie, qu’il avait des liens sociaux plus forts avec la Roumanie qu’avec l’Irak, et que son ex‑épouse et leurs enfants ne pouvaient et ne souhaitaient pas le suivre en Irak (paragraphe 33 ci-dessus). La Cour est d’avis que le premier requérant a soumis aux tribunaux internes des éléments généraux, non assortis d’éléments individuels plus précis. Les juridictions nationales saisies de la contestation à l’exécution ont pris en considération non seulement les arguments présentés par ledit requérant, mais aussi d’autres éléments, dont la nature et la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, de même que ses antécédents judiciaires, les liens sociaux, culturels et familiaux avec la Roumanie et avec l’Irak, ainsi que la période passée sur le territoire roumain (paragraphes 34 et 35 ci‑dessus). La Cour estime que ces éléments ont eux aussi un poids certain pour l’examen du grief des requérants. Ainsi, elle constate que l’infraction commise par le premier requérant avait une gravité particulière, puisqu’elle était liée à des faits de terrorisme, et que l’intéressé avait également été condamné pour d’autres infractions (paragraphe 11 ci-dessus). Ensuite, la Cour note que le premier requérant est arrivé en Roumanie en 1994, qu’il a aussi obtenu le statut de réfugié en Allemagne en 1997 et a été renvoyé du territoire roumain en 2006, et qu’il est retourné en Roumanie de manière illégale quelques mois après son expulsion, sous une fausse identité et muni de faux documents (paragraphes 7-10 ci‑dessus).
90. Qui plus est, la Cour observe que le premier requérant n’a clarifié ni devant les tribunaux internes ni devant elle certaines circonstances factuelles importantes pour l’examen de son grief. Notamment, il n’a pas démontré avoir établi des liens linguistiques, sociaux, culturels ou économiques forts avec la Roumanie. De plus, si l’intéressé a précisé que sa mère et ses frères résidaient en Roumanie (paragraphe 33 ci-dessus), il n’a pas allégué qu’il était dépendant de ces membres de sa famille ou, inversement, qu’il subvenait à leurs besoins. La Cour estime que l’examen opéré par les tribunaux internes a été rendu plus difficile par le défaut de communication par l’intéressé d’aspects factuels plus précis.
91. La Cour observe aussi que la mesure d’interdiction de l’exercice du droit du premier requérant de rester sur le territoire national est limitée à une durée de cinq ans, ce qui distingue la présente affaire d’autres affaires dans lesquelles les intéressés faisaient l’objet d’une expulsion prononcée pour une durée plus longue, voire illimitée (Shala c. Suisse, no 52873/09, § 56, 15 novembre 2012 (affaire dans laquelle le requérant était frappé d’une interdiction du territoire de dix ans), avec les références qui y sont citées).
92. Quant à la situation spécifique des deuxième, troisième et quatrième requérants, la Cour observe que leur garde avait été attribuée à la mère et que le premier requérant n’a pas soutenu, ni devant les tribunaux internes ni devant elle, que, après le divorce, il avait exercé de manière effective un droit de visite envers eux. Elle note également que la troisième requérante est devenue majeure au cours de la procédure devant elle (paragraphe 5 ci‑dessus). La Cour note aussi que le premier requérant affirme avoir reçu la visite des autres requérants après son placement en rétention administrative (paragraphe 81 ci‑dessus), mais elle estime qu’à lui seul cet élément ne pourrait pas être décisif. Le premier requérant soutient par ailleurs que les autres requérants l’ont suivi lors de son expulsion en 2006 (paragraphe 81 ci‑dessus), et les deuxième à cinquième requérants n’ont présenté aucun élément permettant d’établir qu’il existe en ce moment des raisons valables qui les empêcheraient de continuer à maintenir le contact avec le premier requérant ou de lui rendre visite en Irak ou dans un autre pays tiers (voir, mutatis mutandis, Ndidi, précité, § 80). Par conséquent, la Cour juge que dans les circonstances particulières de l’espèce les considérations déjà exposées (paragraphes 88-91 ci‑dessus) l’emportent sur les intérêts de la famille.
93. Dès lors, eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions nationales entre les divers intérêts en jeu en l’espèce, la Cour estime que la mise à exécution de l’expulsion du premier requérant vers l’Irak ne décèlerait aucune apparence de violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
94. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
127. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit. « L’effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, « l’instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 75, CEDH 2002‑I).
128. La Cour tient à souligner que le grief d’un requérant selon lequel son expulsion aura des conséquences contraires aux articles 2 et 3 de la Convention doit impérativement faire l’objet d’un contrôle attentif par une « instance nationale » (voir, mutatis mutandis et en matière d’extradition, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005‑III). Dans ce cas, l’effectivité requiert également que l’intéressé dispose d’un recours de plein droit suspensif (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007‑II ; Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 200, CEDH 2012 ; et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 82 in fine, CEDH 2012).
129. La Cour note que le premier requérant a pu formuler une contestation à l’exécution de la peine complémentaire qui lui avait été imposée (paragraphe 33 ci-dessus) et qu’il a également déposé une demande d’asile (paragraphe 37 ci-dessus). Toutefois, il ne ressort pas des éléments présentés à la Cour que ces recours ont un effet suspensif en droit roumain pour un grief comme celui présenté par le premier requérant. Or, cela est incompatible avec la jurisprudence de la Cour citée au paragraphe précédent. Si, en l’occurrence, les tribunaux internes ont examiné les demandes faites par ledit requérant avant la mise en œuvre de la mesure d’expulsion vers l’Irak, cela est dû au fait que la Cour avait indiqué au gouvernement défendeur de ne pas expulser l’intéressé, en application de l’article 39 du règlement (paragraphe 31 ci-dessus). Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas soutenu devant la Cour que ces recours avaient un caractère suspensif de droit en l’espèce (paragraphe 126 ci-dessus).
130. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention dans le chef du premier requérant.
N.A. c. Finlande du 14 novembre 2019 requête n° 25244/18
Articles 2 et 3 : La décision finlandaise d’expulser un Irakien, qui a ensuite été tué dès son retour dans son pays d’origine, a emporté violation de la Convention
La Cour juge en particulier que les autorités finlandaises ne se sont pas livrées à un examen suffisamment attentif des risques encourus par le père de la requérante en Irak, bien qu’elles aient admis sa version des faits quant aux deux tentatives d’attentats dont il avait été victime, dans un contexte de tensions entre groupes musulmans chiites et sunnites (l’intéressé était sunnite). La décision des autorités finlandaises d’expulser le père de la requérante, qui avait eu un différend avec un collègue chiite alors qu’il travaillait comme enquêteur au ministère de l’Intérieur irakien, a finalement contraint l’intéressé à accepter un retour volontaire en Irak, où il a été tué par balles peu après son arrivée.
FAITS
Le père de Mme N.A. était un Arabe sunnite de Bagdad. Il servit comme commandant dans l’armée sous l’ancien régime irakien de Saddam Hussein, puis travailla pour une entreprise de logistique américaine après la chute de ce régime. Entre 2007 et 2015, il fut affecté au Bureau de l’Inspecteur général irakien, au sein du ministère de l’Intérieur, où il fut enquêteur, puis responsable des affaires de violation des droits de l’homme et de corruption. Il dut fréquemment enquêter sur des agents des services de renseignement ou des milices. Son travail devint plus dangereux lorsque les milices chiites prirent de l’importance. Alors qu’il enquêtait sur une affaire en 2015, il eut un différend avec un collègue qui, selon la requérante, appartenait à la milice chiite principale, l’Organisation Badr. Ledit collègue agressa le père de Mme N.A. et l’insulta, mais il fut ensuite muté au service de renseignement et obtint une promotion. En février 2015, le père de la requérante fit l’objet d’une tentative d’attentat au cours de laquelle on essaya de lui tirer dessus. Il dénonça l’agression mais constata par la suite qu’aucune enquête n’était menée sur les faits. Sentant qu’il ne recevrait aucune protection et n’obtiendrait pas justice en Irak, il démissionna en mars 2015. En avril 2015, la voiture de la famille explosa sous l’effet d’une bombe juste après que les parents de Mme N.A. en fussent sortis et, en mai de la même année, la requérante elle-même fut victime d’une tentative d’enlèvement.
La famille arriva en Finlande en septembre 2015 et le père demanda à bénéficier de la protection internationale. En décembre 2016, les autorités rejetèrent sa demande d’asile. Les services d’immigration avaient en effet admis sa version des faits mais considéré que les Arabes sunnites ne faisaient pas, en tant que tels, l’objet de persécutions en Irak. En septembre 2017, le tribunal administratif d’Helsinki rejeta le recours dont il avait été saisi par le père de la requérante, estimant que le métier que celui-ci avait exercé sous le régime de Saddam Hussein ou pour l’entreprise de logistique américaine ne l’exposait à aucun risque particulier. Il considéra que rien ne prouvait que les agressions dont l’intéressé avait fait l’objet résultaient du conflit qui l’avait opposé à son ancien collègue du ministère de l’Intérieur, et que la situation générale en matière de sécurité en Irak était seule en cause. Il jugea également que le fait d’être sunnite n’exposait pas le père de Mme N.A. à un risque réel de persécutions. Fin novembre 2017, la Cour administrative suprême refusa à l’intéressé l’autorisation de la saisir. Le père de Mme N.A. revint en Irak en novembre 2017 dans le cadre d’un programme de retour volontaire assisté. En décembre 2017, la requérante apprit que l’appartement de sa tante, que sa famille avait auparavant utilisé pour se cacher, avait été la cible d’un attentat. Quelques jours plus tard, elle fut informée que son père avait été tué par des tireurs non identifiés. Selon les documents produits par Mme N.A., on avait tiré sur son père à trois reprises dans une rue de Bagdad.
Article 2 et article 3
La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel l’affaire ne relèverait pas de la juridiction de la Finlande en ce que le père de la requérante serait volontairement rentré dans son pays d’origine. La requérante argue toutefois que le retour de son père n’a pas été volontaire mais qu’il lui a été imposé par les décisions des autorités finlandaises. Elle plaide qu’il ne voulait pas attirer l’attention des autorités irakiennes en étant renvoyé de force dans son pays, ni faire l’objet d’une interdiction de visa dans l’espace Schengen pour une durée de deux ans. La Cour estime que l’intéressé ne serait pas rentré en Irak si une décision d’expulsion exécutoire n’avait été prise à son encontre, et que sa décision d’y retourner n’a pas été volontaire en ce qu’elle n’a pas résulté d’un libre choix. L’affaire relève donc de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention.
La Cour cite également l’absence de choix véritablement libre comme motif de rejet d’un autre argument implicite du Gouvernement selon lequel le père de la requérante aurait renoncé à son droit à la protection de la Convention en signant une déclaration par laquelle il déchargeait de toute responsabilité les organismes et autorités ayant contribué à son retour en Irak. La Cour relève que les autorités finlandaises ont jugé crédible et cohérente la version des faits produite par l’intéressé dans sa demande d’asile, notamment la possibilité qu’il présentât un intérêt pour les autorités irakiennes ou des acteurs non étatiques. Les autorités nationales se sont également largement appuyées sur des informations pertinentes concernant l’Irak, qui montraient notamment qu’il existait des tensions entre milices chiites et Arabes sunnites, que des Irakiens qui avaient travaillé pour des entreprises américaines avaient été tués, et que la situation en matière de sécurité à Bagdad exigeait des organes décisionnels une attention particulière aux risques encourus par chaque personne menacée d’expulsion. Compte tenu de la situation générale en termes de sécurité et de violence, tous ces éléments pris cumulativement pouvaient présenter un risque réel. Les autorités nationales ne les ont toutefois pas appréciés de manière cumulative. Plus important encore, les juridictions n’ont pas suffisamment pris en considération les tentatives d’attentat perpétrées contre le père de la requérante avant qu’il ne quittât l’Irak, alors même que les autorités finlandaises avaient connaissance de la fusillade et de l’explosion de la voiture de l’intéressé. Elles ont jugé que ces incidents résultaient de la situation générale en matière de sécurité, au lieu de s’intéresser plus particulièrement au père de la requérante. La Cour ne voit aucune explication plausible qui justifierait que les autorités finlandaises n’aient pas pris plus au sérieux ces deux incidents et ne les aient pas examinés sous l’angle du risque personnellement encouru par le père de la requérante. Par ailleurs, le conflit entre l’intéressé et son collègue a été écarté comme s’il s’agissait d’un différend personnel, au lieu d’être examiné du point de vue des liens possibles qu’il pouvait avoir avec l’appartenance religieuse des intéressés et l’existence de tensions entre groupes chiites et sunnites, ou avec les attentats dont avait été victime le père de la requérante. La Cour n’est ainsi pas convaincue que l’appréciation par les autorités finlandaises des risques encourus par le père de la requérante dans l’hypothèse d’un retour en Irak a satisfait aux exigences de l’article 2 ou 3. Lesdites autorités avaient en effet connaissance des risques auxquels l’intéressé était exposé, ou auraient dû en avoir connaissance. La Cour conclut que le manquement des autorités finlandaises à leurs obligations découlant de l’article 2 ou 3 lors de l’examen de la demande d’asile présentée par le père de la requérante a emporté violation de ces deux dispositions. Elle rejette le grief de la requérante relativement à la violation des droits qui lui auraient été garantis par l’article 3.
O.D. c. Bulgarie 10 octobre 2019 requête n° 34016/18
Article 13 avec les articles 2 et 3 : Un ancien militaire syrien risquerait de subir des mauvais traitements et une atteinte à son droit à la vie en cas d’expulsion vers la Syrie
La Cour juge en particulier que, eu égard à la situation générale en Syrie et au risque individuel auquel le requérant est exposé, il ne peut être établi que ce dernier peut retourner en Syrie en sécurité. La Cour juge aussi que le requérant n’a pas bénéficié d’une voie de recours effective, relevant que la demande de suspension de la mesure d’expulsion a été rejetée au motif qu’il représentait une menace pour la sécurité nationale, et que la procédure sur la demande d’octroi du statut de réfugié ou du statut humanitaire n’avait pas pour but de contrôler la légalité de l’arrêté de l’expulsion, ni son effet dans le contexte les griefs tirés du droit à la vie et du droit à ne pas subir de mauvais traitements. La Cour décide d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, de ne pas expulser O.D.
LES FAITS
Le requérant est un ressortissant syrien né en 1991 et résidant à Sofia. En 2011, le requérant intégra l’armée syrienne où il aurait atteint le grade de sergent. Il était tireur d’élite et avait la compétence de manipuler des missiles. Il dit avoir déserté l’armée syrienne en 2012, puis avoir rejoint l’Armée syrienne libre pendant neuf mois. En 2013, il quitta la Syrie pour se rendre en Turquie où il demeura trois mois, puis en Bulgarie où il introduisit deux demandes d’asile qui furent rejetées. La même année, les autorités bulgares ordonnèrent son expulsion, estimant qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. Les recours du requérant contre cette décision furent infructueux. En 2018, la Cour européenne des droits de l’homme décida d’indiquer au Gouvernement bulgare de ne pas expulser le requérant pour la durée de la procédure devant la Cour, en application de son l’article 39 du règlement relatif aux mesures provisoires.
La même année, l’ambassade de Syrie en Bulgarie lui fournit un passeport d’une durée de validité de deux ans. Actuellement, ce passeport est retenu par la direction « Migration » du ministère des Affaires intérieures et le requérant est considéré comme séjournant de manière illégale sur le territoire bulgare.
Articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants)
La Cour constate que les décisions de l’Agence pour les réfugiés et de la Cour administrative suprême ainsi que les observations du Gouvernement admettent que la situation générale en Syrie est de nature à justifier une protection des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention. Pour sa part, la Cour observe que la sécurité et la situation humanitaire, ainsi que la nature et la portée des hostilités en Syrie, ont subi une détérioration dramatique durant la période comprise entre l’arrivée du requérant en Bulgarie en juin 2013 et l’arrêt définitif confirmant l’arrêté d’expulsion en août 2014, mais aussi entre cette dernière date et le refus d’octroi d’une protection à l’intéressé. De plus, cette situation semble perdurer à ce jour. En effet, malgré une baisse générale des hostilités, les parties au conflit poursuivent d’intenses combats et se livrent à des attaques indiscriminées, y compris envers la population civile et les infrastructures civiles, à des pillages et à des persécutions. De plus, des arrestations et des détentions arbitraires de masse ont eu lieu encore récemment, début 2019, près de Homs, la ville d’origine du requérant. Pour ce qui est du risque individuel auquel le requérant est exposé, la Cour note que celui-ci craint des mauvais traitements en raison de sa désertion alléguée de l’armée syrienne. Elle observe aussi que rien dans les décisions internes et les observations du Gouvernement n’indique que les autorités bulgares estiment la version du requérant comme non crédible. Par ailleurs, la Cour note tout particulièrement l’existence de pratiques d’exécution, de détention arbitraire ou de mauvais traitements à l’égard des personnes ayant déserté l’armée ou ayant refusé d’exécuter des ordres de tir. En outre, cette analyse quant au risque individuel encouru par le requérant en Syrie a été opérée par la Cour administrative suprême et par le Gouvernement dans ses observations.
Par conséquent, la Cour estime qu’il ne peut être établi, eu égard aux allégations du requérant selon lesquelles il subirait des mauvais traitements en raison de sa désertion de l’armée, que celui-ci peut retourner en Syrie, dans la ville de Homs ou ailleurs dans le pays, en sécurité. Ainsi, le renvoi du requérant de la Bulgarie vers la Syrie emporterait une violation des articles 2 et 3 de la Convention.
Article 13 (droit à un recours effectif), combiné avec les articles 2 et 3
La Cour observe que la Cour administrative suprême ne s’est pas penchée sur le risque évoqué par le requérant, se limitant à dire que les menaces encourues par le requérant et les droits qu’il cherchait à protéger n’étaient pas clairs. Ainsi, elle ne s’est pas livrée à une évaluation de la situation générale en Syrie. En outre, la suspension de la mesure d’expulsion – demandée par le requérant – a été rejetée, notamment au motif que l’intéressé représentait une menace pour la sécurité nationale. Pour ce qui est de la procédure sur la demande d’octroi du statut de réfugié ou du statut humanitaire, en cas d’issue favorable pour le requérant, celui-ci aurait été protégé contre une éventuelle expulsion. Toutefois, cette procédure n’avait pas pour but de contrôler la légalité de l’arrêté de l’expulsion, ni son effet dans le contexte des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. En tout état de cause, la Cour administrative suprême, tout en notant l’existence d’une situation grave et généralisée en Syrie, a appliqué la législation nationale selon laquelle l’argument lié à la menace pour la sécurité nationale prévalait sur la présence d’une situation de risque dans le pays de destination pour fonder sa décision de refus d’octroi du statut. Ce recours n’était donc pas à même de trancher la question du risque. Par ailleurs, le Gouvernement n’invoque pas d’autres recours disponibles en droit bulgare à cet effet. Ainsi, selon la législation en l’état actuel, le requérant n’aurait pas pu obtenir autrement un examen effectif de ces griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.
CEDH
RECEVABILITE
a) Le délai de six mois
32. Le Gouvernement objecte que le requérant n’a pas respecté la règle des six mois (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de traiter une objection similaire dans deux affaires dirigées contre la Suède, P.Z. et autres et B.Z. (nos 68194/10 et 74352/11, décisions du 29 mai 2012), dans lesquelles elle a jugé ce qui suit (§§ 34 et 32 respectivement) :
« Alors que (...) la date de la décision interne définitive assurant un recours effectif constitue normalement le point de départ pour le calcul du délai de six mois, la Cour rappelle (...) que la responsabilité de l’État d’envoi découlant des articles 2 et 3 de la Convention est engagée, en règle générale, seulement au moment de la réalisation de la mesure visant à éloigner l’individu concerné de son territoire. Des dispositions spécifiques de la Convention devraient être interprétées et comprises dans le contexte d’autres dispositions, ainsi que des questions pertinentes dans un type particulier d’affaires. La Cour juge dès lors que les considérations relatives à la détermination de la date de la responsabilité de l’État d’envoi doivent s’appliquer également dans le contexte de la règle des six mois.
En d’autres termes, la date de la responsabilité de l’État sous l’angle des articles 2 et 3 correspond à la date à laquelle le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 commence à courir pour le requérant. Si une décision d’éloignement n’a pas été exécutée et l’individu demeure sur le territoire de l’État souhaitant l’éloigner (...) le délai de six mois n’a pas encore commencé à courir. »
33. La Cour ne voit pas de raison de s’éloigner de ce raisonnement dans la présente affaire. Il convient dès lors de rejeter l’objection de tardiveté soulevée par le Gouvernement au regard de l’article 35 § 1 de la Convention.
b) Le statut de victime
34. Ensuite, le gouvernement défendeur formule une objection d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime (paragraphe 26 ci‑dessus). Il met en avant, sans référence à la réglementation applicable, que l’arrêté d’expulsion n’est plus valide depuis le 6 novembre 2018 (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour remarque que l’arrêté lui-même ne prévoyait pas de date limite pour l’exécution de la mesure. Elle ne peut pas non plus conclure, à la lecture de la législation nationale applicable, à l’existence d’une durée de validité d’une décision administrative d’expulsion, même si celle-ci n’a pas été exécutée (paragraphes 9 et 19 ci‑dessus, avec les références qui y sont citées). Ce constat est confirmé par la lettre de la direction « Migration » du ministère des Affaires intérieures du 13 décembre 2018 (paragraphe 18 ci‑dessus). D’ailleurs, il ressort de l’arrêté du 6 novembre 2013 que seule la mesure d’interdiction du territoire est limitée dans le temps pour le requérant, celle-ci ayant été fixée expressément à cinq ans. La Cour doit conclure, dans ces circonstances, qu’au regard du droit interne et à la lumière des documents dont elle dispose, que l’arrêté litigieux, ayant été confirmé par la Cour administrative suprême, est devenu définitif et exécutoire. Bien qu’adopté il y a plus de cinq ans, il continue à avoir une valeur juridique entière et la suspension de son effet a été expressément refusée par les autorités (paragraphe 12 ci‑dessus). De plus, le requérant ayant obtenu la délivrance d’un passeport, il peut être renvoyé vers la Syrie (paragraphe 17 ci‑dessus).
35. Partant, en dépit de la reconnaissance formulée par le Gouvernement que la réalisation de l’expulsion emporterait une violation des articles 2 et 3 de la Convention (paragraphe 29 ci-dessus), les conséquences de l’arrêté de l’expulsion ne sont pas effacées de sorte que l’on puisse considérer que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Dès lors, la Cour rejette l’objection du Gouvernement formulée à ce titre.
c) Sur l’application de l’article 37 de la Convention
36. Le Gouvernement soutient également que la requête doit être considérée irrecevable au motif qu’aucun acte de mise en œuvre de l’expulsion n’a été engagé depuis l’établissement de l’arrêté litigieux (paragraphe 29 ci-dessus). Il convient d’analyser ce point comme une demande de radiation de la requête du rôle selon l’article 37 § 1 c) de la Convention. Pour estimer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, la Cour doit constater qu’il ressort clairement des informations dont elle dispose que le requérant ne risque plus, ni à présent ni avant longtemps, d’être expulsé et soumis à un traitement contraire aux dispositions de la Convention, et qu’il a la possibilité de contester devant les autorités nationales, et le cas échéant devant la Cour, une éventuelle nouvelle mesure d’éloignement. La Cour a en effet toujours envisagé la question sous l’angle d’une violation potentielle de la Convention et, dans la mesure où la menace d’une telle violation disparaît ou n’est plus imminente, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus, sous réserve de l’application de l’article 37 § 1 in fine (voir, Khan c. Allemagne [GC], no 38030/12, §§ 33‑35, 21 septembre 2016, et les affaires qui y sont citées, ainsi que M.M. c. Bulgarie, précité, §§ 37-38).
37. En l’espèce, la Cour note d’abord qu’elle vient de conclure que le requérant peut encore se prétendre victime des violations alléguées en raison de l’existence à son encontre d’un arrêté d’expulsion valide et exécutable (paragraphes 34 et 35 ci-dessus).
38. Elle observe aussi que, à la suite de la mesure provisoire qu’elle a indiquée aux autorités bulgares en application de l’article 39 de son règlement, l’exécution de la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant a été suspendue.
39. Devant la Cour, le Gouvernement présente des observations ambiguës quant à sa position sur l’éventuelle expulsion du requérant. D’une part, il affirme qu’aucune donnée du dossier ne permet de croire que le requérant ferait l’objet d’un acte d’expulsion et semble se référer aux informations relatant une situation générale instable en Syrie sans toutefois en tirer expressément de conclusions (paragraphe 29 ci-dessus). D’autre part, il explique que requérant ne courrait pas de risque s’il retournait dans son pays d’origine (paragraphe 28 ci-dessus). Par ailleurs, la lettre de la direction «Migration » du ministère des Affaires intérieures du 13 décembre 2018 semble évoquer comme motif de non-réalisation de l’expulsion la mesure provisoire indiquée par la Cour (paragraphe 18 ci‑dessus). Dans ces circonstances, la Cour ne peut considérer les déclarations formulées dans les observations du gouvernement défendeur comme un engagement sérieux à ne pas renvoyer le requérant vers la Syrie. Il convient en particulier de distinguer la présente affaire de l’arrêt M.M. c. Bulgarie (précité). Dans cette dernière affaire, le Gouvernement a fourni des assurances expresses pour un engagement obligatoire de non-renvoi. Il avait notamment produit des lettres formelles émanant des autorités compétentes en matière de migration indiquant précisément que la personne concernée ne ferait pas l’objet d’expulsion, et a informé que celle-ci bénéficiait d’un permis de séjour temporaire valide délivré sur la base d’un statut humanitaire accordé en raison de la situation en Syrie (M.M. c. Bulgarie, précité, §§ 33 et 34, voir aussi Khan, précité, § 37, et Boutagni c. France, no 42360/08, §§ 47-48, 18 novembre 2010, où la Cour a relevé la présence d’assurances expresses de la part des gouvernements défendeurs). Dans la présente affaire, le Gouvernement ne s’est pas formellement engagé à ne pas expulser le requérant mais a simplement émis un avis selon lequel les éléments du dossier ne faisaient pas entendre que l’expulsion en cause serait réalisée. Cet avis, formulé à l’occasion des observations dans la présente affaire, ne se fonde sur aucun acte juridique et n’est reflété dans aucun document formel contraignant, de sorte qu’il n’est pas clair s’il pouvait en soi engager les autorités responsables pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion (Auad, précité, § 105). Par ailleurs, la Cour note que les demandes de protection subsidiaire du requérant ont été rejetées et qu’il ne bénéficie d’aucun titre régularisant son séjour en Bulgarie.
40. Enfin, la Cour note que le gouvernement défendeur n’a pas présenté d’informations permettant de s’assurer que, en cas d’exécution de la mesure d’expulsion, les autorités d’immigration prendraient toutes les garanties contre un refoulement arbitraire du requérant, y compris la possibilité d’un recours juridictionnel.
41. Compte tenu de ces considérations, la Cour conclut que le motif invoqué par le Gouvernement ne justifie pas de mettre fin à la poursuite de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Il n’y a dès lors pas lieu de rayer la requête du rôle.
d) Conclusion quant à la recevabilité
42. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
LE FOND
43. La Cour observe d’abord que les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention se confondent et qu’il convient dès lors de les examiner ensemble (K.A.B. c. Suède, no 886/11, § 67, 5 septembre 2013).
44. Les principes généraux applicables en matière d’éloignement d’étrangers au regard de l’article 3 de la Convention ont été résumés par la Cour dans l’arrêt J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 77-105, 23 août 2016.
45. La Cour souhaite aussi rappeler qu’elle a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Elle est de même parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent à notre époque les États pour protéger leur population de la violence terroriste (voir, parmi d’autres, Lawless c. Irlande (no 3), 1er juillet 1961, § 28-30, série A no 3, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 179, CEDH 2005‑IV, Chahal c. Royaume‑Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 126, CEDH 2009, et A. c. Pays‑Bas, no 4900/06, § 143, 20 juillet 2010). Devant une telle menace, elle considère qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner (Daoudi c. France, no 19576/08, § 65, 3 décembre 2009, Boutagni c. France, no 42360/08, § 45, 18 novembre 2010, Auad, précité, § 95, et A.M. c. France, no 12148/18, § 112, 29 avril 2019).
46. Il convient toutefois de rappeler que la Cour a affirmé que la protection offerte par l’article 3 de la Convention présentant un caractère absolu, pour qu’un éloignement forcé envisagé soit contraire à la Convention, la condition nécessaire – et suffisante – est que le risque pour la personne concernée de subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 3 soit réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés, même lorsqu’elle est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale pour l’État contractant (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 140-141, CEDH 2008, et Auad, précité, § 100). En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que la Cour examine les affirmations selon lesquelles un requérant serait impliqué dans des activités terroristes, car cet aspect des choses n’est pas pertinent dans le cadre de l’analyse sur le terrain de l’article 3, au regard de la jurisprudence actuelle (Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008, et Auad, précité, § 101).
47. En relation avec ce dernier point, la Cour se doit d’observer de suite que toute considération en l’espèce portant sur la question de savoir si le requérant présente un risque pour la sécurité nationale de la Bulgarie est à écarter dans l’analyse des griefs soumis, contrairement aux arguments avancés par le Gouvernement à cet égard (paragraphe 27 ci-dessus). Le point crucial consiste à établir s’il a été démontré en l’occurrence qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant risque d’être exposé à des mauvais traitements ou à la mort si l’arrêté d’expulsion devait être exécuté (Auad, précité, § 101). Pour ce faire, la Cour tiendra compte de l’ensemble des éléments fournis par les parties et de ceux qu’elle s’est procurés d’office (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 116, CEDH 2012.
48. Les allégations du requérant dans la présente affaire sont motivées par le contexte du conflit armé en Syrie, en cours à l’époque de la procédure sur son recours contre l’arrêté d’expulsion du 6 novembre 2013. Il soutient que, en cas de retour dans ce pays, il risquait de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention, d’une part en raison de la situation de violence générale et, d’autre part, à cause de son implication passée dans les deux principaux camps du conflit et de sa désertion de l’armée du gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus).
49. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire devant la Cour (Chahal, précité, § 86). Dès lors que la responsabilité que l’article 3 de la Convention fait peser sur les États contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. L’appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (J.K. et autres c. Suède, précité, § 83, et les affaires qui y sont citées). Quant à l’analyse du risque encouru par le requérant faite par les juridictions internes, la Cour se prononcera sur ce point sous l’angle de l’article 13 de la Convention (paragraphes 63-66 ci‑dessous).
50. Par ailleurs, dans l’arrêt L.M. et autres c. Russie (nos 40081/14 et 2 autres, 15 octobre 2015), la Cour s’est prononcée comme suit :
« La Cour note qu’une situation de violence générale n’emportera normalement pas en soi une violation de l’article 3 en cas d’expulsion (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III) ; toutefois, elle n’a jamais écarté la possibilité qu’une situation générale de violence dans le pays de destination pourrait avoir un degré d’intensité suffisant tel que tout renvoi vers lui emporterait nécessairement une atteinte à l’article 3 de la Convention. Toutefois, la Cour adopterait une telle approche uniquement dans les cas de violence générale les plus extrêmes, où l’individu encourt un risque réel de mauvais traitement du seul fait qu’un retour l’exposait à une telle violence (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 115, 17 juillet 2008). »
51. Dans cet arrêt, la Cour a analysé des griefs similaires à ceux présentés dans la présente espèce concernant la situation en Syrie et a jugé que les circonstances entourant l’affaire (L.M. et autres c. Russie, précité, §§ 123‑126) faisaient apparaître une violation des articles 2 et 3 de la Convention. La Cour a noté qu’à l’époque de cet examen, en 2015, elle n’avait pas encore adopté d’arrêt portant une appréciation sur les allégations de risque lié à un danger de mort ou à des mauvais traitements dans le contexte du conflit en Syrie. Ceci était certainement dû en partie au fait que, tel qu’il ressort des documents pertinents du HCNUR, la plupart des pays européens ne procédaient pas à des renvois forcés vers la Syrie. Dans l’arrêt plus récent S.K. c. Russie (no 52722/15, 14 février 2017), la Cour a observé, sur la base des documents pertinents relatifs à la situation en Syrie et postérieurs à l’arrêt L.M. et autres c. Russie, précité, que la sécurité et la situation humanitaire, ainsi que la nature et la portée des hostilités en Syrie s’étaient dramatiquement détériorées entre 2011 et début 2016. De plus, les rapports disponibles faisaient état d’usage systématique de la force de la part des parties au conflit, ainsi que d’attaques systématiques envers la population civile ou les bâtiments civils, malgré les cessations des hostilités signées en février 2016. Sur la base de ces éléments, la Cour a considéré, à l’instar de l’affaire L.M. et autres c. Russie, précitée, que le renvoi de la personne concernée vers la Syrie constituerait une violation des articles 2 et 3 de la Convention.
52. Eu égard à ces constats, il convient de vérifier les informations sur la situation générale en Syrie lors des circonstances de la présente espèce et au moment de l’examen de l’affaire par la Cour. À cet égard, il est à noter que le Gouvernement présente des observations contradictoires pour ce qui est de l’existence d’un risque pour le requérant dans son pays d’origine. D’une part, le Gouvernement semble affirmer que rien dans le dossier ne démontre que l’histoire du requérant peut être à l’origine d’un risque sérieux pour l’intéressé de se voir poursuivre pénalement ou traiter en violation des dispositions de la Convention. D’autre part, il reconnaît, en s’appuyant sur la décision de la Cour administrative suprême adoptée à la suite de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, que le requérant ne pouvait être renvoyé vers la Syrie, ainsi que sur les informations relatives à la situation actuelle dans ce pays qu’il a recueillies, que, si ce renvoi était réalisé, il y aurait une violation de l’article 3 de la Convention, et éventuellement de l’article 2 (paragraphes 12, 27 et 29). Par ailleurs, l’Agence pour les réfugiés, alors qu’elle examinait les demandes de statut de protection du requérant, a admis que la situation était grave et généralisée en Syrie (paragraphe 14 ci-dessus). Ainsi, la Cour estime que les décisions de l’Agence pour les réfugiés et de la Cour administrative suprême ainsi que les observations du Gouvernement dans le cadre de la présente procédure peuvent être compris comme admettant que la situation générale en Syrie est de nature à justifier une protection sur le terrain des deux dispositions précitées (J.K. et autres c. Suède, précité, § 83, concernant la charge de la preuve pesant sur le gouvernement défendeur pour l’évaluation de la situation générale dans un pays donné).
53. Ces éléments ne peuvent être considérés isolément et la Cour doit les confronter aux informations par ailleurs disponibles sur la situation en Syrie (voir, mutatis mutandis, Auad, précité, §§ 102-103). À cet égard, compte tenu de ses constats à l’occasion de l’affaire S.K. (arrêt précité, §§ 60-61) et des informations pertinentes récentes qu’elle a obtenues, la Cour observe, pour sa part, que la sécurité et la situation humanitaire, ainsi que la nature et la portée des hostilités en Syrie, ont subi une détérioration dramatique durant la période comprise entre l’arrivée du requérant en Bulgarie en juin 2013 et l’arrêt définitif confirmant l’arrêté d’expulsion en août 2014, mais aussi entre cette dernière date et le refus d’octroi d’une protection à l’intéressé (paragraphes 21-23 ci‑dessus). De plus, cette situation semble perdurer à ce jour.
54. En effet, sur le plan du contexte général, les éléments d’information disponibles contiennent les indications suivantes : malgré une baisse générale des hostilités, les parties au conflit poursuivent d’intenses combats et se livrent à des attaques indiscriminées, y compris envers la population civile et les infrastructures civiles, à des pillages et à des persécutions. Face à cette situation, en novembre 2017, le HCNUR a lancé un appel général aux États de ne pas procéder au renvoi forcé des ressortissants syriens eu égard au fait que toutes les régions du pays sont affectées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs conflits (paragraphe 23 ci-dessus). De plus, des arrestations et des détentions arbitraires de masse ont eu lieu encore récemment, début 2019, près de Homs, la ville d’origine du requérant. Pour ce qui est du risque individuel auquel le requérant est exposé, la Cour note que celui-ci craint des mauvais traitements en raison de sa désertion alléguée de l’armée syrienne. Elle observe aussi que rien dans les décisions internes et les observations du Gouvernement n’indique que les autorités bulgares estiment la version du requérant comme non crédible. Tenant compte de cet élément, la Cour doit remarquer tout particulièrement l’existence de pratiques d’exécution, de détention arbitraire ou des mauvais traitements à l’égard des personnes ayant déserté l’armée ou ayant refusé d’exécuter des ordres de tir (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Enfin, cette analyse quant au risque individuel encouru par le requérant en Syrie a été opérée par la Cour administrative suprême dans ses décisions du 21 mars 2014 et du 15 mai 2014 (paragraphe 12 ci-dessus), ainsi que par le Gouvernement dans ses observations en l’espèce (paragraphe 27 ci-dessus).
55. La Cour estime, à la lumière du contexte décrit ci-dessus, qu’il ne peut être établi, eu égard aux allégations du requérant selon lesquelles il subirait des mauvais traitements en raison de sa désertion de l’armée, que celui-ci peut retourner en Syrie, dans la ville de Homs ou ailleurs dans le pays, en sécurité.
56. Elle conclut que le renvoi du requérant de la Bulgarie vers la Syrie, sur le fondement de l’arrêté d’expulsion du 6 novembre 2013, confirmé par la Cour administrative suprême le 6 août 2014, s’il était effectué, emporterait une violation des articles 2 et 3 de la Convention.
ARTICLE 13 COMBINE AUX ARTICLES 2 ET 3
60. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
61. Concernant le fond du grief, compte tenu de ses constats dans les paragraphes 48-56 ci-dessus, la Cour estime que les griefs du requérant sont défendables, de sorte que ce dernier avait le droit à un recours effectif à cet égard. L’effectivité d’un recours dans de telles circonstances comprend deux éléments. D’abord, elle demande impérativement un contrôle attentif, indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 293, CEDH 2011, et les affaires qui y sont citées, et Auad, précité, § 120). Cet examen ne doit pas tenir compte de ce que l’intéressé a pu faire pour justifier une expulsion ni de la menace à la sécurité nationale éventuellement perçue par l’État qui expulse (Chahal, précité, § 151). La deuxième exigence requiert que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (Auad, précité, § 120, et les affaires qui y sont citées). Ainsi, la Cour précise que, contrairement à ce que suggère le Gouvernement (paragraphe 58 ci-dessus), il s’agit d’un contrôle différent de celui requis sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Il n’est dès lors pas pertinent, en l’occurrence, d’établir si la Cour administrative suprême a soumis l’affirmation que le requérant représente une menace pour la sécurité nationale à un véritable examen ou si elle a opéré un contrôle de proportionnalité de l’expulsion (C.G. et autres c. Bulgarie, no 1365/07, §§ 60-64, 24 avril 2008, et Raza c. Bulgarie, no 31465/08, § 63, 11 février 2010).
62. La Cour rappelle ensuite que, dans l’affaire Auad précitée, elle a conclu que la procédure sur l’arrêté d’expulsion du requérant ne pouvait être vue comme un recours effectif pour des allégations tirées de l’article 3 de la Convention. Elle a tenu compte, notamment, du refus de la Cour administrative suprême d’examiner la question du risque, considérant que celle-ci n’était pas pertinente, ainsi que de l’absence en droit interne d’un effet suspensif automatique des arrêtés d’expulsion fondés sur un motif lié à la protection de la sécurité nationale (Auad, précité, § 121).
63. Dans la présente affaire, la Cour observe que, dans son arrêt du 6 août 2014, la Cour administrative suprême a analysé essentiellement les constats de l’Agence pour la sécurité nationale et le respect du droit national dans l’établissement de l’arrêté d’expulsion. En revanche, elle ne s’est pas penchée sur le risque évoqué par le requérant, se limitant à dire que les menaces encourues par le requérant et les droits qu’il cherchait à protéger n’étaient pas clairs (paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi, elle ne s’est pas livrée à une évaluation de la situation générale en Syrie, alors même que la décision de cette même cour sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion suggérait qu’une telle évaluation devait être réalisée dans le cadre de l’examen au fond (paragraphe 12 ci-dessus). De même, la Cour note que, la législation applicable n’ayant pas été modifiée depuis l’arrêt Auad précité, le requérant n’a pas bénéficié d’un effet suspensif sur la mesure d’expulsion dans le cadre de la procédure judiciaire. Quoi qu’il en soit, la suspension demandée par le requérant a été rejetée, notamment au motif que ce dernier représentait une menace pour la sécurité nationale (paragraphe 12 ci‑dessus).
64. Pour ce qui est de la procédure sur la demande d’octroi du statut de réfugié ou du statut humanitaire, il est vrai que, en cas d’issue favorable pour le requérant, celui-ci aurait été protégé contre une éventuelle expulsion. Toutefois, cette procédure n’avait pas pour but de contrôler la légalité de l’arrêté de l’expulsion, ni son effet dans le contexte des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. En tout état de cause, il convient d’observer que, en l’occurrence, la Cour administrative suprême, tout en notant l’existence d’une situation grave et généralisée en Syrie, a appliqué la législation nationale selon laquelle l’argument lié à la menace pour la sécurité nationale prévalait sur la présence d’une situation de risque dans le pays de destination pour fonder sa décision de refus d’octroi du statut. Ce recours n’était donc pas à même, en l’espèce, de trancher la question du risque.
65. La Cour note par ailleurs que le Gouvernement n’invoque pas d’autres recours disponibles en droit bulgare à cet effet. Elle observe que, selon la législation en l’état actuel, le requérant n’aurait pas pu obtenir autrement un examen effectif de ces griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention (Auad, précité, § 122).
66. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention à cet égard.
LM et autres c. Russie 15 octobre 2015 requêtes nos 40081/14, 40088/14 et 40127/14
La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité : qu’un renvoi des requérants en Syrie emporterait violation de l’article 2 (droit à la vie) et/ou de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 5 § 4 (droit à un examen à bref délai par un juge de la régularité de la détention) de la Convention ; et que la Russie a >manqué aux obligations que lui impose l’article 34 (droit de recours individuel).
C’est la première fois que la CEDH se prononce dans un arrêt sur la question des renvois en Syrie dans la situation actuelle. Elle juge que, vu les rapports internationaux relatifs à la crise en Syrie et les informations supplémentaires relatives à la situation individuelle des requérants, ceux-ci étaient fondés à dire qu’un retour en Syrie les aurait exposés à un risque réel pour leur vie et leur sécurité personnelle.
Eu égard à sa conclusion selon laquelle la privation de liberté des requérants depuis la dernière décision des juridictions russes (mai 2014) confirmant leur expulsion était contraire à l’article 5, la CEDH dit, en vertu de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), que la Russie doit assurer la libération immédiate des deux requérants qui demeurent privés de liberté.
En ce qui concerne la recevabilité des griefs, la CEDH rejette une exception soulevée par le gouvernement russe, qui soutenait que les requérants avaient manqué à épuiser les voies de recours internes car au moment où ils avaient introduit leur requête, leurs demandes respectives d’octroi du statut de réfugié et/ou de l’asile temporaire n’avaient pas encore été examinées en dernier ressort.
La CEDH note en particulier que les décisions du 27 mai 2014 par lesquelles le tribunal régional a confirmé les ordonnances d’expulsion sont définitives et demeurent applicables aux trois requérants. La procédure engagée par les intéressés afin d’obtenir le statut de réfugié et l’asile n’a pas abouti ou n’est pas terminée. De plus, certaines particularités de l’enfermement des requérants au centre de rétention les ont empêchés de participer effectivement à la procédure d’examen de leur demande d’octroi du statut de réfugié et de l’asile.
En ce qui concerne la violation alléguée de la Convention dans le cas où les requérants seraient renvoyés en Syrie, la Cour juge que les intéressés ont présenté aux autorités russes des motifs substantiels de croire qu’ils seraient exposés à un risque réel pour leur vie et pour leur sécurité personnelle s’ils étaient expulsés. Dans le cadre de la procédure qu’ils ont engagée pour contester les ordonnances d’expulsion prononcées à leur encontre, ils ont dit être originaires d’Alep et de Damas, où de lourds combats tuant aveuglément font rage depuis 2012. Lors de la procédure d’examen de leur demande d’octroi du statut de réfugié, ils ont donné des informations supplémentaires individualisées quant aux risques qu’ils courraient en cas de retour en Syrie. De plus, la nécessité d’octroyer la protection internationale aux demandeurs d’asile originaires de Syrie a été reconnue dans un rapport du Service fédéral russe des migrations.
La Cour n’est pas convaincue que les allégations des requérants aient été dûment examinées par les autorités russes, dans quelque procédure que ce soit. Dans le cadre de la procédure qui s’est soldée par une ordonnance d’expulsion, l’examen réalisé par les juridictions internes a consisté pour l’essentiel à établir que les requérants se trouvaient en situation de séjour irrégulier en Russie. Le tribunal de district et le tribunal régional ont l’un comme l’autre évité de répondre de manière approfondie aux allégations des requérants selon lesquelles ils auraient été en danger en Syrie et d’examiner les nombreuses sources internationales d’informations sur la situation qui règne actuellement dans ce pays. La Cour souligne que, compte tenu de la nature absolue de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants posée à l’article 3, il n’est pas possible de mettre en balance le risque de tels traitements avec les raisons militant en faveur d’un éloignement. Elle juge le traitement réservé par les tribunaux russes au cas des requérants d’autant plus regrettable qu’il y a déjà eu en Russie, y compris devant la Cour suprême, des affaires où les tribunaux ont accordé suffisamment de poids à des arguments analogues : dans ces affaires où des étrangers accusés d’infractions administratives aux règles de l’immigration arguaient qu’ils auraient risqué d’être maltraités s’ils avaient été renvoyés dans leur pays d’origine, les juges ont tenu compte de ce risque et levé les mesures d’expulsion.
La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas encore rendu d’arrêt dans lequel elle aurait examiné des allégations de danger de mort ou de risque de mauvais traitements dans le contexte du conflit qui fait rage en Syrie. Cela est sans doute dû en partie au fait que la plupart des pays européens s’abstiennent actuellement de renvoyer des individus en Syrie. En octobre 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a approuvé les pratiques appliquées par plusieurs pays européens en matière de protection à l’égard des ressortissants syriens, notamment les moratoires de facto sur les renvois en Syrie. Les derniers rapports des Nations unies qualifiaient la situation de « crise humanitaire » et faisaient état d’une « souffrance incommensurable » des civils, de violations massives des droits de l’homme par toutes les parties et du déplacement de près de la moitié de la population du pays en raison de cette situation.
Les requérants sont originaires d’Alep et de Damas, où des combats particulièrement intenses font rage. M.A. a déclaré que ses proches avaient été tués par des miliciens armés qui avaient pris le contrôle du quartier où il vivait et qu’il craignait d’être tué lui aussi. L.M. est un Palestinien apatride.
Selon le HCR, « presque toutes les régions où se trouvent un nombre important de réfugiés palestiniens sont directement touchées par le conflit ». Le HCR considère que ces réfugiés doivent se voir accorder la protection internationale.
La Cour conclut que l’allégation portée par les requérants selon laquelle leur renvoi en Syrie emporterait violation de l’article 2 et/ou de l’article 3 de la Convention est fondée. Le gouvernement russe n’a présenté aucune information de nature à réfuter cette allégation, ni fait état d’autres circonstances spéciales de nature à garantir que les requérants seraient suffisamment protégés s’ils étaient renvoyés en Syrie.
En conséquence, le renvoi des requérants en Syrie emporterait violation des articles 2 et/ou 3 de la Convention.
La CEDH n’estime pas nécessaire d’examiner séparément les griefs que les requérants tiraient de l’article 13.
En ce qui concerne le grief qu’ils formulaient sur le terrain de l’article 3 quant à leurs conditions de détention, la Cour estime, à la lumière des documents communiqués par les parties, que ces conditions ne font pas apparaître de violation de la Convention. Elle déclare donc cette partie de la requête irrecevable.
Article 5
La CEDH a déjà constaté des violations de l’article 5 § 4 dans plusieurs affaires dirigées contre la Russie en raison de l’absence en droit interne de toute disposition permettant aux justiciables de demander le contrôle juridictionnel des mesures ordonnant leur privation de liberté dans l’attente de leur éloignement. De même, les requérants de la présente affaire n’ont pas disposé d’une procédure de contrôle juridictionnel de la régularité de leur privation de liberté. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4 à l’égard des trois requérants.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 1, la CEDH estime établi que la première mesure de privation de liberté des requérants dans l’attente de leur expulsion avait été ordonnée par le tribunal de district pour une infraction passible de l’expulsion et qu’elle était donc conforme au droit national. De plus, pendant cette première période de privation de liberté, les autorités recherchaient encore si l’éloignement des requérants était possible. Cependant, les requérants ont ensuite communiqué au tribunal régional des informations, corroborées par les sources russes pertinentes, suffisantes pour démontrer qu’ils ne devaient pas être renvoyés en Syrie. Or le tribunal régional n’a pas répondu à leurs allégations à cet égard et a tout simplement confirmé les ordonnances d’expulsion. En conséquence, après les décisions du 27 mai 2014, on ne pouvait plus dire que les requérants étaient des personnes « contre [lesquelles] une procédure d’expulsion ou d’extradition [était] en cours » au sens de l’article 5 § 1 f). Même si aucune mesure concrète n’a été prise depuis mai 2014 pour les expulser, ils sont demeurés en détention sans que cette mesure soit assortie d’une limite temporelle. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1.
Article 34
En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 34, la CEDH observe que les requérants se sont vu refuser la possibilité de rencontrer leurs avocats et leurs représentants. Ils ont en outre allégué avoir été contraints de signer sans les comprendre des déclarations en russe par lesquelles ils retiraient leur demande d’asile. Une fois informés du sens de ces déclarations, ils se sont rétractés. La Cour note avec préoccupation que les autorités compétentes n’ont eu aucune réaction significative face à ces griefs. De plus, elle dispose d’éléments suffisants pour conclure que la communication des requérants avec leurs représentants a été gravement entravée. Elle considère que ces restrictions ont constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit de recours individuel et que, dès lors, la Russie a manqué aux obligations que lui impose l’article 34.
Arrêt de GRANDE CHAMBRE
Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012 Requête no 27765/09
A. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention du fait que les requérants ont été exposés au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en Libye
a) Sur la recevabilité
110. Le Gouvernement considère que les requérants ne sauraient se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention, des faits qu’ils dénoncent. Il conteste l’existence d’un risque réel, pour les requérants, d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants à la suite de leur refoulement. L’évaluation d’un tel danger devrait se faire sur la base de faits sérieux et avérés concernant la situation de chaque requérant. Or, les informations fournies par les intéressés seraient vagues et insuffisantes.
111. La Cour estime que la question soulevée par cette exception est étroitement liée à celles qu’elle devra aborder lors de l’examen du bien-fondé des griefs tirés de l’article 3 de la Convention. Cette disposition impose notamment à la Cour d’établir s’il y avait des motifs sérieux et avérés de croire que les intéressés couraient un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants à la suite de leur renvoi. Il convient dès lors de joindre cette question à l’examen du fond.
112. La Cour considère que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit complexes, qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen au fond ; il s’ensuit qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé, il y a lieu de la déclarer recevable.
b) Sur le fond
i. Principes généraux
α) Responsabilité des Etats contractants en cas d’expulsion
113. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris de la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94 ; et Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI). La Cour note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 102, série A no 215 ; et Ahmed c. Autriche, 17 décembre 1996, § 38, Recueil 1996-VI).
114. Cependant, l’expulsion, l’extradition ou toute autre mesure d’éloignement d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Soering, précité, §§ 90-91 ; Vilvarajah et autres, précité, § 103 ; Ahmed, précité, § 39 ; H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 34, Recueil 1997-III ; Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 38, CEDH 2000-VIII ; et Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 135, 11 janvier 2007).
115. Dans ce type d’affaires, la Cour est donc appelée à apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’Etat contractant, du chef d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à un risque de mauvais traitements prohibés (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 126, 28 février 2008).
β) Eléments retenus pour évaluer le risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention
116. Pour déterminer l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (H.L.R. c. France, précité, § 37 ; et Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 60, CEDH 2001-II). Dans des affaires telles que la présente espèce, la Cour se doit en effet d’appliquer des critères rigoureux en vue d’apprécier l’existence d’un tel risque (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil 1996-V).
117. Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi d’un requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé (Vilvarajah et autres, précité, § 108 in fine).
118. Dans ce but, en ce qui concerne la situation générale dans un pays, la Cour a souvent attaché de l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de sources gouvernementales (voir, par exemple, Chahal, précité, §§ 99-100 ; Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 67, 26 avril 2005 ; Said c. Pays-Bas, no 2345/02, § 54, CEDH 2005-VI ; Al-Moayad c. Allemagne (déc.), no 35865/03, §§ 65-66, 20 février 2007 ; et Saadi, précité, § 131).
119. Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, le cas échéant à l’aide des sources mentionnées au paragraphe précédent, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (voir, mutatis mutandis, Salah Sheekh, précité, §§ 138-149).
120. En raison du caractère absolu du droit garanti, il n’est pas exclu que l’article 3 trouve aussi à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée (H.L.R. c. France, précité, § 40).
121. Pour ce qui est du moment à prendre en considération, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’éloignement.
ii. Application en l’espèce
122. La Cour a déjà eu l’occasion de reconnaître que les Etats situés aux frontières extérieures de l’Union européenne rencontrent actuellement des difficultés considérables pour faire face à un flux croissant de migrants et de demandeurs d’asile. Elle ne saurait sous-estimer le poids et la pression que cette situation fait peser sur les pays concernés, d’autant plus lourds qu’elle s’inscrit dans un contexte de crise économique (voir M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 223, 21 janvier 2011). En particulier, elle est consciente des difficultés liées au phénomène des migrations maritimes, impliquant pour les Etats des complications supplémentaires dans le contrôle des frontières du sud de l’Europe.
Toutefois, vu le caractère absolu des droits garantis par l’article 3, cela ne saurait exonérer un Etat de ses obligations au regard de cette disposition.
123. La Cour rappelle que la protection contre les traitements prohibés par l’article 3 impose à un Etat l’obligation de ne pas éloigner une personne lorsqu’elle court dans l’Etat de destination un risque réel d’être soumise à de tels traitements.
Elle constate que les nombreux rapports d’organes internationaux et d’organisations non gouvernementales décrivent une situation préoccupante quant au traitement réservé en Libye aux immigrés clandestins à l’époque des faits. Les conclusions desdits documents sont par ailleurs corroborées par le rapport du CPT en date du 28 avril 2010 (paragraphe 35 ci-dessus).
124. La Cour observe au passage que la situation en Libye s’est par la suite dégradée, après la fermeture du bureau du HCR de Tripoli, en avril 2010, puis la révolte populaire qui a éclaté dans le pays en février 2011. Toutefois, aux fins de l’examen de la présente affaire, elle se référera à la situation qui prévalait dans ce pays à l’époque des faits.
125. Selon les divers rapports susmentionnés, durant la période concernée aucune règle de protection des réfugiés n’était respectée en Libye ; toutes les personnes entrées dans le pays par des moyens irréguliers étaient considérées comme des clandestins, sans distinction aucune entre les migrants irréguliers et les demandeurs d’asile. En conséquence, ces personnes étaient systématiquement arrêtées et détenues dans des conditions que les visiteurs extérieurs, telles les délégations du HCR, de Human Rights Watch, et d’Amnesty International, n’hésitent pas à qualifier d’inhumaines. De nombreux cas de torture, de mauvaises conditions d’hygiène et d’absence de soins médicaux appropriés ont été dénoncés par l’ensemble des observateurs. Les clandestins risquaient à tout moment d’être refoulés vers leur pays d’origine et, lorsqu’ils parvenaient à retrouver la liberté, ils étaient exposés à des conditions de vie particulièrement précaires du fait de leur situation irrégulière. Les immigrés irréguliers, comme les requérants, étaient destinés à occuper dans la société libyenne une position marginale et isolée, qui les rendait extrêmement vulnérables aux actes xénophobes et racistes (paragraphes 35-41 ci-dessus).
126. Or, il ressort clairement de ces mêmes rapports que les migrants clandestins débarqués en Libye à la suite de leur interception en haute mer par l’Italie, tels que les requérants, n’échappaient pas à ces risques.
127. Face au tableau préoccupant brossé par les différentes organisations internationales, le gouvernement défendeur maintient que la Libye était, à l’époque des faits, un lieu de destination « sûr » pour les migrants interceptés en haute mer.
Il étaye sa conviction sur la présomption que la Libye aurait respecté ses engagements internationaux en matière d’asile et de protection des réfugiés, y compris le principe de non-refoulement. Il fait valoir que le Traité d’amitié italo-libyen de 2008, en vertu duquel les refoulements de clandestins ont été effectués, prévoyait expressément le respect des dispositions de droit international en matière de protection des droits de l’homme, tout comme des autres conventions internationales auxquelles la Libye était partie.
128. A cet égard, la Cour observe que le non-respect par la Libye de ses obligations internationales était une des réalités dénoncées par les rapports internationaux concernant ce pays. En tout état de cause, la Cour ne peut que rappeler que l’existence de textes internes et la ratification de traités internationaux garantissant le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque, comme en l’espèce, des sources fiables font état de pratiques des autorités – ou tolérées par celles-ci – manifestement contraires aux principes de la Convention (voir M.S.S., précité, § 353 et, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 147).
129. Par ailleurs, la Cour observe que l’Italie ne saurait se dégager de sa propre responsabilité en invoquant ses obligations découlant des accords bilatéraux avec la Libye. En effet, à supposer même que lesdits accords prévoyaient expressément le refoulement en Libye des migrants interceptés en haute mer, les Etats membres demeurent responsables même lorsque, postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles à leur égard, ils ont assumé des engagements découlant de traités (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 47, CEDH 2001-VIII ; et Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, § 128, 2 mars 2010).
130. Quant à l’argument du Gouvernement tiré de la présence d’un bureau du HCR à Tripoli, force est de constater que l’activité du Haut-Commissariat, même avant sa cessation définitive en avril 2010, n’a jamais bénéficié de quelque forme de reconnaissance que ce soit de la part du gouvernement libyen. Il ressort des documents examinés par la Cour que le statut de refugié reconnu par le HCR ne garantissait aucune forme de protection aux personnes concernées en Libye.
131. La Cour relève une fois encore que cette réalité était notoire et facile à vérifier à partir de sources multiples. Dès lors, elle estime qu’au moment d’éloigner les requérants, les autorités italiennes savaient ou devaient savoir que ceux-ci, en tant que migrants irréguliers, seraient exposés en Libye à des traitements contraires à la Convention et qu’ils ne pourraient accéder à aucune forme de protection dans ce pays.
132. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas évoqué de façon suffisamment explicite les risques encourus en Libye, dès lors qu’ils n’ont pas demandé l’asile auprès des autorités italiennes. Le simple fait que les requérants se soient opposés à leur débarquement sur les côtes libyennes ne saurait selon lui être considéré comme une demande de protection faisant peser sur l’Italie une obligation en vertu de l’article 3 de la Convention.
133. La Cour observe tout d’abord que cette circonstance est contestée par les intéressés, lesquels ont affirmé avoir fait part aux militaires italiens de leur intention de demander une protection internationale. D’ailleurs, la version des requérants est corroborée par les nombreux témoignages recueillis par le HCR et Human Rights Watch. Quoi qu’il en soit, la Cour considère qu’il appartenait aux autorités nationales, face à une situation de non-respect systématique des droits de l’homme telle que celle décrite ci-dessus, de s’enquérir du traitement auquel les requérants seraient exposés après leur refoulement (voir, mutatis mutandis, Chahal c. Royaume-Uni, précité, §§ 104 et 105 ; Jabari, précité, §§ 40 et 41 ; et M.S.S., précité, § 359). Le fait que les intéressés aient omis de demander expressément l’asile, eu égard aux circonstances de l’espèce, ne dispensait pas l’Italie de respecter ses obligations au titre de l’article 3.
134. A cet égard, la Cour relève qu’aucune des dispositions de droit international citées par le Gouvernement ne justifiait le renvoi des requérants vers la Libye, dans la mesure où tant les normes en matière de secours aux personnes en mer que celles concernant la lutte contre la traite de personnes imposent aux Etats le respect des obligations découlant du droit international en matière de refugiés, dont le « principe de non-refoulement » (paragraphe 23 ci-dessus).
135. Ce principe de non-refoulement est également consacré par l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. A cet égard, la Cour attache un poids particulier au contenu de la lettre écrite le 15 mai 2009 par M. Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne, dans laquelle celui-ci réitère l’importance du respect du principe de non-refoulement dans le cadre d’opérations menées en haute mer par les Etats membres de l’Union européenne (paragraphe 34 ci-dessus).
136. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, des faits sérieux et avérés permettent de conclure qu’il existait un risque réel pour les intéressés de subir en Libye des traitements contraires à l’article 3. La circonstance que de nombreux immigrés irréguliers en Libye étaient dans la même situation que les requérants ne change rien au caractère individuel du risque allégué, dès lors qu’il s’avère suffisamment concret et probable (voir, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 132).
137. Se fondant sur ces conclusions et les devoirs qui pèsent sur les Etats en vertu de l’article 3, la Cour estime qu’en transférant les requérants vers la Libye, les autorités italiennes les ont exposés en pleine connaissance de cause à des traitements contraires à la Convention.
138. Dès lors, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement ayant trait au défaut de la qualité de victime des requérants et de conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention du fait que les requérants ont été exposés au risque d’être rapatriés arbitrairement en Erythrée et en Somalie
146. La Cour rappelle le principe selon lequel le refoulement indirect d’un étranger laisse intacte la responsabilité de l’Etat contractant, lequel est tenu, conformément à une jurisprudence bien établie, de veiller à ce que l’intéressé ne se trouve pas exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de rapatriement (voir, mutatis mutandis, T.I. c. Royaume-Uni (déc.), no 43844/98, CEDH 2000-III, et M.S.S., précité, § 342).
147. Il appartient à l’Etat qui procède au refoulement de s’assurer que le pays intermédiaire offre des garanties suffisantes permettant d’éviter que la personne concernée ne soit expulsée vers son pays d’origine sans une évaluation des risques qu’elle encourt. La Cour observe que cette obligation est d’autant plus importante lorsque, comme en l’espèce, le pays intermédiaire n’est pas un Etat partie à la Convention.
148. Dans la présente affaire, la tâche de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur la violation de la Convention en cas de rapatriement des requérants, mais à rechercher s’il existait des garanties suffisantes permettant d’éviter que les intéressés ne soient soumis à un refoulement arbitraire vers leurs pays d’origine, dès lors qu’ils pouvaient faire valoir de façon défendable que leur rapatriement éventuel porterait atteinte à l’article 3 de la Convention.
149. La Cour dispose d’un certain nombre d’informations sur la situation générale en Erythrée et en Somalie, pays d’origine des requérants, produites par les intéressés et les tiers intervenants (paragraphes 43 et 44 ci-dessus).
150. Elle observe que, selon le HCR et Human Rights Watch, les personnes rapatriées de force en Erythrée courent le risque d’être confrontées à la torture et d’être détenues dans des conditions inhumaines du seul fait qu’elles ont quitté irrégulièrement le pays. Quant à la Somalie, dans la récente affaire Sufi et Elmi (précitée), la Cour a constaté la gravité du niveau de violence atteint à Mogadiscio et le risque élevé pour les personnes renvoyées dans ce pays d’être amenées soit à transiter par les zones touchées par le conflit armé soit à chercher refuge dans les camps pour personnes déplacées ou pour réfugiés, où les conditions de vie sont désastreuses.
151. La Cour estime que l’ensemble des informations en sa possession montre que prima facie la situation en Somalie et en Erythrée a posé et continue de poser de graves problèmes d’insécurité généralisée. Ce constat n’est d’ailleurs pas contesté devant la Cour.
152. En conséquence, les requérants pouvaient, de manière défendable, faire valoir que leur rapatriement porterait atteinte à l’article 3 de la Convention. Il s’agit à présent de rechercher si les autorités italiennes pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que la Libye présentât des garanties suffisantes contre les rapatriements arbitraires.
153. La Cour observe tout d’abord que la Libye n’a pas ratifié la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. En outre, les observateurs internationaux font état de l’absence de toute forme de procédure d’asile et de protection des réfugiés dans le pays. A cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que la présence du HCR à Tripoli n’est guère une garantie de protection des demandeurs d’asile, en raison de l’attitude négative des autorités libyennes, qui ne reconnaissent aucune valeur au statut de réfugié (paragraphe 130 ci-dessus).
154. Dans ces conditions, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel l’action du HCR représenterait une garantie contre les rapatriements arbitraires. De surcroît, Human Rights Watch et le HCR ont dénoncé plusieurs précédents de retours forcés de migrants irréguliers vers des pays à risque, migrants parmi lesquels se trouvaient des demandeurs d’asile et des réfugiés.
155. Dès lors, le fait que certains des requérants aient obtenu le statut de réfugié ne saurait rassurer la Cour quant au risque de refoulement arbitraire. Au contraire, la Cour partage l’avis des requérants selon lequel cela constitue une preuve supplémentaire de la vulnérabilité des intéressés.
156. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’au moment de transférer les requérants vers la Libye, les autorités italiennes savaient ou devaient savoir qu’il n’existait pas de garanties suffisantes protégeant les intéressés du risque d’être renvoyés arbitrairement dans leurs pays d’origine, compte tenu notamment de l’absence d’une procédure d’asile et de l’impossibilité de faire reconnaître par les autorités libyennes le statut de refugié octroyé par le HCR.
157. Par ailleurs, la Cour réaffirme que l’Italie n’est pas dispensée de respecter ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention du fait que les requérants auraient omis de demander l’asile ou d’exposer les risques encourus en raison de l’absence d’un système d’asile en Libye. Elle rappelle encore une fois qu’il revenait aux autorités italiennes de s’enquérir de la manière dont les autorités libyennes s’acquittaient de leurs obligations internationales en matière de protection des refugiés.
158. Il s’ensuit que le transfert des requérants vers la Libye a également emporté violation de l’article 3 de la Convention du fait qu’il les a exposé au risque de rapatriement arbitraire.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 3 DE LA CONVENTION ET 4 DU PROTOCOLE No 4
i. Les principes généraux
197. L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils s’y trouvent consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
198. Il ressort de la jurisprudence que le grief d’une personne selon lequel son renvoi vers un Etat tiers l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention « doit impérativement faire l’objet d’un contrôle attentif par une « instance nationale » (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005-III ; voir aussi Jabari, précité, § 39). Ce principe a conduit la Cour à juger que la notion de « recours effectif » au sens de l’article 13 combiné avec l’article 3 requiert, d’une part, « un examen indépendant et rigoureux » de tout grief soulevé par une personne se trouvant dans une telle situation, aux termes duquel « il existe des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 » et, d’autre part, « la possibilité de faire surseoir à l’exécution de la mesure litigieuse » (arrêts précités, § 460 et § 50 respectivement).
199. En outre, dans l’arrêt Čonka (précité, §§ 79 et suivants) la Cour a précisé, sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole no 4, qu’un recours ne répond pas aux exigences du premier s’il n’a pas d’effet suspensif. Elle a notamment souligné (§ 79) :
« La Cour considère que l’effectivité des recours exigés par l’article 13 suppose qu’ils puissent empêcher l’exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles (...). En conséquence, l’article 13 s’oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant même l’issue de l’examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la Convention. Toutefois, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait l’article 13 (...). »
200. Compte tenu de l’importance de l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, la Cour a jugé que le critère de l’effet suspensif devait s’appliquer également dans le cas où un Etat partie déciderait de renvoyer un étranger vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’il courrait un risque de cette nature (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007-II ; M.S.S., précité, § 293).
ii. Application en l’espèce
201. La Cour vient de conclure que le renvoi des requérants vers la Libye s’analysait en une violation des articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4. Les griefs soulevés par les requérants sur ces points sont dès lors « défendables » aux fins de l’article 13.
202. La Cour a constaté que les requérants n’ont eu accès à aucune procédure tendant à leur identification et à la vérification de leurs situations personnelles avant l’exécution de leur éloignement vers la Libye (paragraphe 185 ci-dessus). Le Gouvernement admet que de telles procédures n’étaient pas envisageables à bord des navires militaires sur lesquels on a fait embarquer les requérants. Le personnel à bord ne comptait d’ailleurs ni interprètes ni conseils juridiques.
203. La Cour observe que les requérants allèguent n’avoir reçu aucune information de la part des militaires italiens, lesquels leur auraient fait croire qu’ils étaient dirigés vers l’Italie et ne les auraient pas renseignés quant à la procédure à suivre pour empêcher leur renvoi en Libye.
Dans la mesure où cette circonstance est contestée par le Gouvernement, la Cour attache un poids particulier à la version des requérants, car elle est corroborée par les nombreux témoignages recueillis par le HCR, le CPT et Human Rights Watch.
204. Or, la Cour a déjà affirmé que le défaut d’information constitue un obstacle majeur à l’accès aux procédures d’asile (M.S.S., précité, § 304). Elle réitère ici l’importance de garantir aux personnes concernées par une mesure d’éloignement, mesure dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, le droit d’obtenir des informations suffisantes leur permettant d’avoir un accès effectif aux procédures et d’étayer leurs griefs.
205. Compte tenu des circonstances de la présente espèce, la Cour estime que les requérants ont été privés de toute voie de recours qui leur eût permis de soumettre à une autorité compétente leurs griefs tirés des articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4 et d’obtenir un contrôle attentif et rigoureux de leurs demandes avant que la mesure d’éloignement ne soit mise à exécution.
206. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants auraient dû se prévaloir de la possibilité de saisir le juge pénal italien une fois arrivés en Libye, la Cour ne peut que constater que, même si une telle voie de recours est accessible en pratique, un recours pénal diligenté à l’encontre des militaires qui se trouvaient à bord des navires de l’armée ne remplit manifestement pas les exigences de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où il ne satisfait pas au critère de l’effet suspensif consacré par l’arrêt Čonka, précité. La Cour rappelle que l’exigence, découlant de l’article 13, de faire surseoir àl’exécution de la mesure litigieuse ne peut être envisagée de manière accessoire ( ">M.S.S., précité, § 388).
207. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4. Il s’ensuit que l’on ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir correctement épuisé les voies de recours internes et que l’exception préliminaire du Gouvernement (paragraphe 62 ci-dessus) est rejetée.
M.A. c. Belgique du 27 octobre 2020 requête n° 19656/18
Violation article 3 : Éloignement d’un requérant vers le Soudan : violation de la Convention
L’affaire concerne l’éloignement du requérant vers le Soudan par les autorités belges malgré une décision judiciaire ordonnant la suspension de l’éloignement. La Cour juge en particulier que les lacunes procédurales dont se sont rendues responsables les autorités belges préalablement à l’éloignement du requérant vers le Soudan n’ont pas permis au requérant de poursuivre la démarche de demande d’asile qu’il avait soumise à la Belgique et ont conduit les autorités belges à ne pas suffisamment évaluer les risques réellement encourus par le requérant au Soudan. D’autre part, en éloignant le requérant vers le Soudan en dépit de l’interdiction qui leur en était faite, les autorités ont rendus ineffectifs les recours que le requérant avait initiés avec succès.
34 • Qualité de victime • Abus de la situation vulnérable du requérant résultant de sa privation de liberté pour lui faire consentir à un soi-disant retour « volontaire » • Caractère équivoque du prétendu départ « volontaire » du territoire belge (embarquement sans résistance et signature d’un formulaire) interdisant d’y voir une renonciation à la protection offerte par l’art 3, à la supposer concevable • Circonstances postérieures (dans le pays de destination) dépourvues d’incidence sur les griefs déjà concrétisés lors du départ
Art 3 • Expulsion (Soudan) • Charge de la preuve des risques : devoir de tenir compte du caractère absolu des droits garantis par l’art 3 • Désistement de la procédure d’asile ne dispensant pas l’État d’évaluer les risques encourus en cas d’éloignement • Carences procédurales (langue, assistance juridique) et contexte de méfiance (mission d’identification avec l’ambassade) pouvant expliquer les silences du requérant quant à sa situation individuelle • Évaluation insuffisante des risques encourus
Art 13 (+ Art 3) • Recours effectif • Combinaison de recours offrant une protection contre un éloignement arbitraire • Autorités n’ayant pas sursis à l’éloignement du requérant conformément à l’interdiction qui leur en était faite
FAITS
M. A. arriva en Belgique de façon irrégulière à une date inconnue, après être passé par l’Italie et dans l’intention de rejoindre le Royaume-Uni. Il séjourna dans le parc Maximilien à Bruxelles avec une centaine d’autres migrants soudanais. Alors qu’il essayait de se rendre au Royaume-Uni, il fut enfin intercepté par la police belge le 18 août 2017. Un ordre de quitter le territoire lui fut délivré avec maintien dans un lieu déterminé en vue de son éloignement. Le jour même, les autorités belges le transférèrent dans un centre fermé pour illégaux près de l’aéroport de Bruxelles. Dans le cadre du droit d’être entendu avant son éloignement, M.A. déclara à une fonctionnaire du centre qu’il avait fui son pays en raison de la situation qui y régnait et du fait qu’il y était recherché. Le 6 septembre 2017, il introduisit une demande d’asile dans laquelle ses déclarations furent notées. À partir de ce moment, les réseaux sociaux et la presse soudanaise relayèrent l’annonce faite par les autorités belges de leur collaboration avec les autorités soudanaises à l’identification et au rapatriement des ressortissants soudanais arrivés illégalement en Belgique. M.A. se désista de sa demande quelques jours après en se référant à ces démarches et au fait qu’il n’avait pas disposé d’un avocat. Le 27 septembre 2017, au centre fermé, M.A. rencontra des membres de l’ambassade soudanaise et de la mission d’identification soudanaise, à la suite de quoi l’ambassade délivra un laissez-passer.
Après s’être entretenu avec un avocat le 30 septembre 2017, M.A. déposa une requête de mise en liberté devant le tribunal de première instance de Louvain. Le 12 octobre 2017, avant que celle-ci ait pu être examinée, il fut averti qu’il devrait embarquer sur un vol à destination de Khartoum (Soudan). Saisi par le requérant sur requête unilatérale, le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles interdit à l’Etat belge de rapatrier le requérant avant que les juridictions se soient prononcées sur la mesure de privation de liberté, sous peine d’une astreinte de 10 000 euros (EUR). Le renvoi, organisé pour le lendemain, fut annulé, mais M.A. fut malgré cela transféré à l’aéroport. Il indique qu’il y fut accueilli par un homme en uniforme qui lui expliqua en arabe que s’il refusait de monter dans l’avion, d’autres tentatives d’éloignement seraient organisées. Le requérant signa une déclaration autorisant son départ et embarqua sur le vol.
Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)
S’agissant des informations sur la situation au Soudan, il était notoire que la situation générale des droits de l’homme au Soudan était problématique à l’époque des faits. Dans ces conditions, il semble difficile de soutenir, comme le fait le Gouvernement, que l’existence d’un risque sérieux et avéré dans le chef du requérant devait être écarté. La Cour souligne que constater a posteriori que l’intéressé ne courrait pas de risques dans son pays d’origine, comme le fait le Gouvernement, ne peut servir à exonérer rétrospectivement ce dernier de ses obligations procédurales dans le cadre d’un éloignement. En ce qui concerne la question de savoir si le requérant a eu une possibilité réelle et effective d’exposer les risques personnels qu’il encourait en cas de retour au Soudan, la Cour relève que le requérant a fait état de ses craintes à plusieurs reprises. La Cour rappelle par ailleurs que si la charge de la preuve en ce qui concerne l’établissement des risques individuels encourus repose en principe sur le demandeur dans le cadre d’une procédure d’asile, les règles relatives à la charge de la preuve entre les parties ne doivent pas vider de leur substance les droits des requérants protégés par l’article 3 de la Convention. Il est également important de tenir compte des obstacles pratiques qu’un étranger peut rencontrer pour accéder à une procédure d’asile. En l’espèce, la Cour attache de l’importance à la version du requérant, qui allègue ne pas avoir rencontré d’avocat au cours des premières semaines de sa rétention, ce qu’aucun élément du dossier ne vient contredire. Elle constate également qu’à l’occasion de l’entretien organisé au moment de l’arrivée du requérant en centre fermé, aucun interprète officiel n’était présent alors que l’intéressé ne comprenait que l’arabe. La Cour estime que ces circonstances ont sans aucun doute représenté des obstacles de nature à expliquer l’attitude procédurale peu cohérente du requérant et la brièveté des éléments fournis aux autorités par ce dernier et ne lui ont pas offert une perspective réaliste d’accéder à la protection internationale. De plus, il ressort du formulaire qui a été rempli sur la base des déclarations du requérant que seules lui ont été posées des questions générales sur les risques auxquels il pouvait être confronté, sans aucune référence ou question concernant la région d’origine, l’origine ethnique ni les raisons d’avoir quitté le Soudan. La Cour est donc d’avis que le Gouvernement n’a pas procédé à un examen préalable suffisant des risques encourus par l’intéressé au regard de l’article 3. De plus, la Cour estime que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’identification du requérant posent question. Le fonctionnaire avec lequel le requérant s’est entretenu ne maîtrisait pas l’arabe, langue dans laquelle était menée les entretiens, et le requérant n’avait pas été informé préalablement qu’un tel entretien aurait lieu. Au regard des différentes lacunes procédurales identifiées ci-dessus, la Cour conclut qu’il y a une violation de l’article 3.
Article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3
En ce qui concerne le point de savoir si le requérant a disposé d’un accès effectif aux recours existants contre un refoulement arbitraire, la Cour estime qu’eu égard au raisonnement qui l’a conduite à conclure à la violation de l’article 3 en l’espèce, il n’y a rien qui justifie un examen séparé des mêmes faits et griefs sous l’angle de l’article 13. S’agissant ensuite de l’allégation du requérant selon laquelle il n’a pas bénéficié d’un recours suspensif de son éloignement, la Cour constate qu’en l’espèce, c’est la combinaison des recours exercés – la requête de mise en liberté combinée avec la saisine du président du tribunal de première instance statuant en référé – qui offrait au requérant une protection contre un éloignement arbitraire, du moins temporairement. La décision du président interdisant son rapatriement étant exécutoire et donc contraignante pour l’État, le requérant pouvait en attendre le respect. Or, sachant que le requérant ne saurait être considéré avoir volontairement quitté la Belgique ou même avoir volontairement signé la déclaration de départ vers le Soudan et vu la rapidité avec laquelle les autorités belges ont agi le lendemain même en dépit de l’ordonnance qui interdisait l’éloignement, il y a lieu de considérer, qu’à défaut d’avoir sursis à l’éloignement du requérant conformément à l’interdiction qui leur en était faite, les autorités belges ont privé les recours qu’il avait initiés avec succès de leur effectivité. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
CEDH
ARTICLE 3
Rappel des principes généraux
77. à titre préliminaire, la Cour tient à souligner qu’elle se garde de sous-estimer les difficultés liées au phénomène de la transmigration qui impliquent, ainsi que le Gouvernement défendeur le fait valoir, des complications particulières en termes d’immigration irrégulière pour des États contractants situés aux frontières maritimes de l’Europe. Toutefois, elle ne peut que réitérer sa jurisprudence bien établie, selon laquelle, vu le caractère absolu de l’article 3 de la Convention, de tels facteurs ne peuvent exonérer les État contractants de leurs obligations au regard de cette disposition (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 223, CEDH 2011, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 184, 15 décembre 2016).
78. La Cour rappelle que, dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un étranger, elle se garde d’examiner elle-même les demandes de protection internationale ou de vérifier la manière dont les États contrôlent l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Ce sont en effet les autorités nationales qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis et qui sont, à ce titre, tenues d’examiner les craintes exprimées par les requérants et d’évaluer les risques qu’ils encourent en cas de renvoi dans le pays de destination au regard de l’article 3. Cela résulte du principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention (Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, § 184, 13 décembre 2016, et références citées) et auquel se réfère le Gouvernement (voir paragraphe 55).
79. Concernant la charge de la preuve dans les affaires d’expulsion, il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 ; et lorsque de tels éléments sont soumis, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 129, CEDH 2008, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 120, 23 mars 2016, et J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 91, 23 août 2016).
80. En réalité, l’obligation d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents de la cause pendant la procédure d’asile est partagée entre le demandeur d’asile et les autorités chargées de l’immigration (J.K. et autres c. Suède, précité, § 96).
81. Le demandeur d’asile est normalement la seule partie à pouvoir fournir des informations sur sa situation personnelle. Sur ce point, la charge de la preuve doit donc en principe reposer sur l’intéressé, lequel doit présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qui sont nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale (J.K. et autres c. Suède, précité, § 96 ; voir également F.G. c. Suède, précité, § 125). Eu égard toutefois au caractère absolu des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, et à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, si un État contractant est informé de faits, relatifs à un individu donné, propres à exposer celui-ci à un risque de mauvais traitements contraires auxdites dispositions en cas de retour dans le pays en question, les obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention impliquent que les autorités évaluent ce risque d’office. Cela vaut spécialement pour les situations où il a été porté à la connaissance des autorités nationales que le demandeur d’asile fait vraisemblablement partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements et qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (F.G. c. Suède, précité, § 127).
82. En ce qui concerne l’évaluation de la situation générale régnant dans un pays donné, les autorités nationales qui examinent une demande de protection internationale ont pleinement accès aux informations. Pour cette raison, la situation générale dans un autre pays doit être établie d’office par les autorités nationales compétentes en matière d’immigration (J.K. et autres c. Suède, précité, § 98 ; voir également F.G. c. Suède, précité, § 126).
Application des principes en l’espèce
83. En l’espèce, le requérant a pénétré le territoire belge de façon irrégulière afin de rejoindre le Royaume-Uni. Il n’avait dans un premier temps aucune intention de demander l’asile en Belgique. Force est toutefois de constater qu’une fois arrêté par la police belge et placé en rétention en centre fermé en vue de son éloignement, il a changé de stratégie. Dans ce contexte, dès sa première arrestation, le requérant a informé la police belge qu’il était originaire du Soudan ; il a ensuite déclaré dès son arrivée au centre fermé, dans le cadre du droit d’être entendu, qu’il avait fui ce pays en raison de la situation qui y régnait et du fait qu’il y était recherché. Ces brefs éléments ont été formalisés dans une demande d’asile (paragraphes 8, 10 et 14 ci-dessus).
84 La Cour relève en outre que, le requérant, invoquant l’article 3 de la Convention, a fait valoir que la situation au Soudan s’opposait à son éloignement dans le cadre de la requête unilatérale qu’il a déposée le 12 octobre 2017 devant le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles pour empêcher son retour, fixé au lendemain, avant que les procédures de mise en liberté ne soient arrivées à terme (paragraphe 26 ci-dessus).
85. Il y a donc lieu de considérer que le requérant a exprimé ses craintes auprès des autorités belges avant son éloignement.
86. Quant à la circonstance que le requérant n’a pas poursuivi la procédure d’asile, la Cour rappelle qu’eu égard au caractère absolu de la protection offerte par l’article 3 de la Convention, elle ne constitue pas en soi un argument pour exonérer l’État défendeur de ses obligations de ne pas procéder à un éloignement sans avoir procédé à un examen préalable des risques au regard de cette disposition.
87. C’est dans ce cadre que se situent les griefs, d’ordre procédural, du requérant au regard de l’article 3 de la Convention. Il se plaint d’avoir été éloigné par les autorités belges vers le Soudan, pays qu’il a fui, sans un examen préalable des risques qu’il encourait au regard de l’article 3 de la Convention. Il allègue également que les autorités internes ont aggravé les risques qu’il encourait au Soudan en organisant une mission d’identification avec les autorités soudanaises.
88. Dans une affaire de ce type, la Cour considère que sa tâche n’est pas d’établir elle-même si le requérant encourait un risque réel de mauvais traitements au Soudan (paragraphe 78 ci-dessus), mais qu’elle doit chercher à déterminer, compte tenu des faits de la cause et des griefs que soulève le requérant relativement à la démarche des autorités belges qu’il estime défaillante, si les autorités ont tenu compte, d’office et de manière appropriée, des informations générales disponibles sur le Soudan, et si le requérant s’est vu offrir une possibilité suffisante de demander la protection internationale en Belgique et d’exposer sa situation personnelle (voir, mutatis mutandis, dans une affaire concernant l’expulsion d’étrangers vers un pays tiers considéré un pays tiers sûr, Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, § 148, 21 novembre 2019). Elle sera également amenée à examiner le grief du requérant selon lequel les autorités belges auraient aggravé sa situation avec la mission d’identification.
89. S’agissant des informations générales sur la situation au Soudan, s’il est vrai, comme le souligne le Gouvernement, que la Cour n’a jamais identifié le Soudan comme un pays où toute personne rapatriée est ipso facto confrontée à un risque réel et avéré de subir des traitements contraires à l’article 3, force est de constater avec le requérant qu’à l’époque litigieuse, il était notoire que la situation des droits de l’homme au Soudan était problématique, et que, pour cette raison, les autorités belges accordaient la protection internationale à un grand nombre de Soudanais, en particulier ceux provenant de la région du Kordofan du Sud d’où le requérant soutient venir (paragraphe 49 ci-dessus). Dans ces conditions, il semble difficile de soutenir, comme le fait le Gouvernement, que l’existence d’un risque sérieux et avéré dans le chef du requérant devait être écarté.
90. Pour autant, la Cour note que l’OQT qui a été notifié au requérant le 18 août 2017 ne contenait aucune mention de la situation au Soudan ni, a fortiori, du risque éventuel au regard de l’article 3. Il en est de même des OQT qui lui avaient été notifiés auparavant.
91. Le Gouvernement s’appuie sur l’évaluation faite par le CGRA de la situation générale au Soudan et de la situation des ressortissants soudanais concernés après leur retour pour faire valoir qu’il ne se justifiait pas de procéder autrement. La Cour note toutefois que le rapport du CGRA a été publié postérieurement à l’éloignement du requérant et rappelle que le fait de constater a posteriori que l’intéressé ne courrait pas de risques dans son pays d’origine, ne peut servir à exonérer rétrospectivement l’État de ses obligations procédurales dans le cadre d’un éloignement (voir, mutatis mutandis, Ilias et Ahmed, précité, § 137).
92. En ce qui concerne, ensuite, la question de savoir si le requérant a eu une possibilité réelle et effective d’exposer les risques personnels qu’il encourait en cas de retour au Soudan, la Cour rappelle qu’il a fait état de ses craintes à plusieurs reprises : au moment de son arrestation, lors de sa rencontre avec le fonctionnaire du centre dans le cadre du droit d’être entendu ainsi que dans le formulaire par lequel il a déclaré introduire une demande d’asile (paragraphe 83 ci-dessus).
93. Le Gouvernement estime toutefois que le requérant est resté en défaut de fournir à l’OE des éléments suffisamment étayés à ce sujet, alors même que toutes les informations utiles sur la procédure d’asile lui ont été fournies dans une langue qu’il comprenait, qu’il a bénéficié d’un avocat et a été entendu par les fonctionnaires du centre ou de l’OE à plusieurs reprises avant son éloignement.
94. La Cour rappelle qu’en ce qui concerne l’établissement, dans le cadre d’une procédure d’asile, des risques individuels encourus dans le pays de destination, la charge de la preuve repose en principe sur le demandeur (paragraphe 81 ci-dessus).
95. Toutefois, les règles relatives à la charge de la preuve entre les parties ne doivent pas vider de leur substance les droits des requérants protégés par l’article 3 de la Convention. Il est également important de tenir compte des obstacles pratiques qu’un étranger peut rencontrer pour accéder à la procédure d’asile (J.K. et autres c. Suède, précité, § 97).
96. Or en l’espèce le requérant se plaint précisément que l’absence d’encadrement procédural auquel il a fait face ne lui a laissé aucune perspective réaliste d’accéder à la procédure d’asile et donc d’étayer ses craintes personnelles.
97. Le requérant allègue premièrement n’avoir reçu aucune information sur les procédures à suivre dans une langue qu’il comprenait. Les parties divergent à cet égard sur le point de savoir si la brochure d’information sur les procédures et les recours qui a été distribuée au requérant au centre fermé était rédigée en arabe. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur cette question et qu’il lui suffit de constater que ladite brochure ne contenait que des informations procédurales sur la détention mais aucune sur la procédure d’asile, ni sur les recours en matière d’éloignement.
98. Le requérant soutient ensuite que, s’il avait eu accès à un avocat durant les premières semaines de sa détention, il aurait été en mesure d’évaluer sa situation sur le terrain de l’asile. Or il indique n’avoir rencontré un avocat qu’une seule fois, le 30 septembre 2017, à l’initiative d’une association d’aide aux réfugiés, soit bien après son désistement.
99. Sans mettre en doute la bonne foi du Gouvernement qui explique qu’à son arrivée au centre le requérant a reçu toutes les informations utiles pour prendre contact avec un avocat et que, conformément à la procédure suivie, un avocat pro deo a été désigné, la Cour attache plus de poids à la version du requérant. D’une part, aucun élément du dossier ne vient attester que le requérant aurait rencontré un avocat au cours des premières semaines de sa rétention. D’autre part, la version du requérant se trouve corroborée par les déclarations consignées dans le formulaire de désistement (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour tient également compte du constat fait par le CGRA selon lequel seule une partie des dix Soudanais concernés ont effectivement bénéficié d’un avocat (paragraphe 49 ci-dessus).
100. La Cour estime que ces circonstances ont sans aucun doute représenté des obstacles de nature à expliquer l’attitude procédurale peu cohérente du requérant. Elle relève en outre dans le dossier de presse soudanaise fourni par le requérant que l’annonce de la collaboration entre les autorités belges et les autorités soudanaises a commencé à circuler au moment où le requérant a déposé sa demande d’asile (paragraphes 14-15 ci‑dessus), ce qui rend plausible le sentiment de méfiance à l’égard des autorités d’asile belges qu’il invoque et le désistement qui a suivi.
101. Le Gouvernement fait en outre valoir qu’indépendamment de la procédure d’asile, le requérant a eu l’opportunité de faire état de ses craintes lors de ses rencontres, dans le cadre du droit d’être entendu avant l’éloignement, avec un fonctionnaire du centre ou de l’OE.
102. La Cour note toutefois qu’à l’occasion de l’entretien organisé au moment de l’arrivée du requérant au centre fermé, aucun interprète officiel n’était présent alors qu’il était avéré qu’il ne comprenait que l’arabe (paragraphe 60 ci-dessus), et qu’un codétenu a traduit les déclarations du requérant de l’arabe vers l’anglais. De plus, il apparaît du formulaire qui a été rempli sur base de ces déclarations que seules des questions générales sur les risques auxquels le requérant pouvait être confronté en cas de retour lui ont été posées, sans aucune référence ou question concernant la région d’origine, l’origine ethnique ni les raisons d’avoir quitté le Soudan (paragraphe 10 ci-dessus). La brièveté des éléments fournis par le requérant peut donc s’expliquer par le caractère vague voire lacunaire des questions posées, sans interprète, comme cela a été le cas, selon le CGRA, pour les autres Soudanais concernés (paragraphe 49 ci-dessus).
103. Le refus opposé par le requérant de remplir un questionnaire plus précis sur les risques encourus dans le cadre du second entretien avec un fonctionnaire du centre ne vient pas modifier ce constat étant donné qu’il est intervenu après la mission d’identification dans un contexte de méfiance exacerbée à l’égard des autorités (paragraphes 15 et 21 ci-dessus).
104. Eu égard à ce qui précède, la Cour est d’avis que l’évaluation faite par l’OE – sans égard à la situation générale au Soudan et sur base des seuls éléments fournis par le requérant – sur laquelle s’appuie le Gouvernement pour dire qu’il n’existait pas de risque réel en cas d’éloignement au Soudan ne saurait passer pour un examen préalable suffisant des risques encourus au regard de l’article 3 de la Convention.
105. Au contraire, il y a lieu de considérer que si les conditions d’une perspective réaliste d’accéder à la protection internationale avaient été mises en place, le requérant aurait été en mesure de poursuivre sa démarche et les instances d’asile belges en mesure d’évaluer les risques réellement encourus par le requérant préalablement à son éloignement. La Cour ne perd pas de vue que cet examen aurait pu les amener à conclure que le récit du requérant de risques de mauvais traitements au Soudan n’était pas convaincant, et qu’une telle conclusion aurait pu être confirmée, comme le fait valoir le Gouvernement, par le fait que le requérant n’a effectivement subi aucun mauvais traitement au Soudan jusqu’à présent. Toutefois, ce n’est pas à la Cour mais aux autorités internes à procéder à une telle évaluation (voir, mutatis mutandis, M.S. c. Slovaquie et Ukraine, no 17189/11, § 128, 11 juin 2020).
106. Reste à examiner l’allégation du requérant selon laquelle l’organisation par les autorités belges de son identification par des agents de l’ambassade soudanaise et la mission d’identification venue du Soudan a été de nature à augmenter le risque qu’il encourait au regard de l’article 3 de la Convention.
107. La Cour est d’accord avec le Gouvernement pour considérer que l’organisation d’une mission d’identification avec des personnes qui représentent les autorités du pays d’origine en vue de la délivrance d’un laissez-passer à des ressortissants étrangers qui, comme le requérant, ne possèdent pas de documents de voyage n’est pas problématique en soi au regard de la Convention.
108. Toutefois, la Cour estime que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’identification en l’espèce posent question.
109. Le requérant fait valoir, sans être contredit par le Gouvernement, qu’il n’avait pas été informé préalablement qu’un tel entretien aurait lieu, et qu’il s’est retrouvé seul à l’entretien. Ce dernier point fait divergence entre les parties, le Gouvernement indiquant qu’un fonctionnaire de l’OE était présent. Quand bien même cette dernière version, corroborée par le rapport du CGRA (paragraphe 49 ci-dessus), correspondait à la réalité, la Cour relève dans ce même rapport que ledit fonctionnaire ne se trouvait pas nécessairement à proximité du lieu de l’entretien, et en général ne maîtrisait pas l’arabe, langue dans laquelle étaient menés les entretiens.
110. Ces éléments montrent à la Cour que l’identification du requérant –qui n’avait pas été précédée d’un examen par les autorités belges de ses besoins de protection – n’a pas non plus été entourée de garanties procédurales suffisantes. Elle relève que ce constat est également celui que le CGRA a dressé dans son rapport établi a posteriori (paragraphe 49 ci‑dessus).
111. En conclusion, au regard des différentes lacunes identifiées ci-dessus, la Cour estime qu’il y a eu une violation de l’article 3 de la Convention.
112. La Cour prend note de la mise en place, postérieure à l’éloignement du requérant, d’une pratique de « demande implicite de protection internationale » permettant au CGRA d’examiner, à l’initiative de l’OE, la situation de personnes qui ne demandent pas l’asile en Belgique (paragraphe 50 ci-dessus). Cette pratique semble a priori susceptible de permettre un examen préalable suffisant des risques encourus par ces personnes.
ARTICLE 13
119. En ce qui concerne le point de savoir si le requérant a disposé d’un accès effectif aux recours existants contre un refoulement arbitraire, la Cour estime qu’eu égard au raisonnement qui l’a conduite à conclure à la violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce (paragraphes 83-112 ci‑dessus), il n’y a rien qui justifie un examen séparé des mêmes faits et griefs sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir, par exemple, M.D. et M.A. c. Belgique, no 58689/12, § 70, 19 janvier 2016, et M.S. c. Slovaquie et Ukraine, précité, § 131).
120. S’agissant ensuite de l’allégation du requérant selon laquelle il n’a pas bénéficié d’un recours suspensif de son éloignement, la Cour constate avec le Gouvernement que la voie de la requête de mise en liberté empruntée par le requérant n’était à l’évidence pas la voie naturelle pour demander que les autorités sursoient à son éloignement. Toutefois, il y a également lieu de noter qu’en interdisant d’éloigner le requérant aussi longtemps qu’il n’y avait pas de décision définitive sur la légalité de la détention, le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a lié la possibilité de rapatriement du requérant à l’issue de la procédure sur la légalité de la détention (paragraphe 26 ci-dessus).
121. C’est cette combinaison de recours – la requête de mise en liberté combinée avec la saisine du président du tribunal de première instance statuant en référé –, qui offrait au requérant une protection contre un éloignement arbitraire, du moins temporairement. La décision du président étant exécutoire et donc contraignante pour l’État, nonobstant sa tierce‑opposition, le requérant était en droit d’en attendre le respect conformément à l’article 13 de la Convention.
122. Or, le requérant se plaint que cette décision n’a pas été effective en pratique puisque les autorités belges ont procédé à son éloignement malgré l’interdiction qui leur en était faite.
123. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la Cour est d’avis, comme elle l’a souligné plus haut (paragraphe 61), que le requérant ne saurait être considéré avoir volontairement quitté la Belgique. Il en va a fortiori de même de la renonciation à la protection que lui offrait la décision en référé, imposant aux autorités belges de surseoir à son éloignement.
124. Ce constat est conforté par la rapidité avec laquelle les autorités belges ont agi le lendemain de l’ordonnance du 12 octobre 2017 interdisant l’éloignement du requérant. Dans la même journée, l’OE a annulé le renvoi fixé le matin pour le retour du requérant, tout en organisant son transfert à l’aéroport et la signature de ladite déclaration, a programmé un nouveau retour, et l’a embarqué sur ce vol quelques heures après. Cet enchaînement vient à l’appui de la thèse du requérant selon laquelle les autorités belges ont délibérément agi en dépit de l’interdiction, pourtant exécutoire, et ont montré leur détermination à l’éloigner avant qu’une décision soit prise sur sa détention. La Cour note que cette thèse est également celle suivie par le président du tribunal de première instance dans son jugement du 5 décembre 2017, certes non définitif, sur la tierce-opposition de l’État belge contre l’ordonnance précitée (paragraphe 33 ci-dessus).
125. Ces considérations amènent la Cour à considérer qu’à défaut pour les autorités belges d’avoir sursis à l’éloignement du requérant conformément à l’interdiction qui leur en était faite, elles ont privé les recours qu’il avait initiés avec succès de leur effectivité au mépris de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
A.I. c. SUISSE du 30 mai 2017 requête 23378/15
Article 2 et 3 : L'expulsion du requérant qui craint des persécutions au Soudan, ne serait pas conforme à la Conv EDH, puisque sa famille n'y a aucun point d'attache.
47. La Cour observe d’emblée que les griefs allégués sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention sont indissociables et examinera donc les deux articles simultanément (voir notamment, mutatis mutandis, F.G. c. Suède, précité, § 110, Tatar c. Suisse, no 65692/12, § 45, 14 avril 2015, T.A. c. Suède, no 48866/10, § 37, 19 décembre 2013, et K.A.B. c. Suède, no 886/11, § 67, 5 septembre 2013).
a) Principes généraux
48. La Cour rappelle que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, par exemple, Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006‑XII, et J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 79, CEDH 2016). Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124‑125, et J.K. et autres c. Suède, précité, § 79).
49. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour (J.K. et autres, précité, § 83, et Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (voir, par exemple, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, §§ 87-95, CEDH 2008, J.K. et autres, précité, § 83, et Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 215, 28 juin 2011).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
50. S’agissant de la situation générale au Soudan, la Cour a récemment rappelé dans l’arrêt A.A. c. Suisse (précité, §§ 39-40), que la situation des droits de l’homme dans ce pays était alarmante, en particulier pour les opposants politiques. Elle a également noté, dans les arrêts A.A. c. France (précité, §§ 55-56) et A.F. c. France (précité, § 49) que la situation s’était encore détériorée depuis le début de l’année 2014. La Cour relève par ailleurs qu’il n’y a pas eu depuis lors d’amélioration significative de la situation. Les conflits au Darfour, au Kordofan du Sud et dans le Nil Bleu ont ainsi perduré et engendré d’importants dommages parmi les populations civiles, même si les combats, notamment au Darfour, étaient moins nombreux. Les rapports internationaux consultés font également état de ce que les individus suspectés d’appartenir à des mouvements rebelles, notamment au JEM, ou de les soutenir, continuent d’être arrêtés, détenus et torturés par les autorités soudanaises (paragraphes 20 à 30 ci-dessus). De plus, il apparaît que les individus encourant un risque de mauvais traitement ne sont pas uniquement les opposants au profil marqué, mais toute personne s’opposant ou étant suspectée de s’opposer au régime en place (A.A. c. France, précité, § 56, A.F. c. France, précité, § 49, et A.A. c. Suisse, précité, § 40). La Cour a enfin indiqué qu’il était reconnu que le gouvernement soudanais surveillait les activités des opposants politiques à l’étranger (A.A. c. Suisse, précité, § 40).
51. La Cour note que le requérant est membre du JEM et du DFEZ, en Suisse, depuis plusieurs années. Le Gouvernement remet en cause la sincérité de son engagement politique et affirme que ses activités en exil n’ont pas atteint une importance suffisante pour attirer l’attention des autorités soudanaises. En ce qui concerne les activités sur place, la Cour a reconnu qu’il est généralement très difficile d’apprécier si une personne s’intéresse sincèrement à l’activité en question ou si elle ne s’y est engagée que pour justifier après coup sa fuite (voir, par exemple, A.A. c. Suisse, précité). Dans des cas similaires, la Cour a cherché à savoir si le requérant s’était engagé dans des activités sur place à un moment où il était prévisible qu’il dépose une demande d’asile dans le futur, si le requérant était un activiste politique avant de fuir son pays d’origine ou s’il avait joué un rôle important afin de rendre son cas public dans l’État défendeur (voir A.A. c. Suisse, précité, § 41, S.F. et autres c. Suède, précité, §§ 66-67, et N. c. Finlande, no 38885/02, § 165, 26 juillet 2005). Cependant, la Cour rappelle que compte tenu de l’importance qu’elle attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage qui résulterait si le risque de mauvais traitements ou de torture se matérialisait, elle préfère analyser le grief du requérant sur la base des activités politiques qu’il a effectivement menées (A.A. c. Suisse, précité, § 41).
52. S’agissant de la crédibilité des allégations du requérant ayant trait à ses activités politiques en Suisse, la Cour considère que, malgré certaines incohérences, notamment s’agissant des messages de menaces censés émaner des services secrets soudanais, elle ne saurait être remise en cause, les propos du requérant ayant été constants tout au long de la procédure et documentés par de nombreux moyens de preuve. Les autorités internes n’ont d’ailleurs pas fondamentalement remis en cause le récit du requérant sur ses activités sur place, se contentant de mettre en doute la sincérité et le caractère exposé de son engagement. Toutefois, concernant plus particulièrement les articles critiquant notamment le gouvernement soudanais que le requérant aurait publiés sur internet, la Cour est d’avis que le requérant, qui n’a ni été appelé à se prononcer sur les doutes du TAF quant à son identité ni été interrogé par le SEM à ce propos après que ce dernier avait reçu des documents relatifs à l’identité du requérant lors de son audition sur les motifs, a fourni des explications crédibles sur les divergences observées à propos des différentes variantes de son nom, de sorte qu’il ne saurait être exclu que le requérant soit l’auteur desdits articles. Il revenait dès lors au TAF d’examiner si leur publication sur internet était susceptible de mettre le requérant en danger. S’agissant de la promotion au poste de responsable média de la section suisse du JEM alléguée par le requérant, la Cour relève que le Gouvernement, qui a certes exprimé des réserves en lien avec la date de cet événement et l’absence de description du cahier des charges du requérant, n’a pas fondamentalement remis en cause la promotion du requérant. Dès lors, à la lumière des lettres émanant de responsables en exil du JEM et malgré certaines incohérences, le requérant a rendu vraisemblable qu’il occupait désormais une telle position. Par conséquent, la Cour doit examiner si les activités du requérant sont susceptibles de lui faire courir un danger en cas de renvoi vers le Soudan.
53. La Cour considère, à la lumière de l’affaire A.A. c. Suisse (précitée) et des documents internationaux consultés (paragraphes 20 à 30 ci-dessus), que la surveillance par les services secrets soudanais des activités des opposants politiques à l’étranger ne saurait être qualifiée de systématique et que, pour évaluer si des individus peuvent être suspectés de soutenir des organisations d’opposition au régime soudanais et encourent des risques de mauvais traitements et de torture en cas de renvoi vers le Soudan en raison de leurs activités politiques en exil, il convient de tenir compte, notamment, des facteurs suivants : l’éventuel intérêt, par le passé, des autorités soudanaises pour ces individus, que ce soit au Soudan ou à l’étranger ; l’appartenance de ces individus, au Soudan, à une organisation s’opposant au régime en place et la nature de cette organisation ; leur appartenance à une organisation d’opposition dans leur pays de résidence, la nature de celle-ci et la mesure dans laquelle elle est ciblée par le gouvernement ; la nature de l’engagement politique de ces individus dans leur pays de résidence, notamment leur participation à des réunions ou manifestations publiques et leur activité sur internet ; et leurs liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition en exil.
54. Dans le cas d’espèce, s’agissant de la question de l’intérêt des autorités soudanaises pour le requérant et plus particulièrement des motifs de fuite allégués par le requérant, la Cour rappelle qu’elle n’a pas identifié d’élément justifiant de remettre en cause l’appréciation des autorités internes selon laquelle les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance (paragraphe 36 ci-dessus). Le requérant n’a pas non plus allégué avoir été actif politiquement à l’étranger au cours des trois années séparant sa fuite du Soudan et son arrivée en Suisse. La Cour considère dès lors qu’aucun élément n’atteste un quelconque intérêt des autorités soudanaises pour le requérant alors qu’il résidait encore au Soudan ou à l’étranger, avant son arrivée en Suisse.
55. La Cour relève par ailleurs, comme le TAF dans son arrêt E‑678/2012 du 27 janvier 2016 (paragraphe 19 ci-dessus), que le JEM est l’un des principaux mouvements de rébellion au Soudan et que le danger qu’il représente aux yeux des autorités soudanaises a augmenté du fait de la légitimité qu’il a acquise en lien avec le conflit au Darfour, entraînant un comportement plus sévère de la part des autorités soudanaises à l’encontre des membres du JEM. L’appartenance du requérant au JEM, depuis son arrivée en Suisse à l’été 2012, constitue dès lors un facteur de risques de persécutions. La Cour ajoute qu’il en va de même de l’appartenance du requérant au DFEZ, ayant déjà constaté une violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi d’un militant de cette organisation vers le Soudan (A.A. c. Suisse, précité).
56. La Cour note que l’engagement politique du requérant, déjà non négligeable au vu de son rôle dans l’organisation des séances hebdomadaires du JEM et de sa participation régulière aux événements du JEM et du DFEZ en Suisse, s’est encore intensifié avec le temps, comme en témoigne sa participation à des conférences internationales à Genève portant sur la situation en matière de droits de l’homme au Soudan, ses articles critiques à l’égard du régime soudanais et sa nomination au poste de responsable média du JEM (voir, mutatis mutandis, A.A. c. Suisse, précité, § 42). Si le profil politique du requérant ne saurait être qualifié de très exposé, du fait notamment qu’il n’a jamais fait de discours au nom d’une organisation d’opposition lors de ces conférences, il convient toutefois de tenir compte de la situation spécifique du Soudan (A.A. c. Suisse, précité, § 42). En effet, comme l’a rappelé la Cour, il apparaît que les individus encourant un risque de mauvais traitement ne sont pas uniquement les opposants au profil marqué, mais toute personne s’opposant ou étant suspectée de s’opposer au régime en place (paragraphe 50 ci-dessus). Il est de plus reconnu que le gouvernement soudanais surveille les activités de ses opposants politiques à l’étranger (A.A. c. Suisse, précité §§ 40 et 43).
57. La Cour note que le requérant ne saurait, sur la seule base des photographies du requérant en compagnie du leader du JEM, prises en marge de réunions de ce mouvement, se réclamer de liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition en exil de nature à pouvoir le mettre en danger. Elle relève toutefois que le requérant a, de par son engagement au sein du JEM, été amené à côtoyer de façon régulière les dirigeants de la branche suisse de ce mouvement.
58. Vu ce qui précède, la Cour ne peut pas exclure que le requérant ait, en tant qu’individu et de par ses activités politiques en exil, attiré l’attention des services de renseignements soudanais. Elle est d’avis qu’il pourrait être suspecté d’être affilié à une organisation s’opposant au régime soudanais. Elle considère dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le requérant risquerait d’être détenu, interrogé et torturé à son arrivée à l’aéroport de Khartoum et qu’il lui serait impossible de se relocaliser dans le pays. En conséquence, la Cour estime qu’il y a aurait violation des articles 2 et 3 de la Convention en cas de mise à exécution de la mesure de renvoidu requérant vers le Soudan.
N.A. c. SUISSE du 30 mai 2017 requête 50364/14
Article 2 et 3 : L'expulsion du requérant qui ne craint aucune persécution au Soudan, serait conforme à la Conv EDH, puisque sa famille y réside.
40. La Cour observe d’emblée que les griefs allégués sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention sont indissociables et examinera donc les deux articles simultanément (voir, notamment, mutatis mutandis, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 110, CEDH 2016, Tatar c. Suisse, no 65692/12, § 45, 14 avril 2015, T.A. c. Suède, no 48866/10, § 37, 19 décembre 2013, et K.A.B. c. Suède, no 886/11, § 67, 5 septembre 2013).
a) Principes généraux
41. La Cour rappelle que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, par exemple, Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH 2006‑XII, et J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 79, CEDH 2016). Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124‑125, et J.K. et autres c. Suède, précité, § 79).
42. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour (J.K. et autres, précité, § 83, et Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (voir, par exemple, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, §§ 87-95, CEDH 2008, J.K. et autres, précité, § 83, et Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 215, 28 juin 2011).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
43. S’agissant de la situation générale au Soudan, la Cour a récemment rappelé dans l’arrêt A.A. c. Suisse (précité, §§ 39-40), que la situation des droits de l’homme dans ce pays était alarmante, en particulier pour les opposants politiques. Elle a également noté, dans les arrêts A.A. c. France (précité, §§ 55-56) et A.F. c. France (no 80086/13, § 49, 15 janvier 2015) que la situation s’était encore détériorée depuis le début de l’année 2014. La Cour relève par ailleurs qu’il n’y a pas eu depuis lors d’amélioration significative de la situation. Les conflits au Darfour, au Kordofan du Sud et dans le Nil Bleu ont ainsi perduré et engendré d’importants dommages parmi les populations civiles, même si les combats, notamment au Darfour, étaient moins nombreux. Les rapports internationaux consultés font également état de ce que les individus suspectés d’appartenir à des mouvements rebelles, notamment au JEM, ou de les soutenir, continuent d’être arrêtés, détenus et torturés par les autorités soudanaises (paragraphes 18 à 28 ci-dessus). De plus, il apparaît que les individus encourant un risque de mauvais traitement ne sont pas uniquement les opposants au profil marqué, mais toute personne s’opposant ou étant suspectée de s’opposer au régime en place (A.A. c. France, précité, § 56, A.F. c. France, précité, § 49, et A.A. c. Suisse, précité, § 40). La Cour a enfin indiqué qu’il était reconnu que le gouvernement soudanais surveillait les activités des opposants politiques à l’étranger (A.A. c. Suisse, précité, § 40).
44. S’agissant des motifs de fuite allégués par le requérant, la Cour n’identifie pas d’élément justifiant de remettre en cause l’appréciation des autorités internes selon laquelle les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance (paragraphes 9 et 12 ci-dessus). Elle souligne à cet égard que les autorités internes, après avoir auditionné à deux reprises le requérant, les 15 mars 2013, sommairement, et 17 avril 2013, sur ses motifs d’asile, ont rendu des décisions détaillées et prenant en compte de manière convaincante les arguments du requérant. La Cour considère que le requérant, qui se contente en grande partie de réitérer les arguments qu’il avait soulevés devant les autorités internes, ne fait pas valoir d’argument décisif. Le requérant n’a pas non plus fourni le moindre document permettant d’étayer les mauvais traitements allégués (voir, a contrario, A.A. c. France, précité, § 59, et A.F. c. France, précité, § 53). La Cour précise par ailleurs que la nature différente des deux auditions du requérant par le SEM ne saurait suffire à expliquer les nombreuses incohérences relevées par les autorités internes, notamment du fait que les deux auditions se sont tenues à seulement un mois d’intervalle (voir, a contrario, M.A. c. Suisse, précité, §§ 60-61).
45. La Cour note que le requérant est membre du JEM en Suisse depuis plusieurs années. Le Gouvernement remet en cause la sincérité de son engagement politique et affirme que ses activités en exil n’ont pas atteint une importance suffisante pour attirer l’attention des autorités soudanaises. En ce qui concerne les activités sur place, la Cour a reconnu qu’il est généralement très difficile d’apprécier si une personne s’intéresse sincèrement à l’activité en question ou si elle ne s’y est engagée que pour justifier après coup sa fuite (voir, par exemple, A.A. c. Suisse, précité). Dans des cas similaires, la Cour a cherché à savoir si le requérant s’était engagé dans des activités sur place à un moment où il était prévisible qu’il dépose une demande d’asile dans le futur, si le requérant était un activiste politique avant de fuir son pays d’origine ou s’il avait joué un rôle important afin de rendre son cas public dans l’État défendeur (voir, A.A. c. Suisse, précité, § 41, S.F. et autres c. Suède, no 52077/10, §§ 66-67, 15 mai 2012, et N. c. Finlande, no 38885/02, § 165, 26 juillet 2005). Cependant, la Cour rappelle que compte tenu de l’importance qu’elle attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage qui résulterait si le risque de mauvais traitements ou de torture se matérialisait, elle préfère analyser le grief du requérant sur la base des activités politiques qu’il a effectivement menées (A.A. c. Suisse, précité, § 41).
46. La Cour considère, à la lumière de l’affaire A.A. c. Suisse (précitée) et des documents internationaux consultés (paragraphes 18 à 28 ci-dessus), que la surveillance par les services secrets soudanais des activités des opposants politiques à l’étranger ne saurait être qualifiée de systématique et que, pour évaluer si des individus peuvent être suspectés de soutenir des organisations d’opposition au régime soudanais et encourent des risques de mauvais traitements et de torture en cas de renvoi vers le Soudan en raison de leurs activités politiques en exil, il convient de tenir compte, notamment, des facteurs suivants : l’éventuel intérêt, par le passé, des autorités soudanaises pour ces individus, que ce soit au Soudan ou à l’étranger ; l’appartenance de ces individus, au Soudan, à une organisation s’opposant au régime en place et la nature de cette organisation ; leur appartenance à une organisation d’opposition dans leur pays de résidence, la nature de celle-ci et la mesure dans laquelle elle est ciblée par le gouvernement ; la nature de l’engagement politique de ces individus dans leur pays de résidence, notamment leur participation à des réunions ou manifestations publiques et leur activité sur internet ; et leurs liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition en exil.
47. Dans le cas d’espèce, s’agissant de la question de l’intérêt des autorités soudanaises pour le requérant et plus particulièrement des motifs de fuite allégués par le requérant, qui a notamment fait valoir qu’il avait été enlevé et maltraité par les autorités soudanaises, la Cour rappelle qu’elle n’a pas identifié d’élément justifiant de remettre en cause l’appréciation des autorités internes selon laquelle les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance (paragraphe 44 ci-dessus). Ce dernier n’a par ailleurs pas prétendu avoir été actif politiquement au sein de l’opposition alors qu’il vivait au Soudan et a pu quitter son pays d’origine légalement, via l’aéroport international de Khartoum, peu après avoir fait prolonger son passeport. Il n’a pas non plus allégué avoir été actif politiquement au cours de son séjour de plusieurs années en Grèce. La Cour considère dès lors qu’aucun élément n’atteste un quelconque intérêt des autorités soudanaises pour le requérant alors qu’il résidait encore au Soudan ou à l’étranger, avant son arrivée en Suisse.
48. La Cour relève par ailleurs, comme le TAF dans son arrêt E‑678/2012 du 27 janvier 2016 (paragraphe 17 ci-dessus), que le JEM est l’un des principaux mouvements de rébellion au Soudan et que le danger qu’il représente aux yeux des autorités soudanaises a augmenté du fait de la légitimité qu’il a acquise en lien avec le conflit au Darfour, entraînant un comportement plus sévère de la part des autorités soudanaises à l’encontre des membres du JEM. L’appartenance du requérant au JEM depuis plusieurs années constitue dès lors un facteur de risques de persécutions.
49. La Cour constate que les activités politiques en Suisse du requérant sont documentées depuis octobre 2013, soit depuis plus de trois ans, mais considère toutefois que son engagement politique ne s’est pas réellement intensifié avec le temps (voir, a contrario, A.A. c. Suisse, précité, § 42). Cette appréciation n’est pas remise en cause par ses activités politiques postérieures à l’arrêt final du TAF du 4 juin 2014, alléguées pour la première fois devant la Cour. Par ailleurs, la Cour est d’avis que le profil politique du requérant au sein de l’opposition au régime soudanais en général et du JEM en particulier ne saurait être qualifié de très exposé (ibidem, § 42). En effet, le requérant n’occupe pas de position exposée au sein de JEM, il n’a jamais représenté ce mouvement, son nom n’a pas été cité et il ne s’est pas montré actif sur internet. Si le requérant a allégué avoir participé au Geneva Summit for Human Rights and Democracy, il ne prétend toutefois pas avoir représenté le JEM à cette occasion (voir, a contrario, A.A. c. Suisse, précité, § 43). La Cour considère dès lors que ses activités politiques en Suisse, se limitant à celles d’un simple participant aux activités des organisations de l’opposition en exil, n’étaient pas de nature à attirer l’attention des services de renseignements soudanais. La publication alléguée sur internet de photographies du requérant aux côtés du leader du JEM et la participation alléguée du requérant à une émission de radio, la teneur des propos tenus à l’antenne n’ayant d’ailleurs pas été portée à la connaissance de la Cour, ne sauraient suffire à remettre en cause cette appréciation. Il en va de même des photographies attestant de la participation du requérant aux divers événements mentionnés ci-dessus.
50. La Cour note que le requérant ne saurait se réclamer de liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition en exil de nature à pouvoir le mettre en danger. Elle précise que les photographies du requérant en compagnie du leader du JEM, prises en marge d’une réunion de ce mouvement, ne sauraient suffire à remettre en cause cette appréciation.
51. Vu ce qui précède, la Cour est d’avis que les activités politiques du requérant en exil, qui se limitent à celles d’un simple participant aux activités des organisations de l’opposition en exil, ne sont pas raisonnablement de nature à attirer l’attention des services de renseignements sur sa personne et considère en conséquence que le requérant n’encoure pas de risques de mauvais traitements et de torture en cas de retour au Soudan en raison de ses activités sur place.
52. Enfin, la Cour n’identifie pas de risque de persécutions en lien avec l’appartenance ethnique du requérant, ce dernier n’ayant pas allégué appartenir à une ethnie non arabe du Darfour (voir, a contrario, A.A. c. France, précité, § 58, et A.F. c. France, précité, § 50).
53. Dès lors, la Cour estime que l’exécution de la mesure de renvoi ordonnée contre le requérant n’emporterait violation ni de l’article 2 ni de l’article 3 de la Convention.
IM C. FRANCE arrêt du 2 février 2012 requête n° 9152/09
L’examen de la première demande d’asile du requérant selon la procédure prioritaire ne lui a pas offert de recours effectif
LES FAITS
Le requérant, I.M., est un ressortissant soudanais, né en 1976 et résidant à Perpignan (France). En décembre 2008, muni d’un faux visa français, il se rendit en Espagne afin de passer la frontière et de se rendre en France. Au Soudan, il avait été arrêté par les forces de l’ordre en raison de ses activités au sein d’un mouvement étudiant et de ses liens supposés avec les groupes rebelles du Darfour. Il avait passé huit jours en détention en mai 2008 puis avait été placé pendant deux mois sous surveillance des autorités soudanaises, qui chaque semaine l’interrogeaient en faisant usage de la violence.
Le requérant fut arrêté à son arrivée à la frontière franco-espagnole, pour entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national et pour faux et usage de faux. Il dit avoir exprimé, dès ce moment, son souhait de déposer une demande d’asile, sans qu’il en soit tenu compte. Il fut placé en détention provisoire, puis entendu au tribunal de grande instance de Perpignan qui prononça à son encontre une peine d’un mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers. I.M. dit avoir réitéré sans succès durant l’audience son intention de solliciter l’asile.
Alors qu’il était détenu, le requérant contesta devant le tribunal administratif l’arrêté de reconduite à la frontière qui avait été pris à son encontre par la préfecture le 7 janvier 2009. Le délai imparti de quarante-huit heures pour ce faire ne lui permit pas de rédiger sa demande en français mais seulement en arabe. Le requérant dit n’avoir ensuite disposé que de quelques minutes avant l’audience pour s’entretenir avec l’avocat de permanence en charge de son dossier. Son recours fut refusé au motif qu’aucun élément probant n’avait été apporté pour appuyer les allégations de risque de mauvais traitements au Soudan. Il fut également observé que le requérant n’avait déposé aucune demande d’asile.
LE DROIT
a) Principes généraux applicables
127. Les principes généraux relatifs à l’effectivité des recours et des garanties fournies par les Etats contractants en cas d’expulsion d’un demandeur d’asile en vertu des articles 13 et 3 combinés de la Convention sont résumés dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 286 à 293, 21 janvier 2011). Dans cet arrêt, la Cour a d’abord rappelé le caractère subsidiaire que revêt, par rapport aux systèmes nationaux, le mécanisme de plainte devant elle, puisqu’elle se garde d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire vers le pays qu’il a fui (§§ 286 et 287).
128. Ensuite, la Cour a réitéré les principes inhérents à l’article 13 de la Convention, qui « garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit » (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 288).
129. La Cour reconnaît une marge d’appréciation aux Etats contractants puisque « l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul » (Gebremedhin, précité, § 53, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 289).
130. En revanche, l’effectivité commande des exigences d’accessibilité et de réalité : « pour être effectif, le recours exigé par l’article 13 doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur » (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 112, CEDH 1999-IV, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 290).
131. Examinant les recours ouverts aux demandeurs d’asile en Grèce, la Cour a également réaffirmé « que l’accessibilité en pratique d’un recours est déterminante pour évaluer son effectivité » (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 318).
132. Par ailleurs, l’effectivité implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité, compte tenu en particulier de l’importance que la Cour attache à l’article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements. Ainsi, « l’article 13 exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir le redressement approprié, même si les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition » (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 48, CEDH 2000-VIII).
133. Une attention particulière doit être prêtée à la rapidité du recours lui-même puisqu’il n’est pas exclu que la durée excessive d’un recours le rende inadéquat (Doran c. Irlande, no 50389/99, § 57, CEDH 2003-X).
134. L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005-III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari, précité, § 50) ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV (extraits)) ; il requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002-I ; Gebremedhin, précité, § 66, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 290 à 293).
135. Enfin, « selon la Cour, l’exigence résultant de l’article 13 de faire surseoir à l’exécution de la mesure litigieuse ne peut être envisagée de manière accessoire, c’est-à-dire en faisant abstraction de ces exigences quant à l’étendue du contrôle. Le contraire reviendrait en effet à reconnaître aux Etats la faculté de procéder à l’éloignement de l’intéressé sans avoir procédé à un examen aussi rigoureux que possible des griefs tirés de l’article 3 » (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 388).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
136. Avant tout, la Cour relève que la question qui se pose concerne l’effectivité des recours exercés en France par le requérant, dont l’éloignement était en cours, pour faire valoir un grief tiré de l’article 3 de la Convention. En effet, si l’accès à ces voies de recours n’est pas en cause en tant que tel, les obstacles rencontrés pour les exercer sont susceptibles de porter atteinte à leur effectivité. A cet égard, la Cour estime nécessaire de souligner à nouveau qu’en ce qui concerne les requêtes relatives à l’asile et à l’immigration, telles que celle du requérant, elle se consacre et se limite, dans le respect du principe de subsidiarité, à évaluer l’effectivité des procédures nationales et à s’assurer que ces procédures fonctionnent dans le respect des droits de l’homme (voir M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 286 et 287).
137. Dans la présente affaire, le requérant a exercé les voies de recours disponibles dans le système français pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention : il a saisi l’OFPRA puis la CNDA d’une demande d’asile, et il a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Selon le Gouvernement, seul cet arrêté serait susceptible de faire grief au regard de l’article 3 de la Convention, puisqu’il faut en France une décision prise par l’autorité administrative pour éloigner l’étranger, une décision de l’OFPRA ou de la CNDA ne suffisant pas.
138. La Cour constate, comme l’indique d’ailleurs le Gouvernement, que le droit français ménage deux voies pour l’étranger qui allègue être exposé à des risques en cas de retour : le recours contre la mesure d’éloignement devant le juge administratif et le recours devant l’OFPRA, chargé d’examiner la demande d’asile. Dans son examen d’un tel dispositif, la Cour n’a pas à se prononcer sur la question de savoir quelle décision serait susceptible de faire grief, ni quelle voie de recours doit être intentée ou privilégiée par le requérant, ce dernier ayant d’ailleurs exercé tous les recours à sa disposition. La Cour rappelle à cet égard que l’article 13 de la Convention ne va pas jusqu’à exiger une forme particulière de recours et que l’organisation des voies de recours internes relève de la marge d’appréciation des Etats (voir Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 122, série A no 215, et, parmi d’autres, G.H.H. et autres c. Turquie, no 43258/98, § 36, CEDH 2000-VIII).
139. La préoccupation essentielle de la Cour est de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire vers le Soudan. Ces garanties peuvent être fournies par l’ensemble des recours offerts par le droit français, qui peut ainsi remplir les exigences de l’article 13, même si aucun recours n’y répond en entier à lui seul (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 289).
140. La Cour note d’abord que le requérant soutient avoir mentionné son intention de demander l’asile en France dès son interpellation et sa garde à vue, puis depuis le lieu de sa détention et pendant la procédure de comparution immédiate dont il a fait l’objet, sans qu’aucune de ses tentatives ne soit suivie d’effet. Ce n’est qu’une fois placé en rétention administrative qu’il a pu soumettre sa demande d’asile à l’OFPRA. En revanche, le Gouvernement conteste le fait même que le requérant ait présenté une demande d’asile avant sa rétention puisque, compte tenu des dispositifs prévus à cet effet, si le requérant avait fait une telle demande, elle aurait été recueillie, même en détention.
141. La Cour n’est pas convaincue par les arguments exposés par le Gouvernement en la matière. Elle commence par observer que le requérant, gardé à vue puis détenu, n’a pas pu se rendre en personne à la préfecture pour introduire une demande d’asile, comme l’exige le droit français (voir paragraphe 42 ci-dessus). Elle note ensuite que les procès-verbaux de garde à vue du requérant paraissent fournir des éléments, même partiels, quant aux tentatives de demandes d’asile que le requérant allègue avoir faites dès son arrivée en France (voir paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Surtout, la Cour constate que le seul fait que la demande d’asile du requérant ait été considérée comme étant postérieure à l’arrêté de reconduite à la frontière a suffi aux autorités pour considérer qu’elle reposait sur une « fraude délibérée » ou constituait un « recours abusif à l’asile » (sur la base du 4o de l’article L. 741-4 du CESEDA, voir paragraphe 45 ci-dessus). Cet unique élément a donc valu à la demande du requérant un classement en procédure prioritaire, comme l’a confirmé le Gouvernement lors de l’audience. La Cour ne peut que relever le caractère automatique du classement en procédure prioritaire de la demande du requérant, lié à un motif d’ordre procédural, et sans relation ni avec les circonstances de l’espèce, ni avec la teneur de la demande et son fondement.
142. Certes, la Cour est consciente de la nécessité pour les Etats confrontés à un grand nombre de demandeurs d’asile de disposer des moyens nécessaires pour faire face à un tel contentieux, ainsi que des risques d’engorgement du système évoqués par le Gouvernement. A cet égard, la Cour reconnaît, comme le soulignent le Gouvernement et l’UNHCR, que les procédures d’asile accélérées, dont se sont dotés de nombreux Etats européens, puissent faciliter le traitement des demandes clairement abusives ou manifestement infondées. Elle a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’estimer que le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne privait pas l’étranger en rétention d’un examen circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale (Sultani c. France, no 45223/05, §§ 64-65, CEDH 2007-IV (extraits)).
143. Toutefois, la Cour le souligne, tel n’est pas le cas du requérant. En effet, il s’agissait en l’espèce d’une première demande, et non d’un réexamen. Ainsi, l’examen de la demande du requérant par l’OFPRA, selon le mode prioritaire, aurait constitué le seul examen sur le fond en matière d’asile avant son éloignement, s’il n’avait pas obtenu en temps utile une mesure provisoire par la Cour.
144. La Cour observe que le classement en procédure prioritaire de la demande du requérant a induit des conséquences substantielles quant au déroulement de la procédure. Ainsi, le délai imparti au requérant pour présenter sa demande a été réduit de vingt et un à cinq jours, sous peine, en cas de non-respect, de rejet pour tardiveté. La Cour relève le caractère particulièrement bref et contraignant d’un tel délai, s’agissant pour le requérant de préparer, en rétention, une demande d’asile complète et documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées hors rétention selon la procédure normale (voir également à ce sujet les recommandations du CPT et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, paragraphes 77 à 79).
145. De plus, pour la Cour, les difficultés rencontrées par le requérant ont été fortement aggravées par le facteur linguistique, aucune interprétation n’étant prise en charge à ce stade. La Cour constate que, si le requérant a eu recours à la CIMADE, seule association présente dans le centre de rétention administrative de Perpignan, celle-ci n’a pu fournir qu’une assistance limitée.
146. Enfin, la Cour ne peut que souligner que le placement en rétention ne permet pas, dans un délai aussi bref, de rassembler, par l’intermédiaire de contacts extérieurs, tous les éléments susceptibles d’appuyer et de documenter une demande d’asile, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une première demande. Tel a été le cas du requérant qui, lors de l’entretien devant l’OFPRA, s’est trouvé dans l’impossibilité de fournir les éléments demandés quant à son origine ethnique et à la provenance darfouri de sa famille. Or, comme cela ressort du compte rendu d’entretien et de la décision rendue par l’OFPRA, ces éléments ont été déterminants lors de l’examen de la demande du requérant, considérée pour l’essentiel comme étant fondée sur des déclarations très imprécises, voire erronées. C’est en effet dans le cadre d’une motivation très succincte que la décision de l’OFPRA, rendue le jour même du déroulement de l’entretien avec le requérant, se borne à relever les incohérences du récit ainsi que l’absence d’éléments probants.
147. La Cour constate qu’en l’espèce le caractère accéléré de la procédure n’a pas permis au requérant d’apporter des précisions sur ces points, éventuellement par écrit ou au cours d’un second entretien, alors même qu’il a pu, par la suite, dissiper les incohérences supposées et fournir les documents manquants. Si la Cour reconnaît l’importance de la rapidité des recours, elle considère que celle-ci ne devrait pas être privilégiée aux dépens de l’effectivité de garanties procédurales essentielles visant à protéger le requérant contre un refoulement arbitraire vers le Soudan.
148. La Cour ne saurait donc pas se limiter à l’analyse théorique avancée par le Gouvernement selon laquelle la procédure prioritaire ne constitue qu’un régime dérogatoire à la règle de l’examen des dossiers par ordre chronologique d’arrivée, assorti de garanties identiques à celles de la procédure classique. En l’espèce, la Cour estime au contraire que le classement de la demande d’asile du requérant en procédure prioritaire a abouti à un traitement extrêmement rapide, voire sommaire de cette demande par l’OFPRA. Pour la Cour, l’ensemble des contraintes imposées au requérant tout au long de cette procédure, alors qu’il était privé de liberté et qu’il s’agissait d’une première demande d’asile, ont affecté en pratique la capacité du requérant à faire valoir le bien-fondé de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention.
149. Quant à la saisine du tribunal administratif en vue de contester l’arrêté de reconduite à la frontière, la Cour reconnaît que ce recours, pleinement suspensif, a été exercé devant un juge dont la compétence pour examiner les griefs tirés de l’article 3 ne saurait être remise en cause. Ainsi, un tel recours aurait théoriquement pu permettre au juge administratif de réaliser un examen effectif des risques que le requérant affirmait encourir en cas de renvoi vers le Soudan (voir, mutatis mutandis, Y.P. et L.P. c. France, précité, § 55).
150. Toutefois, la Cour observe que le requérant s’est heurté en pratique à des obstacles conséquents dans le cadre de cette procédure. Avant tout, la Cour met en exergue le caractère extrêmement bref du délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour préparer son recours, en particulier par rapport au délai de droit commun de deux mois en vigueur devant les tribunaux administratifs.
151. La Cour relève également que la brièveté de ce délai a contraint le requérant, alors en détention et n’ayant aucun accès à une assistance juridique et linguistique, à soumettre son recours sous la forme « d’un courrier en langue arabe » (voir paragraphe 26). Ce document comportait des arguments peu circonstanciés et dépourvus d’éléments de preuve. Devant le tribunal administratif de Montpellier, le requérant bénéficia de l’assistance d’un interprète et d’un avocat commis d’office, ce dernier reprenant, suite à un bref entretien avec le requérant, l’argumentation que celui-ci avait exposée par écrit, sans pouvoir ajouter d’éléments de preuve. Cette absence d’éléments probants motiva, pour l’essentiel, le rejet de la requête par le magistrat administratif. Ce dernier reprocha également au requérant de ne pas avoir préalablement introduit de demande d’asile, alors qu’il n’est pas démontré que le requérant, détenu, ait pu faire valoir une telle demande.
152. Par conséquent, eu égard à la procédure devant le magistrat administratif, la Cour souligne à nouveau les obstacles rencontrés par le requérant pour introduire une requête motivée et documentée dans un délai particulièrement court, avec l’assistance ponctuelle d’un avocat commis d’office rencontré peu de temps avant l’audience.
153. Au vu de ce qui précède, la Cour émet de sérieux doutes sur le fait que le requérant ait été en mesure de faire valoir efficacement ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention devant le magistrat administratif.
154. Ainsi, quant à l’effectivité du système de droit interne pris dans son ensemble, la Cour constate que si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles, leur accessibilité en pratique a été limitée par plusieurs facteurs, liés pour l’essentiel au classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours à sa disposition et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves alors que le requérant se trouvait en détention ou en rétention.
155. Quant à la qualité de l’examen des demandes assurée par l’OFPRA et le juge administratif, force est de constater qu’elle dépend au moins en partie de la qualité de la saisine. Or, cette dernière est liée aux conditions de préparation des recours et à l’assistance juridique et linguistique dont le requérant a pu disposer, qui, en l’espèce, ont été insuffisantes, comme cela vient d’être démontré (voir paragraphes 140 à 141 et 143 à 146). De plus, la Cour note également, avec le requérant, la durée limitée de l’entretien devant l’OFPRA, s’agissant d’une première demande présentant un caractère complexe.
156. Enfin, la Cour constate que les insuffisances relevées quant à l’effectivité des recours exercés par le requérant n’ont pu être compensées en appel. Sa demande ayant été traitée en procédure prioritaire, le requérant ne disposait en effet d’aucun recours en appel ou en cassation suspensifs, que ce soit devant la CNDA, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat (voir, a contrario, H.R. c. France, no 64780/09, §§ 78 à 80, 22 septembre 2011). La Cour relève en particulier à cet égard l’absence de caractère suspensif du recours formé devant la CNDA de la décision de refus par l’OFPRA de la demande d’asile, lorsque l’examen de celle-ci s’inscrit dans le cadre de la procédure prioritaire.
157. Or, la Cour réitère que seule l’application de l’article 39 de son règlement a pu suspendre l’éloignement du requérant, pour lequel un laissez-passer avait déjà été émis par les autorités soudanaises (voir paragraphes 32 et 100 ci-dessus). En effet, à l’issue des procédures devant l’OFPRA et le juge administratif, rien n’aurait pu empêcher l’éloignement du requérant, ni, par conséquent, la décision de non-lieu à statuer de la CNDA (voir paragraphe 100 ci-dessus).
158. Dès lors, si l’effectivité des recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend certes pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant, la Cour ne peut cependant que conclure que, sans son intervention, le requérant aurait fait l’objet d’un refoulement vers le Soudan, sans que ses demandes aient fait l’objet d’un examen aussi rigoureux que possible (voir, mutatis mutandis, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 388).
159. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et concernant les recours devant la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat. Elle constate en outre que le requérant n’a pas disposé en pratique de recours effectifs lui permettant de faire valoir le bien-fondé du grief tiré de l’article 3 de la Convention alors que son éloignement vers le Soudan était en cours.
160. Partant, elle conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.
AA C. FRANCE du 15 janvier 2015 requête 18039/11
Article 3 : Le Soudan reste un État dangereux pour le renvoi ou l'expulsion d'un étranger vers ce pays
52. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
53. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, à propos de l’article 3). Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996‑V).
54. Concernant les incohérences dans le récit du requérant soulignées par le Gouvernement (paragraphe 51), la Cour considère qu’elles ne sont pas de nature à ôter toute crédibilité aux allégations du requérant. La Cour relève que la description faite par le requérant des faits survenus au Soudan est demeurée constante tant devant elle que devant l’OFPRA. Seule leur chronologie diffère légèrement. De l’avis de la Cour, un simple décalage dans le déroulement chronologique des événements ne constitue pas une incohérence majeure, étant donné notamment que la demande d’asile du requérant a été examinée selon la procédure prioritaire et laissant peu de temps au requérant pour préparer son récit.
55. S’agissant du contexte général, la Cour a récemment rappelé dans l’arrêt A.A c. Suisse (no 58802/12, §§ 39-40, 7 janvier 2014) que la situation des droits de l’homme au Soudan est alarmante, en particulier en ce qui concerne les opposants politiques. La Cour note en particulier que depuis le début de l’année 2014, la situation s’est encore détériorée. Les forces gouvernementales, appuyées par des milices, conduisent d’importantes opérations armées dans les régions du Darfour du nord et du Darfour du sud, région d’origine du requérant. Ces actions visent à combattre les groupes rebelles mais engendre d’importants dommages parmi les populations civiles (voir paragraphes 33-34).
56. Les rapports internationaux consultés font également état de ce que les individus suspectés d’appartenir ou de soutenir les mouvements rebelles continuent d’être arrêtés, détenus et torturés par les autorités soudanaises. De plus, comme l’a rappelé la Cour dans l’arrêt A.A. c. Suisse précité, il apparaît que les individus encourant un risque de mauvais traitement ne sont pas uniquement les opposants au profil marqué mais toute personne s’opposant ou étant suspectée de s’opposer au régime en place.
57. S’agissant des risques personnels encourus par le requérant, celui-ci craint de subir des mauvais traitements en raison d’une part de son appartenance à une ethnie non arabe du Darfour et d’autre part en raison de ses liens supposés avec le JEM.
58. En premier lieu, le requérant indique appartenir à la tribu des Birqid, une tribu non arabe du Darfour. La Cour note qu’un des rapports consultés fait état de ce que la seule appartenance d’un individu à une ethnie non arabe du Darfour constitue pour cet individu un risque de persécutions. À ce titre, la Cour observe que si le Gouvernement estime que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments attestant de son origine ethnique, son appartenance à une ethnie non arabe n’a toutefois été remise en cause par aucune autorité administrative ou judiciaire. Dès lors, l’appartenance du requérant à une minorité ethnique victime de persécutions répétées constitue un premier facteur de risque.
59. En second lieu, s’agissant de l’appartenance supposée du requérant au JEM, il convient de rappeler qu’il affirme que les autorités soudanaises l’ont interrogé à plusieurs reprises et torturé afin qu’il leur fournisse des informations sur ce mouvement rebelle. Le certificat médical qu’il produit, bien que succinct, rend les allégations de mauvais traitement crédibles dans la mesure où la présence de séquelles d’hématomes sur les jambes est compatible avec le fait que le requérant rapporte avoir été frappé sur les articulations à l’aide de pinces. Ce document n’a pas été commenté par le Gouvernement. Par ailleurs, bien qu’il n’étaye ses allégations par aucun document, le requérant indique avoir été condamné à une peine de prison pour avoir apporté son soutien aux forces d’opposition. Le Gouvernement ne remet pas directement en cause cette version des faits.
60. La Cour est d’avis que la peine infligée au requérant reflète nécessairement le fait que les autorités soudanaises sont convaincues de l’implication de ce dernier dans un mouvement de rébellion quand bien même celui-ci affirme le contraire. De plus, la Cour estime que s’il est manifeste que les autorités locales portent un intérêt particulier aux darfouris transitant par Khartoum après un séjour à l’étranger, le fait que le requérant soit considéré comme un soutien du JEM ne peut qu’aggraver le risque de mauvais traitement à son égard.
61. Malgré les observations du Gouvernement, la Cour retient que le récit du requérant, dont la partie déterminante est crédible, est à rapprocher de la situation de violences endémiques perpétrées à l’égard des membres des ethnies darfouries.
62. Dès lors, la Cour estime qu’en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi, le requérant encoure un risque sérieux de traitements contraires à l’article 3 de la Convention
M E C. FRANCE du 6 juin 2013 requête 50094/10
UNE EXTRADITION VERS L'EGYPTE SERAIT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3 mais le requérant a bénéficié de recours effectifs en droit interne, il n'y a pas de violation de l'article 3 combiné avec l'article 13
VIOLATION DE L'ARTICLE 3
46. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
47. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, à propos de l’article 3) (art. 3).
48. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
49. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
50. Sur la situation générale en Egypte, les rapports consultés dénoncent les nombreuses violences et persécutions subies par les chrétiens coptes d’Egypte au cours des années 2010 et 2011, mais également la réticence des autorités égyptiennes à poursuivre les agresseurs. Les parties ne fournissent aucun élément permettant de penser que la situation des coptes s’est améliorée au cours de l’année 2012. Malgré cela, la Cour, en l’état des informations dont elle dispose, est d’avis que l’on ne peut conclure à un risque généralisé, pour tous les coptes, suffisant à entraîner une violation de l’article 3 en cas de retour vers l’Egypte.
51. Sur les risques personnels encourus en cas de renvoi dans son pays d’origine, le requérant rappelle les persécutions déjà subies en raison de son appartenance à la minorité copte et fait valoir qu’il risque d’en subir à nouveau notamment en raison de sa condamnation par contumace pour des faits de prosélytisme. La Cour note que le requérant produit de nombreux documents dont l’authenticité n’est pas contestée par le Gouvernement et notamment deux convocations, l’une devant un tribunal datant de 2007 et l’autre du 16 juin 2010 émanant de la police d’Assiout, démontrant qu’il est encore aujourd’hui activement recherché. Certes, le requérant encourt trois ans de prison ferme, peine a priori à elle seule insuffisante au regard du seuil de gravité exigé s’agissant de l’article 3 de la Convention. Tout porte à croire cependant que le requérant pourrait, en tant que prosélyte reconnu et condamné, être une cible privilégiée de persécutions et de violences de la part d’intégristes musulmans, qu’il soit libre ou incarcéré. Même si ces risques proviennent de personnes privées et non pas directement de l’Etat, l’absence de réaction de la part des autorités de police face aux plaintes déposées par les chrétiens coptes, dénoncées par les rapports internationaux, instaure un doute sérieux quant à la possibilité pour le requérant de recevoir une protection adéquate de la part des autorités égyptiennes.
52. Ainsi, la Cour estime, au vu du profil du requérant et de la situation des chrétiens coptes en Egypte, qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel qu’il soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités égyptiennes en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
53. Par conséquent, la décision de renvoyer le requérant vers l’Egypte emporterait violation de cette disposition si elle était mise à exécution.
VIOLATION ARTICLE 3 + 13
a) Principes généraux
61. Les principes généraux relatifs à l’effectivité des recours et des garanties fournies par les Etats contractants en cas d’expulsion d’un demandeur d’asile en vertu des articles 13 et 3 combinés de la Convention sont résumés dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, §§ 286 - 293. Dans cet arrêt, la Cour a d’abord rappelé le caractère subsidiaire que revêt, par rapport aux systèmes nationaux, le mécanisme de plainte devant elle, puisqu’elle se garde d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire vers le pays qu’il a fui (§§ 286 - 287).
62. Ensuite, la Cour a réitéré les principes inhérents à l’article 13 de la Convention, qui « garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit » (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 288).
63. La Cour reconnaît une marge d’appréciation aux Etats contractants puisque « l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul » (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 53, CEDH 2007‑II, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 289).
64. L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005‑III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000‑VIII) ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV (extraits)) ; il requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002‑I ; Gebremedhin, précité, § 66, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 290 - 293).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
65. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié en droit français d’un recours effectif pour faire valoir son grief sous l’article 3, au mépris de l’article 13 de la Convention, en raison du traitement de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire
66. La Cour est consciente de la nécessité pour les Etats confrontés à un grand nombre de demandeurs d’asile de disposer des moyens nécessaires pour faire face à un tel contentieux. Elle ne remet pas en cause l’intérêt et la légitimité de l’existence d’une procédure prioritaire, en plus de la procédure normale de traitement des demandes d’asile, pour les demandes dont tout porte à croire qu’elles sont infondées ou abusives. Elle note d’ailleurs que la directive européenne 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres donne à ces derniers la possibilité d’appliquer une procédure accélérée notamment lorsque des éléments clairs et évidents permettent aux autorités de considérer que le demandeur ne pourra pas bénéficier d’une protection internationale, lorsque la demande paraît frauduleuse ou lorsque, sans motif valable, elle n’a pas été présentée dans les délais les plus brefs suivant la date d’entrée sur le territoire.
67. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la compatibilité de la procédure d’asile dite prioritaire appliquée aux demandeurs en rétention et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Dans l’arrêt I.M. c. France précité, §§ 49-63 et §§ 64-74, la Cour a jugé, quant à l’effectivité du système de droit interne pris dans son ensemble, que si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles, leur accessibilité en pratique avait été limitée par plusieurs facteurs, liés pour l’essentiel au classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours à sa disposition et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves alors que le requérant se trouvait en détention ou en rétention (ibid., § 154). La Cour a conclu à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 après avoir constaté qu’il s’agissait d’une première demande d’asile et que le requérant, gardé à vue puis détenu, n’avait pas eu la possibilité de se rendre en personne à la préfecture pour introduire une demande d’asile comme l’exige le droit français (ibid., §§ 141 et 143). Dans l’arrêt Sultani c. France (no 45223/05, §§ 64-65, CEDH 2007‑IV (extraits)), la Cour a, au contraire, estimé que le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne privait pas l’étranger en rétention d’un examen circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale. Le simple fait qu’une demande d’asile soit traitée en procédure prioritaire et donc dans un délai restreint ne saurait en conséquence, à lui seul, permettre à la Cour de conclure à l’ineffectivité de l’examen mené.
68. En l’espèce, la Cour observe que, comme dans l’arrêt I.M. précité, le requérant est un primo-demandeur d’asile et que, du fait du classement en procédure prioritaire, il a disposé de délais de recours réduits et, partant, très contraignants pour préparer, en rétention, une demande d’asile complète et documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées hors rétention selon la procédure normale. La Cour relève cependant qu’à la différence de l’arrêt I.M., le requérant a particulièrement tardé à former sa demande, ce qui a d’ailleurs justifié le classement en procédure prioritaire. En effet, ce n’est qu’en août 2010, lors de son placement en centre de rétention, que le requérant, arrivé pourtant sur le territoire français en septembre 2007, a sollicité l’asile. La Cour n’est pas convaincue par la thèse du requérant selon laquelle ce retard serait dû à son ignorance de l’existence d’une procédure d’asile. Elle en déduit que le requérant a donc disposé de trois années pour présenter une demande d’asile, laquelle aurait bénéficié d’un examen complet dans le cadre de la procédure normale, ou, à tout le moins, pour se procurer les documents de nature à étayer une telle demande d’asile pour parer la mesure d’éloignement qui, en raison du caractère irrégulier de son séjour en France, risquait d’être prise à son encontre.
69. La Cour souligne que lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le requérant a pu former un recours suspensif devant le tribunal administratif et une demande d’asile, également suspensive, devant l’OFPRA. Ces recours sont certes enfermés dans des délais brefs de, respectivement, quarante-huit heures et cinq jours. Eu égard au caractère particulièrement tardif de la demande d’asile du requérant et, partant, à la possibilité qu’il avait de rassembler, au préalable, toute pièce utile pour documenter une telle demande, celui-ci ne peut cependant valablement soutenir que l’accessibilité des recours disponibles a été affectée par la brièveté des délais dans lesquels ceux-ci devaient être exercés et par les difficultés matérielles, notamment linguistiques, qu’il a rencontrées pour obtenir les preuves qui lui étaient nécessaires.
70. Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.
A.M c. FRANCE du 29 avril 2019 requête n° 12148/18
Article 3 : Un condamné pour terrorisme, interdit du territoire français, peut être renvoyé en Algérie sans risque de traitements inhumains et dégradants. Aucun acte de torture ne serait rapporté depuis 2015 !!!
 L’affaire concerne
le renvoi vers l’Algérie du requérant condamné en France en 2015 pour participation à des actes de terrorisme et
interdit définitivement du territoire français. La Cour conclut que la situation
générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie
n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant. La Cour partage la même
conclusion que les juridictions françaises. Elle considère que leur appréciation
est adéquate et suffisamment étayée par les données internes ainsi que celles
provenant d’autres sources fiables et objectives. La Cour considère qu’il
n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que s’il était renvoyé en
Algérie, le requérant y courrait un risque réel d’être soumis à un traitement
contraire à l’article 3 de la Convention et elle estime en conséquence qu’un tel
renvoi n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.
L’affaire concerne
le renvoi vers l’Algérie du requérant condamné en France en 2015 pour participation à des actes de terrorisme et
interdit définitivement du territoire français. La Cour conclut que la situation
générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie
n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant. La Cour partage la même
conclusion que les juridictions françaises. Elle considère que leur appréciation
est adéquate et suffisamment étayée par les données internes ainsi que celles
provenant d’autres sources fiables et objectives. La Cour considère qu’il
n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que s’il était renvoyé en
Algérie, le requérant y courrait un risque réel d’être soumis à un traitement
contraire à l’article 3 de la Convention et elle estime en conséquence qu’un tel
renvoi n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.
LES FAITS
Le requérant, A.M., est un ressortissant algérien, né en 1985. Il est assigné à résidence sur le territoire d’une commune en France, depuis le mois de septembre 2018. A.M. s’installa en France en 2008, sous couvert d’une carte de résident de dix ans. Le 25 septembre 2015, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Il ressort de ce jugement que le requérant était, au moins en 2012, recherché par les autorités algériennes. Le 21 février 2018, le préfet de la Loire adopta un arrêté fixant l’Algérie comme pays de destination, qui fut notifié au requérant le 23 février 2018. Le 5 mars 2018, A.M. saisit le tribunal administratif de Lyon d’un référé-liberté pour obtenir la suspension de son renvoi vers l’Algérie. Le juge des référés rejeta cette demande, le requérant n’ayant produit aucun élément précis, récent et circonstancié faisant clairement apparaître qu’il se trouverait exposé, en Algérie, à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention.
Le 12 mars 2018, A.M. saisit la Cour européenne des droits de l’homme, sur le fondement de l’article 39 de son règlement, d’une demande de mesure provisoire visant à faire suspendre son renvoi vers l’Algérie. Le 13 mars 2018, la Cour accéda à sa demande et demanda au Gouvernement de ne pas exécuter la mesure de renvoi jusqu’à la fin de la procédure devant elle. Le 19 mars 2018, A.M., placé en rétention administrative, forma une demande d’asile visant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejeta cette demande. Le 4 juillet 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rendit un arrêt rejetant le recours formé par A.M. contre la décision de l’OFPRA. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la CNDA. Le 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille rejeta le recours contre l’arrêté préfectoral fixant le pays de destination, au motif que rien n’attestait que A.M. serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention, en cas d’éloignement vers l’Algérie. A.M. interjeta appel de ce jugement. Le 10 septembre 2018, la rétention administrative d’A.M. prit fin et celui-ci fut assigné à résidence sur le territoire d’une commune.
Article 3
La Cour observe que depuis 2015, en Algérie, ont eu lieu de nombreuses évolutions institutionnelles et normatives. La Cour prend note en particulier de la révision de la Constitution algérienne, en 2016, et le renforcement de la garantie d’un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. La même année, le Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS) a été dissous. Il avait été désigné en 2008 par le Comité des Nations Unies contre la torture comme étant potentiellement à l’origine de nombreux cas de traitements cruels, inhumains et dégradants. La Cour observe également que, depuis 2016, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) organise régulièrement pour les officiers de police des formations sur les droits de l’homme. La Cour constate que la plupart des rapports disponibles sur l’Algérie ne font plus état, pour les années 2017 et 2018, d’allégations de tortures à l’encontre de personnes liées au terrorisme. Des organisations de défense des droits de l’homme ont déclaré en 2017 auprès de l’ambassade britannique à Alger n’avoir aucune preuve de l’existence de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour souligne, sur ce point, que A.M. ne semble pas être en mesure d’établir qu’un quelconque tiers, dans une situation comparable à la sienne, aurait effectivement subi des traitements inhumains et dégradants en 2017 ou en 2018. La Cour constate également que le gouvernement français lui a fourni une liste détaillée des mesures d’éloignement vers l’Algérie, mises à exécution à l’égard de ressortissants algériens en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ou islamiste radicale. Aucune de ces personnes n’aurait allégué avoir subi des mauvais traitements aux mains des autorités algériennes. La Cour attache également de l’importance au fait que plusieurs juridictions des Etats membres du Conseil de l’Europe, après un examen approfondi de la situation générale en Algérie et de la situation personnelle des intéressés, ont récemment conclu à l’absence de risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi de personnes liées au terrorisme vers ce pays. Si certaines caractéristiques de la procédure pénale algérienne peuvent éventuellement soulever des doutes quant au respect du droit à un procès équitable, elles ne permettent pas à elles seules de conclure à l’existence d’un risque général de mauvais traitement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, pour telle ou telle catégorie de personnes. La Cour conclut que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant. En ce qui concerne les recherches dont le requérant ferait l’objet du fait de ses liens avec une cellule djihadiste d’Annaba, la Cour relève que le jugement du 25 septembre 2015 fait clairement état de la réalité de celles-ci, tout au moins pour l’année 2012. Toutefois, rien n’indique que le requérant soit toujours recherché pour ces faits, plus de sept ans après leur commission. Par ailleurs, le gouvernement français a transmis à la Cour une note verbale des autorités algériennes, en date du 28 novembre 2018, affirmant qu’A.M. ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire en Algérie et produisant le casier judiciaire de celui-ci, vierge de toute condamnation. En tout état de cause, la Cour constate que la cellule djihadiste d’Annaba à laquelle était lié le requérant, a été démantelée. Ses membres ont été arrêtés, condamnés, puis libérés sans soutenir avoir subi de mauvais traitements alors même qu’ils opéraient sur le sol algérien. Rien n’atteste donc que les autorités algériennes montrent un intérêt particulier pour le requérant. L’Algérie n’a jamais sollicité de la France son extradition ou une copie du jugement le condamnant en France pour des faits liés au terrorisme. Aucun élément probant n’indique que les autorités algériennes soient à sa recherche. S’il est possible que les activités terroristes passées d’A.M. fassent de lui l’objet de mesures de contrôle et de surveillance à son retour en Algérie, voire de poursuites judiciaires déclenchées à l’occasion de son retour, de telles mesures ne constituent pas un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. La Cour estime, en conclusion, que A.M. n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que s’il était renvoyé en Algérie, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ainsi, la Cour partage la conclusion à laquelle sont arrivés l’OFPRA, la CNDA et les tribunaux administratifs de Lyon et de Lille. Elle considère que leur appréciation est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives. En considération de la situation générale en Algérie, ni les liens passés du requérant avec une cellule djihadiste d’Annaba ni la connaissance de sa condamnation par les autorités algériennes ne sont de nature à convaincre la Cour que ce dernier courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Algérie.
La Cour précise que cette conclusion n’est pas remise en cause par l’absence de garanties diplomatiques de la part des autorités algériennes, ces garanties ne s’avérant pas nécessaires. Ce n’est en effet que dans le cadre de l’examen de la demande de mesure provisoire présentée par le requérant que la Cour avait demandé au gouvernement français s’il pouvait obtenir des autorités algériennes des garanties précises permettant de s’assurer que le requérant ne serait pas soumis à des traitements contraires à la Convention après son arrivée en Algérie. A ce stade, la Cour n’avait pas été encore en mesure de procéder à un examen approfondi de la situation prévalant en Algérie et de la situation personnelle d’A.M.
La Cour considère qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que s’il était renvoyé en Algérie, le requérant y courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Elle estime en conséquence qu’un tel renvoi n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.
CEDH
a) Principes généraux
i. Le caractère absolu des obligations découlant de l’article 3
112. La Cour a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Elle est de même parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent à notre époque les États pour protéger leur population de la violence terroriste (Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). Devant une telle menace, elle considère qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner. Toutefois, même en tenant compte de ces facteurs, la Cour rappelle que l’article 3 de la Convention, ainsi qu’elle l’a dit à maintes reprises, consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 77, 23 août 2016).
ii. Principes généraux concernant l’application de l’article 3 dans les affaires d’expulsion
113. La Cour rappelle régulièrement que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (F.G. c. Suède [GC], précité, § 111).
114. Pour établir s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court ce risque réel, la Cour ne peut éviter d’examiner la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3. Au regard de ces exigences, pour tomber sous le coup de l’article 3, le mauvais traitement auquel le requérant affirme qu’il serait exposé en cas de renvoi doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (F.G. c. Suède [GC], précité, § 112).
iii. Le principe d’une évaluation ex nunc des circonstances
115. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour. Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (F.G. c. Suède [GC], précité, § 115).
iv. Le principe de subsidiarité
116. Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (F.G. c. Suède [GC], précité, § 118). La Cour doit toutefois estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives (X c. Pays-Bas, no 14319/17, § 72, 10 juillet 2018).
v. Appréciation de l’existence d’un risque réel
117. Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 128, CEDH 2008). L’appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (F.G. c. Suède [GC], précité, § 115).
vi. La répartition de la charge de la preuve
118. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et qu’il ne s’agit pas d’exiger des intéressés qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu’ils seront exposés à des traitements prohibés (X c. Pays-Bas, précité, § 74). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (Saadi, précité, § 129).
119. En règle générale, on ne peut considérer que le demandeur d’asile s’est acquitté de la charge de la preuve tant qu’il n’a pas fourni, pour démontrer l’existence d’un risque individuel, et donc réel, de mauvais traitements qu’il courrait en cas d’expulsion, un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existant dans le pays de destination. Cette exigence est toutefois assouplie dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’intéressé allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements (J.K. et autres c. Suède, précité, §§ 91-98 et 103).
b) Application de ces principes au cas du requérant
i. Sur la situation générale prévalant en Algérie
120. En ce qui concerne la situation en Algérie, la Cour relève d’emblée que les différents rapports sur ce pays, soumis par les parties ou examinés d’office, ne sont pas parfaitement unanimes sur la question du traitement des personnes liées au terrorisme. Elle prend toutefois note de plusieurs éléments attestant d’une évolution depuis février 2015, moment qu’elle a pris en considération dans son dernier arrêt relatif au renvoi vers l’Algérie d’une personne liée au terrorisme (M.A. c. France, précité).
121. La Cour observe ainsi que de nombreuses évolutions institutionnelles et normatives ont eu lieu depuis 2015. Plus particulièrement, la Cour prend note de la révision de la Constitution algérienne, qui a eu lieu en 2016 et a renforcé la garantie d’un certain nombre de droits et libertés fondamentaux, de même que la dissolution du DRS la même année. Elle constate également que la DGSN organise régulièrement depuis 2016 des formations sur les droits de l’homme pour les officiers de police (voir paragraphes 28-31 ci-dessus).
122. Certes, la Cour relève l’existence de certaines informations inquiétantes, notamment à la lecture des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies concernant le quatrième rapport périodique de l’Algérie (voir paragraphes 34-36 ci-dessus). Toutefois, elle observe que la plupart des rapports disponibles sur l’Algérie ne font plus état, pour les années 2017 et 2018, d’allégations de tortures à l’encontre de personnes liées au terrorisme. Elle estime également significatif le fait que des organisations de défense des droits de l’homme aient déclaré en 2017 auprès de l’ambassade britannique à Alger n’avoir aucune preuve de l’existence de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour souligne sur ce point que le requérant ne semble pas être en mesure d’établir qu’un quelconque tiers, dans une situation comparable à la sienne, aurait effectivement subi des traitements inhumains et dégradants en 2017 ou en 2018. De même, la Cour prend note, avec la prudence qui s’impose, de l’affirmation de la DGSN suivant laquelle cette dernière n’aurait reçu en 2017 aucune information quant à des mauvais traitements de la part du public (voir paragraphes 32-33 et 39 ci-dessus). S’agissant de la dissolution du DRS et de son remplacement par le DSS, la Cour observe que ce dernier est inséré dans un cadre constitutionnel et législatif renouvelé et de nature à encadrer son action, notamment par une protection accrue des droits de l’homme. En tout état de cause, la restructuration des services de sécurité coïncide avec la disparition des allégations de mauvais traitements dans la plupart des rapports internationaux précités.
123. La Cour constate également que le Gouvernement lui a fourni une liste détaillée des mesures d’éloignement vers l’Algérie mises à exécution à l’égard de ressortissants de cet État en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ou islamiste radicale. Le fait qu’aucune de ces personnes n’aurait allégué avoir subi des mauvais traitements aux mains des autorités algériennes ne permet certes pas à la Cour de déduire que le requérant ne serait pas, personnellement, soumis à un risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention en cas de retour en Algérie (voir, dans le même sens, M.A. c. France, précité, § 57). Toutefois, ces informations précises contribuent à l’appréciation par la Cour de la situation générale prévalant dans ce pays.
124. Dans le même sens, la Cour observe que plusieurs juridictions des États membres du Conseil de l’Europe ont récemment conclu à l’absence de risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi de personnes liées au terrorisme vers ce pays. La Cour se réfère particulièrement, à ce titre, à l’arrêt de la Cour administrative fédérale allemande en date du 27 mars 2018 (voir l’annexe XVII). Examinant de manière pertinente la situation générale en Algérie et la situation personnelle de l’intéressé, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, cette juridiction a notamment relevé qu’aucun cas de torture n’a été rapporté en Algérie depuis 2015, alors que des groupes nationaux de défense des droits de l’homme peuvent opérer dans ce pays et publier leurs résultats. Si la Cour n’ignore pas que, depuis une décision de la Special Immigration Appeals Commission en date du 18 avril 2016, le Royaume-Uni semble avoir suspendu les renvois vers l’Algérie de personnes liées au terrorisme, elle observe que cette décision est antérieure aux changements institutionnels et normatifs qu’elle a relevés, ainsi qu’à l’évolution de la plupart des rapports internationaux quant à la situation des droits de l’homme en Algérie.
125. La Cour souligne également que si certaines caractéristiques de la procédure pénale algérienne critiquées par le requérant, à l’instar de la durée maximale de la garde à vue en matière de terrorisme ou de potentielles difficultés d’accès à un avocat ou à un médecin, peuvent éventuellement soulever des doutes quant au respect du droit à un procès équitable, elles ne permettent pas à elles seules de conclure à l’existence d’un risque général de mauvais traitements sous l’angle de l’article 3 de la Convention pour telle ou telle catégorie de personnes.
126. La Cour conclut de ce qui précède que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie n’empêche pas en soi l’éloignement du requérant. Dès lors, la Cour doit rechercher si la situation personnelle de ce dernier est telle qu’il se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 s’il était renvoyé vers ce pays.
ii. Sur la situation personnelle du requérant
127. La Cour note que les craintes du requérant sont fondées sur deux éléments, à savoir les recherches dont il ferait l’objet du fait de ses liens avec une cellule djihadiste d’Annaba, d’une part, et la connaissance par les autorités algériennes de sa condamnation en France et des motifs de celle-ci, d’autre part.
128. S’agissant des recherches dont le requérant affirme faire l’objet du fait de ses liens avec une cellule djihadiste d’Annaba, la Cour relève que le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 25 septembre 2015 fait clairement état de leur réalité, du moins pour l’année 2012. Toutefois, rien n’indique que le requérant soit toujours recherché pour ces faits, plus de sept ans après leur commission. En particulier, le requérant n’a pas fourni à la Cour une copie du mandat d’arrêt dont il soutient l’existence, bien qu’il ait recouvré sa liberté et qu’il affirme disposer de contacts au sein de la police algérienne. En revanche, le Gouvernement français a fait parvenir à la Cour une note verbale des autorités algériennes, en date du 28 novembre 2018, affirmant que le requérant ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire en Algérie et produisant le casier judiciaire de celui-ci, vierge de toute condamnation. La Cour relève que cette note verbale affirme explicitement que « l’intéressé ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire en Algérie ». En tout état de cause, la Cour constate que la cellule djihadiste d’Annaba à laquelle le requérant était lié a été démantelée en 2012. Ses membres ont été arrêtés, condamnés puis libérés sans soutenir avoir subi des mauvais traitements, La Cour attache une importance particulière à ce constat, dans la mesure où, de toute évidence, le requérant n’occupait pas au sein de ce groupe une position susceptible de le singulariser aux yeux des autorités algériennes.
129. S’agissant de la condamnation en France du requérant et des motifs de celle-ci, la Cour est convaincue que les autorités algériennes en ont pleinement connaissance, que ce soit du fait de leurs services de renseignement ou d’échanges diplomatiques avec la France. La divulgation par des médias de l’identité du requérant, à la suite de l’audience tenue devant la Cour (voir paragraphe 19 ci-dessus), ne fait que renforcer cette conviction. Pour autant, rien n’atteste que les autorités algériennes montrent un intérêt particulier pour le requérant. De même, dans la mesure où le requérant n’a de toute évidence plus de contacts avec des représentants d’AQMI depuis de nombreuses années, rien n’indique qu’il possède des informations d’intérêt pour la lutte contre le terrorisme menée par les autorités algériennes. La Cour remarque en particulier que l’Algérie n’a jamais sollicité de la France l’extradition du requérant ou une copie du jugement le condamnant pour des faits liés au terrorisme. En outre, ainsi que la Cour l’a déjà souligné, aucun élément probant n’indique que les autorités algériennes soient à la recherche du requérant. L’affirmation du requérant selon laquelle ses parents auraient été interrogés à son sujet, même à la supposer établie, n’est pas suffisante pour modifier ce constat.
130. En tout état de cause, s’il est possible que les activités terroristes passées du requérant fassent de lui l’objet de mesures de contrôle et de surveillance à son retour en Algérie, voire de poursuites judiciaires déclenchées à l’occasion de ce retour, de telles mesures ne constituent pas, en tant que telles, un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention.
131. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, s’il était renvoyé en Algérie, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, alors même que la charge d’apporter de tels éléments reposait sur lui.
iii. Conclusion
132. La Cour partage ainsi la conclusion à laquelle sont arrivés l’OFPRA, la CNDA et les tribunaux administratifs de Lyon et de Lille, qui, en application du principe de subsidiarité, se sont prononcés avant elle et dont l’appréciation est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives. En effet, en considération de la situation générale en Algérie, ni les liens passés du requérant avec une cellule djihadiste d’Annaba ni la connaissance de sa condamnation par les autorités algériennes ne sont de nature à convaincre la Cour que le requérant courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Algérie.
133. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’absence de garanties diplomatiques fournies par les autorités algériennes, absence que le gouvernement français explique par une réticence générale de ces dernières en la matière et que n’ont pu surmonter les efforts qu’il a déployés. La Cour précise que c’est dans le cadre de l’examen de la demande de mesure provisoire présentée par le requérant qu’elle avait demandé au gouvernement français s’il était en mesure d’obtenir des autorités algériennes des garanties précises permettant de s’assurer que le requérant ne serait pas soumis à des traitements contraires à la Convention après son arrivée en Algérie. À ce stade, la Cour n’avait pas encore été en mesure de procéder à un examen approfondi de la situation générale prévalant en Algérie et de la situation personnelle du requérant. Toutefois, au regard de la conclusion à laquelle est parvenue la Cour à l’issue d’un tel examen (voir les paragraphes 120-132 ci-dessus), elle estime que des garanties diplomatiques ne s’avèrent pas nécessaires.
134. En définitive, la Cour considère qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant, s’il était renvoyé en Algérie, y courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En conséquence, la Cour estime qu’un tel renvoi n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
135. La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.
136. Elle considère que la mesure qu’elle a indiquée au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement (voir le paragraphe 4 ci‑dessus) doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.
M.A. c. FRANCE du 1er février 2018 requête n° 9375
Article 3 pour le renvoi d'un islamiste en Algérie.
Cette affaire sanctionne l'erreur procédurale de la préfecture. Cet arrêt est aussi un rappel pour la France sur les questions actuelles syriennes et irakiennes, où des ressortissants français risquent la peine de mort. Le requérant avait été arrêté en France dans la mouvance du réseau tchétchène des Pyrénées. Mouvance islamiste des Pyrénées, qui a produit notamment la famille Mehrah. Il était donc légitime de s'en débarrasser mais il fallait traiter avec l'Algérie pour que le requérant ne soit pas torturé pendant deux semaines.
Les faits de torture expliqués par la CEDH
22. Le 20 février 2015, à son arrivée en Algérie, le requérant fut remis aux agents du Département du renseignement et de la sécurité (« DRS ») algérien et placé en garde à vue dans un lieu non connu.
23. Le 3 mars 2015, il fut présenté pour la première fois à un magistrat pour être mis en examen des chefs de « crime d’adhésion à un groupe terroriste armé », « crime de tentative de meurtre avec préméditation » et « vol d’une arme de guerre et munitions de guerre du premier groupe ».
24. Le même jour, il fut placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Chlef.
Le requérant y serait toujours détenu, au vu des informations communiquées par les parties à la Cour.
Son avocat en Algérie a formulé une requête aux fins d’extinction des poursuites, qui n’a pas abouti.
Recevabilité
39. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 74 à 77, CEDH 1999‑V, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).
40. La règle de l’épuisement des voies de recours internes implique qu’un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII ; Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 55, CEDH 2009).
41. La Cour a également affirmé que lorsqu’un requérant cherche à éviter d’être renvoyé par un État contractant, il est normalement appelé à épuiser un recours qui a un effet suspensif (Bahaddar c. Pays-Bas, 19 février 1998, §§ 47-48, Recueil 1998-I). Un contrôle juridictionnel, lorsqu’il existe et lorsqu’il fait obstacle au renvoi, doit être considéré comme un recours effectif qu’en principe les requérants doivent épuiser avant d’introduire une requête devant la Cour ou de solliciter des mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de celle-ci en vue de retarder une expulsion (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 90, 17 juillet 2008).
42. Toutefois, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III ; spécialement en matière d’expulsion, Y.P. et L.P., précité, § 53, et Mi.L. c. France (déc.), no 23473/11, § 33, 11 septembre 2012). Ainsi, dans l’affaire Y.P. et L.P. c. France, la Cour a constaté que les requérants avaient présenté une demande d’asile, puis une demande d’admission au séjour, qui avaient été successivement rejetées par l’OFPRA et la Commission de recours des réfugiés (« CRR ») (devenue depuis la CNDA). L’examen de la demande d’asile devait permettre à l’État français de prévenir l’éloignement des requérants vers leur pays d’origine au cas où il serait établi qu’ils risquaient d’y subir des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour a conclu qu’on ne saurait attendre des requérants qu’ils aient introduit encore un recours devant le tribunal administratif pour contester un arrêté de reconduite à la frontière, dans la mesure où leur demande antérieure devant l’OFPRA et leur recours devant la CRR, saisis pour statuer sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention, n’avait pas abouti (Y.P. et L.P., précité, § 56).
43. La Cour note que dans la présente affaire le requérant n’a pas interjeté appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 juin 2006 (voir paragraphe 9 ci‑dessus) mais également qu’il n’a ni contesté devant la CNDA la décision rendue par l’OFPRA, ni contesté l’arrêté du préfet de la Charente du 20 février 2015 ordonnant son expulsion. La Cour observe toutefois que le requérant avait fait usage de tous les recours en matière d’asile, disposant d’un effet suspensif de plein droit. La Cour estime que l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir poursuivi un seul type de voies de recours, à savoir celles qui étaient ouvertes devant l’OFPRA, et de ne pas avoir introduit de recours devant le tribunal administratif ou la CNDA. La Cour considère en effet qu’il ne lui appartient pas d’affirmer qu’une voie de droit serait, à l’égard du requérant, plus opportune qu’une autre dès lors que la voie de recours poursuivie par celui-ci était effective, c’est-à-dire, en matière d’éloignement d’étrangers, qu’elle permettait à l’État de prévenir l’expulsion d’une personne risquant des traitements contraires à l’article 2 ou à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays d’origine.
44. La Cour rappelle le constat, partagé par le Gouvernement, auquel elle était déjà arrivée dans sa précédente décision (M. X c. France (déc.), no 21580/10), concernant le même requérant. Une peine d’interdiction du territoire correspond à une interdiction générale de se trouver ou de se maintenir en France. Si elle entraîne la reconduite à la frontière de l’intéressé, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, elle ne prévoit pas le pays dans laquelle ce dernier doit être renvoyé, cette prérogative appartenant à l’administration qui, dans le cadre de la mise à exécution de l’interdiction du territoire, prend un arrêté fixant le pays de destination. Présentée auprès de la juridiction pénale qui a prononcé la peine, la requête en relèvement permet donc uniquement au condamné d’obtenir le réexamen de la pertinence de l’interdiction du territoire au regard de son passé pénal et de sa situation personnelle. La juridiction saisie se borne ainsi à dire s’il y a lieu ou non de maintenir cette interdiction, ce qui peut éventuellement l’amener à apprécier si la gravité de la sanction est ou non proportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. En revanche, elle ne se prononce pas sur le point de savoir si l’intéressé doit être renvoyé dans tel ou tel pays et n’examine donc pas les risques de traitements contraires à l’article 3 encourus par celui-ci en cas de reconduite dans son pays d’origine. (M. X, précité, §36)
45. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes prévues par l’article 35 § 1 de la Convention. Il y a lieu en conséquence de rejeter, s’agissant du grief tiré par le requérant en son nom propre de la violation de l’article 3 de la Convention, l’exception du Gouvernement.
2. Conclusion
46. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
SUR LE FOND
51. La Cour se réfère aux principes applicables en la matière (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 77‑105, CEDH 2016). Dans la présente affaire, la Cour entend rappeler que, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124‑125, et J.K. et autres c. Suède, précité, § 79). Concernant la charge de la preuve dans les affaires d’expulsion, la jurisprudence constante de la Cour dit qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 ; et que lorsque de tels éléments sont soumis, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (F.G., précité, § 120, Saadi, précité, § 129, NA., précité, § 111, et R.C. c. Suède, no41827/07, 9 mars 2010, § 50).
52. En l’espèce, la Cour observe que le requérant ayant été expulsé vers l’Algérie le 20 février 2015, malgré la mesure provisoire indiquée par la Cour conformément à l’article 39 du règlement (paragraphe 21 ci‑dessus), c’est cette date qu’il convient de prendre en considération pour apprécier s’il existait un risque réel qu’il soit soumis dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 69 et 74, CEDH 2005‑I).
Toutefois, cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d’un requérant (Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no201, pp. 29‑30, §§ 75-76, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 107, série A, Mamatkoulov et Askarov, précité, § 69 et X c. Suisse, no 16744/14, § 62, 26 janvier 2017).
53. La Cour relève que le requérant a été condamné en France pour des faits de terrorisme et, à l’instar de ce qu’elle a rappelé dans l’affaire Daoudi précitée (§ 65), elle réaffirme qu’elle a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Devant une telle menace, la Cour considère qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner.
54. En ce qui concerne la situation en Algérie, la Cour a eu égard, tout d’abord, aux rapports du Comité des Nations Unies contre la torture et de plusieurs organisations non gouvernementales cités dans l’arrêt Daoudi (précité, voir paragraphe 30 ci‑dessus) qui décrivent une situation préoccupante. La Cour n’a été saisie d’aucun élément relatif à l’évolution de la situation en Algérie depuis l’adoption de l’arrêt Daoudi, de nature à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle elle s’est livrée dans cette affaire. Force est en effet de constater que les rapports précités (voir paragraphes 31 à 35 ci‑dessus) datant de 2015, année au cours de laquelle le requérant a été renvoyé en Algérie, signalent de nombreux cas d’interpellations par le DRS, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes soupçonnées d’être impliquées dans le terrorisme international. Selon les sources précitées, ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l’extérieur (avocat, médecin ou famille), peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris à la torture.
Les pratiques dénoncées par Amnesty International et citées par la Cour au paragraphe 37 de l’arrêt Daoudi précité (les interrogatoires incessants à toute heure du jour ou de la nuit, les menaces, les coups, les décharges électriques, l’ingestion forcée de grandes quantités d’eau sale, d’urine ou de produits chimiques et la suspension au plafond par les bras) atteignent sans conteste le seuil requis pour l’application de l’article 3 de la Convention.
Compte tenu de l’autorité et de la réputation des auteurs des rapports précités, de la multiplicité et de la concordance des informations rapportées par les différentes sources, du caractère sérieux et récent des enquêtes et des données sur lesquelles elles se fondent, la Cour ne doute pas de la fiabilité des éléments ainsi collectés. En outre, le Gouvernement n’a pas produit d’indications ou d’éléments susceptibles de réfuter les affirmations provenant de ces sources.
55. La Cour note qu’en l’espèce, la condamnation du requérant pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme (les faits reprochés ayant été commis en France, en Algérie, au Maroc, en Espagne, en Turquie, en Géorgie et en Syrie entre 1999 et 2004) a fait l’objet d’une décision juridictionnelle amplement motivée et détaillée, dont le texte est public.
La Cour relève également que le requérant a effectivement été appréhendé par le DRS dès son arrivée en Algérie et emprisonné dans les conditions rappelées aux paragraphes 22 à 24 du présent arrêt.
56. Si à l’instar du Gouvernement, la Cour s’étonne que le requérant ait attendu presque quatorze ans avant de solliciter l’admission au statut de réfugié, elle constate également que l’OFPRA, mieux placé pour apprécier non seulement les faits, la crédibilité de témoins ainsi que le comportement de la personne concernée (voir F.G., précité , § 118) n’a nullement pris cette circonstance en compte dans sa décision du 17 février 2015 (voir paragraphe 18 ci‑dessus).
57. De surcroît, si le Gouvernement soutient que deux autres personnes condamnées en France pour leur participation à des activités à caractère terroristes ont été renvoyées en Algérie sans s’être prévalu, devant les instances nationales ou devant la Cour, d’un risque quelconque au titre de l’article 3 de la Convention, la Cour ne saurait déduire de ces seules allégations, au demeurant dénuées de toutes précisions permettant d’en apprécier la portée, que le requérant ne serait pas, personnellement, soumis à un risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention en cas de retour en Algérie.
58. Pour l’ensemble de ces motifs, et eu égard en particulier au profil du requérant qui n’est pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme, mais a fait l’objet, pour des faits graves, d’une condamnation en France dont les autorités algériennes ont eu connaissance, la Cour considère qu’au moment de son renvoi en Algérie, il existait un risque réel et sérieux qu’il soit exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 106, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, Ben Salah c. Italie, no 38128/06, § 7, 24 mars 2009, Soltana c. Italie, no 37336/06, §§ 14-15, 24 mars 2009, C.B.Z. c. Italie, no 44006/06, § 7, 24 mars 2009 et Daoudi, précité, § 71).
59. La Cour conclut en conséquence, qu’en renvoyant le requérant vers l’Algérie, les autorités françaises ont violé l’article 3 de la Convention.
Article 34
64. La Cour a rappelé, dans l’affaire Savriddin Dzhurayev c. Russie (no 71386/10, §§ 211 à 213, CEDH 2013 (extraits)), l’importance cruciale et le rôle vital des mesures provisoires dans le système de la Convention.
65. La Cour souligne également que, dans le cadre de l’examen d’un grief au titre de l’article 34 concernant le manquement allégué d’un État contractant à respecter une mesure provisoire, elle ne reconsidère pas l’opportunité de sa décision d’appliquer la mesure en question (Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 92, 10 mars 2009 et Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, § 161, CEDH 2010). Il incombe au gouvernement défendeur de lui démontrer que la mesure provisoire a été respectée ou, dans des cas exceptionnels, qu’il y a eu un obstacle objectif qui l’a empêché de s’y conformer, et qu’il a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer l’obstacle et pour tenir la Cour informée de la situation.
66. La Cour constate, comme le reconnaît le Gouvernement, que la mesure provisoire n’a pas été respectée. Ce dernier soutient ne pas avoir eu matériellement le temps d’empêcher l’expulsion du requérant.
La Cour doit donc déterminer si, en l’espèce, il y avait des obstacles objectifs qui ont empêché le Gouvernement de se conformer à la mesure provisoire en temps voulu (D.B. c. Turquie, no 33526/08, § 67, 13 juillet 2010).
67. La Cour rappelle que le requérant l’avait déjà saisie d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement (requête no 21580/10), qui a été accordée le 26 avril 2010 et n’a pris fin qu’avec le prononcé de la décision M. X, du 1er juillet 2014.
68. La Cour est pleinement consciente qu’il peut être nécessaire pour les autorités compétentes de mettre en œuvre une mesure d’expulsion avec célérité et efficacité. Toutefois, les conditions d’une telle exécution ne doivent pas avoir pour objet de priver la personne reconduite du droit de solliciter de la Cour l’indication d’une mesure provisoire.
69. La Cour relève que la décision de l’OFPRA du 17 février 2015 n’a été notifiée au requérant que le 20 février 2015 à l’occasion du pointage au commissariat de police auquel il était astreint au titre des obligations de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet (paragraphe 21 ci‑dessus) et ce sans qu’il en ait été informé préalablement. Lui ont également été notifiées à cette occasion deux décisions du 20 février 2015 mettant fin à l’assignation à résidence et fixant l’Algérie comme pays de destination.
La Cour note que ces deux décisions visent expressément la décision de l’OFPRA du 17 février 2015 qui n’avait pas encore été portée à la connaissance du requérant, bien que transmise à la préfecture de la Charente et à la brigade de gendarmerie. Par ailleurs, la Cour constate, ainsi que le démontre la note du ministère de l’Intérieur du 18 février 2015 (paragraphe 20 ci‑dessus), qu’à cette date les services de police avaient déjà fixé les modalités retenues pour le transport du requérant à la frontière. La Cour relève également que, dès le 19 février 2015, les autorités consulaires algériennes avaient délivré, à l’insu du requérant, un laissez‑passer à la demande des autorités françaises. Compte tenu de ces préparatifs, le renvoi du requérant vers l’Algérie a eu lieu à peine sept heures après la notification de la décision fixant le pays de destination.
70. La Cour en conclut que les autorités françaises ont créé des conditions dans lesquelles le requérant ne pouvait que très difficilement saisir la Cour d’une seconde demande de mesure provisoire. Ce faisant, elles ont donc délibérément et de manière irréversible, amoindri le niveau de protection des droits énoncés dans l’article 3 de la Convention que le requérant cherchait à faire respecter en introduisant sa demande devant la Cour. Dans les circonstances de l’espèce, l’expulsion a pour le moins ôté toute utilité à l’éventuel constat de violation de la Convention, le requérant ayant été éloigné vers un pays qui n’est pas partie à cet instrument, où il alléguait risquer d’être soumis à des traitements contraires à celle-ci.
71. Dès lors, la Cour conclut que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations découlant de l’article 34 de la Convention.
M.K. C. France irrecevabilité du 24 septembre 2015 requête 76100/13
Irrecevabilité de la requête, l’expulsion d’un algérien condamné pour assassinat vers son pays d’origine ne violerait pas ses droits fondamentaux
Condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour assassinat, le requérant, ressortissant algérien, fit l’objet d’un arrêté d’expulsion vers l’Algérie, en ce qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public français. Craignant des représailles de la part de la famille de la personne qu’il avait assassinée, laquelle était originaire du même quartier que lui à Alger, le requérant forma plusieurs recours contre l’arrêté d’expulsion et introduisit une demande d’asile, en vain.
Estimant que la preuve des risques encourus de représailles n’est pas rapportée, la Cour considère que, à supposer cette volonté de représailles avérée, les autorités algériennes peuvent fournir à M.K. une protection appropriée, surtout s’il s’installe dans une autre partie du pays, à distance de la famille de sa victime.
CEDH
24. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
25. À cet égard, elle se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
26. En particulier, il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129). La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no269).
27. La Cour rappelle qu’en raison du caractère absolu du droit garanti, elle n’exclut pas que « l’article 3 trouve à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique » (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée (idem).
28. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V).
29. En l’espèce, le risque invoqué par le requérant n’émane pas des organes de l’État, il tient, selon lui, aux représailles qu’il risque de subir de la part de la famille de la personne qu’il a assassinée.
30. La Cour observe, ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement, que le requérant a commis un homicide volontaire sur la personne d’un ressortissant algérien et que la famille du requérant en Algérie réside dans le même quartier que celle de sa victime. Elle constate ensuite que le requérant produit plusieurs attestations émanant de personnes de son entourage et certifiant des velléités de vengeance de la famille. Si les juridictions internes sont en principe les mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles, il convient de noter qu’en l’espèce, les juridictions internes divergent quant à la force probante à accorder à ces documents. La CNDA, confirmant la décision de l’OFPRA, les a jugés suffisants pour établir le risque encouru par le requérant en cas de retour en Algérie, alors que les juridictions administratives ont décidé le contraire. Le Gouvernement insiste, quant à lui, sur la force probante douteuse de ces attestations compte tenu de leurs auteurs et de leur manque de précision. La Cour reconnaît, avec le requérant, qu’il est difficile d’obtenir d’autres types de preuves pour ce genre de menaces. Elle ne peut cependant faire abstraction du fait que toutes les attestations émanent de proches du requérant, qu’il s’agisse de membres de sa famille ou d’amis et prend donc en compte les doutes exprimés tant par le Gouvernement que par les juridictions administratives.
31. En tout état de cause, même à supposer avérée la volonté de représailles de la famille de la victime à l’encontre du requérant, la Cour n’est pas convaincue que les autorités algériennes ne puissent pas fournir au requérant une protection appropriée, surtout s’il s’installe dans une autre partie du pays. Se fondant sur un article de journal faisant état de l’abandon et de la misère sociale dans lesquels les habitants de La Glacière ont été laissés par les pouvoirs publics, la CNDA a certes effectué une analyse différente. Devant la Cour, le requérant verse aux débats un autre article issu du même journal décrivant le quartier de La Glacière comme une favela où règne l’insécurité. La Cour note cependant que ces deux articles sont datés d’il y a respectivement 6 et 4 ans et que le requérant ne donne pas plus de précision sur la situation actuelle dans son quartier d’origine.
32. Par ailleurs et surtout, la Cour rappelle que l’article 3 n’empêche pas les États contractants de prendre en considération l’existence d’une possibilité de réinstallation dans une autre région, dès lors que l’intéressé est en mesure d’effectuer le voyage vers la zone concernée, d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer et de s’y établir sans être exposé à un risque réel de mauvais traitements (voir, notamment, H. et B. c. Royaume-Uni, nos 70073/10 et 44539/11, § 91, 9 avril 2013). Elle a ainsi conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi lorsque la réinstallation dans une autre partie du pays était possible, s’agissant de l’Afghanistan (Husseini c. Suède, no 10611/09, 13 octobre 2011), de l’Irak (D.N.M. c. Suède, précité) ou encore de la République démocratique du Congo (Ndabarishye Rugira c. Pays‑Bas (déc.), no 10260/13, 17 février 2015). Si la Cour est parvenue à cette conclusion dans des cas où le risque résultait d’une situation d’insécurité générale ou partielle dans le pays de destination, cette solution est d’autant plus vraie lorsque le risque allégué émane de personnes privées. En l’espèce, comme cela résulte tant de la décision de la CNDA que de l’attestation établie par la tante du requérant, le risque allégué tient aux représailles de personnes privées et est vraisemblable dans une zone restreinte, le quartier de La Glacière à Alger, où les deux familles concernées sont voisines et où la criminalité est décrite comme importante. Certes, la CNDA a estimé que le requérant ne pourrait raisonnablement pas s’établir dans un autre quartier de la ville ou une autre zone du pays en l’absence d’attaches. La Cour note cependant que le requérant n’établit pas qu’il lui serait impossible, en cas de retour en Algérie, de s’installer à distance de la famille de sa victime, y compris si nécessaire, dans une autre partie du pays. Elle estime, à ce titre, que le requérant, qui est un homme célibataire, adulte de 29 ans, peut s’établir dans une zone où il n’a pas de proches parents et, partant, que l’absence d’attaches n’est pas un obstacle à l’installation dans un lieu situé en dehors de la zone de risques allégués (voir, pour une affaire concernant un jeune adulte de 21 ans, l’affaire >Ndabarishye Rugira c. Pays‑Bas précitée).
33. Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion du requérant l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3. En conséquence, il convient de rejeter la requête comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
34. Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin.
AOULMI c. FRANCE du 17 janvier 2006 Requête no 50278/99
Le renvoi d'un algérien en Algérie ne serait curieusement pas un acte inhumain et dégradant
"A. Quant à l’état de santé du requérant
51. Le requérant fait observer que son état de santé reste préoccupant et que doit être pris en compte le risque réel lié à l’évolution de sa maladie mais également les conditions dans lesquelles il serait pris en charge en Algérie. Il rappelle sur ce point qu’un des deux médicaments n’a pas encore reçu d’autorisation de commercialisation en Algérie.
Il ajoute que depuis son retour en Algérie, il ne peut recevoir les soins nécessaires.
52. Sur ce point, le Gouvernement souligne qu’avant qu’il soit procédé à l’expulsion du requérant, deux certificats médicaux avaient été établis. Il ressortait des informations communiquées par le Directeur de la DDASS sur l’état de santé du requérant que celui-ci ne suivait à l’époque aucun traitement et qu’il n’avait d’ailleurs pas demandé de visite de médecin pendant son séjour au centre de rétention.
53. Il expose par ailleurs que, s’agissant du traitement en cause qui associerait deux médicaments, l’un des deux n’est pas commercialisé en Algérie mais peut y être importé et qu’en tout état de cause, il n’est pas davantage accessible au public français. Il en conclut que, si le requérant décidait de suivre un traitement en Algérie, ce qui n’était pas le cas au moment de son expulsion, il pourrait le faire, même si l’un des médicaments n’est pas facilement accessible dans ce pays.
54. La Cour rappelle tout d’abord que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Toutefois, lorsqu’ils exercent leur droit d’expulser pareilles personnes, ils doivent avoir égard à l’article 3 de la Convention, qui consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique. Telle est la raison pour laquelle la Cour a constamment répété, dans ses précédents arrêts portant sur l’extradition, l’expulsion ou l’éloignement de personnes vers des pays tiers, que l’article 3 prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quelque répréhensible qu’ait pu être la conduite de l’intéressé (voir, par exemple, l’arrêt Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2206, § 38, et l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1853, §§ 73-74).
55. Il est vrai que l’article 3 a été plus couramment appliqué par la Cour dans des affaires où le risque que la personne soit soumise à l’un quelconque des traitements interdits découlait d’actes intentionnels des autorités publiques du pays de destination ou de ceux d’organismes indépendants de l’Etat (voir, par exemple, l’arrêt Ahmed, précité, p. 2207, § 44). Par ailleurs, les non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un État contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l’État qui expulse (voir Ndangoya c. Suède (déc.), no 17868/03, 22 juin 2004, Arcila Henao c. Pays-Bas (déc.), no 13669/03, 24 juin 2003, et, mutatis mutandis, D. c. Royaume-Uni, arrêt du 2 Mai 1997, Recueil 1997-III, p. 794, § 54). Toutefois, compte tenu de l’importance fondamentale de l’article 3, la Cour s’est réservé une souplesse suffisante pour traiter de l’application de cet article dans d’autres situations susceptibles de se présenter. Il ne lui est donc pas interdit d’examiner le grief d’un requérant au titre de l’article 3 lorsque le risque que celui-ci subisse dans le pays de destination des traitements interdits provient de facteurs qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article. Il peut en aller ainsi dans des circonstances exceptionnelles telles que l’éloignement d’un non-national dont l’état de santé est critique et qui serait renvoyé dans un pays où il serait privé des soins médicaux (arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 792, §§ 51 à 53). Restreindre ainsi le champ d’application de l’article 3 reviendrait à en atténuer le caractère absolu. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour doit soumettre à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui expulse (arrêt D. c. Royaume-Uni précité, § 49). En outre, afin de se déterminer, elle s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (arrêt H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 37) et étudiera l’affaire à la lumière des données apparues après l’application de l’article 39 de son règlement (Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, §§ 32 à 35, CEDH 2001-I).
56. La Cour recherchera donc s’il existait un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 compte tenu de son état de santé. Pour cela, la Cour évaluera ce risque à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire, et notamment des informations les plus récentes sur la santé du requérant (arrêts précités Ahmed, p. 2207, § 43, et D. c. Royaume-Uni, pp. 792-793, § 50).
57. La Cour estime qu’en l’espèce, le requérant n’a pas prouvé que sa maladie ne pourrait pas être soignée en Algérie. Le fait que le traitement serait moins facile à se procurer dans ce pays qu’en France, à supposer que cela soit exact, n’est pas déterminant du point de vue de l’article 3 (arrêt Bensaid précité, § 38). La Cour relève par ailleurs que, d’après le certificat médical délivré par un médecin inspecteur de santé publique de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Rhône le 13 août 1999, le requérant : « n’a pas produit de document médical postérieur au mois de janvier 1998, qu’il n’a pas sollicité de visite de médecin depuis son admission au centre de rétention et qu’il ne suit actuellement aucun traitement. Je suis ainsi fondé à estimer que son état de santé actuel ne présente pas un caractère préoccupant immédiat. » (voir § 23 ci-dessus).
58. En outre, aux termes du certificat délivré par un médecin algérien le 31 juillet 2005, le requérant souffre d’ « hépatite virale C chronique traitée à l’interféron en France il y a une dizaine d’années sans aucun suivi ni contrôle depuis une dizaine d’années. »
59. La Cour rappelle que le seuil fixé par l’article 3 est élevé, notamment lorsque l’affaire n’engage pas la responsabilité directe de l’État contractant à cause du tort causé, en l’absence de circonstances exceptionnelles comme dans l’affaire D. c. Royaume-Uni précité et à la lumière de son arrêt Bensaid précité et sa jurisprudence récente portant sur l’expulsion et l’éloignement d’étrangers vers des pays tiers (voir Arcila Henao précitée [Colombie], Meho c. Pays-Bas (déc.), no 76749/01, 20 janvier 2004 [Kosovo], Ndangoya précitée [Tanzanie] et Salkic et autres c. Suède (déc.), no 7702/04, 29 juin 2004 [Bosnie et Herzégovine]).
60. Dans ces conditions, bien que consciente que le requérant souffre d’une maladie sérieuse, la Cour n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que son renvoi en Algérie soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la Convention (Dragan et autres c. Allemagne (déc.), no 33743/03, 7 octobre 2004).
B. Quant aux risques encourus par le requérant
61. Pour ce qui est des risques qu’il encourt en Algérie, le requérant précise que, n’étant jamais allé dans ce pays auparavant, il lui est difficile de faire part d’éléments personnalisés.
62. Il expose toutefois que son grand-père a combattu pour la France pendant la première guerre mondiale et que son père s’est engagé aux côtés de la France lors de la guerre d’indépendance de l’Algérie. Il estime donc qu’il encourt des risques en sa qualité de fils de « harki », décoré à ce titre par la France en 1994.
63. Sur ce point, le Gouvernement rappelle que l’OFPRA n’a pas retenu l’existence des risques allégués. Il estime que le requérant n’a démontré l’existence d’aucune menace personnalisée de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Il en conclut qu’en tout état de cause la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne saurait être tenue pour contraire à l’article 3, faute pour lui de démontrer la réalité des risques encourus.
64. La Cour rappelle que l’interdiction des mauvais traitements énoncée à l’article 3 est tout aussi absolue en matière d’expulsion. Ainsi, chaque fois qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3, la responsabilité de l’Etat contractant – la protéger de tels traitements – est engagée en cas d’expulsion (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 103 ; Chahal, précité, § 80 et Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 66, 26 avril 2005 ).
Pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3.
65. En l’espèce, la Cour a examiné les arguments du requérant tirés à la fois de l’histoire de sa famille et de la situation en Algérie. Ces éléments impliquent toutefois des répercussions trop lointaines (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 33, § 85, Kavak c. Allemagne (déc.), no 61479/00, 26 octobre 2000) pour permettre de conclure que l’intéressé, qui n’est jamais allé en Algérie et n’a pas suggéré avoir eu personnellement des activités politiques, courra, à ce titre, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (Müslim c. Turquie, précité, § 69)
66. La Cour réaffirme qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (Vilvarajah et autres, précité, ibidem), d’autant moins qu’en l’espèce une évolution politique est en cours en Algérie et que l’on est en mesure d’espérer que cela entraîne à l’avenir une amélioration de la conjoncture actuelle (Muslim c. Turquie, précité § 70).
67. La Cour conclut dès lors que la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant en Algérie n’a pas emporté violation de l’article 3 de la Convention."
Arrêt DAOUDI c. France du 3 décembre 2009 requête 19576/08
Cet arrêt de condamnation concerne l'éventuelle expulsion d'un Algérien membre d'un groupe affilié à Al-Qaïda en Algérie
65. La Cour relève d'abord que la condamnation du requérant en France portait sur la préparation d'un acte de terrorisme. A cet égard, elle estime nécessaire de souligner à nouveau les difficultés considérables que les Etats rencontrent pour protéger leur population de la violence terroriste. Elle a une conscience aiguë de l'ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l'importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Devant une telle menace, la Cour considère qu'il est légitime que les Etats contractants fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu'elle ne saurait en aucun cas cautionner (voir, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 137, et aussi A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 126, 19 février 2009, et Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008).
66. Eu égard à la prohibition absolue de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants établie par la Convention et déjà rappelée (paragraphe 64 ci-dessus), il revient à la Cour d'évaluer le risque d'exposition à de tels traitements encouru par le requérant en cas de renvoi vers l'Algérie, selon les critères rigoureux établis par sa jurisprudence (Saadi, précité, § 142).
67. Le requérant n'ayant pas été éloigné, mais assigné à résidence sur le territoire français, la Cour prend en considération pour cet examen la date de la procédure se déroulant devant elle.
68. En ce qui concerne la situation en Algérie, la Cour a eu égard, tout d'abord, aux rapports du Comité des Nations Unies contre la torture et de plusieurs organisations non gouvernementales (paragraphes 37 à 49 ci-dessus) qui décrivent une situation préoccupante. Par ailleurs, ces conclusions sont reprises notamment par des rapports du Département d'Etat américain et du ministère de l'Intérieur britannique (paragraphes 50 à 52 ci-dessus). Si les rapports précités font état d'une amélioration notable sur le plan de la sécurité générale en Algérie, force est de constater qu'ils signalent des cas nombreux d'interpellations par le DRS, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme international. Selon les sources précitées, ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l'extérieur (avocat, médecin ou famille), peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris la torture, ce que le gouvernement défendeur n'exclut pas puisqu'il admet l'existence en Algérie de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, même s'il en conteste le caractère systématique.
Les pratiques dénoncées, qui se produiraient, en toute impunité, essentiellement pour obtenir des aveux et des informations utilisées ensuite comme preuves par les tribunaux, incluent les interrogatoires incessants à toute heure du jour ou de la nuit, les menaces, les coups, les décharges électriques, l'ingestion forcée de grandes quantités d'eau sale, d'urine ou de produits chimiques et la suspension au plafond par les bras (paragraphe 37 ci-dessus). De l'avis de la Cour, de telles pratiques atteignent sans conteste le seuil requis par l'article 3 de la Convention, et ce quelles que soient les formulations utilisées dans les rapports précités. Quant à la fréquence des mauvais traitements décrits, aucun élément ne vient démontrer que ces pratiques ont cessé ni même diminué en Algérie en ce qui concerne les personnes soupçonnées d'actes de terrorisme.
Compte tenu de l'autorité et de la réputation des auteurs des rapports précités, de la multiplicité et de la concordance des informations rapportées par les différentes sources, du caractère sérieux et récent des enquêtes et des données sur lesquelles elles se fondent, la Cour ne doute pas de la fiabilité des éléments ainsi collectés. En outre, le Gouvernement n'a pas produit d'indications ou d'éléments susceptibles de réfuter les affirmations provenant de ces sources.
69. Le requérant a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation, en septembre 2001 et par un groupe affilié à Al-Qaïda, d'un acte terroriste à forte connotation symbolique, puisque les intérêts américains en France étaient directement visés.
Cette condamnation, prononcée en première instance et confirmée en appel, a fait l'objet de deux décisions juridictionnelles amplement motivées et détaillées, dont le texte est public. De plus, aussi bien la procédure nationale qu'une partie de celle qui s'est déroulée devant la Cour (mesure provisoire et recevabilité) ont fait l'objet de l'attention des médias internationaux (paragraphes 18 et 23 ci-dessus). Surtout, le Gouvernement confirme que lors de la procédure d'éloignement entamée en avril 2008, les autorités françaises ont saisi le consulat général d'Algérie en vue d'une audition du requérant et ont transmis une notice d'information mentionnant son état civil, l'infraction pour laquelle il avait été condamné et une copie de son passeport algérien. Ces informations ont ensuite été validées par des contacts diplomatiques. Au vu de ces éléments, la Cour estime que la notoriété, auprès des autorités algériennes, du requérant et des raisons de sa condamnation sont désormais avérées.
70. Certes, il apparaît, comme le démontre le Gouvernement, qu'aucun élément n'indique que le requérant ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, ni d'une condamnation de la part des autorités algériennes et que le cadre légal algérien ne prévoit pas qu'une personne puisse être rejugée pour les mêmes faits.
Toutefois, la Cour n'est pas convaincue que ces données soient déterminantes en l'espèce. En effet, il ressort des rapports précités que les personnes impliquées dans des faits de terrorisme sont arrêtées et détenues par le DRS de façon peu prévisible et sans une base légale clairement établie, essentiellement afin d'être interrogées pour obtenir des renseignements, et non dans un but uniquement judiciaire. Les personnes détenues par le DRS ne bénéficient pas de garanties juridiques suffisantes et le fait d'avoir été condamné auparavant à l'étranger ne permet en rien d'exclure le risque d'une interpellation en Algérie (paragraphes 37 in fine et 38 ci-dessus). A cet égard, même si, au vu des exemples mentionnés par les parties, le caractère systématique de l'interpellation par le DRS de personnes impliquées dans des activités terroristes ne paraît pas démontré, en particulier en ce qui concerne les coaccusés du requérant lors du procès en France, la Cour juge particulièrement significatif que plusieurs sources fiables rapportent de nombreux cas de ce type et relatent des détentions avec mise au secret ayant perduré pendant plusieurs mois (paragraphes 37 et 51 ci-dessus). Aucun suivi sur place ne paraît possible, il n'existe pas de système de contrôle permettant de garantir que les détenus ne vont pas être torturés dans des centres secrets et inaccessibles de tous, et il semble exclu que, placé dans de telles conditions, le requérant puisse soumettre à des juridictions nationales ou internationales d'éventuels griefs qu'il pourrait soulever quant aux traitements auxquels il serait soumis (voir, mutatis mutandis, Ben Khemais c. Italie, no 246/07, 24 février 2009).
De plus, et cela n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, l'amnistie prévue par les dispositions de la Charte algérienne pour la paix et la réconciliation nationale n'est pas applicable au requérant. Certes, le gouvernement expose à cet égard que le requérant pourrait bénéficier de l'esprit de la Charte et donc de ses effets puisqu'il a déjà purgé sa peine en France. Toutefois, la Cour estime qu'une telle thèse, fondée sur le seul esprit du texte, ne permet pas d'établir que le requérant pourrait bénéficier de l'amnistie en théorie ou en pratique. Quant à l'argument tiré de la doctrine qu'appliquerait l'Algérie en matière de non bis in idem, il est, aux yeux de la Cour, en tout état de cause sans influence sur le grief ici examiné.
71. Pour tous les motifs précités, et eu égard en particulier au profil de l'intéressé qui n'est pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme, mais a fait l'objet, pour des faits graves, d'une condamnation en France dont les autorités algériennes ont eu connaissance, la Cour est d'avis qu'il est vraisemblable qu'en cas de renvoi vers l'Algérie le requérant deviendrait une cible pour le DRS (voir, mutatis mutandis, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 106, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et aussi, a fortiori quant au profil du requérant, Ben Salah c. Italie, no 38128/06, § 7, 24 mars 2009, Soltana c. Italie, no 37336/06, §§ 14-15, 24 mars 2009, et C.B.Z. c. Italie, no 44006/06, § 7, 24 mars 2009).
Elle relève d'ailleurs que, prenant en compte la nature et le degré de l'implication du requérant dans les réseaux de la mouvance de l'islamisme radical, la Cour nationale du droit d'asile a considéré raisonnable de penser que, du fait de l'intérêt qu'il peut représenter pour les services de sécurité algériens, M. Daoudi pourrait faire l'objet, à son arrivée en Algérie, de méthodes ou de procédés pouvant être regardés comme des traitements inhumains ou dégradants (décision du 31 juillet 2009, paragraphe 28 ci-dessus ; cette décision a fait l'objet d'un pourvoi du requérant devant le Conseil d'Etat - paragraphe 29 ci-dessus -, ce qui n'interfère pas avec l'examen de la présente requête).
72. Partant, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'espèce, des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir le requérant subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention s'il était renvoyé en Algérie.
73. En conséquence, la décision de renvoyer l'intéressé vers l'Algérie emporterait violation de l'article 3 de la Convention si elle était mise à exécution.
H R contre France requête 64780/09 du 22 septembre 2011
L'arrêt Daoudi ci dessus est confirmé concernant le renvoi d'un algérien en Algérie
Le requérant, H.R., est un ressortissant algérien, né en 1952 et résidant à Lyon (France).
A la suite et dans les circonstances de travaux effectués dans la maison de sa sœur en Algérie, les autorités algériennes considérèrent que H.R. avait procuré une aide aux membres d'un groupe terrroriste et engagèrent des poursuites contre lui avec trois autres personnes pour «création et fondation d'un groupe terroriste et tentative de meurtre sur les hommes de la sûreté nationale».
H.R. arriva en France dans le courant de l'année 2000. Deux demandes d'asile lui furent refusées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Commission des recours des réfugiés (CRR), ainsi qu'une demande d'asile territorial par le Ministère de l'intérieur.
Le 17 mai 2004, il fit l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'exécution d'un mois, obligation à laquelle il ne se soumit pas.
Le 10 février 2009, il fut interpellé et le préfet du Rhône lui notifia le jour même par arrêté sa reconduite à la frontière, le pays fixé de renvoi étant l'Algérie. Le tribunal administratif de Lyon le débouta de ses demandes de contestation, ce qui fut confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel. H.R. exprime n'avoir pas formé de pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, un tel recours étant ineffectif selon lui.
Alors que H.R. avait été libéré, à une date non précisée, par un juge des libertés et de la détention pour des raisons de vice de forme de la procédure, il fut de nouveau interpellé, le 26 novembre 2009, et placé en rétention sur la base de l'arrêté délivré contre lui le 10 février 2009. Son renvoi vers l'Algérie dut être différé en raison de l'introduction par lui d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le juge des libertés et de la détention ordonna alors la prolongation de sa rétention.
Le 8 décembre 2009, l'OFPRA rejeta sa demande estimant que « les explications de l'intéressé ne comport[ai]ent aucun élément susceptible d'accréditer la réalité des menaces qui pès[erai]ent sur lui. »
Cette décision lui fut notifiée le lendemain, quand il saisit la Cour européenne des droits de l'homme et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 du Règlement de la Cour. Ce même jour, la Cour décida d'indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas renvoyer H.R. vers l'Algérie.
Le 4 février 2010, H.R. fut condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 15 mois d'emprisonnement, pour des faits de contrefaçon de monnaie, de détention frauduleuse et d'usage de faux documents administratifs.
Il fut incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon, puis libéré, ayant purgé sa peine, à une date non précisée.
Article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants)
La Cour constate que depuis l'arrêt Daoudi (n° 19576/08) du 3 décembre 2009, jusqu'au 23 février 2011 (date de levée de l'état d'urgence par le gouvernement), la situation en Algérie a peu évolué comme en témoignent divers rapports internationaux.
Toutefois, la Cour estime que H.R. n'a pas démontré l'existence d'un risque réel et actuel auquel il serait exposé de la part de terroristes qu'il aurait dénoncés.
Quant au risque encouru de la part des autorités algériennes, la Cour souligne qu'à la différence de l'affaire Daoudi, H.R. n'a pas été condamné en France pour des faits liés au terrorisme, mais pour des faits de contrefaçon de monnaie. Si cette condamnation n'a probablement pas attiré l'attention des autorités algériennes ni de la presse, la Cour ne peut pas pour autant conclure à l'absence de risque pour H.R. en cas de retour en Algérie.
La Cour prend acte de ce qu'il a été jugé et condamné en 1999 par contumace par les juridictions algériennes à la réclusion à perpétuité pour des faits de «création et fondation d'un groupe terroriste et tentative de meurtre sur les hommes de la sûreté nationale».
De l'avis de la Cour, cette condamnation pour des faits liés au terrorisme suffirait à attirer l'attention des autorités algériennes à son arrivée à l'aéroport en cas de renvoi.
Jusqu'à la date de levée de l'état d'urgence, le 23 février 2011, l'armée et les autorités civiles (le Ministère de l'intérieur notamment) étaient en charge de la lutte contre le terrorisme. Plusieurs organisations internationales ont rapporté des cas de tortures exercées, pour mener à bien des activités de renseignement, à l'encontre de personnes suspectées de liens avec le terrorisme. En raison du caractère récent de la levée de l'état d'urgence, la Cour ne dispose pas d'éléments concrets permettant de confirmer ou d'infirmer de telles pratiques. Elle relève que la lutte contre le terrorisme en Algérie est désormais exclusivement confiée à l'armée et que, selon un communiqué de presse émanant du Conseil des ministres algérien commentant deux textes législatifs accompagnant la levée de l'état d'exception, ne serait par là instituée «aucune situation nouvelle» mais que serait poursuivie la «participation de l'armée nationale populaire à la lutte contre le terrorisme jusqu'à son terme.»
Au vu du profil du requérant, lourdement condamné par les juridictions algériennes en raison de liens avec le terrorisme, la Cour estime qu'il existe pour lui un risque réel qu'il soit soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention de la part des autorités algériennes en cas de mise à exécution de la mesure de son renvoi.
Article 13 (droit à un recours effectif) combiné à l'article 3
La Cour estime que H.R. avait à sa disposition un recours de plein droit suspensif devant le tribunal administratif, et qu'il l'a d'ailleurs exercé. Ce recours lui a permis de faire examiner son grief tiré de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Elle juge en conséquence que les exigences de l'article 13 sont, en l'espèce, satisfaites. Elle rejette le grief comme étant mal fondé.
E.H. c. France du 22 juillet 2021 requête no 39126/18
Art 3 : Renvoi vers le Maroc d’un requérant d’origine sahraouie affirmant militer politiquement en faveur de cette cause : non-violation de la Convention
Art 3 • Renvoi au Maroc d’un ressortissant marocain militant pour l’indépendance sahraouie et donc appartenant à un groupe particulièrement à risque, faute d’avoir prouvé de risques personnels • Décisions des autorités nationales dûment motivées • Imprécisions et caractère non circonstancié du récit du requérant entendu quatre fois
Art 13 (+ Art 3) • Exercice de quatre recours effectifs suspensifs de l’exécution du renvoi • Requérant entendu et bénéficiant, en dépit de délais brefs, de garanties pour faire valoir ses prétentions • Assistance d’un interprète, accompagnement par une association conventionnée, représentation par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle
L’affaire concerne le renvoi vers le Maroc d’un requérant qui invoquait le risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en raison de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de cette cause. Sur un plan général, la Cour juge que les ressortissants marocains militant en faveur de l’indépendance du Sahara occidental et de la cause sahraouie constituent un groupe particulièrement à risque. Dans le cas particulier, la Cour partage, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la conclusion à laquelle sont arrivés l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et les tribunaux administratifs de Paris et de Melun qui se sont prononcés dans des décisions dûment motivées, compte tenu de l’absence d’éléments précis au dossier étayant les allégations du requérant tenant à ses craintes liées à son engagement pour la cause sahraouie et aux recherches menées par les autorités marocaines pour le poursuivre et le retrouver. La Cour relève par ailleurs que l’intéressé d’autre part n’a présenté devant elle aucun document ni élément autres que ceux qu’il avait déjà produits devant les autorités nationales et en déduit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne l’effectivité des recours mis à la disposition du requérant dans l’ordre interne, la Cour constate que celui-ci a bénéficié à quatre reprises de recours suspensifs de l’exécution de son renvoi vers le Maroc. Dans le cadre de ces différents recours, il a été entendu à quatre reprises et il a été mis à même, en dépit de la brièveté des délais, de faire valoir utilement ses prétentions grâce aux garanties – assistance d’un interprète, accompagnement par une association conventionnée, désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle – dont il a effectivement bénéficié. Au terme d’une appréciation globale de la procédure, la Cour en déduit que les voies de recours exercées par le requérant, considérées ensemble, ont revêtu, dans les circonstances particulières de l’espèce, un caractère effectif. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
FAITS
Le requérant, E.H., est un ressortissant marocain d’origine sahraouie, né en 1993, domicilié chez son représentant à Paris. E.H. affirme avoir commencé à militer activement pour la cause sahraouie à la fin de ses études secondaires. Il dit avoir été arrêté, détenu arbitrairement et torturé plusieurs fois par la police. En mars 2018, il aurait appris qu’il était recherché par les autorités marocaines et que des policiers l’auraient menacé ainsi que sa famille. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de fuir le Maroc. Il aurait obtenu un passeport, puis un visa « étudiant » délivré par les services du consulat ukrainien de Rabat, puis aurait acheté un billet d’avion au départ de Marrakech en raison de contrôles de police moins stricts qu’à Casablanca. Le 18 juillet 2018, E.H. arriva à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. L’entrée sur le territoire français lui fut refusée au motif qu’il n’était pas détenteur d’un « visa Schengen » ou d’un permis de séjour valable. Il fut placé dans la zone d’attente pour personnes en instance (ZAPI) de l’aéroport. Le 19 juillet 2018, E.H. sollicita son entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Il souhaitait être admis au séjour en France afin de pouvoir présenter une demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). E.H. fut maintenu en zone d’attente pour une durée de quatre jours afin de permettre l’examen de sa demande. Le même jour, E.H. reçut la convocation à l’entretien avec un officier de protection de l’OFPRA prévu le 20 juillet 2018. Cette convocation, traduite en langue arabe, mentionnait la possibilité d’être accompagné par un avocat ou par un représentant agréé de l’une des associations habilitées par l’OFPRA à intervenir en zone d’attente. Le 20 juillet 2018 à 10 heures, E.H., assisté d’un interprète en arabe, fut entendu par un agent de l’OFPRA, qui s’était déplacé dans la zone d’attente. Par un arrêté du 20 juillet 2018 pris au vu de l’avis émis par l’OFPRA, le ministre de l’intérieur refusa d’admettre le requérant sur le territoire français au titre de l’asile en raison du caractère manifestement infondé de sa demande et ordonna son réacheminement vers le Maroc ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible sur le fondement de l’article L. 213 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le 21 juillet 2018, E.H., toujours placé en zone d’attente, forma devant le tribunal administratif de Paris un recours en annulation contre l’arrêté du 20 juillet 2018. Par une ordonnance du 22 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny autorisa le maintien du requérant en zone d’attente pour une durée de huit jours supplémentaires au motif que le recours formé par celui-ci devant le tribunal administratif de Paris était pendant. E.H. fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris. Le 24 juillet 2018, la cour d’appel déclara l’appel contre l’ordonnance du 22 juillet 2018 irrecevable. Par un jugement du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris rejeta la requête dirigée contre l’arrêté du 20 juillet 2018. E.H. ne fit pas appel de ce jugement. Les 26 et 27 juillet 2018, E.H. s’opposa à son réacheminement vers le Maroc et refusa d’embarquer. Le 28 juillet 2018, E.H. refusa à nouveau d’embarquer sur un vol à destination du Maroc. Il fut en conséquence interpellé et placé en garde à vue pour soustraction délibérée à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée sur le territoire français et entra ainsi de facto sur le territoire français. Le 29 juillet 2018, le préfet de la Seine Saint Denis prit un arrêté obligeant E.H. à quitter le territoire français (OQTF) et fixa le Maroc comme pays de destination. E.H. fut placé au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil Amelot. Le 30 juillet 2018, E.H., assisté juridiquement par le Comité Inter Mouvements Auprès des Évacués (la CIMADE), forma devant le tribunal administratif de Melun un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 29 juillet 2018. Le 31 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention autorisa la prolongation de la rétention administrative du requérant pour une durée de vingt-huit jours, ce que la cour d’appel confirma le 1er août 2018. Le 2 août 2018, E.H. présenta une demande d’asile. Le même jour, le préfet édicta à l’encontre de E.H. un arrêté portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et son maintien en CRA. Le préfet précisa que l’OFPRA examinerait la demande d’asile du requérant selon la procédure accélérée. Le 6 août 2018, E.H. présenta, devant le tribunal administratif de Melun un nouveau recours en annulation contre l’arrêté du 2 août 2018. Le 9 août 2018, l’entretien avec un officier de protection de l’OFPRA se déroula par visio-conférence et dura cinquante-cinq minutes. E.H. fut assisté d’un interprète en arabe hassanya. E.H. affirme qu’en raison de l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée, il n’a pas disposé du temps nécessaire pour rassembler l’ensemble des documents. Par une décision du 9 août 2018, l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée, rejeta la demande d’asile. Le 13 août 2018, le tribunal administratif de Melun tint une audience où furent enrôlées et jointes les deux requêtes de M. E H. (l’arrêté du 29 juillet 2018 en tant qu’il fixait le pays de destination et l’arrêté du 2 août 2018). Présent à l’audience, E.H. fut représenté par un avocat d’office et assisté d’un interprète. Le même jour, le tribunal administratif rejeta les requêtes dans un même jugement. E.H. ne fit pas appel de ce jugement. Le 14 août 2018, la décision de l’OFPRA fut notifiée au requérant. Le 16 août 2018, celui-ci refusa d’embarquer dans un vol à destination du Maroc. Le 17 août 2018, il saisit la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours en annulation contre la décision de l’OFPRA portant rejet de sa demande d’asile. Il demanda que sa demande d’asile soit instruite par une formation collégiale, selon la procédure normale. Par ailleurs, il déposa le même jour une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA. Le 17 août 2018, il demanda au préfet de la Seine Saint Denis de saisir les autorités ukrainiennes d’une demande de « réadmission » en Ukraine. Le préfet refusa d’accéder à cette demande. Le 22 août 2018, E.H. saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire en application de l’article 39 de son règlement pour empêcher son éloignement vers le Maroc. La Cour rejeta la demande. E.H. fut éloigné vers le Maroc le 24 août 2018. Le 7 septembre 2018, la CNDA désigna au titre de l’aide juridictionnelle un avocat pour assister le requérant dans le cadre de la procédure devant elle. Le 4 novembre 2019, après avoir entendu lors de l’audience publique du 25 octobre 2019 l’avocat du requérant désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la CNDA rejeta le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA. La décision de la CNDA fut notifiée au requérant le 23 décembre 2019.
ART 3
Article 3 La Cour relève qu’il s’agit de la première affaire de renvoi vers le Maroc dans laquelle elle est amenée à juger du bien fondé d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention soulevé par un requérant qui allègue que les risques auxquels il aurait été exposé résultent de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de cette cause. Il ressort de différents rapports internationaux sur le Maroc que les ressortissants marocains engagés en faveur de l’indépendance du Sahara occidental et les militants pour la cause sahraouie peuvent être regardées comme étant des catégories de la population marocaine particulièrement à risque. En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, la Cour relève tout d’abord que celui-ci a emprunté les deux voies de procédure ouvertes par le droit interne à l’étranger qui allègue être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays d’origine : la saisine de l’OFPRA qui permet, le cas échéant, d’obtenir le statut de réfugié, sous le contrôle de pleine juridiction de la CNDA et la saisine du juge administratif de droit commun de recours en annulation dirigés contre le refus d’entrée en France au titre de l’asile et contre la mesure d’éloignement à destination du Maroc. Après que l’intéressé eut été entendu (à deux reprises par un agent de protection de l’OFPRA et au cours des deux audiences publiques), le tribunal administratif de Paris a jugé que le requérant avait fait état d’éléments imprécis et non circonstanciés sur la nature et l’intensité de son engagement politique et de ses responsabilités en tant que militant. L’OFPRA, dans sa décision de rejet de la demande d’asile de l’intéressé, a estimé que les explications de celui-ci quant à son activité de militant politique en faveur de la cause sahraouie étaient restées peu personnalisées, de même que les menaces dont il aurait fait l’objet depuis 2011 ainsi que les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté ; le tribunal administratif de Melun a dressé le même constat. A l’instar de l’OFPRA et des juridictions précitées, la CNDA a estimé, après avoir entendu l’avocat du requérant, que les pièces au dossier ne permettaient pas de tenir les craintes du requérant comme étant fondées. La Cour relève que le requérant ne présente pas devant elle d’autres documents que ceux déjà examinés par les instances et juridictions internes qui, de façon unanime, ont estimé qu’ils étaient peu probants, notamment en raison de leur caractère stéréotypé. Si le requérant allègue que les autorités marocaines le recherchaient activement avant son départ du Maroc en raison de ses actions militantes, aucun élément du dossier ne vient corroborer cette affirmation qui a également été regardée comme non établie par l’OFPRA et par les tribunaux administratifs de Paris et de Melun. Le requérant n’apporte aucune explication aux incohérences de son récit, restant très évasif quant à la manière dont il a réussi à obtenir passeport avec un visa « étudiant » auprès des autorités consulaires ukrainiennes à Rabat, et à quitter en avion le territoire marocain. La délivrance d’un titre de voyage international à une personne dont les activités avaient déjà attiré l’attention des autorités du pays dont il est le ressortissant paraît hautement improbable. La Cour constate en dernier lieu que le requérant indique qu’il aurait été convoqué à une audience devant un tribunal d’Agadir, mais qu’il ne précise ni les motifs de cette convocation, ni la date, ni la juridiction. De la même façon, la Cour remarque que le requérant demeure très évasif quant aux traitements qu’il aurait subis à son arrivée au Maroc après son éloignement par les autorités françaises et qu’il n’a présenté devant la Cour aucun élément ou document étayant la réalité de ces traitements. Dans ces conditions, et alors même que les ressortissants marocains militant en faveur de l’indépendance du Sahara occidental constituent un groupe particulièrement à risque, la Cour, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ne peut que partager la conclusion à laquelle sont arrivés l’OFPRA, la CNDA et les tribunaux administratifs de Paris et de Melun qui se sont prononcés dans des décisions dûment motivées, eu égard à l’absence d’éléments précis au dossier étayant les allégations du requérant tenant à ses craintes liées à son engagement pour la cause sahraouie et aux recherches menées par les autorités marocaines pour le retrouver et le poursuivre avant son départ du Maroc puis après son retour forcé. L’intéressé d’autre part n’a présenté devant la Cour aucun document ni élément autres que ceux qu’il avait déjà produits devant les autorités nationales. En conséquence, la Cour considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
ART 13 ET ARTICLE 3
La question qui se pose en l’espèce concerne l’effectivité des différents recours exercés par le requérant pour que soit examiné un grief tiré de l’article 3 de la Convention avant son éloignement vers le Maroc alors qu’il était maintenu en zone d’attente puis placé en CRA. La Cour rappelle avoir déjà traité de ces questions respectivement en 2007 et en 2012 dans les affaires Gebremedhi [Gaberamadhien] c. France et I.M. c. France dans lesquelles elle a conclu à un constat de violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. La Cour constate que le législateur a procédé aux modifications législatives nécessaires à la bonne exécution de ces arrêts. La loi du 20 novembre 2007 a prévu que le recours contre la décision portant refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile était suspensif de plein droit. Par ailleurs, l’examen d’une demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention ne se fait plus systématiquement selon la procédure accélérée, cette possibilité étant réservée, en vertu les textes applicables, à l’hypothèse dans laquelle cette demande est regardée comme ayant pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. La Cour constate également que les textes qui étaient applicables à la situation du requérant, que ce soit en zone d’attente ou en CRA, ont connu d’importantes modifications par rapport à ceux applicables ou en vigueur dans les affaires Gebremedhin [Gaberamadhien] et I.M. c. France, précitées, du fait de l’intervention de la loi du 29 juillet 2015 et dans une moindre mesure de celle du 7 mars 2016. La Cour en conclut que l’examen au fond des griefs du requérant s’inscrit donc dans le contexte législatif renouvelé. Les griefs du requérant portent sur les obstacles qu’il aurait rencontrés en pratique comme en droit et qui, selon lui, ont concrètement porté atteinte à l’effectivité de l’ensemble des recours qu’il a exercés. Les faits de l’espèce envisagés sous l’angle de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention se décomposent en trois séquences chronologiques qui correspondent aux statuts successifs du requérant : le maintien du requérant en zone d’attente, son placement en CRA et sa situation au Maroc postérieurement à son éloignement par les autorités françaises le 24 août 2018. En ce qui concerne l’effectivité des recours exercés par le requérant pour faire valoir un grief tiré de l’article 3 de la Convention avant son éloignement vers le Maroc alors qu’il était maintenu en zone d’attente La Cour remarque que la décision de refus d’admission sur le territoire français au titre de l’asile est prise par le ministre chargé de l’immigration, après consultation de l’OFPRA, dont un agent doit préalablement procéder à l’audition de l’étranger, en présentiel ou par visio-conférence. La Cour souligne qu’à l’occasion de l’examen de la situation de l’intéressé, la circonstance qu’il allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements doit être particulièrement prise en considération. La Cour relève que lors de l’entretien qui s’est déroulé le 20 juillet 2018, les réponses du requérant aux questions de l’agent de l’OFPRA sont demeurées particulièrement évasives qu’il s’agisse de son engagement pour la cause sahraouie, des persécutions qu’il aurait subies de ce fait, des raisons et des conditions de sa fuite du Maroc ainsi que de ses craintes en cas de retour dans ce pays. La Cour constate par ailleurs que si l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français ne dispose pas d’un recours suspensif de plein droit, il en va différemment du requérant dès lors qu’il avait présenté une demande l’asile à la frontière. En effet, en vertu de l’article L. 213 9 du CESEDA applicable à la date des faits de la cause, le requérant a disposé d’un recours suspensif de plein droit lui permettant de contester devant le tribunal administratif de Paris, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, l’arrêté du 20 juillet 2018 portant refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile. La Cour souligne qu’avant que le juge administratif ait statué sur son recours, le requérant ne pouvait donc pas être renvoyé vers le Maroc où il alléguait risquer de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour souligne qu’elle ne mésestime pas les difficultés que peuvent rencontrer les étrangers maintenus en zone d’attente demandant l’asile et qui découlent notamment du fait que le CESEDA ne prévoit pas le bénéfice d’un dispositif d’aide juridique à la différence de ce qui existe pour les étrangers placés en CRA. Toutefois, la Cour remarque que si le requérant n’a été ni assisté d’un avocat ni accompagné par l’une des associations présentes dans la zone d’attente avant et pendant l’entretien du 20 juillet 2018 avec l’agent de l’OFPRA, un avocat désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle l’a assisté devant le tribunal administratif de Paris. La Cour relève en outre qu’il est de l’office de ce tribunal de contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d’asile et que le tribunal administratif doit, le cas échéant, annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre chargé de l’immigration.
En l’espèce, la Cour note que lors de l’audience du 25 juillet 2018, le requérant a été entendu. Il a été ainsi mis à même de se prévaloir des risques encourus en cas de retour au Maroc et de produire des pièces au soutien de ses allégations. Le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur la demande du requérant par une décision dûment motivée après avoir personnellement entendu l’intéressé. En ce qui concerne l’effectivité des recours exercés par le requérant pour faire valoir un grief tiré de l’article 3 de la Convention avant son éloignement vers le Maroc alors qu’il était placé en centre de rétention administrative La Cour note que, le 29 juillet 2018, le préfet de la Seine Saint Denis a pris une OQTF à l’encontre du requérant et l’a placé en rétention. Le requérant a fait l’objet, après avoir déposé sa demande d’asile, d’un arrêté du 2 août 2018 portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile. Le 30 juillet 2018 puis le 6 août 2018, le requérant a saisi le tribunal administratif de Melun de recours en annulation dirigés respectivement contre la mesure d’éloignement, la fixation du Maroc comme pays de destination, et la décision lui refusant le séjour au titre de l’asile, recours qui ont été rejetés par le même jugement, le 13 août 2018. Par ailleurs, il a saisi le 2 août 2018 l’OFPRA d’une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 9 août 2018. S’agissant, en premier lieu de l’examen par l’OFPRA d’une demande d’asile présentée par une personne retenue en CRA, la Cour constate tout d’abord qu’en vertu du droit applicable aux faits de l’espèce, cet examen ne se fait plus systématiquement selon la procédure accélérée. Quand bien même, les préfectures considèreraient systématiquement que de telles demandes ont été introduites dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, il n’en demeure pas moins que l’article L. 556 1 du CESEDA prévoit que l’appréciation de l’autorité administrative repose sur des critères objectifs tirés notamment de la chronologie et du sérieux de la demande. En vertu de l’article L. 723 2 du même code, l’OFPRA peut toujours décider de statuer selon la procédure normale lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande.
En l’espèce, la Cour constate que le requérant qui a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours en annulation dirigé contre l’OQTF du 29 juillet 2018 ne pouvait pas être éloigné vers le Maroc avant que cette juridiction se prononce sur son recours. Si le délai de quarante-huit heures pour introduire le recours est bref, la Cour remarque que le requérant a bénéficié de l’assistance juridique de la CIMADE pour préparer sa requête et, qu’en vertu de l’article R. 776 26 du code de justice administrative, il avait la possibilité de la compléter jusqu’à la clôture de l’audience devant le tribunal administratif, ce qu’il a d’ailleurs fait. Lors de l’audience devant le TA de Melun au cours de laquelle ont été examinés ensemble les recours dirigés respectivement contre la mesure d’éloignement et contre la décision portant maintien en rétention et refus d’admission au séjour au titre de l’asile, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète et d’un avocat désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle afin de faire valoir sa position. Ces deux recours ont été rejetés par un jugement en date du13 août 2018 qui est devenu définitif. En ce qui concerne l’effectivité du recours du requérant contre la décision de rejet d’asile de l’OFPRA jugé par la CNDA postérieurement au 24 août 2018, date de l’éloignement forcé de l’intéressé vers le Maroc Postérieurement à l’éloignement forcé du requérant par les autorités françaises, la CNDA a conclu à l’absence de risques avérés et a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA. S’il est regrettable que la CNDA se soit crue tenue de tirer des conséquences de l’absence du requérant lors de l’audience devant elle, il n’en demeure pas moins que ni devant cette instance ni devant la Cour, le requérant n’a produit de nouveaux éléments relatifs aux risques qu’il alléguait encourir. Enfin, la Cour considère au regard des circonstances de l’espèce et notamment de l’ensemble des garanties dont a bénéficié le requérant et des recours suspensifs qu’il a exercés avant son éloignement forcé vers le Maroc, que l’absence d’effet suspensif de son recours devant la CNDA n’a pas porté atteinte à son droit à un recours effectif.
Conclusion
La Cour constate que le requérant a bénéficié à quatre reprises de recours suspensifs de l’exécution de son renvoi au Maroc. Dans le cadre de ces différents recours, il a été entendu à quatre reprises et il a été mis à même, en dépit de la brièveté des délais, de faire valoir utilement ses prétentions grâce aux garanties dont il a effectivement bénéficié (assistance d’un interprète, accompagnement par une association conventionnée, désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle). Au terme d’une appréciation globale de la procédure, la Cour déduit que les voies de recours exercées par le requérant, considérées ensemble, ont revêtu, dans les circonstances particulières de l’espèce, un caractère effectif. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
CEDH
a) Principes généraux
127. De manière générale, la Cour rappelle que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non‑nationaux. Cependant, l’éloignement forcé d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays (F.G. c Suède [GC], no 43611/11, § 111, 23 mars 2016 et, A.M. c. France, no 12148/18, § 113, 29 avril 2019).
128. Dans les affaires mettant en cause l’éloignement forcé d’un demandeur d’asile, il n’appartient pas à la Cour d’examiner elle‑même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui. En vertu de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce sont en effet les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis et qui sont, à ce titre, tenues d’examiner les craintes exprimées par les requérants et d’évaluer les risques qu’ils encourent en cas de renvoi dans le pays de destination au regard de l’article 3 de la Convention (M.A. c. Belgique, no 19656/18, § 78, 27 octobre 2020). Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286‑287, CEDH 2011). La Cour doit néanmoins vérifier que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, comme d’autres États contractants ou des États tiers, des agences des Nations unies et des organisations non gouvernementales réputées pour leur sérieux (voir notamment, N.A. c. Royaume‑Uni, no 25904/07, § 119, 17 juillet 2008, F.G. c. Suède [GC], précité, § 117 et, M.S. c. Slovaquie et Ukraine, no 17189/11, § 114, 11 juin 2020).
129. De plus, lorsque les faits litigieux ont donné lieu à une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir, notamment, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 179‑180, CEDH 2011). En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les faits et, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (voir, par exemple, R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010).
130. Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements dans les affaires d’éloignement forcé, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (Chahal c. Royaume‑Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil 1996‑V, Saadi [GC], no 37201/06, § 128, CEDH 2008 et, X. c. Suisse, no 16744/14, § 61, 26 janvier 2017). Concernant la charge de la preuve, la Cour rappelle qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe alors au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (Saadi [GC], précité, § 129‑132, F.G. c. Suède [GC], précité, § 120 et, M.A. c. Belgique, précité, § 79).
131. Eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et la fiabilité des documents produits à leur soutien (X. c. Suisse, précité, § 61). Toutefois, lorsqu’au vu des informations disponibles, il existe de bonnes raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui‑ci de fournir une explication satisfaisante à cet égard (F.G. c. Suède, précité, § 113 et, S.H.H. c. Royaume‑Uni, no 60367/10, § 71, 29 janvier 2013). Néanmoins, la circonstance que certains détails du récit d’un requérant apparaissent quelque peu invraisemblables n’est pas nécessairement de nature à affecter la crédibilité générale de ses allégations (Said c. Pays‑Bas, no 2345/02, § 53, CEDH 2005‑VI et, J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 93, 23 août 2016).
132. La Cour rappelle que l’obligation d’établir la réalité des faits pertinents de la cause pendant la procédure d’examen de la demande d’asile pèse à la fois sur le demandeur d’asile et sur les autorités nationales compétentes. Le demandeur d’asile est normalement la seule partie à pouvoir fournir des informations sur sa situation personnelle. Sur ce point, la charge de la preuve doit donc en principe reposer sur l’intéressé, lequel doit présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qui sont nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Lorsqu’il a été porté à la connaissance des autorités nationales que le demandeur fait vraisemblablement partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, celles-ci doivent chercher à évaluer d’office le risque personnellement encouru par l’intéressé (M.A. c. Belgique, précité, §§ 80‑81).
133. Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui‑ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources disponibles se bornent à décrire une situation générale, les allégations particulières d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve. Ces exigences sont toutefois assouplies dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’intéressé allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements (J.K. et autres c. Suède [GC], précité, § 103). Ainsi, dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, le cas échéant à l’aide des sources susmentionnées, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (J.K. et autres c. Suède [GC], précité, § 104, A.M. c. France, précité, § 119, D et autres c. Roumanie, no 75953/16, § 63, 14 janvier 2020 et, M.A. c. Belgique, précité, § 81).
134. Pour déterminer s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des données qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office. Pour ce qui est de l’appréciation des éléments de preuve, il est établi dans la jurisprudence de la Cour que l’existence du risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’éloignement (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 61, J.K. et autres c. Suède [GC], précité, § 87, X. c. Suisse, précité, § 62 et, N.A. c. Finlande, § 74). Cela ne fait toutefois pas obstacle à ce que la Cour tienne compte d’éléments ultérieurs qui peuvent, le cas échéant, servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien‑fondé des craintes d’un requérant (Vilvarajah et autres c. Royaume‑Uni, 30 octobre 1991, § 107, série A no 215 et autres, Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 69, ECHR 2005‑I et, A.S. c. France, précité, § 60).
b) Application de ces principes en l’espèce
Sur la situation générale au Maroc
136. La Cour relève toutefois qu’il s’agit de la première affaire de renvoi vers le Maroc dans laquelle elle est amenée à juger du bien‑fondé d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention soulevé par un requérant qui allègue que les risques auxquels il aurait été exposé résultent de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de cette cause.
137. À cet égard, la Cour note qu’il ressort des rapports précités que peuvent être regardées comme particulièrement à risque certaines catégories de la population marocaine. La Cour considère que tel est le cas des ressortissants marocains engagés en faveur de l’indépendance du Sahara occidental et les militants pour la cause sahraouie (voir les paragraphes 102 à 110 ci‑dessus). Il s’ensuit que l’appréciation du risque pour le requérant au moment de son éloignement vers le Maroc doit se faire sur une base individuelle compte tenu du fait que les personnes relevant de l’une des catégories particulièrement à risque sont susceptibles, davantage que les autres, d’attirer l’attention des autorités. Ceci étant rappelé, la Cour considère que la protection offerte par l’article 3 de la Convention ne peut entrer en jeu que si le requérant est en mesure d’établir qu’il existait des motifs sérieux de croire que son renvoi au Maroc l’exposait personnellement au risque de subir des traitements contraires à cet article.
Sur la situation personnelle du requérant
138. Ainsi qu’il ressort des principes généraux précédemment énoncés, il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer que son renvoi au Maroc l’a exposé à un risque réel et sérieux de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Si de tels éléments sont produits, il incombe alors à l’État défendeur de dissiper les doutes éventuels à ce sujet. En l’espèce, le requérant se prévaut de son engagement pour la cause sahraouie qui daterait de ses années d’études à Agadir, du fait que les autorités marocaines l’auraient recherché activement avant son départ et qu’après son retour, l’intérêt de celles‑ci à son égard se serait à nouveau manifesté.
139. S’agissant en premier lieu de l’engagement du requérant en faveur de la cause sahraouie, la Cour note le caractère général des éléments avancés par celui‑ci (voir paragraphes 116 à 119 ci‑dessus). Les craintes du requérant sont fondées sur son engagement pour la cause sahraouie lorsqu’il était étudiant à Agadir puis, dans sa ville natale à la fin de ses études (voir paragraphes 4, 6 et 7 ci‑dessus). Il soutient qu’elles auraient été corroborées par les traitements qu’il dit avoir subis après le 24 août 2018, date de son éloignement forcé vers le Maroc par les autorités françaises (voir paragraphes 57 et 58 ci‑dessus).
140. La Cour relève tout d’abord que le requérant a emprunté les deux voies de procédure ouvertes par le droit interne à l’étranger qui allègue être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays d’origine : la saisine de l’OFPRA qui permet, le cas échéant, d’obtenir le statut de réfugié, sous le contrôle de pleine juridiction de la CNDA et la saisine du juge administratif de droit commun de recours en annulation dirigés contre le refus d’entrée en France au titre de l’asile et contre la mesure d’éloignement à destination du Maroc dont la légalité suppose l’absence de risque d’y subir des traitements contraires l’article 3 de la Convention. La Cour constate ensuite que les instances et les juridictions de l’asile ainsi que le juge administratif ont unanimement estimé, au vu des éléments apportés par le requérant – tant son récit que les preuves documentaires fournies à son soutien – et après qu’il eut été personnellement entendu à quatre reprises, qu’elles ne pouvaient tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées en raison des imprécisions et du caractère non circonstancié de son récit.
141. La Cour relève en particulier, qu’après que l’intéressé eut été entendu (à deux reprises par un agent de protection de l’OFPRA et au cours des deux audiences publiques), le tribunal administratif de Paris a jugé que le requérant avait fait état d’éléments imprécis et non circonstanciés sur la nature et l’intensité de son engagement politique et de ses responsabilités en tant que militant (voir paragraphe 27 ci‑dessus), que l’OFPRA dans sa décision de rejet de la demande d’asile de l’intéressé a estimé que les explications de celui‑ci quant à son activité de militant politique en faveur de la cause sahraouie étaient restées peu personnalisées, de même que les menaces dont il aurait fait l’objet depuis 2011 ainsi que les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté (voir paragraphe 43 ci‑dessus) et que le tribunal administratif de Melun a dressé le même constat (voir paragraphe 47 ci‑dessus). La Cour remarque par ailleurs que s’il est regrettable que la CNDA ait cru devoir tirer les conséquences de l’absence du requérant lors de l’audience devant elle qui s’est tenue quatorze mois après son éloignement forcé (voir paragraphe 62 ci‑dessus), alors qu’en outre il était frappé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans (voir paragraphe 31 ci‑dessus), il n’en demeure pas moins qu’à l’instar de l’OFPRA et des juridictions précitées, elle a estimé, après avoir entendu l’avocat du requérant (voir paragraphes 59 et 62 ci‑dessus), que les pièces au dossier ne permettaient pas de tenir pour fondées ses craintes.
142. La Cour relève, à l’instar du Gouvernement que le requérant ne présente pas devant elle d’autres documents que ceux déjà examinés par les instances et juridictions internes citées ci‑dessus qui, de façon unanime, ont estimé qu’ils étaient peu probants, notamment en raison de leur caractère stéréotypé. De façon plus particulière, la Cour remarque que le requérant n’établit pas de lien de parenté avec l’auteur de l’attestation datée du 17 août 2018 qu’il présente comme l’un de ses cousins (voir paragraphe 60 ci‑dessus) et constate, à l’instar du Gouvernement, que les faits relatés dans cette attestation ne correspondent pas au récit fait par cette personne devant la CNDA (voir paragraphes 60 et 96 ci‑dessus).
143. La Cour relève en deuxième lieu que si le requérant allègue que les autorités marocaines le recherchaient activement avant son départ du Maroc le 18 juillet 2018 (voir paragraphe 8 ci‑dessus) en raison des actions militantes qu’il dit avoir menées en tant qu’étudiant à Agadir (voir paragraphe 4 ci‑dessus) puis à Guelmin après ses études, aucun élément du dossier ne vient corroborer cette affirmation qui a également été regardée comme non établie par l’OFPRA et par les tribunaux administratifs de Paris et de Melun. La Cour constate d’ailleurs que le requérant s’est vu délivrer un passeport marocain à son nom revêtu d’un visa « étudiant » obtenu auprès des autorités consulaires ukrainiennes à Rabat et qu’il s’en est servi pour quitter le Maroc en avion (voir paragraphe 7 ci‑dessus). À cet égard, la Cour remarque que le requérant n’apporte aucune explication aux incohérences relevées dans son récit par le Gouvernement, restant très évasif quant à la manière dont il a réussi à obtenir de tels documents et à quitter en avion le territoire marocain, dans les circonstances qu’il prétend avoir traversées en 2018. La Cour rappelle que la délivrance d’un titre de voyage international à une personne dont les activités avaient déjà attiré l’attention des autorités du pays dont il est le ressortissant paraît hautement improbable (voir, K.Y. c. France (déc.), no 14875/09, 3 mai 2011 et, R.K. et autres c. France, précité, § 54).
144. La Cour constate en dernier lieu que pour prouver l’intérêt des autorités marocaines à son égard après son éloignement forcé vers le Maroc par les autorités françaises, le requérant indique qu’il aurait été convoqué à une audience devant un tribunal d’Agadir. La Cour remarque que l’intéressé reste très évasif à ce sujet, ne précisant ni les motifs de cette convocation, ni la date, ni la juridiction devant laquelle il devait se présenter. En tout état de cause, la Cour rappelle que la question à trancher dans la présente affaire n’est pas de rechercher si le requérant risque d’être détenu et interrogé, ou même condamné ultérieurement, par les autorités du pays de destination, ce qui ne serait pas, en soi, contraire à la Convention. Son office se limite à vérifier s’il était raisonnable de penser à la date de son éloignement que le requérant serait maltraité ou torturé, en violation de l’article 3 de la Convention, dans ce pays (voir, X c. Suède, précité, § 55).
145. De la même façon, la Cour souligne que, si elle ne mésestime pas la difficulté pour le requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que l’exécution de la mesure d’éloignement incriminée l’exposerait à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, elle remarque toutefois qu’il demeure très évasif quant aux traitements qu’il aurait subis à son arrivée au Maroc après son éloignement par les autorités françaises et qu’il n’a présenté devant la Cour aucun élément ou document étayant la réalité de ces traitements.
146. Dans ces conditions, et alors même que les ressortissants marocains militant en faveur de l’indépendance du Sahara occidental constituent un groupe particulièrement à risque, la Cour, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ne peut que partager la conclusion à laquelle sont arrivés l’OFPRA, la CNDA et les tribunaux administratifs de Paris et de Melun qui, en application du principe de subsidiarité, se sont prononcés avant elle dans des décisions dûment motivées, eu égard, d’une part, à l’absence d’éléments précis au dossier étayant les allégations du requérant tenant à ses craintes liées à son engagement pour la cause sahraouie et aux recherches menées par les autorités marocaines pour le retrouver et le poursuivre avant son départ du Maroc puis après son retour forcé et, d’autre part, à la circonstance que l’intéressé n’a présenté devant elle aucun document ni élément autres que ceux qu’il avait déjà produits devant les autorités nationales.
147. En conséquence, la Cour considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
A.S. c. FRANCE du 19 avril 2018 requête 46240/15
Articles 3 et 34 : Le requérant a été expulsé au Maroc, pays Prétendument dangereux pour lui, il n'explique pas pourquoi ce pays est dangereux pour lui : non violation article 3.
Violation article 34 : Il a été expulsé , avant même qu'il ait pu faire son recours en suspension d'expulsion devant la CEDH, au titre de l'article 39.
a) Principes applicables
51. À cet égard, la Cour se réfère aux principes exposés dans son arrêt Y.P. et L.P. c. France (no 32476/06, §§ 50 à 53, 2 septembre 2010).
b) Application des principes
52. La Cour rappelle, à titre liminaire, que le requérant avait présenté une demande d’asile auprès de l’OFPRA et qu’il en a été débouté le 25 août 2015. Le 21 décembre 2016, soit postérieurement à la saisine de la Cour, la CNDA a rejeté le recours formé contre cette décision.
Parallèlement, le requérant a contesté l’arrêté d’expulsion du 14 août 2015 devant le TA de Paris, qui a rejeté son recours par un jugement du 30 juin 2016. Le requérant a interjeté appel devant la CAA de Paris.
53. La Cour rappelle que dans des affaires relatives à l’expulsion ou à l’extradition, l’effectivité d’un recours interne requiert notamment que ce recours soit de plein droit suspensif (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007‑II, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 200, CEDH 2012 ou plus récemment Allanazarova c. Russie, no 46721/15, § 97, 14 février 2017).
En l’espèce, elle observe que l’OFPRA ayant statué selon la procédure prioritaire (voir paragraphe 19 ci‑dessus), un recours formé devant la CNDA est dépourvu d’effet suspensif de plein droit (voir paragraphe 42 ci‑dessus). La saisine de l’OFPRA permettait au requérant de demeurer provisoirement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande (Sultani c. France, no 45223/05, §§ 30 à 36, CEDH 2007‑IV (extraits) et Y.P. et L.P., précité, §§ 54 à 57). Celle‑ci impliquait pour l’Office d’examiner la question de savoir si le requérant était victime de persécutions dans son pays d’origine visées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et s’il devait à cet égard se voir reconnaître le statut de réfugié et les droits qui y sont attachés, dont celui du non-refoulement (articles 1er et 33 (1) de la Convention de 1951). En conséquence, l’examen de la demande d’asile du requérant par l’OFPRA devait permettre au Gouvernement de prévenir l’éloignement du requérant à destination du Maroc s’il était établi qu’il y serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
54. La Cour rappelle, de surcroit, que l’article 13 de la Convention n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction dans ce type d’affaires ; il suffit qu’il existe au moins un recours interne qui remplisse les conditions d’effectivité voulues par cette disposition, c’est-à-dire un recours permettant un contrôle attentif et un examen rigoureux d’une allégation quant à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et comportant un effet suspensif de plein droit à l’égard de la mesure litigieuse (A.M. c. Pays-Bas, no 29094/09, §§ 62 et 70, 5 juillet 2016 ou Allanazarova, précité § 98).
55. La Cour considère qu’en l’espèce, la demande d’asile formée par le requérant auprès de l’OFPRA lui a permis de faire examiner la question de la réalité des risques qu’il alléguait encourir dans son pays, tout en demeurant provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. A la lumière de ce qui précède, elle estime que le requérant a épuisé une voie de recours effective. Il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
56. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
57. Le requérant se plaint en premier lieu, d’avoir été expulsé alors qu’il était exposé à un risque de traitements prohibés par l’article 3 de la Convention qui s’est manifesté par sa « disparition » immédiatement après son arrivée au Maroc.
Il se plaint, en second lieu, de ses conditions de détention qui constituent selon lui un traitement inhumain et dégradant.
à l’appui de ses prétentions, il soumet à la Cour une lettre manuscrite rédigée lors de sa détention à Tiflet. Il y décrit tout d’abord ses conditions de détention à la prison de Salé, rendues difficiles notamment par le manque d’hygiène et de sorties. Il allègue avoir été maintenu pendant un mois et demi, sans égard pour son état de santé, dans une cellule surpeuplée, infestée de rats et dénuée de sanitaires salubres.
Après son transfert à la prison de « Tiflet 1 », le requérant dit avoir également été détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. Il soutient avoir été placé dans une cellule surpeuplée, privée d’accès à la lumière du jour et insalubre, dans laquelle il a contracté la gale. Le requérant se plaint également de la promiscuité avec ses codétenus, pour la plupart sous traitement psychiatrique, ainsi que de l’absence d’accès à une hygiène élémentaire. Il affirme avoir entamé, avec dix‑neuf codétenus, une grève de la faim, qui devait prendre fin, selon ses déclarations, après trois mois. Les grévistes de la faim auraient, selon les déclarations du requérant, fait l’objet de mauvais traitements de la part des gardiens de prison.
Au cours du mois d’avril 2016, le requérant a été transféré à la prison de « Tiflet 2 », dans laquelle il a immédiatement été placé à l’isolement, dans une cellule de six mètres carrés, qu’il ne pouvait quitter que quinze minutes par jour. Le requérant affirme avoir été, à une date inconnue, transféré dans une autre cellule. Il soutient également avoir perdu une grande partie de son acuité visuelle en raison des traitements subis.
Le requérant reproche également aux autorités françaises de n’avoir sollicité des autorités marocaines aucune garantie permettant de s’assurer qu’il ne serait ni détenu ni jugé une seconde fois pour les faits ayant déjà justifié sa condamnation en France.
58. Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne démontre pas être exposé à des risques actuels et personnels de mauvais traitements de la part des autorités marocaines. S’il soutient avoir été arrêté dès son arrivée au Maroc puis placé à la maison d’arrêt de Salé, le requérant n’établit nullement avoir effectivement subi des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement relève que l’OFPRA avait considéré qu’il n’existait pas d’éléments pertinents et individualisés accréditant les allégations du requérant.
2. Appréciation de la Cour
59. En l’espèce, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 77‑105, CEDH 2016) et en particulier au principe de subsidiarité. Elle rappelle qu’elle doit toutefois estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’Etat contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 117, CEDH 2016).
60. La Cour observe que le requérant a été expulsé vers le Maroc le 22 septembre 2015, malgré la mesure provisoire indiquée par la Cour conformément à l’article 39 du règlement (paragraphe 23 ci‑dessus). C’est donc cette date qu’il convient de prendre en considération pour apprécier s’il existait un risque réel qu’il soit soumis dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 69 et 74, CEDH 2005‑I). Mais cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d’un requérant (Mamatkoulov et Askarov, précité, §§ 69‑74, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 121, CEDH 2012 et X c. Suisse, no 16744/14, § 62, 26 janvier 2017).
61. La Cour relève que le requérant a été condamné en France pour des actes terroristes et, à l’instar de ce qu’elle a rappelé dans l’affaire Daoudi c. France (no 19576/08, § 65, 3 décembre 2009), elle souhaite réaffirmer qu’elle a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Devant une telle menace, la Cour considère qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner (voir, mutatis mutandis, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 137, CEDH 2008, Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008 et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 126, CEDH 2009).
62. S’agissant tout d’abord des risques auxquels le requérant soutient avoir été exposé en raison de la mise à exécution de son renvoi vers le Maroc, la Cour attache de l’importance au rapport établi par Amnesty International (voir paragraphe 45 ci‑dessus) selon lequel le Maroc a pris des mesures afin de prévenir les risques de torture et de traitements inhumains et dégradants. Elle partage la conclusion à laquelle est arrivée l’OFPRA (voir paragraphe 19 ci‑dessus) : la nature de la condamnation du requérant ainsi que les contextes national et international, profondément et durablement marqués par la lutte contre le terrorisme, expliquent que celui‑ci puisse faire l’objet de mesures de contrôle et de surveillance à son retour au Maroc, sans que celles‑ci puissent, ipso facto, être constitutives d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. De même, la Cour relève, à l’instar de l’OFPRA, que ni devant les instances nationales ni devant elle, le requérant n’a apporté des éléments de nature à établir que les personnes qui sont présentées comme ses complices et poursuivies au Maroc aient été victimes d’agissements assimilables à des traitements inhumains et dégradants lors du déroulement de l’enquête ou de la procédure judicaire qui a suivi.
Cette appréciation des risques auxquels aurait été exposé le requérant au moment de son expulsion est confirmée par les faits postérieurs dont la Cour a eu connaissance. En particulier, la seule circonstance que le requérant ait « disparu » dès son arrivée ne suffit pas à établir le bien‑fondé de ce grief. à cet égard, la Cour observe que, si le requérant a été placé en garde‑à‑vue du 22 septembre 2015 au 2 octobre 2015 avant d’être détenu à la maison d’arrêt de Salé (voir paragraphes 31 et 32 ci‑dessus) puis transféré à la maison d’arrêt de Tiflet, il ressort des pièces du dossier qu’il a eu accès à un avocat dès son placement en détention, qu’il n’est pas soutenu qu’il n’ait pas pu maintenir le contact avec lui tout au long de la procédure et qu’il a été libéré le 21 décembre 2016.
À ce stade de son examen, la Cour estime nécessaire de différencier la présente requête d’autres affaires. La Cour estime ainsi, en premier lieu, qu’elle se distingue de l’affaire M.A. c. France (précitée) dans la mesure où, dans cette dernière, le requérant avait été renvoyé vers un pays qui, à la différence du Maroc, n’avait pas entrepris d’actions concrètes afin de prévenir le risque de torture en détention. En outre, M.A., encore détenu lorsque sa requête a été examinée par la Cour, ne pouvait pas faire connaître à la Cour des renseignements ultérieurs à l’appui de ses prétentions (voir paragraphe 60 ci‑dessus), à la différence du requérant. Pour ce dernier, ces informations confirment que le risque dont il se prévalait ne s’est pas effectivement réalisé. En deuxième lieu, la Cour estime que la présente affaire se distingue également de l’affaire X. c. Suisse (no 16744/14, § 63, 26 janvier 2017) dans laquelle le demandeur, renvoyé vers le Sri Lanka se prévalait de la situation d’un tiers, Y, qui avait effectivement subi des traitements prohibés par l’article 3 lors de son retour dans ce pays. Dans cette affaire, X, à la différence du requérant, avait été en mesure d’établir que le tiers auquel il se comparait avait effectivement subi des traitements inhumains et dégradants.
En l’état de tous les éléments portés à sa connaissance (voir Saadi, précité, § 142), la Cour déduit qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments montrant, en l’espèce, qu’existait au jour de l’expulsion du requérant un risque de traitements contraires à l’article 3.
63. S’agissant des conditions de détention au Maroc, qu’en tout état de cause le requérant n’a pas évoquées devant l’OFPRA, la Cour note que, malgré sa libération et malgré les contacts entretenus avec son avocat marocain, il se contente de verser, à l’appui de ses allégations, un simple document manuscrit décrivant ses conditions de détention, sans l’assortir d’aucun élément de preuve tels, par exemple, des certificats médicaux propres à établir que ses conditions de détention auraient dépassé le seuil de gravité nécessaire pour constituer une violation de l’article 3 de la Convention.
64. Partant, aucune violation de l’article 3 de la Convention ne peut être constatée.
II. SUR LE NON-RESPECT ALLÉGUÉ DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
65. Le requérant soutient qu’en le remettant aux autorités marocaines en violation de la mesure indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 du règlement, l’État défendeur a manqué à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
66. Le Gouvernement a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du caractère prématuré de la requête en ce qu’elle concerne le grief tiré du non‑respect de l’article 34 de la Convention.
Il rappelle que la procédure intentée par le requérant devant les juridictions administratives, tant contre l’arrêté du 14 août 2015 portant expulsion que contre l’arrêté du 21 septembre 2015 fixant le pays de destination, est pendante. Dès lors, l’existence de ce recours encore pendant rend le grief susmentionné prématuré.
67. Le requérant s’oppose à cette thèse. Il fait valoir que les recours cités au paragraphe précédent ne sont pas de nature à réparer les violations alléguées dès lors qu’il a effectivement quitté le territoire français.
2. Appréciation de la Cour
68. La Cour rappelle la nature purement procédurale d’un grief tiré du non‑respect de l’article 34 de la Convention, dont la recevabilité ne peut dès lors faire l’objet d’une contestation (voir Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 118, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV et Pivovarnik c. Ukraine, no 29070/15, § 52, 6 octobre 2016). L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement est donc sans objet.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
69. Le requérant rappelle que le Gouvernement a déployé tous ses efforts afin de l’expulser à des fins de communication politique.
Il souligne que le 21 septembre 2015, la préfecture, contactée par son avocat, avait affirmé à ce dernier qu’aucune décision n’avait encore été prise. De surcroît, le 22 septembre 2015, l’avocat n’est pas arrivé à joindre un interlocuteur dans les services de la préfecture.
Enfin, le requérant souligne que son avion n’avait pas encore décollé à 12 h 45. Il en déduit que le Gouvernement disposait de la possibilité matérielle d’empêcher l’exécution de son expulsion.
70. Le Gouvernement souhaite rappeler qu’il coopère pleinement avec le greffe de la Cour afin d’assurer l’entière exécution des mesures prises sur le fondement de l’article 39 de son règlement. À cet effet, dès sa saisine par le greffe de la Cour, la sous-direction des droits de l’homme du ministère des affaires étrangères et du développement international prend l’attache de la sous‑direction compétente du ministère de l’intérieur afin que la mesure de renvoi soit suspendue sans délai. Le ministère de l’intérieur prend alors immédiatement contact avec les agents des centres de rétention administrative ou des zones d’attente pour s’assurer de l’imminence d’un vol et les informer de la décision de la Cour et de l’obligation de suspendre l’éloignement.
71. S’agissant du cas d’espèce, le Gouvernement rappelle que le greffe de la Cour n’a pris contact avec lui qu’à 10 h 45 et ce, en vue de déterminer la date d’expulsion du requérant. À 12 h 05, le greffe a informé le Gouvernement de l’adoption de la mesure provisoire mentionnée au paragraphe 23 ci‑dessus. Le Gouvernement souligne que cette mesure a été prise avant qu’il n’ait communiqué au greffe les informations qu’il avait sollicitées.
La teneur de la mesure provisoire a été aussitôt relayée aux services compétents du ministère de l’intérieur. Toutefois, le très bref délai séparant la notification de la mesure provisoire (12 h 05) du départ de l’avion (12 h 35) n’a pas permis au Gouvernement d’interrompre le décollage de l’avion.
Le Gouvernement en conclut avoir tout mis en œuvre pour se conformer à la mesure provisoire et conclut qu’il ne peut se voir reprocher une violation de l’article 34 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
72. La Cour a rappelé, dans l’affaire Savriddin Dzhurayev c. Russie (no 71386/10, § § 211 à 213, CEDH 2013 (extraits), l’importance cruciale et le rôle vital des mesures provisoires dans le système de la Convention (voir également Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 144, CEDH 2014 (extraits), Mamazhonov c. Russie, no 17239/13, § 214, 23 octobre 2014 ou encore M.A. c. France, no 9373/15, § 64, 1er février 2018). Elle y renvoie.
73. La Cour souligne également que, dans le cadre de l’examen d’un grief au titre de l’article 34 concernant le manquement allégué d’un État contractant à respecter une mesure provisoire, elle ne reconsidère pas l’opportunité de sa décision d’appliquer la mesure en question (Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 92, 10 mars 2009 et Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, § 161, CEDH 2010). Il incombe au Gouvernement défendeur de lui démontrer que la mesure provisoire a été respectée ou, dans des cas exceptionnels, qu’il y a eu un obstacle objectif qui l’a empêché de s’y conformer, et qu’il a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer l’obstacle et pour tenir la Cour informée de la situation.
74. La Cour constate, comme le reconnaît le Gouvernement, que la mesure provisoire n’a pas été respectée. Il soutient ne pas avoir eu matériellement le temps d’empêcher l’expulsion du requérant.
La Cour doit donc déterminer si, en l’espèce, il y avait des obstacles objectifs qui ont empêché le Gouvernement de se conformer à la mesure provisoire en temps voulu (D.B. c. Turquie, no 33526/08, § 67, 13 juillet 2010).
75. La Cour est pleinement consciente qu’il peut être nécessaire pour les autorités compétentes de mettre en œuvre une mesure d’expulsion avec célérité et efficacité. Toutefois, les conditions d’une telle exécution ne doivent pas avoir pour objet de priver la personne reconduite du droit de solliciter de la Cour l’indication d’une mesure provisoire.
76. La Cour observe qu’il résulte des circonstances de l’espèce (paragraphes 21 et 22 ci-dessus) que, si le ministre de l’intérieur a décidé le 14 août 2015 d’expulser le requérant, cette décision ne lui a été notifiée que le 22 septembre 2015, soit plus d’un mois plus tard. La Cour souligne la durée anormalement longue de cette notification, alors que celle-ci ne devait pas présenter de difficultés particulières, le requérant étant détenu au centre pénitentiaire de Réau.
Elle observe également que le jour de cette notification tardive était également celui de la libération du requérant.
La Cour relève aussi que la notification des deux arrêtés d’expulsion et désignant le Maroc comme pays de destination, dont la réunion était nécessaire à l’éloignement effectif du requérant, n’a été achevée que le jour de la libération du requérant.
La Cour souligne qu’ensuite, dès sa libération, le requérant a été immédiatement emmené à l’aéroport afin d’être effectivement renvoyé vers le Maroc. Elle constate que l’exécution d’une telle expulsion est nécessairement précédée par la réalisation de certaines démarches, dont la plus évidente est la réservation d’un billet d’avion. Elle note également que l’avocat du requérant a affirmé, sans être démenti par le Gouvernement, que la préfecture de Seine et Marne lui avait certifié, ce même jour, qu’aucune décision n’avait encore été prise.
La Cour relève ainsi que le renvoi du requérant vers le Maroc a eu lieu environ cinq heures après la notification de la décision d’expulsion, pourtant édictée plus d’un mois avant sa notification.
La Cour retient qu’il résulte de ce contraste que le requérant n’a pas disposé d’un délai suffisant pour demander de façon effective à la Cour la suspension d’une décision que l’Etat défendeur avait pourtant déjà prise de longue date.
77. La Cour en conclut que les autorités françaises ont délibérément et de manière irréversible, amoindri le niveau de protection des droits énoncés dans l’article 3 de la Convention que le requérant cherchait à faire respecter en introduisant sa demande devant la Cour. Dans les circonstances de l’espèce, l’expulsion a pour le moins ôté toute utilité à l’éventuel constat de violation de la Convention, le requérant ayant été éloigné vers un pays qui n’est pas partie à cet instrument, où il alléguait risquer d’être soumis à des traitements contraires à celle-ci.
78. Dès lors, la Cour conclut que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations découlant de l’article 34 de la Convention.
Ouabour C. Belgique du 2 juin 2015 requête 26417/10
Article 3 : le renvoi du requérant vers le Maroc serait un acte inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.
a) Rappel des principes généraux
62. Il est de jurisprudence constante que la protection contre les traitements prohibés par l’article 3 est absolue et qu’il en résulte que l’éloignement d’une personne du territoire par un État contractant peut soulever un problème au regard de cette disposition, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161).
63. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle est pleinement consciente des difficultés que les États rencontrent pour protéger leur population contre la violence terroriste, laquelle constitue en elle-même une grave menace pour les droits de l’homme. Elle se garde donc de sous-estimer l’ampleur du danger que représente le terrorisme et la menace qu’il fait peser sur la collectivité (Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 183, CEDH 2012 (extraits), et références citées). Elle considère qu’il est légitime, devant une telle menace, que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme (idem). Enfin, la Cour ne perd pas de vue les fondements de l’extradition qui sont d’empêcher les délinquants en fuite de se soustraire à la justice ni l’objectif bénéfique qu’elle poursuit pour tous les États dans un contexte de la criminalité internationale (consulter sur ce point, Soering, précité, § 89).
64. Aucun de ces éléments ne saurait toutefois remettre en cause le caractère absolu de l’article 3. Comme la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, cette règle ne souffre aucune exception. Il y a donc lieu de réaffirmer le principe maintes fois exprimé depuis l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni (15 novembre 1996, §§ 80-81, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) selon lequel il n’est pas possible de prendre en compte les agissements de la personne considérée, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ni de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’éloignement afin de déterminer si la responsabilité de l’État est engagée sur le terrain de l’article 3 (Saadi, précité, § 138 ; voir également Daoudi c. France, no 19576/08, § 64, 3 décembre 2009, et M.S. c. Belgique, no 50012/08, §§ 126-127, 31 janvier 2012).
65. La Cour rappelle en outre les enseignements de l’arrêt Saadi précité (§§ 129-132) dans lequel elle a expliqué la manière dont il convenait d’évaluer s’il y avait des motifs sérieux de croire qu’un requérant, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Pour ce faire, l’examen doit porter sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé. C’est au requérant qu’il appartient en principe de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments. Il ne suffit pas de faire valoir la situation générale du pays de renvoi ou une simple possibilité de mauvais traitements en raison de la conjoncture dudit pays pour établir en soi une violation de l’article 3 ; dans le cas où un requérant fait état d’allégations spécifiques telles que, comme en l’espèce, l’appartenance à un groupe systématiquement exposé à des pratiques de mauvais traitements, ces allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve.
66. Pour ce qui est du moment à prendre en considération, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’éloignement. Toutefois, si le requérant n’a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal, précité, §§ 85-86, Saadi, précité, § 133). Pareille situation se produit généralement lorsque, comme dans la présente affaire, l’expulsion ou l’extradition est retardée par suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour conformément à l’article 39 du règlement. Partant, s’il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui sont déterminantes (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 69, CEDH 2005‑I, Saadi, précité, § 133, et Khaydarov c. Russie, no 21055/09, § 100, 20 mai 2010).
b) Application des principes généraux en l’espèce
67. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la Cour doit examiner si les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers le Maroc sont telles qu’il l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
68. Étant donné que l’intéressé n’a pas encore été extradé, conformément à l’indication par la Cour d’une mesure provisoire en application de l’article 39 de son règlement, le moment à prendre en considération pour évaluer l’existence de ce risque est celui de l’examen de l’affaire par la Cour.
69. Pour ce faire, la Cour s’appuiera sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office. Pour ce qui est des éléments qu’elle se procure d’office, la Cour estime que, compte tenu de la nature absolue de la protection garantie par l’article 3, elle doit se convaincre que l’appréciation effectuée par les autorités nationales est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, comme par exemple d’autres États contractants ou non contractants, des agences des Nations unies et des organisations non gouvernementales réputées pour leur sérieux (Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 136, 11 janvier 2007).
70. Dans sa requête et ses observations, le requérant a expliqué que ses craintes d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 au Maroc étaient justifiés par deux facteurs. Premièrement, se référant à de nombreux rapports publiés par des organisations internationales et des OING, il soutient que la situation générale au Maroc est caractérisée par des pratiques systématiques de torture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Deuxièmement, il soutient qu’il appartient lui-même à la catégorie des personnes visées par ce type de mesures.
71. La Cour doit donc d’abord examiner la problématique des traitements inhumains et dégradants au Maroc dans le contexte de la politique de lutte contre le terrorisme.
72. Elle rappelle les termes dans lesquels elle a analysé cette problématique en 2012 dans l’affaire El Haski précitée (§§ 96-98) :
« 97. (...) [La] Cour relève que le requérant faisait valoir devant les juridictions internes que les déclarations litigieuses émanaient de personnes suspectées d’être impliquées dans les attentats de Casablanca du 16 mai 2003, interrogées au Maroc dans le cadre des enquêtes et procédures qui avaient suivi. Il exposait que ce pays était sévèrement critiqué par des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour des actes de torture et des mauvais traitements infligés de manière systématique aux personnes poursuivies après ces événements, renvoyant en particulier au rapport (...) de Human Rights Watch [du 28 novembre 2005, portant sur les conséquences des attentats précités]. Il précisait que les auteurs des déclarations en question s’étaient plaints d’avoir subi des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants. Il ajoutait que les autorités marocaines n’avaient pas conduit d’enquête suite à ces allégations. Il arguait aussi du fait que la procédure marocaine avait été menée de manière expéditive.
La cour d’appel de Bruxelles a toutefois considéré qu’en se bornant à « citer de manière générale » des rapports d’organisations de défense des droits de l’homme, le requérant n’avait apporté aucun élément concret propre à susciter en la présente cause un « doute raisonnable » s’agissant de violences, tortures ou traitements inhumains ou dégradants dont les personnes auditionnées au Maroc auraient été victimes (...).
98. La Cour considère pour sa part que, dès lors que ces déclarations émanaient de suspects interrogés au Maroc dans le cadre des enquêtes et procédures consécutives aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003, les rapports susmentionnés établissaient l’existence d’un « risque réel » qu’elles aient été obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il en ressort en effet que des mauvais traitements aux fins d’aveux ont été largement pratiqués à l’encontre de ces suspects.
Ainsi, en 2004, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est dit préoccupé par les nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements à l’égard de personnes en détention au Maroc, tout comme le Comité contre la torture des Nations unies, qui a spécifiquement relevé l’augmentation de celles mettant en cause la direction de la surveillance du territoire.
(...)
En outre, il ressort du rapport de Human Rights Watch que la plupart des présumés islamistes détenus dans les semaines qui ont suivi les attentats de Casablanca « ont été maintenus au secret pendant des jours, voire des semaines, et ont été soumis, par les policiers, à différentes formes de mauvais traitements voire, dans certains cas, à des actes de torture afin de leur soutirer des aveux » (...). La FIDH fait état de nombreux cas de privations de liberté arbitraires dans des centres secrets, où les interrogatoires étaient « menés en violation de l’ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention et d’emprisonnement adoptés par les Nations Unies en 1975 et de la convention contre la torture et traitements cruels, inhumains et dégradants ». (...) Amnesty International fait une description similaire des traitements infligés aux personnes détenues à Témara (...).
99. Selon la Cour, ces informations, issues de sources diverses, objectives et concordantes, établissent qu’il existait à l’époque des faits un « risque réel » que les déclarations litigieuses aient été obtenues au Maroc au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. (...) »
73. Ensuite, en 2013, dans l’affaire Rafaa précitée (§§ 29 et 41), la Cour considéra, à la lumière des observations finales du Comité des Nations Unies contre la torture sur le quatrième rapport périodique du Maroc publié en 2011, que la situation des droits de l’homme au Maroc avait peu évolué depuis l’arrêt Boutagni c. France (no 42360/08, § 46, 18 novembre 2010) et que les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées de participation à des entreprises terroristes persistaient.
74. La Cour constate par ailleurs que plus récemment encore, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi que le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies ont chacun publié, à la suite de visites effectuées au Maroc respectivement en 2012 et 2013, un rapport soulignant que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les autorités marocaines continuaient à recourir aux actes de torture et aux mauvais traitements lors de l’arrestation et pendant la détention (voir paragraphes 50-52, ci-dessus). Les derniers rapports en date publiés par Human Rights Watch et Amnesty International (voir paragraphe 54 ci-dessus) confirment que la situation ne s’est pas améliorée.
75. Selon la Cour, ces informations, issues de sources objectives, diverses et concordantes, établissent que la situation au Maroc en matière de respect des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme n’a pas évolué favorablement et que l’usage de pratiques contraires à l’article 3 de la Convention à l’encontre des personnes poursuivies et arrêtées dans ce cadre est un problème durable au Maroc.
76. La Cour relève en outre que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le requérant ne se limite pas à dénoncer in abstracto le risque d’être exposé à une violation de l’article 3 de la Convention en raison de la pratique des autorités marocaines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il établit en effet que lui-même appartient à la catégorie de personnes visées par ce type de mesures. Le mandat d’arrêt international émis par le procureur près la cour d’appel de Rabat indique que le requérant est recherché pour « constitution d’une bande pour préparer et commettre des actes terroristes » (voir paragraphe 15, ci-dessus).
77. La Cour estime en outre utile d’observer qu’il ne ressort pas des observations qui lui ont été soumises que les autorités belges auraient accompli une quelconque démarche diplomatique auprès des autorités marocaines en vue d’obtenir de celles-ci des garanties ou des assurances que le requérant ne serait pas exposé, après son extradition, à des traitements inhumains et dégradants.
78. Dans ces circonstances, la Cour est loin d’être convaincue par l’analyse proposée par le Gouvernement belge selon laquelle les craintes du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention ne sont pas fondées.
79. Eu égard à ce qui précède, elle estime au contraire que la mise en œuvre de l’arrêté ministériel d’extradition délivré à l’endroit du requérant entraînerait une violation de l’article 3 de la Convention.
Arrêt Boutagni contre France du 18 novembre 2010 requête 42360/08
La France n'a pas expulsé le requérant au Maroc mais il n'a pas d'autre choix que de saisir la Grande Chambre
44. Les principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats contractants en cas d'expulsion, aux éléments à retenir pour évaluer le risque d'exposition à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention et à la notion de « torture » et de « traitements inhumains et dégradants » sont résumés dans l'arrêt Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008-...). Dans cet arrêt, la Cour a réitéré le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l'article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle a également réaffirmé l'impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l'expulsion afin de déterminer si la responsabilité d'un Etat est engagée sur le terrain de l'article 3 (§§ 137-141). Elle a aussi souligné que « l'existence de textes internes et l'acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque (...) des sources fiables font état de pratiques des autorités – ou tolérées par celles-ci – manifestement contraires aux principes de la Convention » (Daoudi c. France, no 19576/08, § 64, 3 décembre 2009).
45. La Cour relève que le requérant a été condamné en France pour des actes terroristes et, à l'instar de ce qu'elle a rappelé dans l'affaire Daoudi précitée, elle souhaite réaffirmer qu'elle a une conscience aiguë de l'ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l'importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Devant une telle menace, la Cour considère qu'il est légitime que les Etats contractants fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu'elle ne saurait en aucun cas cautionner (voir, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 137, et aussi Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 126, CEDH 2009-...).
46. Elle constate néanmoins que l'ensemble des rapports internationaux sur la situation des droits de l'homme au Maroc s'accordent pour dénoncer les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées de participation à des entreprises terroristes (voir paragraphes 26-30 ci-dessus). La Cour est d'avis qu'au vu du profil du requérant, le risque de violation de l'article 3 de la Convention en cas de retour est réel. Elle note d'ailleurs que l'OFPRA a reconnu, lorsqu'il s'est prononcé sur la demande d'asile du requérant, que les craintes de ce dernier de subir des persécutions en cas de retour au Maroc étaient avérées (voir paragraphe 19 ci-dessus).
47. Cependant, la Cour prend acte de l'engagement du Gouvernement, suite à la décision de l'OFPRA du 5 février 2010, de ne pas expulser l'intéressé. La Cour rappelle que le Gouvernement affirme que malgré le rejet de la demande d'asile du requérant, ce dernier ne sera pas expulsé, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA (voir paragraphe 40 ci-dessus).
La présente espèce se distingue ainsi de l'affaire Daoudi précitée dans laquelle le requérant avait aussi fait l'objet d'une condamnation pénale pour actes de terrorisme et s'était vu notifier un arrêté de reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine, l'Algérie. Le Gouvernement n'avait pas considéré que la constatation par la CNDA des risques encourus par le requérant en cas de retour en Algérie était de nature à empêcher l'expulsion du requérant et à aucun moment il n'avait pris l'engagement de ne pas mettre à exécution la mesure de renvoi.
48. L'affirmation du Gouvernement selon laquelle le requérant ne sera pas reconduit vers le Maroc suffit à la Cour pour conclure que ce dernier n'encourt plus de risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. En tout état de cause, la Cour observe que si la mesure de renvoi devait être mise à exécution, des recours demeurent ouverts au requérant dans le cadre desquels sa situation pourrait être à nouveau examinée. En particulier, il pourrait saisir la Cour d'une nouvelle demande d'application de l'article 39 du règlement.
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'y a pas, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
53. La Cour rappelle que, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.
54. Elle considère que les mesures qu'elle a indiquées au Gouvernement en application de l'article 39 de son règlement doivent demeurer en vigueur jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que le collège de la Grande Chambre accepte la demande de renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre qui aurait été formulée par l'une des parties ou les deux en vertu de l'article 43 de la Convention.
Arrêt Rafaa contre France du 30 mai 2013 requête 25393/10
LE RENVOI AU MAROC EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT
40. La Cour note que le Gouvernement allègue que le requérant lie et a toujours lié son risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 à sa qualité revendiquée de militant de la cause sahraouie, et l’invite, en conséquence, à se prononcer au regard de cette seule circonstance sans prendre en considération la dimension terroriste de l’affaire. La Cour observe cependant que l’appartenance du requérant à une mouvance terroriste a été largement discutée devant les juridictions internes et, en particulier, devant celles en charge de l’asile (voir paragraphes 20 à 22). Elle relève ensuite que, dans ses observations, le requérant a visé plusieurs rapports internationaux dénonçant les tortures pratiquées à l’encontre des personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau terroriste. Elle constate enfin que la demande d’extradition est motivée par des faits liés au terrorisme. Les autorités marocaines soupçonnent, en effet, le requérant d’être un membre actif de la branche d’AQMI, ce que semblent d’ailleurs confirmer les services secrets français. L’existence de risques de traitements contraires à l’article 3 doit donc être examinée au regard de ces circonstances particulières.
A cet égard, la Cour souhaite réaffirmer le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle tient également à réitérer l’impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un Etat est engagée sur le terrain de l’article 3, tout en soulignant qu’elle a pleinement conscience des difficultés considérables que les Etats rencontrent pour protéger leur population de la violence terroriste (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 127 et suiv., CEDH 2008, et Daoudi précité, no 19576/08, §§ 64 et 65).
41. A la lecture des rapports précités (voir paragraphes 29 et 30 ci‑dessus), la Cour considère que la situation des droits de l’homme au Maroc a peu évolué depuis l’arrêt Boutagni c. France (no 42360/08, § 46, 18 novembre 2010) et que les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées de participation à des entreprises terroristes persistent. La Cour est d’avis qu’au vu du profil du requérant, le risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour est réel. Elle note d’ailleurs que le Gouvernement, tout comme les juridictions internes, ont reconnu que les craintes du requérant de subir des persécutions en cas de retour au Maroc étaient plausibles (voir paragraphes 20-23 et 39 ci-dessus).
42. La Cour constate enfin qu’à la différence de l’arrêt Boutagni précité, le Gouvernement n’a, en aucune manière, pris l’engagement de ne pas éloigner le requérant vers le Maroc.
43. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère qu’un renvoi du requérant vers le Maroc emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
Saidani c. Allemagne du 27 septembre 2009 requête n°17675/18
NON VIOLATION DE L'ARTICLE 3 : ’expulsion vers la Tunisie d’une personne considérée comme une menace pour la sécurité nationale en Allemagne n’est pas contraire à la Convention
Dans sa décision en l’affaire Saidani c. Allemagne (requête no 17675/18), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive. L’affaire concerne l’expulsion du requérant de l’Allemagne vers la Tunisie au motif qu’il était considéré comme un criminel potentiel constituant une menace pour la sécurité nationale (« Gefährder »), compte tenu de ses activités pour « l’État islamique ». La Cour a constaté qu’il existait un risque réel que la peine de mort soit infligée à M. Saidani en Tunisie, mais qu’une telle peine devait s’analyser de fait en une réclusion à perpétuité puisqu’il y avait depuis 1991 un moratoire sur les exécutions. Elle n’a vu non plus aucune raison de s’écarter des conclusions du juge interne selon lesquelles il existait clairement dans le droit et la pratique en Tunisie un mécanisme permettant le contrôle des peines de perpétuité dans l’optique ultérieure d’une libération.
LES FAITS
Le requérant, Haykel Ben Khemais Saidani, est un ressortissant tunisien qui est né en 1980 et résidait à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).
Le 1er août 2017, le ministère de l’Intérieur du land de Hesse ordonna, avec exécution immédiate, l’expulsion du requérant au motif qu’il était considéré comme une menace pour la sécurité nationale (« Gefährder »). Le requérant saisit la Cour administrative fédérale d’une demande de mesures provisoires, qui fut rejetée en septembre 2007 sous la réserve que les autorités tunisiennes offrent des assurances diplomatiques. En mars 2018, la Cour administrative fédérale modifia sa décision et rejeta dans son intégralité la demande formée par le requérant. Elle constata qu’il existait un risque réel que ce dernier soit condamné à mort ou à la perpétuité en Tunisie. Cependant, compte tenu du moratoire sur l’exécution de la peine capitale et des assurances données par les autorités tunisiennes, il n’y avait aucun risque réel que le requérant soit mis à mort.
En cas de condamnation à la peine de mort, une telle peine devait de fait être considérée comme une peine de perpétuité étant donné que, selon les informations disponibles, chaque peine de mort était tôt ou tard commuée en peine de perpétuité au moyen d’une grâce présidentielle. Par la suite, toute personne purgeant une peine de perpétuité pouvait demander le réexamen de celle-ci et une libération sous condition après avoir passé 15 ans en prison.
Par une décision du 4 mai 2018, signifiée le 7 mai 2018, la Cour constitutionnelle fédérale refusa de statuer sur le recours constitutionnel dont M. Saidani l’avait saisie. Elle jugea que la Cour administrative fédérale avait examiné, sur tous les points de fait et de droit, les circonstances de l’affaire. Elle fit sienne la conclusion que le requérant, quand bien même il serait condamné à la peine de mort, n’avait pas à craindre que celle-ci soit exécutée. Pour autant que la peine de mort constituait de fait une peine de perpétuité, la Cour administrative fédérale n’avait pas excédé sa marge d’appréciation en jugeant que la peine que le requérant encourait en Tunisie était compressible et qu’il avait une chance réaliste, aussi bien de fait que de droit, d’être libéré après avoir passé un certain temps en prison. Ce raisonnement était étayé par des éléments de fait produits par les autorités tunisiennes et par des rapports concernant ce pays. Aucun élément n’indiquait que les possibilités existantes de commuer une peine de mort en peine de perpétuité puis de réduire cette dernière peine ne vaudraient pas pour les personnes condamnées sur la base de la nouvelle loi de lutte contre le terrorisme, le président tunisien ayant auparavant gracié des personnes reconnues coupables d’infractions de terrorisme.
Par une
décision du 7 mai 2018, la Cour a rejeté une demande de mesure conservatoire
tendant à ajourner l’expulsion de Haykel Saidani de l’Allemagne vers la Tunisie.
Articles 2 et 3 de la Convention et article 1 du Protocole no 13
La CEDH rappelle que l’article 2 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 13 interdisent l’extradition et le refoulement vers un autre État où l’intéressé courra un risque réel d’être soumis à la peine de mort, et que l’article 3 de la Convention pose la même interdiction lorsqu’il y a un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. La Cour constate que les chefs d’accusation retenus contre M. Saidani en Tunisie peuvent lui faire encourir la peine de mort et que les autorités tunisiennes ont confirmé qu’il existait un risque réel qu’une telle peine soit prononcée. Cependant, chaque peine de mort étant tôt ou tard commuée en peine de perpétuité au moyen d’une grâce présidentielle, M. Saidani ne peut prétendre qu’il craint légitimement d’être exécuté.
La Cour fait sienne l’appréciation par le juge interne des risques à la lumière du moratoire tunisien sur l’exécution de la peine capitale, et tient compte des assurances diplomatiques données à cette fin par les autorités tunisiennes en l’espèce.
De plus, la Cour partage les conclusions du juge interne selon lesquelles la peine de perpétuité que M. Saidani encourt vraisemblablement est compressible et qu’il avait une chance réaliste d’être libéré après avoir passé un certain temps en prison. M. Saidani dispose de deux mécanismes constituant des possibilités légitimes de commutation de peine, à savoir la procédure de libération conditionnelle prévue par le code tunisien de procédure pénale ou une autre grâce présidentielle.
Enfin, la Cour est convaincue que le système de contrôle des peines de perpétuité satisfait à ses principes dégagés sur le terrain de l’article 3 : il repose sur des critères objectifs et prédéterminés dont tout détenu pouvait avoir connaissance à la date de l’imposition de sa peine. Il était donc suffisamment prévisible aux yeux de M. Saidani que la peine capitale serait finalement commuée en peine de perpétuité et que la possibilité ultérieure de libération conditionnelle serait régie non seulement par les règles en matière de grâce mais aussi par les dispositions du code tunisien de procédure pénale. La Cour ne voyant aucune raison de s’écarter des constats et conclusions du juge interne, elle rejette à l’unanimité la requête pour défaut manifeste de fondement.
TOUMI c. ITALIE du 5 AVRIL 2011 Requête no 25716/09
Nouveau renvoi d’un terroriste d’Italie vers la Tunisie en dépit des indications de la Cour et du risque de mauvais traitements.
Cet arrêt démontre les limites de la puissance de la CEDH qui ne peut pas se faire respecter des Etats qui ne respectent plus les règles démocratiques.
Principaux faits
Le requérant, Ali Ben Sassi Toumi, est un ressortissant tunisien né en 1965 et résidant en Tunisie. Il est marié à une ressortissante italienne et père de trois enfants en bas-âge. A l’issue d’une procédure pénale ouverte à son encontre en 2003, le 23 octobre 2007, la cour d’appel de Milan le condamna à six ans de détention pour terrorisme international; cette décision fut confirmée le 11 juin 2008 par la Cour de cassation. Le 18 mai 2009, M. Toumi, qui avait bénéficié d’une remise de peine, fut mis en liberté.
Par un arrêté du même jour, le Préfet de Crotone ordonna son expulsion vers la Tunisie. Toujours le même jour, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par M. Toumi d’une demande de mesures provisoires (application de l’article 39 du Règlement de la Cour)3, indiqua au gouvernement italien de ne pas l’expulser jusqu’à nouvel ordre, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure. Le 19 mai 2009, M. Toumi fut placé en centre de rétention temporaire, en vue de son expulsion. Le Greffe de la Cour, qui en fut informé par l’avocat de M. Toumi, rappela aux autorités italiennes la teneur de la mesure provisoire qu’elle avait indiquée la veille. Le 20 mai 2009, le juge de paix de Crotone valida la décision d’expulsion, mais ordonna un sursis à exécution de 30 jours. Le 21 juin 2009, M. Toumi demanda le statut de réfugié, mais sa demande fut rejetée le 7 juillet 2009. Le 24 juillet 2009, à nouveau informée par l’avocat de M. Toumi de ce que la mise à exécution de l’expulsion était imminente, le Greffe de la Cour rappela à nouveau aux autorités italiennes la mesure provisoire qu’elle leur avait indiquée. Sur ordre du chef de la police de Crotone et après accord du juge de paix de Crotone, M. Toumi fut expulsé le 2 août 2009.
Entre temps, les autorités italiennes avaient obtenu des autorités tunisiennes (le 25 juin 2009) des assurances diplomatiques (respect de la dignité de M. Toumi, garantie d’un procès équitable, de recevoir des visites et des soins médicaux). Celles-ci précisaient que M. Toumi ne faisait pas l’objet de poursuites pour terrorisme.
M. Toumi affirme avoir été arrêté dès son arrivée en Tunisie, torturé pendant sa détention, puis libéré après dix jours sous condition de garder le silence. Il ajoute faire l’objet de menaces continues de la part de la police. Le gouvernement italien, sur la base des informations fournies par les autorités tunisiennes, affirme au contraire que M. Toumi n’a été détenu que trois jours, en attente d’être interrogé dans une affaire en lien avec le terrorisme international, et n’a pas subi de mauvais traitement.
Grief concernant le risque de torture (article 3)
L’expulsion par un État contractant peut engager sa responsabilité au titre de la Convention lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 commande de ne pas procéder à l’expulsion vers ce pays.
Se basant sur les conclusions auxquelles elle est parvenue dans une précédente affaire4 et qui sont confirmées par le rapport 2008 d’Amnesty International relatif à la Tunisie, la Cour estime que des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir M. Toumi subir des traitements contraires à l’article 3 en Tunisie.
Il reste à la Cour à vérifier tout d’abord si les assurances diplomatiques fournies par les autorités tunisiennes suffisent à écarter ce risque, puis si les renseignements relatifs à la situation de M. Toumi après son expulsion ont confirmé l’avis des autorités italiennes.
Sur le premier point, la Cour examine si, au-delà des assurances et des textes en vigueur, l’application effective qui en a été faite dans le cas de M. Toumi était de nature à le protéger contre le risque de traitements interdits par la Convention. Elle constate que les autorités tunisiennes ont étayé leurs assurances, mais n’en relève pas moins que des sources internationales sérieuses et fiables indiquent que les allégations de mauvais traitements ne sont pas examinées par les autorités tunisiennes compétentes, et que les autorités tunisiennes sont réticentes à coopérer avec les organisations indépendantes de défense des droits de l’homme (l’impossibilité pour l’avocat italien de M. Toumi de rendre visite à son client emprisonné en Tunisie confirmant la difficulté d’accès des prisonniers tunisiens à des conseils étrangers indépendants). La Cour ne peut donc pas souscrire à la thèse de l’Italie selon laquelle les assurances données offraient une protection efficace contre le risque sérieux que courait M. Toumi d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3.
Sur le deuxième point, la Cour rappelle que si, pour contrôler l’existence d’un risque de mauvais traitements, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion, cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs, qui peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont l’État en question a jugé du bien-fondé des craintes d’un requérant. La Cour relève que les versions des parties sont divergentes quant aux événements postérieurs à l’expulsion de M. Toumi. En tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle considère que les renseignements fournis par le Gouvernement ne sont pas en mesure de rassurer la Cour quant à la manière dont l’Italie a jugé du bien-fondé des craintes du requérant au moment de l’expulsion. La Cour en conclut que la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers la Tunisie a violé l’article 3 de la Convention.
Grief concernant le respect de la vie privée et familiale (article 8)
Vu le constat de violation de l’article 3 auquel elle est parvenue, la Cour juge, par quatre voix contre trois, qu’il n’est pas nécessaire de trancher séparément ce grief.
Grief concernant le non-respect de la mesure provisoire indiquée à l’Italie (article 34)
Dans des affaires telles que la présente, où l’existence d’un risque de préjudice irréparable est alléguée de manière plausible, la mesure provisoire indiquée par la Cour a pour but de geler la situation en attendant que la Cour tranche l’affaire ; la mesure provisoire touche donc au fond de la requête. La Cour a, en outre, déjà jugé que l’inobservation de mesures provisoires doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l’article 34.
Il n’en va pas autrement dans la présente affaire. L’Italie a expulsé M. Toumi vers la Tunisie alors qu’elle savait la mesure provisoire adoptée aux termes de l’article 39 du Règlement
toujours en vigueur. Certes, M. Toumi a été remis en liberté et a pu reprendre contact avec son avocat après sa détention en Tunisie (sur laquelle la Cour manque d’informations), mais cela ne signifie pas pour autant que l’Italie a respecté son obligation de n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace du droit de requête individuelle. Le fait que M. Toumi ait été soustrait à la juridiction de l’Italie constitue un obstacle sérieux qui pourrait empêcher le Gouvernement de s’acquitter de ses obligations (découlant des articles 1 et 46 de la Convention) de sauvegarder les droits de l’intéressé et d’effacer les conséquences des violations constatées par la Cour. Cette situation a constitué une entrave à l’exercice effectif par M. Toumi de son droit de recours individuel, droit que son expulsion a réduit à néant.
La Cour conclut donc à la violation de l’article 34.
Al Hanchi c. Bosnie-Herzégovine requête no 48205/09 du 15 novembre 2011
La Tunisie n'est plus un Etat dangereux, il est possible de lui renvoyer ses ressortissants islamistes
Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1965 ; il se trouve actuellement au centre d’immigration d’Istocno, à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine).
Le requérant arriva en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre de 1992-1995 et rejoignit les moudjahidines étrangers. Le phénomène des moudjahidines est décrit par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) comme un mouvement religieux au sein duquel les Musulmans se livrent à un « djihad », ou guerre sainte. Selon les éléments produits devant le TPIY, les moudjahidines étrangers sont arrivés en Bosnie-Herzégovine dans l’intention d’aider leurs frères musulmans à se défendre contre les agresseurs serbes et de répandre leurs croyances qui, d’après eux, sont l’expression la plus fidèle des textes islamiques. Les moudjahidines sont originaires pour la plupart de l’Afrique du Nord, du Proche-Orient et du Moyen-Orient.
En décembre 1995, M. Al Hanchi obtint une carte d’identité nationale sur la base d’une décision falsifiée de février 1992 accordant la nationalité à quelqu’un d’autre. En 1997, il épousa une ressortissante de Bosnie-Herzégovine, avec laquelle il eut deux enfants, nés respectivement en 1998 et 2000.
En avril 2009, à la faveur d’un contrôle aléatoire, les autorités établirent que le requérant était un immigré clandestin. En conséquence, l’intéressé fut placé dans un centre d’immigration à Sarajevo en vue de son expulsion. Sa demande de contrôle juridictionnel de la régularité de sa détention fut rejetée pour tardiveté, et sa détention fut prolongée de mois en mois.
En mai 2009, sur la base de rapports des services secrets, le service des étrangers décida que M. Al-Hanchi représentait une menace pour la sécurité nationale et ordonna son expulsion, assortie d’une interdiction de territoire de cinq ans. Cette décision, confirmée par le ministère de la Sécurité et la Cour de l’Etat, est actuellement pendante devant la Cour constitutionnelle.
En juillet 2009, M. Al-Hanchi demanda l’asile, alléguant qu’il risquait de subir des mauvais traitements s’il était renvoyé en Tunisie, où il serait selon lui soupçonné de terrorisme. Sa demande fut rejetée et, le 10 décembre 2009, une ordonnance d’expulsion lui fut signifiée. Il saisit immédiatement la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande tendant à suspendre son renvoi en Tunisie. La Cour accueillit sa demande de mesures provisoires jusqu’à nouvel ordre.
M. Al-Hanchi présenta également une demande de mesures provisoires contre son expulsion devant la Cour constitutionnelle, laquelle le débouta en janvier 2010. Il est toujours détenu au centre d’immigration de Sarajevo.
Mauvais traitements (article 3)
La Cour rappelle sa jurisprudence établie selon laquelle les États ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des ressortissants étrangers. Toutefois, il convient de veiller à ce que les expulsions n’exposent pas les personnes concernées à des risques de torture ou d’autres formes de mauvais traitements dans le pays de renvoi.
Ainsi que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les rapporteurs spéciaux des Nations unies l’ont relevé, des mesures sont actuellement prises en Tunisie pour passer à un système démocratique. Ces mesures comprennent l’amnistie accordée à tous les détenus politiques, la dissolution du service de sécurité d’État, très souvent accusé de violations des droits de l’homme pendant l’ancien régime, et la révocation ou la mise en accusation de certains fonctionnaires de haut rang pour des abus passés.
Si l’on rapporte toujours des cas de mauvais traitements en Tunisie, il s’agit d’incidents sporadiques, et rien n’indique que les Islamistes soient systématiquement visés en tant que groupe depuis le changement de régime. Par ailleurs, les médias se sont largement fait l’écho du retour en Tunisie du dirigeant du principal mouvement islamiste tunisien après un exil de 20 ans et du fait qu’il a pu fonder un parti politique.
De plus, la Tunisie a signé le Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la Torture, qui met en place un système préventif de visites dans les centres de détention ; la Tunisie a également adopté le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme des Nations unies pour connaître d’affaires individuelles.
Les considérations ci-dessus démontrent la détermination des autorités tunisiennes pour éradiquer une fois pour toutes la culture de la violence et l’impunité qui caractérisaient l’ancien régime politique.
En conséquence, la Cour conclut que M. Al-Hanchi ne court aucun risque de mauvais traitement en cas d’expulsion vers la Tunisie. Partant, son renvoi n’emporterait pas violation de l’article 3.
Autres articles
La Cour rejette les autres griefs de M. Al-Hanchi.
En particulier, elle estime que la détention de l’intéressé en vue de son expulsion respecte strictement le droit interne, que ses conditions de détention sont convenables et que sa détention ne se fonde pas sur des motifs arbitraires.
En outre, quand au manque d’équité allégué de la procédure d’expulsion, la Cour rappelle que les décisions concernant l’entrée, le séjour et l’expulsion de ressortissants étrangers ne relèvent pas de l’article 6 puisqu’elles ne portent pas sur des droits ou obligations de caractère civil.
Par ailleurs, concernant le grief de M. Al-Hanchi relatif à sa vie privée et familiale, la Cour observe qu’elle a déjà établi dans des affaires précédentes qu’un recours devant la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine représente en principe un recours effectif au regard de la Convention. Etant donné que l’affaire du requérant est toujours pendante devant cette juridiction, et que la Convention n’exige pas que les requérants qui soutiennent que leur expulsion emporterait violation de l’article 8 aient accès à un recours ayant un effet suspensif automatique (contrairement aux allégations de violation de l’article 3), le grief est prématuré.
Enfin, la Cour indique au Gouvernement qu’il ne convient pas d’expulser M. Al-Hanchi avant que son arrêt ne soit devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention.
MO C. Suisse du 20 juin 2017 requête 41282/16
Article 3 : Le renvoi de Suisse d’un demandeur d’asile érythréen n’emporterait pas violation de la Conv EDH.
LES FAITS
Le requérant, M. M.O., est un ressortissant érythréen né en 1990. Il a grandi en Érythrée mais réside actuellement en Suisse. M. M.O. entra en Suisse illégalement en juin 2014 et y demanda l’asile. Il fut entendu à trois reprises par les autorités suisses compétentes pour les questions d’asile et de migration avant que sa demande ne soit définitivement rejetée en 2016 et que son renvoi de Suisse ne soit décidé. Il saisit alors le Tribunal administratif fédéral d’un appel contre cette décision et fut débouté. M. M.O. soutenait en substance qu’il risquait de subir des mauvais traitements s’il était renvoyé en Érythrée car il avait déserté pendant qu’il y effectuait son service militaire et qu’il s’était plus tard évadé de prison et avait quitté le pays illégalement en 2013. Les autorités compétentes en matière d’asile et le Tribunal administratif fédéral estimèrent qu’à l’occasion de ses trois entretiens, l’intéressé n’avait pas étayé son allégation, qui n’était ni assez solide sur le fond ni assez détaillée. Ils mentionnèrent également un certain nombre d’incohérences et de préoccupations sur le plan de la crédibilité relativement à des aspects essentiels de son allégation et à son récit dans son ensemble, notamment les circonstances de son départ d’Érythrée. Cependant, dans l’intervalle, l’expulsion de M. M.O. avait été suspendue sur la base d’une mesure provisoire indiquée par la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 39 de son règlement, qui demandait au gouvernement suisse de ne pas expulser le requérant vers l’Érythrée tant que l’affaire serait pendante devant la Cour
EN DROIT
La Cour note que la situation en matière de droits de l’homme en Érythrée est actuellement très préoccupante. Toutefois, aucun des rapports soumis ne conclut que la situation générale dans ce pays est telle à l’heure actuelle qu’un ressortissant érythréen risquerait d’y subir des mauvais traitements s’il y était simplement renvoyé. Dès lors, la Cour estime que la situation générale en matière de droits de l’homme en Érythrée n’empêche pas en soi le renvoi du requérant. La Cour considère donc que la situation personnelle de M. M.O. est déterminante aux fins de l’appréciation de l’affaire. Rappelant que c’est à M. M.O. qu’il incombe d’étayer son allégation, du moins pour autant qu’elle concerne sa situation personnelle, la Cour relève que l’intéressé n’a soumis aucune preuve documentaire directe indiquant qu’il courrait un risque réel de subir des mauvais traitements en Érythrée, en particulier en raison de son départ illégal du pays. M. M.O. s’est au contraire appuyé sur des informations générales relatives à son pays montrant que le départ illégal d’une personne en âge d’être appelée était suffisant pour que cette personne soit perçue comme un déserteur et, par conséquent, pour considérer qu’elle risquait de subir des mauvais traitements si elle était renvoyée de force. La plausibilité du témoignage de l’intéressé devant les autorités et juridictions internes est donc particulièrement décisive. Toutefois, tant les autorités compétentes en matière d’asile que le Tribunal administratif fédéral, dans des décisions solidement motivées, ont estimé que le récit du requérant dans son ensemble n’était pas crédible, y compris relativement à son départ d’Érythrée. Étant donné qu’il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, qui sont en règle générale les mieux placés pour apprécier les éléments de preuve, la Cour souscrit à l’analyse des autorités suisses, à savoir que M. M.O. n’a pas étayé son allégation selon laquelle s’il était renvoyé en Érythrée, il courrait un risque réel d’y subir des traitements inhumains ou dégradants. En conséquence, elle conclut que l’expulsion de M.M.O. vers l’Érythrée n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention. La Cour rejette pour non-épuisement des voies de recours internes le grief que M. M.O. soulève sur le terrain de l’article 4 et selon lequel il serait contraint d’effectuer un service militaire d’une durée indéterminée s’il était renvoyé en Érythrée. En particulier, devant les autorités compétentes en matière d’asile et devant le Tribunal administratif fédéral l’intéressé a principalement allégué qu’il risquait d’être soumis à des mauvais traitements s’il était renvoyé en Érythrée. Il n’a pas soutenu que le service militaire constituait de l’esclavage, de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire ». La Cour note que le gouvernement suisse a indiqué que les circonstances de l’espèce permettent au requérant d’engager une nouvelle procédure d’asile dans le cadre de laquelle son grief sous l’angle de l’article 4 de la Convention serait examiné par le Secrétariat d’État aux migrations et, en cas de recours, par le Tribunal administratif fédéral. La Cour décide en outre de continuer à indiquer au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement de ne pas expulser M. M.O. avant que son arrêt ne soit devenu définitif ou jusqu’à nouvel ordre.
Arrêt B.A contre France du 2 décembre 2010, requête 14951/09
La CEDH constate que le requérant qui allègue les actes de torture qu'il peut subir au Tchad s'il est renvoyé ne démontre pas les faits mais elle laisse la chance d'un appel devant la Grande Chambre
a) Principes applicables
38. Dans son analyse des risques de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion d’un individu par un Etat membre, la Cour appliquera les principes développés dans sa jurisprudence (voir, notamment et entre autres, NA. c. Royaume-Uni, précitée, §§ 108-117).
b) Application à l’espèce
39. La Cour constate que l’ensemble des rapports consultés font état d’une situation de conflit déstabilisant le Tchad depuis plusieurs années (paragraphes 22-25 ci-dessus). Le pays subit les répercussions de la violence qui se poursuit au Darfour, entraînant une grande insécurité, notamment dans les régions de l’est.
Cependant, il semble que, bien que la situation générale soit toujours préoccupante, elle soit en voie d’amélioration. En attestent les récents Accords de Dakar conclus entre le Tchad et le Soudan ayant pour but de mettre fin à la guerre qui oppose les deux Etats ainsi que la récente résolution du Conseil de sécurité de l’ONU (1923) organisant le retrait progressif de la MINURCAT (voir « droit pertinent »). La Cour conclut que malgré une situation générale très instable et le conflit qui sévit dans le pays, celle-ci n’est pas suffisante à ce jour pour, en elle-même, causer une violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour du requérant vers le Tchad. La Cour devra donc établir si le requérant présente un risque personnalisé suffisant pouvant entraîner une violation des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, F.H. c. Suède, no 32621/06, § 93, 20 janvier 2009).
40. La Cour note en premier lieu qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement que le requérant a participé, en 2004, à une formation de sous-officiers organisée en France, qu’il s’est maintenu sur le territoire à son issue et qu’il n’a pas rejoint son corps militaire. Se pose en deuxième lieu la question de savoir si ces éléments sont suffisants pour établir que le requérant encourt toujours un risque d’être soumis à des traitements contraires à la Convention dans son pays en cas de retour.
Le requérant produit devant la Cour un avis de recherche en date du 30 juin 2004, émis par le commandant de la brigade des recherches et qui mentionne qu’il est recherché pour « avoir commis une faute grave dans l’armée nationale tchadienne ». Le requérant affirme qu’il est toujours recherché par les autorités. Le Gouvernement, sans contester l’authenticité de l’avis de recherche, s’étonne de ne pas avoir été saisi de cette désertion par les autorités tchadiennes et exprime des doutes sur le fait que le requérant soit toujours recherché. La Cour constate qu’il ne ressort pas clairement de l’analyse de cette pièce qu’elle ait été émise du fait de la désertion du requérant ou pour une autre infraction militaire. Toutefois, le fait même que les autorités le recherchaient à cette époque n’est pas contesté.
41. Concernant le risque pour le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour constate, contrairement aux affirmations du Gouvernement (paragraphe 33 ci-dessus) que le Tchad pratique une répression sévère à l’encontre des déserteurs afin de contrer la multiplication des groupes rebelles combattant contre le Gouvernement. Les autorités françaises ont d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises les risques qu’encourraient certains déserteurs en cas de retour au Tchad : en témoignent la décision de la CNDA du 8 février 2007 (paragraphe 20 ci-dessus) qui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un élève sous-officier de l’armée de l’air tchadienne, recherché par les autorités militaires de son pays, ainsi que la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, dans un arrêt du 2 juillet 2009, a annulé l’arrêté préfectoral fixant le Tchad comme pays de renvoi pour un militaire tchadien estimant que la peine de prison de longue durée encourue était contraire aux articles L. 513-2 du CESEDA et 3 de la Convention (paragraphe 19 ci-dessus).
42. La Cour note cependant que les profils des intéressés dans les affaires susmentionnées étaient plus marqués que celui de la présente espèce ; le premier n’avait pas seulement décidé d’abandonner les rangs de l’armée tchadienne mais avait participé à des manifestations de protestation et avait communiqué dans la presse sur cet événement ; le second était un militaire ayant le grade d’officier et qui avait fait l’objet d’une note ministérielle le désignant nommément comme un opposant politique et demandant qu’il soit immédiatement interpellé.
43. La Cour souhaite aussi distinguer la présente espèce de l’affaire Saïd c. Pays-Bas, précitée (§§ 11-13), dans laquelle le requérant, déserteur de l’armée érythréenne, se distingua en prenant la parole lors d’une réunion de son bataillon et critiqua ouvertement le commandement. Il fut détenu pendant plusieurs mois sans être traduit devant un tribunal avant de réussir à s’enfuir.
44. Dans la présente affaire, aucun document désignant personnellement le requérant et prouvant que les autorités tchadiennes sont toujours à sa recherche n’a été joint dans la présente procédure. De plus, celui-ci a fui son pays il y a plus de six ans et l’avis de recherche qu’il produit ne mentionne pas le délit de désertion comme cause du mandat. Ainsi, la Cour considère que le risque pour le requérant d’être arrêté dès son arrivée au Tchad et soumis à des mauvais traitements n’apparaît pas fondé.
45. Les mêmes considérations s’appliquent, a fortiori, concernant l’allégation du requérant selon laquelle il sera poursuivi pour désertion et risque d’être condamné à la peine capitale. Ainsi, l’allégation du requérant relevant de l’article 2 n’apparaît pas non plus fondée.
46. Enfin, s’il apparaît, au vu des rapports internationaux, que les personnes soupçonnées de sympathiser avec les groupes rebelles constituent des cibles particulièrement privilégiées pour les autorités, il n’en demeure pas moins que le requérant n’a pas démontré que l’activité politique qu’il mène au sein du RNDP depuis sa désertion entraînerait pour lui un risque de traitements contraires à l’article 3.
47. En conséquence, et au vu des éléments qui précèdent, la Cour est d’avis que le requérant n’a pas établi qu’il encourt des risques relevant des articles 2 et 3 de la Convention, du fait de sa qualité de déserteur ou de son engagement politique en France.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
50. La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.
51. Elle considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que le collège de la Grande Chambre accepte la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre qui aurait été formulée par l’une des parties ou les deux en vertu de l’article 43 de la Convention.
Arrêt MO.M. c. FRANCE du 18 avril 2013 requête 18372/10
Le Renvoi du requérant au Tchad serait une violation de l'article 3 de la Convention.
34. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
35. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, à propos de l’article 3) (art. 3).
36. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
37. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
38. S’agissant de la situation générale au Tchad, la Cour note que si les relations entre ce pays et le Soudan se sont relativement apaisées depuis l’accord de paix signé en janvier 2010 (voir, en ce sens, B.A. c. France, no 14951/09, § 39, 2 décembre 2010), les menaces sur la sécurité des personnes demeurent et la situation reste instable. Dans ce contexte, il apparaît peu probable que le traitement réservé à ceux qui sont soupçonnés d’avoir collaboré avec les rebelles se soit adouci. Les rapports des ONG locales et des observateurs institutionnels témoignent, par ailleurs, de l’existence de prisons militaires gérées par les services secrets et de la persistance des dysfonctionnements au sein des prisons tchadiennes (voir paragraphes 19-21 ci-dessus).
39. S’agissant des risques personnels encourus en cas de renvoi, le requérant allègue avoir été torturé par les services secrets tchadiens et craindre de l’être à nouveau.
40. La Cour observe que les certificats médicaux produits attestent de la présence de nombreuses cicatrices sur tout le corps du requérant. Si, parmi ces cicatrices, certaines résultent de traitements traditionnels par incisions superficielles, les médecins s’accordent pour attribuer toutes les autres à des actes de torture. En particulier, le docteur H.J., qui possède une expérience décennale sur les questions tchadiennes, affirme que les stigmates présentés par le requérant correspondent aux suites habituellement observées dans les types de torture allégués et sont, en conséquence, cohérents avec le récit de ce dernier. La Cour considère ainsi qu’elle dispose d’éléments suffisants pour rendre vraisemblables les tortures dénoncées par le requérant.
41. La question demeure de savoir si le requérant court le risque de subir des mauvais traitements en cas de retour. Pour établir ce risque, le requérant produit un mandat d’amener pris à son encontre le 2 mars 2009, soit près de trois ans après son départ du Tchad. Le Gouvernement, pour mettre en doute l’authenticité de ce document, se limite à relever qu’il n’existe aucune trace d’un tel mandat dans les bases de données internationales prévues à cet effet. La Cour observe toutefois que si la diffusion internationale d’un mandat atteste de la réalité de celui-ci, sa seule absence de diffusion ne saurait suffire à établir son inexistence, l’Etat émetteur restant libre de diffuser internationalement ou non un tel acte. Le Gouvernement fait ensuite valoir que l’existence d’un risque de mauvais traitements en cas de retour du requérant dans son pays d’origine a été examinée, de manière circonstanciée, par les juridictions internes. La Cour constate cependant que les juridictions nationales, au terme d’une motivation très succincte, se sont bornées à relever l’absence d’éléments probants (voir paragraphes 13 et 14). Par conséquent, la Cour ne saurait se fonder sur l’appréciation du risque faite par les juridictions nationales dans la mesure où elle ne dispose, à cet égard, d’aucun élément explicatif. La Cour observe, en outre, que le requérant produit devant elle plusieurs pièces de nature à étayer son grief tiré de l’article 3, qui sont postérieures aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA et qui n’ont donc pas pu être examinées par les juridictions internes (voir paragraphe 26). Le Gouvernement insiste, enfin, sur la demande d’asile faite par le requérant, en mars 2010, sous une fausse identité. Pour critiquable que soit un tel comportement, la Cour retient qu’il n’est pas de nature à influer sur le caractère probant des documents fournis par le requérant lors de sa première demande d’asile.
42. La Cour souligne, par ailleurs, que le militantisme actuel du requérant au sein du RNDP, qui n’est pas contesté par le Gouvernement, accentue encore le risque pour le requérant d’être soumis à des mauvais traitements.
43. La Cour estime ainsi, au vu du profil du requérant, des certificats médicaux établissant qu’il a subi des tortures et de la situation passée et actuelle au Tchad, qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel que celui-ci soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités tchadiennes en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
44. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère qu’un renvoi du requérant vers le Tchad emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ZM C. FRANCE du 14 novembre 2013 requête 40042/11
UN OPPOSANT DE KABILA NE PEUT ÊTRE RENVOYE EN RDC
a) Principes applicables
59. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008).
60. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles‑ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007, et N. c. Suède, no 23505/09, § 53, 20 juillet 2010). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits (Mo. P. c. France (déc.), no 55787/09, § 53, 30 avril 2013).
61. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
62. Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (Saadi, précité, § 132).
63. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996‑V).
b) Application des principes
64. La Cour constate que le requérant allègue l’existence d’un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi vers la RDC, non en raison d’une situation de violence généralisée dans ce pays, mais du fait de sa situation personnelle en tant que militant au sein de l’opposition au gouvernement de Joseph Kabila.
65. Il appartient donc à la Cour de déterminer si le requérant, en sa qualité d’opposant politique, risque d’être exposé à des mauvais traitements.
66. Les rapports internationaux consultés (voir paragraphes 42-43) mentionnent que les ressortissants de la RDC renvoyés dans leur pays sont automatiquement interrogés à leur arrivée à l’aéroport par la DGM. Lorsqu’ils sont identifiés comme des opposants au gouvernement Kabila, que ce soit en raison de leur profil politique, militaire ou ethnique, ils risquent ensuite d’être envoyés au centre de détention de la DGM à Kinshasa ou à la prison de la direction des renseignements généraux et services spéciaux (DRGS) de Kin-Mazière. Les rapports font état de détentions pouvant durer de quelques jours à plusieurs mois durant lesquels les personnes incarcérées sont soumises à des traitements inhumains et dégradants, voire subissent des actes de torture.
67. Au regard de ces constatations, la Cour estime que, pour qu’entre en jeu la protection offerte par l’article 3, le requérant doit démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt tel pour les autorités congolaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour (voir NA. c. Royaume-Uni, précité, § 133, et Mawaka c. Pays-Bas, no 29031/04, § 45, 1er juin 2010).
68. En l’espèce, le requérant allègue avoir eu des activités militantes en tant que caricaturiste au sein de l’opposition, en particulier pour le MLC et l’UDPS, à partir de 2005 et jusqu’en juin 2008, date à laquelle il se réfugia en France.
69. La Cour note que le Gouvernement conteste les dires du requérant selon lesquels il serait connu des autorités en raison de son engagement en tant que caricaturiste auprès des partis d’opposition et estime trop peu étayées ses allégations quant à ses conditions d’incarcération à la prison de Kin-Mazière.
70. La Cour admet que si le requérant a fourni des dessins signés de ses initiales et dénonçant les exactions commises par le gouvernement en place (voir paragraphes 9 et 18), rien ne permet d’établir avec certitude que ceux‑ci ont été effectivement rendus publics par voie d’affichage ou sous forme de tracts.
71. En revanche, la Cour constate que d’autres éléments viennent corroborer le récit du requérant.
72. En effet, pour ce qui est des traitements subis par le requérant durant sa détention en 2006, le certificat médical produit atteste des nombreuses cicatrices et des séquelles psychologiques dont il souffre, établit que ces cicatrices sont compatibles avec les faits rapportés (voir paragraphe 13) et témoigne de la gravité des sévices infligés.
73. De plus, le requérant fut incarcéré à la prison de Kin-Mazière, centre de détention dirigé par la DRGS, division de la police spécialisée dans le renseignement et chargée d’enquêter sur les activités des opposants au gouvernement Kabila (voir paragraphe 41), ce que le Gouvernement ne conteste pas.
74. En conséquence, la Cour estime avéré le passé politique du requérant et constate que sa détention apparaît directement liée à son activité militante au sein de l’opposition.
75. Quant à l’existence d’un risque actuel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant en RDC, le Gouvernement soutient que le contexte politique a changé en RDC et que les militants du MLC ne sont plus menacés. La Cour observe toutefois que cette organisation fait toujours partie de l’opposition parlementaire. Si la répression systématique des membres du MLC n’a plus cours, les rapports internationaux indiquent toutefois que certains membres du MLC ont été inquiétés jusqu’en 2011 (voir paragraphe 35).
76. Surtout, la Cour relève que le requérant allègue avoir également milité pour d’autres partis d’opposition, tels que l’UDPS, ce que met en doute le Gouvernement. La Cour observe que les dessins du requérant, en particulier ceux réalisés en 2007, comportent des slogans au nom de plusieurs partis d’opposition, dont l’UDPS (voir paragraphe 18). Or les sympathisants de ce parti font aujourd’hui l’objet d’une répression d’une particulière gravité, ceux-ci étant régulièrement soumis à des menaces, intimidations et arrestations arbitraires (voir paragraphe 36).
77. En tout état de cause, le requérant fournit un avis de recherche, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le Gouvernement, daté du 27 août 2010 à son nom et le désignant comme « artiste dessinateur, combattant de la rue, sympathisant de certains mouvements opposants à citer l’exemple MLC » et mentionnant qu’il est recherché pour « évasion de la prison de Kin-Mazière, non-respect des consignes de mise en liberté, atteinte à la sûreté de l’Etat et aux institutions de la République », faits constitutifs de l’infraction de « très haute trahison » sanctionnée par la peine de prison à perpétuité selon le code pénal militaire. Le requérant produit en outre une convocation en date du 3 septembre 2010, lui demandant de se rendre au tribunal de grande instance de Matete à Kinshasa (voir paragraphe 25).
78. La Cour constate que le Gouvernement cite dans ses observations la décision de l’OFPRA du 6 octobre 2010 selon laquelle cette dernière convocation ne comporterait pas « toutes les garanties d’authenticité » (voir paragraphe 26). La Cour observe cependant que l’OFPRA n’apporte aucune justification à l’appui de cette conclusion. Par conséquent, la Cour ne saurait se fonder sur l’appréciation faite par l’OFPRA dans la mesure où elle ne dispose, à cet égard, d’aucun élément explicatif (voir, mutatis mutandis, Mo. M. c. France, no 18372/10, § 41, 18 avril 2013).
79. Ainsi, la Cour estime, au vu du profil du requérant, et notamment de ses liens avec l’opposition, de son incarcération à la prison de Kin-Mazière, du certificat médical explicite corroborant son récit, de l’avis de recherche et de la convocation datés de 2010 émis à son encontre en raison de son engagement militant et indiquant qu’il est poursuivi pour des crimes passibles d’une peine de prison à perpétuité, qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il présente un intérêt tel pour les autorités congolaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour (a contrario voir Xa c. France (déc.), no 36457/08, 25 mai 2010, Mawaka, précité, § 67, M.M. c. France (déc.), no 49029/10, 11 septembre 2012). Il existe donc, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel qu’il soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités congolaises en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
80. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’un renvoi du requérant vers la RDC emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
B et C c. Suisse du 17 novembre 2020 requêtes n° 889/19 et 43987/16
Article 3 : Les autorités suisses n’ont pas suffisamment évalué les risques auxquels un homosexuel serait exposé en cas de renvoi vers la Gambie
La Cour considère que l’incrimination des pratiques homosexuelles ne suffit pas à rendre une décision de renvoi contraire à la Convention. Elle estime néanmoins que les autorités suisses n’ont pas correctement apprécié le risque de mauvais traitements auquel le premier requérant, du fait de son homosexualité, se trouverait exposé en cas de renvoi vers la Gambie, et qu’elles n’ont pas suffisamment cherché à déterminer si l’État le protègerait contre de tels actes aux mains d’acteurs non étatiques. Selon plusieurs autorités indépendantes, les autorités de Gambie refusent d’accorder leur protection aux personnes LGBTI. La Cour considère en outre que la mesure qu’elle a indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 de son règlement doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif.
FAITS
Les requérants, MM. B et C, sont des ressortissants de nationalité gambienne et suisse respectivement. Nés en 1974 et 1948 respectivement, ils résidaient ensemble à Saint-Gall (Suisse) jusqu’au décès du deuxième requérant le 15 décembre 2019. Le premier requérant était arrivé en Suisse en 2008. Sa demande d’asile avait été rejetée, les autorités suisses ayant jugé non crédibles ses allégations selon lesquelles il avait subi des mauvais traitements. En 2014, les requérants conclurent un partenariat enregistré. Le second requérant introduisit une demande de regroupement familial à l’égard du premier requérant, mais sa demande fut rejetée. En appel, le Département de la sécurité et de la justice du canton de Saint-Gall (« le DSJ ») rejeta la demande dont M. B l’avait saisi aux fins d’obtenir le droit de rester en Suisse pendant la procédure de regroupement familial. Le Tribunal fédéral, tenant compte notamment des antécédents judiciaires de l’intéressé dans le canton de Lucerne et du temps qu’il avait passé en prison, confirma cette décision en dernière instance. M. B resta toutefois en Suisse pendant la durée de la procédure de regroupement familial, la Cour ayant indiqué une mesure provisoire.
Le Tribunal fédéral confirma par la suite la décision de rejet de la demande de regroupement familial qui avait été prononcée par le DSJ. Il considéra que le premier requérant disposait en Gambie d’un réseau familial sur lequel il pouvait s’appuyer, et que la condition des homosexuels s’était améliorée dans ce pays. Il estimait que ni les autorités de Gambie ni le public n’auraient connaissance de l’orientation sexuelle du premier requérant. Évoquant ses antécédents judiciaires, il ajouta que l’intéressé n’était pas bien intégré en Suisse. Il conclut qu’il y avait un « intérêt public important » à éloigner le premier requérant et que l’atteinte à ses droits était justifiée.
CEDH
La Cour prononce la jonction des requêtes. Elle considère qu’il n’y a pas de circonstance spéciale propre à justifier qu’elle examine la requête du second requérant, décédé entre-temps.
Article 3
Le premier requérant allègue qu’il a quitté la Gambie parce que l’homosexualité y était activement réprimée, et que les actes homosexuels y sont toujours réprimés par la loi. Or, il considère que l’homosexualité est un élément central de son identité. La Cour rappelle qu’une loi interdisant les actes homosexuels ne suffit pas à rendre un renvoi vers le pays concerné contraire à la Convention. Elle relève qu’il ne fait pas débat que le premier requérant est homosexuel, mais elle souscrit au constat des juridictions internes qui consiste à dire que les allégations selon lesquelles il aurait par le passé subi des mauvais traitements ne sont pas crédibles. La Cour note que le premier requérant réside toujours en Suisse et que c’est donc la situation actuelle en Gambie qui doit être examinée. Elle considère que l’orientation sexuelle d’une personne constitue un élément essentiel de son identité et que personne ne devrait se voir contraint de la dissimuler pour éviter des persécutions. L’orientation sexuelle du premier requérant pourrait être découverte s’il venait à être renvoyé vers la Gambie. Or les autorités internes ont affirmé le contraire. Elles ont en outre omis de rechercher si les autorités gambiennes auraient la capacité et la volonté d’offrir au premier requérant le degré de protection nécessaire contre les mauvais traitements qu’il risquerait de subir aux mains d’acteurs non étatiques à raison de son orientation sexuelle. Le ministère britannique de l’intérieur et les tiers intervenants, notamment, soutiennent que les autorités gambiennes refusent actuellement d’offrir une protection aux personnes LGBTI qui se trouvent sur leur territoire. La Cour considère que les juridictions suisses n’ont suffisamment apprécié ni les risques de mauvais traitements auxquels le premier requérant se trouverait exposé en cas renvoi vers la Gambie, ni le degré de protection que l’État lui offrirait contre tout risque de mauvais traitements aux mains d’acteurs non étatiques. Elle conclut que le renvoi du premier requérant vers la Gambie emporterait violation de la Convention.
Article 8
Les requérants allèguent que l’expulsion du premier requérant porterait atteinte au droit au respect de leur vie familiale et que le fait pour le premier requérant de devoir dissimuler son homosexualité s’analyserait en une atteinte au droit au respect de sa vie privée. Le premier requérant reconnaît que le décès du second requérant a changé la situation, mais il soutient qu’il souhaite malgré tout continuer de vivre dans l’environnement qu’il partageait avec son ancien partenaire. La Cour considère que la question de la séparation physique des deux requérants n’est plus pertinente et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner séparément les griefs fondés sur cet article.
JOSEF c. BELGIQUE Requête 70 055/10 du 27 février 2014
Le renvoi d'une personne qui devait avoir des soins est une violation de la convention
91. La Cour considère que la requérante avait prima facie des griefs défendables à faire valoir devant les juridictions internes tant sous l'angle de l'article 3 que de l'article 8 de la Convention et que, par conséquent, l'article 13 s'applique.
92. La Cour constate que le Gouvernement ne suggère pas que la requérante ne pourrait se prévaloir de la qualité de victime d'une violation alléguée de la Convention en raison de l'absence de mesures de contrainte (voir paragraphes 79 à 82 ci-dessus).
93. La Cour observe, à la lumière des dispositions légales applicables et de la jurisprudence y relative (voir paragraphes 46 et 67 ci-dessus), qu'en droit belge, un ordre de quitter le territoire est une décision administrative exécutoire permettant à l'administration d'en poursuivre l'exécution forcée. En l'espèce, l'ordre donné à la requérante de quitter le territoire pouvait ainsi être exécuté à tout moment à partir du 22 décembre 2010. La Cour estime que cette circonstance suffit pour conclure que la requérante avait droit à un recours permettant un examen effectif de ses griefs.
94. La Cour se réfère, à cette fin, aux principes généraux relatifs à l'effectivité des recours et des garanties à fournir par les États parties en cas d'expulsion d'un étranger en vertu des articles 13 et 3 combinés tels qu'ils sont résumés dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (no 30696/09, §§ 286 à 293, CEDH 2011 ; voir, plus récemment, I.M. c. France, no 9152/09, §§ 127 à 135, 2 février 2012, et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, §§ 77 à 83, CEDH 2012).
95. La Cour constate qu'en droit belge, le recours porté devant le CCE visant l'annulation d'un ordre de quitter le territoire ou d'un refus de séjour n'est pas suspensif de l'exécution de l'éloignement. La loi sur les étrangers prévoit par contre des procédures spécifiques pour en demander la suspension, soit la procédure de l'extrême urgence, soit la procédure de suspension « ordinaire » (voir paragraphes 64 à 73 ci-dessus).
96. La demande de suspension en extrême urgence a pour effet de suspendre de plein droit la mesure d'éloignement. Le CCE peut, dans ce cas, sur la base notamment d'un examen du caractère sérieux des moyens fondés sur la violation de la Convention, ordonner, dans un délai de 72 heures, le sursis à l'exécution des décisions attaquées et prévenir de la sorte que les intéressés soient éloignés du territoire avant un examen approfondi de leurs moyens, à effectuer dans le cadre du recours en annulation.
97. Le Gouvernement fait valoir, ainsi que le CCE l'a souligné dans son arrêt du 27 novembre 2010 (voir paragraphe 46 ci-dessus), que la suspension peut également être obtenue par le jeu d'une autre combinaison de recours : d'abord, un recours en annulation et une demande de suspension ordinaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision faisant grief ; ensuite, au moment où l'étranger fait l'objet d'une mesure de contrainte, une demande de mesures provisoires en extrême urgence. Le CCE est alors dans l'obligation légale d'examiner, dans les 72 heures et en même temps, la demande de mesures provisoires en extrême urgence et la demande de suspension ordinaire introduite auparavant. L'introduction de la demande de mesures provisoires en extrême urgence a, à partir du moment de son introduction, un effet de suspension de plein droit de l'éloignement.
98. En vertu de l'interprétation qu'a donnée le CCE de la notion d'extrême urgence, tant la demande de suspension en extrême urgence que la demande de mesures provisoires en extrême urgence nécessitent, pour pouvoir être déclarées recevables et fondées, l'existence d'une mesure de contrainte (voir paragraphes 46 et 67 ci-dessus).
99. En l'espèce, la requérante a saisi le CCE d'un recours en annulation et d'une demande de suspension en extrême urgence dirigés contre la décision de rejet de la demande de régularisation de séjour et l'ordre de quitter le territoire délivrés par l'OE les 20 octobre et 22 novembre 2010 respectivement. Le CCE a constaté qu'en l'absence de mesure de contrainte prise à son égard, la requérante n'avait pas démontré l'extrême urgence de sa situation. Le CCE a donc rejeté la demande de suspension en extrême urgence pour ce motif par un arrêt du 27 novembre 2010.
100. La requérante allègue qu'en rejetant ainsi sa demande de suspension, le CCE l'a privée, en violation de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention, de la seule possibilité en droit belge d'obtenir la suspension de plein droit de son éloignement alors que celui-ci pouvait être exécuté à tout moment après le 22 décembre 2010.
101. Le Gouvernement soutient, quant à lui, que la requérante aurait dû utiliser, comme le lui suggérait le CCE par son arrêt du 27 novembre 2010, l'autre combinaison de recours, à savoir un recours en annulation et une demande de suspension ordinaire de l'ordre de quitter le territoire assortie, le moment venu, d'une demande de mesures provisoires en extrême urgence.
102. La Cour observe que ce système, tel que décrit ci-dessus (voir paragraphes 96 et 97 ci-dessus), a pour effet d'obliger l'étranger, qui est sous le coup d'une mesure d'éloignement et qui soutient qu'il y a urgence à demander le sursis à exécution de cette mesure, à introduire un recours conservatoire, en l'occurrence une demande de suspension ordinaire. Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, doit être introduit dans le seul but de se préserver le droit de pouvoir agir en urgence lorsque la véritable urgence, au sens donné par la jurisprudence du CCE, se réalise, c'est-à-dire quand l'étranger fera l'objet d'une mesure de contrainte. La Cour observe au surplus que, dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pas mis en mouvement ce recours conservatoire au début de la procédure, et où l'urgence se concrétise par après, il est définitivement privé de la possibilité de demander encore la suspension de la mesure d'éloignement.
103. Selon la Cour, si une telle construction peut en théorie se révéler efficace, en pratique, elle est difficilement opérationnelle et est trop complexe pour remplir les exigences découlant de l'article 13 combiné avec l'article 3 de disponibilité et d'accessibilité des recours en droit comme en pratique (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 112, CEDH 1999‑IV, M.S.S., précité, § 318, et I.M., précité, § 150). Elle note en outre que si, dans l'hypothèse précitée (voir paragraphe 102 in fine), l'étranger ne retire pas son recours en annulation initial et ne le réintroduit pas, cette fois accompagné d'une demande de suspension ordinaire, le système préconisé par le Gouvernement peut mener à des situations dans lesquelles l'étranger n'est en fait protégé par un recours à effet suspensif ni durant la procédure contre l'ordre d'expulsion ni face à l'imminence d'un éloignement. C'est cette situation qui s'est produite en l'espèce, alors même que la requérante était conseillée par un avocat spécialisé. Eu égard à l'importance du droit protégé par l'article 3 et au caractère irréversible d'un éloignement, une telle situation est incompatible avec les exigences desdites dispositions de la Convention (voir, parmi d'autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007‑II, M.S.S., précité, § 293 et 388, Diallo c. République tchèque, no 20493/07, § 74, 23 juin 2011, Auad c. Bulgarie, no 46390/10, § 120, 11 octobre 2011, Al Hanchi c. Bosnie-Herzégovine, no 48205/09, § 32, 15 novembre 2011, I.M., précité, § 58, De Souza Ribeiro, précité, § 82, Mohammed c. Autriche, no 2283/12, § 72, 6 juin 2013, et M.A. c. Chypre, no 41872/10, § 133, CEDH 2013 (extraits)).
104. La Cour observe en outre que ce système accule les intéressés, qui se trouvent déjà dans une position vulnérable, à agir encore in extremis au moment de l'exécution forcée de la mesure. Cette situation est d'autant plus préoccupante dans le cas d'une famille accompagnée d'enfants mineurs sachant que l'exécution de la mesure sous la forme d'un placement en détention, si elle ne peut pas être évitée, doit être réduite au strict minimum conformément, notamment, à la jurisprudence de la Cour (Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, no 41442/07, 19 janvier 2010, Kanagaratnam c. Belgique, no 15297/09, 13 décembre 2011, et Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 19 janvier 2012).
105. La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la possibilité qu'avait la requérante de saisir le juge judiciaire des référés (voir paragraphes 75 à 77 ci-dessus). Il lui suffit de constater que ce recours n'est pas non plus suspensif de plein droit de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il ne remplit donc pas non plus les exigences requises par l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3 (voir, mutatis mutandis, Singh et autres c. Belgique, no 33210/11, § 97, 2 octobre 2012).
106. Au vu de l'analyse du système belge qui précède, la Cour conclut que la requérante n'a pas disposé d'un recours effectif, dans le sens d'un recours à la fois suspensif de plein droit et permettant un examen effectif des moyens tirés de la violation de l'article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention.
107. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de la multitude de recours devant le CCE ou du recours devant le juge judiciaire des référés pour faire valoir son grief tiré de l'article 3. L'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne le grief fondé sur l'article 3 (voir paragraphe 83 ci-dessus) doit donc être rejetée.
108. Vu la conclusion sur l'article 13 combiné avec l'article 3 et les circonstances de l'affaire, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de la requérante sous l'angle de l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention.
K.A.B C. Suède du 5 septembre 2013 requête 886/11
Une Expulsion vers la Somalie ne comporte aucun risque pour le requérant.
R.D. c. FRANCE du 16 juin 2016 requête 34648/14
Violation de l'article 3 et de l'article 3 combiné à l'article 13, la requérante originaire de Conakry, appartient à l'ethnie peule. Musulmane, elle connaît et épouse un chrétien. Pour sa famille dont le père est IMAM, c'est l'horreur absolu ! Elle se sauve et se réfugie en France pour épouser son amour. Au centre de rétention pour étranger, elle est examinée par des médecins. Les cicatrices relevées sont compatibles avec sa description des faits, prononcée en français.
36. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
37. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 113, CEDH 2016). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, F.G. c. Suède, précité, § 118).
38. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
39. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996‑V, F.G. c. Suède, précité, § 115).
40. La Cour observe, en premier lieu, que les rapports internationaux relatifs à la situation en Guinée dénoncent le traitement réservé aux femmes (voir paragraphes 19-21). Il ressort également de ces rapports que les autorités guinéennes ne sont pas en mesure d’assurer la protection des femmes dans la situation de la requérante.
41. En deuxième lieu, la Cour prend note des arguments du Gouvernement et, notamment, de ceux relatifs à l’impossibilité d’apprécier l’authenticité des éléments du récit produit par la requérante devant l’OFPRA (voir paragraphes 14 et 34) à l’occasion d’un entretien qui se déroula à une date antérieure à l’établissement des deux certificats médicaux mentionnés ci-dessus.
42. Toutefois, la Cour souligne qu’au‑delà de cet élément, la requérante produit des documents dont le contenu est de nature à rendre crédible le risque allégué. En particulier la Cour relève que le récit de la requérante est étayé par trois documents : les deux certificats médicaux (voir paragraphe 15) d’une part et une copie certifiée conforme du registre d’état civil attestant que la requérante épousa X le 4 novembre 2012 à Conakry.
43. La Cour rappelle, en troisième lieu, que les traitements prohibés par l’article 3 que la requérante craint de subir trouvent leur origine dans les agissements de sa famille. En outre, le récit de la requérante, que le gouvernement n’a pas mis en doute sur ce point, établit que la famille dispose de moyens lui permettant de retrouver la requérante, même si elle s’installait hors de Conakry (voir paragraphe 9).
44. Enfin, en quatrième lieu, eu égard tant aux raisons qui présidèrent à la fuite de la requérante (voir paragraphes 6 à 11 ci‑dessus) qu’aux circonstances dans lesquelles cette fuite se déroula, la Cour estime improbable que le passage du temps ait diminué les risques de mauvais traitements.
45. Dès lors, la Cour estime qu’en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi, la requérante encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ce qui emporterait violation de cette disposition.
ARTICLE 3 COMBINE A L'ARTICLE 13
55. S’agissant des principes applicables, il est renvoyé aux arrêts I.M. c. France (précité, §§ 127-135) et M.E. c. France (précité, §§ 61-64).
56. La Cour est consciente, ainsi qu’elle l’a déjà exprimé dans l’arrêt I.M. c. France (précité, § 142) de la nécessité pour les États confrontés à un grand nombre de demandeurs d’asile de disposer des moyens nécessaires pour faire face à un tel contentieux. Elle ne remet pas en cause l’intérêt et la légitimité de l’existence d’une procédure prioritaire, en plus de la procédure normale de traitement des demandes d’asile, pour les demandes dont tout porte à croire qu’elles sont infondées ou abusives. La Cour a jugé, quant à l’effectivité du système de droit interne pris dans son ensemble, que, si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles, leur accessibilité en pratique avait été limitée par plusieurs facteurs liés, pour l’essentiel, au classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours à sa disposition et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves alors que le requérant se trouvait en détention ou en rétention (I.M. c. France, précité, §§ 49-63, §§ 64-74 et § 154). La Cour a conclu à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 après avoir constaté qu’il s’agissait d’une première demande d’asile et que le requérant, gardé à vue puis détenu, n’avait pas eu la possibilité de se rendre en personne à la préfecture pour introduire une demande d’asile comme l’exige le droit français (ibid., §§ 141 et 143).
57. Dans les arrêts M.E. c. France (précité, §§ 65-70) et K.K. c. France (no 18913/11, §§ 66-71, 10 octobre 2013), la Cour est arrivée à la conclusion inverse après avoir constaté que les requérants avaient particulièrement tardé à présenter leur demande d’asile et, partant, qu’ils avaient pu rassembler, au préalable, toute pièce utile pour documenter une telle demande. En outre, dans l’arrêt Sultani c. France (no 45223/05, §§ 64‑65, CEDH 2007-IV (extraits)), la Cour a estimé que le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne privait pas l’étranger en rétention d’un examen circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale. Le simple fait qu’une demande d’asile soit traitée en procédure prioritaire et donc dans un délai restreint ne saurait en conséquence, à lui seul, permettre à la Cour de conclure à l’ineffectivité de l’examen mené.
58. En l’espèce, la Cour observe que la requérante déposa une première demande en France le 2 mai 2014 et que, du fait du classement en procédure prioritaire, elle ne bénéficia que de délais de recours réduits pour préparer une demande d’asile complète et documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées selon la procédure normale.
59. La Cour relève cependant qu’il n’est pas contesté que la requérante était convoquée le 23 mai 2014 en préfecture. Elle a néanmoins été interpellée le 28 avril 2014 alors qu’elle tentait de quitter le territoire français pour la Grande‑Bretagne sous une fausse identité. Cette circonstance est à l’origine de son placement en rétention et du caractère prioritaire de l’examen de sa demande d’asile.
60. La Cour en déduit que la requérante, contrairement à l’affaire I.M. c. France précitée, était libre, a disposé de deux mois pour rédiger le récit des faits à l’origine de son départ et de ses craintes en cas de retour ainsi que pour se procurer les documents de nature à étayer sa demande d’asile.
61. La Cour note en particulier que si le temps de présence de la requérante en France est notablement plus bref que celui des requérants dans les affaires M.E. c. France (précité) ou K.K. c. France (précité), la requérante bénéficiait du soutien de la plate-forme d’information et d’accueil des demandeurs d’asile et de la Croix-Rouge de Châlons-en-Champagne. De surcroît, la requérante s’était déjà vu fixer un rendez-vous avec les services préfectoraux en vue du dépôt d’une demande d’asile. La Cour en déduit que la requérante avait nécessairement des informations sur la procédure d’asile en France mais également commencé à préparer sa propre demande qu’elle n’avait pas encore finalisée.
62. La Cour constate que la requérante n’allègue pas avoir rencontré des difficultés particulières liées à la barrière de la langue ou à l’indisponibilité d’une assistance juridique dans le centre de rétention.
63. La Cour souligne enfin qu’outre sa demande d’asile, la requérante a pu, lorsqu’elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, former un recours suspensif devant le tribunal administratif (voir paragraphe 13 ci‑dessus).
64. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la requérante ne peut valablement soutenir que l’accessibilité des recours disponibles a été affectée par la brièveté des délais dans lesquels ils devaient être exercés et par les difficultés matérielles rencontrées pour obtenir les preuves nécessaires (voir, mutatis mutandis, M.E. c. France, précité, §§ 65-70). Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de violation de l’article 13 combiné avec l’article 3
SOW c. BELGIQUE du 19 janvier 2016 requête 27081/13
Non violation de l'article 3 : la requérante qui a subi une excision de type 1 de la part de sa famille, peut être renvoyée en Guinée. A 28 ans, armée d'une éducation progressiste elle sait se défendre et sa famille ne pratique pas un Islam wahhabite mais dit "tolérant". Le renvoi de cette femme vers la Guinée ne la soumettrait pas à la torture, soit à une excision de type 2 ou 3.
a) Principes généraux
59. La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 124-125, CEDH 2008, N. c. Royaume-Uni [GC], no 26565/05, § 30, CEDH 2008, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, §§ 113-114, CEDH 2012).
60. Quant aux éléments à prendre en compte pour évaluer le risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour renvoie aux principes généraux dégagés dans sa jurisprudence (Saadi, précité, §§ 128-133).
61. Aussi, la Cour considère qu’eu égard au fait que l’article 3 consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques et proscrit en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, il faut impérativement soumettre à un contrôle attentif (Sultani, précité, § 63) et à un examen indépendant et rigoureux tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention (Jabari, précité, § 50).
b) Application au cas d’espèce
62. Il n’est pas contesté qu’exposer un adulte, contre sa volonté, ou un enfant à une MGF serait constitutif d’un mauvais traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir Collins and Akaziebie, décision précitée, Izevbekhai et autres, décision précitée, § 73, et Omeredo c. Autriche (déc.), no 8969/10, 20 septembre 2011). Il n’est pas davantage contesté que les filles et femmes guinéennes ont traditionnellement été soumises à des MGF et que, dans une très large mesure, elles continuent de l’être. En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une MGF de type I. La question cruciale est donc de savoir s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante courrait un risque réel de subir une ré-excision si elle était rapatriée en Guinée.
63. Les autres motifs d’asile rapportés par la requérante dans ses deux premières demandes d’asile – notamment le mariage forcé – n’ont pas été réitérés devant la Cour. Celle-ci n’examinera donc pas le risque de violation de l’article 3 au regard de ces allégations.
64. D’emblée, la Cour observe que la requérante craint d’être ré-excisée à l’initiative de son oncle, et non pas par les autorités guinéennes. À cet égard, la Cour rappelle qu’en raison du caractère absolu du droit garanti, il n’est pas exclu que l’article 3 de la Convention trouve aussi à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas des autorités publiques, dans les cas où il apparaît que les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III).
65. Aussi, la Cour rappelle qu’en principe les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant si elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010). En l’espèce, la Cour ne voit pas de raison de ne pas suivre les conclusions tirées par les instances d’asile belges.
66. En effet, la Cour note qu’après un examen circonstancié et approfondi de la première demande d’asile, les instances compétentes ont conclu, d’une part, que le récit de la requérante n’était pas crédible et, d’autre part, qu’elle ne courait pas de risque d’être soumise à une ré-excision en cas de renvoi vers la Guinée. Pour arriver à une telle conclusion, le CGRA s’est basé notamment sur un rapport duquel il ressortait que la ré-excision n’était pratiquée que dans des cas déterminés en Guinée, dans lesquels la requérante ne tombait pas. En outre, sur ce point, le CCE considéra que la requérante n’avait fourni aucune information ou indication crédible ou un quelconque commencement de preuve pour établir sa crainte (voir paragraphe 13, ci-dessus). La Cour ne voit aucun élément du dossier ou des rapports internationaux sur la situation générale en Guinée consultés (voir paragraphes 38-42, ci-dessus) permettant de penser que les conclusions auxquelles sont parvenues les instances d’asile nationales en l’espèce étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables. La Cour relève d’ailleurs que, dans son recours devant le CCE dans le cadre de sa première demande d’asile, la requérante n’a pas contesté les rapports cités par le CGRA pour rejeter le risque de ré-excision.
67. Le fait que le CCE ait, dans certaines autres affaires, sur base notamment d’une évaluation des circonstances particulières de chaque affaire, reconnu le risque de ré-excision de jeunes femmes guinéennes (voir paragraphe 34, ci-dessus), n’est pas de nature à modifier ce constat.
68. Aussi, la Cour prend note de la situation personnelle actuelle de la requérante. En effet, la requérante n’ayant pas été expulsée à ce jour, la date à prendre en compte pour évaluer le risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Saadi, précité, § 133). La Cour relève que la requérante est maintenant âgée de vingt-huit ans. Elle a reçu une éducation progressiste et a clairement exprimé son opposition à la pratique des MGF. Sa mère, qui semble être la seule personne de sa famille avec laquelle la requérante est toujours en contact, serait elle aussi progressiste et contre la pratique des MGF, et elle n’a d’ailleurs elle-même pas été excisée. La Cour en conclut que la requérante ne peut pas être considérée comme une jeune femme particulièrement vulnérable (dans le même sens, Collins et Akaziebie, décision précitée, et Izevbekhai et autres, décision précitée).
69. En conclusion, la Cour estime que la requérante n’a pas démontré qu’elle courrait un risque réel d’être ré-excisée en cas de renvoi vers la Guinée. Partant, il n’y aurait pas violation de l’article 3 de la Convention si la requérante était expulsée vers son pays d’origine.
DIALLO c. REPUBLIQUE TCHEQUE du 23 JUIN 2011 Requête no 20493/07
L'Expulsion vers la Guinée sans examen de leur situation est une violation de l'article 3 combiné à l'article 13.
Les requérants, Ibrahima Diallo et Mamadou Dian Diallo, sont deux ressortissants guinéens nés respectivement en 1980 et 1985. En automne 2006, ils arrivèrent à l'aéroport de Prague par un vol en provenance de Dakar (Sénégal) via Lisbonne. Ils demandèrent tous deux aussitôt l'asile, affirmant qu’ils seraient incarcérés voire tués en Guinée s'ils devaient être refoulés vers ce pays où, selon eux, la police était à leur recherche parce qu'ils avaient participé à des activités réprouvées par le gouvernement guinéen.
Le département des réfugiés et des politiques migratoires du ministère de l'Intérieur rejeta, sans examen au fond, leurs demandes d’asile respectives en vertu des dispositions pertinentes de la loi sur l'asile au motif que, les intéressés étant arrivés par le Portugal, considéré comme un pays tiers sûr, leurs demandes étaient manifestement injustifiées. Ibrahima et Mamadou Diallo attaquèrent tous deux ces décisions devant le juge. Ibrahima fut débouté par le tribunal régional en mai 2007 et, dans le cas de Mamadou, la procédure demeura en cours jusqu’à ce qu’il en demande la clôture ; toutefois, en vertu des dispositions de la loi sur l'asile, elle n'avait pas d'effet suspensif étant donné que l'intéressé était arrivé par un pays tiers considéré comme sûr.
Ni l'un ni l'autre des requérants ne s’étant conformés aux décisions leur enjoignant de quitter le territoire, une procédure d’expulsion administrative fut ouverte contre eux, dans le cadre de laquelle le ministère de l'Intérieur déclara que rien ne s'opposait à leur renvoi du fait qu'ils étaient censés être refoulés vers le Portugal, un pays sûr. La police signifia aux requérants des arrêtés d’expulsion leur sommant de quitter le territoire et les recours formés par eux contre ces décisions furent rejetés. En mai 2007, vers 4 heures, sans préavis et sans avoir informé leurs avocats, ils furent expulsés vers la Guinée par un vol via Bruxelles. Ibrahima Diallo, qui est resté en contact avec son avocat après son expulsion, vit actuellement en Arabie Saoudite. On ignore où Mamadou Diallo se trouve exactement et son avocat n'a pas pu reprendre contact avec lui après son expulsion. Néanmoins, il avait signé une procuration à son avocat alors qu'il se trouvait encore à Prague, autorisant ce dernier à entreprendre toute action en justice se rapportant à son expulsion.
Article 13 en combinaison avec l'article 3
La Cour rejette l'exception tirée par le gouvernement tchèque de ce que, Mamadou Diallo n'ayant eu aucun contact avec son avocat après son expulsion, il doit être considéré comme ayant perdu intérêt à la poursuite de l'affaire. Elle relève que, en signant la procuration autorisant son avocat à agir en son nom et à le représenter devant n'importe quel tribunal dans le cadre de son expulsion, Mamadou Diallo a suffisamment démontré qu'il souhaitait que son avocat introduisît en son nom une requête devant la Cour. De plus, ce n'est pas de la faute de M. Diallo si, après avoir été expulsé vers la Guinée à 4 heures sans préavis, son avocat a perdu tout contact avec lui.
La Cour considère que les requérants pouvaient tous deux se prévaloir, sur le terrain de l'article 13, d'un grief défendable tiré de ce que leur retour en Guinée les aurait exposés à un risque de mauvais traitement contraire à l'article 3. Elle prend note en particulier de divers rapports, établis notamment par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et des organisations telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch, faisant état de violations des droits de l'homme commises en Guinée en 2006 et 2007. Compte tenu de la situation des requérants, qui étaient recherchés par la police parce que le premier s’était livré à des activités politiques et avait participé à des grèves et à des manifestations et que le second avait présidé une organisation d'opposition rassemblant des jeunes, leurs craintes étaient bien fondées.
Pour ce qui est des procédures d'asile, la Cour relève que le moyen tiré par les requérants de ce que leur retour en Guinée les aurait exposés à des mauvais traitements n'a pas fait l'objet par le ministère de l'Intérieur de l'examen minutieux et rigoureux exigé par la Convention, ni même à une quelconque analyse, ce au seul motif qu'ils étaient arrivés par le Portugal, considéré comme un pays tiers sûr. S'il n'appartient pas à la Cour d'interpréter le droit communautaire ni le droit interne afin d'établir si c’était la République tchèque ou le Portugal qui aurait dû examiner les demandes d'asile, il lui suffit de constater que les requérants ont été expulsés non pas vers le Portugal mais vers leur pays d'origine, la Guinée.
De plus, les recours en justice formés par les requérants n'avaient pas d’effet suspensif de plein droit. Il ne pouvait donc être reproché à Ibrahima Diallo, contrairement à ce que plaide le gouvernement tchèque, de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes.
Dans son cas, les tribunaux tchèques n'ont en effet jamais examiné sa demande. En ce qui concerne Mamadou Diallo, au lieu d'examiner son grief défendable sur le terrain de l'article 3, ils se sont contentés de confirmer la décision concluant que sa demande n'était pas justifiée au motif qu'il était arrivé par un pays tiers sûr. Dans ces conditions, les procédures d'asile ne constituaient pas pour les requérants un recours interne effectif au sens de l’article 13.
Les autorités n'ont pas non plus examiné dans le cadre des procédures d'expulsion administrative le grief défendable des requérants sur le terrain de l'article 3. En particulier, la conclusion du ministère de l'Intérieur selon laquelle rien ne faisait obstacle à leur renvoi partait du principe qu’ils devaient seulement être refoulés vers le Portugal.
Demander l’examen par le juge de la décision administrative d'expulsion voire saisir ensuite la Cour constitutionnelle n'aurait pas constitué un recours effectif, étant donné que cette dernière n'aurait fait qu'examiner la constitutionnalité des dispositions applicables de la loi nationale, au lieu d'examiner sur le fond les griefs fondés sur l'article 3. Par ailleurs, pareils recours n'auraient pas eu d'effet suspensif sur les expulsions.
Aucune instance interne n'ayant donc examiné sur le fond le grief défendable soulevé par les requérants sur le terrain de l'article 3 et aucun recours avec un effet suspensif de plein droit ne leur ayant été ouvert pour contester les décisions rejetant leurs demandes d'asile et ordonnant leur expulsion, la Cour conclut à la violation de l'article 13 en combinaison avec l'article 3.
Arrêt Ahorugeze c. Suède du 27 octobre 2011 requête no 37075/09
L'extradition d'un individu soupçonné de génocide au Rwanda ne violerait pas la Convention européenne des droits de l’homme. Il aura un procès équitable.
S’il apparaît que le requérant a été opéré du cœur, aucun certificat médical donnant à penser qu’il pourrait avoir besoin d’une autre opération n’a été produit. En tout état de cause, l’état de santé de l’intéressé n’est pas suffisamment préoccupant pour soulever une question sur le terrain de l’article 3.
En ce qui concerne l’allégation de l’intéressé selon laquelle son appartenance à l’ethnie hutue l’exposerait à un risque de persécution en cas d’extradition, la Cour relève que rien ne permet de conclure qu’il existe au Rwanda une pratique généralisée de persécution et de mauvais traitements à l’encontre des Hutus. Par ailleurs, le requérant n’a fait état d’aucun élément de sa situation personnelle qui serait susceptible de l’exposer à un risque de persécution en raison de son origine hutue.
La prison où l’intéressé serait détenu s’il était extradé et où il purgerait sa peine s’il était condamné offre des conditions d’incarcération satisfaisantes. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (dans une affaire dont il a eu à connaître), le gouvernement néerlandais (dans ses observations de tiers intervenant dans la présente affaire) et le tribunal de district d’Oslo (dans un jugement rendu en juillet 2011 autorisant l’extradition vers le Rwanda d’un autre individu soupçonné de génocide) l’ont confirmé. Pour sa part, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a fait transférer plusieurs condamnés à la prison en question pour qu’ils y purgent leur peine.
Enfin, rien de donne à penser que l’intéressé serait soumis à des mauvais traitements au Rwanda. Depuis 2008, les personnes renvoyées au Rwanda par des Etats tiers pour y être jugées ne peuvent être condamnées à la réclusion à perpétuité à l’isolement.
Dans ces conditions, la Suède n’enfreindrait pas l’interdiction des mauvais traitements posée par l’article 3 de la Convention si elle extradait l’intéressé vers le Rwanda.
Procès équitable (article 6)
S’il est vrai que, en 2008 et 2009, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et plusieurs pays ont refusé de renvoyer au Rwanda des personnes soupçonnées de génocide parce qu’ils craignaient que celles-ci ne puissent y bénéficier d’un procès équitable, la législation rwandaise a évolué depuis lors et la pratique du droit s’y est améliorée.
La question centrale qui se pose à la Cour est celle de savoir si le requérant pourrait faire citer des témoins et obtenir des tribunaux rwandais qu’ils examinent leurs dépositions dans le respect du principe de l’égalité des armes entre la défense et l’accusation s’il était extradé. Après un examen approfondi des évolutions de la législation et de la pratique du droit au Rwanda, la Cour conclut que les juridictions rwandaises sont censées agir dans le respect des exigences posées par la Convention en matière de procès équitable.
En outre, le requérant pourrait désigner un avocat de son choix ou bénéficier de l’assistance d’un avocat rémunéré par l’Etat. Il convient de relever que nombre d’avocats rwandais ont une expérience professionnelle supérieure à cinq ans.
S’appuyant sur l’expérience acquise par des équipes d’enquêteurs néerlandais et la police norvégienne au cours de missions au Rwanda, la Cour estime que l’on ne peut reprocher à la justice rwandaise un manque d’indépendance ou d’impartialité.
En outre, l’intéressé n’a pas démontré que le fait qu’il ait par le passé témoigné en faveur de la défense dans le cadre de procès pour génocide l’exposerait à un risque de procès inéquitable s’il était extradé. Les personnes extradées pour leur implication présumée dans des faits de génocide sont jugées par la Haute cour de justice et la Cour suprême, non par les juridictions communautaires gacaca mises en place en 2002 pour statuer sur de très nombreuses affaires mettant en cause des personnes accusées de génocide et promouvoir l’unité nationale.
Enfin, en juin 2011, le TPIR a décidé pour la première fois d’ordonner le transfert vers le Rwanda d’un individu – M. Uwinkindi – accusé de génocide pour qu’il y soit jugé. Pour se prononcer ainsi, le TPIR s’est déclaré convaincu que l’accusé bénéficierait au Rwanda d’un procès équitable conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme compte tenu des solutions apportées aux problèmes qui l’avaient conduit à refuser en 2008 d’ordonner le transfert vers le Rwanda de personnes soupçonnées de génocide.
Dans ces conditions, l’extradition de l’intéressé au Rwanda en vue de son procès ne l’exposerait pas à un risque de déni de justice flagrant. En conséquence, il n’y aurait pas violation de l’article 6.
La Cour invite le gouvernement suédois à surseoir à l’extradition du requérant tant que son arrêt n’aura pas acquis un caractère définitif.
Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni du 3 octobre 2022 requête no 22854/20
Art 3 : L’extradition du requérant ne serait pas contraire à la Convention européenne
Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, que l’extradition de M. Sanchez-Sanchez vers les États-Unis ne serait pas contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour juge que, si les principes exposés dans sa jurisprudence antérieure doivent s’appliquer dans le contexte interne, une approche modulée s’impose dans une affaire d’extradition telle que celle-ci, où le requérant n’a été ni reconnu coupable ni condamné, et où un constat de violation pourrait l’empêcher de passer en jugement. Elle écarte ensuite la jurisprudence Trabelsi c. Belgique en l’espèce pour les affaires non internes, soulignant toutefois que cela ne remet nullement en cause sa position selon laquelle l’extradition d’une personne par un État contractant soulève des problèmes lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que l’intéressé sera exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. La Cour dit que, en matière d’extradition, il appartient en premier lieu au requérant de démontrer qu’il existe un risque réel que, s’il était reconnu coupable, il soit condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En second lieu, conformément à l’essence de la jurisprudence Vinter et autres c. Royaume-Uni, l’État requis doit s’assurer, avant d’autoriser l’extradition, qu’il existe dans l’État requérant un mécanisme de réexamen des peines permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou tout autre motif de libération fondé sur son comportement ou sur d’autres circonstances. En ce qui concerne M. Sanchez-Sanchez, la Cour estime qu’il n’a pas démontré que, s’il venait à être reconnu coupable aux États-Unis des infractions qui lui étaient reprochées, il existait un risque réel qu’il soit condamné à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Il n’y a donc pas lieu de passer à la seconde étape de l’analyse. L’arrêt est définitif. La Cour décide également de lever la mesure provisoire (qu’elle avait prise en vertu de l’article 39 de son règlement) indiquant au gouvernement britannique qu’il devait surseoir à l’extradition de M. Sanchez-Sanchez.
Art 3 • Absence de preuve d’un risque réel que le requérant soit condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s’il est extradé et reconnu coupable aux États-Unis • Absence d’obligation pour les États contractants sur le terrain de la Convention à raison des défaillances qui apparaîtraient dans le système d’un État tiers si l’on appliquait l’intégralité des normes tirées de l’arrêt Vinter et autres, qui comprennent à la fois une obligation matérielle et des garanties procédurales • Jurisprudence de la Cour Trabelsi c. Belgique écartée • Approche modulée pour les affaires d’extradition consistant en une analyse en deux étapes • 1) Vérifier si le requérant a produit des éléments prouvant qu’il y a des raisons sérieuses de penser que sa condamnation l’exposerait à un risque réel de se voir infliger une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle • 2) Rechercher si, dès le prononcé de la peine, il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales de considérer les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou tout autre motif de libération fondé sur son comportement ou sur d’autres circonstances personnelles pertinentes • Présence de garanties procédurales pour les « détenus condamnés à perpétuité » dans l’État requérant n’étant pas une condition préalable indispensable au respect de l’art 3 par l’État contractant requis • Requérant n’encourant pas une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité
FAITS
Le requérant, Ismail Sanchez-Sanchez, est un ressortissant mexicain né en 1968. Il est détenu à la prison de Wandsworth, au Royaume-Uni. Il fut arrêté à l’aéroport d’Heathrow (Royaume-Uni) le 19 avril 2018 à la demande des États-Unis, qui avaient sollicité son arrestation provisoire. M. Sanchez-Sanchez est censé être extradé aux États-Unis, où il est recherché pour distribution et trafic de drogue. À l’audience d’extradition, les parties convinrent que si M. Sanchez-Sanchez était reconnu coupable des infractions dont il était accusé, il encourrait une peine de niveau 43 selon les lignes directrices en matière de peines (Sentencing Guidelines), qui prévoient une échelle des peines. La juge de district (District Judge) estima qu’il existait une « possibilité réelle » que, dans le cas où il serait reconnu coupable, le requérant soit condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. M. Sanchez-Sanchez contesta l’ordonnance d’extradition devant la High Court. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne, il arguait qu’il y avait un risque réel qu’il soit condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité « incompressible », sans possibilité de libération conditionnelle, s’il était reconnu coupable des infractions dont il était accusé. La High Court le débouta, refusant de tenir compte de l’arrêt Trabelsi c. Belgique de 2014, dans lequel la Cour européenne avait conclu que l’extradition vers les États-Unis du requérant violait la Convention, au motif que celui-ci risquait d’y être condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité qui, à l’aune des normes applicables dans les États contractants, était incompressible. La High Court s’estimait en effet liée par l’arrêt que la Chambre des Lords avait rendu en l’affaire R (Wellington) v. Secretary of State for the Home Department [2009] 1 AC 335, dans lequel la haute juridiction avait jugé que l’extradition vers les États-Unis d’un justiciable qui risquait, s’il était reconnu coupable, d’y être condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle n’était pas contraire à l’article 3 de la Convention puisque la peine ne serait pas incompressible. La High Court estima en outre qu’une éventuelle peine de perpétuité pourrait être réduite car les détenus disposaient dans le système américain de deux moyens d’obtenir une réduction de peine : la libération pour motif d’humanité (titre 18 du code des États-Unis) et la grâce.
ART 3
a) Principes généraux en ce qui concerne les peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans le contexte interne
78. L’article 3 de la Convention, qui prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, et d’après l’article 15 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 163, série A no 25, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, Al-Adsani c. Royaume‑Uni [GC], no 35763/97, § 59, CEDH 2001-XI, et Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 335, CEDH 2005‑III).
79. Dans l’affaire Kafkaris c. Chypre ([GC], no 21906/04, CEDH 2008), une peine obligatoire de réclusion à perpétuité avait été infligée au requérant, qui avait été jugé coupable à Chypre de trois chefs d’assassinat. La Cour a reconnu que le prononcé d’une peine d’emprisonnement perpétuel à l’encontre d’un délinquant adulte n’était pas en soi prohibé par l’article 3 ou toute autre disposition de la Convention et ne se heurtait pas à celle‑ci (Kafkaris, précité, § 97, et les affaires qui y sont citées). Elle a néanmoins estimé qu’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Kafkaris, précité, § 97, et les affaires qui y sont citées). Pour la Cour, la principale question à trancher était de savoir si l’on pouvait dire qu’un détenu condamné à perpétuité avait des chances d’être libéré. Aux fins de l’article 3, il suffisait qu’une peine perpétuelle fût de jure et de facto compressible (Kafkaris, précité, § 98). La Cour en a conclu que la possibilité d’une libération anticipée, même lorsqu’une telle décision relevait du pouvoir discrétionnaire du chef de l’État, suffisait à établir l’existence d’une telle possibilité (Kafkaris, précité, § 103). Plus tard, dans l’arrêt Iorgov c. Bulgarie (no 2) (no 36295/02, §§ 51-60, 2 septembre 2010), elle a confirmé que l’espoir d’une mesure de clémence accordée par le chef d’État sous la forme soit d’une grâce soit d’une commutation de peine suffisait à caractériser une possibilité de libération.
80. Dans l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni ([GC], nos 66069/09 et 2 autres, CEDH 2013 (extraits)), la Grande Chambre est revenue sur cette question. Les requérants dans cette affaire, qui étaient eux aussi des détenus à vie, avaient été condamnés à des « peines de perpétuité réelle » après avoir été reconnus coupables au Royaume-Uni de meurtres et ils contestaient la compatibilité de ces peines avec l’article 3 de la Convention. La Cour a dit qu’une peine d’emprisonnement est contraire à l’article 3 de la Convention si elle est « nettement disproportionnée » (Vinter et autres, précité, § 102), ou si – comme elle l’avait conclu dans l’arrêt Kafkaris – il s’agit d’une peine de perpétuité incompressible (Vinter et autres, précité, § 107).
81. Sur ce dernier point, la Cour, compte tenu des objectifs de prévention et de réinsertion de la peine, a mis l’accent non plus sur la « compressibilité » en tant que telle (Kafkaris, précité, § 98) mais sur l’existence d’un mécanisme de réexamen axé sur l’amendement du détenu (Vinter et autres, précité, §§ 109 et suiv.) Sur la question de savoir comment déterminer si, dans une affaire donnée, une peine perpétuelle peut passer pour compressible, elle a posé les principes suivants (Vinter et autres, précité, §§ 119-122) :
« 119. Pour les raisons avancées ci-dessus, la Cour considère qu’en ce qui concerne les peines perpétuelles l’article 3 doit être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention.
120. La Cour tient toutefois à souligner que, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux États contractants en matière de justice criminelle et de détermination des peines (...), elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen. Pour la même raison, elle n’a pas à dire à quel moment ce réexamen doit intervenir. Cela étant, elle constate aussi qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (...).
121. Il s’ensuit que, là où le droit national ne prévoit pas la possibilité d’un tel réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article 3 de la Convention.
122. Même si le réexamen requis est un événement qui par définition ne peut avoir lieu que postérieurement au prononcé de la peine, un détenu condamné à la perpétuité réelle ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les exigences de l’article 3 en la matière. Cela serait contraire non seulement au principe de la sécurité juridique mais aussi aux principes généraux relatifs à la qualité de victime, au sens de ce terme tiré de l’article 34 de la Convention. De plus, dans le cas où la peine est incompressible en vertu du droit national à la date de son prononcé, il serait inconséquent d’attendre du détenu qu’il œuvre à sa propre réinsertion alors qu’il ne sait pas si, à une date future inconnue, un mécanisme permettant d’envisager son élargissement eu égard à ses efforts de réinsertion sera ou non instauré. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article 3 en résultant prend naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention. »
82. Dans l’arrêt Murray c. Pays-Bas ([GC], no 10511/10, § 100, 26 avril 2016), la Cour a étoffé les garanties qui s’imposent dans le contexte interne afin d’assurer l’effectivité du mécanisme de réexamen. En particulier, elle a noté que le droit du détenu à un réexamen implique une appréciation concrète des informations pertinentes et doit être entouré de garanties procédurales adéquates. Elle a ajouté que, dans la mesure nécessaire pour que le détenu sache ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions, une motivation des décisions peut être requise, et qu’il faut donc que l’intéressé ait accès à un contrôle juridictionnel pour faire remédier à tout défaut à cet égard. Enfin, elle a dit que, pour apprécier si une peine perpétuelle est compressible de facto, il peut être utile de prendre en compte les données statistiques sur le mécanisme de recours antérieures au réexamen en question.
b) Principes généraux en ce qui concerne les peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans le contexte de l’extradition
83. Dans les affaires d’extradition, les États contractants voient peser sur eux une obligation de coopérer en matière pénale internationale. Toutefois, cette obligation est assujettie à l’obligation faite aux mêmes États de respecter le caractère absolu de l’interdiction posée par l’article 3 de la Convention (Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, § 94, 29 avril 2022).
84. La Cour a dit à maintes reprises que, la prohibition de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants étant absolue, l’extradition d’une personne par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l’État en cause, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé sera exposé dans l’État requérant à un risque réel d’être soumis à pareils mauvais traitements (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161 ; voir aussi López Elorza c. Espagne, no 30614/15, § 102, 12 décembre 2017).
85. Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 120, 23 mars 2016, et Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 130, CEDH 2008). À cette fin, elle ne peut éviter d’apprécier la situation dans ce pays à l’aune des exigences de l’article 3. Il ne s’agit pas pour autant de faire de la Convention un instrument régissant les actes d’un État tiers ni de prétendre exiger des États contractants qu’ils imposent des normes à pareil État (Soering, précité, § 86, et López Elorza, précité, § 104). Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer une personne à des mauvais traitements prohibés (Soering, précité, § 91, Saadi, précité, § 126, et López Elorza, précité, § 104).
86. La perspective que l’intéressé constitue une menace grave pour la collectivité s’il n’est pas expulsé ne diminue en rien le risque qu’il subisse des mauvais traitements s’il est refoulé, et elle ne peut donc peser dans la balance, compte tenu du caractère absolu de l’article 3 (Saadi, précité, §§ 137‑139).
87. En ce qui concerne la charge de la preuve, c’est en principe au requérant qu’il appartient de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (voir, par exemple, F.G. c. Suède, précité, § 120, et Saadi, précité, § 129).
88. Si le requérant se trouve encore dans l’État contractant, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour. Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (F.G. c. Suède, précité, § 115).
89. Concernant les situations où le risque supposé exister dans l’État requérant est l’imposition éventuelle d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, la Cour, avant l’arrêt Vinter et autres (précité), avait dit qu’une question ne se poserait sur le terrain de l’article 3 que s’il pouvait être démontré soit que le requérant courait un risque réel de se voir infliger une peine nettement disproportionnée dans l’État requérant, soit que, si à un moment donné son maintien en détention ne pouvait plus se justifier par un quelconque motif légitime d’ordre pénologique, la peine perpétuelle serait incompressible de facto et de jure (Harkins et Edwards, précité, §§ 134 et 137‑138). En conséquence, c’est au requérant, au moment de l’extradition litigieuse, d’établir l’existence d’un risque qu’il ait à purger une peine perpétuelle dépourvue de toute justification d’ordre pénologique, étant entendu que le moment où son maintien en détention ne poursuivrait plus aucun but pourrait ne jamais survenir (ibidem, § 140).
90. Dans l’arrêt Vinter et autres (précité), la Cour a jugé, dans le contexte des peines de perpétuité réelle infligées au niveau interne, que le motif d’ordre pénologique justifiant une telle peine devait être réexaminé une fois écoulé un certain laps de temps (paragraphes 80-81 ci-dessus). Par la suite, dans l’arrêt Trabelsi (précité, § 137), elle a appliqué au contexte de l’extradition les critères tirés de l’arrêt Vinter et autres, pour en conclure que l’extradition du requérant emporterait violation de l’article 3 de la Convention au motif qu’aucune des procédures prévues dans l’État requérant ne s’apparentait à un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle si, au cours de l’exécution de sa peine, ce dernier a tellement évolué et progressé qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifierait son maintien en détention.
91. Or, Vinter et autres n’était pas une affaire d’extradition. Cette distinction est importante.
92. Dans un contexte interne, la situation juridique d’un requérant, qui a déjà été jugé coupable et condamné, est connue. De plus, le système interne de réexamen de la peine est lui aussi connu, tant des autorités internes que de la Cour. Dans le contexte d’une extradition, en revanche, lorsque – comme en l’espèce – le requérant n’a pas encore été condamné, une appréciation complexe des risques s’impose, c’est-à-dire un pronostic a priori qui se caractérisera inévitablement par un degré d’incertitude très différent de celui qui entoure le contexte interne. Il faut donc – par principe, mais aussi pour des raisons pratiques – faire preuve de prudence lorsque l’on applique, dans le contexte de l’extradition, l’intégralité des principes tirés de l’arrêt Vinter et autres, qui ont été définis pour s’appliquer dans le contexte interne.
93. À cet égard, la Cour tient tout d’abord à observer que les principes énoncés dans l’arrêt Vinter et autres englobent non seulement l’obligation matérielle qui impose aux États contractants de veiller à ce qu’aucune peine perpétuelle ne devienne avec le temps une peine incompatible avec l’article 3, mais aussi les garanties procédurales en la matière (voir, entre autres, Murray, précité, §§ 99-104), qui ne sont pas des fins en soi mais dont l’observation par les États contractants a pour finalité de prévenir les violations de l’interdiction qui frappe les peines inhumaines ou dégradantes. En ce qui concerne l’obligation matérielle, la Cour rappelle qu’exposer un individu à un risque réel d’être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants irait à l’encontre de l’esprit et de la finalité de l’article 3. En revanche, les garanties procédurales semblent se prêter davantage à un contexte purement interne, de sorte que la question de leur existence ne se pose pas relativement à l’extradition d’un individu demandée par un État tiers, car sinon la responsabilité qui pèserait sur les États contractants dans ce contexte serait interprétée de façon trop extensive. Il s’ensuit que ces derniers ne peuvent pas être tenus pour responsables, sur le terrain de la Convention, des défaillances du système d’un État tiers qui apparaîtraient si l’on appliquait l’intégralité des règles découlant de l’arrêt Vinter et autres. La Cour reconnaît en outre qu’imposer à un État contractant d’analyser le droit et la pratique pertinents d’un État tiers aux fins d’apprécier dans quelle mesure ce dernier respecterait ces garanties procédurales peut se révéler excessivement difficile pour les autorités nationales statuant sur les demandes d’extradition.
94. De plus, la Cour rappelle que, dans le contexte interne, en cas de constat de violation de l’article 3 de la Convention, le requérant resterait en détention jusqu’à ce que soit appliqué ou créé un mécanisme de réexamen conforme à la Convention pouvant permettre sa libération anticipée, sans pour autant y conduire forcément. Ainsi, les motifs légitimes d’ordre pénologique justifiant la détention ne seraient pas remis en cause. En revanche, dans le contexte de l’extradition, le constat d’une violation de l’article 3 aurait pour conséquence qu’une personne faisant l’objet d’accusations graves ne passera jamais en jugement, sauf si elle peut être poursuivie dans l’État requis ou si l’État requérant est à même de fournir les assurances nécessaires pour faciliter l’extradition. Permettre à une telle personne de s’échapper ainsi en toute impunité est une issue qui ne serait guère conciliable avec l’intérêt général de la société à ce que justice soit rendue en matière pénale (López Elorza, précité, § 111), ni avec l’intérêt des États contractants à respecter leurs obligations conventionnelles internationales (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 94), qui visent à empêcher la création de refuges pour les personnes accusées des infractions pénales les plus graves.
95. Par conséquent, si les principes exposés dans l’arrêt Vinter et autres doivent s’appliquer dans le contexte interne, une approche modulée s’impose dans le contexte de l’extradition. Premièrement, une question préliminaire se pose, en l’occurrence celle de savoir si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que sa condamnation l’exposerait à un risque réel d’imposition d’une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sur ce point, c’est au requérant qu’il appartient de démontrer qu’une telle peine serait prononcée (López Elorza, précité, § 107, et Findikoglu c. Allemagne (déc.), no 20672/15, § 37, 7 juin 2016). L’existence d’un tel risque sera d’autant plus facile à établir si le requérant encourt une peine obligatoire de réclusion à perpétuité.
96. S’il est établi à l’issue de cette première étape de l’analyse que le requérant est exposé à un risque réel de peine d’emprisonnement à perpétuité (paragraphe 95 ci-dessus), alors la seconde étape de cette analyse, compte tenu des principes tirés de l’arrêt Vinter et autres, sera axée sur la garantie matérielle, qui est l’essence de cette jurisprudence et qui est facilement transposable du contexte interne à celui de l’extradition : avant d’autoriser l’extradition, les autorités concernées de l’État requis doivent avoir vérifié qu’il existe au sein de l’État requérant un mécanisme de réexamen de la peine permettant aux autorités nationales compétentes de rechercher si, au cours de l’exécution de celle-ci, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (Vinter et autres, précité, § 119). Quant aux garanties procédurales accordées aux « détenus condamnés à perpétuité » (Vinter et autres, précité, §§ 120-122), comme il est indiqué ci‑dessus, la présence de celles-ci dans l’ordre juridique de l’État requérant n’est pas une condition préalable indispensable au respect de l’article 3 par l’État contractant requis.
97. Il s’ensuit que, dans une affaire d’extradition, la question n’est pas de savoir si, au moment de l’extradition du détenu, les peines de réclusion à perpétuité prononcées dans l’État requérant sont compatibles avec l’article 3 de la Convention, à l’aune de toutes les règles applicables aux détenus condamnés à perpétuité dans les États contractants. Au lieu de cela, l’approche modulée à retenir consiste en une analyse en deux étapes : il faut dans un premier temps établir si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son extradition et sa condamnation l’exposeraient à un risque réel de se voir infliger la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (paragraphe 87 ci‑dessus). Dans un second temps, il faut vérifier si, dès le prononcé de la peine, il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle.
98. Dans l’arrêt Trabelsi, la Cour n’a pas abordé, à titre préliminaire, la question de savoir s’il existait un risque réel que le requérant fût condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a recherché si, au moment de l’extradition, les critères tirés de l’arrêt Vinter et autres étaient satisfaits dans leur intégralité. Pour ces raisons, la Cour considère que l’approche adoptée dans l’arrêt Trabelsi doit être écartée.
99. La Cour tient à souligner que l’interdiction des mauvais traitements posée par l’article 3 demeure absolue. À cet égard, elle estime qu’aucune distinction ne peut être opérée entre le niveau minimal de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 dans le contexte interne et le niveau minimal requis dans le contexte extraterritorial (voir, en comparaison, Harkins et Edwards, précité, §§ 124-131). En outre, rien dans les paragraphes précédents ne remet en cause le principe désormais bien établi selon lequel l’extradition d’un individu par un État contractant soulève des problèmes au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que l’intéressé sera exposé dans l’État requérant à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (Soering, précité, § 88 ; voir aussi López Elorza, précité, § 102).
c) Application des principes susmentionnés aux faits de la présente espèce
100. Le requérant n’avance pas que, s’il était jugé coupable des chefs d’inculpation retenus contre lui, une condamnation à la réclusion à perpétuité serait une peine « nettement disproportionnée ». En fait, il allègue simplement qu’une telle peine serait incompressible de facto et de jure et qu’en conséquence elle emporterait violation de l’article 3 de la Convention. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, il incombe à la Cour de déterminer en l’espèce si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son extradition l’exposerait à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (López Elorza, précité, § 107, et les références qui y sont citées). Puisqu’il n’a pas encore été reconnu coupable et que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas passibles d’une peine obligatoire de réclusion à perpétuité, le requérant doit tout d’abord démontrer qu’au cas où il serait condamné, il y aurait un risque réel qu’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle lui soit infligée sans que soient dûment prises en compte toutes les circonstances atténuantes et aggravantes pertinentes (López Elorza, précité, § 107, et Findikoglu, décision précitée, § 37). S’il parvient à le démontrer, il faudra alors s’assurer de l’existence d’un mécanisme de réexamen de la peine qui permettrait aux autorités de l’État requérant d’examiner les progrès accomplis par lui sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle.
101. La Cour répondra à la première question en prenant pour point de départ l’analyse opérée par le juge interne. Alors que la Cour livre sa propre appréciation ex nunc puisque l’extradition n’a pas encore eu lieu (F.G. c. Suède, précité, § 115), les juridictions nationales ont pu procéder à une analyse détaillée des éléments de preuve dans le cadre d’une procédure à laquelle les États-Unis étaient partie (paragraphes 10-23 ci-dessus). La juge de district, au vu des pièces produites par le Gouvernement, a relevé que les condamnations à perpétuité étaient rares dans les affaires de trafic de stupéfiants, et a exposé que de telles peines n’avaient été prononcées que dans 0,3 % de toutes les affaires en 2013, et dans moins d’un tiers des affaires de trafic de stupéfiants au cours de cette même année. Elle s’est référée à la déposition du substitut du procureur fédéral, qui avait déclaré qu’il était peu probable que le requérant fût condamné à une peine de perpétuité pour quelque chef que ce soit, et encore moins probable qu’il se vît infliger des peines consécutives. Elle a estimé que l’intéressé serait donc vraisemblablement condamné à une peine prévoyant sa libération avant sa mort (paragraphe 13 ci-dessus). En revanche, l’expert mandaté par le requérant, s’appuyant apparemment sur le rapport émis en février 2015 par la Commission fédérale sur les peines, intitulé « Les peines de perpétuité dans le système fédéral », avait déclaré que l’infliction d’une peine de perpétuité supposait en général qu’une personne fût décédée suite à l’infraction en cause (paragraphe 14 ci-dessus).
102. Au vu du dossier, la juge de district a conclu que, si le requérant venait à être reconnu coupable, la peine qui lui serait infligée relèverait du niveau 43 dans les lignes directrices fédérales en matière de peines, qui prévoient une échelle des peines de perpétuité. Elle a admis qu’il existait une « possibilité réelle » que l’intéressé soit condamné à perpétuité, l’un de ses co-conspirateurs ayant succombé à une surdose de fentanyl (paragraphe 15 ci-dessus). Cependant, si elle a relevé que le requérant encourrait vraisemblablement des peines confondues plutôt que consécutives, elle a estimé qu’il n’était pas possible de déterminer quelle peine lui serait imposée.
103. Pour les besoins de l’appréciation d’un « risque réel », qui est la première des deux étapes de l’analyse opérée par la Cour, les conclusions de la juge de district ne sont pas déterminantes, même si celle-ci n’a manifestement pas dit, contrairement à ce qu’affirme le requérant, que celui‑ci serait « vraisemblablement » condamné à la réclusion à perpétuité (paragraphe 71 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, il faut examiner les éléments qui ont été produits devant la Cour à ce sujet.
104. À cet égard, la Cour relève que le rapport émis en février 2015 par la Commission fédérale sur les peines, intitulé « Les peines de perpétuité dans le système fédéral » (paragraphe 63 ci-dessus), indique que des peines de réclusion à perpétuité ont été prononcées dans moins d’un tiers de 1 % de l’ensemble des affaires de trafic de stupéfiants en 2013. Par ailleurs, dans sa lettre du 23 novembre 2020 (paragraphe 64 ci-dessus), le ministère de la Justice des États-Unis se réfère aux sources interactives de la Commission fédérale sur les peines, selon lesquelles, en 2019, dans le district du nord de la Géorgie, où le requérant a été inculpé, environ 65 % des 507 peines prononcées étaient inférieures à celles recommandées selon l’échelle établie par les lignes directrices fédérales en matière de peines.
105. Selon le rapport de février 2015, les lignes directrices en matière de stupéfiants prévoient expressément une peine d’emprisonnement à vie pour les infractions de trafic de stupéfiants si la consommation de ceux-ci a entraîné la mort ou des blessures graves, et si l’accusé a déjà été reconnu coupable auparavant d’une infraction de ce type. Si l’un des co-conspirateurs du requérant a certes succombé à une surdose de fentanyl, les éléments de preuve dont dispose la Cour indiquent que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation antérieure (paragraphe 9 ci-dessus).
106. Une peine d’emprisonnement à perpétuité peut également être prononcée dans d’autres affaires de trafic impliquant de grandes quantités de stupéfiants, ou lorsque le tribunal applique d’autres dispositions prévoyant un alourdissement de peine en matière de trafic de stupéfiants (paragraphe 63 ci‑dessus). Les chefs d’accusation retenus contre le requérant sont incontestablement graves (paragraphe 8 ci-dessus), et le ministère de la Justice des États-Unis a indiqué que l’intéressé était soupçonné d’avoir codirigé une opération de trafic de stupéfiants basée au Mexique et supervisé les activités de distributeurs implantés aux États-Unis (paragraphe 7 ci‑dessus). Cependant, ce même ministère a fourni des renseignements sur quatre des co-conspirateurs du requérant, selon lesquels ils se sont vu infliger des peines allant de sept à vingt ans d’emprisonnement. Les deux personnes qui ont été condamnées aux peines les plus lourdes (V-P et H-H) avaient été inculpées des mêmes chefs d’importation de stupéfiants et de conspiration que ceux qui ont été retenus contre le requérant ; par ailleurs, elles ont été reconnues coupables de chefs supplémentaires qui ne pèsent pas sur le requérant, notamment celui de blanchiment d’argent. V-P et H-H encouraient chacun une peine recommandée de réclusion à perpétuité. Selon le ministère de la Justice des États-Unis, la peine qui serait infligée au requérant s’il plaidait coupable ou s’il était reconnu coupable lors du procès serait prononcée par le juge qui a condamné ses quatre co-conspirateurs. Ce juge serait tenu de prendre en considération les facteurs énumérés dans la section 3553(a) du titre 18 du code des États-Unis (paragraphe 57 ci‑dessus), notamment la nécessité d’éviter les disparités de peine injustifiées entre accusés ayant des antécédents similaires et ayant été reconnus coupables d’agissements similaires.
107. Dans l’affaire López Elorza, la Cour a estimé pertinent le fait que les co-conspirateurs du requérant avaient été condamnés à des peines d’une durée inférieure à celle prévue par les lignes directrices fédérales en matière de peines, d’autant que la peine qui serait infligée à l’intéressé serait prononcée par le juge qui avait déjà condamné les co-conspirateurs, lequel serait tenu de prendre en compte la nécessité d’éviter les disparités injustifiées (López Elorza, précité, §§ 115-116 ; voir également Findikoglu, décision précitée, § 38). Or, en l’espèce, le requérant estime que sa situation n’est pas comparable à celle de ses co-conspirateurs (voir, en comparaison, López Elorza, précité, § 116). Selon lui (paragraphe 72 ci-dessus), si les infractions commises par V-P et H-H et celles qui lui sont reprochées correspondent à des niveaux de base similaires, le chef d’accusation pour lequel ces derniers ont plaidé coupable ne renfermait aucune allégation selon laquelle leurs méfaits avaient entraîné la mort de qui que ce fût. De plus, contrairement au requérant, ni l’un ni l’autre n’aurait été soupçonné d’être l’un des codirigeants d’une organisation criminelle.
108. La Cour peut admettre que les co-conspirateurs du requérant ne se trouvaient peut-être pas dans une situation tout à fait comparable à celle de ce dernier, même si les infractions dont ils étaient accusés correspondaient à des niveaux de base similaires à celles qui lui sont reprochées. Les co‑conspirateurs ne semblent pas avoir été soupçonnés d’être à la tête d’une quelconque organisation criminelle et, ce qui est peut-être plus important encore, ils pouvaient prétendre à une réduction de peine parce qu’ils avaient plaidé coupable. Cela dit, dans la procédure conduite devant la Grande Chambre, le requérant n’a pas apporté la preuve que des accusés présentant des antécédents similaires aux siens auraient été reconnus coupables d’agissements similaires et condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En outre, si la Cour ne peut pas baser son appréciation sur la peine qui serait probablement infligée au requérant s’il plaidait coupable, elle reconnaît néanmoins que de nombreux facteurs interviennent dans le choix de la peine à imposer et qu’avant l’extradition, il est impossible d’envisager tous les retournements de situation ou tous les cas de figure qui pourraient survenir (López Elorza, précité, § 118). Comme la Cour l’a relevé dans la décision Findikoglu, des facteurs antérieurs au procès, tels que l’acceptation d’une coopération avec le gouvernement des États-Unis (Findikoglu, décision précitée, § 39) pourraient avoir une incidence sur la durée de la peine d’emprisonnement imposée au requérant. De plus, si ce dernier venait à plaider coupable ou à être reconnu coupable lors du procès, le juge disposerait d’une grande latitude pour fixer la peine appropriée à l’issue d’un processus d’établissement des faits dans le cadre duquel l’intéressé aura eu la possibilité de présenter des moyens de preuve sur toute circonstance atténuante susceptible de justifier une peine inférieure à celle recommandée selon l’échelle prévue par les lignes directrices en matière de peines. Le juge chargé de fixer la peine serait tenu de prendre en compte les peines infligées aux co‑conspirateurs, quand bien même leur situation ne serait pas identique à celle du requérant. Enfin, ce dernier aurait le droit de faire appel de toute peine qui lui serait infligée (paragraphe 64 ci-dessus).
109. Compte tenu de l’ensemble des facteurs susmentionnés, on ne saurait dire que le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer que son extradition vers les États-Unis l’exposerait à un risque réel de traitement atteignant le niveau de gravité de l’article 3. Dès lors, il n’est pas nécessaire pour la Cour d’en venir en l’espèce à la seconde étape de l’analyse (paragraphe 97 ci-dessus).
110. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y aurait pas violation de l’article 3 de la Convention si le requérant était extradé.
Grande Chambre Phillip Harkins c. Royaume-Uni du 15 juin 2017 requête 71357/14
Article 3 et article 6 : l'extradition vers les USA n'est pas dangereuse. Le requérant avait déjà saisi la CEDH au sens de l'article 3. il ne peut pas saisir à nouveau la CEDH pour les mêmes faits. Sous l'angle de l'article 6, la CEDH conclut par avance que le requérant ne sera pas soumis à un déni de justice flagrant.
Article 3
a) Principes généraux
41. En ce qu’il fait obstacle à l’examen par la Cour d’une requête qui serait essentiellement la même qu’une autre précédemment tranchée, le critère de recevabilité énoncé dans la première branche de l’article 35 § 2 b) de la Convention vise à garantir le caractère définitif des arrêts et décisions de la Cour et à empêcher les requérants, par l’introduction d’une nouvelle requête, de chercher à former un recours contre des décisions ou arrêts antérieurs de celle-ci (Lowe c. Royaume-Uni (déc.), no 12486/07, 8 septembre 2009, et Kafkaris c. Chypre (déc.), no 9644/09, § 67, 21 juin 2011).
42. En principe, une requête tombe sous le coup de la première branche de l’article 35 § 2 b) lorsque le même requérant a déjà introduit une requête portant essentiellement sur la même personne, les mêmes faits et les mêmes griefs (Vojnovic c. Croatie (déc.), no 4819/10, § 28, 26 juin 2012, Anthony Aquilina c. Malte, no 3851/12, § 34, 11 décembre 2014, et X. c. Slovénie (déc.), no 4473/14, § 40, 12 mai 2015). Un requérant ne peut alléguer qu’il présente des faits nouveaux lorsqu’il ne fait qu’étayer ses griefs précédents à l’aide de nouveaux arguments de droit (voir, par exemple, I.J.L. c. Royaume-Uni (déc.), no 39029/97, 6 juillet 1999, et Kafkaris, décision précitée, § 68). Pour que la Cour connaisse d’une requête portant sur les mêmes faits que ceux exposés dans une requête antérieure, il faut que le requérant présente véritablement un grief nouveau ou des faits nouveaux non examinés antérieurement par elle, et ce dans le respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (Lowe, décision précitée, et Kafkaris, décision précitée, § 68).
b) Application des principes généraux précités au cas d’espèce
43. La Cour estime, à l’inverse du requérant, que le grief qu’il soulève en l’espèce sur le terrain de l’article 3 est « essentiellement le même » que celui exposé dans sa requête antérieure introduite en 2007 (paragraphe 11 ci-dessus). L’intéressé allègue dans chacune de ces requêtes que son extradition vers les États-Unis d’Amérique serait contraire à l’article 3 de la Convention parce que, en cas de condamnation, il risquerait de se voir infliger une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et qu’une telle peine serait « nettement disproportionnée ». De plus, comme le Gouvernement l’indique (paragraphe 36 ci-dessus), les faits sur lesquels reposait la requête initiale n’ont pas connu d’évolution depuis que la Cour a rendu son arrêt définitif dans l’affaire Harkins et Edwards, le 17 janvier 2012. En effet, le requérant fait l’objet des mêmes chefs d’inculpation pour les mêmes infractions pénales, et les règles en matière de fixation des peines et de grâce en Floride sont les mêmes aujourd’hui qu’en 2012.
44. Or le requérant soutient qu’il n’y a pas lieu de rejeter la requête en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention en raison des « faits nouveaux » que constituent selon lui les arrêts de la Cour Vinter et autres [GC], Trabelsi et Murray, le réexamen de ses griefs au niveau interne à la lumière des deux premiers de ces arrêts, et les expertises supplémentaires analysant le régime de fixation des peines et de grâce en vigueur en Floride.
45. Pour autant que le requérant évoque la procédure récemment conduite par les juridictions internes, la Cour rappelle que, s’agissant de griefs nouveaux tirés d’un défaut d’exécution de ses arrêts par l’État, elle a reconnu que le réexamen d’une affaire par les autorités internes, que ce soit par la réouverture du procès ou par l’ouverture d’une toute nouvelle instance, pouvait dans certaines circonstances s’analyser en un « fait nouveau » susceptible de donner lieu à une violation nouvelle (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 65, CEDH 2009, Egmez c. Chypre (déc.), no 12214/07, §§ 48-56, 18 septembre 2012, et Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 34, CEDH 2015). Elle n’exclut donc pas la possibilité que, aux fins de la première branche de l’article 35 § 2 b) de la Convention, le nouvel examen d’un grief par les juridictions internes soit lui aussi qualifié de « fait nouveau », pourvu que la nouvelle procédure interne ne soit pas fondée sur des faits antérieurement examinés par la Cour (Kafkaris, décision précitée, §§ 68-69, dans laquelle la Cour a conclu que ni une nouvelle demande de grâce ou de libération conditionnelle auprès de l’Attorney-General ni le recours contentieux ultérieurement formé ne constituaient des « faits nouveaux », la nouvelle requête étant fondée sur un fait qui avait été précédemment analysé par la Grande Chambre lorsque celle-ci avait examiné la compatibilité avec l’article 3 de la Convention de la peine de perpétuité infligée au requérant).
46. En l’espèce, la nouvelle procédure interne était fondée sur les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Vinter et autres [GC] et Trabelsi, tous deux faisant suite à l’arrêt Harkins et Edwards. Dès lors, si les faits de l’espèce étaient certes les mêmes, on ne peut pas dire que les arguments avancés par le requérant au cours de la nouvelle procédure interne eussent été antérieurement examinés par la Cour. Toujours est-il que la seule question sur laquelle la High Court devait se prononcer était celle de savoir si les arrêts Vinter et autres [GC] et Trabelsi avaient fait évoluer la jurisprudence au point d’autoriser exceptionnellement cette juridiction, sur la base des règles internes, à revenir sur sa décision définitive (paragraphe 26 ci-dessus). Ayant répondu par la négative, la High Court a refusé de rouvrir l’instance. En cela, la question de savoir si la récente procédure menée au niveau interne constitue un « fait nouveau » est intimement liée à celle de savoir si l’évolution que les arrêts Vinter et autres [GC], Trabelsi et Murray ont fait subir à la jurisprudence de la Cour s’analyse en un « fait nouveau ».
47. De même, le requérant soutenant pour l’essentiel que le régime de fixation des peines et la procédure de grâce en Floride ne sont pas conformes aux exigences découlant de l’arrêt Vinter et autres [GC] et de la jurisprudence ultérieure de la Cour, les nouvelles expertises invoquées par lui ne sont rien de plus que des « arguments juridiques nouveaux » fondés sur ces arrêts (Kafkaris, décision précitée, § 68).
48. Dès lors, la véritable question que la Cour est appelée à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’évolution de sa jurisprudence à la suite de son arrêt Harkins et Edwards s’analyse en elle-même en un « fait nouveau » pour les besoins de la première branche de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
49. À cet égard, la Cour a déjà souligné que, en tant que traité international, la Convention doit être interprétée à la lumière des règles d’interprétation énoncées aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (pour un exemple récent, voir Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 118, CEDH 2016). La Convention de Vienne lui impose de rechercher le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la disposition dont ils sont tirés (ibidem, § 119, et article 31 § 1 de la Convention de Vienne, cité au paragraphe 30 ci-dessus). Il faut aussi tenir compte de ce que la Convention, instrument de protection effective des droits de l’homme, doit être interprétée et appliquée d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires (ibidem, §§ 120-121).
50. À ce jour, la Cour n’a pas donné d’indication précise sur le sens de la notion de « faits nouveaux ». Cela dit, si le texte anglais de l’article 35 § 2 b) emploie l’expression « relevant new information », le texte français utilise les termes « faits nouveaux » ; or cette disparité ne peut être surmontée que si l’expression anglaise s’entend, en son sens ordinaire, comme désignant des éléments de fait nouveaux (relevant new factual information) (comparer avec X. c. Royaume-Uni (déc.), no 8206/78, 10 juillet 1981). Pareille interprétation serait compatible avec le raisonnement suivi par la Cour lorsqu’elle décide si une requête doit être rejetée au titre de la première branche de l’article 35 § 2 b). Si, dans sa décision X. c. République fédérale d’Allemagne ((déc.), no 4256/69, 14 décembre 1970), la Commission a reconnu que, dans cette affaire concernant une « situation continue », un changement dans la qualification juridique d’un grief né de l’entrée en vigueur du Protocole no 4 à l’égard de l’État défendeur constituerait un « fait nouveau », dans leur jurisprudence postérieure, les organes de la Convention se sont plutôt attachés à la question de l’existence de faits nouveaux (voir, par exemple, Vojnovic, décision précitée, §§ 28-30, Anthony Aquilina, précité, §§ 34-37, et X c. Slovénie, décision précitée, §§ 40-42) et ils ont rejeté les allégations cherchant à étayer des griefs antérieurs à l’aide d’arguments juridiques nouveaux (voir, par exemple, les décisions précitées I.J.L. c. Royaume-Uni, et Kafkaris, § 68).
51. La Cour doit donc se pencher sur l’objet et le but du critère de recevabilité énoncé dans la première branche de l’article 35 § 2 b). Ainsi qu’il a déjà été noté au paragraphe 41 ci-dessus, ce critère vise principalement à protéger le caractère définitif des décisions de justice et la sécurité juridique en empêchant les requérants, par l’introduction d’une nouvelle requête, de contester des décisions ou arrêts antérieurs de la Cour (Kafkaris, décision précitée, § 67).
52. Par ailleurs, outre qu’il sert les deux buts précités, l’article 35 § 2 b) fixe aussi les limites de la compétence de la Cour. S’agissant des requêtes déjà soumises à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, la Cour a maintes fois dit que cette disposition excluait sa compétence à l’égard de toute requête entrant dans son champ d’application (voir, par exemple, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, no 14902/04, § 520, 20 septembre 2011, POA et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 59253/11, § 27, 21 mai 2013, et Hilal Mammadov c. Azerbaïdjan, no 81553/12, §§ 103 et 105, 4 février 2016). Bien que, dans sa jurisprudence, elle n’ait pas expressément fait mention de sa juridiction ou de sa compétence relativement aux requêtes qui sont essentiellement les mêmes que des requêtes précédemment tranchées, elle ne voit aucune raison logique de traiter différemment les deux situations visées à l’article 35 § 2 b). Si sa compétence est exclue à l’égard de toute requête relevant de la seconde branche de l’article 35 § 2 b), il doit en aller de même d’une requête tombant sous le coup de la première branche de cette disposition.
53. La Cour a dit que certaines règles de recevabilité devaient s’appliquer avec souplesse et sans formalisme excessif, eu égard à leur objet et à leur but, de même qu’à ceux de la Convention en général qui, en tant qu’elle constitue un traité de garantie collective des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être interprétée et appliquée d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 51, CEDH 2000‑VII, concernant la compatibilité ratione personae, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 69, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, concernant l’épuisement des voies de recours internes).
54. Toutefois, la Cour a fait preuve de davantage de rigueur dans l’application des critères de recevabilité qui ont pour objet et pour but de garantir la sécurité juridique et de marquer les limites de sa compétence (voir, par exemple, Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, §§ 39-42, 29 juin 2012, et Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I, affaires qui concernaient toutes deux l’application du délai de six mois). Les limitations de la compétence de la Cour offrent une stabilité juridique en ce qu’elles indiquent au justiciable et aux autorités de l’État quand son contrôle peut ou non être exercé (voir, par exemple, Sabri Güneş, précité, § 42, et Walker, décision précitée), tandis que le principe de la sécurité juridique constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, qui veut notamment que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit pas remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). Faute de cela, les parties ne jouiraient pas de la certitude ou de la stabilité qu’offre le fait de savoir qu’un litige a été définitivement tranché par la Cour. C’est précisément pour cette raison que l’article 80 du règlement de la Cour restreint les cas dans lesquels une partie peut demander la révision d’un arrêt définitif à la découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu de cette partie.
55. L’objet et le but de l’article 35 § 2 b) étant de garantir la sécurité juridique et de fixer les limites de sa compétence (paragraphes 51 et 52 ci‑dessus), la Cour ne peut élargir la portée de la notion de « faits nouveaux » au-delà de son sens ordinaire tel qu’il ressort tant du texte anglais que du texte français de la Convention et qu’il a été appliqué jusqu’à présent dans sa jurisprudence (paragraphe 50 ci-dessus).
56. Compte tenu du sens ordinaire de cette expression ainsi défini, force est pour la Cour de conclure qu’un développement dans sa jurisprudence ne constitue pas un « fait nouveau » aux fins de l’article 35 § 2 b) de la Convention. La jurisprudence de la Cour évolue constamment, et si de tels développements jurisprudentiels devaient permettre à des requérants déboutés de présenter de nouveau leurs griefs, les arrêts définitifs seraient sans cesse remis en cause par l’introduction de nouvelles requêtes. Les critères stricts énoncés à l’article 80 du règlement pour autoriser la révision des arrêts de la Cour s’en trouveraient fragilisés (paragraphe 54 ci-dessus), de même que la crédibilité et l’autorité de ces textes. De surcroît, le principe de la sécurité juridique ne s’appliquerait pas également à chacune des parties, car seul le requérant, sur la base de développements jurisprudentiels ultérieurs, serait concrètement autorisé à « rouvrir » des affaires précédemment examinées, pourvu qu’il soit en mesure d’introduire une nouvelle requête dans le délai de six mois.
57. Dès lors, les deux griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 3 – à savoir que son extradition vers les États-Unis, où il serait passible d’une peine de perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle, serait incompatible avec les exigences formulées par la Cour, et qu’une telle peine serait « nettement disproportionnée » – sont essentiellement les mêmes que ceux précédemment examinés par la Cour dans son arrêt Harkins et Edwards du 17 juin 2012. La jurisprudence ultérieure de la Cour ne saurait être qualifiée de « fait nouveau » aux fins de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Aussi y a-t-il lieu, en application de l’article 35 § 4 de la Convention, de rejeter pour irrecevabilité les griefs fondés sur l’article 3.
ARTICLE 6
61. Pour autant qu’il puisse être déduit de l’invocation par le Gouvernement des principes de la sécurité juridique et du caractère définitif des décisions de justice que celui-ci plaide pour que le grief soulevé par le requérant sur le terrain de l’article 6 soit lui aussi rejeté en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire de trancher ce point étant donné que, pour les raisons exposées aux paragraphes 62 à 68 ci-dessous, elle juge ce grief manifestement mal fondé.
62. À cet égard, la Cour rappelle que, tel que le consacre l’article 6 de la Convention, le droit à un procès équitable en matière pénale occupe une place éminente dans une société démocratique. Elle n’exclut donc pas qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever une question sur le terrain de cet article au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant dans le pays de destination (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 113, série A no 161). Cependant, dans la jurisprudence de la Cour, l’expression « déni de justice flagrant » est synonyme de procès manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes y consacrés (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 84, CEDH 2006-II).
63. Si jusqu’à présent elle n’a pas été appelée à définir plus précisément cette expression, la Cour n’en a pas moins indiqué que certaines formes de manque d’équité pouvaient s’analyser en un « déni de justice flagrant », notamment : une condamnation in absentia sans possibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation (Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI, Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 56, 24 mars 2005, et Sejdovic, précité, § 84) ; un procès à caractère sommaire conduit au mépris total des droits de la défense (Bader et Kanbor c. Suède, no 13284/04, § 47, CEDH 2005-XI) ; une détention sans le moindre accès à un tribunal indépendant et impartial pour en faire examiner la légalité (Al-Moayad c. Allemagne (déc.), no 35865/03, § 101, 20 février 2007) ; un refus délibéré et systématique d’accès à un avocat, surtout s’agissant d’une personne détenue dans un pays étranger (ibidem) ; et l’utilisation dans un procès pénal de déclarations recueillies en torturant l’accusé ou un tiers en violation de l’article 3 (Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 267, CEDH 2012 (extraits), et El Haski c. Belgique, no 649/08, § 85, 25 septembre 2012).
64. Par conséquent, le « déni de justice flagrant » est un critère strict de manque d’équité qui va au-delà de simples irrégularités ou défauts de garanties pendant le déroulement du procès qui seraient de nature à emporter violation de l’article 6 s’ils survenaient dans l’État contractant lui‑même. Pour qu’il y ait un tel déni, il faut qu’il y ait une violation du principe d’équité du procès garanti par l’article 6 suffisamment grave pour entraîner l’annulation, voire la destruction de l’essence même du droit protégé par cet article (Othman (Abu Qatada), précité, § 260). À ce jour, la Cour n’a jamais jugé établi qu’une extradition serait contraire à l’article 6 (par opposition à une expulsion comme dans l’affaire Othman (Abu Qatada) (arrêt précité, § 285), et à des remises de prisonniers comme dans les affaires Al Nashiri c. Pologne (no 28761/11, § 568, 24 juillet 2014) et Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne (no 7511/13, § 560, 24 juillet 2014)).
65. La Cour juge que, pour déterminer si ce critère strict de manque d’équité a été rempli, il y a lieu d’appliquer le même niveau de preuve et la même répartition de la charge de la preuve que lorsqu’elle examine les affaires d’expulsion au regard de l’article 3. C’est donc au requérant qu’il incombe de produire des éléments de preuve aptes à prouver qu’il existe des motifs sérieux de croire que, s’il était expulsé de l’État contractant, il serait exposé à un risque réel de faire l’objet d’un déni de justice flagrant. S’il y parvient, il appartient ensuite au Gouvernement de dissiper tout doute à ce sujet (Othman (Abu Qatada), précité, § 261).
66. En l’espèce, le requérant se contente de dénoncer le caractère obligatoire de la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Or, comme la High Court l’a relevé, une telle peine serait prononcée à l’issue d’un procès dont le requérant ne plaide pas qu’il serait en lui-même inéquitable (paragraphe 27 ci-dessus). En particulier, compte tenu de la jurisprudence analysée au paragraphe 63 ci‑dessus, la Cour constate que rien ne permet de dire que la juridiction de jugement ne serait pas « indépendante et impartiale », que le requérant serait privé de représentation en justice, que les droits de la défense seraient bafoués, qu’il y aurait utilisation de déclarations recueillies sous la torture ou que le requérant risquerait pour d’autres raisons d’être victime d’une atteinte grave aux principes garantissant l’équité du procès.
67. La Cour conclut de ce qui précède qu’il ne ressort aucunement des faits de l’espèce que le requérant risquerait d’être victime aux États-Unis d’un « déni de justice flagrant » aux fins de l’article 6 de la Convention.
68. Le grief tiré par le requérant d’une violation de l’article 6 doit donc être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
Nasr et Ghali c. Italie du 23 février 2016 requête no 44883/09
Violation de l'article 3 : L’enlèvement et le transfèrement extrajudiciaire par la CIA de l’imam Abou Omar vers l’Égypte a porté atteinte aux droits protégés par la Convention.
Babar Ahmad et autres C. Royaume Uni du 10 avril 2012
requête n°24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09
Les États Unis ne sont pas un Etat dangereux
Les conditions de détention et la durée des peines susceptibles d’être infligées à cinq terroristes présumés s’ils étaient extradés vers les Etats-Unis ne constitueraient pas des mauvais traitements
Conditions de détention
Après avoir examiné en détail tous les éléments de preuve émanant des parties, dont des déclarations spécifiquement préparées par les responsables de la prison de Florence ainsi que des lettres fournies par le ministère américain de la Justice, la Cour a jugé que les conditions de détention dans cet établissement ne seraient pas constitutives de mauvais traitements.
En particulier, les détenus condamnés pour terrorisme international ne sont pas tous incarcérés dans cette prison. Pour ceux qui le sont, des garanties procédurales suffisantes sont prévues, comme la tenue d’une audience avant de décider du transfert dans cette prison. En outre, lorsque le transfert n’est pas jugé satisfaisant, il est possible de faire une réclamation auprès du Bureau fédéral des prisons au titre du programme de redressement administratif et auprès des tribunaux fédéraux américains.
Pour ce qui est des restrictions en vigueur dans cet établissement et de l’absence de contacts humains qui y règne, la Cour estime que, si les requérants étaient déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés, les autorités américaines auraient de bonnes raisons de considérer qu’ils constituent un risque important pour la sécurité et d’imposer des limitations strictes à leur capacité de communiquer avec le monde extérieur. Par ailleurs, les détenus incarcérés à la prison de Florence, tout en était confinés dans leur cellule la majeure partie du temps, bénéficient de services et d’activités (télévision, radio, journaux, livres, loisirs et activités manuelles, appels téléphoniques, visites, correspondance avec les familles, prières de groupe) bien plus variés que ce qui se fait dans la plupart des prisons d’Europe. De plus, selon ce qu’indique le ministère américain de la Justice dans l’une de ses lettres, sur les 252 détenus de la prison, 89 bénéficieraient du « programme d’allègement progressif ». Si les requérants étaient condamnés et transférés à la prison de Florence, ils auraient ainsi une véritable possibilité d’entrer progressivement en contact avec d’autres personnes jusqu’à ce qu’ils soient aptes à un transfert dans un établissement normal. Enfin, concernant les problèmes de santé mentale invoqués, la Cour note que cela n’a pas empêché MM. Ahmad, Ahsan et Bary d’être détenus dans des prisons de haute sécurité au Royaume-Uni et que, en tout état de cause, il y aurait des services psychiatriques pour les traiter à la prison de Florence.
Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y aurait pas de violation de l’article 3 si MM. Ahmad, Ahsan, Bary et Al-Fawwaz devaient être détenus à la prison de sécurité maximale de Florence.
La Cour rejette par ailleurs la demande d’Abu Hamza visant au réexamen de la décision déclarant irrecevable son grief concernant la prison de Florence. Elle observe que les autorités américaines jugeraient impossible de détenir Abu Hamza à la prison de Florence en raison de son handicap (en particulier son amputation des avant-bras).
Durée des peines
M. Bary encourt 269 peines obligatoires d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que MM. Ahmad, Ahsan, Abu Hamza et Al-Fawwaz encourent des peines perpétuelles à durée discrétionnaire.
Eu égard à la gravité des infractions en cause, la Cour ne considère pas que ces peines soient totalement disproportionnées ou s’analysent en des traitements inhumains ou dégradants. Il n’y aurait donc violation de l’article 3 pour aucun des cinq requérants s’ils étaient extradés, reconnus coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement à vie.
Procédure ultérieure concernant la requête Aswat c. Royaume-Uni (no 17299/12)
La Cour décide d’ajourner l’examen des griefs de M. Aswat, qu’elle étudiera au titre de la nouvelle requête no 17299/12. Elle invite les parties à soumettre des observations écrites complémentaires sur les trois questions ci-dessous :
1. Le transfert de M. Aswat de la prison de Long Lartin à l’hôpital de Broadmoor en raison de son état de santé mentale constitue-t-il un élément pertinent et, si oui, dans quelle mesure ?
2. Des informations sur l’état de santé mentale de M. Aswat seraient-elles transmises aux autorités américaines avant qu’il ne leur soit livré ?
3. Après sa remise aux autorités américaines, quelles mesures celles-ci prendraient-elles pour déterminer si M. Aswat est apte à comparaître devant un tribunal et pour assurer que, en cas de condamnation, son état mental serait bien pris en compte dans le choix de son lieu d’incarcération ?
Le Gouvernement britannique a été prié de soumettre ses observations sur ces questions d’ici au 9 mai 2012. Le requérant aura alors quatre semaines pour y répondre, après quoi le Gouvernement sera invité à présenter ses observations finales en réponse dans un délai de deux semaines. La Cour rendra alors son arrêt dans l’affaire de M. Aswat le plus rapidement possible.
Arrêt Aswat C. Royaume Uni du 16 avril 2013, requête 17299/12
Un homme souffrant de graves problèmes mentaux ne devrait pas être extradé vers les Etats-Unis pour terrorisme
Au vu des pièces médicales produites devant elle, la Cour estime qu’il y a un risque réel que l’extradition de M. Aswat vers les Etats-Unis, un pays où il n’a aucune attache et où il connaîtrait un environnement carcéral différent et peut-être plus hostile, aggraverait significativement son état de santé physique et mental. Pareille aggravation serait susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3.
Alors que, dans l’affaire Babar Ahmad, la Cour avait estimé que les conditions dans la prison de Florence ne s’analyseraient pas en un traitement contraire à l’article 3, le cas de M. Aswat n’est pas comparable en raison de la gravité de son état mental.
La Cour a dûment pris en considération les observations que le département de la Justice des Etats-Unis a produites devant elle. Elle constate notamment que l’on ne peut déterminer avec certitude dans quel(s) centre(s) de détention M. Aswat serait placé, que ce soit avant ou après son procès, s’il venait à être extradé vers les Etats-Unis, ni combien de temps il serait censé rester en détention provisoire. Quant à sa détention consécutive à une condamnation éventuelle, la Cour concède que M. Aswat aurait accès aux services de soins psychologiques quel que soit l’établissement où il serait incarcéré, mais elle estime que son extradition vers un pays où il n’a aucune attache et où son avenir serait incertain dans une prison encore inconnue, et où il serait peut-être soumis au régime particulièrement restrictif de la prison de Florence, serait contraire à l’article 3 de la Convention.
Si la Cour a conclu que l’extradition de M. Aswat vers les Etats-Unis l’exposerait à un risque réel de traitement contraire à l’article 3, c’est sur la base de tous les éléments ci-dessus et non à raison de la durée de sa détention éventuelle dans ce pays.
TRABELSI C. BELGIQUE du 4 septembre 2014 Requête n° 140/10
VIOLATION DE L'ARTICLE 3 : L'extradition vers les USA est une violation de la convention car le requérant est exposé à une peine de détention à vie sans révision possible.
110. La violation alléguée consisterait à avoir exposé le requérant, par son extradition aux États-Unis, au risque d’être condamné à une peine à perpétuité incompressible et sans possibilité de libération conditionnelle contrairement aux exigences de l’article 3 de la Convention.
111. La Cour abordera le problème qui lui est posé en commençant par des considérations générales sur l’état de sa jurisprudence relative à l’article 3, d’une part en ce qui concerne les peines perpétuelles, d’autre part en ce qui concerne l’éloignement des étrangers. Puis, elle procédera à la question de l’application des principes concernant les peines perpétuelles dans la situation du requérant, objet d’une extradition.
a) Principes applicables à la réclusion à perpétuité
112. Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que ni l’article 3 de la Convention ni aucune autre disposition de la Convention ne prohibe en soi le prononcé d’une peine d’emprisonnement perpétuel à l’encontre d’un délinquant adulte (Kafkaris, précité, § 97, et références citées) sous réserve qu’elle ne soit jamais nettement disproportionnée (Vinter et autres, précité, §§ 88 et 89). La Cour a toutefois estimé qu’infliger à une personne une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 (Kafkaris, précité, § 97).
113. De ce dernier principe découlent deux autres. Premièrement, l’article 3 ne s’oppose pas à ce qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité. Ce qu’interdit l’article 3, c’est que la peine perpétuelle soit de jure et de facto incompressible. Deuxièmement, pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la Cour recherche si l’on peut dire qu’un détenu condamné à perpétuité a des chances d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre ou d’y mettre fin, ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait à l’article 3 (Kafkaris, précité, § 98, et références citées).
114. Jusque récemment, la Cour estimait que la seule éventualité d’un aménagement de la peine perpétuelle suffisait pour satisfaire aux exigences de l’article 3. Elle jugea ainsi que la possibilité d’une libération anticipée même relevant exclusivement du pouvoir discrétionnaire du chef d’État (Kafkaris, précité, § 103) ou l’espoir d’une grâce accordée par le chef d’État pouvant prendre la forme soit du pardon soit de la commutation de la peine (Iorgov c. Bulgarie (no 2), no 36295/02, §§ 51 à 60, 2 septembre 2010) suffisaient à caractériser une telle possibilité.
115. À l’occasion de l’affaire Vinter et autres et autres, précitée, la Cour réexamina le point de savoir comment déterminer si, dans un cas donné, une peine perpétuelle pouvait passer pour compressible. Elle envisagea cette question à la lumière des objectifs de prévention et de réinsertion de la peine (§§ 112 à 118). Se référant à un principe déjà énoncé dans l’arrêt Kafkaris, la Cour souligna que, pour passer comme étant compressible, une peine perpétuelle devait être soumise à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu avait tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permettait plus de justifier son maintien en détention (§ 119). La Cour précisa, en outre et pour la première fois, qu’un détenu condamné à la perpétuelle réelle avait le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il devait faire pour que sa libération soit envisagée et quelles étaient les conditions applicables. Il avait le droit de connaître le moment où le réexamen de sa peine aurait lieu ou pourrait être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoyait aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article 3 de la Convention en résultant prenait naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention (§ 122).
b) Principes applicables à l’éloignement des étrangers
116. Il est de jurisprudence constante que la protection contre les traitements prohibés par l’article 3 est absolue et qu’il en résulte que l’éloignement d’une personne du territoire par un État contractant peut soulever un problème au regard de cette disposition, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161). La circonstance que les mauvais traitements seraient le fait d’un État tiers à la Convention n’entre pas en considération (Saadi, précité, § 138). Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays, fût-ce un État tiers. La Cour ne fait pas de distinction selon la base légale de l’éloignement ; qu’il s’agisse d’une expulsion ou d’une extradition, la Cour adopte le même raisonnement (Harkins et Edwards, précité, § 120, et Babar Ahmad et autres, précité, § 168).
117. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle est pleinement consciente des difficultés que les États rencontrent pour protéger leur population contre la violence terroriste, laquelle constitue en elle-même une grave menace pour les droits de l’homme. Elle se garde donc de sous-estimer l’ampleur du danger que représente le terrorisme et la menace qu’il fait peser sur la collectivité (Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 183, CEDH 2012 (extraits), et références citées). Elle considère qu’il est légitime, devant une telle menace, que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme (idem). Enfin, la Cour ne perd pas de vue les fondements de l’extradition qui sont d’empêcher les délinquants en fuite de se soustraire à la justice ni l’objectif bénéfique qu’elle poursuit pour tous les États dans un contexte d’externalisation de la criminalité (Soering, précité, § 89).
118. Aucun de ces éléments ne saurait toutefois remettre en cause le caractère absolu de l’article 3. Comme la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, cette règle ne souffre aucune exception. Il y a donc lieu de réaffirmer le principe maintes fois exprimé depuis l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni (15 novembre 1996, §§ 80 et 81, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) selon lequel il n’est pas possible de prendre en compte les agissements de la personne considérée, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ni de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’éloignement afin de déterminer si la responsabilité de l’État est engagée sur le terrain de l’article 3 (Saadi, précité, § 138 ; voir également Daoudi c. France, no 19576/08, § 64, 3 décembre 2009, et M. S. c. Belgique, no 50012/08, §§ 126 et 127, 31 janvier 2012).
119. Pour établir une telle responsabilité, la Cour ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3. Il ne s’agit pas pour autant de faire de la Convention un instrument régissant les actes d’un État tiers ni de prétendre exiger des États contractants qu’elles imposent des normes à pareil État (Soering, précité, § 86, et Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 141, CEDH 2011). Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés (Soering, précité, § 91, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005‑I, et Saadi, précité, § 126).
120. Si l’extradition risque d’avoir des conséquences dans le pays de destination qui seraient incompatibles avec l’article 3 de la Convention, l’État contractant ne peut pas extrader ; il y va de l’effectivité de la garantie assurée par cette disposition, vu la gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée (voir Soering, précitée, § 90).
c) Application des principes en l’espèce
121. La Cour note que le requérant a été extradé aux États-Unis où il est poursuivi du chef d’infractions liées à des actes de terrorisme inspirés par Al Qaeda et que, s’il est reconnu coupable et condamné du chef de certaines de ces infractions, il est passible au maximum d’une peine d’emprisonnement à vie discrétionnaire. Il s’agit d’une peine discrétionnaire dans le sens où le juge pourra fixer une peine moins sévère et décider de prononcer une peine fixée en nombre d’années.
122. La question posée à la Cour est celle de savoir si, eu égard au risque encouru, l’extradition du requérant a heurté l’article 3 de la Convention. La Cour a déjà été confrontée à plusieurs reprises à la question posée par le risque d’une condamnation à la peine à perpétuité. Dans chaque affaire, elle a cherché à déterminer, en tenant compte des assurances diplomatiques données par le pays de destination, si l’extradition des intéressés les exposait effectivement à un tel risque et, dans l’affirmative, si la peine à perpétuité pouvait faire l’objet d’un aménagement leur offrant un espoir d’être libérés (voir, entre autres, Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001-VII, Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001-XI, Salem c. Portugal (déc.), no 26844/04, 9 mai 2006, Olaechea Cahuas c. Espagne, no 24668/03, CEDH 2006-X, et Schuchter c. Italie, (déc.), no 68476/10, 11 octobre 2011).
123. Ladite problématique s’est, à nouveau, présentée dans les affaires Harkins et Edwards et Babar Ahmad et autres, précitées. Dans ces affaires, la majorité des requérants étaient menacés d’extradition du Royaume-Uni vers les États-Unis où ils étaient poursuivis du chef d’infractions liées à des actes de terrorisme inspirés par Al Qaeda et, en cas de condamnation, passibles d’une peine perpétuelle obligatoire ou discrétionnaire.
124. S’inspirant de sa jurisprudence sur la réclusion à perpétuité dans l’ordre interne telle qu’énoncée dans son arrêt Kafkaris (voir paragraphes 112 à 114, ci-dessus), la Cour considéra que, sous réserve du caractère totalement disproportionné de la peine, la perpétuité discrétionnaire sans possibilité de libération conditionnelle ne posait problème au titre de l’article 3 que s’il pouvait être démontré que le maintien de l’intéressé en détention ne pouvait plus être justifié par aucun motif légitime d’ordre pénologique et que la peine était incompressible de facto et de jure (Harkins et Edwards, précité, § 135, et Babar Ahmad et autres, précité, §§ 241 et 242).
125. La Cour estima ensuite que les requérants, n’ayant pas été condamnés et n’ayant a fortiori pas davantage commencé à purger la peine qui pourrait résulter de leur condamnation, n’avaient pas démontré qu’en cas d’extradition, leur incarcération aux États-Unis ne poursuivrait aucun motif légitime d’ordre pénologique. Elle jugea encore moins démontré que, si ce point était jamais atteint, les autorités des États-Unis refuseraient de faire usage des mécanismes légaux disponibles pour réduire leurs peines (Harkins et Edwards, précité, §§ 140 et 142, et Babar Ahmad et autres, précité, §§ 130, 131 et 243). La Cour conclut que le risque de subir des peines perpétuelles ne faisait pas obstacle à l’extradition des requérants.
126. En l’espèce, la Cour note que le requérant se trouvait, avant son extradition, dans une situation fort comparable à celle des requérants dans l’affaire Babar Ahmad et autres.
127. A l’instar de l’approche suivie dans cette affaire, la Cour considère qu’étant donné la gravité des infractions terroristes reprochées au requérant et la circonstance que la peine ne serait éventuellement imposée qu’après que le juge ait pris en considération tous les facteurs atténuants et aggravants, la peine perpétuelle discrétionnaire, éventuellement imposée, ne serait pas totalement disproportionnée (Babar Ahmad et autres, précité, § 243).
128. Le Gouvernement défendeur soutient en substance que, pour déterminer la conformité de cette peine avec l’article 3 de la Convention dans un contexte d’extradition, le « test » que la Cour a appliqué dans les affaires Harkins et Edwards et Babar Ahmad et autres doit s’appliquer et qu’il ne se justifie pas en l’espèce que ce « test » soit écarté sur la base de la jurisprudence plus récente résultant de l’arrêt Vinter et autres.
129. Selon le Gouvernement, il faut tenir compte du fait que le requérant a été extradé aux seules fins de poursuites, qu’il n’a pas encore été condamné et qu’il n’est donc pas possible de déterminer avant la condamnation si le point à partir duquel sa détention ne poursuivrait plus un motif pénologique se poserait jamais, ni de spéculer sur la façon dont, à ce moment-là, les autorités des États-Unis appliqueraient les mécanismes existants. La circonstance que, dans l’arrêt Vinter et autres (§ 122), la Cour a estimé que, pour déterminer la conformité avec l’article 3 de la Convention, il fallait se placer à la date d’imposition de la peine perpétuelle, serait sans conséquence en l’espèce puisque le requérant n’a pas encore été condamné.
130. La Cour estime qu’elle ne peut pas suivre ce raisonnement. Il a pour effet de contourner la fonction préventive de l’article 3 de la Convention en matière d’éloignement des étrangers qui est d’éviter que les intéressés soient effectivement victimes d’une peine ou d’un traitement ayant atteint le seuil de gravité interdit par cette disposition. La Cour rappelle que l’article 3 oblige les États contractants d’empêcher la perpétration d’un tel traitement ou l’application d’une telle peine (voir paragraphe 120, ci-dessus). Aussi, et comme elle le fait dans les affaires d’extradition depuis l’affaire Soering, la Cour estime qu’elle doit évaluer le risque que le requérant encourt au regard de l’article 3 ex ante – c’est-à-dire, en l’occurrence, avant son éventuelle condamnation aux États-Unis – et non ex post facto comme le suggère le Gouvernement.
131. La tâche de la Cour consiste à s’assurer que l’extradition du requérant était compatible avec l’article 3 et, à ce titre, à examiner si la peine perpétuelle discrétionnaire à laquelle le requérant risque d’être condamné remplit les critères qu’elle a posés dans sa jurisprudence en la matière (voir paragraphes 112 à 115, ci-dessus).
132. Sur ce terrain, le Gouvernement affirme que le système américain correspond tant aux exigences posées par la Cour dans l’arrêt Kafkaris qu’aux nouveaux critères posés par la Cour dans l’arrêt Vinter et autres. Il fait valoir que la peine à perpétuité qu’encourt le requérant est compressible de jure du fait que ce dernier aura la possibilité, en vertu de la Constitution des États-Unis, de demander la grâce présidentielle ou la commutation de sa peine. Il pourra en faire la demande à tout moment dès que la condamnation est définitive et autant de fois qu’il le souhaite. Sa demande sera examinée par le Pardon Attorney lequel donnera un avis, non contraignant, au Président. Les motifs pour lesquels le requérant pourra obtenir la grâce sont, de l’avis du Gouvernement, suffisamment larges et, en tous cas, plus larges que ceux prévalant au Royaume-Uni et examinés dans l’arrêt Vinter et autres. La peine perpétuelle discrétionnaire est également compressible de facto. Le Gouvernement s’appuie sur les assurances diplomatiques et les données chiffrées fournies par les autorités américaines qui attestent que les présidents américains ont tous fait usage de leur pouvoir de grâce ou de commutation et qu’ils en ont déjà fait bénéficier des personnes condamnées à la perpétuité ou pour des infractions concernant la sécurité nationale.
133. Le requérant soutient, quant à lui, que son seul « espoir d’être libéré » repose sur les chances de succès, de facto inexistantes dans le contexte post-attentats du 11 septembre 2001, d’une demande de grâce présidentielle ou de commutation de peine. Cette possibilité, laissée à l’entière discrétion de l’exécutif, n’a rien d’une garantie et ne repose sur aucun critère prédéfini. Dans ces conditions, la peine perpétuelle discrétionnaire à laquelle il pourrait être condamné ne peut être considérée comme compressible de jure et de facto au sens donné par la Cour dans l’arrêt Vinter et autres.
134. La Cour comprend des dispositions de la législation américaine auxquelles fait référence la note diplomatique du 10 août 2010 fournie par les autorités américaines qu’elles ne prévoient pas de possibilité de libération conditionnelle en cas de condamnation à la peine perpétuelle, qu’elle soit obligatoire ou discrétionnaire, mais qu’il existe plusieurs possibilités de réduction d’une telle peine. Une réduction peut intervenir sur la base de la coopération substantielle du détenu à l’enquête dans son affaire ou aux poursuites d’un ou des tiers. Elle peut résulter de l’existence de raisons humanitaires impérieuses. En outre, un détenu peut demander la commutation de sa peine ou la grâce présidentielle sur base de la Constitution des États-Unis (voir paragraphes 27 et 79 à 83, ci-dessus).
135. La Cour constate ensuite que, malgré l’exigence expresse formulée le 10 juin 2010 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles dans son avis relatif à l’extradition du requérant (voir paragraphe 26, ci-dessus), les autorités américaines n’ont, à aucun moment, fourni l’assurance que le requérant échapperait à la peine à perpétuité ou qu’en cas d’imposition d’une telle peine, elle serait assortie d’une réduction ou commutation de peine (voir, a contrario, Olaechea Cahuas, précité, § 43, et Rushing c. Pays-Bas (déc.), no 3325/10, § 26, 27 novembre 2012). La Cour n’a donc pas à vérifier, en l’espèce, si les assurances fournies par les autorités du pays de destination sont suffisantes, du point de vue de leur contenu, pour garantir que le requérant est protégé contre le risque d’une peine incompatible avec l’article 3 de la Convention. Elle considère que les explications des autorités américaines relatives à la fixation des peines et leurs références aux dispositions applicables de la législation américaine prévoyant la réduction de peine ou la grâce présidentielle sont en tout cas très générales et vagues et ne sauraient être considérées comme atteignant la précision voulue (voir Othman (Abu Qatada), précité, § 189).
136. La Cour en vient à présent à la question centrale en l’espèce qui consiste à déterminer si, indépendamment des assurances données, les dispositions de la législation américaine prévoyant des possibilités de réduction d’une peine perpétuelle et de grâce présidentielle satisfont aux critères qu’elle a posés pour évaluer la compressibilité d’une peine perpétuelle et sa conformité avec l’article 3 de la Convention.
137. La réponse à cette question n’appelle pas d’amples développements ; il suffit en effet à la Cour de constater que si lesdites dispositions témoignent de l’existence d’une « chance d’élargissement » au sens de l’arrêt Kafkaris – même si des doutes peuvent être émis sur la réalité de cette chance en pratique – aucune des procédures prévues ne s’apparente à un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de l’exécution de sa peine, l’intéressé a tellement évolué et progressé qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie son maintien en détention (voir paragraphe 115, ci-dessus).
138. Dans ces conditions, la Cour considère que la peine perpétuelle à laquelle le requérant pourrait se voir condamner ne peut être qualifiée de compressible aux fins de l’article 3 de la Convention au sens de l’arrêt Vinter et autres. En exposant le requérant au risque d’un traitement contraire à cette disposition, le Gouvernement a engagé la responsabilité de l’État défendeur au titre de la Convention.
139. Partant, la Cour conclut que l’extradition du requérant vers les États-Unis a emporté violation de l’article 3 de la Convention.
arrêt A.L. (X.W.) c. Russie du 29 octobre 2015 requête no 44095/14
Violation des articles 2 et 3 de la CEDH : L’expulsion vers la Chine d’une personne soupçonnée de meurtre l’exposerait au risque d’être condamnée à mort, en violation de la CEDH. La Chine est un État dangereux car elle applique la peine de mort.
Articles 2 et 3 – le renvoi potentiel du requérant
La Cour estime que la Russie a l’obligation, en vertu des articles 2 et 3 de la Convention, de ne pas extrader ou refouler une personne vers un autre État lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la peine de mort. La Russie n’a pas ratifié les Protocoles no 6 et no 13 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort. Toutefois, la Russie s’étant engagée au moment de son adhésion au Conseil de l’Europe à abolir la peine de mort – engagement qu’elle a partiellement rempli par le biais d’un moratoire sur cette forme de peine –, la Cour considère que sa jurisprudence selon laquelle la peine de mort est devenue une forme de sanction inacceptable s’applique pleinement à la Russie.
La Cour constate que les juridictions russes n’ont pas procédé à une appréciation des risques que le requérant soit soumis à la peine de mort ou à un traitement inhumain en cas de renvoi vers la Chine. Elle n’est pas convaincue par l’argument selon lequel l’interdiction de séjour visant le requérant n’entraîne pas automatiquement son renvoi vers la Chine et que l’intéressé a toujours la possibilité de quitter la Russie pour un autre pays. La législation russe prévoit que les ressortissants étrangers sous le coup d’une interdiction du territoire doivent être renvoyés s’ils ne quittent pas le pays.
L’interdiction du territoire visant le requérant mentionne explicitement qu’il sera renvoyé s’il ne quitte pas la Russie dans le délai requis. Étant donné que le requérant s’est vu saisir son passeport russe et que rien n’indique qu’il possède une autre pièce d’identité pour quitter la Russie et entrer dans un pays tiers, la Cour souscrit à la thèse du requérant selon laquelle il se trouve maintenant exposé à un risque imminent d’être renvoyé vers la Chine.
En outre, les parties ne contestent pas qu’en cas de renvoi vers la Chine le requérant court un risque sérieux d’être condamné à la peine de mort. Le renvoi de l’intéressé emporterait donc violation des articles 2 et 3 de la Convention.
X c. Suisse du 26 janvier 2017 requête no 16744/14
Violation de l'article 3 Le gouvernement suisse a expliqué que le requérant n'était plus victime car ila présenté ses excuses. La CEDH répond que c'est bien mais pas suffisant car le requérant a été passé à tabac tous les jours au Sri Lanka. Les autorités suisses n’ont pas dûment examiné le risque de mauvais traitements avant d’expulser un ressortissant sri lankais d’origine tamoule.
Sur la recevabilité
Le Gouvernement estimait que la requête de M. X devait être déclarée irrecevable, plaidant que l’intéressé ne pouvait plus être considéré comme « victime » d’une violation de l’article 3 de la Convention. Il a déclaré que les autorités suisses, une fois informées de l’incarcération de M. X et des mauvais traitements subis par lui, avaient reconnu des manquements dans leur appréciation de la première demande d’asile et avaient accordé un redressement approprié, notamment en présentant des excuses, en demandant une enquête et en offrant à M. X et aux membres de sa famille une aide pour faciliter leur retour en Suisse.
Le Gouvernement a également dit que M. X aurait pu en vertu de la loi sur la responsabilité demander réparation des manquements constatés dans le traitement de sa première demande d’asile, mais qu’il ne l’avait pas fait.
Pour la Cour, les mesures susmentionnées constituent une reconnaissance suffisante de la violation de l’article 3, mais le fait que M. X n’ait pas bénéficié d’une réparation signifie que ces mesures ne peuvent pas dans sa cause passer pour un redressement suffisant.
En outre, le Gouvernement n’a pas démontré que M. X aurait pu obtenir réparation s’il avait engagé une procédure interne à cet effet.
M. X a évoqué la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à une affaire similaire à la sienne sur le plan factuel, indiquant que la responsabilité de l’État aurait été écartée dans sa cause.
De plus, la Cour relève que le délai d’un an pour déposer une demande de réparation en vertu de la loi sur la responsabilité avait expiré alors que M. X était en prison au Sri Lanka ; il aurait été irréaliste de s’attendre à ce que M. X s’adressât aux autorités suisses pour obtenir réparation d’une violation de ses droits alors qu’il était encore détenu dans une prison du Sri Lanka. Ainsi, M. X n’a pas bénéficié d’un redressement suffisant au niveau national, et demeure victime au regard de l’article 3.
Sur le fond
La Cour rappelle que la décision d’expulser un étranger hors du territoire d’un État peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3.
Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays.
La Cour observe que, à l’époque de l’expulsion de M. X, les autorités suisses auraient dû être parfaitement informées de ce que le requérant et ses proches risquaient d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 s’ils étaient renvoyés au Sri Lanka.
Parmi les éléments dont elles disposaient, il y avait non seulement les propres déclarations de M. X concernant les mauvais traitements précédemment subis par lui aux mains des autorités sri lankaises, mais également l’affaire parallèle d’un autre Tamoul, M. Y, qui avait été expulsé vers le Sri Lanka quelques semaines avant M. X et y avait subi des mauvais traitements ayant nécessité une hospitalisation.
Par ailleurs, l’avocat de M. Y avait écrit au ministre de la Justice et au directeur de l’OFM pour demander la suspension de toutes les expulsions de Tamouls vers le Sri Lanka ; les autorités ne semblent pas avoir répondu à cette lettre. Dès lors, la Cour conclut que les autorités suisses n’ont pas satisfait à leurs obligations au regard de l’article 3 lorsqu’elles ont traité la première demande d’asile de M. X
CINQ ARRET CONCERNANT LES EXPULSIONS DU DANEMARK VERS LE SRI LANKA
FONT DATE DANS LES EXPULSIONS DES ETRANGERS SANS VIOLATION DE L'ARTICLE 3
N.S. c. Danemark (requête no 58359/08), P.K. c. Danemark (no 54705/08), S.S. et autres c. Danemark (no 54703/08), T.N. c. Danemark (no 20594/08) et T.N. et S.N. c. Danemark (no 36517/08)
Démarche de la Cour
Dans chacune des cinq affaires, la Cour a suivi la démarche qu’elle avait définie dans son arrêt de principe N.A. c. Royaume-Uni (n° 25904/07 du 17 juillet 2008), où elle avait jugé que, d’une manière générale, le renvoi de Tamouls vers le Sri Lanka n’était pas de nature à exposer les intéressés à un risque de traitements contraires à l’article 3, précisant que la protection garantie par cette disposition ne pouvait entrer en jeu que si un requérant pouvait établir qu’il y avait des raisons sérieuses de croire qu’il présentait pour les autorités un intérêt suffisant pour justifier son arrestation et son placement en détention aux fins d’interrogatoire à son retour.
Suivant ledit arrêt, l’appréciation du point de savoir s’il existait un risque réel doit dès lors être menée au cas par cas et eu égard à l’ensemble des éléments susceptibles de faire conclure à un accroissement du risque de mauvais traitements, par exemple une appartenance antérieure ou une suspicion d’appartenance antérieure aux TLET ; l’existence d’un casier judiciaire et/ou d’un mandat d’arrêt toujours en cours ; un non-respect des termes d’une libération conditionnelle et/ou une évasion ; la signature d’aveux ou de document analogues ; une invitation à travailler comme informateur pour les forces de sécurité ; la présence de cicatrices sur le corps de la personne intéressée; un renvoi censé se faire à partir de Londres ou d’autres centres névralgiques de financement des TLET ; un départ illégal du Sri Lanka ; la non-possession d’une carte d’identité ou d’autres documents d’identité ; l’introduction d’une demande d’asile à l’étranger ; ou encore l’appartenance à une famille dont certains membres appartiennent aux TLET.
La Cour réaffirme que si certains facteurs peuvent ne pas faire conclure à l’existence d’un risque réel lorsqu’on les considère de manière séparée, ils peuvent, en fonction de la situation générale régnant au Sri Lanka à l’époque pertinente, entraîner la conclusion inverse lorsqu’on les considère de manière cumulative.
Risque de mauvais traitements aux mains des TLET
S’agissant des requérants qui affirmaient qu’un renvoi vers le Sri Lanka les exposerait à un risque de subir des mauvais traitements aux mains des TLET, la Cour relève que les hostilités entre les TLET et l’armée sri lankaise ont pris fin le 19 mai 2009. Dans l’affaire T.N., la requérante quitta l’organisation en 1994 et elle n’a pas établi qu’elle serait une activiste éminente de l’opposition ou qu’elle serait considérée par les TLET comme une renégate ou une traîtresse. Dans l’affaire T.N. et S.N., T.N. ne faisait que prêter aide et assistance aux TLET sans en être membre, et ni lui ni le requérant dans l’affaire P.K. n’ont jamais affirmé avoir eu le moindre problème avec les TLET. Dans l’affaire N.S., le requérant ne faisait que prêter aide et assistance aux TLET sans en être membre, et la dernière fois qu’il a travaillé avec les TLET c’est en janvier 1997 et cela ne lui a valu aucun problème.
Risque de mauvais traitements aux mains des autorités sri lankaises
Dans les cinq affaires, eu égard à la situation générale qui règne actuellement au Sri Lanka, combinée avec les facteurs de risque identifiés ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a aucun motif sérieux de considérer que l’un des requérants susciterait l’intérêt des autorités sri lankaises en cas de renvoi au Sri Lanka. Aussi juge-t-elle qu’une mise en oeuvre de l’arrêté d’expulsion des requérants vers le Sri Lanka n’emporterait pas violation de l’article 3.
Dans les quatre premières affaires, la Cour estime notamment que les requérants n’ont jamais été inscrits dans des registres d’arrestation ou de détention tenus par les autorités sri lankaises ; rien n’indique par ailleurs qu’il existe des photographies, des empreintes digitales ou d’autres moyens d’identification qui auraient été conservés par les autorités sri lankaises et seraient de nature à permettre leur identification à leur retour. Dans l’affaire N.S., le requérant n’a pas démontré qu’il risquerait de susciter l’intérêt des autorités à son retour. Même si sa photo avait été prise lors de son arrestation, il demeure que de 1991 à son départ en décembre 1997 il ne fut ni détenu ni interrogé, ses empreintes digitales ne furent pas recueillies et il n’a jamais, d’une manière ou d’une autre, suscité l’intérêt des autorités sri lankaises.
Quant aux particularités de chaque affaire
T.N. c. Danemark – La Cour estime que T.N. n’a jamais été arrêtée ou détenue et qu’elle na jamais eu de problèmes avec les autorités sri lankaises. Rien ne donne à penser que celles-ci la soupçonnaient d’être une combattante des TLET. Ses cicatrices ne lui ont pas causé le moindre problème pour obtenir son passeport en 2004 ou pour quitter son pays en 2005. Rien ne permet de penser que les autorités sri lankaises savent qu’elle a formulé une demande d’asile à l’étranger, et, si expulsion il devait y avoir, elle ne se ferait pas à partir d’un lieu considéré comme un centre de financement des TLET. Quant à l’argument selon lequel son ex-conjoint et/ou sa famille communiqueraient ou auraient pu communiquer des informations à son sujet aux autorités sri lankaises, il relève de la pure spéculation.
T.N. et S.N. c. Danemark – La Cour juge que rien n’indique qu’à leur retour les requérants pourraient susciter l’intérêt des autorités, désireuses de trouver le cousin de T.N. En ce qui concerne les cicatrices de T.N., La Cour observe que l’intéressé n’a eu aucun problème pour obtenir un passeport ni pour quitter son pays en décembre 2005. Si l’âge, le sexe et le district dont les requérants sont originaires ont été divulgués sur un site web et dans les médias, pareilles informations ne peuvent guère permettre de « remonter jusqu’à eux », ne serait-ce que parce que Batticaloa est une ville relativement importante qui compte beaucoup d’habitants. Dans la procédure suivie devant la Cour européenne des droits de l'homme, les requérants n’ont pas demandé l’anonymat, et rien ne permet de croire qu’au travers du propre site internet de la Cour ou des références ayant figuré dans la presse danoise les autorités sri lankaises aient pu prendre connaissance du fait que les requérants se sont vu refuser l’asile et qu’ils pourraient dès lors présenter un intérêt particulier pour elles à leur retour.
S.S. et autres c. Danemark – La Cour relève que les requérants n’avaient aucune base légale pour demeurer au Danemark et qu’ils pouvaient être renvoyés de force au Sri Lanka s’ils ne quittaient pas le pays volontairement. Il n’a pas été établi qu’ils eussent apporté une aide significative aux TLET, qu’ils eussent pu présenter un intérêt pour les autorités en 1999, lorsqu’ils ont quitté leur pays en toute légalité, qu’ils eussent été recherchés ultérieurement par les autorités sri lankaises ou qu’à leur retour ils présenteraient un intérêt pour les autorités eu égard aux liens qu’ils auraient entretenus avec les TLET quelque douze ans auparavant. Même si la soeur de l’épouse de S.S. est un membre éminent des TLET et qu’elle apparaît sur YouTube, les requérants n’ont plus été en contact avec elle depuis des années. Quant à la blessure à la main de S.S., elle ne lui a causé aucun problème pour quitter le pays en 1999 et rien ne permet de croire que les autorités sri lankaises aient été informées que les requérants avaient formulé une demande d’asile à l’étranger ou qu’ils ont participé à des manifestations au Danemark ; par ailleurs, si expulsion il devait y avoir, elle ne se ferait pas à partir d’un lieu réputé constituer un centre de financement des TLET.
P.K. c. Danemark – Le requérant a lui-même déclaré qu’il ne présente personnellement aucun intérêt pour les autorités, qu’il avait seulement été interrogé, en rapport avec le meurtre de son neveu, au sujet de ce qu’il savait sur certains membres des TLET et qu’il n’avait personnellement été ni persécuté ni menacé dans son pays d’origine. Il quitta le Sri Lanka sans aucun problème en utilisant son passeport. Il est peu probable qu’il eût pu présenter un quelconque intérêt pour les autorités sri lankaises ou qu’il eût pu être soupçonné de prêter aide et assistance aux TLET. L’intéressé n’a fourni aucune raison propre à expliquer ses arrestations entre 1995 et 1998, hormis l’explication selon laquelle, pour quitter le camp de réfugiés dans lequel il séjournait, il lui fallait obligatoirement obtenir une autorisation des autorités militaires. D’après lui, ses arrestations entre 1998 et 2002 visaient à vérifier qu’il était autorisé à séjourner à Colombo, ce qui était le cas. Rien n’indique qu’une des arrestations en question ait été enregistrée ou que, d’une manière générale, l’intéressé ait eu des problèmes avec les autorités sri lankaises. P.K. lui-même reconnaît que lorsque les militaires l’avaient interrogé après le meurtre de son neveu, leur but était essentiellement de retrouver les autres enfants de son frère. Nonobstant l’intérêt que les autorités militaires ont pu lui porter à l’époque, rien n’indique qu’à son retour il présenterait un quelconque intérêt pour les autorités sri lankaises. Rien ne permet de croire que celles-ci aient été informées qu’il a introduit une demande d’asile à l’étranger, et, si expulsion il devait y avoir, elle ne se ferait pas à partir d’un lieu réputé constituer un centre de financement des TLET.
N.S. c. Danemark – N.S. affirme que la dernière fois qu’il a été détenu par les autorités sri lankaises, c’était en 1991, soit cinq ou six ans avant qu’il ne quitte le pays. Il précise qu’il avait simplement été pris dans une arrestation collective et qu’il avait été libéré, sans conditions et sans avoir été inculpé ou condamné, dans le cadre d’un accord de paix. De surcroît, c’est sans aucun problème qu’il put, avec son épouse, quitter le pays en toute légalité en 1997, muni d’un passeport valide. Rien n’indique que les autorités sri lankaises aient connaissance de l’affiliation antérieure des autres membres de sa famille et de son épouse aux TLET, rien ne permet de croire qu’elles savent qu’il a introduit une demande d’asile à l’étranger, et, si expulsion il devait y avoir, elle ne se ferait pas à partir d’un lieu réputé être un centre de financement des TLET.
RJ Contre France du 19 septembre 2013 requête 10466/11
31. La Cour relève d’emblée que le requérant n’a pas objecté aux arguments du Gouvernement selon lesquels son admission sur le territoire français, après l’application par la Cour de l’article 39 de son règlement, fait maintenant obstacle à sa réadmission vers la Syrie dans la mesure où celle-ci n’a constitué qu’un pays de transit. La Cour estime donc établi qu’en cas de mise à exécution d’une mesure de renvoi à l’encontre du requérant, elle s’effectuerait à destination du Sri Lanka, son pays d’origine.
32. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
33. En particulier, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, à propos de l’article 3, série A no 269).
34. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
35. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
36. S’agissant du règlement de la preuve, la Cour a explicité les principes applicables en la matière dans deux décisions récentes, à savoir F.N. et autres c. Suède (no 28774/09, § 67, 18 décembre 2012, et Mo.P. c. France ((déc.), no 55787/09, 30 avril 2013). Dans cette dernière affaire, la Cour s’est fondée sur les arguments exposés par le Gouvernement français pour rejeter les éléments de preuve avancés par le requérant et a conclu à l’irrecevabilité de la requête. Pour ce faire, elle a suivi le raisonnement suivant :
« S’agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs d’asile, la Cour a observé dans la décision F.N. et autres c. Suède (no 28774/09, § 67, 18 décembre 2012) qu’« eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, no >23505/09, § 53, 20 juillet 2010, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007). C’est en principe au requérant de produire des éléments propres à démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 111, 17 juillet 2008) »
37. Dans l’affaire T.N. c. Danemark (§§ 86-94) précitée, la Cour a exposé les principes généraux applicables à l’évaluation des risques auxquels sont exposés à ce jour les Tamouls en cas de retour au Sri Lanka, de même qu’elle a réaffirmé sa conclusion aux termes de l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (précité, § 133) selon laquelle il n’existe pas un risque généralisé de traitements contraires à l’article 3 pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (T.N. c. Danemark, précité, § 93). La protection offerte par l’article 3 entre uniquement en jeu lorsqu’un requérant est en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt tel pour les autorités sri lankaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour (ibid.). En conséquence, l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle, en tenant compte des facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (précité, §§ 129-130) et repris par l’arrêt T.N. c. Danemark (précité, § 94). (Voir E.G. c. Royaume-Uni, précité, § 68 et Mo. P. c. France, précité, § 48).
38. En l’espèce, le requérant invoque principalement le risque qu’il encourt d’être arrêté dès son arrivée du fait à la fois de son origine tamoule, de son statut de demandeur d’asile débouté et de son engagement en faveur du mouvement des LTTE.
39. La Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant appartient à l’ethnie tamoule. La Cour estime que cet élément, en lui-même, au vu des rapports mentionnés dans les affaires E.G. c. Royaume-Uni et T.N. c. Danemark précitées ne suffit pas à convaincre d’un risque de mauvais traitements en cas de retour et que seuls les Tamouls au profil marqué nécessitent une protection internationale (E.G. c. Royaume-Uni, précité, § 45).
40. Il s’agit donc de déterminer si le requérant a un profil marqué, notamment eu égard à ses allégations concernant son engagement en faveur du mouvement des LTTE.
41. Si le récit du requérant est, ainsi que l’ont constaté les instances nationales compétentes en matière d’asile, peu étayé tant sur son soutien financier au mouvement des LTTE que sur les conditions de sa détention, la Cour relève cependant qu’il produit un certificat médical à l’appui de ses allégations de mauvais traitements subis lors de sa détention. Ce certificat médical, établi par un médecin de l’« Unité médicale de la ZAPI de Roissy » alors que le requérant se trouvait en zone d’attente, décrit de façon précises quatorze « plaies par brûlure datant de quelques semaines » et occasionnant « des douleurs importantes nécessitant un traitement local et par la bouche (...) ».
42. La Cour considère que ce document constitue une pièce particulièrement importante du dossier. En effet, la nature, la gravité et le caractère récent des blessures constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé au requérant dans son pays d’origine. Or, malgré la présentation de ce certificat, aucune des instances nationales compétentes en matière d’asile qui se sont prononcées postérieurement à l’application de l’article 39 n’a cherché à établir d’où provenaient ces plaies et à évaluer les risques qu’elles révélaient. La Cour ne peut estimer suffisante la motivation de la CNDA selon laquelle « le certificat en date du 3 février 2011 ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’un lien entre les constatations relevées lors de l’examen médical du requérant et les sévices dont il déclare avoir été victime lors de sa détention ». Par la seule invocation du caractère lacunaire du récit, le Gouvernement ne dissipe pas les fortes suspicions sur l’origine des blessures du requérant.
43. Partant, la Cour considère que le requérant, sans être utilement contredit par le gouvernement, a établi le risque qu’il soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi au Sri Lanka. Dès lors, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour du requérant au Sri Lanka.
N.K. c. FRANCE du 19 décembre 2013 Requête 7974/11
LE PAKISTAN est dangereux
a) Principes généraux
37. La Cour rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, §§ 113-114, CEDH 2012-II).
38. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution de la mesure incriminée, à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 129, CEDH 2008-II ; NA. c. Royaume-Uni, précité, § 111). La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007, et N. c. Suède, no 23505/09, § 53, 20 juillet 2010). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits (Mo. P. c. France (déc.), no 55787/09, § 53, 30 avril 2013).
39. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
40. Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (Saadi, précité, § 132).
41. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996‑V).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
42. Concernant la situation générale au Pakistan, la Cour observe que le risque, dans ce pays, de traitements inhumains et dégradants pour les personnes de confession ahmadie est bien documenté tant dans les rapports internationaux consultés que dans les lignes directrices de l’Upper Tribunal britannique (voir paragraphes 18 à 21). Il en ressort que les personnes de confession ahmadie, en particulier les convertis, sont fréquemment victimes de rejet social, mais aussi d’agressions, de torture et de meurtres par leur famille, leur environnement social ou des groupes islamistes. Les autorités ne les protègent généralement pas et participent même fréquemment à ces persécutions, sous couvert notamment de la législation interdisant le blasphème. Dans le cadre des arrestations et détentions fondées sur ce motif, de nombreux cas de violences et de traitements inhumains ou dégradants du fait des autorités sont, par ailleurs, rapportés. Toutefois, les lignes directrices de l’Upper Tribunal britannique mettent particulièrement en évidence les risques encourus par les Ahmadis qui prêchent leur religion en public et font du prosélytisme, à la différence de ceux qui pratiquent leur foi en privé qui ne sont pas inquiétés par les autorités.
43. Au regard de ces dernières constatations, la Cour estime que, pour qu’entre en jeu la protection offerte par l’article 3, la seule appartenance à la confession ahmadie ne suffit pas. Le requérant doit démontrer qu’il pratique ouvertement cette religion et qu’il est un prosélyte ou, à tout le moins, qu’il est perçu comme tel par les autorités pakistanaises (ce qui est notamment le cas lorsqu’une enquête préliminaire est ouverte, voir paragraphe 21).
44. Le requérant allègue avoir fui en raison des violences et persécutions subies de la part de sa famille et des autorités du fait de sa conversion à la confession ahmadie. Il dit être toujours recherché au Pakistan.
45. La Cour constate, tout d’abord, que le requérant présente un récit circonstancié et étayé par de nombreuses pièces documentaires, dont son acte de conversion, son acte de mariage attestant que chacun des mariés est de confession ahmadie, un mandat d’arrêt du 27 juillet 2009 et des copies de plaintes déposées contre lui. Elle observe que les documents produits tendent à corroborer les faits exposés. Elle note toutefois les réserves émises par le Gouvernement, au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, quant à la crédibilité du récit du requérant. La Cour relève qu’en l’espèce, les éléments apportés par le requérant – tant son récit que les preuves documentaires – furent écartés par les autorités au moyen de motivations succinctes. L’OFPRA, en premier lieu, a rejeté la demande d’asile, sans même avoir entendu le requérant, au seul motif que ses déclarations écrites étaient sommaires, peu crédibles et dénuées de précision personnalisée et argumentée. Statuant en appel, la CNDA s’est limitée à affirmer que les pièces du dossier ne présentaient pas de garanties d’authenticité suffisantes et qu’elles ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués. Saisis à l’occasion de la demande de réexamen, l’OFPRA et la CNDA se sont bornés à indiquer que les faits allégués ne pouvaient être considérés comme nouveaux. Il en résulte que la Cour ne trouve pas d’éléments suffisamment explicites dans ces motivations des instances nationales pour écarter le récit du requérant. Elle observe, par ailleurs, que le Gouvernement ne lui a soumis aucun élément mettant manifestement en doute l’authenticité des documents produits. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas apporté d’informations pertinentes donnant des raisons suffisantes de douter de la véracité des déclarations du requérant quant aux événements à l’origine de son départ et, partant, qu’il n’existe aucune raison de douter de la crédibilité de ce dernier. Dès lors, il ne saurait être attendu du requérant qu’il prouve plus avant ses dires et l’authenticité des éléments de preuve par lui fournis.
46. La question demeure de savoir si le requérant court le risque de subir des mauvais traitements en cas de retour. Pour établir ce risque, le requérant produit notamment les rapports d’enquête préliminaire établis à la suite des plaintes déposées à son encontre. Ces documents, dont le Gouvernement ne conteste pas l’authenticité, attestent, à tout le moins, de ce que la confession ahmadie du requérant est connue des autorités et qu’elle a donné lieu à des poursuites notamment du chef de blasphème. La Cour en conclut que le requérant est perçu par les autorités pakistanaises non comme un simple pratiquant de la confession ahmadie mais comme un prosélyte et, partant, qu’il possède un profil marqué susceptible d’attirer défavorablement l’attention des autorités en cas de retour sur le territoire.
47. En conséquence, la Cour considère que, faute pour le Gouvernement de parvenir à mettre sérieusement en doute la réalité des craintes du requérant et compte tenu du profil de ce dernier et de la situation des Ahmadis au Pakistan, le renvoi du requérant vers son pays d’origine l’exposerait, au vu des circonstances de l’espèce, à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention.
Renvoi entre Etats européens avec risque de renvoyer au final en Afghanistan
Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 5 novembre 2024 pourvoi n° 24-85.705 Rejet
19. Il s'ensuit qu'il doit être désormais jugé que la chambre de l'instruction, qui ne peut, sauf hypothèse d'une défaillance systémique de l'Etat d'émission, subordonner la remise de la personne réfugiée en exécution du mandat européen à l'engagement de cet Etat de ne pas renvoyer ultérieurement l'intéressée vers son Etat d'origine, n'est pas tenue de rechercher l'existence d'un tel engagement.
A.A. c. SUISSE du 5 novembre 2019 requête n° 32218/17
Violation de l'article 3 : Le requérant, est un musulman converti au christianisme, s'il est renvoyé en Afghanistan, il sera au moins torturé.
L’affaire porte sur le renvoi de Suisse d’un ressortissant afghan d’ethnie hazara converti de l’islam au christianisme vers son pays d’origine. La Cour relève que, selon de nombreux documents internationaux sur la situation en Afghanistan, les Afghans convertis au christianisme ou soupçonnés de l’être sont exposés à un risque de persécution émanant de divers groupes. Ces persécutions peuvent prendre une forme étatique et conduire à la peine de mort. La Cour note que, alors que l’authenticité de la conversion en Suisse du requérant a été admise par le Tribunal administratif fédéral, celui-ci n’a pas procédé à une appréciation suffisante des risques que pourrait courir personnellement l’intéressé en cas de renvoi en Afghanistan. La Cour constate notamment que le dossier ne contient aucun élément indiquant que le requérant aurait été interrogé sur la manière dont il vivait sa foi chrétienne depuis son baptême en Suisse et pourrait, en cas de renvoi, continuer à la vivre en Afghanistan, en particulier à Kaboul, où il n’a jamais vécu et où il conteste pouvoir se reconstruire un avenir.
a) Principes généraux applicables
39. La Cour rappelle régulièrement que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (F.G. c. Suède [GC], précité, § 111).
40. Pour établir s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court ce risque réel, la Cour ne peut éviter d’examiner la situation dans le pays de destination sous l’angle des exigences de l’article 3. Au regard de ces exigences, pour tomber sous le coup de l’article 3, le mauvais traitement auquel le requérant affirme qu’il serait exposé en cas de renvoi doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (F.G. c. Suède [GC], précité, § 112).
41. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour (F.G. c. Suède [GC], précité, § 115).
42. Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (F.G. c. Suède [GC], précité, § 118). La Cour doit toutefois estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives (X c. Pays-Bas, no14319/17, § 72, 10 juillet 2018).
43. Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (Saadi c. Italie [GC], no 37201/16, § 128, CEDH 2008). L’appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (F.G. c. Suède [GC], précité, § 115).
44. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et qu’il ne s’agit pas d’exiger des intéressés qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu’ils seront exposés à des traitements prohibés (X c. Pays-Bas, précité, § 74). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (Saadi, précité, § 129).
45. En règle générale, on ne peut considérer que le demandeur d’asile s’est acquitté de la charge de la preuve tant qu’il n’a pas fourni, pour démontrer l’existence d’un risque individuel, et donc réel, de mauvais traitements qu’il courrait en cas d’expulsion, un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existant dans le pays de destination. Cette exigence est toutefois assouplie dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’intéressé allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 91-98 et 103, 23 août 2016).
b) Application des principes généraux au cas d’espèce
46. La Cour est d’avis que, à la lumière des informations dont elle dispose, il n’y a pas lieu de remettre en cause son appréciation, réitérée à plusieurs reprises, selon laquelle la situation générale de violence en Afghanistan n’est pas à elle seule de nature à empêcher tout renvoi vers ce pays (E.P. et A.R. c. Pays-Bas (déc.), nos 43538/11 et 63104/11, § 80, 11 juillet 2017, et les références citées).
47. La Cour s’attachera donc à vérifier si la situation personnelle du requérant est telle que son renvoi en Afghanistan serait contraire à l’article 3 de la Convention.
48. En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant a été interrogé par le SEM à trois reprises et qu’il a, à chaque fois, mentionné s’être converti au christianisme. A cet égard, l’autorité lui a en particulier posé des questions sur ses premiers contacts avec cette religion, l’enseignement qu’il en avait tiré ainsi que la manière dont il avait vécu ses croyances en Afghanistan, arrivant toutefois à la conclusion que les allégations du requérant n’étaient pas crédibles. Le Tribunal administratif fédéral a, quant à lui, retenu qu’il ne pouvait être exclu que le requérant s’était intéressé au christianisme dans son pays d’origine, mais qu’il fallait plutôt retenir que la conversion avait eu lieu en Suisse. Il était indéniable que le requérant disposait d’un certain nombre de connaissances sur le christianisme. Au vu de ce constat et des documents remis lors de la procédure de recours, le Tribunal administratif fédéral, à la différence du SEM, dit qu’il n’entendait pas mettre en doute l’authenticité de la conversion du requérant. La Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de cette appréciation. Elle se rallie également aux conclusions des autorités internes s’agissant des faits survenus en Afghanistan, dans la mesure où elle n’est pas convaincue par l’argument du requérant selon lequel il était déjà converti avant sa fuite et avait été recherché en raison de son prosélytisme.
49. Les autorités suisses se sont donc trouvées confrontées à une conversion sur place. Elles ont, conformément à la jurisprudence de la Cour, dû vérifier si la conversion du requérant était sincère et avait atteint un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance avant de rechercher si le requérant serait exposé au risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de retour en Afghanistan (F.G. c. Suède [GC], précité, § 144).
50. La Cour relève qu’il ressort des informations sur la situation en Afghanistan exposées ci-avant (voir la partie « Le droit interne et les documents internationaux pertinents ») que les Afghans convertis au christianisme, ou soupçonnés de l’être, sont exposés sur place à un risque de persécution émanant de divers groupes. Ces persécutions peuvent également prendre une forme étatique et conduire à une condamnation à la peine de mort, laquelle est encore appliquée en Afghanistan (voir aussi Pa c. France (déc.), no 45269/07, 23 mars 2010).
51. Conformément aux principes directeurs du HCR sur la protection internationale relatifs aux demandeurs d’asile fondés sur la religion, l’autorité concernée est invitée à apprécier au cas par cas si un étranger a établi de façon plausible que sa conversion sur place est sincère en ce sens qu’elle repose sur des convictions religieuses réelles et personnelles. Cela passe par une appréciation des circonstances dans lesquelles la conversion est intervenue et du point de savoir si l’on peut s’attendre à ce que le demandeur vive sa nouvelle foi à son retour dans son pays d’origine (F.G. c. Suède [GC], précité, § 145).
52. Dans ses observations, le Gouvernement a exposé que les autorités suisses avaient, conformément aux principes directeurs du HCR, procédé à une appréciation ex nunc des risques que pourrait courir personnellement le requérant en cas de renvoi en Afghanistan. Force est cependant de constater que le Tribunal administratif fédéral, en tant que seule instance judiciaire à avoir examiné l’affaire, ne s’est, dans son arrêt du 21 octobre 2016, ni penché sur la manière du requérant de manifester sa foi chrétienne en Suisse ni sur la manière dont il entendait continuer à la manifester en Afghanistan si la décision d’éloignement était mise en œuvre. Le tribunal s’est contenté de présumer, de manière générale, que le requérant ne rencontrerait aucun problème auprès de ses oncles et cousins à Kaboul, étant donné qu’il avait seulement extériorisé ses croyances avec ses proches les plus intimes, dont ne font pas partie lesdits oncles et cousins au vu du contexte décrit (voir notamment paragraphe 31). En d’autres termes, le retour ne poserait pas de problème, dans la mesure où la famille du requérant à Kaboul n’est pas au courant de sa conversion.
53. De l’opinion de la Cour, cette argumentation, qui apparaît pour le moins contradictoire, ne relève pas d’un examen rigoureux et approfondi des circonstances du cas particulier.
54. Le dossier ne contient aucun élément indiquant que le requérant aurait été interrogé au sujet de la manière dont il vivait sa foi en Suisse depuis son baptême et pourrait continuer à la vivre en Afghanistan, en particulier à Kaboul, où il n’a jamais vécu et conteste pouvoir se reconstruire un avenir. Or, arrivant à une conclusion différente que le SEM sur la question de la conversion, le Tribunal administratif fédéral se devait d’instruire la cause sur ces points, par exemple par le biais d’un renvoi à l’autorité de première instance ou en soumettant au requérant une liste de questions notamment sur sa façon d’exprimer sa foi depuis son baptême en Suisse et sur son intention de l’exercer en Afghanistan. Tel n’a cependant pas été le cas, l’arrêt du 21 octobre 2017 étant muet sur le sujet (a contrario, voir A. c. Suisse, no 60342/16, 19 décembre 2017, §§ 43-46, concernant le renvoi d’un converti vers l’Iran, où l’examen effectué par les autorités internes a été considéré comme suffisant par la Cour).
55. Pour la Cour, l’explication du Tribunal administratif fédéral selon laquelle le renvoi du requérant à Kaboul ne serait pas problématique parce qu’il avait partagé ses croyances seulement avec ses proches les plus intimes, implique que, bien que le tribunal ait admis la sincérité de la conversion du requérant, celui-ci serait à son retour contraint de modifier son comportement social de manière à cantonner sa nouvelle foi dans le domaine strictement privé. Il ressort clairement des sources consultées qu’un apostat n’est pas libre d’exprimer ouvertement ses croyances en Afghanistan. L’intéressé serait contraint de vivre dans le mensonge et pourrait se voir forcé de renoncer à tout contact avec d’autres personnes de sa confession par crainte d’être découvert. Le Tribunal administratif fédéral suisse, dans un jugement de référence publié quelques mois seulement après l’arrêt rendu dans la présente affaire, a d’ailleurs lui-même concédé que la dissimulation et la négation quotidiennes de convictions intimes dans le contexte de la société afghane conservatrice pouvaient, dans certains cas, être qualifiées de pression psychique insupportable (paragraphe 22 ci‑dessus). Cela étant, le tribunal ne pouvait, sans préalablement chercher à savoir comment le requérant allait pratiquer sa nouvelle religion en Afghanistan, exiger de lui qu’il se contente de cacher ses croyances à Kaboul, étant souligné encore une fois que ses oncles censés l’accueillir ne seraient pas au courant de son apostasie.
56. S’ajoute à ce qui précède que le requérant, vraisemblablement encore mineur à son départ d’Afghanistan, fait partie de la communauté hazara, une communauté qui continue à faire face à un certain degré de discrimination, malgré les efforts du gouvernement afghan (A.M. c. Pays‑Bas, no 29094/09, § 86, 5 juillet 2016). Même si le requérant ne s’est pas spécifiquement prévalu de son origine ethnique à l’appui de sa demande d’asile, et que cet élément n’est pas déterminant pour l’issue de la cause, la Cour ne saurait complètement ignorer ce fait en rien commenté dans les décisions internes (F.G. c. Suède [GC], précité, § 127).
57. Enfin, même si les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les faits et la crédibilité des requérants (paragraphe 42 ci-dessus), la comparaison avec la situation dans le centre de l’Irak faite par le Tribunal administratif fédéral (paragraphe 19 ci-dessus) paraît d’autant plus problématique qu’elle n’est pas étayée par des rapports internationaux se prononçant sur la situation en Afghanistan des personnes converties au christianisme.
58. La Cour conclut que, tout en admettant que le requérant, d’ethnie hazara, s’était converti en Suisse de l’islam au christianisme et qu’il était dès lors susceptible d’appartenir à un groupe de personnes qui, pour diverses raisons, pouvaient être exposées à un risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de retour en Afghanistan, le Tribunal administratif fédéral ne s’est pas livré à un examen ex nunc suffisamment sérieux des conséquences de sa conversion.
59. Il s’ensuit qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention, si le requérant était renvoyé en Afghanistan.
A.M. c. Pays-Bas du 5 juillet 2016 requête no 29094/09
Le droit à un recours effectif d’un demandeur d’asile afghan a été respecté dans le cadre d’une procédure devant les tribunaux néerlandais. Le requérant peut être expulsé vers l'Afghanistan, pas de problèmes, les talibans sont gentils !
ARTICLES 13 ET 3
La Cour rejette tout d’abord une exception du gouvernement néerlandais selon laquelle A.M. n’a pas épuisé les voies de recours internes. Elle relève qu’un nouveau recours devant la division administrative du Conseil d’État n’aurait pas eu d’effet suspensif, contrairement à l’exigence posée par sa jurisprudence sur l’article 13 combiné avec l’article 3 pour qu’un recours interne soit considéré comme effectif.
Cependant, la Cour observe qu’un recours devant le tribunal d’arrondissement de La Haye dans les affaires d’asile avait en revanche un effet suspensif automatique. Étant donné que les États n’ont pas l’obligation en vertu de l’article 13 d’établir une deuxième instance de recours, la Cour estime que A.M., qui a pu saisir le tribunal régional de la Haye, a bien disposé d’un recours permettant de contester la décision du ministre de rejeter sa demande d’asile qui était conforme aux exigences de l’article 13. Outre l’effet suspensif de la procédure, ce tribunal avait le pouvoir de se livrer à un examen approfondi de tout risque de traitement contraire à l’article 3.
ARTICLE 3
En ce qui concerne les risques allégués de mauvais traitements dans le cas d’un renvoi de A.M. vers l’Afghanistan, la Cour parvient à la conclusion qu’il n’a pas été démontré que l’intéressé serait exposé à de tels risques pour des motifs liés à sa personne.
La Cour observe tout d’abord que, après le renversement du régime communiste en Afghanistan par les forces moudjahidins en 1992, A.M. est resté dans le pays, a travaillé pour une faction moudjahidin, le Hezb-e Wahdat, jusqu’en 1994, sans rencontrer aucun problème de la part des autorités, d’un groupe quelconque ou d’une personne privée en raison de ses activités passées pour l’ancien régime communiste. Si, selon ses dires, il a vécu dans la clandestinité à la suite de la retraite du Hezb-e Wahdat de Kaboul en 1994 jusqu’à l’arrivée des troupes américaines en 2001, rien dans le dossier n’indique qu’il ait rencontré un problème quelconque avec les Talibans ou tout autre groupe lors d’un déplacement d’une cachette à l’autre.
De plus, la Cour relève en particulier que rien n’indique qu’après sa fuite le parti moudjahidin ait fait un quelconque effort pour rechercher A.M. ou qu’après son départ d’Afghanistan le requérant ait fait l’objet d’une attention négative d’un organe gouvernemental ou non-gouvernemental ou d’un particulier en Afghanistan en raison de son passé communiste ou de ses activités pour le Hezb-e Wahdat. De plus, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés n’a pas inclus les personnes impliquées dans l’ancien régime communiste et/ou dans le Hezb-e Wahdat dans ses éventuels profils à risque en ce qui concerne l’Afghanistan.
Devant les tribunaux néerlandais, A.M. a également souligné qu’il était d’origine ethnique hazara et a soutenu qu’il courait un risque d’être soumis à des mauvais traitements pour cette raison. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour estime que, si la situation générale en Afghanistan est loin d’être idéale pour cette minorité, il n’y aurait pas de risque réel de traitement prohibé par l’article 3 dans le cas où une personne d’origine hazara serait renvoyée vers l’Afghanistan.
Enfin, ainsi qu’elle l’a constaté dans d’autres affaires récentes, la Cour estime qu’il n’y a pas en Afghanistan une situation générale de violence telle qu’elle entraînerait un risque réel de mauvais traitements du simple fait qu’un individu serait renvoyé dans ce pays.
En conséquence, l’expulsion de A.M. vers l’Afghanistan n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.
SINGH ET AUTRES c. BELGIQUE du 2 octobre 2012 requête n° 33210/11
L'EXPULSION DU REQUERANT VERS LA RUSSIE EQUIVAUT A LE RENVOYER EN AFGHANISTAN OU IL SERA TORTURE.
VIOLATION DE L'ARTICLE 13 COMBINE A L'ARTICLE 3
a) Existence d’un grief défendable
78. La Cour l’a dit à de maintes reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne de recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 53, CEDH 2007-II).
79. Le Gouvernement explique qu’à ce jour les requérants sont responsables de leur départ et qu’il n’y a donc plus de risque que ceux-ci soient éloignés, même indirectement, vers l’Afghanistan (paragraphe 65).
80. La Cour ne saurait toutefois en déduire que les requérants n’ont, de ce fait, plus de « grief défendable » à faire valoir. En effet, pour évaluer si les griefs sont « défendables », elle doit se placer au moment où la procédure litigieuse interne s’est déroulée même si, comme en l’espèce, le risque de traitements contraires à l’article 3 a évolué dans le temps (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 56, I. M. c. France, no 9152/09, § 100, 2 février 2012).
81. A cet égard, la Cour constate que la violation alléguée sur le terrain de l’article 13 (relative au défaut d’effectivité des voies de recours disponibles contre un refoulement, via la Russie, vers l’Afghanistan) était « consommée » au moment où le risque de renvoi vers la Russie a été levé. De plus, si l’éloignement des requérants vers la Russie a été suspendu et ceux-ci ont été autorisés à entrer sur le territoire belge, cela est en raison de la mise en œuvre par le Gouvernement belge de la mesure provisoire que la Cour lui a indiquée le 30 mai 2011.
82. Cela étant, la Cour remarque que le statut des requérants en droit belge n’a pas changé. En application de l’article 74/5 § 5 de la loi sur les étrangers, en vertu duquel la mesure de refoulement est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire, les requérants doivent quitter le territoire belge.
83. Ensuite, s’agissant de la possibilité que les requérants puissent être admis, volontairement ou autrement, par l’Inde, la Cour relève que le Gouvernement belge ne fournit aucun argument convaincant qu’il s’agirait là d’une alternative réaliste. Rien ne démontre d’ailleurs que les autorités belges examineront les risques de traitements contraires à l’article 3 encourus par les requérants dans un pays tiers (voir mutatis mutandis, Auad c. Bulgarie, no 46390/10, § 106, 11 octobre 2011 et références citées).
84. La Cour doit donc rechercher si les griefs que les requérants tiraient de l’article 3 étaient « défendables ». Elle rappelle qu’un grief peut être considéré comme étant défendable dès lors qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il nécessite un examen au fond (Çelik et İmret c. Turquie, no 44093/98, § 57, 26 octobre 2004).
85. Le Gouvernement est d’avis que les requérants ne pouvaient plus se prévaloir du principe de non-refoulement à l’égard des autorités russes et que rien n’aurait de toute façon permis de supposer que la Russie ne se conformerait pas à ses engagements internationaux.
86. La Cour ne partage pas cet avis. Elle considère, à la lumière des rapports que les requérants invoquent (paragraphes 50 à 52), que la crainte des requérants d’être victimes de la pratique des autorités russes de refoulement vers leurs pays d’origine n’était pas dénuée de fondement. De plus, la circonstance qu’en Belgique, les requérants n’étaient plus des demandeurs d’asile ne saurait en rien préjuger qu’un sort différent leur ait été réservé par les autorités russes.
87. S’agissant ensuite de leurs craintes en Afghanistan, la Cour note qu’il n’est pas contesté que les requérants se sont présentés à la frontière belge avec des documents d’identité et des copies des pages d’identité de deux passeports afghans, documents qu’ils se sont vus confisquer par les services de police. Il n’est pas non plus contesté que des copies de mandats de protection du HCR ont été versées au dossier par l’intermédiaire d’un fonctionnaire du HCR en place à New Delhi. La Cour dispose en outre de plusieurs rapports indiquant que la minorité ethno-religieuse sikhe a fait l’objet de persécutions dans le passé et fait encore à ce jour l’objet de discriminations, de harcèlements voire de violence de la part des autres groupes religieux, circonstances que le HCR recommande de prendre en considération lors de l’examen des demandes de protection de membres de cette minorité, en plus du contexte de conflit armé à large échelle en Afghanistan et de la présence d’enfants (paragraphes 44 à 48).
88. La Cour estime, à la lumière de ces éléments et des problèmes juridiques en jeu, que les allégations des requérants de risques de violation de l’article 3 de la Convention appelaient manifestement un examen circonstancié et qu’ils devaient pouvoir les défendre devant les instances belges conformément aux exigences de l’article 13.
b) Effectivité des recours disponibles
89. Les principes généraux relatifs à l’effectivité des recours et des garanties fournies par les Etats contractants en cas d’expulsion d’un demandeur d’asile en vertu des articles 13 et 3 combinés de la Convention sont résumés dans l’arrêt M.S.S. précité (§§ 286 à 293) et plus récemment dans l’arrêt I.M. précité (§§ 127 à 135). En ce qu’elles concernent la qualité des voies de recours disponibles, ces garanties peuvent se résumer comme suit.
90. Premièrement, l’effectivité commande des exigences de disponibilité et d’accessibilité des recours en droit comme en pratique (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 112, CEDH 1999‑IV, et M.S.S., précité, § 318, I.M., précité, § 150).
91. Deuxièmement, compte tenu en particulier de l’importance que la Cour attache à l’article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’article 13 exige un contrôle attentif (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005‑III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000‑VIII). L’instance nationale doit être compétente pour examiner le contenu du grief et à offrir le redressement approprié (ibidem, § 50). Dans l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (no10486/10, §106, 20 décembre 2011), la Cour a précisé que l’instance de contrôle ne pouvait pas se placer fictivement au moment où l’administration a adopté la décision litigieuse pour en apprécier la validité au regard de l’article 3 et ainsi faire l’économie d’un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de l’intéressé.
92. Troisièmement, pour être effectif, le recours interne doit être suspensif de plein droit de l’exécution de la mesure d’éloignement (Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002-I, Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66). Cette exigence ne peut être envisagée de manière accessoire, c’est-à-dire en faisant abstraction des conditions posées par l’article 13 quant à l’étendue du contrôle (M.S.S., précité, § 388).
93. En l’espèce, une controverse existe entre les parties sur les modalités du recours en annulation de la mesure d’éloignement dont les requérants auraient pu ou dû faire usage pour faire valoir leurs craintes d’un refoulement en chaîne vers la Russie puis l’Afghanistan.
94. Les requérants estiment qu’il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir fait valoir leurs craintes d’un refoulement en chaîne de la Russie vers l’Afghanistan lors de la notification de la mesure d’éloignement le 19 mars 2011, à un moment où ils ne savaient pas si et vers où ils seraient finalement éloignés. Le Gouvernement réplique que les requérants auraient dû introduire leur recours après que la décision d’éloignement soit devenue exécutoire à savoir, le 24 mai 2011, quand le CCE a rendu son arrêt rejetant le recours en réformation dans le cadre de la procédure d’asile.
95. A supposer qu’une réactivation du recours par le jeu des mesures provisoires prévues par l’article 39/85 de la loi (paragraphe 37) ait été une possibilité pour les requérants de faire examiner leurs craintes une fois la destination fixée, la Cour constate que le Gouvernement ne fournit aucun exemple de jurisprudence démontrant qu’il s’agissait d’une voie présentant un degré suffisant de certitude en pratique. Au demeurant, la Cour note que la mesure d’éloignement qui fut délivrée aux requérants indiquait textuellement qu’un éventuel recours devait être introduit par voie de requête, dans les trente jours de la notification de cette décision (paragraphe 8). Il lui semble également clairement ressortir de l’article 39/80 de la loi sur les étrangers (paragraphe 35) que le recours contre la mesure d’éloignement est à introduire préalablement à l’issue du recours en plein contentieux dans le cadre de la procédure d’asile.
96. Ensuite, même en supposant que les requérants aient introduit un recours en annulation contre la mesure d’éloignement une fois que celle-ci fut devenue exécutoire et que la destination de transfert fut déterminée, la Cour s’interroge, avec les requérants, sur l’utilité pratique d’un tel recours. En effet, il lui apparaît que, de fait, leurs craintes liées à un retour en Afghanistan avaient été « épuisées » par le refus du CGRA puis du CCE de considérer que les requérants avaient la nationalité afghane et donc d’examiner le bien-fondé de leurs griefs tirés de l’article 3. Si l’effectivité d’un recours ne dépend certes pas de la certitude d’avoir une issue favorable, l’absence de toute perspective réaliste d’obtenir un redressement approprié pose problème selon l’article 13 (M.S.S., précité, § 394). Or, la Cour n’aperçoit pas quels arguments spécifiques les requérants auraient pu invoquer pour éviter un retour en Afghanistan via la Russie.
97. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la possibilité qu’avaient les requérants de saisir le juge judiciaire. Il lui suffit de constater que les recours dont il est question ne sont pas suspensifs de plein droit de l’exécution de la mesure d’éloignement et ne remplissaient donc pas une des exigences requises par l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3.
98. Pour ce qui est de la divergence entre les parties quant à la possibilité qu’auraient eue les requérants en application de la Convention de Chicago de se faire transporter dans un autre pays que la Russie, la Cour rappelle que les exigences de l’article 13 sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique (Čonka, précité, § 83).
99. Du fait que les requérants, en déposant une demande d’asile, avaient saisi les instances d’asile de l’examen de leurs craintes liées à un retour en Afghanistan, la Cour se doit de vérifier s’ils ont disposé dans ce cadre d’un recours remplissant les exigences de l’article 13 et les prémunissant contre un refoulement arbitraire, même indirect, vers l’Afghanistan. Elle rappelle en effet que l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13 même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi d’autres, Čonka, précité, § 75).
100. La Cour note que ni le CGRA ni le CCE ne se sont interrogés, même à titre accessoire, sur la question de savoir si les requérants courraient des risques au sens de l’article 3 de la Convention. Elle remarque que cet examen a été occulté au niveau du CGRA par l’examen de la crédibilité des requérants et les doutes quant à la sincérité de leurs déclarations (paragraphe 13). Si le fait de ne pas accorder plein crédit aux déclarations des requérants et d’instiguer un doute quant à la nationalité et au parcours des requérants relevait à l’évidence de l’appréciation de l’instance d’asile, la Cour observe que le CGRA n’a posé aucun acte d’instruction complémentaire, telle que l’authentification des documents d’identité présentés par les requérants, qui lui aurait permis de vérifier ou d’écarter de manière plus certaine l’existence de risques en Afghanistan.
101. Il n’apparaît pas à la Cour que le CCE ait remédié à cette lacune. En vue d’obtenir la réformation de la décision du CGRA, les requérants ont présenté au CCE des documents de nature à lever les doutes émis par le CGRA quant à leur nationalité et leur parcours. La Cour note que ces documents n’étaient pas insignifiants puisqu’il s’agissait de courriels, envoyés par l’intermédiaire du CBAR, partenaire du HCR en Belgique, et postérieurement à la décision du CGRA, par un fonctionnaire du HCR à New Delhi. A ces courriels étaient jointes des attestations du HCR que les requérants avaient été enregistrés comme réfugiés sous mandat du HCR et qui confirmaient les dates déclarées par les requérants pour étayer leur parcours lors de leurs interrogatoires par les services de l’OE. Le CCE n’a accordé aucun poids à ces documents au motif qu’ils étaient faciles à falsifier et que les requérants restaient en défaut de fournir les originaux.
102. La question, soulevée par les requérants, de savoir si, ce faisant, le CCE s’est cantonné derrière une interprétation stricte de l’article 39/76 de la loi relatif au dépôt de documents nouveaux, dépasse le rôle subsidiaire de la Cour. Il lui suffit de constater que la seule question importante à ses yeux, à savoir si les documents présentés étayaient les allégations de risques en Afghanistan, n’a pas fait l’objet d’investigation par exemple auprès des bureaux du HCR à New Delhi, comme le recommande par ailleurs le HCR (paragraphe 49).
103. Or, la Cour insiste sur le fait que, compte tenu de l’importance qu’elle attache à l’article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de mauvais traitement, il appartient aux autorités nationales de se montrer aussi rigoureuses que possible et de procéder à un examen attentif des griefs tirés de l’article 3 sans quoi les recours perdent de leur effectivité (M.S.S., précité, § 388, dd, précité, § 121). Un tel examen doit permettre d’écarter tout doute, aussi légitime soit-il, quant au caractère mal-fondé d’une demande de protection et, ce, quelle que soit l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle.
104. Or, la démarche opérée en l’espèce qui a consisté tant pour le CGRA que le CCE à écarter des documents, qui étaient au cœur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier préalablement leur authenticité, alors qu’il eut été aisé de le faire auprès du HCR, ne peut être considérée comme l’examen attentif et rigoureux attendu des autorités nationales au sens de l’article 13 de la Convention et ne procède pas d’une protection effective contre tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
105. Il résulte de ce qui précède que les autorités internes n’ont pas examiné conformément aux exigences de l’article 13 le bien-fondé des griefs que les requérants faisaient valoir de manière défendable sous l’angle de l’article 3. Partant, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes et que l’exception préliminaire de non-épuisement du Gouvernement (paragraphe 57) ne saurait être accueillie.
H et B c. Royaume-Uni du 9 avril 2013, requêtes nos 70073/10 et 44539/11
Un ancien conducteur de l'ONU et un ancien interprète de l'armée américaine peuvent être refoulés du Royaume-Uni vers l'Afghanistan alors que le danger de mort sur ordre des talibans, est évident. Nous espérons que les requérants feront appel.
La Cour rappelle qu'une expulsion par un État contractant peut faire naître une question sur le terrain de l'article 3 mais que, en principe, il revient à MM. H. et B. de le prouver et à la Cour d'examiner les conséquences prévisibles de leur renvoi vers l'Afghanistan, compte tenu de la situation générale et de leur situation personnelle.
Pour ce qui est de la situation générale actuelle, la Cour estime que le seul retour d'un individu dans ce pays n'exposerait pas celui-ci à un risque réel de mauvais traitement.
Les deux requérants ont toutefois axé leur raisonnement sur le risque de mauvais traitement par les Taliban du fait de leur concours prêté à la communauté internationale.
M H
Les prétentions de M. H. reposent seulement sur sa crainte des Taliban parce qu'il avait travaillé comme conducteur pour l'ONU entre 2005 et 2008 et les éléments relatifs à la province de Wardak n'entrent pas en ligne de compte car il serait réinstallé à Kaboul, une zone hors de contrôle des Taliban. Or, sur ce point, la Cour estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves que les Taliban aient l'intention ou la possibilité de s'en prendre à des collaborateurs de moindre importance à Kaboul, surtout vu que quatre années se sont écoulées depuis que M. H. a cessé de travailler pour l'ONU. De plus, il n'est pas notoire en Afghanistan qu’il était conducteur pour l'ONU et il n'a connu aucun problème alors qu'il travaillait pour celle-ci, à part une menace téléphonique. D'ailleurs, le ministre et le tribunal du droit d'asile et de l'immigration ont eu la possibilité de voir, entendre et interroger M. H. et ils sont donc mieux placés pour jauger sa crédibilité. La Cour ne voit dès lors aucune raison de conclure à un défaut dans les décisions du ministre et du tribunal ni dans leur appréciation ou leur raisonnement. M. H. n’a non plus produit aucun nouvel élément susceptible de mettre en cause ces décisions.
La Cour en conclut que M. H. n'a pas produit d'élément permettant d'établir qu'il existe des raisons légitimes de penser que son refoulement vers Afghanistan l'exposerait à un risque réel de mauvais traitement. Il n'y aurait donc aucune violation de l'article 3 de la Convention s'il venait à être renvoyé à Kaboul (Afghanistan).
M B
Les prétentions de M. B. reposent sur sa crainte des Taliban et des autorités afghanes parce qu'il avait travaillé comme interprète pour les forces américaines. La Cour relève que ses prétentions ont été examinées sur tous les points par les autorités nationales, lesquelles ont admis qu'il avait été interprète pour l'armée américaine mais n'ont pas reconnu qu'il avait participé au sauvetage d'un travailleur humanitaire. La Cour rappelle qu'elle ne peut s'écarter des conclusions factuelles du juge national que pour des raisons convaincantes et elle constate qu'aucune raison de ce type n'a été avancée dans le cas de M. B. Elle écarte la thèse récemment défendue par M. B. selon laquelle les autorités afghanes constitueraient pour lui une menace au motif qu'il ne l'avait jamais affirmé devant les instances britanniques et qu’il n'a produit aucun élément à l'appui.
La Cour rejette la thèse de M. B. selon laquelle il ne serait pas en sécurité à Kaboul à cause de ses antécédents et de l'état de la sécurité dans cette ville. Elle n'est pas convaincue qu'il serait exposé à un risque du seul fait qu'il avait été interprète pour l'armée américaine et elle constate qu'il avait travaillé dans une autre province où il n'a aucun antécédent particulier. M. B. n'a produit aucun élément de preuve ni avancé aucune raison permettant de dire qu'il serait identifié ou pris à partie par les Taliban à Kaboul, une zone hors du contrôle de ces derniers.
Enfin, pour ce qui est de la thèse de M. B. selon laquelle il serait indigent à Kaboul s’il devait y retourner, la Cour rappelle que les conditions humanitaires dans le pays de renvoi ne peuvent conduire à une violation de l'article 3 que dans des cas particulièrement exceptionnels. Or elle constate que M. B. n'a produit devant elle aucun élément permettant de dire que son retour à Kaboul, une zone urbaine contrôlée par l’Etat et où habitent encore des membres de sa famille, serait un cas de ce type.
Note de frédéric Fabre : Nous pouvons malheureusement souhaiter un bon enterrement pour les requérants s'ils ne font pas appel ou si leur appel est refusé. La juge Kalaydjieva a exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt. Elle est l'honneur de la CEDH!
R c France du 30 août 2022 requête n° 49857/20
Art 3 : Expulsion d’un ressortissant russe d’origine tchétchène vers la Russie ayant conservé la qualité de réfugié en France, en dépit de la révocation de son statut • Arrêté d’expulsion ne faisant aucune mention expresse de la conservation de sa qualité de réfugié • Tribunal administratif ayant rejeté le référé suspension, la veille de l’éloignement effectif, sans indiquer expressément les motifs • Impossible contrôle de savoir si l’analyse des risques a été effectuée en temps utile • Évaluation approfondie de la situation du requérant par le tribunal administratif après son expulsion ne saurant remédier aux insuffisances de l’analyse des risques
CEDH
140. La Cour constate qu’en l’espèce le requérant a conservé, en dépit de la révocation de son statut sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, la qualité de réfugié. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, confirmée par le Conseil d’Etat (paragraphe 39 ci-dessus), le fait que l’intéressé a la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion (K.I. c. France, précité, § 144 et Bivolaru et Moldovan c. France, nos 40324/16 et 12623/17, § 141, 25 mars 2021).
141. En premier lieu, la décision préfectorale fixant la Russie comme pays de destination, prise sur le fondement de l’arrêté d’expulsion, mentionne qu’il a été mis fin au statut de réfugié du requérant et qu’il n’a apporté aucune justification ni aucune précision sur les dangers invoqués en cas de retour dans son pays d’origine. En revanche, l’arrêté ne fait aucune mention expresse du fait que l’intéressé a conservé la qualité de réfugié.
142. En second lieu, le tribunal administratif a rejeté, la veille de son éloignement effectif, le référé suspension introduit par le requérant sans indiquer expressément les motifs ayant fondé son appréciation (paragraphe 26 ci-dessus). Le seul constat d’un défaut de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination ne permet pas à la Cour au regard, en particulier, de la motivation de cet arrêté relevée plus haut, de vérifier que le tribunal a bien pris en compte, d’une part, la qualité de réfugié du requérant, quand bien même le maintien de cette qualité pouvait in fine ne pas apparaître déterminant, et, d’autre part, les craintes engendrées par le fait qu’il pourrait être identifié comme appartenant à une catégorie ciblée en raison de ses activités en lien avec le terrorisme islamiste. La Cour estime donc qu’elle n’est pas en mesure de contrôler qu’il a été procédé en temps utile à l’analyse des risques attendue au regard de l’article 3 de la Convention, laquelle implique un examen, au besoin d’office, des risques connus ou pouvant être connus à la date de l’expulsion (paragraphe 124 ci-dessus).
143. La Cour remarque que par deux décisions du mois de février 2021, le tribunal administratif rejeta les recours en annulation du requérant introduits contre l’arrêté d’expulsion et la décision fixant la Russie comme pays de destination (paragraphe 30 ci-dessus). Concernant les moyens soulevés par M. R sur le fondement des articles 2 et 3 de la Convention, le tribunal considéra que « dans les circonstances de l’espèce, au vu des éléments produits, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Ainsi que cela ressort du raisonnement du tribunal administratif, cette conclusion était fondée sur une évaluation approfondie de la situation de M. R. Cet examen ayant été effectué après l’expulsion du requérant vers la Russie, l’appréciation portée par le tribunal administratif en février 2021 ne saurait remédier aux insuffisances de l’analyse des risques que la Cour a déjà décrites (paragraphes 140 à 142 ci-dessus).
144. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
W c France du 30 août 2022 requête n° 1348/21
Art 3 : Mesure d’expulsion vers la Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, suite à la révocation de son statut de réfugié • Requérant suspecté par les autorités françaises de radicalisation et d’appartenance à la lutte armée tchétchène, et signalé comme tel aux autorités russes • Gouvernement n’ayant pas dissipé les doutes quant aux éléments produits par le requérant • Défaut d’authenticité des convocations émises par le département du Ministère de l’intérieur de la Russie • Examen par l’OFPRA des griefs du requérant, non juridictionnel, rapide et distinct de celui de la juridiction administrative
CEDH
78. Pour l’essentiel, le requérant soutient que, dans la mesure où il est suspecté par les autorités françaises de radicalisation et d’appartenance à la lutte armée tchétchène, et signalé comme tel aux autorités russes, il risque d’être arrêté et torturé en cas de retour vers la Fédération de Russie. En l’état, la Cour estime détenir la preuve matérielle (date, heure de l’envoi par télécopie et documents envoyés par la préfecture compétente, voir paragraphe 24) de ce que, lors des démarches entreprises pour renvoyer le requérant, les autorités françaises ont été en contact direct avec les autorités russes et leur ont transmis, en plus de la demande de réadmission, le dossier concernant le requérant, y compris des éléments détaillés sur sa situation. Il s’agit en particulier d’un document indiquant l’appartenance du requérant à la mouvance islamiste radicale tchétchène, son passé de combattant au sein d’une organisation terroriste tchétchène, ainsi que son engagement au profit du jihad international. Ces informations étaient accompagnées de procès-verbaux émanant de la police française concernant la convocation du requérant à une audition.
79. Le requérant verse également au dossier deux convocations à son nom émises quelques jours plus tard (voir paragraphe 24) ainsi que des témoignages de sa famille proche se trouvant en République tchétchène expliquant que le requérant est recherché et que les forces de l’ordre russes leur rendent souvent visite pour leur poser des questions sur lui. Au vu de ces éléments, de leur séquence temporelle et aussi de ce que des sources internationales fiables montrent que détention arbitraire et torture continuent de se produire en Fédération de Russie et en particulier en République tchétchène dans des cas concernant des personnes suspectées de terrorisme, la Cour considère que le requérant a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, s’il était renvoyé vers la Fédération de Russie, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (X, précité, § 46).
80. Afin de dissiper les doutes quant aux risques encourus par le requérant en cas de renvoi, le Gouvernement conteste notamment l’authenticité et la date des convocations émises par le département du ministère de l’Intérieur de la Russie dans le district de Grozny en République tchétchène. Le Gouvernement indique également qu’une dizaine de mesures d’éloignement du type de celle du requérant ont été mises à exécution depuis 2018 et que le requérant ne sera pas remis aux autorités russes lors de son arrivée en Fédération de Russie, mais escorté, comme il est d’usage, par trois fonctionnaires de la police aux frontières, chargés uniquement de l’admission effective de l’intéressé sur le territoire russe à son arrivée à Moscou. Le Gouvernement réitère que les craintes du requérant ont été examinées de manière attentive et rigoureuse par les instances et juridictions internes, y compris lors de la seconde demande de réexamen de sa demande d’asile déposée auprès de l’OFPRA, dans le cadre de laquelle il a pu invoquer, en particulier, la transmission par les autorités françaises de l’arrêté d’expulsion le visant aux autorités russes.
81. La Cour note d’abord que le Gouvernement n’indique pas les raisons du défaut d’authenticité des convocations émises par le département du ministère de l’Intérieur de la Russie à l’intention du requérant, qui n’apparaît en rien manifeste. Quant à la date de ces documents, il s’avère qu’elle est postérieure à l’envoi par télécopie des documents concernant le requérant aux autorités russes effectué par la préfecture. À cet égard, la Cour ne peut que relever que le Gouvernement reconnaît un dysfonctionnement dans la transmission par la préfecture de l’arrêté d’expulsion aux autorités russes dans le cadre de la demande de laissez-passer consulaire.
82. Quant au contrôle auquel ont procédé les instances internes des griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention, la Cour constate que seule l’OFPRA, en procédure de réexamen, a pu examiner les conséquences de la transmission par les autorités françaises de l’arrêté d’expulsion aux autorités russes. Statuant à titre préliminaire, l’OFPRA a déclaré la demande de réexamen irrecevable, estimant qu’aucun élément nouveau ou probant venaient à l’appui de la réouverture du dossier du requérant. La Cour constate que cet examen, au caractère non juridictionnel, rapide et distinct de l’examen par la juridiction administrative, a pu avoir lieu uniquement suite à l’indication par la Cour de mesures provisoires, le requérant ayant auparavant épuisé les voies de recours internes suspensives.
83. À ce stade, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas dissipé les doutes quant aux éléments produits par le requérant, et ce quels que soient les modalités d’escorte prévues et le nombre d’éloignements de ce type effectués par les autorités françaises.
84. Partant, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir le requérant subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Fédération de Russie. En conséquence, la décision de renvoyer l’intéressé vers la Fédération de Russie emporterait violation de l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution.
K.I. c. France du 15 avril 2021 requête no 5560/19
Article 3 : Expulsion d’un réfugié dont le statut a été révoqué : la Cour en accepte le principe à condition que l’expulsion soit précédée d’une appréciation complète et précise de la réalité du risque
Sous son volet procédural, si le requérant était renvoyé, après la révocation de statut, dans son pays d’origine en l’absence d’une appréciation préalable par les autorités françaises de la réalité et de l’actualité du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure d’expulsion. L’affaire concerne un ressortissant russe d’origine tchéchène, arrivé en France encore mineur, qui a obtenu le statut de réfugié. En raison de sa condamnation pour des faits de terrorisme et étant donné que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française, l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) révoqua en juillet 2020 le statut de réfugié du requérant sur le fondement de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Une mesure d’expulsion à destination de la Russie fut ensuite prise à son encontre. Après avoir relevé qu’en vertu tant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que de celle du Conseil d’État français, la révocation du statut de réfugié est sans incidence sur la qualité de réfugié, la Cour rappelle que la question de savoir si l’intéressé a effectivement conservé la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent, au regard de l’article 3 de la Convention, la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion vers son pays d’origine. Or la Cour constate que, dans le cadre de l’édiction puis du contrôle juridictionnel de la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie, les autorités françaises n’ont pas spécifiquement pris en compte que le requérant est présumé avoir conservé la qualité de réfugié en dépit de la révocation de son statut dans l’évaluation des risques encourus en cas de retour en Russie. La Cour en déduit qu’il y aurait une violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en l’absence d’une appréciation préalable par les autorités françaises de la réalité et de l’actualité du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure d’expulsion.
Art 3 (procédural) • Mesure d’expulsion vers la Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène ayant son statut de réfugié révoqué au motif d’une condamnation pénale pour terrorisme • Absence de prise en compte par les autorités de la conservation de la qualité de réfugié du requérant et du bénéfice du principe de non‑refoulement • Pas d’évaluation complète et ex nunc des risques encourus en cas d’expulsion à l’aune de sa qualité de réfugié et de son appartenance à un groupe ciblé
Principaux faits
K.I. arriva en France en août 2011, à l’âge de 17 ans. En 2013, l’OFPRA lui accorda le statut de réfugié. Un peu plus de neuf mois après l’obtention du statut de réfugié, K.I. fut interpellé par les autorités françaises dans le cadre d’une commission rogatoire visant les chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il fut mis en examen avec quatre compatriotes et placé en détention provisoire. Il lui était notamment reproché d’être parti dans une zone de combat en Syrie afin de suivre un entraînement militaire consistant dans le maniement d’armes de guerre et d’avoir combattu en intégrant un groupe djihadiste. En 2015, le tribunal correctionnel de Paris condamna K.I. à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme commis entre le 1er septembre 2012 et le 19 novembre 2013 sur le territoire national ainsi qu’en Allemagne, Pologne, Ukraine, Turquie et Syrie en préparant et organisant avec un complice et l’aide de leurs contacts leur départ sur la zone de combat en Syrie et en menant à bien ce projet. Le 18 novembre 2015, le préfet de l’Essonne prit un arrêté d’expulsion en raison de la menace grave que K.I. constituait pour l’ordre public. Le 14 janvier 2016, ce dernier forma devant le tribunal administratif de Versailles un recours en annulation dirigé contre l’arrêté d’expulsion. Le 23 juin 2016, l’OFPRA mit fin au statut de réfugié de K.I. en application de l’article L. 711 6 2° du CESEDA au motif qu’il avait été condamné en dernier ressort en France pour des faits de terrorisme et que sa présence en France constituait une menace grave pour la société. Le 14 décembre 2016, K.I. saisit la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours en annulation dirigé contre la décision de l’OFPRA du 23 juin 2016. En défense, l’OFPRA conclut au rejet de ce recours. L’Office soutint à titre principal que la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, a) de la convention de Genève devait être appliquée au requérant aux motifs que les agissements imputables au groupe armé que celui-ci avait rejoint en Syrie étaient assimilables à des crimes contre l’humanité et à des crimes de guerre et que les actes terroristes pour lesquels il avait été condamné en France étaient qualifiables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. À titre subsidiaire, l’OFPRA fit valoir que la présence du requérant en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’État ainsi que pour la société. Depuis sa sortie de prison le 11 décembre 2017, K.I. est assigné à résidence. Il affirme qu’il a l’obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat. Le 11 janvier 2019, la CNDA confirma la décision de fin de protection de l’OFPRA. Le 25 janvier 2019, K.I. saisit la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement pour qu’il soit indiqué au Gouvernement de ne pas procéder à son renvoi vers la Fédération de la Russie. Le 28 janvier 2019, le juge de permanence prit la décision de faire droit temporairement à la demande de mesure provisoire jusqu’au 4 février 2019 et de demander au Gouvernement de lui fournir des renseignements. Le 28 janvier 2019, alors qu’il était assigné à résidence, K.I. fut interpellé. La préfète de la Seine Maritime prit à son encontre un arrêté de placement au centre de rétention administrative (CRA) de Lille Lesquin dans le but d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge de permanence de la Cour décida le 4 février 2019 de lever l’application de l’article 39 du règlement et indiqua à K.I. que sa demande était prématurée dans la mesure où il ne faisait pas l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire, l’arrêté d’expulsion n’étant pas assorti d’une décision fixant le pays de destination. Le 25 février 2019, la préfète de la Seine Maritime prit un arrêté fixant la Fédération de Russie comme pays de destination ou tout pays dans lequel K.I. serait légalement admissible. Le 27 février 2019, K.I. introduisit une nouvelle demande de mesure provisoire devant la Cour. Le même jour, le juge de permanence décida d’appliquer de nouveau temporairement l’article 39 du règlement jusqu’au 8 mars 2019 inclus. Le 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejeta le recours en référé formé par le requérant le 27 février 2019 aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2019. Le 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lille rejeta le recours en annulation du requérant dirigé contre l’arrêté du 25 février 2019 fixant la Russie comme pays de destination.
Le 26 mai 2020, le préfet de la Dordogne prit à l’encontre du requérant un arrêté portant assignation à résidence assorti de l’obligation faite à celui-ci de se présenter trois fois par jour au commissariat. Le 29 juillet 2020, le Conseil d’État décida de ne pas admettre le pourvoi du requérant formé contre la décision de la CNDA du 11 janvier 2019 confirmant la décision de l’OFPRA portant révocation de son statut de réfugié. Le Gouvernement précise que le requérant, actuellement assigné à résidence, bénéficie d’un hébergement fourni par l’État et qu’il est pris en charge financièrement par celui-ci. Le requérant allègue que seuls deux de ses proches résident encore en Tchétchénie et que les membres de sexe masculin de sa famille sont décédés ou bénéficiaires de la protection internationale en Europe.
Article 3
En ce qui concerne la situation générale dans la région du Nord-Caucase, la Cour a déjà estimé que la situation n’est pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. La Cour constate que la situation du requérant n’est pas celle d’un demandeur d’asile qui vient de fuir son pays et qui peut être considéré comme vulnérable du fait de son parcours migratoire. Elle note que le requérant est arrivé en France en 2011 et qu’il a obtenu le statut de réfugié en janvier 2013. Ce statut a été révoqué en 2016 à la suite de sa condamnation pénale en 2015 en raison de faits commis en France, Allemagne, Pologne, Ukraine, Turquie et Syrie entre le 1er septembre 2012 et le 19 novembre 2013, et du fait d’avoir passé en Syrie près de deux mois sur la zone de combat très peu de temps après l’obtention de son statut de réfugié. Son départ pour la Syrie est survenu à l’issue de préparatifs minutieux et prolongés. La Cour estime en conséquence qu’il ne ressort pas des faits de la cause que le requérant puisse être qualifié de vulnérable au regard de la répartition de la charge de la preuve dans les affaires concernant l’article 3 de la Convention. En l’espèce, la Cour observe d’une part, que le 14 mai 2019, deux jours avant que le tribunal administratif de Lille ne se prononce sur les risques que le requérant allègue encourir en cas de retour en Russie, la CJUE avait jugé que la révocation du statut de réfugié en cas de menace pour la sécurité ou la société de l’État membre d’accueil n’emportait pas révocation de la qualité de réfugié.
D’autre part, dans son arrêt du 19 juin 2020, le Conseil d’État a fait application de la jurisprudence de la CJUE. La Cour relève qu’il ressort tant de la jurisprudence de la CJUE que de celle du Conseil d’État, que le requérant a conservé, en dépit de la révocation de son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, la qualité de réfugié, la CNDA n’ayant pas accueilli les conclusions de l’OFPRA tendant à l’application de la clause d’exclusion. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le fait que l’intéressé a la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion. Or la Cour relève que la circonstance que la révocation du statut de réfugié du requérant est sans incidence sur le maintien ou non de sa qualité de réfugié n’a pas été prise en compte par les autorités françaises dans le cadre de l’édiction puis du contrôle de la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie. La Cour en déduit que les autorités françaises et les juridictions internes n’ont pas évalué les risques que le requérant allègue encourir dans l’hypothèse où la mesure d’éloignement serait mise à exécution. La Cour n’exclut pas qu’au terme de l’examen approfondi et complet de la situation personnelle du requérant et de la vérification qu’il possède encore ou non la qualité de réfugié, les autorités françaises arriveraient à la même conclusion que le tribunal administratif de Lille, à savoir l’absence de risque pour celui-ci, au regard de l’article 3 de la Convention, en cas d’expulsion vers la Russie. La Cour relève toutefois que la CNDA a déjà émis des avis défavorables à l’expulsion de personnes vers le pays dont ils avaient la nationalité au motif que, s’ils avaient perdu le statut de réfugié, ils en avaient conservé la qualité. Dans ces avis, la CNDA a estimé que la décision fixant le pays de destination était contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la Convention. En conclusion, la Cour estime qu’il y aurait une violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en l’absence d’une appréciation complète et précise par les autorités françaises du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
CEDH
a) Principes généraux
115. À titre liminaire, la Cour estime utile de clarifier l’objet et la nature d’une mesure provisoire au titre de l’article 39 du règlement de la Cour, mesure qui a été appliquée en l’espèce le 8 mars 2019 le temps de l’examen de la requête devant elle. Elle rappelle que dans des affaires où le requérant allègue de manière plausible un risque de dommage irréparable quant à la jouissance de l’un des droits qui relèvent du noyau dur des droits protégés par la Convention, tel que celui prévu à l’article 3, une mesure provisoire a pour objet de préserver et protéger les droits et intérêts des parties à un litige pendant devant la Cour dans l’attente de la décision finale de celle‑ci. La faculté d’indiquer à l’État défendeur la ou les mesures provisoires qu’il doit adopter ne s’exerce que dans des domaines limités et, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, en présence d’un risque imminent de dommage irréparable (voir Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 104, CEDH 2005‑I). La Cour a déjà souligné l’importance cruciale et le rôle vital des mesures provisoires dans le système de la Convention (voir, entre autres, Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 125, 10 mars 2009 et, Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, §§ 211‑213, CEDH 2013 (extraits)). Lorsqu’un État défendeur a expulsé un requérant malgré l’application d’une mesure provisoire, la Cour peut conclure que ledit État a manqué à ses obligations découlant de l’article 34 de la Convention (voir, par exemple, M.A. c. France, no 9373/15, § 71, 1er février 2018).
116. Toutefois, il découle de l’économie générale de l’article 39 du règlement de la Cour que la décision de l’appliquer dans un cas donné est généralement prise à très bref délai afin d’éviter la réalisation d’un risque imminent de dommage irréparable et souvent sur la base d’informations limitées. Par conséquent, les faits de la cause ne seront souvent pas établis dans leur intégralité avant l’arrêt de la Cour sur le fond du grief auquel se rapporte la mesure. Lorsque ceci est possible compte tenu de l’urgence, la Cour peut cependant inviter l’État défendeur à lui fournir des renseignements complémentaires avant de prendre une décision sur la demande de mesure provisoire ou décider d’appliquer l’article 39 de façon temporaire dans l’attente de telles informations de la part des deux parties, ainsi qu’elle l’a fait en l’espèce (voir paragraphes 36 et 42 ci‑dessus). Dans tous les cas, c’est précisément afin de préserver la capacité de la Cour à rendre son arrêt après un examen effectif du grief qu’il est fait application de l’article 39. Ainsi, jusque‑là, la Cour peut se voir conduite à indiquer à l’État défendeur les mesures provisoires qu’il doit adopter sur la base de faits qui, tout en appelant a priori l’application de telles mesures, sont par la suite complétés ou contestés au point de remettre en question la justification de celles-ci (Mamatkoulov et Askarov, précité, §§ 104 et 125 et, Paladi, précité, § 88).
L’application de l’article 3 dans les affaires d’expulsion
117. Dans la présente affaire, la Cour entend rappeler que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non‑nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 111, 23 mars 2016 et, A.M. c. France, no 12148/18, § 113, 29 avril 2019).
Le caractère absolu des obligations découlant de l’article 3
118. La Cour souligne qu’elle a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Elle est de même parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent actuellement les États pour protéger leur population de la violence terroriste (Chahal c. Royaume‑Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, p. 1855, § 79, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 137, CEDH 2008 et, A.M. c. France, précité, § 112). Devant une telle menace, elle considère qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner (Daoudi c. France, no 19576/08, § 65, 3 décembre 2009, Boutagni c. France, no 42360/08, § 45, 18 novembre 2010, Auad c. Bulgarie, no 46390/10, § 95, 11 octobre 2011, A.M. c. France, précité, § 112 et, O.D. c. Bulgarie, no 34016/18, § 46, 10 octobre 2019).
119. Il convient toutefois de rappeler que la protection offerte par l’article 3 de la Convention présente un caractère absolu. Pour qu’un éloignement forcé envisagé soit contraire à la Convention, la condition nécessaire – et suffisante – est que le risque pour la personne concernée de subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 3 soit réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés, même lorsqu’elle est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale pour l’État contractant (Saadi, précité, §§ 140‑141, Auad, précité, § 100 et, O.D. c. Bulgarie, précité, § 46). En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que la Cour examine les affirmations selon lesquelles un requérant serait impliqué dans des activités terroristes, car cet aspect des choses n’est pas pertinent dans le cadre de l’analyse sur le terrain de l’article 3, au regard de la jurisprudence actuelle (Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008, Auad, précité, § 101 et, O.D. c. Bulgarie, précité, § 46). En effet, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V et, J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 77, 23 août 2016). Il en est de même y compris dans l’hypothèse, où comme en l’espèce, le requérant a eu des liens avec une organisation terroriste (voir A.M. c. France, précité).
Le principe d’une évaluation ex nunc du risque
120. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour. Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (Chahal, précité, § 79, F.G. c. Suède [GC], précité, § 115, A.M. c. France, précité, § 115 et, D et autres c. Roumanie, no 75953/16, § 62, 14 janvier 2020).
121. Lorsqu’il y a eu une procédure interne portant sur les faits litigieux, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, la Cour se garde d’examiner elle‑même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés (voir F.G. c. Suède, précité, § 117). En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (A.M. c. France, précité, § 116). La Cour doit toutefois vérifier que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives (X. c. Pays‑Bas, no 14319/17, § 72, 10 juillet 2018).
L’articulation entre le droit de la Convention, le droit de l’UE et la Convention de Genève
122. La Cour note que le droit de l’UE consacre au niveau du droit primaire le droit d’asile et le droit à la protection internationale (article 78 du TFUE et article 18 de la Charte, cités aux paragraphes 71 et 72 ci‑dessus). Par ailleurs, en vertu de l’article 14 §§ 4 ou 5 de la directive 2011/95 (voir paragraphe 73 ci‑dessus), le bénéfice du principe de non‑refoulement et de certains droits consacrés par le droit de l’UE à la suite de la Convention de Genève (articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de cette convention) (voir paragraphes 80 et 81 ci‑dessus) est accordé, contrairement aux autres droits énumérés dans ces deux instruments, à toute personne qui, se trouvant sur le territoire d’un État membre, remplit les conditions matérielles pour être considérée comme réfugié, même si elle n’a pas formellement obtenu le statut de réfugié ou se l’est vu retirer (voir N.D. et N.T. c. Espagne [GC], précité, § 183 et, voir paragraphes 74 à 76 ci‑dessus).
123. La Cour souligne toutefois qu’aux termes des articles 19 et 32 § 1 de la Convention, elle n’est pas compétente pour appliquer les règles de l’Union européenne ou pour en examiner les violations alléguées, sauf si et dans la mesure où ces violations pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. En outre, statuant dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, tel que celui relatif à la question du maintien de la qualité de réfugié à la suite de la révocation de ce statut, la CJUE, à la différence des juridictions nationales et de la Cour, est parfois invitée à se prononcer sur la validité in abstracto des possibilités offertes par les dispositions du droit de l’UE (voir le paragraphe 79 ci‑dessus). D’une manière plus générale, il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, si nécessaire en conformité avec le droit de l’UE, le rôle de la Cour se bornant à déterminer si les effets de leurs décisions dans un cas concret sont compatibles avec la Convention (voir N.H. et autres c. France, nos 28820/13 et 2 autres, § 166, 2 juillet 2020). De façon plus particulière, la Cour ne s’est pas, à ce jour, prononcée sur la distinction faite dans le droit de l’UE et dans le droit interne entre le statut et la qualité de réfugié. Elle souligne que ni la Convention ni ses Protocoles ne protègent en tant que tel le droit d’asile. La protection qu’ils offrent se limite aux droits qui y sont consacrés, ce qui inclut, en particulier, ceux garantis par l’article 3 de la Convention tels que rappelés ci‑dessus. À cet égard, l’article 3 de la Convention englobe l’interdiction du refoulement au sens de la convention de Genève (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], précité, § 188).
L’appréciation de l’existence d’un risque réel
124. Pour établir s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court un risque réel, il revient à la Cour d’examiner la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 de la Convention. Au regard de ces exigences, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, le mauvais traitement auquel le requérant affirme qu’il serait exposé en cas de renvoi doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (F.G. c. Suède [GC], précité, § 112 et, A.M. c. France, précité, § 114). Même si l’évaluation de pareil risque a dans une certaine mesure un aspect spéculatif, la Cour a toujours fait preuve d’une grande prudence, surtout lorsque des questions de sécurité publique sont également en cause, et examiné avec soin les éléments qui lui ont été soumis à la lumière du niveau de preuve requis avant de prononcer une mesure d’urgence au titre de l’article 39 du règlement (voir paragraphes 115 et 116 ci‑dessus) ou de conclure que l’exécution d’une mesure d’éloignement du territoire se heurterait à l’article 3 de la Convention (Saadi, précité, § 142).
La répartition de la charge de la preuve
125. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir, s’agissant de demandeurs d’asile, F.G. c. Suède [GC], précité, § 112 et, J.K. et autres c. Suède, précité, § 91). Dans ce contexte, il y a lieu de réitérer qu’une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et qu’il ne s’agit pas d’exiger des intéressés qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu’ils seront exposés à des traitements prohibés (X. c. Pays-Bas, précité, § 74). Néanmoins, il appartient à ceux‑ci de démontrer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’ils encourront un risque réel s’ils étaient effectivement expulsés vers le pays de destination. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (Saadi, précité, § 129, M.A. c. France, précité, § 51 et, A.M. c. France, précité, § 118).
b) Application de ces principes en l’espèce
Sur la situation générale prévalant dans la région du Nord Caucase
126. Concernant la situation générale dans la région du Nord-Caucase, la Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir I c. Suède, no 61204/09, § 58, 5 septembre 2013, M.V. et M.T. c. France, précité, §§ 39‑40, R.K. et autres c. France, précité, §§ 49‑50, R.M. et autres c. France, no 33201/11, §§ 50‑51, 12 juillet 2016, I.S. c. France, précité, §§ 47‑48 et, M.I. c. Bosnie‑Herzégovine, précité, §§ 45‑46). Au vu des rapports internationaux précités (voir paragraphes 85 à 91 ci‑dessus), la Cour ne voit pas de raison de remettre en cause une telle conclusion et considère que la protection offerte par l’article 3 de la Convention ne peut entrer en jeu que si le requérant est en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire que son renvoi en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de traitements regardés comme prohibés par l’article 3 de la Convention.
127. À cet égard, la Cour note qu’il ressort des rapports internationaux que peuvent être particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre, les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles ainsi que les personnes soupçonnés ou condamnés pour des faits de terrorisme (voir paragraphes 85 à 91 ci‑dessus). La Cour estime en conséquence que l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle tout en gardant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées peuvent être plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention des autorités.
Sur la situation personnelle du requérant
128. Ainsi qu’il ressort des principes généraux précédemment énoncés, s’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en cas d’exécution de la mesure d’éloignement incriminée, il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, lorsque de tels éléments sont soumis il incombe à l’État défendeur de dissiper les doutes éventuels à ce sujet. En l’espèce, la Cour note le caractère général des arguments soumis par le requérant pour s’opposer à l’exécution de la mesure d’expulsion (voir paragraphes 94 à 102 ci‑dessus) mais observe que les craintes de celui-ci semblent être fondées sur deux éléments. Le premier élément avancé par le requérant se rapporte aux allégations selon lesquelles il a été détenu et torturé en Russie en raison de ses liens de parenté avec des individus ayant pris position en faveur de la guérilla tchétchène et de son refus de collaborer avec les autorités et qu’il serait toujours recherché pour ces faits. Selon lui, ces faits ont donné lieu à la décision de l’OFPRA lui octroyant le statut de réfugié (voir paragraphe 17 ci‑dessus). Le second élément avancé par le requérant tient à la connaissance qu’auraient les autorités russes et tchéchènes de sa condamnation pénale en France (voir paragraphe 21 ci‑dessus) et au fait qu’elles le rechercheraient en raison de ses liens avec un groupe djihadiste en Syrie (voir paragraphes 23, 46 et 49 ci‑dessus).
129. La Cour observe que, s’agissant d’une expulsion vers la Fédération de Russie, elle est appelée à connaître pour la première fois, sur le fond du grief tiré de l’article 3 de la Convention, d’un requérant russe d’origine tchétchène qui fait valoir qu’il encourrait des traitements contraires à cette disposition du fait de sa condamnation pénale pour des faits de terrorisme dans l’État défendeur. En outre, il s’agit d’un requérant dont le statut de réfugié accordé par l’État défendeur a été révoqué (voir paragraphe 27 ci‑dessus).
130. S’agissant du premier élément avancé par le requérant (voir paragraphe 128 ci‑dessus), la Cour rappelle tout d’abord qu’il ne lui appartient pas de tirer les conséquences qu’il convient d’attacher tant au regard de la convention de Genève, du droit de l’UE que du droit français à la révocation du statut de réfugié du requérant sur le fondement de l’article L. 711-6 2o du CESEDA (voir paragraphe 56 ci‑dessus). Elle estime toutefois, aux fins d’examen de la présente affaire, qu’elle doit prendre en compte les éléments ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié au requérant par l’OFPRA et les informations alors à la disposition des autorités françaises (voir paragraphe 17 ci‑dessus) (voir, mutatis mutandis, Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, §§ 8, 9 et 82, 22 septembre 2009 et, M.G. c. Bulgarie, no 59297/12, § 88, 25 mars 2014). À l’époque où ce statut lui avait été accordé, les autorités françaises ont estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments démontrant que celui‑ci risquait d’être persécuté dans son pays d’origine en cas de retour. La Cour considère toutefois que ceci ne représente qu’un point de départ quant à son analyse de la situation actuelle du requérant qu’elle ne doit effectuer qu’au regard de l’article 3 de la Convention (voir mutatis mutandis M.G. c. Bulgarie, précité, § 88).
131. La Cour observe tout d’abord qu’un certain laps de temps s’est écoulé depuis les évènements qui ont justifié l’octroi du statut de réfugié au requérant (voir paragraphes 5 à 9 ci‑dessus). Le requérant lui-même fait valoir que seuls deux de ses proches résident encore en Tchétchénie et que les membres de sexe masculin de sa famille sont décédés ou bénéficiaires de la protection internationale en Europe. En outre, ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits, le requérant a organisé son départ de France pour la Syrie en mars 2013 (voir paragraphe 21 ci‑dessus) soit peu après son entretien le 21 juin 2012 avec l’agent de l’OFPRA (voir paragraphe 16 ci‑dessus) et l’octroi du statut de réfugié le 31 janvier 2013 (voir paragraphe 17 ci‑dessus). Il ressort également de l’exposé des faits qu’il s’y est rendu en transitant au début du mois d’août 2013 par l’Allemagne, la Pologne où il récupéra son « passeport externe » russe, l’Ukraine et la Turquie (voir paragraphe 21 ci‑dessus).
132. La Cour relève, par ailleurs, que pour prouver l’intérêt persistant des autorités à son égard, le requérant produit, joint à son formulaire de requête, un témoignage (voir paragraphe 11 ci‑dessus). La Cour constate avec le Gouvernement que ce témoignage n’est pas daté et que le requérant n’établit pas de lien de parenté avec son auteur. Par ailleurs, si lors de l’entretien du 19 mai 2015 avec un agent de l’OFPRA, le requérant a relaté que le parquet russe aurait tenté d’entrer en contact avec lui (voir paragraphe 24 ci‑dessus), la Cour remarque, d’une part, qu’il est resté très évasif à cet égard et d’autre part, que rien dans le dossier n’indique que les autorités russes ou tchétchènes seraient encore à sa recherche à raison des faits survenus en 2011. En effet, tout au long des procédures devant les autorités responsables en matière d’asile et devant les juridictions françaises, celles‑ci ont observé que les propos du requérant sont demeurés vagues et peu consistants.
133. La Cour relève en outre que le requérant s’est vu délivrer un « passeport externe » russe dont il s’est servi pour quitter la Russie (voir paragraphe 6 ci‑dessus) puis pour voyager en 2013 de Pologne vers la Turquie et la Syrie (voir paragraphe 21 ci‑dessus). À cet égard, la Cour remarque que le requérant n’apporte aucune explication aux incohérences relevées dans son récit par le Gouvernement, n’expliquant pas comment, dans les circonstances qu’il prétend être les siennes en 2011, il a réussi à obtenir un « passeport externe » russe. La Cour rappelle que la délivrance d’un titre de voyage international à une personne dont les activités avaient déjà attiré l’attention des autorités russes paraît hautement improbable (voir, K.Y. c. France (déc.), no 14875/09, 3 mai 2011 et, R.K. et autres c. France, précité, § 54).
134. La Cour remarque également qu’à l’été 2013, soit postérieurement à la décision de l’OFPRA accordant au requérant le statut de réfugié (voir paragraphe 17 ci‑dessus), ses proches qui résidaient en Tchétchénie ont récupéré le « passeport intérieur » russe à son nom dont ils avaient demandé la délivrance (voir paragraphe 24 ci‑dessus). La Cour constate que le requérant n’allègue aucunement que ses proches auraient été inquiétés par les autorités russes pour avoir sollicité et obtenu ce passeport.
135. S’agissant du second élément avancé par le requérant (voir paragraphe 128 ci‑dessus), le Gouvernement soutient que plusieurs autres personnes condamnées en France pour leur participation à des activités à caractère terroriste ont été renvoyées en Russie sans s’être prévalu, devant les instances nationales ou devant la Cour, d’un risque quelconque au titre de l’article 3 de la Convention. La Cour ne saurait déduire de ces seuls faits [, au demeurant dénuées de toutes précisions permettant d’en apprécier la portée,] que le requérant ne serait pas, personnellement, soumis à un risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention en cas de retour en Russie. La Cour relève néanmoins que le requérant ne conteste pas le constat du Gouvernement selon laquelle l’un de ses coaccusés qui est rentré en Tchétchénie depuis la Syrie n’a pas été inquiété (voir paragraphe 21 ci‑dessus).
136. La Cour note que l’argument principal du requérant consiste à faire valoir que les autorités russes et tchétchènes ont connaissance de sa condamnation pénale en France (voir paragraphe 21 ci‑dessus) et sont à sa recherche en raison de son engagement avec un groupe djihadiste en Syrie. La Cour ne peut certes pas totalement écarter l’hypothèse selon laquelle les autorités russes ont eu connaissance du jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris (voir paragraphe 21 ci‑dessus). Pour autant, rien n’atteste que les autorités russes montrent un intérêt particulier pour le requérant qui ferait l’objet, ainsi qu’il le soutient, dans son pays d’origine de recherches en raison de ses liens avec un réseau djihadiste en Syrie. La Cour remarque en particulier que la Russie n’a jamais sollicité de la France l’extradition du requérant ou une copie du jugement le condamnant pour des faits liés au terrorisme. En outre, il ne ressort pas plus du dossier que les autorités russes sont à sa recherche pour des infractions perpétrées sur le sol russe ou ailleurs. En tout état de cause, la nature de la condamnation en France du requérant ainsi que les contextes national et international, profondément et durablement marqués par la lutte contre le terrorisme, n’excluent pas que celui‑ci puisse faire l’objet de mesures de contrôle et de surveillance à son retour en Russie, sans que celles-ci puissent, ipso facto, être constitutives d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention (A.S. c. France, précité, § 62). Ainsi la Cour a déjà relevé, la question à trancher dans une affaire comme celle-ci n’est pas de savoir si le requérant serait détenu et interrogé, ou même condamné ultérieurement, par les autorités du pays de destination, ce qui ne serait pas, en soi, contraire à la Convention. Son office se limite à vérifier si le requérant risque d’être maltraité ou torturé, en violation de l’article 3 de la Convention, dans ce pays (voir, X. c. Suède, no 36417/16, § 55, 9 janvier 2018).
137. La Cour rappelle par ailleurs que les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant puisqu’elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010, M.E. c. Suède, no 71398/12, § 78, 26 juin 2014 et, F.G. c. Suède [GC], précité, § 118).
138. En l’espèce, la Cour observe que le 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours du requérant dirigé contre l’arrêté préfectoral fixant la Fédération de Russie comme pays de destination (voir paragraphe 48 ci‑dessus) après une analyse, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, des risques que le requérant allègue encourir en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Pour autant, la Cour relève qu’il s’agit encore de déterminer si, compte tenu des faits qui ont conduit l’OFPRA à accorder le statut de réfugié au requérant (voir paragraphe 17 ci‑dessus), la procédure menée devant les autorités françaises a été adéquate et a permis un examen complet de sa situation personnelle. Or, la Cour observe que, ainsi qu’il ressort du paragraphe 29 ci‑dessus, le tribunal administratif de Versailles, saisi antérieurement d’une demande d’annulation de la décision fixant la Russie comme pays de destination, avait considéré que la première décision prise à cet égard n’était pas suffisamment motivée eu égard notamment au statut de réfugié dont bénéficiait le requérant à l’époque.
139. Concernant les principes gouvernant la répartition de la charge de la preuve tels qu’exposés paragraphe 125 ci‑dessus, la Cour rappelle qu’ils s’appliquent à toutes les affaires d’expulsion. La Cour a en effet déjà indiqué que pour les demandeurs d’asile, il peut être difficile, voire impossible, de produire des preuves à bref délai, spécialement si elles doivent être obtenues dans le pays qu’ils disent avoir fui. Eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient est appréciée (voir notamment J.K. et autres c. Suède [GC], précité, §§ 92‑93).
140. Au regard des faits de l’espèce, la Cour constate que la situation du requérant n’est pas celle d’un demandeur d’asile qui vient de fuir son pays et qui peut donc être considéré comme vulnérable du fait de son parcours migratoire (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 232, CEDH 2011, Ilias et Ahmed c. Hongrie, [GC], no 47287/15, § 192, 21 novembre 2019 et, N.H. et autres c. France, précité, § 162, 2 juillet 2020). La Cour observe que le requérant est arrivé en France en 2011, qu’il a obtenu le statut de réfugié en janvier 2013 et que ce statut a été révoqué en 2016 à la suite de sa condamnation pénale en 2015 en raison de faits commis sur le territoire national ainsi qu’en Allemagne, Pologne, Ukraine, Turquie et Syrie entre le 1er septembre 2012 et le 19 novembre 2013, notamment le fait d’avoir passé en Syrie près de deux mois sur zone de combat très peu de temps après l’obtention du statut de réfugié (voir paragraphe 17 ci‑dessus). Par ailleurs, ainsi que l’a retenu la CNDA dans sa décision du 11 mai 2019 rejetant le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA portant révocation du statut de réfugié du requérant (voir paragraphe 31 ci‑dessus), le départ de celui‑ci et de son complice pour la Syrie est survenu à « l’issue de préparatifs minutieux et prolongés » (voir paragraphes 21 et 31 ci‑dessus). La Cour estime en conséquence qu’il ne ressort pas des faits de l’espèce que le requérant puisse être qualifié de « vulnérable » au sens qu’elle l’entend au regard de la répartition de la charge de la preuve dans les affaires concernant l’article 3 de la Convention, ce qui aurait alors rendu nécessaire d’accorder à celui-ci le bénéfice du doute.
141. Sans préjudice de la charge de la preuve, la Cour rappelle qu’une évaluation complète et ex nunc du grief du requérant est requise lorsqu’il faut prendre en compte des éléments apparus après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (voir paragraphe 118 ci‑dessus).
142. En l’espèce, la Cour observe d’une part, que le 14 mai 2019, soit deux jours avant que le tribunal administratif de Lille ne se prononce sur les risques que le requérant allègue encourir en cas de retour en Russie, la CJUE avait jugé que la révocation du statut de réfugié en cas de menace pour la sécurité ou la société de l’État membre d’accueil n’emportait pas celle de la qualité de réfugié (voir paragraphes 74 et 76 ci‑dessus). En outre, dans son arrêt du 19 juin 2020 (voir paragraphe 61 ci‑dessus), le Conseil d’État a fait application de la jurisprudence de la CJUE (voir paragraphe 76 ci‑dessus). La Cour relève que si dans son pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la CNDA, le requérant a soulevé un moyen tiré de l’erreur de droit commise par celle‑ci à avoir retenu que la révocation de son statut de réfugié emportait de facto celle de sa qualité de réfugié (voir paragraphe 53 ci‑dessus), il ressort tant de la jurisprudence de la CJUE que de celle du Conseil d’État (voir paragraphes 61 et 62 ci‑dessus) qui n’a en l’espèce pas admis ledit pourvoi du requérant (voir paragraphe 53 ci‑dessus), que celui‑ci a conservé, en dépit de la révocation de son statut sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, la qualité de réfugié, la CNDA n’ayant pas accueilli les conclusions de l’OFPRA tendant à l’application de la clause d’exclusion.
143. La Cour relève d’autre part que, le requérant n’a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant son recours en annulation dirigé contre l’arrêté préfectoral du 25 février 2019 (voir paragraphe 39 ci‑dessus) et que ce jugement est devenu définitif. Sans préjudice de la mesure provisoire prise en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, le requérant pourrait donc être éloigné vers la Fédération de Russie ou vers tout pays vers lequel il sera légalement admissible en application des dispositions de cet arrêté.
144. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le fait que l’intéressé a la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion (voir mutatis mutandis, Shiksaitov c. Slovaquie, nos 56751/16 et 33762/17, §§ 70-71, 10 décembre 2020 et, Bivolaru et Moldovan c. France, nos 40324/16 et 12623/17, § 141, 25 mars 2021, non définitif). Or, à la lumière de ce qui vient d’être dit aux paragraphes 142 à 143 ci‑dessus, la Cour relève que la circonstance que la révocation du statut de réfugié du requérant est sans incidence sur le maintien ou non de sa qualité de réfugié n’a pas été prise en compte par les autorités françaises dans le cadre de l’édiction puis du contrôle de la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie. La Cour en déduit que les autorités françaises et les juridictions internes n’ont pas évalué les risques que le requérant allègue encourir dans l’hypothèse où la mesure d’éloignement serait mise à exécution à l’aune de cette circonstance et du fait que, du moins lors de son arrivée en France en 2011, le requérant a été identifié comme appartenant alors à un groupe ciblé.
145. La Cour n’exclut pas que, au terme de l’examen approfondi et complet de la situation personnelle du requérant et de la vérification qu’il possède encore ou non la qualité de réfugié, les autorités françaises arriveraient à la même conclusion que le tribunal administratif de Lille, à savoir l’absence de risque pour celui‑ci, au regard de l’article 3 de la Convention, en cas d’expulsion vers la Russie. La Cour relève toutefois que la CNDA a émis sur le fondement de l’article L. 731-3 du CESEDA (voir paragraphes 63 et 64 ci-dessus) et dans des hypothèses analogues des avis défavorables à l’expulsion de personnes vers le pays dont ils ont la nationalité au motif que, s’ils avaient perdu le statut de réfugié, ils en avaient conservé la qualité (voir paragraphes 65 et 66 ci-dessus), et ce y compris dans l’hypothèse de l’expulsion vers la Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène présentant un profil similaire (sans toutefois être identique) à celui du requérant (voir paragraphe65 ci‑dessus). La Cour constate également que dans ces deux avis, la CNDA a estimé que la décision fixant le pays de destination était contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la Charte et l’article 3 de la Convention (voir paragraphes 65 et 66 ci‑dessus).
146. En conclusion, et eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il y aurait une violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en l’absence d’une appréciation ex nunc par les autorités françaises du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
R.M. ET AUTRES c. FRANCE du 12 juillet 2016 requête 33201/11
Non violation de l'article 3, si la famille est renvoyée en Russie, il n'y aurait pas violation de l'article 3 car ils ne démontrent pas leur lien avec le conflit tchéchène
a) Principes généraux
46. La Cour se réfère aux principes applicables en la matière (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
47. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3 si la mesure incriminée était mise à exécution (Saadi, précité, § 129). Sur ce point, la Cour reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 113, 23 mars 2016). Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui-ci de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, no 23505/09, 20 juillet 2010, Hakizimana c. Suède (déc.), no 37913/05, 27 mars 2008, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007). La Cour rappelle également que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre, en principe, pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (F.G. c. Suède, précité, § 118).
48. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
49. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
50. Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, la Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir I c. Suède, précité, § 58). Au vu des rapports internationaux précités (voir paragraphes 29 à 31), la Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion et considère que la protection offerte par les articles 2 et 3 ne peut entrer en jeu que si les requérants sont en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils présenteraient un intérêt tel pour les autorités qu’ils seraient susceptibles d’être détenus et interrogés par celles-ci à leur retour. Ainsi, elle doit déterminer si le renvoi des requérants en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
51. À cet égard, la Cour note qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. La Cour estime en conséquence que l’appréciation du risque pour les requérants doit se faire sur une base individuelle mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités.
52. En l’espèce, les requérants allèguent que le premier requérant fut torturé par les autorités en raison de ses liens supposés avec les combattants tchétchènes et qu’il est toujours recherché.
53. La Cour constate que les requérants présentent un récit relativement circonstancié et étayé par de nombreuses pièces documentaires, dont des certificats médicaux et des convocations.
54. Elle rappelle cependant qu’en règle générale, les juridictions internes sont les mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant puisqu’elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010, M.E. c. Suède, no 71398/12, § 78, 26 juin 2014, et F.G. c. Suède, précité, § 118). Or, en l’espèce, elles ont considéré qu’elles ne pouvaient tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées en raison des imprécisions et des incohérences du récit des requérants. En particulier, la CNDA, lorsqu’elle a examiné pour la première fois la demande d’asile du requérant, a estimé qu’une partie de son récit était incompatible avec la situation géopolitique. En effet, le requérant avait décrit le 9 mai 2004 à Grozny comme un jour où les contrôles d’identité étaient relâchés alors même qu’un attentat au stade avait coûté la vie au président Kadyrov le matin même. En outre, la CNDA, dans une décision très motivée, a statué sur l’actualité du risque encouru par les requérants dans le cadre de leur demande de réexamen de leur demande d’asile. Elle a relevé que le récit du requérant était, malgré des demandes en ce sens, particulièrement peu circonstancié sur plusieurs points et que les pièces produites étaient d’une force probante douteuse. Notamment, le requérant n’expliquait pas les circonstances ayant amené les autorités russes à diligenter des recherches à son encontre et n’indiquait pas clairement à quelle fréquence ses parents auraient été interrogés à son sujet après son départ, ni les raisons pour lesquelles il ne produisait qu’un seul procès-verbal de perquisition daté du 5 juillet 2012 alors qu’il alléguait qu’il y avait eu plusieurs perquisitions. La CNDA a constaté, par ailleurs, que ce dernier document se rapportait à des faits datant de près de trois ans, qu’il n’était produit qu’en copie et qu’il était en tout point similaire à des modèles de procès-verbal de perquisition figurant sur internet et aisément téléchargeables.
55. Il n’appartient pas à la Cour, au vu de ces décisions particulièrement motivées, de substituer sa propre vision des faits à celle des juridictions internes (F.G. c. Suède, précité, § 118). Aussi, si elle n’ignore pas les sévices corporels allégués par le requérant et attestés par des certificats médicaux, elle ne peut, au vu des éléments ci-dessus, considérer que le lien entre ceux-ci et les menaces invoquées est établi. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’existe pas de motifs sérieux et actuels de croire que les requérants seraient exposés à des risques réels de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers la Fédération de Russie. En conséquence, il n’y aurait pas violation de cette disposition en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
R.V. c. FRANCE du 7 juillet 2016 requête 78514/14
Violation de l'article 3 si le requérant ressortissant russe d'origine de tchétchènie, était renvoyé en Russie.
a) Principes généraux
48. La Cour se réfère aux principes applicables en la matière (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
49. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3 si la mesure incriminée était mise à exécution (Saadi, précité, § 129). Sur ce point, la Cour reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 113, 23 mars 2016). Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui-ci de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède, no 23505/09, 20 juillet 2010, Hakizimana c. Suède (déc.), no 37913/05, 27 mars 2008, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007). La Cour rappelle également que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre, en principe, pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (F.G.c. Suède, précité, § 118).
50. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
51. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996 V, F.G.c. Suède précité, § 115).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
52. Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, dans son arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 39), la Cour a constaté que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
53. À cet égard, la Cour rappelle qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. Dans ce contexte, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 40), l’appréciation du risque pour un requérant doit se faire sur une base individuelle, mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités.
54. La Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion. Elle doit donc déterminer si le renvoi d’un requérant en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
55. En l’espèce, le requérant allègue avoir été détenu et torturé à plusieurs reprises en raison de ses liens avec un membre de la rébellion tchétchène, et dit être toujours recherché par les autorités.
56. La Cour constate que le requérant présente un récit circonstancié, crédible au regard des données internationales disponibles et étayé par de nombreuses pièces documentaires. Elle relève, en particulier, qu’il verse aux débats un certificat médical du 29 novembre 2010, rédigé par un médecin légiste, qui relève la présence de plusieurs cicatrices sur son corps et qui déclare que ces lésions sont compatibles avec les sévices rapportés. La Cour estime cet élément suffisant pour rendre vraisemblables les événements relatés par le requérant et les tortures subies. Elle observe que celui-ci produit, en outre, plusieurs convocations devant le ROUBOP, certaines lui étant adressées personnellement, la dernière étant datée du 12 décembre 2012, et d’autres étant destinées à son oncle et à son père.
57. La Cour note toutefois les réserves émises par le Gouvernement au regard des nombreux examens de sa situation dont a bénéficié le requérant, ainsi que les incohérences qu’il relève dans le récit de ce dernier.
58. La Cour considère qu’en règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité des témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010, M.E. c. Suède, no 71398/12, § 78, 26 juin 2014, et F.G. c. Suède précité, § 118). Or, en l’espèce, ces autorités ont considéré qu’elles ne pouvaient tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. La Cour relève néanmoins que les éléments apportés par le requérant lors de sa première demande d’asile – tant son récit que les preuves documentaires – furent écartés par l’OFPRA au moyen d’une motivation succincte. L’OFPRA débouta, en effet, le requérant en se basant uniquement sur l’imprécision générale de ses déclarations et sur l’absence de garanties suffisantes d’authenticité des convocations produites, sans indiquer les motifs fondant ses suspicions. La Cour observe que la décision de la CNDA est plus motivée. En particulier, elle reproche au requérant de ne pas donner d’indications concernant tant les activités de son ami en faveur des combattants tchétchènes, que les modalités de l’aide qu’il a apportée à ce dernier et que ses différentes arrestations. La Cour constate cependant que le requérant a, devant elle, fourni un récit particulièrement circonstancié, notamment sur ces points. La CNDA a, par ailleurs, estimé, sans s’expliquer plus avant, que les convocations produites ne présentaient pas de garanties suffisantes d’authenticité et que les autres documents fournis ne permettaient pas d’attester l’existence de craintes personnelles et actuelles du requérant en cas de retour en Tchétchénie. S’agissant des demandes de réexamen, les instances de l’asile les déclarèrent irrecevables, faute pour le requérant d’avoir présenté des éléments nouveaux de nature à justifier ses craintes en cas de retour dans son pays. Le tribunal administratif se limita, quant à lui, à décider qu’au vu des documents produits, le requérant n’établissait pas l’actualité du risque allégué en cas de retour en Russie. Il en résulte que la Cour ne trouve pas d’éléments suffisamment explicites dans ces motivations des instances nationales pour écarter le récit du requérant et rejeter sa demande (voir, en ce sens, K.K. c. France, no 18913/11, § 52, 10 octobre 2013 ; N.K. c. France, no 7974/11, § 45, 19 décembre 2013).
59. La Cour estime cependant important d’examiner les incohérences soulevées par le Gouvernement.
60. En particulier, celui-ci signale l’existence d’une pièce fournie par le requérant et en contradiction avec le récit de ce dernier. Un certificat émanant du « Centre républicain Clinique de protection de la santé de la mère et de l’enfant », dont seule la traduction est fournie, indique en effet que la femme du requérant a été admise à l’hôpital le 14 novembre 2007 alors que le requérant a toujours déclaré qu’il avait été arrêté à son domicile le 15 novembre 2007 et que sa femme avait été si violemment battue à cette occasion qu’elle avait dû être conduite à l’hôpital où elle avait accouché prématurément. La Cour relève néanmoins, d’une part, que ce document atteste de ce que la femme du requérant a accouché prématurément le 22 novembre 2007 à la suite de coups et, d’autre part, que plusieurs témoignages produits par le requérant font le lien entre l’arrestation du requérant à son domicile en novembre 2007 et les coups ayant entraîné l’accouchement prématuré de sa femme (voir paragraphe 20). La Cour constate que les autorités nationales n’ont pas envisagé la possibilité d’une simple erreur matérielle sur le certificat médical ou sur la traduction de ce document. Aussi, sans négliger l’observation du gouvernement sur ce point, la Cour l’inclut dans une appréciation globale de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
61. La Cour observe, en outre, que, dans ses observations complémentaires, le requérant répond aux différentes interrogations soulevées par le Gouvernement sur d’autres points. Il précise ainsi les raisons pour lesquelles il est parti de Russie sans sa femme et celles pour lesquelles il n’a pas consulté immédiatement un médecin en France. S’agissant de l’actualité du risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine, il se réfère, outre aux convocations qui le concernaient, à celles reçues par ses proches, qui sont récentes et qui témoignent de l’intérêt persistant des autorités à l’encontre de sa famille. La Cour estime que les autorités nationales n’ont pas indiqué suffisamment les raisons pour lesquelles elles ont écarté les explications et les précisions que leur avait présentées le requérant.
62. La Cour estime ainsi, au vu du récit du requérant, des documents produits et de la situation actuelle en Tchétchénie, qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel que celui-ci soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités russes en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
63. Il s’ensuit, pour la Cour, qu’un renvoi du requérant vers la Fédération de Russie emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
ARTICLE 5-1
2. Appréciation de la Cour
119. Pour être conforme à l’article 5 § 1, toute privation de liberté doit avoir respecté « les voies légales » et été « régulière » (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ; Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III).
120. La Cour rappelle, par ailleurs, que pour qu’une détention se concilie avec l’article 5 § 1 f) de la Convention, il suffit qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son application. En principe, il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision initiale d’expulsion se justifiait ou non au regard de la législation interne ou de la Convention ou si la rétention pouvait être considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour empêcher un risque de fuite ou d’infraction. La Cour a cependant égard à la situation particulière des personnes privées de liberté. Ainsi, par exception, quand un enfant est présent, elle estime que la privation de liberté doit être nécessaire pour atteindre le but poursuivi, à savoir pour assurer l’expulsion de la famille. Dans l’affaire Popov, elle a conclu à la violation de l’article 5 § 1 après avoir notamment constaté que les autorités n’avaient pas recherché si le placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer (ibid., § 119).
121. La Cour relève que le droit français réglemente certains aspects de la présence des mineurs accompagnant leurs parents placés en rétention (voir les paragraphes 25 à 28 ci-dessus). Il n’existe, en revanche, aucun texte déterminant les conditions dans lesquelles cette présence en rétention est possible. En particulier, l’étranger mineur de dix-huit ans ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire (voir le paragraphe 19 ci‑dessus), aucune disposition interne ne prévoit qu’il puisse être soumis à un arrêté de placement en rétention en vue de son éloignement. Cela explique qu’un tel arrêté n’a été pris en l’espèce qu’à l’encontre des parents requérants et non à l’encontre de l’enfant les accompagnant.
122. Toutefois, la Cour observe que la situation des enfants est intrinsèquement liée à celle de leurs parents, dont il convient, dans toute la mesure du possible, de ne pas les séparer. Ce lien, conforme à l’intérêt des enfants, a pour conséquence que, lorsque leurs parents sont placés en rétention, ils sont eux-mêmes de facto privés de liberté. Cette privation de liberté résulte de la décision légitime des parents, ayant autorité sur eux, de ne pas les confier à une autre personne. La Cour peut accepter qu’une telle situation n’est pas, dans son principe, contraire au droit interne. Elle souligne néanmoins que le cadre dans lequel se trouvent alors les enfants est source d’angoisse et de tensions pouvant leur être gravement préjudiciable.
123. Dans de telles conditions, la Cour juge que la présence en rétention d’un enfant accompagnant ses parents n’est conforme à l’article 5 § 1 f) qu’à la condition que les autorités internes établissent qu’elles ont recouru à cette mesure ultime seulement après avoir vérifié concrètement qu’aucune autre moins attentatoire à la liberté ne pouvait être mise en œuvre.
124. En l’espèce, la Cour note que les requérants et leur enfant ont été placés en rétention dans l’attente de leur expulsion et, partant, qu’il s’agissait d’une privation de liberté relevant de l’article 5 § 1 f). La Cour retient que la cour administrative d’appel a jugé qu’il ne ressortait pas des arrêtés de placement en rétention que le préfet avait recherché, au regard de la présence de l’enfant, si une mesure moins coercitive que la rétention était possible. Dès lors, tout en ayant égard aux motifs figurant dans la décision préfectorale de placement en rétention, la Cour estime ne pas avoir d’éléments suffisants pour se persuader que les autorités internes ont effectivement recherché si le placement en rétention administrative de la famille était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer.
125. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention à l’égard de l’enfant des requérants.
M.D. ET M.A. c. BELGIQUE du 19 janvier 2016 requête 58689/12
Violation de l'article 3 : il y un doute que leur retour en Russie exposerait les requérants à des représailles puisque Ramzan Kadyrov, l’actuel président de la République de Tchétchénie a déjà tué des membres de leur famille et qu'il les recherche. Le doute profite aux requérants. Leur expulsion serait contraire à la Convention.
1. Principes généraux
54. La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 124-125, CEDH 2008, N. c. Royaume-Uni [GC], no 26565/05, § 30, CEDH 2008, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, §§ 113-114, CEDH 2012).
55. Aussi, la Cour considère qu’eu égard au fait que l’article 3 consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques et proscrit en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, il faut impérativement soumettre à un contrôle attentif (Sultani c. France, no 45223/05, § 63, CEDH 2007‑IV (extraits)) et à un examen indépendant et rigoureux tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000‑VIII).
56. Toutefois, la Cour rappelle qu’il est légitime pour les États de vouloir réduire les demandes d’asile répétitives et manifestement abusives ou mal fondées et de prévoir par conséquent des règles spécifiques pour le traitement de telles demandes (voir, dans le même sens, Mohammed c. Autriche, no 2283/12, § 80, 6 juin 2013). Ainsi, la Cour a déjà estimé que le simple fait qu’une demande d’asile successive soit traitée selon une procédure accélérée ne saurait, à lui seul, permettre de conclure à l’ineffectivité de l’examen mené par les instances d’asile (Sultani, précité, § 65).
2. Application au cas d’espèce
57. Les requérants ont introduit successivement quatre demandes d’asile après leur arrivée sur le territoire belge. Ainsi, lorsqu’ils déposèrent une quatrième demande d’asile, les requérants avaient déjà bénéficié d’un examen complet de leur première demande d’asile introduite lors de leur arrivée en janvier 2007.
58. La Cour constate que les requérants n’ont pas contesté devant elle les décisions prises par les instances d’asile nationales dans le cadre des trois premières demandes d’asile. Dès lors, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la conformité de ces décisions avec la Convention. En revanche, il revient à la Cour d’apprécier si les décisions prises par les instances d’asile sur la quatrième demande d’asile pourraient exposer les requérants à une violation de l’article 3 de la Convention.
59. Selon les requérants, le risque allégué par eux n’a pas été examiné par les instances nationales à la lumière des documents qu’ils ont présentés à l’appui de leur quatrième demande d’asile.
60. À cet égard, la Cour constate que la quatrième demande d’asile à l’appui de laquelle les requérants ont présenté les deux convocations de 2012 qu’ils avaient reçues ainsi que l’avis de recherche paru dans un journal daté de 2012 (voir paragraphe 31, ci-dessus), a été rejetée par les instances d’asile belges au motif que les documents produits par les requérants étaient datés d’avant la dernière phase de leur précédente demande d’asile au cours de laquelle ils auraient pu les présenter et que, par conséquent, ils ne constituaient pas des « éléments nouveaux » au sens de l’article 51/8 de la loi sur les étrangers. La Cour relève que, pour ce faire, était prise en compte par les autorités belges la date mentionnée sur les documents en question, et non pas la date à laquelle les requérants allèguent avoir été mis en possession desdits documents. En effet, les instances d’asile ne furent pas convaincues par l’allégation des requérants selon laquelle ils n’avaient pas eu connaissance du contenu des documents à une date antérieure à celle à laquelle ils les avaient présentés aux autorités belges et qu’ils avaient donc été dans l’impossibilité de les présenter auparavant.
61. La Cour constate que la conséquence de la considération que ces documents ne constituaient pas des « éléments nouveaux » était le refus de prise en considération de la quatrième demande d’asile des requérants et, de facto, l’absence d’examen du risque prétendument encouru par les requérants en cas de renvoi vers la Russie, tel que ce risque avait été décrit lors de cette demande. En effet, comme le CCE le rappela, la compétence de l’OE se limitait à déterminer la présence ou l’absence d’éléments nouveaux fournis par les demandeurs d’asile multiples et l’OE n’effectuait en aucun cas un examen sur le fond desdits éléments (voir paragraphe 35, ci-dessus).
62. Il en résulte que l’interprétation faite par les instances d’asile belges de la notion « d’éléments nouveaux » a, en l’espèce, occulté l’évaluation du risque que les requérants prétendent courir en cas de renvoi vers la Fédération de Russie puisque ni l’OE ni le CCE ne se sont interrogés, même à titre accessoire, sur cette question. Tout au plus le CCE a, dans son arrêt du 10 décembre 2012, rappelé, en se référant à la décision du CGRA du 27 mars 2007, que les requérants n’avaient pas démontré un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour vers leur pays d’origine (voir paragraphe 38, ci-dessus).
63. La Cour relève que cette approche adoptée par les instances d’asile belges en l’espèce était conforme à l’article 51/8 de la loi sur les étrangers tel qu’en vigueur au moment des faits et tel qu’interprété par les juridictions nationales (voir paragraphe 41, ci-dessus). Aussi, la Cour estime que le fait que la quatrième demande d’asile des requérants ait été traitée selon la procédure prévue à l’article 51/8 de la loi sur les étrangers ne saurait, à lui seul, permettre à la Cour de conclure à l’ineffectivité de l’examen mené par les instances nationales (mutatis mutandis, Sultani, précité, § 65).
64. Toutefois, la Cour est d’avis que la démarche opérée en l’espèce qui a consisté tant pour l’OE que pour le CCE à écarter les nouvelles pièces produites par les requérants qui étaient au cœur de leur demande de protection, sans aucune évaluation préalable de leur pertinence, de leur authenticité et de leur caractère probant, ne peut être considérée comme l’examen attentif et rigoureux attendu des autorités nationales et ne procède pas d’une protection effective contre tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
65. En effet, la Cour considère que l’existence d’un élément nouveau a, en l’espèce, été examinée de manière trop restrictive par l’OE. L’OE s’est borné à constater que les documents étaient datés d’avant la dernière phase de la précédente demande d’asile au cours de laquelle les requérants auraient pu les présenter. Des documents auxquels elle peut avoir égard, la Cour constate que les requérants pourraient avoir été dans l’impossibilité de produire les documents litigieux au cours d’une précédente demande d’asile. Dans l’état actuel du dossier, elle n’aperçoit aucun élément concret permettant de douter de la bonne foi des requérants sur ce point. Ceux-ci ont d’ailleurs tout mis en œuvre pour démontrer aux instances d’asile qu’ils n’avaient pas pu fournir les documents plus tôt, notamment en déposant la déclaration d’A.C. En rejetant l’argumentation des requérants sur ce point, l’OE a imposé une charge de la preuve déraisonnable sur les requérants. Ensuite, le CCE, dans son arrêt du 10 septembre 2012, s’est contenté de valider l’approche restrictive adoptée par l’OE.
66. Or, la Cour insiste sur le fait que, compte tenu de l’importance qui doit être attachée à l’article 3, du caractère absolu de cette disposition et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de mauvais traitement, il appartient aux autorités nationales de se montrer aussi rigoureuses que possible et de procéder à un examen attentif des griefs tirés de l’article 3 sans quoi les recours perdent de leur effectivité (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 388, CEDH 2011). Un tel examen doit permettre d’écarter tout doute, aussi légitime soit-il, quant au caractère mal fondé d’une demande de protection et ce, quelle que soit l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle (Singh et autres, précité, § 103).
67. La Cour estime qu’en l’absence de réexamen par les instances nationales du risque encouru par les requérants à la lumière des documents produits à l’appui de leur quatrième demande d’asile, ces instances ne disposaient pas d’éléments suffisants pour être assurées qu’en cas de renvoi vers la Russie, les requérants ne couraient pas de risque concret et réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que, si les requérants devaient être envoyés vers la Russie sans examen desdits documents, il y aurait violation de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, §§ 121-122, CEDH 2014 (extraits).
R.K. c. FRANCE arrêt du 9 juillet 2015 requête 61264/11
Violation de l'article 3 : Le requérant est un Tchétchène. Le renvoyer en Russie serait une violation de l'article 3 car il va subir des sévices.
58. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
59. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269).
60. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
61. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996‑V).
62. Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, dans son arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 39), la Cour a constaté que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
63. À cet égard, la Cour rappelle qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. Dans ce contexte, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 40), l’appréciation du risque pour un requérant doit se faire sur une base individuelle, mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités.
64. La Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion. Elle doit donc déterminer si le renvoi d’un requérant en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
65. En l’espèce, le requérant allègue avoir été détenu et torturé à plusieurs reprises en raison de l’engagement de ses proches dans le mouvement de rébellion tchétchène.
66. La Cour prend note des arguments du Gouvernement et, notamment, de ceux relatifs au défaut de preuve attestant du lien de parenté du requérant avec des combattants tchétchènes et à la possession par le requérant d’un passeport.
67. Toutefois, la Cour souligne qu’au-delà de ces éléments, le requérant produit des documents dont le contenu est de nature à rendre crédible le risque allégué.
68. En particulier, la Cour relève que le récit du requérant est étayé par deux documents dont l’authenticité n’a pas été contestée par le gouvernement : un certificat médical en date du 11 septembre 2006, ainsi qu’une convocation l’invitant à se présenter le 10 novembre 2009 pour un interrogatoire devant un juge d’instruction.
69. Il ressort du certificat médical qu’à la suite de la séquestration dont il a été victime en 2006, le requérant s’est rendu dans un hôpital afin de recevoir des soins et de faire constater ses blessures. Les constatations contenues dans le certificat relatent des contusions multiples et corroborent ainsi le déroulement des faits tels que rapportés par le requérant.
70. S’agissant de la convocation, la Cour constate que, si les motifs précis de sa délivrance ne sont pas indiqués, il y est mentionné qu’elle a pour objet de soumettre le requérant à un interrogatoire. Or, le simple fait que les autorités requièrent la présence du requérant permet de penser qu’elles lui portent toujours un intérêt qui, au regard des sévices qu’il a déjà subis et du contexte local, est lourd de menaces.
71. La Cour estime ainsi, au vu du récit du requérant, même entaché de certaines contradictions, des documents produits et de la situation actuelle en Tchétchénie, qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel que celui-ci soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités russes, en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
Senchishak c. Finlande du 18 novembre 2014 requête 5049/12
Pas de violation de l'article 3 de la Convention : Expulsion de Finlande d’une femme âgée russe, rien ne prouve qu’elle ne bénéficierait pas de soins en Russie qui n'est pas un pays dangereux au sens des droits de l'homme.
Article 3 (traitements inhumains ou dégradants)
La Cour a examiné la question de savoir si Mme Senchishak risquait de subir de mauvais traitements si elle était expulsée vers la Russie, compte tenu de la situation générale dans ce pays et de la situation personnelle de l’intéressée.
La situation générale en matière de droits de l’homme en Russie n’est clairement pas de nature à donner lieu à une violation de la Convention européenne si Mme Senchishak était renvoyée dans ce pays.
En outre, la Cour ne voit dans la situation personnelle de l’intéressée aucune circonstance qui serait de nature à empêcher l’expulsion de celle-ci vers la Russie. À l’instar du gouvernement finlandais, elle estime que la requérante n’a pas fourni d’éléments à l’appui de son allégation selon laquelle elle n’aurait pas accès à un traitement médical en Russie, considérant l’existence d’établissements de santé privés et publics et la possibilité d’obtenir une aide extérieure. En ce qui concerne le renvoi lui-même, la Cour s’est assurée que l’état de santé de la requérante serait pris en compte et qu’un transport approprié – par ambulance par exemple – serait organisé. Dès lors, elle conclut que, dans les circonstances actuelles, il n’y a pas de motif sérieux de penser que Mme Senchishak serait exposée à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants si elle était expulsée vers la Russie.
Article 39 :
La Cour décide également, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure devant elle, de maintenir la mesure provisoire indiquée au gouvernement finlandais en vertu de l’article 39 de son règlement, à savoir qu’il ne doit pas expulser M
me Senchishak jusqu’à ce que le présent arrêt soit devenu définitif ou jusqu’à nouvel ordre.Arrêt I.K c. Autriche, du 28 mars 2013 requête 2964/12
Le refoulement d’un Tchétchène de l’Autriche vers la Russie l’exposerait à un risque de mauvais traitement
La Cour juge bon d’examiner sur le seul terrain de l’article 3 le grief tiré par M. K. d’un risque de mauvais traitement.
À la date où elles ont connu de la demande d’asile de M. K., les autorités autrichiennes avaient à leur disposition différents rapports relatifs au Nord-Caucase russe, établis par des organes internationaux et d’autres Etats, dans lesquels étaient constatées, partout dans cette région, une détérioration de la situation générale en matière de sécurité en 2009 et de graves violations des droits de l’homme. Ces rapports donnent foi à la thèse constamment défendue par M. K. selon laquelle un retour en Russie l’exposerait à un risque réel de persécution.
M. K. a invoqué les mêmes raisons que sa mère pour expliquer sa fuite. Or, alors que l’asile a été accordé à elle en 2009 après que le tribunal autrichien du droit d’asile eut jugé son récit convaincant, les autorités ont rejeté la deuxième demande d’asile de M. K.
et ne se sont pas penchées sur la relation entre cette procédure et celle engagée par sa mère. De plus, dans ses observations devant la Cour, le gouvernement autrichien n’a avancé aucun argument pour justifier la disparité dans l’issue de ces deux procédures.
De ce fait, la Cour n’est pas convaincue que les autorités autrichiennes aient examiné les griefs de M. K. sur tous les points.
Les éléments relatifs à la situation du père de M. K. au sein des services de sécurité et le récit de son assassinat ont été jugés crédibles dans le cadre de la procédure d’asile concernant sa mère. Les autorités nationales étant bien mieux placées pour apprécier les dépositions et preuves matérielles directement produites devant elles, la Cour n’a aucune raison de douter des conclusions du tribunal autrichien du droit d’asile quant à la crédibilité des raisons pour lesquelles la mère de M. K. – et donc M. K. lui-même – ont fui la Tchétchénie. Par ailleurs, M. K. a fourni à la Cour un rapport médical constatant une ancienne blessure à l’os du visage, qui attestait des sévices qu’il disait avoir subis.
Rien dans le dossier ne permet de dire que, en cas de retour en Russie, il risque moins d’être persécuté que sa mère. Enfin, le laps de temps écoulé depuis l’issue de la procédure d’asile de sa mère, en mai 2009, n’est pas suffisamment long pour conduire à une conclusion différente.
La Cour a constaté des violations des articles 2 et 3 de la Convention dans de nombreux arrêts concernant des disparitions et des mauvais traitements en Tchétchénie. Bien que se rapportant à des faits remontant à plusieurs années, ces affaires servent de contexte général à l’aune duquel la Cour peut examiner le cas de M. K. De plus, le tableau brossé dans des rapports récents d’organes internationaux fait toujours état de violations régulières des droits de l’homme commises tant par des groupes rebelles que par les forces de sécurité, d’un climat d’impunité et d’une absence d’enquêtes effectives sur les disparitions et les mauvais traitements. Ces rapports font toujours état aussi de la pratique consistant à soumettre à des représailles et à des châtiments collectifs les proches des insurgés allégués et les personnes soupçonnées d’aider ceux-ci.
La Cour conclut que, s’il venait à retourner en Russie, M. K. y serait exposé à un risque réel et individuel de traitement contraire à l’article 3. Dès lors, il y aurait violation de l’article 3 en cas de refoulement vers ce pays.
En revanche, la Cour estime que l’état de santé mental de M. K. et le risque qu’il se détériore ne justifient pas l’application de l’article 3. En outre, compte tenu de ses conclusions sur le terrain de l’article 3, elle ne juge pas nécessaire d’examiner le grief sous l’angle de l’article 8.
La Cour considère que la mesure indiquée par elle au gouvernement autrichien en vertu de l’article 39 de son règlement, invitant celui-ci à ne pas refouler M. K. vers la Russie, doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou qu’elle rende une autre décision à cet égard.
M.G. c. BULGARIE du 25 mars 2014 requête 59297/12
L'EXTRADITION VERS LA RUSSIE SERAIT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3
83. À la lumière des principes exposés ci-dessus, la Cour doit chercher à établir si, à l’heure actuelle, le requérant encourt un risque sérieux et avéré de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de mise à exécution de la décision de l’extrader vers la Russie. Pour ce faire, la Cour examinera d’abord la situation générale dans la région du Caucase du Nord, et en particulier en Ingouchie où le tribunal pénal de Nazran a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé (paragraphe 13 ci-dessus). Elle se penchera ensuite sur la situation individuelle du requérant.
84. La Cour rappelle que, dans plusieurs dizaines d’affaires dirigées contre la Fédération de Russie, elle a constaté l’existence de graves violations des droits de l’homme dans le Caucase du Nord, y compris en Ingouchie, qui étaient perpétrées au cours d’opérations antiterroristes ou dans le cadre de poursuites pénales menées contre des personnes soupçonnées d’appartenir à des groupes d’insurgés. Il s’agissait notamment de cas de disparitions forcées, de torture et de traitements inhumains et dégradants, ainsi que d’absence d’enquêtes effectives sur les allégations relatives à ces violations (voir, parmi beaucoup d’autres, Bazorkina c. Russie, no 69481/01, 27 juillet 2006, Loulouïev et autres c. Russie, no 69480/01, CEDH 2006‑XIII (extraits), Mutsolgova et autres c. Russie, no 2952/06, 1er avril 2010, Shokkarov et autres c. Russie, no 41009/04, 3 mai 2011, et Velkhiyev et autres c. Russie, no 34085/06, 5 juillet 2011). S’il est vrai que ces constats de violation des articles 2 et 3 de la Convention se réfèrent pour la plupart à des événements datant de la première moitié des années 2000, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un élément pertinent qui doit être pris en compte par la Cour pour l’établissement de la situation générale dans cette région de la Russie. Par ailleurs, en l’espèce, l’ouverture des poursuites pénales contre le requérant et son départ précipité du Caucase du Nord en direction de la Pologne datent précisément de cette période (paragraphes 8-14 ci-dessus).
85. La Cour constate ensuite que le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à la suite de sa visite de 2011, le rapport du CPT consécutif à sa visite de la même année et les observations finales du Comité contre la torture des Nations unies de 2012 témoignent de la situation fortement dégradée des droits de l’homme dans le Caucase du Nord, y compris en Ingouchie (paragraphes 47-54 ci-dessus). Elle relève que les forces de l’ordre et les responsables politiques locaux étaient la cible d’attaques violentes des insurgés et que la population civile de la région était également affectée par la violence et l’insécurité. Elle note que les rapports mentionnent plusieurs cas de violations graves des droits fondamentaux attribuées aux forces de l’ordre russes, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des punitions collectives de civils suspectés de liens avec les insurgés, et des cas de torture et autres traitements inhumains et dégradants infligés aux détenus soupçonnés d’appartenir à des groupes d’insurgés.
86. La Cour prend également note des deux derniers rapports annuels de l’organisation Human Rights Watch, et notamment des données suivantes y figurant : les groupes islamistes continuent leur insurrection dans le Caucase du Nord ; plus de 700 personnes, dont 180 civils, ont été blessées ou tuées pendant les neuf premiers mois de 2013 ; certains groupes de la population locale, suspectés de coopérer avec les insurgés, sont soumis à des persécutions de la part des autorités russes et de milices locales soutenues par celles-ci ; des cas récents de disparitions forcées en Ingouchie sont recensés ; et un attentat mortel contre un haut responsable politique dans cette dernière république a eu lieu en août 2013 (paragraphes 55-58 ci‑dessus).
87. À la lumière de ces informations, la Cour ne peut que constater que le Caucase du Nord, y compris l’Ingouchie, continue d’être une zone de conflit armé, marquée par la violence et l’insécurité et par de graves violations des droits fondamentaux de la personne humaine, telles que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture ou d’autres traitements inhumains et dégradants, ou encore les punitions collectives de certains groupes de la population locale. Cela étant, la Cour doit à présent se pencher sur la question de savoir si la situation individuelle du requérant est telle qu’il puisse craindre d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était extradé vers la Fédération de Russie.
88. À cet égard, la Cour note que le requérant s’est prévalu de son statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève et de la règle de non‑refoulement prévue à l’article 33 de celle-ci pour prouver l’existence d’un danger de persécution dans son pays d’origine. Il apparaît que, dans le cadre de la procédure interne d’extradition, cette question a été longuement débattue par les parties et que les tribunaux de première et deuxième instance ont expressément abordé ce problème dans leurs décisions (paragraphes 20-31 ci-dessus). La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’interpréter le droit interne bulgare concernant l’octroi du statut de réfugié et de l’asile politique. Elle n’a pas pour rôle de répondre à la question de savoir si la décision d’octroyer le statut de réfugié prise par les autorités d’un pays contractant à la Convention de Genève doit être interprétée comme conférant à l’intéressé le même statut dans tous les autres pays contractants de ladite convention. Elle n’a pas non plus pour mission de se prononcer formellement sur le respect des actes législatifs des institutions de l’Union européenne en matière d’asile et de protection équivalente. Cependant, aux fins d’examen de la présente affaire, la Cour estime qu’elle doit prendre en compte l’octroi du statut de réfugié par le requérant dans les deux autres pays européens précités, à savoir la Pologne et l’Allemagne (voir, mutatis mutandis, Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, §§ 8, 9 et 82, 22 septembre 2009). Elle souligne qu’il s’agit là d’une indication importante démontrant que, à l’époque où ce statut avait été accordé à l’intéressé, respectivement en 2004 et en 2005, il y avait suffisamment d’éléments démontrant que celui-ci risquait d’être persécuté dans son pays d’origine. Elle considère toutefois que ceci ne représente qu’un point de départ quant à son analyse de la situation actuelle du requérant.
89. En effet, la Cour relève que le requérant, dans ses observations devant elle, expose qu’il est recherché par les autorités russes à cause de sa participation à la guérilla tchétchène et qu’il a adopté la même position devant la cour d’appel de Veliko Tarnovo dans le cadre de la procédure interne d’extradition (paragraphe 30 ci-dessus). Elle note que ces allégations sont amplement corroborées par les autres pièces du dossier et notamment par celles envoyées par les autorités russes aux autorités bulgares dans le cadre de la procédure d’extradition. Il ressort de ces éléments que le requérant fait l’objet de poursuites pénales dans la République d’Ingouchie pour participation à un groupe armé, préparation d’actes terroristes, trafics d’armes et de substances toxiques, que peu avant son départ pour la Pologne les agents du FSB avaient saisi une grande quantité d’armes à feu, d’explosifs et de munitions à son domicile, et que l’intéressé est soupçonné par les autorités russes d’appartenance à un groupe armé djihadiste qui combattait en Tchétchénie et en Ingouchie (paragraphes 8, 9, 12, 13 et 18 ci‑dessus).
90. La Cour note que les autorités russes ont recherché activement le requérant, qu’elles ont lancé un avis de recherche international à son encontre par le biais d’Interpol (paragraphe 13 in fine ci-dessus) et que, peu après l’arrestation de l’intéressé en Bulgarie, elles ont promptement sollicité des autorités bulgares l’obtention de son extradition vers la Russie (paragraphe 18 ci-dessus).
91. La Cour observe que le tribunal pénal de Nazran, en Ingouchie, a ordonné le placement du requérant en détention provisoire (voir paragraphe 13 ci-dessus) et que, si ce dernier venait à être extradé vers la Russie, il est vraisemblable qu’il serait incarcéré dans un des établissements de détention provisoire du Caucase du Nord. Or, étant donné que l’intéressé est inculpé pour des infractions liées aux activités d’un groupe armé d’insurgés, elle estime qu’il serait particulièrement exposé au danger d’être torturé pour livrer des aveux ou de subir d’autres traitements inhumains et dégradants. À cet égard, la Cour s’appuie sur les constats du rapport du CPT suivant sa visite de 2011 dans le Caucase du Nord (paragraphes 53 et 54 ci-dessus). Elle note ainsi que, selon ce rapport, les membres de la délégation du CPT ont entendu de nombreuses allégations de mauvais traitements infligés aux détenus, ont trouvé dans les registres des établissements pénitentiaires des preuves médicales qui corroboraient ces allégations et ont eux-mêmes observé des traces de violences sur les corps de certains détenus. Elle note aussi que, d’après ce rapport, les détenus soupçonnés des mêmes infractions que celles reprochées au requérant dans la présente affaire étaient systématiquement soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants. De même, elle observe que les rapports du Commissaire aux droits de l’homme et les observations finales du Comité contre la torture des Nations unies vont dans le même sens (paragraphes 47-52 ci-dessus).
92. Par ailleurs, la Cour relève que, au cours de l’examen de la demande d’extradition devant les tribunaux bulgares ainsi que dans ses observations écrites devant elle, le requérant a soutenu que ses proches en Ingouchie avaient été harcelés par les forces de l’ordre russes, qu’il a relaté des cas de perquisitions et saisies arbitraires, menaces et maltraitances, et qu’il a expliqué que sa sœur avait disparu (paragraphes 24 et 68 in fine ci-dessus). Elle note qu’il n’a pas présenté d’autres preuves à l’appui de ces allégations. Cependant, elle constate que les rapports internationaux dont elle dispose témoignent de persécutions et punitions collectives de la part des forces de l’ordre russes à l’encontre des proches des personnes soupçonnées de participation à la guérilla dans le Caucase du Nord (paragraphe 49 ci-dessus). La Cour est d’avis qu’il s’agit là encore d’une circonstance qui justifie les craintes du requérant quant à un risque de mauvais traitements qu’il pourrait se voir infliger par les autorités dans son pays d’origine.
93. S’agissant ensuite de la position du Gouvernement, la Cour note que dans ses observations, celui-ci a mis l’accent sur les assurances données par le parquet général russe aux autorités bulgares que l’intéressé ne serait pas soumis à des traitements inhumains et dégradants s’il était extradé vers la Russie (paragraphe 73 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que les assurances données par les autorités d’un pays de destination ne représentent qu’un des facteurs à prendre en considération pour l’examen de la situation personnelle de la personne menacée d’extradition et qu’elles ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Elle estime que le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (Saadi, précité, § 148, et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, §§ 187-189, CEDH 2012 (extraits)).
94. La Cour ne perd pas de vue que, dans la présente espèce, les assurances en question ont été données par le parquet général de la Fédération de Russie, un pays contractant à la Convention qui, de ce fait, s’est engagé à respecter les droits fondamentaux garantis par celle-ci. Elle considère cependant que, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, ces assurances ne sauraient suffire à écarter le risque de mauvais traitements encouru par le requérant. Elle observe en particulier que les rapports internationaux dont elle dispose relèvent que les personnes accusées – à l’instar du requérant – d’appartenance au groupe armé en cause opérant dans le Caucase du Nord sont souvent soumises à la torture lors de leur détention et que les autorités compétentes russes manquent souvent à leur obligation de diligenter des enquêtes effectives dans le cas d’allégations de maltraitances subies dans les établissements de détention provisoire du Caucase du Nord (paragraphes 51-54 ci-dessus). En outre, elle note que le Gouvernement n’a pas précisé quelles seraient concrètement les démarches qu’il comptait entreprendre pour s’assurer du respect des engagements des autorités russes, ni si ses services diplomatiques avaient déjà coopéré par le passé avec les autorités russes dans des cas similaires d’extradition vers le Caucase du Nord.
95. La Cour observe par ailleurs que le tribunal interne de deuxième instance s’est appuyé exclusivement sur ces mêmes assurances données par les autorités russes pour autoriser l’extradition du requérant : la question de savoir si ce dernier encourrait un risque sérieux et avéré de subir des maltraitances dans son pays d’origine a été traitée de manière insuffisante dans la décision de cette juridiction (paragraphe 31 ci-dessus). La Cour est cependant d’avis que, dans le cadre d’une procédure d’extradition, l’appréciation du risque pour la personne concernée de subir des maltraitances dans son pays d’origine est une question essentielle qui mérite une attention particulière de la part des tribunaux internes. Il apparaît que tel n’a pas été le cas en l’occurrence et que le requérant a été privé des garanties requises par l’article 3 de la Convention (voir paragraphes 74 à 82 ci-dessus, avec les références).
96. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant encourt un risque sérieux et avéré d’être soumis à la torture ou d’autres traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Dès lors, la mise à exécution de la décision de l’extrader vers la Fédération de Russie emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
M.V. ET M.T. c. FRANCE du 4 septembre 2014 requête 17897/09
Violation de l'article 3 : Renvoyer des tchétchènes en Fédération de Russie est un acte inhumain et dégradant.
a) Principes généraux
35. La Cour se réfère aux principes applicables en la matière (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
36. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269).
37. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
38. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996 V).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
39. Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, la Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir I. c. Suède, précité, § 58). Au vu des rapports internationaux précités (voir paragraphes 23 à 25), la Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion et considère donc que la protection offerte par l’article 3 ne peut entrer en jeu que si les requérants sont en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils présenteraient un intérêt tel pour les autorités qu’ils seraient susceptibles d’être détenus et interrogés par celles-ci à leur retour. Ainsi, elle doit déterminer si le renvoi des requérants en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
40. À cet égard, la Cour note qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles (voir paragraphe 23 à 25). La Cour estime en conséquence que l’appréciation du risque pour les requérants doit se faire sur une base individuelle mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités.
41. En l’espèce, les requérants allèguent avoir été exposés aux représailles des milices de Kadyrov, après avoir aidé l’un des membres de leur famille appartenant à la rébellion tchétchène, et être toujours recherchés par les autorités.
42. La Cour constate que les requérants présentent un récit suffisamment circonstancié, crédible au regard des données internationales disponibles et étayé par de nombreuses pièces documentaires. La Cour relève que les documents produits, qui comprennent, entre autres, des certificats médicaux, une convocation invitant le requérant à se présenter au bureau de recrutement du district d’Atchkhoï-Martan le 20 février 2009 pour y effectuer les démarches liées à son service militaire, une convocation à se présenter le 22 février 2012 auprès du « juge d’instruction » pour y être interrogé en qualité de suspect et plusieurs témoignages, tendent à corroborer les faits exposés. Elle note toutefois les réserves émises par le Gouvernement au regard des nombreux examens de leur situation dont ont bénéficié les requérants devant les juridictions internes, ainsi que ses doutes quant à l’authenticité des documents en la possession du requérant et les incohérences qu’il relève dans le récit fourni.
43. La Cour relève d’emblée que les éléments apportés par le requérant – tant son récit que les preuves documentaires – furent écartés par les autorités au moyen de motivations succinctes. Lors de l’examen de leur demande d’asile initiale, l’OFPRA débouta les requérants au seul motif que leurs déclarations étaient peu circonstanciées et la CNDA fit de même parce qu’elle considérait que ni les pièces du dossier, ni les déclarations des requérants ne permettaient de tenir pour établis les faits rapportés et que l’aide ponctuelle apportée à un oncle ne pouvait justifier les craintes alléguées. Lors de la première demande de réexamen, les instances de l’asile se bornèrent à énoncer que les faits allégués n’étaient pas établis et qu’en particulier, les convocations de police produites n’énonçaient pas les motifs à l’origine de leur édiction. Enfin, lors de la seconde demande de réexamen, l’OFPRA indiqua que les éléments de preuve supplémentaires soumis n’étaient pas recevables. Les juridictions administratives se limitèrent, quant à elles, à se référer aux décisions des instances de l’asile pour écarter les risques allégués par les requérants en cas de renvoi. Il en résulte que la Cour ne trouve pas d’éléments suffisamment explicites dans ces motivations des instances nationales pour écarter le récit des requérants et rejeter leur demande (voir, en ce sens, K.K. c. France, no 18913/11, § 52, 10 octobre 2013 ; N.K. c. France, no 7974/11, § 45, 19 décembre 2013).
44. S’agissant des documents produits et, plus précisément, de ceux concernant l’état de santé du requérant, la Cour note que sont versés aux débats, outre le certificat médical d’un médecin généraliste français attestant de l’existence d’une pathologie du genou gauche, deux autres documents corroborant les sévices allégués : d’une part, une attestation de l’hôpital central d’Atchkhoï-Martan certifiant de l’hospitalisation du requérant pendant sept jours en avril 2008 pour, notamment, « endommagement des deux ménisques de l’articulation du genou gauche » et, d’autre part, un ordre de transfert du ministère de la Santé tchétchène orientant le requérant vers un autre établissement hospitalier (voir paragraphe 10). S’agissant de ce dernier document, la Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel il serait hautement improbable que les autorités aient remis au requérant un tel document. À cet égard, la Cour observe que la manière dont est intervenu le transfert du requérant d’un hôpital à un autre correspond à la pratique russe en la matière qui requiert, en cas de nécessité d’orienter un patient vers un établissement hospitalier situé dans une autre région, l’intervention du ministère de la Santé compétent, entité totalement indépendante des autres ministères de la région. La Cour souligne ensuite que le document litigieux indique uniquement que le requérant doit être transféré dans une autre structure hospitalière « pour consultation et, si besoin, pour un traitement stationnaire », et ne précise nullement la cause du séjour à l’hôpital du requérant et, encore moins, l’implication des autorités à cet égard. Elle ne saurait dès lors considérer que l’ordre de transfert incrimine les autorités et, partant, qu’il est surprenant que le requérant soit en possession de celui-ci.
45. La Cour relève, par ailleurs, que, pour prouver l’intérêt persistant des autorités à son égard, le requérant produit, outre des témoignages, une convocation du bureau de recrutement d’Atchkhoï-Martan en vue de l’accomplissement de son service militaire et une convocation pour un interrogatoire. Si la Cour accepte l’argument du Gouvernement selon lequel le premier document ne peut, en lui-même, suffire à justifier de l’existence de risques de mauvais traitements en cas de retour du requérant dans son pays d’origine, elle considère néanmoins que celui-ci doit être apprécié à la lumière de l’allégation, non contestée, du requérant selon laquelle il aurait déjà effectué son service militaire et, ainsi, qu’il peut être un indice de la volonté des autorités de retrouver le requérant. S’agissant du second document, la Cour observe qu’il n’est effectivement pas daté et qu’il ne contient pas le motif à l’origine de la convocation du requérant en qualité de suspect. Elle rappelle cependant qu’une telle convocation est un acte procédural qui a pour unique objet d’assurer la présence de la personne concernée auprès du « juge d’instruction » le jour dit, qu’elle n’a en elle-même aucune autre valeur juridique et, partant, qu’elle n’est pas encadrée par un formalisme excessif. De la sorte, la Cour estime que l’absence relevée par le Gouvernement de certaines mentions sur la convocation ne prive pas celle-ci de sa force probante.
46. S’agissant enfin des incohérences prétendues dans le récit des requérants, la Cour observe que la seule qui a été signalée par le Gouvernement a trait à la date de leur mariage. Or, à ce sujet, elle estime convaincante l’explication donnée par les requérants selon lesquels leur mariage a été célébré deux fois, la première de manière traditionnelle et la seconde auprès des autorités de l’État.
47. La Cour estime, au vu du profil marqué des requérants, des documents par eux produits et de la situation passée et actuelle en Tchétchénie, qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel que ceux-ci soient soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités russes en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi. Elle constate également qu’aucune des instances nationales n’a fait état, dans le cadre des décisions rendues à l’égard des requérants, d’éléments suffisamment explicites et détaillés permettant d’infirmer cette conclusion.
48. Il s’ensuit, pour la Cour, qu’un renvoi des requérants vers la Fédération de Russie emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
Grande Chambre PAPOSHVILI c. BELGIQUE du 13 décembre 2016 requête 41738/19
Article 3, l'expulsion vers la Géorgie du requérant aurait été un acte inhumain et dégradant car atteint d'une leucémie, il n'aurait pas pu être soigné. Il est aujourd'hui décédé
1. Principes généraux
172. La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (N. c. Royaume-Uni, précité, § 30). Dans le contexte de l’article 3, cette jurisprudence a été formulée pour la première fois dans l’affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni (30 octobre 1991, § 102, série A no 215).
173. L’expulsion d’un étranger par un État contractant peut toutefois soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Saadi, précité, § 125, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 365, Tarakhel, précité, § 93, et F.G. c. Suède, précité, § 111).
174. L’interdiction faite par l’article 3 de la Convention ne vise pas tous les mauvais traitements. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (N. c. Royaume-Uni, précité, § 29 ; voir aussi, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 219, Tarakhel, précité, § 94, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 86, CEDH-2015).
175. La Cour rappelle en outre avoir jugé que la souffrance due à une maladie survenant naturellement peut relever de l’article 3 si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte de conditions de détention, d’une expulsion ou d’autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (Pretty, précité, § 52). Pour autant, il ne lui est pas interdit d’examiner le grief d’un requérant au titre de l’article 3 lorsque le risque que celui-ci subisse des traitements interdits dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce pays (D. c. Royaume-Uni, précité, § 49).
176. La Cour s’est appuyée sur les principes généraux rappelés ci-dessus (paragraphes 172-174) dans deux affaires concernant l’expulsion par le Royaume-Uni de ressortissants étrangers gravement malades. Dans ces deux affaires, la Cour est partie du postulat selon lequel les étrangers qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un État contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’État de renvoi (D. c. Royaume-Uni, précité, § 54, et N. c. Royaume-Uni, précité, § 42).
177. Dans l’affaire D. c. Royaume-Uni précitée, qui concernait la décision prise par les autorités britanniques d’expulser vers Saint-Kitts un étranger malade du sida, la Cour a considéré que cet éloignement exposerait le requérant à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses et constituerait un traitement inhumain (D. c. Royaume-Uni, précité, § 53). Elle a jugé que l’affaire était marquée par des « circonstances très exceptionnelles », à savoir que le requérant souffrait d’une maladie incurable, qu’il était parvenu au stade terminal de sa maladie, qu’il n’était pas certain qu’il puisse bénéficier à Saint-Kitts de soins médicaux ou infirmiers et qu’il ait là-bas un parent désireux ou en mesure de s’occuper de lui ou d’autres formes de soutien moral ou social (ibidem, §§ 52-53). Considérant que, dans ces conditions, ses souffrances atteindraient le minimum de gravité requis par l’article 3, la Cour a conclu que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre l’expulsion du requérant (ibidem, § 54).
178. Dans l’affaire N. c. Royaume-Uni qui concernait l’éloignement d’une ressortissante ougandaise malade du sida vers son pays d’origine, examinant le point de savoir si les circonstances de l’espèce atteignaient la gravité requise par l’article 3 de la Convention, la Cour a rappelé que ni le fait d’ordonner l’expulsion d’un étranger atteint d’une maladie grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie étaient inférieurs à ceux disponibles dans l’État partie, ni le fait que l’intéressé connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, ne constituaient en soi des circonstances « exceptionnelles » suffisantes pour emporter violation de l’article 3 (N. c. Royaume-Uni, précité, § 42). Il faut en effet se garder, selon la Cour, de compromettre le juste équilibre inhérent à l’ensemble de la Convention entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Conclure le contraire reviendrait à faire peser sur les États une charge trop lourde en leur faisant obligation de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (ibidem, § 44). En revanche, il fallait avoir égard au fait que l’état de la requérante n’était pas critique et était stable grâce au traitement antirétroviral dont elle bénéficiait au Royaume-Uni, qu’elle était apte à voyager et que son état ne se détériorerait pas tant qu’elle continuerait à prendre le traitement dont elle avait besoin (ibidem, § 47). La Cour a considéré qu’il fallait également tenir compte du fait que l’appréciation de la rapidité avec laquelle l’état de la requérante se dégraderait dans son pays de destination et de la mesure dans laquelle elle pourrait y obtenir un traitement médical, un soutien et des soins, y compris l’aide de proches parents, comportait nécessairement une part de spéculation, eu égard en particulier à l’évolution constante de la situation en matière de traitement du sida dans le monde (ibidem, § 50). La Cour a conclu que la mise à exécution de la décision d’expulser la requérante n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention (ibidem, § 51). Elle a toutefois précisé qu’à côté des situations de décès imminent envisagées dans l’affaire D. c. Royaume-Uni, il pouvait exister d’autres cas très exceptionnels d’éloignement dans lesquels pouvaient entrer en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses s’opposant à l’éloignement des intéressés (D. c. Royaume-Uni, précité, § 43). L’examen de la jurisprudence postérieure à l’arrêt N. c. Royaume-Uni n’a révélé aucun exemple dans ce sens.
179. La Cour a appliqué la jurisprudence N. c. Royaume-Uni pour déclarer irrecevables pour défaut manifeste de fondement de nombreuses requêtes soulevant des questions du même ordre – qu’il s’agisse d’étrangers malades du sida (voir, parmi d’autres, E.O. c. Italie (déc.), no 34724/10, 10 mai 2012) ou souffrant d’autres pathologies graves, physiques (voir, parmi d’autres, V.S. et autres c. France (déc.), no 35226/11, 25 novembre 2014) ou mentales (voir, parmi d’autres, Kochieva et autres c. Suède (déc.), no 75203/12, 30 avril 2013, et Khachatryan c. Belgique (déc.), no 72597/10, 7 avril 2015). Plusieurs arrêts ont appliqué cette jurisprudence à l’éloignement de personnes gravement malades dont la maladie était sous contrôle grâce à l’administration des médicaments dans l’État contractant concerné et qui étaient aptes à voyager (voir Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, 20 décembre 2011, S.H.H. c. Royaume-Uni, no 60367/10, 29 janvier 2013, Tatar, précité, et A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015).
180. Toutefois, dans l’arrêt Aswat c. Royaume-Uni (no 17299/12, § 49, 16 avril 2013), la Cour est parvenue à une conclusion différente, estimant que l’extradition du requérant vers les États-Unis, où il était poursuivi pour activités terroristes, aurait entraîné un mauvais traitement, en particulier parce que les conditions de détention dans la prison de très haute sécurité où il serait incarcéré risquaient d’aggraver son état de schizophrénie paranoïaque. La Cour a jugé que le risque de détérioration significative de l’état de santé mentale et physique du requérant était suffisant pour enfreindre l’article 3 de la Convention (ibidem, § 57).
181. La Cour déduit de ce rappel de jurisprudence que l’application de l’article 3 de la Convention aux seules expulsions de personnes se trouvant au seuil de la mort, comme elle l’a fait depuis l’arrêt N. c. Royaume-Uni, a eu pour effet de priver les étrangers gravement malades ne se trouvant pas dans un état aussi critique du bénéfice de cette disposition. Corrélativement, la jurisprudence postérieure à N. c. Royaume-Uni n’a fourni aucune indication plus précise au sujet des « cas très exceptionnels » visés dans l’arrêt N. c. Royaume-Uni, autres que celui envisagé par l’arrêt D. c. Royaume-Uni.
182. À la lumière de ce qui précède, et rappelant qu’il est essentiel que la Convention soit interprétée et appliquée d’une manière qui rende les garanties qu’elle contient concrètes et effectives et non pas théoriques et illusoires (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121, CEDH 2005-I, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 175, CEDH 2012), la Cour est d’avis qu’il y a lieu de clarifier l’approche suivie jusqu’à présent.
183. La Cour estime qu’il faut entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever, au sens de l’arrêt N. c. Royaume-Uni (§ 43), un problème au regard de l’article 3 les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. La Cour précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades.
184. Quant au point de savoir si ces conditions sont remplies dans un cas d’espèce, la Cour rappelle que dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un étranger, la Cour se garde d’examiner elle-même les demandes de protection internationale ou de contrôler la manière dont les États contrôlent l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. En vertu de l’article 1 de la Convention, ce sont en effet les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis et qui sont, à ce titre, tenues d’examiner les craintes exprimées par les requérants et d’évaluer les risques qu’ils encourent en cas de renvoi dans le pays de destination au regard de l’article 3. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 286-287, et F.G. c. Suède, précité, §§ 117-118).
185. En conséquence, dans ce type d’affaires, l’obligation de protéger l’intégrité des intéressés que l’article 3 fait peser sur les autorités s’exécute en premier lieu par la voie de procédures adéquates permettant un tel examen (voir, mutatis mutandis, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 182, CEDH 2012, Tarakhel, précité, § 104, et F.G. c. Suède, précité, § 117).
186. Dans le cadre de celles-ci, il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (Saadi, précité, § 129, et F.G. c. Suède, précité, § 120). Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et qu’il ne s’agit pas d’exiger des intéressés qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu’ils seront exposés à des traitements prohibés (voir, notamment, Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 130, CEDH 2014 (extraits)).
187. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l’État de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (voir Saadi, précité, § 129, et F.G. c. Suède, précité, § 120). L’évaluation du risque allégué doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux (Saadi, précité, § 128, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 214, 28 juin 2011, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 116, et Tarakhel, précité, § 104) à l’occasion duquel les autorités de l’État de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé (Vilvarajah et autres, précité, § 108, El-Masri, précité, § 213, et Tarakhel, précité, § 105). L’évaluation du risque tel que défini ci-dessus (paragraphes 183-184) implique donc d’avoir égard à des sources générales telles que les rapports de l’Organisation mondiale de la santé ou les rapports d’organisations non gouvernementales réputées, ainsi qu’aux attestations médicales établies au sujet de la personne malade.
188. Ainsi que la Cour l’a rappelé ci-dessus (voir paragraphe 173), se trouve en jeu ici l’obligation négative de ne pas exposer quelqu’un à un risque de mauvais traitements prohibés par l’article 3. Il s’ensuit que les conséquences du renvoi sur l’intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait le sien dans l’État de destination après y avoir été envoyé.
189. S’agissant des facteurs à prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l’État de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l’intéressé afin d’éviter qu’il soit exposé à un traitement contraire à l’article 3 (voir paragraphe 183, ci‑dessus). Le paramètre de référence n’est pas le niveau de soins existant dans l’État de renvoi ; il ne s’agit pas, en effet, de savoir si les soins dans l’État de destination seront équivalents ou inférieurs à ceux qu’offre le système de santé de l’État de renvoi. Il ne saurait pas non plus être déduit de l’article 3 un droit à bénéficier dans l’État de destination d’un traitement particulier qui ne serait pas disponible pour le reste de la population.
190. Les autorités doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans l’État de destination. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné l’accessibilité des soins (Aswat, précité, § 55, et Tatar, précité, §§ 47-49) et évoqué la prise en considération du coût des médicaments et traitements, l’existence d’un réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux soins requis (Karagoz c. France (déc.), no 47531/99, 15 novembre 2001, N. c. Royaume-Uni, précité, §§ 34-41 et références citées, et E.O. c. Italie (déc.), précitée).
191. Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant à l’impact de l’éloignement sur les intéressés – en raison de la situation générale dans l’État de destination et/ou de leur situation individuelle – il appartient à l’État de renvoi d’obtenir de l’État de destination, comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation contraire à l’article 3 (sur l’obtention d’assurances individuelles, voir Tarakhel, précité, § 120).
192. La Cour tient à préciser qu’en cas d’éloignement de personnes gravement malades, le fait qui provoque le traitement inhumain et dégradant et engage la responsabilité de l’État de renvoi au regard de l’article 3, n’est pas le manquement par l’État de destination à disposer d’infrastructures médicales. N’est pas davantage en cause une quelconque obligation pour l’État de renvoi de pallier les disparités entre son système de soins et le niveau de traitement existant dans l’État de destination, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. La responsabilité sur le terrain de la Convention qui se trouve engagée dans des cas de ce genre est celle de l’État de renvoi du chef d’un acte, en l’occurrence l’expulsion, qui aurait pour résultat d’exposer quelqu’un à un risque de traitement prohibé par l’article 3.
193. Enfin, la circonstance que l’État tiers soit un État partie à la Convention n’est pas déterminante. Tout en considérant, comme le soutient le Gouvernement, que la possibilité qu’aurait eue le requérant de mettre en mouvement une procédure à son retour en Géorgie était en principe la voie la plus normale dans le cadre du système mis en place par la Convention, la Cour rappelle que les autorités de l’État de renvoi ne sont pas dispensées, pour cette raison, de leurs obligations préventives au titre de l’article 3 de la Convention (voir, parmi d’autres, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 357-359, et Tarakhel, précité, §§ 104-105).
2. Application des principes généraux à la présente espèce
194. Il n’est pas contesté que le requérant était atteint d’une maladie très grave, une leucémie lymphoïde chronique, et que son pronostic vital était engagé.
195. Le requérant a fourni des informations médicales détaillées. Celles‑ci émanaient du docteur L., médecin spécialisé dans le traitement de la leucémie et responsable d’un service d’hématologie au sein d’un hôpital entièrement consacré aux maladies cancéreuses. D’après ces informations, l’état de santé du requérant était stabilisé grâce au traitement dont il bénéficiait en Belgique. Il s’agissait d’un traitement très ciblé dont l’objectif était de lui permettre d’accéder à une allogreffe qui était la dernière option curative possible, à condition d’être réalisée dans des délais assez brefs. Si le traitement dont bénéficiait le requérant avait dû être interrompu, son espérance de vie moyenne aurait été inférieure à six mois (voir paragraphe 46, ci-dessus).
196. Le médecin conseil de l’OE avait souligné, dans un rapport du 23 juin 2015, que les informations médicales relatives au requérant ne mettaient pas en évidence de menace directe pour sa vie, ni qu’il aurait été dans un état de santé critique (voir paragraphe 68, ci-dessus).
197. Le requérant faisait valoir que, d’après les informations à la disposition du docteur L., le traitement dont il bénéficiait en Belgique et l’allogreffe n’étaient pas disponibles en Géorgie. Quant aux autres formes de traitement de la leucémie disponibles en Géorgie, il soutenait qu’il n’avait aucune garantie d’y avoir accès, en raison des défaillances du système géorgien d’assurance sociale (voir paragraphe 141, ci-dessus). De l’avis de la Cour, ces affirmations ne sont pas denuées de toute crédibilité.
198. La Cour constate que, le 10 septembre 2007 et le 2 avril 2008, le requérant a fait deux demandes d’autorisation de régularisation de son séjour en Belgique pour raisons médicales en vertu de l’article 9ter de la loi sur les étrangers (voir paragraphes 54 et 59, ci-dessus). Les demandes étaient fondées principalement sur la nécessité d’un traitement adéquat de sa leucémie et sur le postulat qu’il n’aurait pu bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Géorgie.
199. Les 26 septembre 2007 et 4 juin 2008 respectivement, ces demandes de régularisation ont été rejetées par l’OE qui considéra que le requérant était exclu du bénéfice de l’article 9ter de la loi en raison des crimes graves qu’il avait commis (voir paragraphes 55 et 60 ci-dessus). Saisi de recours en suspension et en annulation contre ces décisions, le CCE jugea, par des arrêts du 28 août 2008 et du 21 mai 2015, que, lorsque l’autorité administrative invoquait un motif d’exclusion, il n’y avait pas lieu d’examiner les éléments médicaux soumis à son appréciation. En outre, s’agissant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention, le CCE nota que la décision de refus de séjour n’était pas assortie d’une mesure d’éloignement du territoire, de sorte que le risque d’interruption du traitement médical en cas de retour en Géorgie était de nature purement hypothétique (voir paragraphes 57 et 62, ci-dessus). Le Conseil d’État, saisi d’un recours en cassation, confirma le raisonnement du CCE et précisa que l’évaluation de la situation médicale d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et dont l’autorisation de séjour avait été rejetée devait se faire au moment de l’exécution forcée de cette mesure et non au moment où elle avait été décidée (voir paragraphe 64 ci-dessus).
200. La Cour déduit de ce qui précède que, même si le médecin conseil de l’OE avait rendu plusieurs avis à propos de l’état de santé du requérant basés sur les attestions médicales fournies par ce dernier (voir paragraphes 67-68 ci-dessus), ceux-ci n’ont été examinés ni par l’OE ni par le CCE au regard de l’article 3 de la Convention dans le cadre de la procédure de régularisation pour raisons médicales.
201. La situation médicale du requérant n’a pas davantage été examinée dans le cadre des procédures d’éloignement menées contre lui (voir paragraphes 73, 78 et 84 ci-dessus).
202. À elle seule, la circonstance qu’une telle évaluation aurait pu être effectuée in extremis au moment de l’exécution forcée de la mesure d’éloignement (voir paragraphe 199 in fine, ci-dessus), ne répond pas à ces préoccupations, en l’absence d’indications quant à l’étendue d’un tel examen et quant à ses effets sur la nature exécutoire de l’ordre de quitter le territoire.
203. Il est vrai qu’à l’audience du 15 septembre 2015, le gouvernement belge a assuré que dans l’hypothèse où il aurait finalement été décidé de procéder à une allogreffe en Belgique, les autorités belges n’auraient pris aucune disposition pour l’en empêcher ou éloigner le requérant alors qu’il était à l’hôpital. La Cour prend acte de cette déclaration.
204. De plus, selon le Gouvernement, il aurait pu être envisagé que la continuité du traitement dont bénéficiait le requérant ait été assurée par le biais d’envois postaux sous le contrôle de son médecin traitant et avec l’assistance de médecins géorgiens. Toutefois, le Gouvernement n’a pas fourni d’éléments concrets relatifs à la faisabilité pratique d’une telle solution.
205. En conclusion, la Cour estime qu’en l’absence d’évaluation par les instances nationales du risque encouru par le requérant à la lumière des données relatives à son état de santé et à l’existence de traitements adéquats en Géorgie, les éléments d’information dont disposaient ces instances ne suffisaient pas à leur permettre de conclure qu’en cas de renvoi vers la Géorgie, le requérant n’aurait pas couru de risque concret et réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir paragraphe 183, ci-dessus).
206. Il s’ensuit que, si le requérant avait été éloigné vers la Géorgie sans évaluation de ces données, il y aurait eu violation de l’article 3.
207. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 2 de la Convention.
S c. FRANCE du 6 octobre 2022 Requête no 18207/21)
Art 3 • Expulsion • Absence d’une appréciation ex nunc par les autorités de la situation personnelle du requérant tchéchène au regard du risque encouru allégué en cas de renvoi vers la Fédération de Russie
CEDH
RECEVABILITE
79. En premier lieu, la Cour relève que la procédure d’avis devant la CNDA, instituée par les dispositions de l’article L. 731-3 du CESEDA dans leur rédaction applicable en l’espèce (voir paragraphe 43 ci-dessus), a certes un effet suspensif de l’éloignement mais que cet effet ne perdure toutefois que jusqu’au moment où la CNDA rend son avis. Ainsi que l’indiquent les dispositions de l’article R. 733-40 du CESEDA (voir paragraphe 44 ci-dessus), l’avis est transmis sans délai au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé de l’asile. L’administration n’est toutefois pas liée par cet avis et peut décider de mettre à exécution la décision d’éloignement. Il en résulte que cette procédure ne peut être regardée comme ayant pour effet direct d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement vers un pays donné. Elle ne peut donc être considérée comme présentant l’effectivité requise qui impliquerait d’imposer son épuisement au requérant avant toute saisine de la Cour (R c. France, no 49857/20, § 86, 30 août 2022, non définitif).
80. En deuxième lieu, la Cour, écartant l’argument du Gouvernement selon lequel le référé-liberté et le référé-suspension auraient un effet suspensif en « pratique », a déjà jugé que ces deux recours n’étaient pas des voies de recours effectives pour faire valoir un grief tiré de l’article 3 de la Convention en l’absence d’un effet suspensif de plein droit (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, §§ 65-67, CEDH 2007-II).
81. En l’espèce, laissant de côté les demandes d’asile puis de réexamen dans lesquelles le requérant a exposé ses craintes en cas de retour en Russie, le requérant a fait un recours en annulation contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le requérant a donc utilisé au moins une voie de droit apparemment effective et suffisante, il ne saurait donc se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui ne présentaient guère plus de chances de succès et étaient dépourvues en droit de caractère suspensif.
82. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes prévues par l’article 35 § 1 de la Convention. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception du Gouvernement. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
ARTICLE 3
Principes généraux
Le caractère absolu des obligations découlant de l’article 3
96. La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 111, 23 mars 2016)
97. La Cour souligne qu’elle a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Elle est de même parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent actuellement les États pour protéger leur population de la violence terroriste (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 137, CEDH 2008, et K.I. c. France, précité, § 118). Devant une telle menace, elle considère qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner (O.D. c. Bulgarie, no 34016/18, § 45, 10 octobre 2019, et K.I. c. France, précité, § 118).
98. Il convient toutefois de rappeler que la protection offerte par l’article 3 de la Convention présente un caractère absolu. Pour qu’un éloignement forcé envisagé soit contraire à la Convention, la condition nécessaire – et suffisante – est que le risque pour la personne concernée de subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 3 soit réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés, même lorsqu’elle est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale pour l’État contractant (Saadi, précité, §§ 140‑141 et K.I. c. France, précité, § 119). En effet, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V et J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 77, 23 août 2016). Il en est de même y compris dans l’hypothèse où le requérant a des liens avec une organisation considérée comme terroriste (K.I. c. France, précité, § 119).
Date de l’appréciation par la Cour
99. Lorsque le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour. Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive. Dès lors que la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les États contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment du renvoi. Cette réserve montre que le principe de l’évaluation ex nunc a pour finalité principale de fournir une garantie lorsqu’un laps de temps notable s’est écoulé entre l’adoption de la décision interne et l’examen par la Cour du grief de violation de l’article 3 exposé par le requérant, et donc lorsque la situation dans le pays de destination a peut-être évolué en ce qu’elle se serait détériorée ou améliorée (Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, § 107, 29 avril 2022).
100. La Cour souligne que, dans des affaires de ce type, tout constat relatif à la situation générale dans un pays donné et à sa dynamique ainsi que tout constat relatif à l’existence de tel ou tel groupe vulnérable procède par essence d’une appréciation factuelle ex nunc à laquelle elle se livre sur la base des éléments disponibles (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 107).
Champ de l’appréciation : situation générale et circonstances individuelles
101. L’arrêt de Grande Chambre Khasanov et Rakhmanov (précité), expose la méthodologie à suivre pour l’appréciation du risque de mauvais traitements en cas d’éloignement d’étrangers.
102. En particulier, l’appréciation du risque doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres à l’intéressé. Il faut rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Si l’existence d’un tel risque est établie, le renvoi du requérant emporterait nécessairement violation de l’article 3, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 95).
103. Le point de départ dans cette démarche est l’analyse de la situation générale dans le pays de destination. À cet égard, et s’il y a lieu, la Cour examinera s’il existe une situation générale de violence dans ce pays. Toutefois, une situation générale de violence n’est en principe pas à elle seule de nature à entraîner une violation de l’article 3 en cas d’expulsion vers le pays en question, sauf si la violence est d’une intensité telle que tout renvoi dans ce pays emporterait une pareille violation. La Cour n’adopterait pareille approche que dans les cas de violence générale les plus extrêmes où l’intéressé courrait un risque réel de subir des mauvais traitements du seul fait que son retour dans le pays en question l’exposerait à cette violence (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 96).
104. Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à des mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, éventuellement en s’appuyant sur les sources disponibles, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la pratique en question existe et qu’il appartient au groupe visé (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 97).
105. Les allégations de cette nature ne s’apprécient pas de la même façon que, d’une part, celles se rapportant à une situation générale de violence dans tel ou tel pays et, d’autre part, celles se rapportant aux circonstances individuelles (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 98).
106. La première étape de cette démarche consiste à examiner si l’existence d’un groupe systématiquement exposé à des mauvais traitements a été établie, question qui relève du volet de l’analyse du risque consacré à la « situation générale ». Les requérants qui appartiendraient à un groupe vulnérable ciblé doivent évoquer non pas la situation générale mais l’existence d’une pratique ou d’un risque accru de mauvais traitements visant le groupe auquel ils disent appartenir. L’étape suivante consiste pour eux à établir qu’ils appartiennent chacun au groupe concerné, sans qu’ils aient besoin de faire état d’autres circonstances individuelles ou caractéristiques distinctives (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 99).
107. Dans les cas où, nonobstant l’existence d’une crainte de persécutions pouvant être bien fondée en raison de certaines circonstances aggravant les risques, on ne peut pas établir qu’un groupe est systématiquement exposé à des mauvais traitements, les requérants sont tenus de démontrer l’existence d’autres caractéristiques distinctives particulières qui les exposeraient à un risque réel de mauvais traitements, faute de quoi la Cour conclura à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 100).
b) Application au cas d’espèce
Sur la situation générale prévalant dans la région du Nord Caucase
108. Concernant la situation générale dans la région du Nord-Caucase, la Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (K.I. c. France, précité, § 126 et, R c. France, précité, § 121, non définitif).
109. De plus, au vu des rapports internationaux précités (voir paragraphes 53-67 ci‑dessus), la Cour ne voit pas de raison de remettre en cause une telle conclusion et considère que la protection offerte par l’article 3 de la Convention ne peut entrer en jeu que si le requérant est en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire que son renvoi en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de traitements regardés comme prohibés par l’article 3 de la Convention.
Sur la situation des personnes considérées comme des membres de la lutte armée de la résistance tchétchène et des personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits de terrorisme
110. La Cour estime que quand bien même il ressort des rapports précités que peuvent être particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre, les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles ainsi que les personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits de terrorisme (K.I. c. France, précité § 127), elle n’est pas d’avis qu’il s’agirait de groupes systématiquement exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, notamment pour la dernière catégorie évoquée (R c. France, précité, § 122, non définitif).
111. La Cour estime en conséquence que l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle tout en gardant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées peuvent être plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention des autorités (R c. France, précité, § 123, non définitif).
Sur la situation personnelle du requérant
112. À titre préliminaire, comme le relève le Gouvernement, en l’espèce la CNDA a confirmé la décision d’irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant, rendue par l’OFPRA le 31 mai 2017, à l’issue d’une procédure en révision pour fraude. Dans sa décision du 28 juin 2019 (voir paragraphe 14 ci-dessus), la CNDA a déclaré nulle et non avenue la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant en date du 12 février 2018. La présente affaire se distingue donc de l’affaire K.I. c. France, précitée, portant sur un retrait du statut de réfugié en application de l’article L. 711-6 CESEDA alors applicable. Le requérant ne saurait se prévaloir de cette qualité de réfugié.
113. La Cour rappelle que les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant puisqu’elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (F.G. c. Suède, précité, § 118).
114. En l’espèce, la Cour constate que si la fraude commise pouvait être légitimement sanctionnée, la question de savoir si le requérant risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention demeure distincte compte tenu du caractère absolu des droits garantis par cette disposition. À cet égard, la Cour relève que le 2 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours du requérant dirigé contre l’arrêté préfectoral fixant la Fédération de Russie comme pays de destination (voir paragraphe 20 ci‑dessus) après une analyse, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, des risques allégués par le requérant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, sans prendre en compte de rapports internationaux sur la situation dans le pays de renvoi. La Cour note que la cour administrative d’appel dans ses arrêts du 11 mars 2022 mentionne que « selon des rapports internationaux, les pratiques de mauvais traitements et de tortures par les forces de l’ordre dans la région du Caucase du Nord sont répandues ainsi que la violation des droits de l’homme » (voir paragraphes 29-30 ci-dessus).
115. Par ailleurs, le 28 juin 2019, la CNDA a rejeté son recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen de demande d’asile au terme de la procédure en révision initiée par l’OFPRA (voir paragraphe 14 ci-dessus). La Cour observe que, dans sa décision, la CNDA ne fait pas mention de la note de la DGSI à son attention en date du 6 mai 2019, note qu’elle a pourtant elle-même sollicitée. Le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d’appel de Nantes, ne font pas plus référence à cette note dans leurs décisions du 2 février 2021 et du 11 mars 2022. Cette note de la DGSI mentionne pourtant que « selon des informations issues de la coopération internationale », le requérant était un membre actif de l’organisation Émirat du Caucase ; qu’il a participé à des attaques contre les autorités russes et qu’une enquête pénale a été ouverte à son encontre pour des faits de « participation aux activités d’une formation armée illégale, de participation à une association criminelle, de trafic illégal d’armes, d’attentat à la vie contre un membre des forces pénales » (voir paragraphe 13 ci-dessus). Si le requérant nie les informations contenues dans cette note, et en particulier le fait d’avoir été un combattant, il affirme devant la Cour avoir vécu pendant trois ans au sein d’un campement rebelle (voir paragraphe 4 ci-dessus).
116. En outre, la note des renseignements français précitée précise que les informations contenues dans cette note sont issues de la « coopération internationale » sans que la source précise des informations ne soit mentionnée. À cet égard, la Cour note que le requérant est inscrit sur la liste de personnes impliquées dans des activités de terrorisme établie par l’organisme Rosfinmonitoring, service d’intelligence en matière financière des autorités russes (voir paragraphe 68 ci-dessus). Bien que porté à sa connaissance dans le recours contre la décision du tribunal administratif du 2 février 2021, la cour administrative d’appel ne semble pas prendre en compte cet élément dans ses arrêts du 11 mars 2022 (voir paragraphes 29-30 ci‑dessus).
117. D’autre part, la demande de laissez-passer consulaire établie par les autorités françaises et à destination des autorités russes, porte la mention suivante « individu signalé. Prévoir escorte » (voir paragraphe 19 ci-dessus). La Cour relève également que le requérant a versé une attestation de l’organisation Memorial établie le 20 décembre 2016 faisant état d’un entretien entre un membre de cette organisation et le père du requérant. Cette attestation rapporte, entre autres, la détention du requérant, accusé d’avoir participé à une organisation terroriste, son séjour au sein d’un campement illégal, les multiples perquisitions au domicile familial, la fuite du territoire russe du requérant, ainsi que l’actualité des recherches le visant (voir paragraphe 9 ci-dessus). Cette attestation doit toutefois être lue en tenant compte de ce que le requérant avait déjà produit un autre document similaire préparé par une ONG qui s’est révélé peu fiable (voir paragraphe 14 ci‑dessus).
118. Enfin, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le fait que le requérant puisse présenter un profil correspondant à l’une des catégories particulièrement à risque doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion (K.I. c. France, précité, § 127). Or, si la cour administrative d’appel a relevé cette circonstance dans les écritures du requérant, elle ne semble pas l’avoir examiné expressément (voir paragraphes 29-30 ci‑dessus).
119. En conclusion, et eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il y aurait une violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en l’absence d’une appréciation ex nunc par les autorités françaises du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
ZARMAYEV c. BELGIQUE du 27 février 2014 Requête 35/10
L'extradition pour meurtre vers la Tchtchenie n'est pas une violation de la Convention
i. Principes généraux
Il est de jurisprudence constante que l’extradition d’une personne par un État partie à la Convention peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas extrader la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 88 et 91, série A no 161, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005‑I).
88. Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des données qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office. Pour apprécier l’existence de ce risque, dans un cas où l’extradition a effectivement eu lieu, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition, même si cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs. Toutefois, si l’extradition ne s’est pas produite au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 69).
89. En vue d’apprécier l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3, la Cour doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers l’État demandant l’extradition, compte tenu de la situation générale dans le pays en question et des circonstances propres au cas du requérant (comparer, en matière d’expulsion, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 108, série A no 215 ; Saadi, précité, § 130).
90. En ce qui concerne la situation générale dans un pays, la Cour a souvent attaché de l’importance aux informations contenues dans des rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme ou de sources gouvernementales (voir, Saadi, précité, § 131, et les références qui y sont citées). Cependant, lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 73 ; Saadi, précité, § 131).
91. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la décision accordant l’extradition était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (voir, mutatis mutandis, en matière d’expulsion, Saadi, précité, § 129).
92. En matière d’extradition, lorsque l’État requérant a fourni des assurances diplomatiques quant au respect des droits de l’homme à l’endroit du requérant, celles-ci constituent un facteur pertinent dont la Cour tient compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements : il faut vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera protégé contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (voir, mutatis mutandis, en matière d’expulsion, Saadi, précité, § 148 ; Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 187, CEDH 2012, extraits).
93. Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la Cour tient compte d’une série de facteurs qu’elle a récemment énumérés dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (précité, § 189) et auxquels elle renvoie pour les besoins de la présente espèce.
ii. Application des principes en l’espèce
94. En l’espèce, le requérant allègue qu’il serait poursuivi par les autorités russes pour d’autres raisons que celles qui sont à la base de la demande d’extradition, à savoir son passé d’ancien combattant au service de la cause tchétchène. S’il était extradé vers la Fédération de Russie, il risquerait d’être victime d’un procès truqué et d’être exposé, au cours de sa détention, aux traitements infligés aux anciens combattants tchétchènes détenus dans les prisons russes qui atteignent, selon lui, le seuil de gravité de l’article 3.
95. Le Gouvernement belge renvoie en substance à l’examen de la situation générale en Fédération de Russie et de la situation individuelle du requérant qui a été fait par les instances internes dans le cadre des procédures d’asile et d’extradition.
96. La Cour souligne, à titre préalable, qu’il n’est pas question dans la présente affaire d’expulser « simplement » le requérant vers la Tchétchénie. Si ce dernier est éloigné vers la Fédération de Russie, ce sera en réponse à une demande d’extradition. S’il est rendu aux autorités russes, il est possible qu’il soit maintenu en détention en attendant son procès, qu’il fasse l’objet d’une enquête et d’une poursuite, et qu’un procès soit ouvert contre lui. S’il est alors reconnu coupable et condamné, il est probable qu’il doive purger sa peine dans un centre de détention pour personnes condamnées. Il appartient donc à la Cour d’examiner les risques allégués par le requérant dans ce contexte spécifique.
97. La Cour prend note des conclusions des rapports émanant de sources internationales énumérés dans l’arrêt Bajsultanov précité (§§ 38 à 50) et faisant état d’atteintes graves et persistantes aux droits de l’homme, en particulier pour les personnes liées aux combattants tchétchènes. Ces rapports donnent des exemples de mauvais traitements infligés aux anciens combattants tchétchènes détenus dans les prisons russes.
98. La Cour ne saurait toutefois en déduire que la situation générale en Russie, et en particulier en Tchétchénie, soit suffisamment grave pour conclure que l’extradition de Tchétchènes emporterait en soi infraction de l’article 3 de la Convention (ibidem, § 67).
99. La Cour doit donc examiner la question de savoir si la situation personnelle du requérant est susceptible, en cas d’extradition, de l’exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants.
100. La Cour observe en premier lieu que le requérant fonde ses craintes sur son passé de combattant pour la cause tchétchène. Or, il a déposé quatre demandes d’asile et les instances d’asile belges ont examiné à plusieurs reprises et en détail les allégations du requérant liées à un tel passé. Elles ont toutefois considéré que la crédibilité de son récit était fortement sujette à caution. Outre la circonstance qu’il avait, une première fois, trompé les autorités belges pour obtenir l’asile sous une fausse identité, elles reprochent au requérant l’incohérence des faits à la base de ses demandes d’asile, le caractère contradictoire de ses déclarations ainsi que l’absence d’éléments de preuve venant étayer son implication personnelle dans les guerres en Tchétchénie. Les autorités compétentes en matière d’extradition se sont ralliées aux conclusions auxquelles sont parvenues les instances d’asile.
101. La Cour constate que la version des faits donnée par le requérant a fort évolué au fil du temps (voir paragraphes 9, 10, 12 et 13 ci-dessus) et relève que chaque fois que l’occasion s’est présentée, il a fourni une version, en tout ou en partie, différente de son parcours et des événements auxquels il aurait participé et a ajouté des informations qui ne s’articulent pas avec ses précédentes déclarations. Il en est de même du récit qu’il a donné à la Cour dans ses observations en réponse au Gouvernement (voir paragraphes 58 à 61 ci-dessus) qui mentionnent des faits et des événements très précis sur lesquels le requérant aurait à l’évidence pu s’appuyer auparavant devant les instances belges. Le fait que le requérant s’y réfère pour la première fois devant elle ne fait qu’ajouter au caractère invraisemblable de son passé de combattant.
102. La Cour remarque que la seule raison donnée par le requérant aux autorités belges pour expliquer les incohérences entre ses récits tient à ce qu’il aurait souffert d’un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il fut traité par voie médicamenteuse. Il en aurait résulté des problèmes de concentration et de mémoire. La Cour estime que les instances belges ont pu écarter cette explication, qui est manifestement insuffisante pour justifier lesdites incohérences et contradictions.
103. La Cour note les réserves émises par les instances d’asile sur la fiabilité des témoignages et lettres de soutien produits par le requérant au motif que vu le moment où ils avaient été recueillis, il était fortement probable qu’ils aient été sollicités par le requérant dans le seul but d’échapper à l’extradition. Devant la Cour, le requérant ne fournit pas d’explication à ce sujet. Dans ces circonstances, la Cour convient avec le Gouvernement que ces éléments ne viennent pas étayer en quoi le requérant aurait été impliqué personnellement dans les événements en Tchétchénie.
104. La circonstance que le requérant a reçu, durant son incarcération en Belgique, le soutien de parlementaires et d’organisations non gouvernementales ne change rien à ce constat.
105. La Cour observe encore qu’un certain laps de temps s’est écoulé depuis les événements qui, selon le requérant, auraient motivé son départ de la Fédération de Russie. Or le requérant ne fait aucunement état de ce qu’il aurait continué de susciter l’attention négative des autorités russes pour d’autres motifs que ceux de la demande d’extradition.
106. Ces considérations amènent la Cour à conclure qu’elle n’a aucune raison de s’écarter de l’analyse faite par les autorités belges selon laquelle il n’y a pas de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé en Fédération de Russie en tant qu’ancien combattant au service de la cause tchétchène et pour ce motif à un risque réel de mauvais traitements.
107. Reste que le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition aux fins de poursuite du chef d’un crime de droit commun et que la Cour doit également vérifier que, dans ce cadre, les autorités belges ne l’exposent pas à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention.
108. S’agissant tout d’abord de la possibilité invoquée par le requérant devant elle de condamnation à une peine à perpétuité, la Cour constate que les infractions pour lesquelles il est poursuivi en Fédération de Russie sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans (voir paragraphe 73 ci-dessus). Elle considère donc que le risque que le requérant soit condamné à la réclusion à perpétuité est exclu.
109. La Cour constate ensuite que les autorités de la Fédération de Russie ont fourni à leurs homologues belges plusieurs assurances précises quant au respect des droits de l’homme à l’égard du requérant.
110. La note diplomatique du 19 octobre 2009, qui transmettait à la Belgique la demande d’extradition, indiquait que la peine de mort n’était plus appliquée en Fédération de Russie et que le requérant ne serait pas soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou humiliants (voir paragraphe 36 ci-dessus). Sur invitation des autorités belges à fournir des assurances complémentaires à la suite de l’avis négatif rendu le 8 janvier 2010 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, le Parquet général de la Fédération de Russie, dans une lettre du 24 novembre 2010, garantit que, s’il était condamné, le requérant purgerait sa peine sur le territoire de la Fédération de Russie dans un établissement correctionnel du service de l’exécution des peines où les normes posées dans la Convention sont respectées. Si le requérant devait être détenu, l’ambassade de Belgique en Russie serait informée du lieu de détention pendant l’enquête ainsi qu’en cas de condamnation, et des personnes mandatées par la représentation diplomatique pourraient lui rendre visite et s’entretenir avec lui seul (voir paragraphe 43 ci-dessus).
111. La Cour constate que le ministre de la Justice puis le Conseil d’État ont conclu, après un examen approfondi et diligent de ces assurances et en se basant sur la jurisprudence de la Cour (Gasayev (déc.), précité, et Chentiev et Ibragimov (déc.), précité), qu’elles étaient suffisantes pour écarter le risque que le requérant subisse des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention.
112. En tenant compte de l’ensemble des facteurs énumérés dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) précité et en l’absence de tout élément pouvant la convaincre du contraire, la Cour ne saurait infirmer ces conclusions des instances internes et en particulier celles du Conseil d’État qui a soigneusement examiné les moyens du requérant invoqués dans le cadre de son recours en annulation de l’arrêté ministériel autorisant son extradition.
113. La Cour attache une importance particulière au fait que ces assurances émanent d’un État partie à la Convention qui s’est engagé à respecter les droits qui s’y trouvent garantis, parmi lesquels figure l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (Gasayev (déc.), précité, et Chentiev et Ibragimov (déc.), précité).
114. Pour autant que le requérant suggère que les autorités russes pourraient le poursuivre et le condamner pour d’autres raisons que celles sur lesquelles la demande d’extradition est fondée, la Cour note que l’extradition a été accordée par le ministre de la Justice belge pour la seule complicité de meurtre. Comme le souligne le Gouvernement, le requérant est protégé par le principe de spécialité inscrit dans l’article 14 de la Convention européenne d’extradition (voir paragraphe 72 ci-dessus), en vertu duquel il ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l’extradition (voir, dans le même sens, Salem c. Portugal (déc.), no 26844/04, 9 mai 2006, et Gökalp et Cardona Giraldo c. Pologne (déc.), nos 37286/09 et 2352/11, 11 septembre 2012).
115. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que l’extradition du requérant vers la Fédération de Russie n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.
ALLANAZAROVA c. RUSSIE du 14 février 2017 Requête no 46721/15
Violation des articles 3 et 13, la CEDH se soumet à la jurisprudence des institutions près de l'ONU et analyse les rapports des ONG pour constater que le Turkménistan est un État dangereux pour lequel, une demande d'extradition ne peut pas être accordée.
A. Institutions des Nations unies
1. Comité des droits de l’homme des Nations unies
a) Rapport périodique
41. Dans ses observations finales sur le Turkménistan en date du 28 mars 2012 (CCPR/C/SR.2887), le Comité des droits de l’homme, tout en se félicitant du dépôt par ce pays du rapport initial attendu depuis 1998, a relevé notamment les sujets de préoccupation suivants :
« 5. Le Comité accueille certes avec satisfaction l’adhésion au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la volonté exprimée par l’État partie de mettre en œuvre les constatations adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers, mais il relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme chargé de surveiller la suite donnée aux constatations du Comité et que l’État partie n’a pas assez mis en œuvre les décisions concernant des communications de façon satisfaisante (art. 2). (...)
7. Le Comité note la création de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme, mandaté pour agir en tant qu’institution nationale des droits de l’homme, mais il craint que l’Institut, qui fait partie du Cabinet du Président, ne soit pas indépendant (art. 2). (...)
9. Le Comité est préoccupé par le nombre en augmentation de plaintes dénonçant des actes de torture et de mauvais traitements dans les centres de détention, souvent pour obtenir des aveux de la part des suspects, ainsi que par l’absence d’organe indépendant chargé d’enquêter sur les exactions imputées à des membres des forces de l’ordre et d’effectuer régulièrement des visites dans les prisons et autres lieux de détention. Le Comité est également préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne contienne pas de définition de la torture. Il est également préoccupé par le fait que l’accès aux lieux de détention soit refusé aux observateurs internationaux des droits de l’homme (art. 7).
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De réviser son Code pénal pour y introduire une définition de la torture conforme à celle qui figure dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) De prendre les mesures voulues pour faire cesser la pratique de la torture, notamment en créant un organe de surveillance indépendant chargé de procéder à des inspections indépendantes dans tous les lieux de détention et d’enquêter sur les plaintes mettant en cause le comportement des personnels de surveillance;
c) De veiller à ce que les membres des forces de l’ordre suivent une formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements en intégrant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) de 1999 dans tous les programmes de formation. L’État partie devrait également veiller à ce que les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête diligente, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et que les victimes reçoivent une réparation appropriée;
d) D’autoriser les organisations humanitaires internationales reconnues à se rendre dans tous les lieux de détention (...)
13. Le Comité note avec préoccupation que d’après des sources d’information la corruption est très répandue dans l’appareil judiciaire. Il est également préoccupé par le manque d’indépendance de la magistrature, en particulier en ce qui concerne le mandat des juges, puisque ceux-ci sont nommés par le Président pour des mandats de cinq ans renouvelables. Le Comité est préoccupé par le fait que ce manque de sécurité de mandat a pour résultat que l’exécutif exerce une influence excessive dans l’administration de la justice (art. 2 et 14) (...)
14. Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale les preuves obtenues par la contrainte sont sans effet juridique, mais il est préoccupé par les informations de plus en plus nombreuses selon lesquelles les juges continuent d’admettre comme preuves les témoignages obtenus par la torture (art. 2 et 14). »
b) Plaintes individuelles
42. Dans ses constatations adoptées le 24 juillet 2008 dans l’affaire Leonid Komarovskiy c. Turkménistan (communication no 1450/2006), le Comité a conclu qu’entre 2002 et 2003 l’auteur de la plainte avait été détenu dans la prison du ministère de la Sécurité nationale du Turkménistan dans des conditions ayant porté atteinte à sa dignité humaine et qu’il avait également été soumis à des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
43. Dans ses constatations adoptées le 25 mars 2015 dans l’affaire Tatiana Shikhmuradova (au nom de son mari, Boris Shikhmuradov) c. Turkménistan (communication no 2069/2011), le Comité a examiné la plainte de l’intéressée qui affirmait n’avoir eu aucun contact avec son mari depuis que celui-ci avait été emprisonné en 2002 au Turkménistan. Le Comité a constaté que le Turkménistan n’avait fourni aucun élément démontrant qu’il s’était acquitté de son obligation de protéger la vie du mari de l’intéressée au cours des douze années qui s’étaient écoulées depuis la condamnation de celui-ci et que ce dernier était détenu au secret. Le Comité a en outre regretté que le Turkménistan n’eût donné aucune information sur la recevabilité et/ou sur le fond des griefs de l’intéressée.
44. Dans ses constatations adoptées le 25 mars 2015 dans l’affaire Zafar Abdullayev c. Turkménistan (communication no 2218/2012), le Comité a examiné les conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire LBK‑12, situé près de la ville de Seydi, dans lequel l’auteur de la plainte avait été détenu entre 2012 et 2014. L’intéressé a dénoncé, notamment, une surpopulation extrême, une détention mixte de personnes non malades et de personnes atteintes de tuberculose et de maladies de la peau, ainsi qu’un manque d’hygiène et de soins médicaux. Il s’est plaint en outre d’actes de torture et de mauvais traitements infligés par les gardiens de cet établissement. Le Comité a constaté que le Turkménistan avait failli à soumettre tout élément qui aurait réfuté les allégations de l’intéressé et il a conclu que celui-ci avait été détenu dans de mauvaises conditions de détention et soumis à des mauvais traitements lors de sa détention dans l’établissement LBK-12.
45. Dans ses constatations adoptées le 1er avril 2015 dans l’affaire Sapardurdy Khadzhiev c. Turkménistan (communication no 2079/2011), le Comité a indiqué que l’État turkmène n’avait présenté aucun document susceptible de réfuter les allégations de torture et de mauvais traitements auxquels l’auteur de la plainte aurait été soumis en 2006 dans la prison du ministère de la Sécurité nationale du Turkménistan, et il a conclu à la violation de l’article 7 du Pacte.
46. Dans ses constatations adoptées le 29 octobre 2015 dans les affaires Mahmud Hudaybergenov c. Turkménistan (communication no 2221/2012), Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan (communication no 2222/2012) et Sunnet Japparow c. Turkménistan (communication no 2223/2012), le Comité a examiné les conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire LBK-12, situé près de la ville de Seydi, dans lequel les auteurs des plaintes avaient été détenus entre 2011 et 2012. Le Comité a constaté que le Turkménistan avait failli à soumettre tout élément qui eût réfuté les allégations des intéressés et il a conclu que ceux-ci avaient été détenus dans de mauvaises conditions dans l’établissement en question.
2. Comité contre la torture
47. Dans ses observations finales sur le rapport initial du Turkménistan adoptées en mai 2011 (CAT/C/TKM/CO/1), le Comité contre la torture a déploré qu’il ne contînt pas suffisamment d’informations statistiques et concrètes sur l’application des dispositions de la Convention et qu’il eût été présenté avec dix années de retard. En outre, le Comité a relevé notamment les sujets de préoccupation suivants :
« Mécanismes d’examen des plaintes et enquêtes ; impunité
11. Le Comité est profondément préoccupé par les allégations indiquant que les actes de torture et les mauvais traitements pratiqués par des agents de l’État donnent rarement lieu à des enquêtes et à des poursuites et qu’il semble exister un climat d’impunité qui se traduit par une absence de véritables mesures disciplinaires et poursuites pénales contre les agents de l’État accusés d’actes visés dans la Convention (art. 2, 11, 12, 13 et 16). Le Comité est préoccupé en particulier par :
a) L’absence de mécanisme indépendant et efficace habilité à recevoir des plaintes dénonçant des actes de torture, en particulier des prisonniers condamnés et de personnes en détention avant jugement, à effectuer des enquêtes impartiales et complètes sur ces plaintes ;
b) Les informations donnant à penser que de graves conflits d’intérêts empêchent les mécanismes de plainte existants de conduire des enquêtes efficaces et impartiales sur les plaintes reçues ;
c) Les informations indiquant qu’aucun agent de l’État n’a fait l’objet de poursuites pour avoir commis des actes de torture et, qu’au cours des dix dernières années, seuls quatre agents d’organes chargés de faire appliquer la loi ont été inculpés du chef moins grave d’« abus d’autorité » qualifié au paragraphe 2 de l’article 182 du Code pénal ;
d) L’absence d’informations détaillées, y compris de statistiques, sur le nombre de plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements adressées à tous les mécanismes de plainte existants, y compris à l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme et à la Commission d’État chargée d’examiner les plaintes des citoyens concernant les activités des organes ayant pour mission de faire respecter la loi et sur les résultats de ces enquêtes, que la procédure ait été engagée au niveau pénal ou disciplinaire, et leurs conclusions. À ce sujet, le Comité s’inquiète tout particulièrement du cas de Bazargeldy et Aydyemal Berdyev, dans lequel l’État partie a contesté l’authenticité d’une réponse que les intéressés disent avoir reçue de l’Institut national en 2009, au sujet d’une plainte pour torture qu’ils avaient soumise précédemment (...)
Surveillance et inspection des lieux de détention
14. Le Comité prend note des activités de surveillance des lieux de détention menées par le Bureau du Procureur général, mais relève avec une vive préoccupation que les organismes internationaux de surveillance, qu’ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, n’ont pas accès aux lieux de détention. Le Comité note que l’État partie coopère avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui apporte une assistance dans le domaine du droit humanitaire et d’autres manières. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas accordé au CICR l’accès aux lieux de détention, malgré les recommandations d’organismes internationaux, notamment de l’Assemblée générale dans ses résolutions 59/206 et 60/172, et comme l’a indiqué le Secrétaire général (A/61/489, par. 21). Le Comité regrette également qu’il n’ait pas encore été donné suite aux demandes de visites faites depuis longtemps par neuf titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en particulier le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Groupe de travail sur la détention arbitraire (art. 2, 11 et 16) (...)
Décès en détention
16. Le Comité est profondément préoccupé par les informations nombreuses et concordantes faisant état de décès en détention et de restrictions qui entraveraient la réalisation d’examens médico-légaux par des spécialistes indépendants dans de tels cas, et notamment par le cas de Ogulsapar Muradova, qui a été maintenue au secret pendant toute la durée de sa détention et est morte en détention dans des circonstances suspectes. Cette affaire, dans laquelle des signes de torture ont été constatés, est attestée par de nombreux documents et a été mentionnée par le Secrétaire général (A/61/489, par. 39) et par plusieurs rapporteurs spéciaux (A/HRC/WG.6/3/TKM/2, par. 38) (art. 2, 11, 12 et 16) (...)
Violence en prison, y compris le viol et la violence sexuelle
18. Le Comité est préoccupé par la violence physique et les pressions psychologiques exercées par le personnel pénitentiaire, y compris les châtiments collectifs, les mauvais traitements à titre de mesure «préventive», la mise à l’isolement et les violences sexuelles et les viols commis par les gardiens ou les détenus, qui auraient conduit plusieurs détenus au suicide. Dans le cas de la femme détenue dans la colonie pénitentiaire de Dashoguz qui a été rouée de coups, en février 2009, le Comité note avec préoccupation qu’alors que le responsable de l’établissement a été démis de ses fonctions pour corruption, aucune sanction pénale n’a été infligée aux fonctionnaires responsables de ces actes de violence (art. 2, 11, 12 et 16) (...)
Conditions de détention
19. Tout en prenant acte du plan du Gouvernement pour la construction de nouveaux centres de détention, le Comité demeure profondément préoccupé par les conditions matérielles et les conditions d’hygiène qui règnent actuellement dans les lieux de privation de liberté (nourriture et soins de santé insuffisants, grave surpeuplement, restriction non justifiée des visites des familles, etc.) (art. 11 et 16) (...)
Aveux par la contrainte
20. Le Comité note qu’il existe des dispositions législatives garantissant le principe de l’irrecevabilité dans le cadre d’une procédure judiciaire des preuves obtenues par la contrainte, telles que l’article 45 de la Constitution et le paragraphe 1 de l’article 25 du Code de procédure pénale. Il note toutefois avec une vive préoccupation les informations nombreuses, concordantes et crédibles qui indiquent qu’il est fréquent que des aveux obtenus par la contrainte soient retenus comme preuves par les tribunaux de l’État partie et que de telles pratiques persistent en raison de l’impunité dont jouissent les coupables. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a apporté aucune information au sujet de fonctionnaires qui auraient été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux (art. 15) (...)
Absence de données
25. Malgré la publication de ses directives sur la forme et le contenu des rapports initiaux (CAT/C/4/Rev.3) et malgré son insistance auprès de l’État partie pour qu’il lui fournisse des données statistiques, le Comité note avec regret qu’il n’a guère reçu d’informations sur des aspects autres que les dispositions législatives. L’absence de données complètes ou ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans des affaires de torture et de mauvais traitements où sont impliqués des agents des forces de l’ordre, sur le taux global d’occupation des prisons et sur les décès en détention, ainsi que sur les cas dans lesquels des individus auraient été victimes de torture et de disparition forcée évoqués − y compris sur le sort de ces personnes − par le Comité, constitue un obstacle majeur qui empêche de déterminer l’existence éventuelle d’un ensemble de violations devant retenir l’attention (art. 2, 12, 13 et 19). »
48. Dans une lettre du 23 mai 2014, le rapporteur sur le suivi de la mise en œuvre des observations finales adoptées en mai 2011 par le Comité contre la torture à l’égard du Turkménistan a demandé au gouvernement turkmène des clarifications supplémentaires en ce qui concerne la surveillance et l’inspection des lieux de détention, notamment :
– il a fait part de ses préoccupations quant au fait que les commissions ministérielles chargées de visiter les lieux de détention comprenaient des représentants des organes officiels, y compris des organes chargés de l’application de la loi, ce qui remettait d’après lui en cause leur indépendance, et il a invité le gouvernement turkmène à préciser si ces commissions pouvaient visiter tous les lieux de détention, et ce sans annonce préalable, et quelle était la fréquence des visites ;
– il a pris note de l’information sur la visite effectuée en avril 2012 par le Comité international de la Croix-Rouge (le CICR) d’un centre de détention du ministère des Affaires intérieures, et il a invité le gouvernement turkmène à préciser si le CICR était autorisé à visiter tous les centres de détention comme préconisé par ce dernier et si d’autres organisations non gouvernementales avaient été autorisées à effectuer de telles visites et à l’informer sur leurs dates et lieux éventuels ;
– il a constaté que le Turkménistan n’avait pas donné suite aux demandes émises par le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et par le Groupe de travail sur la détention arbitraire de visiter le pays conformément à leurs mandats, et il a invité les autorités turkmènes à lui faire savoir si elles avaient pris des mesures pour faciliter de telles visites.
3. Groupe de travail sur la détention arbitraire
49. Dans son avis adopté à sa 71e session du 17 au 21 novembre 2014 (A/HRC/WGAD/2014/40), le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme a regretté que le gouvernement turkmène n’ait pas répondu aux allégations qui lui avaient été adressées dans la communication no 40/2014 du 16 septembre 2014 portant sur la situation de deux individus inculpés de fraude avec collusion et de détournement de biens publics. Le groupe a conclu que les violations manifestes du droit au procès équitable, des droits de la défense et du droit à la liberté et à la sécurité des personnes concernées étaient d’une gravité telle qu’elles avaient rendu la privation de la liberté de celles-ci arbitraire.
4. Secrétaire général adjoint aux droits de l’homme
50. Le 28 mai 2013, le Secrétaire général adjoint aux droits de l’homme, Ivan Ṡimonović, a fait une déclaration à l’issue d’une visite de deux jours effectuée au Turkménistan. Il a déclaré que, malgré un certain progrès, le Turkménistan avait un long chemin à parcourir dans le domaine de la protection des droits de l’homme. En particulier, tout en constatant des modifications législatives quant à la définition de la torture et à l’exclusion des preuves obtenues sous la torture, il a indiqué que ces normes n’étaient pas appliquées dans la pratique. Il a également déclaré que, bien que le procureur général fût en charge de la surveillance des lieux de détention, le service de celui-ci n’avait jusqu’à présent reçu aucune plainte sur des allégations de torture de la part de personnes privées de liberté ou de leurs avocats et qu’il n’avait ouvert d’office aucune enquête pénale sur des cas éventuels de torture. En se basant sur ses discussions avec des représentants du ministère de la Justice, de la Cour suprême et du service du procureur général, le Secrétaire général adjoint a conclu que le pouvoir judiciaire manquait d’indépendance.
B. Organisations non gouvernementales
1. Amnesty International
51. Dans le cadre de la procédure de suivi sur la mise en œuvre des observations finales adoptées en mai 2011 par le Comité contre la torture à l’égard du Turkménistan (CAT/C/TKM/CO/1), Amnesty International a soumis en mai 2012 un rapport concernant, notamment, la surveillance et l’inspection des lieux de détention dans ce pays. Amnesty International indiquait dans son rapport que l’accès aux centres de détention était strictement contrôlé par les autorités turkmènes et que leur surveillance relevait du service du procureur général, et que certains centres de détention, comme la prison Ovadan-Depe, étaient connus pour leurs conditions extrêmement sévères ; selon Amnesty International, une commission, créée par un décret présidentiel du 31 mars 2010 et chargée d’examiner des plaintes des détenus, était censée inclure des représentants des ONG ; or aucune ONG indépendante n’aurait été opérationnelle dans le pays, ce qui, pour Amnesty International, remettait en cause l’indépendance de cette commission composée pour le reste de membres provenant d’organismes d’État. Amnesty International notait en outre que le CICR n’avait pas été autorisé à visiter tous les centres de détention.
52. Dans la partie de son rapport de 2014/2015 concernant le Turkménistan, Amnesty International s’exprimait ainsi :
« L’appareil judiciaire jouissait d’une indépendance limitée. Il n’existait pas de véritable procédure d’appel et, lors des procès au pénal, les acquittements étaient rares. Les avocats qui cherchaient à être indépendants dans leur exercice s’exposaient à être rayés du barreau. La torture et les autres formes de mauvais traitements demeuraient très répandues (...)
Le Turkménistan a accepté en septembre 2013 les recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations unies lui demandant de coopérer avec les procédures spéciales de l’ONU. Les autorités ont cependant limité de façon draconienne l’accès des observateurs internationaux au territoire turkmène. Le Turkménistan n’a pas répondu aux demandes de visite d’Amnesty International, et 10 demandes de même nature formulées par des procédures spéciales de l’ONU étaient toujours en souffrance à la fin de l’année. (...)
Torture et autres mauvais traitements
Un certain nombre d’informations dignes de foi ont fait état d’actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par les forces de sécurité contre des personnes soupçonnées d’infractions pénales. Les victimes de ces actes auraient été soumises à divers sévices : tenailles appliquées sur les organes génitaux, décharges électriques, coups assénés au moyen de pieds de chaise ou de bouteilles en plastique pleines d’eau. Concernant les prisons, on a signalé, entre autres, le cas d’un détenu qui aurait été contraint d’avaler des cachets et aurait subi des menaces contre sa famille, des cas de viols forcés entre prisonniers, et le maintien au fer des prisonniers purgeant des peines de réclusion à perpétuité (...) »
53. Dans la partie de son rapport de 2015/2016 concernant le Turkménistan, Amnesty International s’exprimait ainsi :
« Aucune amélioration de la situation relative aux droits humains n’a été constatée en 2015 et le Turkménistan est resté fermé aux observateurs indépendants. Le gouvernement a annoncé en janvier son intention de mettre en place un médiateur chargé des droits humains. Les organisations de la société civile indépendantes ne pouvaient toujours pas fonctionner librement. (...)
Torture et autres mauvais traitements
Cette année encore, des informations ont indiqué que les organes chargés de l’application des lois avaient toujours recours à la torture et à d’autres mauvais traitements pour extorquer des « aveux » à certains détenus ou pour les contraindre à incriminer des tiers (...)
Disparitions forcées
On était toujours sans nouvelles des détenus victimes de disparitions forcées au lendemain de la tentative d’assassinat dont aurait été victime en 2002 le président de l’époque, Saparmourad Niazov. Les autorités n’ont pas répondu à une demande d’informations sur cette affaire, formulée en juin dans le cadre du dialogue Union européenne-Turkménistan sur les droits humains. Depuis 13 ans, les familles de ces détenus n’ont reçu aucune information concernant l’endroit où ils se trouvent ou le sort qui leur a été réservé. »
2. Human Rights Watch
54. Les parties pertinentes en l’espèce du rapport mondial de 2015 de Human Rights Watch peuvent se traduire ainsi :
« Le bilan catastrophique du gouvernement turkmène en matière de droits de l’homme n’a connu aucune réelle amélioration en 2014. Le président, ses proches et ses collaborateurs exercent toujours un contrôle absolu sur tous les aspects de la vie publique. Le gouvernement empêche totalement l’exercice des libertés d’association, d’expression et de religion, et le pays est fermé à tout contrôle indépendant. Les familles de dizaines de personnes emprisonnées lors des campagnes d’arrestations massives de la fin des années 1990 et du début des années 2000 n’ont eu aucune information officielle sur le sort de ces dernières. Le projet de « réforme » de la constitution n’annonce aucune amélioration des droits et libertés fondamentaux (...)
Prisonniers politiques, disparitions forcées et torture
Plus de dix ans après leur arrestation et le simulacre de leur procès au cours de plusieurs vagues de répression sous le régime de l’ancien président, M. Niyazov, des dizaines de personnes figurent toujours sur la liste des victimes de disparition forcée. Parmi ces personnes se trouvent l’ancien ministre des Affaires étrangères Boris Shikhmuradov, son frère Konstantin et l’ancien ambassadeur du Turkménistan auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Batyr Berdiev. En 2014, Human Rights Watch a reçu des informations non vérifiées selon lesquelles plusieurs de ces disparus étaient morts en détention (...)
La torture demeure un grave problème. Un rapport de 2014 rédigé par une coalition de groupes indépendants de défense des droits de l’homme, Prove They Are Alive! (« Prouvez qu’ils sont vivants ! ») décrit les tortures subies par des détenus de la prison d’Ovadan Tepe, un centre de détention entouré du plus grand secret où sont emprisonnées de nombreuses personnes qui auraient été condamnées pour des motifs politiques. Le gouvernement a systématiquement refusé l’accès à cette prison à des observateurs des droits de l’homme indépendants, dont la Croix-Rouge et dix rapporteurs des Procédures spéciales des Nations unies. »
3. Turkmen Initiative for Human Rights et International Partnership for Human Rights
55. En janvier 2014, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le rapport initial du Turkménistan (paragraphe 41 ci-dessus), deux organisations non gouvernementales – Turkmen Initiative for Human Rights et International Partnership for Human Rights, ont soumis un rapport commun. Dans leur rapport, les ONG ont attiré l’attention du Comité sur les points suivants :
– une définition de la torture conforme à celle qui figure dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants avait été introduite dans le code pénal turkmène, mais la mise en œuvre de la disposition nécessitait un ensemble de mesures effectives ;
– aucune mesure n’avait été prise pour créer un organe de surveillance indépendant chargé de procéder à des inspections indépendantes dans tous les lieux de détention, les autorités turkmènes continuant d’imposer des restrictions à de telles visites ;
– aucune mesure n’avait été prise pour enquêter sur les plaintes mettant en cause le comportement des personnels de surveillance des lieux de détention et pour poursuivre et punir les personnes responsables de tortures et de mauvais traitements :
– alors que les autorités turkmènes avaient permis au CICR de visiter deux centres de détention (en juillet 2011 et en avril 2012), le CICR n’avait pas été autorisé à visiter sans entrave tous les lieux de détention, alors que cela aurait permis un monitoring complet conforme à ses principes de base, incluant conversation en privé avec les détenus de son choix et visites répétées sans limitation de leur nombre.
ARTICLE 3
PRINCIPES GENERAUX
67. La Cour rappelle que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi les arrêts récents, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 111, CEDH 2016). Cependant, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’extradition ou l’expulsion d’une personne par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas renvoyer la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 90-91, série A no 161, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 103, série A no 215, et Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 135, 11 janvier 2007).
68. Afin de déterminer s’il est établi que le requérant court un risque réel, en cas d’extradition ou d’expulsion, de subir des traitements contraires à l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, et Salah Sheekh, précité, § 136). Pour apprécier l’existence de ce risque, il faut se référer par priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition ou de l’expulsion (Vilvarajah et autres, précité, § 107, Riabikine, précité, § 111). Toutefois, si le renvoi ne s’est pas produit au moment où la Cour examine l’affaire, elle doit procéder à cet examen à la lumière des circonstances présentes, tout en tenant compte des faits antérieurs dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 85-86, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
69. L’examen de la question doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers le pays demandant l’extradition ou l’expulsion, compte tenu de la situation générale dans le pays en question et des circonstances propres au cas du requérant (Vilvarajah et autres, précité, § 108, et Umirov c. Russie, no 17455/11, § 94, 18 septembre 2012).
70. En ce qui concerne la situation générale dans un pays particulier, la Cour peut accorder une certaine importance aux informations contenues dans des rapports récents d’organisations indépendantes de défense des droits de l’homme ou aux informations issues de sources gouvernementales (voir, par exemple, Chahal, précité, §§ 99-100, Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 67, 26 avril 2005, et Said c. Pays-Bas, no 2345/02, § 54, CEDH 2005‑VI).
71. En principe, il appartient au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure dénoncée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 91, CEDH 2016, N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels qu’ils pourraient faire naître (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 129, CEDH 2008, Riabikine, précité, § 112).
72. En ce qui concerne l’appréciation des assurances fournies par l’État d’accueil, la Cour renvoie aux principes dégagés en la matière dans son arrêt Othman (Abu Qatada) (précité, §§ 187-189).
b) Application des principes précités au cas d’espèce
73. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans un certain nombre d’affaires en raison du risque de mauvais traitements qu’encouraient les individus susceptibles d’être extradés ou expulsés de la Russie ou d’un autre État membre du Conseil de l’Europe vers le Turkménistan (Kolesnik, précité, §§ 67-74, 17 juin 2010, Soldatenko, précité, §§ 70-75, Riabikine, précité, §§ 115-122, Garabaïev, précité, §§ 77‑83). En se fondant sur diverses sources, tels des rapports des institutions des Nations unies et d’organisations non gouvernementales internationales, la Cour a relevé que la situation générale des droits de l’homme au Turkménistan était alarmante. Elle a tenu notamment compte de plusieurs éléments, à savoir : des informations crédibles sur la persistance de la torture, de mauvais traitements et de recours inconsidérés à la force à l’encontre de personnes poursuivies au pénal par les autorités turkmènes ; des conditions particulièrement mauvaises de détention ; la discrimination de personnes d’origine ethnique non turkmène les rendant vulnérables aux abus ; l’effet cumulatif de mauvaises conditions de détention eu égard à la durée éventuelle de la peine privative de liberté encourue ; le refus systématique des autorités turkmènes de permettre tout monitoring des lieux de détention par des observateurs internationaux ou non gouvernementaux. Elle a conclu que toute personne placée en détention au Turkménistan pour des charges pénales courait un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
74. La Cour doit donc examiner en l’espèce s’il y a eu, depuis l’adoption en 2010 de son arrêt Kolesnik précité, une évolution en matière de droits de l’homme au Turkménistan. Elle note qu’il y eu un certain progrès en ce qui concerne la coopération des autorités turkmènes avec les institutions des Nations unies. Notamment, le gouvernement turkmène a soumis ses rapports initiaux dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (paragraphes 41 et 47 ci‑dessus). Il ressort également des informations soumises aux Comité des droits de l’homme et au Comité contre la torture que les autorités turkmènes ont procédé à un certain nombre de changements législatifs et administratifs en ce qui concerne la lutte contre la torture et les mauvais traitements ainsi que la surveillance et l’inspection des lieux de détention, et qu’elles ont permis au CICR de visiter deux établissements de détention, en 2011 et en 2012 (paragraphes 48, 51 et 55 ci-dessus).
75. Cependant, au vu de l’ampleur des déficiences constatées tant par les institutions des Nations unies que par les organisations non gouvernementales, la Cour n’est pas en mesure de constater que ces avancements reflètent un changement substantiel de la situation en matière de droits de l’homme et, notamment, en ce qui concerne le risque d’être soumises à la torture ou aux mauvais traitements que les personnes placées en détention pour des charges pénales encourent au Turkménistan. Elle relève que les observations finales du Comité contre la torture et du Comité des droits de l’homme sur les rapports soumis par le Turkménistan, adoptées respectivement en 2011 et en 2012, font état d’actes de torture et de mauvais traitements ainsi que de mauvaises conditions de détention dans les prisons turkmènes. En outre, selon ces observations, il n’y a pas de mécanisme indépendant et effectif destiné à recevoir des plaintes pour cause de torture, émanant en particulier de prisonniers condamnés et de personnes en détention avant jugement, et à déclencher des enquêtes impartiales et complètes sur ces plaintes (paragraphes 41 et 47 ci-dessus). Il n’apparaît pas que la mise en œuvre des recommandations formulées dans les observations finales en question ait été jusqu’ici effective puisque plusieurs déficiences ont été progressivement constatées : en 2012, par Amnesty International (paragraphe 51 ci-dessus) ; en 2013, par le Secrétaire général adjoint aux droits de l’homme (paragraphe 50 ci-dessus) ; en 2014, par le rapporteur du Comité contre la torture (paragraphe 48 ci-dessus) et par les organisations non gouvernementales Turkmen Initiative for Human Rights et International Partnership for Human Rights (paragraphe 55 ci-dessus). Amnesty International et Human Rights Watch, dans leurs rapports établis entre 2014 et 2016, indiquent qu’aucune amélioration de la situation en matière de droits de l’homme n’a été constatée et que le Turkménistan est resté fermé aux observateurs indépendants (paragraphes 52-54 ci-dessus).
76. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère qu’aucun des éléments dont elle a tenu compte dans les arrêts cités au paragraphe 73 ci‑dessus n’a perdu de son actualité au jour de l’examen de la présente affaire. Elle conclut que toute personne placée en détention au Turkménistan pour des charges pénales court un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
77. La Cour note ensuite que les autorités turkmènes ont ordonné le placement en détention de la requérante (paragraphe 8 ci-dessus). L’extradition de l’intéressée est demandée sur le fondement de l’article 228 §§ 2 et 4 du code pénal du Turkménistan qui, dans ses parties pertinentes en l’espèce, prévoit des peines allant jusqu’à quinze ans de réclusion criminelle (paragraphes 10 et 56 ci-dessus). Pour la Cour, il est donc plus que probable, si son extradition est réalisée, que la requérante sera placée en détention dès son arrivée au Turkménistan et qu’elle y courra un risque réel d’être soumise à des mauvais traitements.
78. Face à ce constat, la Cour doit examiner le point de savoir si les assurances contenues dans la demande d’extradition de la requérante lèvent tout risque réel de mauvais traitements à son égard. Elle note que le Gouvernement attache une importance particulière à ces assurances et affirme, de surcroît, que l’exigence d’un mécanisme propre à vérifier leur respect en pratique par le pays de destination irait à l’encontre du principe de souveraineté étatique consacré selon lui par le droit international (paragraphe 63 ci-dessus).
79. La Cour note d’emblée que l’argument du Gouvernement quant à un prétendu conflit entre la possibilité de contrôler le respect des assurances en question et le principe de souveraineté étatique n’est nullement étayé par des exemples pertinents issus de la jurisprudence internationale ou nationale. Elle renvoie à sa jurisprudence pour des exemples démontrant le contraire (Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, § 254, CEDH 2013 (extraits), avec les références qui y figurent, et Othman (Abu Qatada), précité, §§ 80‑81 et 141-154).
80. En ce qui concerne la qualité des assurances données, la Cour rappelle que plusieurs facteurs énumérés au paragraphe 189 de l’arrêt Othman (Abu Qatada) (précité) entrent en ligne de compte pour apprécier leur fiabilité. Dans ses arrêts concernant des renvois au Turkménistan, elle a considéré que les assurances données par le service du procureur général turkmène n’étaient pas fiables eu égard notamment à l’absence de mécanismes de contrôle permettant de vérifier objectivement leur respect dans la pratique (Kolesnik, précité, § 73, Soldatenko, précité, § 73, et Riabikine, § 120). En l’espèce, elle estime que le gouvernement russe n’a pas non plus démontré l’existence d’un tel mécanisme ni la capacité du service du procureur turkmène à engager le Turkménistan ni le respect par le passé d’assurances analogues.
81. La Cour relève à cet égard que la volonté des autorités du Turkménistan de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle (dont les ONG de défense des droits de l’homme) s’avère extrêmement limitée. Notamment, le Comité contre la torture a regretté que le rapport du Turkménistan ne contînt pas « suffisamment d’informations statistiques et concrètes » sur l’application de la Convention contre la torture (paragraphe 47 ci-dessus). Dans ses observations sur les plaintes individuelles introduites auprès du Comité des droits de l’homme, le gouvernement turkmène n’a fourni aucun élément pour réfuter les allégations de mauvaises conditions de détention et de mauvais traitements infligés aux détenus en question (paragraphes 42-46 ci-dessus) ; il en est de même en ce qui concerne le Groupe de travail sur la détention arbitraire (paragraphe 49 ci‑dessus). Le Turkménistan n’a pas donné suite aux demandes du Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et du Groupe de travail sur la détention arbitraire de visiter le pays conformément à leurs mandats, ni à celles formulées par Amnesty International (paragraphes 48 et 52 ci-dessus). La Cour note d’ailleurs que les autorités turkmènes semblent être réticentes à coopérer dans le domaine du respect des droits de l’homme également au niveau bilatéral : il ressort de la décision du tribunal de Moscou du 4 juin 2015 qu’elles ont refusé de donner toute information sur le sort d’un individu détenu au Turkménistan malgré plusieurs demandes en ce sens du ministère russe des Affaires étrangères (paragraphe 57 ci-dessus).
82. La Cour estime donc que les assurances fournies par le service du procureur général turkmène ne sont pas fiables et que, par conséquent, elles ne lèvent pas tout risque réel de mauvais traitements en cas d’extradition de la requérante vers le Turkménistan.
83. Partant, la Cour conclut que l’extradition de la requérante vers le Turkménistan emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
ARTICLE 3 COMBINE A L'ARTICLE 13
a) Principes généraux
91. En vertu de l’article 1 de la Convention, ce sont les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).
92. La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Les États jouissent en effet d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 48, CEDH 2000‑VIII). Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Kudła, précité, § 157).
93. L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’est pas nécessairement juridictionnelle. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 67, série A no 28). S’agissant des « instances » non juridictionnelles, la Cour s’attache à en vérifier l’indépendance (voir, par exemple, Leander c. Suède, 26 mars 1987, §§ 77 et 81-83, série A no 116, Khan c. Royaume-uni, no 35394/97, §§ 44‑47, CEDH 2000‑V), ainsi que les garanties de procédure offertes aux requérants (voir, mutatis mutandis, Chahal, précité, §§ 152‑154).
94. Une procédure de contrôle juridictionnel constitue en principe un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire état de griefs en matière d’expulsion et d’extradition, dès lors que les juridictions peuvent effectivement contrôler la légalité des décisions prises par le pouvoir exécutif dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, tant par rapport aux règles de fond que par rapport aux règles de procédure, et qu’elles ont le pouvoir, le cas échéant, d’annuler les décisions (Tershiyev c. Azerbaïdjan, no 10226/13, § 71, 31 juillet 2014).
95. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 69, CEDH 2000‑V).
96. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Lorsqu’il s’agit d’un grief selon lequel l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu de l’importance que la Cour attache à cette disposition et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005‑III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari, précité, § 50) ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 81, CEDH 2012).
97. Dans ce type d’affaires, l’effectivité requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 200, CEDH 2012). Les exigences de l’article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique. C’est là une des conséquences de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, inhérent à l’ensemble des articles de la Convention, ce qui a par ailleurs conduit la Cour à rejeter les arguments selon lesquels l’effet suspensif aurait été assuré du fait de l’existence d’une « pratique » administrative ou d’autre nature (Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 81‑83, CEDH 2002‑I, Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, M.A. c. Chypre, no 41872/10, § 137, CEDH 2013 (extraits)). La Cour a jugé que l’on ne saurait exclure que, dans un système où la suspension est accordée sur demande, au cas par cas, elle puisse être refusée à tort (Čonka c. Belgique, précité, § 82).
98. L’article 13 de la Convention n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction dans ce type d’affaires, il suffit qu’il existe au moins un recours interne qui remplit les conditions d’effectivité voulues par cette disposition, c’est-à-dire un recours permettant un contrôle attentif et un examen rigoureux d’une allégation quant à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et disposant d’un effet suspensif de plein droit à l’égard de la mesure litigieuse (A.M. c. Pays-Bas, no 29094/09, §§ 62 et 70, 5 juillet 2016).
99. Les mêmes principes s’appliquent lorsque l’expulsion expose le requérant à un risque réel d’atteinte à son droit à la vie, protégé par l’article 2 de la Convention (L.M. et autres c. Russie, nos 40081/14, 40088/14 et 40127/14, § 108, 15 octobre 2015).
b) Application des principes précités à la présente espèce
i. Procédure relative à l’extradition
100. La Cour observe que la requérante a mis en avant le risque de mauvais traitements qu’elle estimait encourir au Turkménistan dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire de la décision d’extradition prise à son encontre le 12 mai 2015. Elle doit donc rechercher si ce contrôle a constitué un recours ayant satisfait aux critères d’effectivité susmentionnés.
α) « Effet suspensif de plein droit »
101. La Cour note que, selon les articles 462 et 463 du CPP russe, toute décision du procureur général ou de son adjoint portant sur l’extradition d’une personne est susceptible de recours devant une instance judiciaire à deux degrés de juridiction, ce recours ayant un effet suspensif de plein droit (paragraphe 27 ci-dessus). La présente espèce en est l’illustration puisque la requérante, ayant contesté la décision d’extradition en justice, a bénéficié d’un tel effet jusqu’au 24 septembre 2015 sans que la mesure d’extradition ait été mise en œuvre à son encontre.
β) « Examen indépendant et rigoureux »
102. En vertu de la directive no 11 de la Cour suprême russe du 14 juin 2012 relative à l’extradition des personnes, les juridictions nationales sont tenues de vérifier si la personne extradée court un risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants dans l’État demandeur, auquel cas l’extradition n’est pas permise (paragraphe 29 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que les juridictions nationales russes, saisies d’un recours contre une décision d’extradition, ont, au moins en principe, la compétence et la possibilité d’effectuer un « examen indépendant et rigoureux » d’un grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, et d’offrir un redressement approprié, c’est-à-dire d’annuler une décision d’extradition et de prévenir le risque de mauvais traitement allégué (voir, dans ce sens, Savriddin Dzhurayev, précité, § 259).
103. La Cour considère cependant qu’en l’espèce un tel examen a fait défaut en pratique. En effet, la requérante a produit devant les juridictions internes des éléments susceptibles de démontrer qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que, si l’extradition était mise à exécution, elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des mauvais traitements. Une fois ces éléments produits, il revenait donc aux juridictions d’examiner les conséquences prévisibles du renvoi de la requérante dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressée. Or les juridictions internes ont rejeté les allégations de la requérante quant au risque en question au seul motif qu’elles se fondaient sur de simples suppositions (paragraphes 19 et 22 ci-dessus). La Cour estime qu’une telle approche ne satisfait pas au critère de l’examen rigoureux. Elle réaffirme qu’exiger d’une personne qu’elle produise des preuves « incontestables » d’un risque de mauvais traitements dans le pays de renvoi consisterait à lui demander de prouver l’existence d’un évènement futur, ce qui est impossible, et placerait sur elle un fardeau disproportionné (voir, dans le contexte de l’article 3 de la Convention, Rustamov c. Russie, no 11209/10, § 117, 3 juillet 2012).
104. De surcroît, avant d’estimer que les assurances des autorités turkmènes étaient suffisantes, les juridictions russes n’ont pas procédé à l’examen de ces assurances à la lumière des critères pertinents, rappelés au paragraphe 80 du présent arrêt. Notamment, elles n’ont pas cherché à savoir si le respect des assurances données par le procureur général du Turkménistan pouvait être vérifié objectivement en pratique à l’aide d’un mécanisme de contrôle, ni si le procureur général turkmène avait la capacité d’engager le Turkménistan ou s’il avait respecté des assurances analogues dans le passé.
105. La Cour estime par conséquent qu’il n’y a pas eu, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la décision du 12 mai 2015 portant sur l’extradition de la requérante, d’examen rigoureux du grief de l’intéressé relatif au risque de mauvais traitements encouru en cas de renvoi vers le Turkménistan.
ii. Autres procédures
106. La Cour relève que la requérante a eu la possibilité de déposer des demandes tendant à l’obtention du statut de réfugié et de l’asile temporaire et qu’elle a pu soulever dans ce cadre son grief relatif au risque de mauvais traitements encouru en cas de renvoi vers le Turkménistan, et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour suprême que l’obtention du statut de réfugié ou de l’asile temporaire fait obstacle à l’extradition (paragraphe 29 ci‑dessus). Elle rappelle ensuite que l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul. Elle doit donc vérifier si le fait que la requérante a eu accès à ces procédures a permis de remédier à l’insuffisance de la procédure d’extradition constatée ci-dessus.
α) Procédure relative au statut de réfugié
107. Selon l’article 1 § 1-1 de la loi sur les réfugiés, la procédure relative à une demande de statut de réfugié est censée établir, dans le chef de la personne concernée, l’existence ou non « d’une crainte justifiée » de persécutions dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ou dont elle détient la nationalité, « du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Cette procédure semble donc, au premier regard, offrir une possibilité aux autorités internes d’examiner la question de savoir si le demandeur court un risque de mauvais traitements en cas de renvoi dans le pays de destination et de lui octroyer le cas échéant le statut de réfugié.
108. La Cour a toutefois relevé à plusieurs reprises dans des affaires qui concernaient des cas d’extradition que les autorités russes interprètent l’article 1 § 1-1 de la loi sur les réfugiés d’une manière stricte, excluant son application dans le cas d’allégations d’un risque d’être soumis à de mauvais traitements pour des raisons autres que celles qu’il énumère (voir, à titre d’exemples, Turgunov c. Russie, no 15590/14, §§ 20-24, 22 octobre 2015, Khalikov c. Russie, no 66373/13, §§ 21-24, 26 février 2015, Mamazhonov c. Russie, no 17239/13, §§ 42-47, 23 octobre 2014, Mamadaliyev c. Russie, no 5614/13, §§ 29-33, 24 juillet 2014, Kadirzhanov et Mamashev c. Russie, nos 42351/13 et 47823/13, §§ 53, 60 et 63, 17 juillet 2014, Ermakov c. Russie, no 43165/10, §§ 30-42, 7 novembre 2013, Savriddin Dzhurayev, précité, §§ 27-29, Makhmudzhan Ergashev c. Russie, no 49747/11, §§ 20-23 et 28-29, 16 octobre 2012, et Abdulkhakov c. Russie, no 14743/11, §§ 33-39, 2 octobre 2012). Elle note que cela a été également le cas en l’espèce, le bureau régional du SFM ayant rejeté la demande de la requérante sans analyser le risque spécifique qu’elle évoquait, à savoir que, selon elle, en cas de renvoi au Turkménistan elle serait placée en détention, ce qui mettrait sa vie en danger. Le bureau régional du SFM s’est borné à constater qu’il n’y avait pas de raison sérieuse de craindre qu’elle fût persécutée ou punie dans ce pays du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphes 12-13 ci-dessus). Cette décision a été maintenue par le bureau central du SFM en février 2015 (paragraphe 16 ci-dessus).
109. Eu égard à ces éléments, la Cour considère que, dans les circonstances de la cause, la procédure relative à l’obtention du statut de réfugié n’a pas permis un examen rigoureux du grief de la requérante relatif au risque d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en Turkménistan.
110. Au surplus, la Cour constate que la procédure de contrôle juridictionnel prévue par l’article 254 du CPC à laquelle le demandeur débouté avait ensuite accès n’avait pas non plus d’effet suspensif de plein droit, le tribunal saisi n’étant pas obligé de surseoir à l’exécution de l’acte ou de la décision contestée (paragraphe 38 ci-dessus). Il reste, certes, que le paragraphe 26 de l’ordonnance no 11 du 14 juin 2012 de la Cour suprême de la Fédération de Russie indique que l’extradition d’une personne est « de facto » bloquée « jusqu’au moment de l’adoption d’une décision sur sa demande [de statut de réfugié ou d’asile temporaire] ou jusqu’à la fin de la procédure de contestation d’un éventuel rejet de sa demande [de statut de réfugié ou d’asile temporaire] » (paragraphe 29 ci-dessus). Le fondement juridique d’une telle pratique et l’application générale de celle-ci sont toutefois incertains, le paragraphe 26 ne se référant à cet égard à aucune disposition de droit interne, se bornant à renvoyer à certaines normes du droit international. La Cour considère que, afin de correspondre aux exigences de l’article 13 de la Convention, « l’effet suspensif » d’un recours interne devrait être « de plein droit », c’est-à-dire, consacré par le droit interne d’une manière claire et non équivoque. Du reste, même s’il existait une pratique administrative ou d’autre nature consistant à ne pas extrader une personne pendant la procédure de contestation du rejet d’une demande de statut de réfugié, la Cour rappelle que « les exigences de l’article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique » (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66).
111. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que la procédure relative à la demande de la requérante tendant à l’obtention du statut de réfugié, telle que suivie en pratique par les autorités nationales, n’a pas permis un examen rigoureux du grief de l’intéressée relatif au risque d’être soumise aux traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
β) Procédure relative à l’asile temporaire
112. La Cour note que l’asile temporaire peut être octroyé à une personne pour des « motifs humanitaires » même si celle-ci ne peut pas bénéficier du statut de réfugié (paragraphe 33 ci-dessus). Selon la Cour constitutionnelle russe, les motifs humanitaires présupposent l’existence d’une « situation difficile » dans le chef de la personne qui fait une demande d’asile temporaire (paragraphe 39 ci-dessus). La Cour ne dispose pas d’éléments qui tendraient à montrer qu’un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention pourrait ne pas être considéré, par les instances nationales, comme une « situation difficile ». Elle note toutefois que le Gouvernement n’a pas non plus démontré que cela pourrait être le cas. En tout état de cause, à supposer que la procédure relative à une demande d’asile temporaire permette en principe un contrôle attentif et un examen rigoureux d’une allégation quant à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour relève que la question principale dans le cas d’espèce est celle de savoir si la requérante, ayant introduit le 17 juillet 2015 une demande tendant à l’obtention de l’asile temporaire, a bénéficié de plein droit d’un effet suspensif à l’égard de la mesure d’extradition devenue définitive et exécutoire le 24 septembre 2015.
113. La Cour relève que ni l’article 464 § 1 du CPP ni l’article 12 § 4 de la loi sur les réfugiés n’établissent une interdiction de renvoyer une personne qui a soumis une demande d’asile temporaire, une telle interdiction étant prévue uniquement au bénéfice de ceux qui ont « obtenu » l’asile temporaire (paragraphes 28 et 33 ci-dessus). Le Gouvernement n’ayant pas démontré le contraire, la Cour considère par conséquent que le fait qu’une procédure d’examen d’une demande d’asile temporaire est pendante devant les autorités chargées de questions des migrations ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’extradition devenue définitive et n’a donc pas d’« effet suspensif de plein droit » à son égard. Les circonstances de la présente affaire en offrent du reste l’illustration : si la requérante n’a pas été extradée vers le Turkménistan, ce n’est pas en raison de son dépôt d’une demande d’asile temporaire, mais seulement à la suite de l’indication par la Cour, le 24 septembre 2015, d’une mesure provisoire sur la base de l’article 39 de son règlement. En effet, il ressort de la décision du SFM de Saratov du 16 octobre 2015 que l’asile temporaire a été accordé à la requérante « jusqu’à nouvel ordre » suite à « (...) l’indication d’une mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement de la Cour dans le cadre de la requête no 46721/15 « Allanazarova c. Russie » » (paragraphe 26 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne peut que conclure que, sans son intervention, la requérante aurait fait l’objet d’un renvoi vers le Turkménistan, avant que sa demande ait été examinée sur le fond.
114. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la procédure relative à la demande de la requérante tendant à l’obtention de l’asile temporaire n’a pas eu d’effet suspensif de plein droit voulu par l’article 13 de la Convention.
c) Conclusion
115. La Cour conclut que la procédure de contrôle judiciaire de la décision du 12 mai 2015 portant sur l’extradition de la requérante, à elle seule ou combinée avec les procédures relatives aux demandes de la requérante tendant à l’obtention du statut de réfugié et de l’asile temporaire, n’a pas constitué, dans les circonstances de l’espèce, un « recours effectif » au sens de l’article 13 quant à l’allégation de la requérante selon laquelle elle risquait de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas d’extradition vers le Turkménistan. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
Arrêt YP et LP contre France du 2 septembre 2010 requête 32476/06
Les requérants, Y.P., et son épouse, L.P., sont deux ressortissants du Belarus, nés respectivement en 1966 et 1967 et résidant actuellement clandestinement en France. Ils sont respectivement ingénieur et professeur des écoles et ont trois enfants.
Au Belarus, Y.P. a été arrêté, détenu et battu par la police pour ses activités en tant que membre du Front populaire biélorusse, notamment pour des faits d’ « hooliganisme » en février 1999, fait mentionné dans un rapport du Centre de défense des droits de l’homme « Viasna ». En octobre de la même année, il fut détenu et frappé par les autorités pour sa participation à la « marche pour la liberté » à Minsk.
Entre 2002 – après, selon le requérant, avoir été agressé suite à son élection à la présidence du comité central du parti à Moghilev – et 2004, il commença à chercher asile en Allemagne et en Norvège, en vain. En octobre 2004, Y.P. allègue avoir été emmené dans un bois par la police et battu jusqu’à en perdre connaissance. Le requérant déclare avoir été également violenté lors de son arrestation et assignation à résidence, la veille des élections législatives. Son fils, également membre du parti, fut arrêté à différentes reprises, notamment en octobre 2004 alors qu’il distribuait des tracts contre les modifications apportées à la Constitution biélorusse, qui permettaient au président de demeurer au pouvoir à vie. Quelques mois auparavant, un traumatisme crânien avait été diagnostiqué chez le jeune homme après sa détention pour avoir participé à un meeting contre la dictature.
En février 2005, à leur arrivée en France, à Strasbourg, ils déposèrent immédiatement une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui fut refusée au motif que le requérant n’avait pas fait de déclaration assez précise quant à son engagement politique et aux persécutions alléguées.
Des certificats médicaux établis à l’automne 2005 à Strasbourg font état d’une cicatrice frontale chez Y.P. et d’un « état anxio-dépressif grave, directement en relation avec les traumatismes subis au Belarus » chez L.P. Le fils du requérant a également subi une intervention chirurgicale à Strasbourg pour soigner des séquelles au bras droit.
La Commission de recours des réfugiés (CRR), saisie par les requérants, confirma le refus de la demande d’asile. La famille se rendit alors en Norvège, en Suède et au Danemark. Ils furent renvoyés du Danemark vers la France, où ils firent l’objet d’arrêtés de reconduite à la frontière en 2007 et 2008. En mars 2008, le petit garçon des requérants, né en 2006, fut hospitalisé à Paris en raison de conditions de vie précaires de la famille.
Le 29 avril 2008, l’OFPRA, sur demande de réexamen par les requérants – qui faisaient valoir qu’un retour au Belarus signifierait leur incarcération pendant deux à cinq ans – leur refusa de nouveau l’asile. Placés au centre de rétention de Rouen, ils firent auprès de la Cour européenne des droits de l’homme une demande de suspension de la mesure de renvoi à leur encontre, que la Cour accorda en vertu de l’article 39 de son Règlement (mesures provisoires) pour la durée de la procédure devant elle. Suite au rejet de leur demande auprès de l’OFPRA, les requérants engagèrent un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA, ancienne CRR), en vain.
Épuisement des voies de recours internes
Il existe en France un recours administratif suspensif pour les étrangers faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, pour en demander l’annulation dans les quarante-huit heures suivant sa notification. On ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir introduit ce recours, dans la mesure où leur demande d’asile antérieure n’avait pas abouti et que la situation au Belarus était la même qu’alors. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante, il ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres, qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès. Ainsi, la Cour estime que les requérants ont démontré l’existence de circonstances particulières qui les dispensaient de l’obligation d’épuiser la voie de recours indiquée par le gouvernement français. Leur requête est donc recevable.
Article 3
La Cour estime le récit d’Y.P. crédible : il a fourni des éléments confirmant son engagement politique et les persécutions subies, notamment les attestations de l’association « Viasna » et les certificats médicaux. Dans leur refus de sa demande d’asile – en raison de déclarations jugées peu personnalisées et peu circonstanciées – les autorités françaises n’ont mentionné aucun rapport international sur la situation au Belarus. Elles n’ont par ailleurs considéré ni la poursuite alléguée de son activité politique en France ni le sort réservé à d’autres opposants comme des indications qu’Y.P. pourrait être recherché.
Le passage du temps ne diminue pas automatiquement le risque auquel Y.P. serait exposé au Belarus. Si le Conseil de l’Europe a récemment relevé quelques évolutions positives en matière de démocratie, il note aussi les obstacles au rétablissement du statut d’invité spécial au Conseil de l’Europe du Belarus – suspendu en 1997 en raison de la dégradation de la situation des droits de l’homme – notamment la persistance du harcèlement de l’opposition. La Cour relève à cet égard qu’un individu ayant exercé des fonctions politiques similaires à celles d’Y.P. a disparu dans des circonstances inexpliquées et que d’autres sont régulièrement arrêtés.
Le degré de militantisme du requérant est suffisamment démontré par ses activités à Moghilev. Par ailleurs la probabilité que des données sur lui et sa famille soient mises à disposition des autorités biélorusses en cas de retour est confortée par les brutalités et intimidations subies par le fils d’Y.P. En outre, leur demande d’asile en France pourrait être analysée comme « discréditant le Belarus » et constituer une infraction passible d’une peine de prison, en vertu du Code pénal bélarussien. Du seul fait de leur lien avec Y.P., les membres de sa famille pourraient également être exposés à des persécutions.
Ainsi, à l’heure actuelle, un renvoi des requérants vers le Belarus emporterait violation de l’article 3.
LA MOTIVATION DE LA CEDH
a) Principes applicables
62. Si la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique, il est désormais bien établi dans la jurisprudence de la Cour que l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Saadi c. Italie [GC], no 3701/06, § 125, 28 février 2008).
63. Pour établir s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra un tel risque dans le pays de destination, on ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/66, § 67, CEDH 2005-I). Cela implique que les mauvais traitements auxquels le requérant sera selon lui exposé en cas de renvoi doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de cette disposition. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 60, CEDH 2001-II).
64. Il convient d’appliquer des critères rigoureux en vue d’apprécier l’existence d’un tel risque (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil 1996-V, et Saadi, précité, § 128). Il incombe en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
65. Pour apprécier ce risque, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour (Saadi, précité, § 133). Une appréciation ex nunc pleine et entière est requise dans la mesure où la situation dans le pays de destination peut évoluer au cours du temps. S’il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui sont déterminantes, et il est donc nécessaire de prendre en compte les informations qui sont apparues après la décision définitive prise par les autorités internes (Salah Sheekh, précité, § 136).
b) Application des principes
66. Quant aux risques encourus en cas de renvoi au Belarus, la Cour observe que le requérant soumet qu’il sera exposé aux représailles en raison de son passé d’opposant politique d’une part et de son départ du pays pour demander l’asile d’autre part.
67. La Cour rappelle que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe suit de près la situation au Belarus, et ce depuis 1992, date à laquelle elle accorda le statut d’invité spécial au Parlement de ce pays. Ce statut fut cependant suspendu en 1997 en raison de la dégradation de la situation en matière de démocratie et de droits de l’homme et, l’année suivante, sa demande d’adhésion à l’Organisation fut gelée. Récemment, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe ont pris acte de faits importants intervenus au Belarus pour renouer le dialogue avec le pays (paragraphes 38 et 39 ci-dessus). Cependant, le pays ne remplit pas, à ce jour, les conditions requises pour devenir membre du Conseil de l’Europe (voir point 1 de la résolution 1671, paragraphe 38 ci-dessus). La Cour a d’ailleurs déjà statué sur plusieurs requêtes alléguant des risques de torture ou de mauvais traitements en cas d’expulsion ou d’extradition vers le Belarus, et où elle a constaté soit l’obtention du statut de réfugié dans le pays d’accueil, soit le refus d’extrader de la part de celui-ci (Dimitrij Aleksandrevich Mostachjov et autres c. Suède (déc.), no 44891/04, 17 janvier 2006, S. c. Finlande (déc.), no 48736/06, 26 février 2008, V.B c. France, no 42975/07, 9 septembre 2008, et Svetlorusov c. Ukraine, no 2929/05, § 37, 12 mars 2009 ; voir, la partie en fait, Stankevich c. Ukraine (déc.), no 48814/07, 26 mai 2009, Dubovik c. Ukraine, nos 33210/07 et 41866/08, §§ 37 à 41, 15 octobre 2009, Koktysh c. Ukraine, no 43707/07, 10 décembre 2009, et Puzan c. Ukraine, no 51243/08, § 34, 18 février 2010).
68. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les rapports internationaux n’excluent pas que l’appartenance à l’opposition politique puisse suffire à se voir garantir la protection offerte par l’article 3. La Cour se doit cependant d’examiner la situation personnelle du requérant et vérifier la crédibilité du récit fait par lui devant les autorités nationales et au cours de la présente procédure. Il ressort des pièces versées devant les autorités nationales que le requérant est un militant actif du Front populaire, principal parti d’opposition, et qu’il fut à plusieurs reprises arrêté, intimidé et violenté par les autorités du Belarus au cours de manifestations et de prises de position. Les événements qu’il décrit se sont passés principalement à la veille de l’élection présidentielle de 2001 puis au cours des élections législatives et du référendum sur le mandat du président de 2004. Les attestations qu’il fournit notamment de l’association Viasna (laquelle se voit refuser depuis des années son enregistrement en tant qu’association), les certificats médicaux le concernant et ceux de sa famille (paragraphes 16 et 19 ci-dessus), confirment son engagement politique et les persécutions subies, le Gouvernement ne le conteste pas. Les rapports internationaux sur le respect des normes démocratiques par le Belarus corroborent la réalité de la situation à l’époque où le requérant fuit le pays (paragraphes 44 et 45 ci-dessus), en raison d’une pratique de harcèlement et d’intimidation des militants d’opposition. Dans ces conditions, la Cour estime que le récit du requérant est crédible (voir, mutatis mutandis, les allégations d’un membre du front populaire biélorusse dans la partie en fait de la décision Dimitrij Aleksandrevich Mostachjov et autres, précitée ; a contrario, Vasilina Matsiukhina et Aliaksandr Matsiukhin c. Suède, no 31260/04, 21 juin 2005).
69. Il reste que le requérant n’a pas obtenu le statut de réfugié en France (voir, un exemple contraire, V.B. c. France, no 42975/07, 9 septembre 2008). La Cour s’attachera en conséquence à examiner les motivations des autorités nationales et, le cas échéant, à les confronter avec les allégations du requérant à la lumière des informations sur la situation du pays. A cet égard, la Cour relève qu’elle a déjà considéré qu’une motivation substantielle de rejet d’une demande d’asile d’un ressortissant biélorusse n’ayant pas pu donner le nom du parti d’opposition biélorusse dont il prétendrait être membre et qui n’a demandé l’asile que tardivement après son entrée dans le pays hôte, lui suffisait pour considérer que le requérant ne courrait pas de risques de dommages irréparables en cas de retour dans ce pays (Gordyeyev c. Pologne (déc.), nos 43369/98 et 51777/99, 3 mai 2005).
70. En l’espèce, les autorités compétentes refusèrent l’asile au requérant au motif que ses déclarations étaient peu personnalisées et peu circonstanciées quant à son engagement politique. Elles considérèrent très généralement que les craintes du requérant n’était pas fondées au regard de son passé politique. Elles ne firent toutefois mention d’aucun rapport international sur la situation au Belarus. Ni l’allégation de la poursuite de son activité politique en France, ni le sort réservé à d’autres opposants politiques ne constituèrent par ailleurs pour les autorités des éléments indiquant que le requérant serait recherché (paragraphe 34 ci-dessus). Le Gouvernement reprend ces constats pour conclure également à l’absence de risque en cas de retour des requérants.
71. Pour sa part, la Cour rappelle que même après plusieurs années d’absence, le requérant peut présenter un profil à risque ; l’écoulement du temps ne saurait déterminer le risque auquel il est exposé sans que l’on se livre à une appréciation de la politique actuelle des autorités du Belarus (mutatis mutandis, NA. c. Royaume-Uni, précité, § 145). Or, la Cour l’a déjà souligné, si la récente résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relève quelques évolutions positives en matière de démocratie, dont la libération de prisonniers politiques, elle ne propose pas le rétablissement pour le moment du statut d’invité spécial au Belarus et note les obstacles à cette accession dont les plus graves sont l’absence d’abolition de la peine de mort mais aussi la persistance du harcèlement de l’opposition (paragraphe 38 ci-dessus). Même si la Cour n’a pu vérifier le degré de responsabilité exact du requérant au sein de son parti à Moghilev, elle relève qu’un individu ayant exercé des fonctions similaires, le vice-président de la section municipale du Front populaire de Vitsebsk, avait disparu dans des circonstances inexpliquées et que d’autres étaient régulièrement arrêtés (paragraphe 44 ci-dessus).
72. La Cour observe encore que le requérant a été arrêté plusieurs fois en tant que participant actif au mouvement d’opposition. Entre 1999 et 2001 ainsi qu’au cours de la période 2002-2004, il a été interrogé plusieurs fois par les autorités, détenu et parfois maltraité. Ces nombreuses arrestations et détentions, dont certaines d’entre elles ont fait l’objet de comptes rendus dans la presse ou dans des rapports de Viasna, et qui ont été forcément enregistrées, peuvent justifier la crainte du requérant de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé au Belarus. Son degré de militantisme à suffisance démontré par ses activités au sein de la ville de Moghilev, laisse présumer que le passage du temps ne diminue pas les risques de mauvais traitements. Les brutalités et intimidations dont a fait l’objet son fils conforte la probabilité que les données concernant le requérant et sa famille soient mises à disposition des autorités du Belarus dès leur retour. La Cour relève enfin que le fait d’avoir demandé l’asile en France pourrait être analysé par ces autorités comme « discréditant la République » et constituer une infraction passible d’une peine de prison (paragraphes 31, 37 et 40 ci-dessus), ce qui accentue encore le risque pour le requérant d’être exposé à des traitements prohibés par l’article 3 (mutatis mutandis, N. c Finlande, précité, § 165).
73. Quant à la requérante, la Cour ne peut exclure qu’en tant qu’épouse d’un opposant politique, elle serait exposée à des risques d’intimidation, de pressions ou de mauvais traitements si elle était renvoyée au Belarus. La Cour constate qu’une telle interprétation du risque est corroborée par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale qui dispose que « les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec le réfugié, risquent en règle générale d’être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l’octroi du statut de réfugié (point 27) » ou par le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 sur les réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR/1P/4/FRE/REV.1) qui prévoit qu’il « n’est pas nécessaire que les arguments invoqués se fondent sur l’expérience personnelle du demandeur. Ainsi, le sort subi par des parents ou des amis ou par d’autres membres du même groupe racial ou social peut attester que la crainte du demandeur d’être lui-même tôt ou tard victime de persécutions est fondée (point 43) ».
74. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère que, à l’heure actuelle, un renvoi des requérants vers le Belarus emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
M.N. et autres c. Türkiye du 21 juin 2022 requête no 40462/16
L’expulsion de Tadjiks en situation irrégulière ne violerait pas la Convention
3 • Expulsion • Possible renvoi vers le Tadjikistan de ressortissants tadjiks de confession islamique sans motifs sérieux et avérés d’un risque de traitements contraires à l’art 3 en raison de leur arrestation en Turquie dans une école coranique non enregistrée • Aucune procédure pénale contre les requérants • Acceptation par les juridictions nationales de leur qualité d’étudiants de l’école et de leur absence de lien avec l’État islamique ou une organisation illégale ou terroriste • Pas de risque de persécution en raison d’une quelconque activité politique ou sociale précédente dans le pays d’origine
Art 13 (+ Art 3) • Examen implicite et rudimentaire par les juridictions nationales du risque en cas de renvoi en raison des conditions de l’arrestation sans conséquence sur l’effectivité du recours compte tenu du faible degré de pertinence du risque allégué
L'affaire concerne le risque pour les requérants d’être expulsés de la Türkiye vers le Tadjikistan aux motifs qu’ils ne disposaient pas de visas valables et qu’ils représenteraient une menace pour la sécurité publique du fait de leur participation à des cours coraniques non enregistrés auprès des autorités turques. Dans son arrêt de chambre1 rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y aurait non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants), pris isolément ou combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, en cas de mise à exécution de la décision d’expulsion visant les requérants. La Cour juge que les requérants ne sont pas parvenus à établir qu’ils courraient un risque d’être persécutés ou de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de retour au Tadjikistan, ni en raison d’une quelconque activité politique ou sociale à laquelle ils se seraient livrés dans leur pays d’origine ni en raison des conditions de leur arrestation en Türkiye. La Cour aussi d’indiquer au Gouvernement, en vertu de l’article 39 de son règlement, de ne pas expulser les requérants jusqu’à ce que l’arrêt rendu dans cette affaire soit devenu définitif1 ou jusqu’à nouvel ordre.
Expulsion • Possible renvoi vers le Tadjikistan de ressortissants tadjiks de confession islamique sans motifs sérieux et avérés d’un risque de traitements contraires à l’art 3 en raison de leur arrestation en Turquie dans une école coranique non enregistrée • Aucune procédure pénale contre les requérants • Acceptation par les juridictions nationales de leur qualité d’étudiants de l’école et de leur absence de lien avec l’État islamique ou une organisation illégale ou terroriste • Pas de risque de persécution en raison d’une quelconque activité politique ou sociale précédente dans le pays d’origine
Art 13 (+ Art 3) • Examen implicite et rudimentaire par les juridictions nationales du risque en cas de renvoi en raison des conditions de l’arrestation sans conséquence sur l’effectivité du recours compte tenu du faible degré de pertinence du risque allégué
CEDH
Principes généraux
33. À titre préliminaire, la Cour tient à souligner qu’elle se garde de sous-estimer les difficultés qui sont liées au phénomène du flux croissant de migrants et de demandeurs d’asile et qui impliquent des complications particulières en termes d’immigration irrégulière pour des États contractants situés aux frontières de l’Europe, notamment ceux qui ont des frontières terrestres ou maritimes avec les pays dans lesquels sévit la guerre civile. Cette dernière peut avoir pour effet d’attirer sur le territoire des États contractants des personnes désireuses de prendre parti dans le conflit, c’est-à-dire des belligérants potentiels, dont la présence et les activités présenteraient également un danger éventuel pour l’ordre public de l’État hôte. Toutefois, la Cour ne peut que réitérer sa jurisprudence bien établie, selon laquelle, vu le caractère absolu de l’article 3 de la Convention, de tels facteurs ne peuvent exonérer les États contractants de leurs obligations au regard de cette disposition (voir, par exemple, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 127, 23 mars 2016, et Babajanov c. Turquie, no 49867/08, § 43, 10 mai 2016).
34. De manière générale, la Cour rappelle que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux. Cependant, l’éloignement forcé d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays (F.G. c Suède [GC], précité, § 111, et A.M. c. France, no 12148/18, § 113, 29 avril 2019).
35. Dans les affaires mettant en cause l’éloignement forcé d’un demandeur d’asile, il n’appartient pas à la Cour d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui. En effet, ce sont les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis et qui sont, à ce titre, tenues d’examiner les craintes exprimées par les requérants et d’évaluer les risques qu’ils encourent en cas de renvoi dans le pays de destination au regard de l’article 3 de la Convention (M.A. c. Belgique, no 19656/18, § 78, 27 octobre 2020).
36. La Cour doit néanmoins vérifier que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, comme d’autres États contractants ou des États tiers, des agences des Nations unies et des organisations non gouvernementales réputées pour leur sérieux (voir notamment, N.A. c. Royaume Uni, précité, § 119, F.G. c. Suède [GC], précité, § 117, et M.S. c. Slovaquie et Ukraine, no 17189/11, § 114, 11 juin 2020).
37. Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements dans les affaires d’éloignement forcé, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (Chahal c. Royaume Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil 1996‑V, Saadi [GC], no 37201/06, § 128, CEDH 2008, et X. c. Suisse, no 16744/14, § 61, 26 janvier 2017). Concernant la charge de la preuve, la Cour rappelle qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe alors au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (Saadi [GC], précité, § 129-132, F.G. c. Suède [GC], précité, § 120, et M.A. c. Belgique, précité, § 79).
38. La Cour rappelle que l’obligation d’établir la réalité des faits pertinents de la cause pendant la procédure d’examen de la demande d’asile pèse à la fois sur le demandeur d’asile et sur les autorités nationales compétentes. Lorsqu’il a été porté à la connaissance des autorités nationales que le demandeur fait vraisemblablement partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, celles‑ci doivent chercher à évaluer d’office le risque personnellement encouru par l’intéressé (M.A. c. Belgique, précité, §§ 80‑81).
39. Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé. La première étape de cette démarche consiste à examiner si l’existence d’un groupe systématiquement exposé à des mauvais traitements a été établie, question qui relève du volet de l’analyse du risque consacré à la « situation générale ». Les requérants qui appartiendraient à un groupe vulnérable ciblé doivent évoquer non pas la situation générale mais l’existence d’une pratique ou d’un risque accru de mauvais traitements visant le groupe auquel ils disent appartenir. L’étape suivante consiste pour eux à établir qu’ils appartiennent chacun au groupe concerné, sans qu’ils aient besoin de faire état d’autres circonstances individuelles ou caractéristiques distinctives. Ainsi, dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, § 99, 29 avril 2022, J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 104, 23 août 2016, A.M. c. France, précité, § 119, D et autres c. Roumanie, no 75953/16, § 63, 14 janvier 2020, et M.A. c. Belgique, précité, § 81).
40. Cela étant dit, en ce qui concerne l’évaluation de la situation générale régnant dans un pays donné, les autorités nationales qui examinent une demande de protection internationale ont pleinement accès aux informations. Pour cette raison, la situation générale dans un autre pays doit être établie d’office par les autorités nationales compétentes en matière d’immigration (J.K. et autres c. Suède, précité, § 98 ; voir également F.G. c. Suède [GC], précité, § 126, et M.A. c. Belgique, précité, § 82).
41. Pour déterminer s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des données qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office. Pour ce qui est de l’appréciation des éléments de preuve, il est établi dans la jurisprudence de la Cour que l’existence du risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’éloignement (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 61, J.K. et autres c. Suède [GC], précité, § 87, X. c. Suisse, précité, § 62, et N.A. c. Finlande, no 25244/18, § 74, 14 novembre 2019).
42. Par ailleurs, la portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction du grief du requérant. Toutefois, dans tous les cas, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000 XI, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 288, CEDH 2011). Lorsque l’article 3 est en jeu, l’effectivité requiert en outre que l’intéressé dispose d’un recours de plein droit suspensif (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007 II, Hirsi Jamaa et autres [GC], précité, § 200, et D et autres, précité, § 128). L’effectivité implique également l’existence d’un recours d’une certaine qualité. L’article 13 exige en effet un contrôle attentif, un examen indépendant et rigoureux de tout grief tiré de l’existence d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], précité §§ 293 et 387).
a) De manière générale
43. La Cour rappelle en premier lieu, comme l’avait fait la Cour constitutionnelle, que le caractère absolu de l’article 3 de la Convention fait obstacle à ce que les États contractants soient exonérés de leurs obligations découlant de cette disposition, y compris de l’obligation de ne pas éloigner une personne vers un pays lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que celle-ci courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 si on la renvoie vers ce pays. Elle estime à cet égard que les considérations exposées dans les décisions rendues le 28 avril 2016 par le tribunal administratif d’Istanbul, selon lesquelles même dans l’hypothèse où les requérants risqueraient d’être persécutés au Tadjikistan, ils ne pouvaient pas se prévaloir d’un droit au non-refoulement vers ce pays parce qu’ils présentaient une menace pour la sécurité publique en Turquie ne sont pas compatibles avec la jurisprudence de la Cour précitée en la matière (voir ci‑dessus § 33).
44. La Cour constate ensuite qu’au plan national, le tribunal administratif s’est prononcé au sujet des risques que les requérants alléguaient courir en cas de retour au Tadjikistan en se contentant de constater que ceux-ci n’avaient pas démontré qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’ils seraient soumis à de mauvais traitements dans leur pays. Le tribunal administratif a considéré que les requérants n’avaient pas explicitement précisé le type de persécution qu’ils risquaient de subir et qu’ils n’avaient pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de leurs allégations, lesquelles restaient, d’ailleurs, de portée générale. La Cour constitutionnelle, quant à elle, n’a pas repris le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel les requérants constituaient une menace pour la sécurité publique en Turquie, mais elle a estimé que les requérants n’avaient pas fourni de renseignements spécifiques sur eux-mêmes qui auraient été utiles pour apprécier leur situation, qu’ils n’avaient pas donné d’explications concrètes sur les conditions qui les auraient forcés à quitter leur pays et sur le type de problèmes qu’ils y avaient rencontrés, et n’avaient pas fourni de documents s’y rapportant. La Cour note que les deux juridictions nationales ne se sont pas clairement prononcées sur le risque qui aurait été déduit des conditions d’arrestation des requérants en Turquie susceptibles de conduire les autorités tadjikes à les soupçonner d’avoir des liens avec une organisation terroriste.
45. Afin d’opérer son contrôle européen sur l’appréciation livrée par les instances nationales, la Cour, après avoir rappelé brièvement l’état des droits de l’homme au Tadjikistan, examinera les risques auxquels les requérants disent être exposés, du point de vue, d’une part, de leur situation dans leur pays et, d’autre part, de leur arrestation en Turquie.
46. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans le cadre des affaires précédentes que les personnes soupçonnées de faire partie de l’opposition ou des mouvements, groupes ou partis de tendance islamiste (notamment du Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan) ainsi que les personnes accusées d’être liées à des extrémistes islamistes, pouvaient être particulièrement exposées à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, qui seraient largement répandus dans le pays comme moyens d’interrogatoire ou de répression. Si les rapports émanant d’États ou d’organisations internationales et non gouvernementales font état de représailles contre les personnes ne respectant pas les consignes gouvernementales en matière d’éducation religieuse des enfants de moins de 18 ans, il n’en est pas ainsi des adultes pratiquant et étudiant la religion musulmane individuellement ou en communauté, sauf s’ils appartiennent aux groupes islamistes extrémistes (Gaforov c. Russie, no 25404/09, §§ 101‑140, 21 octobre 2010, Azimov c. Russie, no 67474/11, §§ 102-143, 18 avril 2013).
b) Sur les risques auxquels les requérants disent être exposés en raison de leur situation dans leur pays d’origine
47. La Cour note à cet égard que les requérants ne font état d’aucune activité politique qu’ils auraient menée au Tadjikistan avant de venir en Turquie et qui serait considérée par les autorités de ce pays comme illégale. Les requérants n’allèguent d’ailleurs pas qu’ils étaient membres d’un mouvement ou d’une organisation réputé(e) illégal(e) ou contestataire au Tadjikistan. La Cour observe sur ce point que les requérants ne font état non plus d’aucune enquête pénale dirigée contre eux au Tadjikistan. En outre, il ne ressort pas du dossier que les autorités du Tadjikistan aient lancé des avis de recherche contre eux pour une quelconque activité illégale effectuées au Tadjikistan. Ces autorités n’ont pas cherché non plus à faire rentrer les requérants au Tadjikistan par la contrainte ou par la menace.
48. La Cour observe également qu’aucun élément du dossier n’indique que les requérants aient eu du mal à obtenir leur passeport au Tadjikistan. Ils ont pu quitter leur pays régulièrement et se sont rendus en Turquie munis d’un visa d’entrée ordinaire.
49. Les allégations des requérants sur les problèmes qu’ils auraient rencontrés dans leur pays d’origine avant de venir en Turquie sont qu’ils ne pouvaient pas faire d’études coraniques à leur guise. Or les rapports des organisations internationales ne signalent aucune persécution ayant pour origine des cours coraniques dispensés aux adultes, pourvu que les établissements concernés n’aient pas de connections avec des groupes extrémistes islamiques.
50. Par conséquent, la Cour estime, à l’instar des instances nationales, que les requérants ne sont pas parvenus à établir qu’ils courraient un risque d’être persécutés, en cas de retour au Tadjikistan, en raison d’une quelconque activité politique ou sociale à laquelle ils se seraient livrés dans leur pays d’origine.
c) Sur les risques auxquels les requérants disent être exposés du fait des conditions de leur arrestation en Turquie
51. La Cour examine, en second lieu, les allégations des requérants selon lesquelles, en raison des fausses informations diffusées dans la presse au sujet de leur arrestation et des motifs invoqués dans l’arrêté d’expulsion pris à leur encontre, les autorités tadjikes pourraient croire qu’ils ont un lien avec l’État islamique. Les requérants en prennent pour preuve le fait que des fonctionnaires du consulat du Tadjikistan à Istanbul sont venus au centre de rétention de Kumkapı pour s’enquérir de leur situation. Ils estiment qu’en raison de ces soupçons, ils risquent d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’ils étaient renvoyés au Tadjikistan dans le cadre d’une procédure d’expulsion.
52. La Cour observe que les juridictions nationales n’ont examiné qu’implicitement et de manière rudimentaire les allégations des requérants quant aux risques qu’ils auraient encourus en cas de renvoi au Tadjikistan en raison des conditions de leur arrestation en Turquie. Le tribunal administratif s’est contenté de dire qu’il n’était pas établi de manière générale qu’ils étaient membres d’un groupe illégal. La Cour constitutionnelle a relevé que leur croyance religieuse ne les exposait à aucun risque particulier dans leur pays. Toutefois, ces quelques défaillances dans l’examen effectué par les instances nationales ne suffisent pas en soi pour conclure à une violation de l’article 3 combiné avec l’article 13 de la Convention, compte tenu du faible degré de pertinence du risque allégué par les requérants dans les circonstances particulières de la présente affaire.
53. En effet, quant à la couverture médiatique de l’arrestation des requérants dans une école coranique non enregistrée, la Cour observe que certains médias ont présenté l’opération et les perquisitions menées par la police d’Istanbul dans cette école comme une action visant des milieux présumés proches de l’État islamique. Toutefois, au cours de ces campagnes médiatiques, il a été fait usage certes de titres à sensation, mais aussi de termes très généraux faisant état d’un nombre approximatif d’adultes et de mineurs qui s’étaient trouvés sur place et avaient été appréhendés par la police. Les noms ou l’identité des requérants n’étaient pas mentionnés. Les informations publiées dans ces médias n’ont pas été reprises par les autorités officielles et n’ont en aucun cas fait apparaître une éventuelle responsabilité pénale des requérants. D’ailleurs, les agents de police ont noté dans le procès-verbal de la perquisition qu’aucun élément relatif à une quelconque délit n’avait été retrouvé sur les lieux. Il en ressort que les autorités pénales turques chargées de l’affaire ont accepté la version des faits des requérants, à savoir qu’ils étudiaient le Coran dans une medrese (école religieuse) non enregistrée, et qu’ils n’avaient aucun lien avec l’État islamique ou toute autre organisation islamiste.
54. Quant à l’ordre d’expulsion des requérants, qui avait notamment pour motif la menace que leur présence en Turquie pouvait constituer pour la sécurité publique, la Cour relève que le tribunal administratif n’a pas admis que les requérants pussent faire partie d’une organisation illégale ou terroriste telle que l’État islamique. Il a simplement considéré que leur présence pouvait poser un problème pour la sécurité publique en Turquie au motif qu’il s’agissait d’étudiants dans un établissement qui n’avait pas été déclaré aux autorités turques et qui n’était pas donc soumis au contrôle et à la surveillance de celles-ci. Il a aussi tenu compte du fait que les requérants se trouvaient en situation irrégulière en Turquie, puisque leurs visas d’entrée étaient déjà périmés lorsqu’ils avaient été appréhendés. Il ne peut en être déduit que les requérants étaient considérés par les autorités judiciaires turques comme des militants potentiels de l’État islamique.
55. En ce qui concerne le fait que les agents du consulat de Tadjikistan à Istanbul se sont rendus au centre de rétention, afin de s’entretenir avec les requérants et de s’enquérir de leur situation, la Cour rappelle qu’il est du devoir des agents d’un consulat d’intervenir pour les ressortissants de leur pays lorsque ces derniers sont privés de leur liberté par les autorités du pays hôte. À supposer que lesdits agents eussent été informés des allégations des journaux selon lesquelles les personnes arrêtées étaient proches de l’État islamique, elle estime que les requérants étaient en mesure d’expliquer aux agents du consulat qu’ils n’étaient que de simples étudiants dans ces cours coraniques, comme ils l’ont fait devant les autorités turques. Ces dernières semblaient d’ailleurs convaincues de leur explication puisque, comme il a été expliqué ci-dessus, d’une part, les requérants n’ont fait l’objet d’aucune procédure pénale et que, d’autre part les juridictions administratives n’ont pas considéré qu’ils pouvaient être liés à une organisation terroriste.
56. À la lumière de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, la Cour considère que les requérants n’ont pas démontré qu’il y avait de motifs sérieux et avérés de croire que, s’ils sont renvoyés en Tadjikistan, ils y courront un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
En conséquence, la Cour estime que la mise à exécution de la décision d’expulsion visant les requérants n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13.
Savriddin Dzhurayev C. Russia du 25 avril 2013 Requête n° 71386/10
La CEDH constate une violation de l'article 3 pour l'extradition vers ce pays pour cause de risque de torture.
KHOLMURODOV c. RUSSIE du 1er mars 2016 requête 58923/14
Extradition contraire à l'article 3 : Une meilleure protection est requise dans les affaires d’extradition au sens de l'article 3 combiné à l'article 13 de la Convention. L'extradition pour cause religieuse et politique serait contraire à l'article 3 de la Convention
L’appréciation de la Cour sur l'article 3
56. La Cour note, à titre liminaire, que le service du procureur général russe n’a pas encore statué sur la demande d’extradition du requérant (voir la thèse du Gouvernement ci-dessus). Elle observe cependant que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de l’intéressé est toujours en vigueur et que la procédure d’expulsion n’a été suspendue qu’à la suite de l’indication par elle d’une mesure provisoire sur la base de l’article 39 de son règlement. Eu égard à ces circonstances, la Cour estime que le risque à l’origine du grief formulé sous l’angle de l’article 3 de la Convention reste d’actualité (voir, pour une approche similaire, Fozil Nazarov c. Russie, no 74759/13, § 32, 11 décembre 2014).
(a) Principes généraux
57. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’extradition ou l’expulsion d’une personne par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 de la Convention implique l’obligation de ne pas renvoyer la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 90-91, série A no 161, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 103, série A no 215, et Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 135, 11 janvier 2007).
58. Afin de déterminer s’il est établi que le requérant court un risque réel, en cas d’extradition ou d’expulsion, de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, Salah Sheekh, précité, § 136). Pour apprécier l’existence de ce risque, il faut se référer par priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition ou d’expulsion (Vilvarajah, précité, §107, Riabikine c. Russie, no 8320/04, § 111, 19 juin 2008). Toutefois, si le renvoi ne s’est pas produit au moment où la Cour examine l’affaire, elle doit effectuer cette appréciation à la lumière des circonstances présentes, tout en tenant compte des faits précédents dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle (voir Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 85-86, Recueil 1996-V).
59. L’examen de la question doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers le pays demandant l’extradition ou l’expulsion, compte tenu de la situation générale dans le pays en question et des circonstances propres au cas du requérant (Vilvarajah et autres, précité, § 108, Umirov c. Russie, no 17455/11, § 94, 18 septembre 2012).
60. En ce qui concerne la situation générale dans un pays particulier, la Cour peut accorder une certaine importance aux informations contenues dans des rapports récents d’organisations indépendantes de défense des droits de l’homme ou aux informations issues des sources gouvernementales (voir, par exemple, Chahal, précité, §§ 99-100, Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 67, 26 avril 2005, et Said c. Pays-Bas, no 2345/02, § 54, CEDH 2005‑VI).
61. En même temps, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la Convention (Vilvarajah et autres, précité, § 111, et Saadi c. Royaume‑Uni, no 13229/03, § 131, 11 juillet 2006). Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 73, CEDH 2005‑I, et Müslim, précité, § 68).
62. En principe, il appartient au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure dénoncée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels qu’ils pourraient faire naître (Riabikine, précité, § 112, et Saadi, précité, § 129).
(b) Application des principes précités au cas d’espèce
63. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans un certain nombre d’affaires à raison du risque de mauvais traitements qu’encouraient les individus susceptibles d’être extradés ou expulsés de la Russie ou d’un autre État membre du Conseil de l’Europe vers l’Ouzbékistan. En se fondant sur diverses sources, tels des rapports des institutions des Nations unies et d’organisations non gouvernementales internationales, la Cour a relevé que la situation générale des droits de l’homme en Ouzbékistan était alarmante et qu’il y avait un problème sérieux et persistant de mauvais traitements de détenus – la pratique de torture des individus incarcérés étant décrite comme « systématique » et « inconsidérée » (voir, parmi d’autres, Mukhitdinov c. Russie, no 20999/14, § 52, 21 mai 2015, Fozil Nazarov, précité, § 34, Egamberdiyev, précité, § 47, Garayev c. Azerbaïdjan, no 53688/08, § 71, 10 juin 2010). Eu égard aux informations contenues dans les rapports récents provenant des institutions des Nations unies et d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme (paragraphes 46‑50 ci‑dessus), la Cour constate qu’il n’y a pas eu d’évolution tangible de la situation dans ce domaine et que le problème de torture et de mauvais traitements de détenus en Ouzbékistan reste d’actualité.
64. En outre, la Cour rappelle avoir jugé à plusieurs reprises que les individus accusés par les autorités de l’Ouzbékistan d’infractions à caractère politique et religieux constituaient un groupe vulnérable, systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements dans ce pays (Mukhitdinov, précité, § 45, avec les références qui y sont citées). Ainsi, une fois qu’un individu susceptible d’être expulsé ou extradé vers ce pays a pu démontrer son appartenance à ce groupe, il n’est pas tenu d’établir l’existence d’autres caractéristiques particulières qui le distingueraient personnellement pour démontrer qu’il était et continue d’être personnellement en danger (Saadi, précité, § 132, CEDH 2008, Zokhidov c. Russie, no 67286/10, § 138, 5 février 2013).
65. En l’espèce, la Cour relève que le requérant est accusé en Ouzbékistan, entre autres, d’atteinte à l’ordre constitutionnel, de fabrication ou divulgation de matériel portant atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, ainsi que de création et direction d’organisations religieuses extrémistes, séparatistes, fondamentalistes ou d’autres organisations interdites et de participation à de telles organisations (paragraphe
12 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, ces accusations sont indubitablement à caractère politique et religieux, ce qui place le requérant dans le groupe des personnes particulièrement vulnérables encourant le risque de mauvais traitements en cas de retour en Ouzbékistan (Nizamov et autres c. Russie, nos 22636/13, 24034/13, 24334/13 et 24528/13, § 41‑43, 7 mai 2014).
66. Le Gouvernement ayant fait observer que les autorités ouzbèkes avaient présenté des assurances selon lesquelles le requérant ne serait pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, la Cour rappelle que des assurances diplomatiques ne sont pas en elles‑mêmes suffisantes. Il faut que ces assurances fournissent, dans leur application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera effectivement protégé contre le risque de mauvais traitements (Othman (Abu Qatada) c. Royaume‑Uni, no 8139/09, § 187, CEDH 2012 (extraits)). En l’occurrence, la Cour note que les assurances données par les autorités ouzbèkes ne prévoient pas de mécanismes, diplomatiques ou reposant sur l’intervention d’observateurs, qui permettraient d’assurer un contrôle objectif de leur respect (ibidem, § 189). Partant, elle considère que les assurances en question ne sont pas suffisantes pour garantir que le requérant ne serait pas soumis à des mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Ouzbékistan (Khalikov c. Russie, no 66373/13, § 53, 26 février 2015, Zokhidov, précité, § 141).
67. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel l’Ouzbékistan est lié par ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l’homme, la Cour tient à rappeler que l’existence de textes internes et la ratification de traités internationaux garantissant le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque, comme en l’espèce, des sources fiables font état de pratiques des autorités – ou tolérées par celles‑ci – manifestement contraires aux principes de la Convention (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 128, CEDH 2012).
68. Enfin, l’argument du Gouvernement consistant à dire que l’absence de danger pour la vie ou la santé du requérant en cas de retour en Ouzbékistan est confirmée par des démarches effectuées par l’intéressé – à savoir, un retrait de la demande d’asile et une introduction tardive de la demande d’asile temporaire – et par de nombreux franchissements de la frontière par celui-ci entre 2005 et 2012 ne convainc pas la Cour. En effet, la Cour ne voit pas en quoi les agissements du requérant cités par le Gouvernement pourraient avoir une influence sur la réalité du risque encouru par l’intéressé, en tant que personne accusée d’infractions à caractère politique et religieux, en cas de retour en Ouzbékistan (Rakhimov c. Russie, no 50552/13, § 91‑92, 10 juillet 2014).
69. La Cour en déduit que le Gouvernement n’a présenté aucun fait ou argument à même de la convaincre de parvenir à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans les arrêts mentionnés au paragraphe 63 ci-dessus.
70. Partant, la Cour conclut que le renvoi du requérant en Ouzbékistan exposerait ce dernier à un risque réel d’être soumis à des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
L'appréciation de la Cour au sens de l'article 3 combiné à l'article 13 de la Convention.
76. L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils s’y trouvent consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Compte tenu de l’importance que la Cour attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention ainsi qu’une célérité particulière. Il requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, §§ 78 et 82, CEDH 2012 et les arrêts auxquels il renvoie).
77. La Cour observe que le requérant a mis en avant le risque de mauvais traitements qu’il estimait encourir en Ouzbékistan aussi bien dans le cadre de la procédure d’expulsion que dans celui de la procédure relative au statut de réfugié temporaire (paragraphes 24 et 31 ci-dessus). Or à supposer que ces procédures soient en principe susceptibles de remplir les conditions rappelées au paragraphe 76 ci‑dessus, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, en ce qui concerne la première procédure, les tribunaux ont omis d’examiner les arguments du requérant quant à un risque de mauvais traitements, se bornant à motiver la mesure d’éloignement par des considérations de protection de l’ordre public (paragraphes 26 et 28 ci‑dessus). Quant à la procédure d’asile temporaire, la Cour relève que la décision du 27 avril 2015 du bureau du SFM de la région de Kostroma, par laquelle le requérant a obtenu l’asile temporaire, ne contenait ni une analyse de sa situation personnelle ni une évaluation du risque qu’il courrait en cas d’expulsion vers l’Ouzbékistan, et qu’elle se bornait à évoquer la mesure provisoire indiquée par la Cour en application de l’article 39 de son règlement (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour en déduit que ni l’une ni l’autre de ces procédures n’ont offert au requérant le contrôle attentif et l’examen rigoureux qu’exige l’article 13 quant à son allégation selon laquelle il risquait de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi vers l’Ouzbékistan.
78. Relevant ensuite que le Gouvernement ne prétend pas que le requérant avait accès à une autre procédure remplissant les critères rappelés ci‑dessus, la Cour conclut qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
Mamazhonov c. Russie du 23 octobre 2014 requête 17239/13
Extradition contraire à l'article 3 : Disparition d’un ressortissant ouzbek ; une meilleure protection est requise dans les affaires d’extradition
Le risque de subir des mauvais traitements en Ouzbékistan. La Cour observe d’emblée que, depuis plus de dix ans, des organes des Nations unies et des organisations non gouvernementales publient des rapports alarmants sur les défaillances du système de justice pénale de l’Ouzbékistan, le recours à la torture par les organes d’application des lois, la persécution systémique de l’opposition politique et le traitement très dur réservé à certains groupes religieux. Compte tenu de ces rapports et d’affaires analogues portées devant la Cour, les autorités russes avaient des raisons sérieuses de penser que M. Mamazhonov serait exposé à un risque réel de subir des mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Ouzbékistan. En outre, tous les documents soumis aux autorités russes par les organes ouzbeks d’application des lois dans le contexte de la coopération juridique relative à l’extradition indiquaient clairement que M. Mamazhonov avait été accusé d’infractions inspirées par des motifs religieux et politiques.
Les juridictions et autorités de poursuite russes sont néanmoins restées en défaut d’examiner convenablement les griefs de M. Mamazhonov. En effet, le procureur général adjoint de la Fédération de Russie, se fiant totalement aux assurances diplomatiques données par les autorités ouzbèkes, a autorisé l’extradition de M. Mamazhonov sans faire aucun effort pour apprécier les risques réels. Concernant les juridictions russes, il est difficile de concilier, d’une part, le récent arrêt de la Cour suprême recommandant aux juridictions inférieures d’examiner de manière plus approfondie les allégations de mauvais traitements et, d’autre part, la position restrictive qui a été adoptée dans la cause de M. Mamazhonov, d’autant que la Cour suprême était indéniablement informée que la Cour européenne des droits de l’homme avait indiqué une mesure provisoire au gouvernement russe. Dès lors, la Cour conclut que les allégations de M. Mamazhonov, bien que suffisamment étayées, n’ont pas été convenablement appréciées par les autorités russes, au mépris de l’article 3.
S’agissant de la question de savoir si le requérant est exposé à un risque réel de mauvais traitements, la Cour observe en particulier que le système de justice pénale de l’Ouzbékistan ne s’est pas amélioré ces dernières années, notamment en ce qui concerne les poursuites pour infractions inspirées par des motifs religieux et politiques, et que certains éléments montrent que les personnes accusées de telles infractions sont exposées au risque de subir des mauvais traitements. La Cour conclut dès lors que le fait d’avoir autorisé le transfert de M. Mamazhonov vers l’Ouzbékistan a exposé l’intéressé au risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3.
LES EXTRADITIONS ET MAE AU SEIN DE L'UE
Bivolaru et Moldovan c. France requêtes nos 40324/16 et 12623/17 du 25 mars 2021
Article 3 : Violation pour Moldovan et non violation pour Bivolaru : La Cour précise les conditions d’application de la présomption de protection équivalente dans des litiges relatifs à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen
Les affaires concernent la remise des requérants par la France aux autorités roumaines en exécution de mandats d’arrêts européens (MAE) aux fins d’exécution d’une peine de prison. Elles ont conduit la Cour à préciser les conditions d’application de la présomption de protection équivalente dans pareille hypothèse.
La Cour juge que la présomption de protection équivalente s’applique au cas de M. Moldovan dans la mesure où les deux conditions de son application, à savoir l’absence de marge de manœuvre pour les autorités nationales et le déploiement de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne (UE) sont remplies.
La Cour s’est dès lors bornée à vérifier si la protection des droits garantis par la Convention était ou non entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser cette présomption. Pour ce faire, elle a recherché si l’autorité judiciaire d’exécution disposait ou non de bases factuelles suffisamment solides pour devoir conclure que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque concret et individuel d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en raison de ses conditions de détention en Roumanie.
La Cour relève que M. Moldovan a fourni des éléments suffisamment étayés sur la réalité du risque pour impliquer que l’autorité judiciaire d’exécution demande des informations complémentaires et des garanties à l’État d’émission quant à ses futures conditions de détention en Roumanie. La Cour conclut à une violation de l’article 3 dans la mesure où il apparaît que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, les autorités judiciaires d’exécution n’ont pas tiré les conséquences qui s’attachaient aux éléments d’information recueillis qui constituaient pourtant une base factuelle suffisamment solide pour qu’elles doivent refuser d’exécuter le MAE litigieux.
S’agissant de M. Bivolaru, la Cour estime que, du fait de son choix de ne pas saisir la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur les conséquences à tirer sur l’exécution d’un MAE de l’octroi du statut de réfugié par un État membre à un ressortissant d’un État tiers devenu par la suite également État membre, la Cour de cassation a statué sans que le mécanisme international pertinent de contrôle du respect des droits fondamentaux ait pu déployer l’intégralité de ses potentialités. La présomption de protection équivalente ne trouve donc pas à s’appliquer.
Le grief soulevé par M. Bivolaru comporte deux branches respectivement relatives aux conséquences de son statut de réfugié et aux conditions de détention en Roumanie. Aucun élément du dossier instruit par l’autorité judiciaire d’exécution ou des éléments apportés par le requérant devant la Cour n’indiquent que ce dernier risquait encore, en cas de remise, d’être persécuté pour des raisons religieuses en Roumanie. La Cour estime que l’autorité judiciaire d’exécution, au terme de l’examen approfondi et complet de la situation personnelle du requérant auquel elle a procédé et qui manifeste l’attention qu’elle a portée à son statut de réfugié, ne disposait pas de bases factuelles suffisamment solides pour caractériser l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention et refuser, pour ce motif, l’exécution du MAE.
La Cour estime d’autre part que la description faite par le requérant devant l’autorité judiciaire d’exécution, à l’appui de sa demande de ne pas exécuter le MAE dont il faisait l’objet, des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains n’était ni suffisamment détaillée ni suffisamment étayée pour constituer un commencement de preuve d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 en cas de remise aux autorités roumaines.
La Cour estime qu’il n’incombait pas à l’autorité judiciaire d’exécution de demander des informations complémentaires aux autorités roumaines. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’autorité judiciaire d’exécution ne disposait pas de bases factuelles solides lui permettant de caractériser l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention et refuser, pour ce motif, l’exécution du MAE.
Art 3 (matériel) • Traitement inhumain et dégradant • Remise d’un requérant aux autorités roumaines en exécution d’un mandat d’arrêt européen en présence d’un risque réel de mauvaises conditions de détention • Remise d’un requérant, reconnu réfugié par les autorités suédoises, aux autorités roumaines en exécution d’un mandat d’arrêt européen en l’absence d’un risque réel de persécution et de mauvaises conditions de détention
FAITS
M. Moldovan fut condamné par le tribunal de Mures (Roumanie) à sept ans et six mois d’emprisonnement en juin 2015, pour des faits de traite des êtres humains commis courant 2010 en Roumanie et en France. Il retourna en France après son procès. Le 29 avril 2016, les autorités roumaines émirent un MAE à l’encontre de M. Moldovan en vue de l’exécution de la peine de prison. En juin 2016, le requérant, qui faisait l’objet d’un contrôle judiciaire l’obligeant à se présenter au commissariat de police de Clermont-Ferrand une fois par semaine, fut appréhendé et le MAE lui fut notifié. Devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, il fit valoir que sa remise ne pouvait être accordée sans que la chambre de l’instruction n’ait au préalable sollicité et obtenu des informations complémentaires sur les conditions de sa détention future en Roumanie. La chambre de l’instruction fit cette demande afin d’apprécier l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. Après réception de ces éléments d’information, la chambre d’instruction releva, par un arrêt rendu le 5 juillet 2016, l’absence d’obstacle à la remise de M. Moldovan. Le pourvoi en cassation formé par M. Moldovan contre cet arrêt fut rejeté le 10 août 2016. Le 26 août 2016, le requérant fut remis aux autorités roumaines en exécution du MAE. M. Bivolaru, leader d’un mouvement spirituel de yoga depuis les années 1990, fit l’objet de poursuites pénales en Roumanie en 2004. Il gagna la Suède en 2005 où il demanda l’asile politique et obtint un titre de séjour permanent en qualité de réfugié, ce qui lui permit de voyager dès 2007. Par un arrêt du 14 juin 2013, la Haute Cour de Roumanie le condamna par défaut à une peine de six ans d’emprisonnement du chef de rapports sexuels avec un mineur. Le 17 juin 2013, le tribunal départemental de Sibiu délivra un MAE au nom du requérant en vue de l’exécution de cette peine. En février 2016, M. Bivolaru fut appréhendé à Paris alors qu’il circulait sous une fausse identité, muni de faux papiers bulgares. Devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, il s’opposa à l’exécution du MAE en faisant valoir que le statut de réfugié accordé par la Suède ainsi que les motifs politiques et religieux de sa condamnation en Roumanie l’exposeraient à des traitements inhumains et dégradants et constituaient par conséquent un obstacle absolu à sa remise. La chambre de l’instruction ordonna un complément d’information. Les autorités suédoises fournirent des précisions, dont celle qu’elles n’avaient pas engagé de procédure de retrait du statut de réfugié de M. Bivolaru. Le 8 juin 2016, la chambre de l’instruction ordonna la remise de M. Bivolaru aux autorités judiciaires roumaines. Elle considéra notamment que la remise était demandée aux fins de l’exécution d’une condamnation prononcée en répression d’une infraction de droit commun et déduisit de la jurisprudence de la Cour que les affirmations du requérant selon lesquelles il avait été condamné en raison de ses opinions politiques étaient de simples allégations. Elle estima également qu’il ne lui appartenait pas de rechercher si le requérant courrait un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention en Roumanie. M. Bivolaru forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 12 juillet 2016, jugeant que le statut de réfugié accordé par la Suède ne s’opposait pas à l’exécution du MAE. Le 13 juillet 2016, M. Bivolaru demanda, sur le fondement de l’article 39 du Règlement de la Cour, la suspension de l’exécution de la mesure de remise aux autorités roumaines. Le 15 juillet 2016, la Cour ne fit pas droit à cette demande. Une semaine plus tard, M. Bivolaru fut conduit en Roumanie en exécution du MAE, et incarcéré. Il fut remis en liberté conditionnelle le 13 septembre 2017.
Article 3 Lorsqu’ils appliquent le droit international, les Etats contractants demeurent soumis aux obligations qu’ils ont contractées en adhérant à la Convention européenne des droits de l’homme. Une mesure prise en vertu d’obligations juridiques internationales doit être réputée justifiée dès lors que l’organisation internationale en question accorde aux droits fondamentaux une protection équivalente ou comparable à celle assurée par la Convention. Si l’on considère que l’organisation offre une protection équivalente, il y a lieu de présumer que les Etats respectent les exigences de la Convention lorsqu’ils exécutent des obligations juridiques résultant de leur adhésion à l’organisation.
La Cour doit vérifier si les conditions d’application de la présomption de protection équivalente sont remplies dans les circonstances de l’espèce. Si tel est le cas, elle doit s’assurer que l’autorité d’exécution du MAE avait vérifié que celui-ci ne donnait pas lieu à une insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention. Dans le cas contraire où les conditions d’application de la présomption de protection équivalente ne seraient pas toutes remplies, la Cour doit contrôler comment l’autorité judiciaire d’exécution a procédé pour rechercher s’il existait un risque réel et individualisable de violation des droits protégés par la Convention en cas d’exécution du MAE. Elle doit se prononcer sur le point de savoir si la remise du requérant est contraire à l’article 3.
Affaire Moldovan
En ce qui concerne la première condition d’application de la présomption de protection équivalente, à savoir l’absence de marge de manœuvre pour les autorités nationales, la Cour relève que l’obligation juridique pesant sur l’autorité judiciaire d’exécution du MAE résulte des dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584/JAI telles qu’interprétées par la CJUE depuis l’arrêt Aranyosi et Căldăraru. En l’état de la jurisprudence de la CJUE, l’autorité judiciaire d’exécution était autorisée à déroger, dans des circonstances exceptionnelles, aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelle entre États membres en reportant voire, le cas échéant, en refusant l’exécution du MAE. Saisie de la contestation de l’exécution du MAE au motif que celle-ci exposerait le requérant au risque d’être détenu en Roumanie dans des conditions contraires à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, il appartenait à l’autorité judiciaire d’exécution d’apprécier la réalité des défaillances systémiques dans l’État membre d’émission alléguées par le requérant puis, le cas échéant, de procéder à un examen concret et précis du risque individuel de traitement inhumain et dégradant auquel celui-ci serait exposé en cas de remise. La Cour relève la convergence, s’agissant de la caractérisation d’un risque individuel réel, entre les exigences posées par la CJUE et celles qui résultent de sa jurisprudence. Il s’ensuit que la chambre de l’instruction aurait dû refuser l’exécution du MAE si, au terme du contrôle décrit précédemment, elle avait considéré qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant risquerait réellement, en cas de remise, d’être soumis à un traitement inhumain et dégradant en raison de ses conditions de détention. Pour autant, ce pouvoir d’appréciation des faits et des circonstances ainsi que des conséquences juridiques devant y être attachées dont dispose l’autorité judiciaire est exercé dans le cadre strictement défini par la jurisprudence de la CJUE et pour assurer l’exécution d’une obligation juridique dans le plein respect du droit de l’UE, à savoir l’article 4 de la charte des droits fondamentaux qui assure une protection équivalente à celle qui résulte de l’article 3 de la Convention. Dans ces conditions, l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait être regardée comme disposant, pour assurer ou refuser l’exécution du MAE, d’une marge de manœuvre autonome de nature à entraîner la non-application de la présomption de protection équivalente. S’agissant de la seconde condition d’application, à savoir le déploiement de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union, la Cour relève l’absence, eu égard à la jurisprudence de la CJUE, de difficulté sérieuse liée à l’interprétation de la décision-cadre et à la question de sa compatibilité avec les droits fondamentaux qui permettrait de considérer qu’il aurait été nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel à la CJUE. La seconde condition d’application de la présomption de protection équivalente doit donc être considérée comme remplie. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la présomption de protection équivalente trouve à s’appliquer au cas d’espèce. Dès lors, la Cour doit vérifier si la protection des droits garantis par la Convention est entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser cette présomption, auquel cas le respect de la Convention en tant qu’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale. Pour ce faire, elle s’attachera à déterminer si l’autorité judiciaire d’exécution disposait ou non de bases factuelles suffisamment solides pour devoir conclure que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque concret et individuel d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en raison de ses conditions de détention en Roumanie. La Cour relève tout d’abord que le requérant a produit devant les juridictions internes des éléments attestant des défaillances systémiques ou généralisées au sein des établissements pénitentiaires de l’État d’émission. Elle note le caractère sérieux et précis des éléments qu’il a présentés, devant la chambre de l’instruction puis devant la Cour de cassation, faisant état des défaillances du système pénitentiaire roumain, et, en particulier, de l’établissement de Gherla, centre dans lequel les autorités roumaines envisageaient de l’incarcérer. La Cour note ensuite les diligences du juge interne qui a sollicité des informations complémentaires auprès des autorités roumaines. Au vu des précisions qui lui ont été apportées dans le cadre de cet échange d’informations, l’autorité judiciaire d’exécution a estimé que l’exécution du MAE litigieux n’emportait pas de risque d’une violation de l’article 3 à l’encontre du requérant. La Cour considère pour sa part que cette autorité disposait de bases factuelles suffisantes pour reconnaître l’existence d’un tel risque. En premier lieu, la Cour estime que les informations fournies par l’État d’émission n’ont pas été suffisamment mises en perspective avec sa jurisprudence, en particulier en ce qui concerne la situation de l’établissement pénitentiaire de Gherla présenté comme celui dans lequel le requérant devait être incarcéré. La Cour rappelle que, dans sa jurisprudence, une superficie de 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective constitue la norme minimale applicable au regard des exigences de l’article 3 de la Convention. Elle considère que l’autorité judiciaire d’exécution disposait d’informations relatives à l’espace personnel qui serait réservé au requérant donnant lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. En deuxième lieu, la Cour relève que les engagements des autorités roumaines relativement aux autres aspects des conditions de détention au sein de l’établissement de Gherla, qui auraient été de nature à permettre d’écarter l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3, étaient formulés de manière stéréotypée et n’ont pas été mobilisés par l’autorité judiciaire d’exécution dans son évaluation du risque. En troisième lieu, la Cour considère que, si les autorités roumaines n’ont pas exclu que le requérant puisse être détenu dans un autre établissement pénitentiaire que celui de Gherla, la précaution prise à cet égard par l’autorité judiciaire d’exécution, à savoir la recommandation que le requérant soit détenu dans un établissement offrant des conditions identiques sinon meilleures, n’est pas suffisante pour écarter un risque réel de traitement inhumain et dégradant. La Cour considère par conséquent que l’autorité judiciaire d’exécution disposait de bases factuelles suffisamment solides, provenant en particulier de sa propre jurisprudence, pour caractériser l’existence d’un risque réel que le requérant soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses conditions de détention en Roumanie et ne pouvait dès lors s’en remettre exclusivement aux déclarations des autorités roumaines. Elle en déduit, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une insuffisance manifeste de protection des droits fondamentaux de nature à renverser la présomption de protection équivalente. La Cour constate la violation de l’article 3 de la Convention.
Affaire Bivolaru
Le grief soulevé sous l’angle de l’article 3 par M. Bivolaru comporte deux branches respectivement relatives aux conséquences de son statut de réfugié et aux conditions de détention en Roumanie. En ce qui concerne l’application de la présomption de la protection équivalente, la Cour note que la Cour de cassation a écarté la demande du requérant tendant à saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur les conséquences à tirer sur l’exécution d’un MAE de l’octroi du statut de réfugié par un État membre à un ressortissant d’un État tiers devenu par la suite également État membre. Il s’agit d’une question réelle et sérieuse quant à la protection des droits fondamentaux par le droit de l’UE et son articulation avec la protection issue de la Convention de Genève de 1951 sur laquelle la CJUE ne s’est jamais prononcée. La Cour estime que, du fait du choix de ne pas procéder au renvoi à la CJUE, la Cour de cassation a statué sans que le mécanisme international de contrôle du respect des droits fondamentaux, en principe équivalent à celui de la Convention, ait pu déployer l’intégralité de ses potentialités. Au regard de ce choix et de l’importance des enjeux en cause, la présomption de protection équivalente ne trouve pas à s’appliquer. Dès lors, il revient à la Cour de contrôler comment l’autorité judiciaire d’exécution a procédé pour rechercher s’il existait un risque réel qu’en cas d’exécution du MAE, le requérant soit exposé à des persécutions en raison de ses convictions politiques et religieuses. Il lui revient de déterminer si l’autorité judiciaire d’exécution disposait de bases factuelles suffisamment solides pour devoir conclure que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque concret et individuel d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 et refuser, pour ce motif, d’exécuter le MAE. La Cour relève que le requérant s’est principalement prévalu devant les juridictions internes de son statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève et de la règle de non-refoulement prévue à l’article 33 de celle-ci pour établir l’existence d’un risque réel de traitements inhumains et dégradants en cas d’exécution du MAE. En ce qui concerne le contrôle du respect de l’article 3, la Cour relève que la décision-cadre relative au MAE ne prévoit pas de motif de non-exécution tenant au statut de réfugié de la personne dont la remise est demandée. Elle souligne que l’octroi du statut de réfugié au requérant par les autorités suédoises révèle que, à l’époque, les autorités avaient considéré qu’il existait suffisamment d’éléments établissant qu’il risquait d’être persécuté dans son pays d’origine. S’agissant du contrôle, la Cour estime que l’autorité judiciaire d’exécution a considéré que le statut de réfugié du requérant était un élément qu’elle devait particulièrement prendre en considération. La chambre de l’instruction a procédé à un échange d’informations avec les autorités suédoises pour demander des précisions sur le statut de réfugié du requérant. Les autorités suédoises ont répondu qu’elles entendaient maintenir le statut de réfugié sans toutefois se prononcer sur la persistance, dix ans après son octroi, des risques de persécution dans son pays d’origine. Aucun élément du dossier instruit par l’autorité judiciaire d’exécution ou des éléments apportés par le requérant devant la Cour n’indiquent que ce dernier risquait encore, en cas de remise, d’être persécuté pour des raisons religieuses en Roumanie. La Cour relève en outre que les autorités judiciaires d’exécution ont vérifié que la demande d’exécution du MAE n’avait pas été émise dans un but discriminatoire et notamment en raison des opinions politiques de l’intéressé. La Cour estime donc que l’autorité judiciaire d’exécution, au terme de l’examen approfondi et complet de la situation personnelle du requérant auquel elle a procédé et qui manifeste l’attention qu’elle a portée à son statut de réfugié, ne disposait pas de bases factuelles suffisamment solides pour caractériser l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention et refuser, pour ce motif, l’exécution du MAE. En ce qui concerne la question des conditions de détention en Roumanie, la Cour relève que le requérant s’est borné, devant les juridictions internes, à dénoncer, de manière très générale, la situation réservée aux opposants politiques en Roumanie, y compris en prison, et non les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains, de sorte que l’autorité judiciaire d’exécution ne disposait pas d’élément suffisant à cet égard. Dans ces conditions, la Cour estime que la description faite par le requérant devant l’autorité judiciaire d’exécution, à l’appui de sa demande de ne pas exécuter le MAE dont il faisait l’objet, des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains n’était ni suffisamment détaillée ni suffisamment étayée pour constituer un commencement de preuve d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 en cas de remise aux autorités roumaines. La Cour relève par ailleurs qu’eu égard à l’office du juge de cassation, il était vain d’invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, l’arrêt Aranyosi et Căldăraru pour tenter d’établir la réalité des défaillances structurelles. La Cour estime qu’il n’incombait pas à l’autorité judiciaire d’exécution de demander des informations complémentaires aux autorités roumaines sur le lieu de détention futur du requérant et sur les conditions et le régime de détention qui lui seraient réservés aux fins d’identifier l’existence d’un risque réel qu’il subisse des traitements inhumains et dégradants en raison de ses conditions de détention. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’autorité judiciaire d’exécution ne disposait pas de bases factuelles solides lui permettant de caractériser l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention et refuser, pour ce motif, l’exécution du MAE. Il résulte que l’exécution du MAE litigieux n’a pas entraîné de violation de l’article 3 de la Convention.
LE DROIT EUROPEEN
Les dispositions pertinentes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du Protocole (no 24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne
46. Les extraits pertinents de l’article 78 du TFUE sont les suivantes :
« 1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents. (...) »
47. L’article unique du Protocole (no 24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’UE dispose que :
« Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants :
a) si l’État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l’article 15 de la Convention de Rome sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prend, après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention ;
b) si la procédure prévue à l’article F.l, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été déclenchée et jusqu’à ce que le Conseil prenne une décision à ce sujet ;
c) si le Conseil, statuant sur la base de l’article F.l, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, a constaté, à l’égard de l’État membre dont le demandeur est ressortissant, l’existence d’une violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1 ;
d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un ressortissant d’un autre État membre ; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé ; la demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l’État membre ne soit affecté d’aucune manière ».
La directive 2011/95/UE
48. Les dispositions pertinentes de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) citée par le Gouvernement dans ses observations (paragraphe 92 ci-dessous) sont les suivantes :
Article 11
Cessation
« 1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants :
(...)
e) s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister ;
Aux fins de l’application du paragraphe 1, points e) et f), les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.
3. Le paragraphe 1, points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. »
Article 12
Exclusion
« (...)
2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :
b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié ; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ; »
Jurisprudence de la CJUE
49. Dans son arrêt du 26 février 2013 dans Melloni c. Ministerio Fiscal (C‑399/11, EU:C:2013:107), la CJUE a dit pour droit que les États membres sont tenus, au nom de l’autorité du droit de l’Union, de donner suite à un MAE dont l’exécution ne peut être subordonnée qu’aux seules conditions définies dans la décision-cadre :
« En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre 2002/584, les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de ladite décision-cadre ».
50. Dans son arrêt Aranyosi et Căldăraru précité, la CJUE a consacré l’existence d’une exception au principe d’automaticité de la remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission du MAE dans le cas où l’État membre d’exécution dispose d’éléments révélant l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention, dans l’État d’émission, de la personne concernée par le MAE. La CJUE a strictement encadré cette exception qui s’ajoute aux motifs de non-exécution obligatoire et facultative d’un MAE prévus par la décision-cadre, et détaillé la méthode à adopter par l’État membre d’exécution :
« Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
Les articles 1er, paragraphe 3, 5 et 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membre. À cette fin, elle doit demander la fourniture d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission, laquelle, après avoir, au besoin, requis l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission, au sens de l’article 7 de ladite décision-cadre, doit communiquer ces informations dans le délai fixé dans une telle demande. L’autorité judiciaire d’exécution doit reporter sa décision sur la remise de la personne concernée jusqu’à ce qu’elle obtienne les informations complémentaires lui permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise. »
51. Dans son arrêt du 25 juillet 2018 dans ML (C-220/18 PPU, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), EU:C:2018:589), la CJUE a dit pour droit que lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments attestant l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, elle ne peut écarter l’existence d’un risque réel que la personne visée par le MAE fasse l’objet d’un traitement inhumain et dégradant au seul motif que cette personne dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester ses conditions de détention. Elle a également dit pour droit que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’examiner uniquement les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires dans lesquels il est probable, selon les informations dont elle dispose, que cette personne sera détenue et qu’elle doit vérifier, à cette fin, les seules conditions de détention concrètes et précises de la personne concernée qui sont pertinentes pour déterminer si celle-ci courra un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, étant précisé qu’elle peut prendre en compte des informations fournies par des autorités de l’État membre d’émission telles que, en particulier, l’assurance que la personne concernée ne fera pas l’objet d’un traitement inhumain et dégradant.
52. Dans son arrêt du 15 octobre 2019 dans Dorobantu (C-128/18, EU:C:2019:857), la CJUE a précisé la nature et l’étendue du contrôle, par l’autorité judiciaire d’exécution, des conditions de détention dans l’État membre d’émission de la personne visée par le MAE. Elle a dit pour droit qu’il devait être tenu compte de l’ensemble des aspects matériels pertinents tels que l’espace personnel disponible par détenu dans une cellule, les conditions sanitaires ainsi que l’étendue de la liberté de mouvement du détenu au sein de l’établissement. Elle a également dit pour droit que cette appréciation n’est pas limitée au contrôle des insuffisances manifestes et qu’aux fins d’une telle appréciation, l’autorité judiciaire d’exécution doit solliciter de l’autorité judiciaire d’émission les informations qu’elle juge nécessaires. La Cour de justice a enfin dit pour droit que la constatation par l’autorité judiciaire d’exécution de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un risque de traitement inhumain et dégradant en raison des conditions de détention prévalant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé de l’incarcérer, ne saurait être mise en balance, aux fins de décider de sa remise à l’État membre d’émission, avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles.
Sur l’appréciation des conditions de détention au regard de l’espace personnel dont dispose la personne détenue, la CJUE a relevé ce qui suit :
« (...)72. Ce faisant, la Cour a jugé que, compte tenu de l’importance attachée au facteur spatial dans l’appréciation globale des conditions de détention, le fait que l’espace personnel dont dispose un détenu est inférieur à 3 m2 dans une cellule collective fait naître une forte présomption de violation de l’article 3 de la CEDH [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 92 et jurisprudence citée].
(...)
77. S’agissant des modalités de calcul, aux fins d’apprécier s’il existe un risque réel pour la personne concernée d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, de l’espace minimal dont doit disposer une personne détenue dans une cellule collective au sein de laquelle se trouvent des meubles et des infrastructures sanitaires, il convient également, en l’absence, actuellement, de normes minimales à cet égard dans le droit de l’Union, de tenir compte des critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme au regard de l’article 3 de la CEDH. Cette juridiction considère que si, pour le calcul de la surface disponible dans une telle cellule, la surface des sanitaires ne doit pas être prise en compte, ce calcul doit inclure l’espace occupé par les meubles, étant toutefois précisé que les détenus doivent conserver la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 75 et 114 ainsi que jurisprudence citée). »
53. Dans son arrêt du 17 décembre 2020 dans L et P Openbaar Ministerie (C-354/20 PPU et C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033), la CJUE a dit pour droit que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission du MAE, elle ne peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet du MAE courra, en cas de remise à cet État, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendrait compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit l’émission tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.
54. Ainsi que le présente l’avocat général Manuel Campos Sanchez-Bordona, dans ses conclusions présentées le 12 novembre 2020 sur l’arrêt L et P précité (EU:C:2020:925 :) : « La Cour a admis que, au-delà des cas de figure expressément visés par la décision-cadre (articles 3 à 5), l’exécution d’un MAE peut également être refusée « dans des circonstances exceptionnelles » qui, en raison de leur gravité même, imposent que soient apportées des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres sur lesquels est fondée la coopération judiciaire en matière pénale ».
55. Par ailleurs, dans les motifs de son arrêt I.B. précité (paragraphe 33 ci-dessus) cité par le Gouvernement dans ses observations devant la Cour (paragraphe 88 ci-dessous), la CJUE a indiqué que l’existence d’une demande d’asile ne constitue pas un motif de non-exécution d’un MAE (point 43) et précisé, s’agissant du cas particulier d’une demande d’asile présentée aux autorités compétentes d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, que « l’article unique du protocole no 29 sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, annexé au traité CE (devenu protocole no 24, annexé au traité TFUE) dispose notamment que, étant donné le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile » (point 44).
CEDH
a) Principes généraux relatifs à la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne
96. Les principes généraux relatifs à la présomption de protection équivalente énoncés dans l’arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande ([GC], no 45036/98, CEDH 2005‑VI) puis développés dans les arrêts Michaud et Avotiņš précités peuvent être résumés ainsi.
97. Lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union européenne, les États contractants demeurent soumis aux obligations qu’ils ont librement contractées en adhérant à la Convention. Ces obligations sont toutefois à apprécier à l’aune de la présomption de protection équivalente. Une mesure prise en vertu d’obligations juridiques internationales doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux une protection à tout le moins équivalente, c’est-à-dire non pas identique mais « comparable » à celle assurée par la Convention, étant entendu qu’un constat de « protection équivalente » de ce type doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux. Si l’on considère que l’organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer que les États respectent les exigences de la Convention lorsqu’ils ne font qu’exécuter des obligations juridiques résultant de leur adhésion à l’organisation (Avotiņš, précité, § 101)
98. L’application de la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’UE est soumise à deux conditions : l’absence de marge de manœuvre pour les autorités nationales et le déploiement de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne. Premièrement, l’atteinte alléguée à un droit protégé par la Convention doit découler d’une obligation juridique internationale qui pèse sur l’État défendeur et pour l’exécution de laquelle les autorités internes ne disposent ni d’un pouvoir d’appréciation ni d’une marge de manœuvre. Deuxièmement, il faut que l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle des droits fondamentaux prévu par le droit de l’UE, que la Cour a reconnu comme assurant une protection des droits de l’homme équivalente à celle de la Convention, ait été déployée (idem, § 105).
99. La seconde condition d’application de la présomption de protection équivalente doit être appliquée sans formalisme excessif et en tenant compte des particularités du mécanisme de contrôle en cause. Il n’est pas approprié de subordonner la mise en œuvre de cette présomption à la condition que la juridiction nationale s’adresse à la CJUE dans tous les cas sans exception, y compris ceux où aucune question réelle et sérieuse ne se poserait quant à la protection des droits fondamentaux par le droit de l’Union ou ceux dans lesquels la CJUE aurait déjà indiqué de façon précise l’interprétation – conforme aux droits fondamentaux – qu’il convient de donner aux dispositions du droit de l’Union applicable (idem, § 109).
100. Les principes dégagés dans les arrêts cités au paragraphe 96 ci‑dessus s’appliquent à l’ensemble des mécanismes de reconnaissance mutuelle prévus par le droit de l’Union européenne (idem, § 113). Il s’ensuit que lorsque les autorités internes mettent en œuvre le droit de l’UE sans disposer d’un pouvoir d’appréciation, la présomption de protection équivalente s’applique. Tel est le cas lorsque les mécanismes de reconnaissance mutuelle obligent le juge à présumer le respect suffisant des droits fondamentaux par un autre État membre (idem, § 115).
101. Toutefois, cette présomption peut être renversée dans le cadre d’une affaire donnée. Même si elle entend tenir compte, dans un esprit de complémentarité, du mode de fonctionnement des dispositifs de reconnaissance mutuelle et notamment de leur objectif d’efficacité, la Cour doit vérifier que le principe de reconnaissance mutuelle n’est pas appliqué de manière automatique et mécanique, au détriment des droits fondamentaux (idem, § 116).
102. Dans cet esprit, lorsque les juridictions des États qui sont à la fois parties à la Convention et membres de l’UE sont appelées à appliquer un mécanisme de reconnaissance mutuelle établi par le droit de l’UE, tel que celui prévu pour l’exécution d’un MAE décerné par un autre État européen, c’est en l’absence de toute insuffisance manifeste des droits protégés par la Convention qu’elles donnent à ce mécanisme son plein effet (idem, § 116).
103. En revanche, s’il leur est soumis un grief sérieux et étayé dans le cadre duquel il est allégué que l’on se trouve en présence d’une insuffisance manifeste de protection d’un droit garanti par la Convention et que le droit de l’UE ne permet pas de remédier à cette insuffisance, elles ne peuvent renoncer à examiner ce grief au seul motif qu’elles appliquent le droit de l’UE (idem, § 116). Il leur appartient dans ce cas de lire et d’appliquer les règles du droit de l’UE en conformité avec la Convention (Pirozzi c. Belgique, § 64, no 21055/11, 17 avril 2018).
b) Application de ces principes dans les affaires relatives au mandat d’arrêt européen
104. Dans l’arrêt Pirozzi précité, la Cour a considéré que sauf en présence de motifs de non-exécution, l’exécution du MAE est obligatoire pour l’autorité judiciaire d’exécution, ce qui entraîne l’application de la présomption de protection équivalente (§§ 66 et 71). Elle a cependant souligné que cette autorité avait vérifié que l’exécution du MAE ne donnait pas lieu, dans le cas du requérant, à une insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention après avoir rappelé, en ces termes, que le système du MAE ne heurte pas, en soi, la Convention :
«58. (...) la décision-cadre relative au MAE s’appuie sur un mécanisme de reconnaissance mutuelle lui-même fondé sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres de l’UE (voir paragraphes 24-29, ci-dessus).
59. La Cour est consciente de l’importance des mécanismes de reconnaissance mutuelle pour la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et de la confiance mutuelle qu’ils nécessitent. Le MAE prévu par la décision-cadre est une concrétisation de ce principe de reconnaissance mutuelle, dans le domaine dont l’objectif est d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Le MAE est un titre d’arrestation résultant d’une décision judiciaire émise par l’autorité judiciaire compétente d’un État membre de l’UE, en vue de l’arrestation et de la remise par l’autorité judiciaire compétente d’un autre État membre, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.
60. La Cour a indiqué son attachement à la coopération internationale et européenne. Elle estime entièrement légitimes au regard de la Convention, dans son principe, la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en Europe et l’adoption de moyens nécessaires à cette fin (voir, notamment, Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 113, CEDH 2016). Partant, elle estime que le système du MAE ne se heurte pas, en soi, à la Convention. »
105. Dans l’arrêt Romeo Castaño précité, la Cour a considéré que le refus d’exécuter un MAE au motif que la remise ferait craindre un risque de violation des droits fondamentaux de la personne recherchée peut être contraire à l’obligation procédurale de coopérer découlant de l’article 2 de la Convention lorsqu’il ne repose pas sur une base factuelle suffisante. Elle a rappelé les principes énoncés dans sa jurisprudence selon lesquels, dans le cadre de l’exécution d’un MAE par un État membre de l’UE, il convient de ne pas appliquer le mécanisme de reconnaissance mutuelle de manière automatique et mécanique au détriment des droits fondamentaux. Elle a estimé qu’un risque de traitement inhumain et dégradant de la personne dont la remise est demandée peut constituer un motif légitime pour refuser l’exécution d’un MAE à condition que le constat d’un tel risque repose sur des bases factuelles suffisantes (§§ 82-91).
106. S’agissant du cas particulier de risque de traitement inhumain et dégradant en raison des conditions de détention de la personne visée par le MAE dans l’État d’émission, la Cour a indiqué qu’il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution de procéder à un examen actualisé et circonstancié de la situation consistant à rechercher s’il existe un risque réel et individualisable de violation des droits protégés par la Convention (idem, § 86).
c) Principes généraux relatifs au contrôle par la Cour du respect de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant dans son pays d’origine
107. Il est établi dans la jurisprudence de la Cour que les États ont l’obligation de ne pas extrader une personne vers un pays qui demande son extradition, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (Soering c. Royaume‑Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161, Romeo Castaño précité, § 92) et donc de s’assurer qu’un tel risque n’existe pas (idem).
108. À cet égard, il est aussi utile de renvoyer aux principes généraux applicables dans le contexte certes différent de l’expulsion tels qu’ils ont été résumés dans l’arrêt F.G. précité (§§ 111 à 127) et dans l’arrêt J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 79 à 105, 23 août 2016).
109. La Cour rappelle en particulier qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure contestée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels qu’ils pourraient faire naître (idem, § 91, Allanazarova c. Russie, no 46721/15, § 71, 14 février 2017, A.M. c. France, no 12148/18, §§ 118 et 119, 29 avril 2019).
d) Application de ces principes dans l’affaire Moldovan
110. La décision de remettre le requérant aux autorités de l’État d’émission du MAE a été prise alors qu’il soutenait que l’exécution de ce dernier l’exposerait à un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants à raison de ses futures conditions de détention en Roumanie. Il ne s’agit pas ici pour la Cour de se prononcer sur le respect, par la Roumanie, des obligations qui découlent de la Convention. Son contrôle porte seulement sur la décision des autorités judiciaires françaises d’exécuter le MAE dont faisait l’objet le requérant alors que celui-ci soutenait devant elles qu’une telle exécution aurait pour effet de l’exposer à un traitement contraire à l’article 3. Dès lors que les éléments produits par le requérant à l’appui de ses allégations proviennent d’arrêts de la Cour concernant les conditions de détention en Roumanie, un bref rappel de la jurisprudence en la matière s’impose. Avant d’apprécier le bien-fondé du grief tiré de la violation de l’article 3, il convient de déterminer si la présomption de protection équivalente s’appliquait, dans les circonstances de l’espèce.
111. Devant la chambre de l’instruction, le requérant a d’abord invoqué quatre arrêts rendus en 2014 (paragraphe 8 ci-dessus) concluant à la violation de l’article 3 de Convention en raison des conditions de détention indignes subies par les requérants dans plusieurs établissements pénitentiaires roumains, dont celle de Rahova à Bucarest, du fait de la surpopulation carcérale qui les touche, de l’absence de chauffage et d’eau chaude ainsi que du manque d’hygiène. Ces arrêts se réfèrent à l’arrêt de principe Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, 24 juillet 2012) dans lequel, sous l’angle de l’article 46 de la Convention, la Cour a rappelé qu’elle avait fait le constat de violations répétées de la Convention en raison de la surpopulation, du manque d’hygiène et de l’inadéquation des soins médicaux à la prison de Gherla notamment (§ 195). Par la suite, le requérant s’est référé à l’arrêt Axinte précité (paragraphe 11 ci-dessus) qui concerne également, entre autres, les conditions de détention à la prison de Gherla. Dans cet arrêt, la Cour a relevé que le requérant avait souffert d’une situation de surpopulation carcérale grave et qu’il avait disposé de moins de 3 m2 d’espace individuel, parfois moins de 2 m2 (§ 48). Elle a aussi rappelé qu’elle avait « déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 3 en raison principalement du manque d’espace individuel suffisant, d’une absence d’hygiène, ou de ventilation ou d’éclairage inadéquats dans la prison de Gherla (Porumb c. Roumanie, no 19832/04, § 72, 7 décembre 2010, et Radu Pop c. Roumanie, no 14337/04, § 96, 17 juillet 2012) » (§ 49).
112. La Cour doit vérifier si les conditions d’application de la présomption de protection équivalente, rappelées aux paragraphes 98 et 99 ci-dessus, sont remplies dans les circonstances de l’espèce.
113. En ce qui concerne la première condition, la Cour relève que l’obligation juridique pesant sur l’autorité judiciaire d’exécution du MAE résulte des dispositions pertinentes de la décision-cadre telles qu’interprétées par la CJUE depuis l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (paragraphe 50 ci-dessus). En l’état de la jurisprudence de la Cour de justice, l’autorité judiciaire d’exécution était autorisée à déroger, dans des circonstances exceptionnelles, aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelle entre États membres en reportant voire, le cas échéant, en refusant l’exécution du MAE. Saisie de la contestation de l’exécution du MAE au motif que celle-ci exposerait le requérant au risque d’être détenu en Roumanie dans des conditions contraires à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, il appartenait à cette dernière d’apprécier la réalité des défaillances systémiques dans l’État membre d’émission alléguées par le requérant puis, le cas échéant, de procéder à un examen concret et précis du risque individuel de traitement inhumain et dégradant auquel celui-ci serait exposé en cas de remise.
114. La Cour relève la convergence, s’agissant de la caractérisation d’un risque individuel réel, entre les exigences posées par la CJUE qui met à la charge de l’autorité judiciaire d’exécution un contrôle qui comporte deux étapes portant successivement sur l’existence, dans l’État d’émission, de défaillances systémiques ou généralisées puis sur celle, appréciée de manière concrète et précise, de motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un risque réel d’être exposé, en raison des conditions de sa détention dans l’État d’émission, à un traitement contraire à l’article 4 de la charte de droits fondamentaux (paragraphes 50 et 52 ci-dessus) et celles qui résultent de sa jurisprudence qui met à la charge des autorités nationales l’obligation de contrôler s’il existe un risque réel et individualisable, apprécié de manière concrète, que cette personne soit, en raison des mêmes circonstances, soumise à un traitement contraire à l’article 3 (paragraphe 106 ci-dessus). Il s’ensuit que la chambre de l’instruction aurait dû refuser l’exécution du MAE si, au terme du contrôle décrit précédemment, elle avait considéré qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant courra, en cas de remise, un risque réel d’être soumis à un traitement inhumain et dégradant en raison de ses conditions de détention. Pour autant, ce pouvoir d’appréciation des faits et des circonstances ainsi que des conséquences juridiques devant y être attachées dont dispose l’autorité judiciaire est exercé dans le cadre strictement défini par la jurisprudence de la CJUE et pour assurer l’exécution d’une obligation juridique dans le plein respect du droit de l’Union européenne, à savoir l’article 4 de la charte des droits fondamentaux qui assure une protection équivalente à celle qui résulte de l’article 3 de la Convention. Dans ces conditions, l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait être regardée comme disposant, pour assurer ou refuser l’exécution du MAE, d’une marge de manœuvre autonome de nature à entraîner la non-application de la présomption de protection équivalente (Avotiņš, précité, § 107).
115. S’agissant de la seconde condition d’application, la Cour relève l’absence, eu égard à la jurisprudence de la CJUE précitée (paragraphes 50 et 113 ci-dessus), de difficulté sérieuse liée à l’interprétation de la décision-cadre et à la question de sa compatibilité avec les droits fondamentaux qui permettrait de considérer qu’il aurait été nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel à la CJUE. La seconde condition d’application de la présomption de protection équivalente doit donc être considérée comme remplie.
116. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la présomption de protection équivalente trouve à s’appliquer au cas d’espèce. Dès lors, sa tâche se limite à rechercher si la protection des droits garantis par la Convention est entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser cette présomption, auquel cas le respect de la Convention en tant qu’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale (Bosphorus, précité, § 156, et Michaud, précité, § 103).
Sur l’allégation d’insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention
117. La Cour rappelle qu’elle a reconnu, dans l’arrêt Romeo Castaño précité, que, du point de vue de la Convention, un risque réel de traitement inhumain et dégradant de la personne dont la remise est demandée, en raison de ses conditions de détention, appréciées sur des bases factuelles suffisantes, dans l’État d’émission, constitue un motif légitime pour refuser l’exécution du MAE, et donc pour refuser la coopération avec cet État. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de l’approche qu’elle a adoptée dans l’arrêt Romeo Castaño (§§ 82-91) et qui est rappelée aux paragraphes 105 et 106 ci-dessus.
118. La Cour doit à présent rechercher si la protection des droits fondamentaux offerte par l’autorité judiciaire d’exécution est entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente. Pour ce faire, elle s’attachera à déterminer si l’autorité judiciaire d’exécution disposait ou non de bases factuelles suffisamment solides pour devoir conclure que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque concret et individuel d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en raison de ses conditions de détention en Roumanie.
119. En premier lieu, la Cour relève tout d’abord que le requérant a produit devant les juridictions internes des éléments attestant des défaillances systémiques ou généralisées au sein des établissements pénitentiaires de l’État d’émission. Elle note le caractère sérieux et précis des éléments qu’il a présentés, à l’appui de ses allégations, devant la chambre de l’instruction puis devant la Cour de cassation (paragraphes 8, 11 et 13 ci-dessus) faisant état de manière concordante et répétée des défaillances du système pénitentiaire roumain, et, en particulier, des caractéristiques de l’établissement de Gherla, centre dans lequel les autorités roumaines envisageaient de l’incarcérer.
120. La Cour note ensuite les diligences avec lesquelles le juge interne a fait usage de la possibilité que lui offre l’article 695-33 du CPP en sollicitant des informations complémentaires auprès des autorités roumaines. Au vu des éléments produits par le requérant, elle a demandé des informations complémentaires aux autorités compétentes de cet État portant sur les conditions concrètes de détention de l’intéressé afin d’apprécier la réalité du risque que celui-ci soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de remise.
121. Au vu des précisions qui lui ont été apportées dans le cadre de cet échange d’informations, l’autorité judiciaire d’exécution a estimé que l’exécution du MAE litigieux n’emportait pas de risque d’une violation de l’article 3 à l’encontre du requérant. Au vu de ces mêmes éléments, la Cour considère pour sa part que cette autorité disposait de bases factuelles suffisantes pour reconnaître l’existence d’un tel risque.
122. En premier lieu, la Cour estime que les informations fournies par l’État d’émission n’ont pas été suffisamment mises en perspective avec sa jurisprudence, en particulier en ce qui concerne la situation de l’établissement pénitentiaire de Gherla présenté comme celui dans lequel le requérant devait être incarcéré. Dans l’arrêt Axinte précité (paragraphe 111 ci-dessus), invoqué par le requérant devant l’autorité judiciaire d’exécution, il est relevé que cet établissement connaît un taux de surpopulation carcérale endémique et que, dans une telle situation, le manque d’espace personnel constitue l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la non-contrariété d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Or, la Cour note que cet aspect des futures conditions de détention du requérant n’a pas été sérieusement pris en considération, la chambre de l’instruction retenant la perspective d’un « espace minimal de 2 à 3 m2 » (paragraphe 12 ci-dessus) alors que les autorités roumaines avaient indiqué que le requérant disposerait d’un « espace entre 2 et 3 m2 » à la prison de Gherla (paragraphe 10 ci-dessus). Il était en outre indiqué que la surface réservée aux installations sanitaires était comprise dans la superficie de cet espace personnel. Enfin, la Cour relève qu’il ressort des autres arrêts invoqués par le requérant (paragraphes 8 et 111 ci-dessus), que les conditions de détention au centre pénitentiaire de Rahova présenté comme l’établissement dans lequel le requérant devait être placé en quarantaine à son arrivée en Roumanie n’offrent pas aux personnes qui s’y trouvent détenues un espace personnel satisfaisant (Voicu, précité, § 51 et Constantin Aurelian Burlacu précité, § 27).
123. La Cour rappelle que, dans sa jurisprudence, une superficie de 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective constitue la norme minimale applicable au regard des exigences de l’article 3 de la Convention (voir pour la confirmation de ce standard, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 137, 20 octobre 2016). Elle considère, au vu de l’ensemble des éléments présentés devant elle, en particulier ceux fournis par les autorités roumaines sur sa demande que l’autorité judiciaire d’exécution disposait d’informations relatives à l’espace personnel qui serait réservé au requérant donnant lieu à une forte présomption de violation de l’article 3.
124. En deuxième lieu, la Cour relève que les engagements des autorités roumaines relativement aux autres aspects des conditions de détention au sein de l’établissement de Gherla, tels la liberté de circulation et les activités hors cellule, qui auraient été de nature à permettre d’écarter l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 (idem, §§ 135 et 138), étaient formulés de manière stéréotypée et n’ont pas été mobilisés par l’autorité judiciaire d’exécution dans son évaluation du risque.
125. En troisième lieu, la Cour considère que, si les autorités roumaines n’ont pas exclu que le requérant puisse être détenu dans un autre établissement pénitentiaire que celui de Gherla, la précaution prise à cet égard par l’autorité judiciaire d’exécution, à savoir la recommandation que le requérant soit détenu dans un établissement offrant des conditions identiques sinon meilleures, n’est pas suffisante pour écarter un risque réel de traitement inhumain et dégradant dès lors, d’une part, qu’elle ne permettait pas de procéder à l’évaluation d’un tel risque s’agissant d’un établissement déterminé et, d’autre part, que les éléments attestant de l’existence des défaillances systémiques du système pénitentiaire de l’État d’émission dont elle disposait établissaient qu’un nombre important de prisons n’offraient pas des conditions de détention conformes aux standards consacrés par la Cour.
126. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que l’autorité judiciaire d’exécution disposait de bases factuelles suffisamment solides, provenant en particulier de sa propre jurisprudence (paragraphes 111, 122 et 123 ci-dessus), pour caractériser l’existence d’un risque réel que le requérant soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses conditions de détention en Roumanie et ne pouvait dès lors s’en remettre exclusivement aux déclarations des autorités roumaines (paragraphe 10 ci-dessus). Elle en déduit, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une insuffisance manifeste de protection des droits fondamentaux de nature à renverser la présomption de protection équivalente. Partant, elle constate la violation de l’article 3 de la Convention.
e) Application de ces principes dans l’affaire Bivolaru
127. Le grief soulevé sous l’angle de l’article 3 comporte deux branches respectivement tirées des conséquences devant être attachées au statut de réfugié du requérant et des conditions de détention en Roumanie.
Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention en raison du statut de réfugié du requérant
128. Avant de se prononcer sur l’application de la présomption de protection équivalente et la violation alléguée de l’article 3, il apparaît nécessaire de faire un bref rappel de l’arrêt Amarandei et autres précité invoqué par le requérant devant la chambre de l’instruction pour démontrer qu’il risquait, en cas d’exécution du MAE, de subir des traitements inhumains et dégradants en tant qu’opposant politique roumain.
1) Sur l’arrêt Amarandei et autres contre Roumanie invoqué par le requérant devant la chambre de l’instruction
129. Introduite par des adhérents ou des sympathisants du MISA, le mouvement crée en 1990 par le requérant, la requête concerne l’opération policière dont ils ont fait l’objet en 2004 aux fins de saisie des supports informatiques que le parquet avait indiqué être utilisés pour produire et diffuser sur Internet des images pornographiques. La Cour rappelle qu’elle a considéré que cette opération et les arrestations qui avaient suivi emportaient violation des articles 3 et 5 compte tenu de la manière dont les immeubles visés par les perquisitions avaient été investis par les militaires de la Gendarmerie et de la privation de liberté arbitraire des requérants à la suite de cette opération. Elle a également jugé que l’article 8 de la Convention avait été violé du fait de défaillances relevées concernant la perquisition, la saisie de biens, des fouilles et la diffusion des opérations policières dans la presse. Enfin, elle a déclaré irrecevable, comme suit, le grief des requérants tiré de l’article 9 combiné avec l’article 14 concernant leur allégation de discrimination fondée sur leur appartenance au MISA dans leur droit de manifester leurs convictions :
243. En l’espèce, la Cour constate que le SRI surveillait les activités de MISA depuis sa création, en 1990. Si les motifs de cette surveillance étaient liés, en partie, à l’expression des opinions jugées contraires aux choix de politique externe de l’État, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’opération policière du 18 mars 2004 faisait suite à des indices de commission d’infractions pénales dans certains immeubles du MISA.
244. Par conséquent, la Cour estime qu’elle n’est pas en présence d’éléments graves, précis et concordants pour conclure que l’ouverture des poursuites contre G.B. et d’autres membres du MISA et l’autorisation de perquisition de ces immeubles poursuivaient un but discriminatoire portant atteinte à la liberté des requérants de manifester leurs convictions.
245. Par ailleurs, la Cour souligne que les allégations concernant le comportement des représentants des forces de l’ordre au cours l’opération policière du 18 mars 2004 ont été examinées sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
246. Quant aux déclarations qui auraient porté un jugement négatif sur les activités du MISA, la Cour constate que les propos incriminés par les requérants émanaient non pas des autorités judicaires qui contrôlaient le déroulement de l’enquête, mais de divers hommes politiques. Or, la Cour estime qu’il convient de situer ces déclarations dans le contexte de l’affaire qui a suscité un grand émoi dans l’opinion publique. Tels qu’ils ressortent des articles de presse fournis par les requérants, la Cour considère que les propos litigieux ne sauraient démontrer l’existence d’une campagne de dénigrement et de persécutions orchestrée par certains hommes politiques contre MISA et ses membres.
247. Enfin, s’agissant de l’écho que l’affaire a eu dans la presse, la Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par les journalistes sur des affaires sensibles.
2) Sur l’application de la présomption de protection équivalente
130. La Cour rappelle, en ce qui concerne la seconde condition d’application de la présomption de protection équivalente du droit de l’UE, qu’elle a reconnu que, pris dans sa globalité, le mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne accorde une protection équivalente à celle qu’offre la Convention (Bosphorus, précité, §§ 160-164).
131. S’agissant de la présente affaire, la Cour note que la Cour de cassation a écarté la demande du requérant tendant à ce qu’elle saisisse la CJUE d’une question préjudicielle sur les conséquences à tirer sur l’exécution d’un MAE de l’octroi du statut de réfugié par un État membre à un ressortissant d’un État tiers devenu par la suite également État membre. Il s’agit d’une question réelle et sérieuse quant à la protection des droits fondamentaux par le droit de l’UE et son articulation avec la protection issue de la Convention de Genève de 1951 sur laquelle la CJUE ne s’est jamais prononcée. L’arrêt I.B. cité par le Gouvernement (paragraphe 55 ci-dessus) dans lequel la Cour de justice a dit pour droit que le fait que la personne concernée par un MAE avait introduit une demande d’octroi du statut de réfugié dans l’État d’exécution ne constituait pas un motif de non-exécution de celui-ci porte en effet sur une autre hypothèse. Dans ces conditions, la Cour estime que, du fait du choix de la Cour de cassation de ne pas procéder au renvoi à la Cour de justice, celle-ci a statué sans que le mécanisme international pertinent de contrôle du respect des droits fondamentaux, en principe équivalent à celui de la Convention, ait pu déployer l’intégralité de ses potentialités. Au regard de ce choix et de l’importance des enjeux en cause, la présomption de protection équivalente ne trouve pas à s’appliquer (Michaud, précité, § 115, Avotiņš, précité, § 111) sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la première condition.
132. Dès lors, il appartient à la Cour de se prononcer sur le point de savoir, s’agissant des conséquences s’attachant au statut de réfugié du requérant, si la remise de celui-ci aux autorités roumaines en exécution du MAE litigieux est ou non contraire à l’article 3 de la Convention.
3) Sur le point de savoir si la remise du requérant était contraire à l’article 3 de la Convention
133. Il revient à la Cour de contrôler comment l’autorité judiciaire d’exécution a procédé pour rechercher s’il existait un risque réel qu’en cas d’exécution du MAE, le requérant soit exposé à des persécutions en raison de ses convictions politiques et religieuses constitutives de traitements inhumains et dégradants. Elle s’attachera à déterminer si l’autorité judiciaire d’exécution disposait de bases factuelles suffisamment solides pour devoir conclure que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque concret et individuel d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 et refuser, pour ce motif, d’exécuter le MAE.
134. La Cour relève que le requérant s’est principalement prévalu devant les juridictions internes de son statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève et de la règle de non-refoulement prévue à l’article 33 de celle-ci pour établir l’existence d’un risque réel de traitements inhumains et dégradants en cas d’exécution du MAE. La chambre de l’instruction et la Cour de cassation ont considéré que le statut de réfugié du requérant n’avait pas pour effet de leur imposer de refuser d’exécuter le MAE litigieux.
135. En premier lieu, il n’appartient pas à la Cour, eu égard à son office, de se prononcer sur l’articulation entre la protection des réfugiés par la Convention de Genève et les règles du droit de l’Union européenne, en particulier la décision-cadre. Son contrôle se limite à rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du MAE concernant M. Bivolaru a ou non entraîné une violation de l’article 3 (mutatis mutandis, Paci c. Belgique, no 45597/09, § 73, 17 avril 2018). En second lieu, s’agissant des conséquences qu’il lui reviendrait d’attacher au statut de réfugié du requérant, la Cour rappelle que ni la Convention ni ses Protocoles ne protègent en tant que tel le droit d’asile. La protection qu’ils offrent se limite aux droits qui y sont consacrés, ce qui inclut, en particulier, ceux garantis par l’article 3. Cette disposition interdit le renvoi de tout étranger se trouvant dans la juridiction d’un État contractant, au sens de l’article 1 de la Convention, vers un État dans lequel il pourrait courir un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants voire à la torture : à cet égard, elle englobe l’interdiction de refoulement au sens de la Convention de Genève (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 188, 13 février 2020). La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas de rechercher si la décision d’octroyer le statut de réfugié prise par les autorités d’un pays contractant à la Convention de Genève doit être interprétée comme conférant à l’intéressé le même statut dans tous les autres pays contractants de cette convention (M.G. c. Bulgarie, no 59297/12, § 88, 25 mars 2014).
136. En ce qui concerne le contrôle du respect de l’article 3 dans les circonstances de l’espèce, la Cour relève que la décision-cadre relative au MAE ne prévoit pas de motif de non-exécution tenant au statut de réfugié de la personne dont la remise est demandée. Elle souligne toutefois que l’octroi du statut de réfugié au requérant par les autorités suédoises révèle que, à l’époque où ce statut lui a été accordé, lesdites autorités ont considéré qu’il existait suffisamment d’éléments établissant qu’il risquait d’être persécuté dans son pays d’origine (mutatis mutandis, M.G. précité, § 88). Un tel élément doit être particulièrement pris en compte par la Cour lorsqu’elle examine la réalité du risque que le requérant subisse des traitements contraires à l’article 3 en cas de remise (idem). Cet examen doit être effectué au regard de la situation de l’intéressé qui prévalait à la date de la prise de décision de l’autorité judiciaire d’exécution et compte tenu de l’économie générale du MAE.
137. S’agissant du contrôle exercé par l’autorité judiciaire d’exécution, la Cour estime que celle-ci a considéré que le statut de réfugié du requérant était un élément qu’elle devait particulièrement prendre en considération et concilier avec le principe de confiance mutuelle mais qu’il ne constituait pas de plano une dérogation à ce principe justifiant à lui seul le refus d’exécuter le MAE en le remettant aux autorités de son pays d’origine. La Cour considère qu’une telle position ne heurte pas en soi l’article 3 de la Convention à la condition que les autorités judiciaires d’exécution apprécient, au moment de leur décision, si le requérant est ou non exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de remise. Or, elle constate que les autorités judiciaires d’exécution ont procédé à une telle vérification en recherchant, si au-delà de son statut de réfugié, la situation personnelle du requérant ne s’opposait pas, dans les circonstances de l’espèce prévalant à la date de leur décision, à sa remise aux autorités roumaines (mutatis mutandis, Shiksaitov c. Slovaquie, nos 56751/16 et 33762/17, §§ 70 et 71, 10 décembre 2020).
138. La chambre de l’instruction a procédé à un échange d’informations avec les autorités suédoises pour demander des précisions sur le statut de réfugié du requérant. Elle les a en particulier interrogées sur les conséquences qu’elles avaient ou non tirées de l’adhésion de la Roumanie à l’UE, un an après l’octroi du statut. Elle a également demandé une actualisation des informations concernant le requérant et s’il était envisagé de lui retirer son statut à la suite de sa venue en France sous une fausse identité. Les autorités suédoises ont répondu qu’elles entendaient maintenir le statut de réfugié du requérant sans toutefois se prononcer sur la persistance, dix ans après son octroi, des risques de persécution dans son pays d’origine.
139. La Cour relève en outre que, conformément aux dispositions du code de procédure pénale français (article 695-22 5o du CPP, paragraphe 59 ci-dessus), les autorités judiciaires d’exécution ont vérifié que la demande d’exécution du MAE n’avait pas été émise dans un but discriminatoire, et notamment en raison des opinions politiques de l’intéressé. Elles se sont assurées que la demande de remise du requérant reposait uniquement sur l’exécution de la condamnation prononcée contre lui en répression d’une infraction de droit commun. Elles ont en particulier apprécié l’existence d’un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de sa condamnation pénale au regard des motifs de l’arrêt Aramandei et autres précité invoqué par le requérant à titre de preuve principale des persécutions subies par les membres du MISA. Au vu de ces motifs, les autorités judiciaires d’exécution ont considéré, après avoir rappelé le passé du requérant en Roumanie, que les éléments présentés devant elles ne permettaient pas de conclure au but politique du MAE et, d’autre part, que la seule appartenance de l’intéressé au MISA, au vu des éléments dont elles disposaient, ne suffisait pas à établir la crainte qu’il soit porté atteinte à sa situation en Roumanie en raison de ses opinions ou convictions (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour note que le requérant n’apporte dans ses observations devant elle aucun élément de nature à étayer le risque de subir des persécutions constitutives de traitements d’une gravité telle qu’ils atteindraient le seuil de l’article 3. Il fait seulement valoir que les autorités judiciaires d’exécution auraient estimé à tort que les motifs de l’arrêt Aramandei et autres étaient suffisants pour considérer qu’il ne risquait pas d’être persécuté en cas de remise.
140. Elle relève par ailleurs que le requérant n’a pas mis les autorités judiciaires de l’exécution à même de vérifier qu’il subirait une discrimination à raison de son appartenance au MISA dès lors qu’il n’a jamais invoqué devant la chambre de l’instruction la violation des articles 9 et 14 de la Convention et qu’il a seulement cité le premier article dans son troisième moyen de cassation sans développer d’argumentation à cet égard (paragraphe 32 ci-dessus).
141. Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément du dossier instruit par l’autorité judiciaire d’exécution ou des éléments apportés par le requérant devant la Cour n’indiquent que ce dernier risquait encore, en cas de remise, d’être persécuté pour des raisons religieuses en Roumanie. Dans ces circonstances particulières, et même si les autorités suédoises n’entendaient pas lever le statut de réfugié du requérant, la Cour estime que l’autorité judiciaire d’exécution, au terme de l’examen approfondi et complet de la situation personnelle de ce dernier auquel elle a procédé et qui manifeste l’attention qu’elle a portée à son statut de réfugié, ne disposait pas de bases factuelles suffisamment solides pour caractériser l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention et refuser, pour ce motif, l’exécution du MAE.
ii. Sur le risque de traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention en Roumanie
142. S’agissant de la seconde branche du grief du requérant, à savoir le risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en raison de ses conditions de détention en cas de remise, les considérations faites aux paragraphes 113 à 115 ci-dessus concernant les conditions d’application de la présomption de protection équivalente sur ce point s’appliquent également dans les circonstances de l’espèce. Dans le cadre de l’application de cette présomption dans la présente affaire, il appartient à la Cour de déterminer si la protection des droits fondamentaux offerte par l’autorité judiciaire d’exécution est ou non entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente.
143. Sur le point de savoir si l’autorité judiciaire d’exécution disposait de bases factuelles suffisamment solides pour considérer que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque réel d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses conditions de détention en Roumanie, la Cour relève que le requérant s’est borné, devant les juridictions internes, à dénoncer, de manière très générale, la situation réservée aux opposants politiques en Roumanie, y compris en prison, et non les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains, de sorte que l’autorité judiciaire d’exécution ne disposait pas d’élément suffisant à cet égard. S’agissant des éléments présentés devant la chambre de l’instruction, il a soutenu que « la torture et les traitements inhumains restaient monnaie courante en Roumanie » et qu’un rapport du CPT de 2015 mentionnait des « passages à tabac sur des prisonniers » (paragraphe 23 ci‑dessus). Il a également invoqué la violation de l’article 3 résultant de l’opération de police dont avaient fait l’objet certains membres du MISA en 2004 (paragraphe 27 ci-dessus). Devant la Cour de cassation, il a invoqué l’arrêt Aranyosi et Căldăraru(paragraphe 32 ci-dessus).
144. Dans ces conditions, la Cour estime que la description faite par le requérant devant l’autorité judiciaire d’exécution, à l’appui de sa demande de ne pas exécuter le MAE dont il faisait l’objet, des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains n’était ni suffisamment détaillée ni suffisamment étayée pour constituer un commencement de preuve d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 en cas de remise aux autorités roumaines (mutatis mutandis, Muršić, précité, § 128). Elle relève par ailleurs qu’eu égard à l’office du juge de cassation auquel échappe toute appréciation factuelle a fortiori au vu d’éléments dont ne disposaient pas les juges du fond, il était vain d’invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, l’arrêt Aranyosi et Căldăraru pour tenter d’établir la réalité des défaillances structurelles. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’incombait pas à l’autorité judiciaire d’exécution de demander des informations complémentaires aux autorités roumaines sur le lieu de détention futur du requérant et sur les conditions et le régime de détention qui lui seraient réservés aux fins d’identifier l’existence d’un risque réel qu’il subisse des traitements inhumains et dégradants en raison de ses conditions de détention.
145. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’au vu des éléments dont elle disposait qui n’appelaient pas un examen plus approfondi de sa part ainsi qu’exposé ci-dessus, l’autorité judiciaire d’exécution ne disposait pas de bases factuelles solides lui permettant de caractériser l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention et refuser, pour ce motif, l’exécution du MAE.
iii. Conclusion
146. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution du MAE litigieux n’a pas entraîné de violation de l’article 3 de la Convention.
LOI ET JURISPRUDENCE INTERNE FRANÇAISE
CONDITIONS DE L'OCTROI D'ASILE
Art. L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les actes de persécution et les motifs de persécution, au
sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet
1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions
prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10
de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre
2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection.
S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à
l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la
reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de
l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un
des motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection
contre de tels actes.
Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être
persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les
caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui
soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions.
Art. L. 711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le statut de réfugié n'est pas accordé à une
personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E
ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.
La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices
ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou
qui y sont personnellement impliquées.
Art. L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'Office français de protection des réfugiés
et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de
l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée
relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er
de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des
5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié
la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif
et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus
être considérées comme fondées.
L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à
la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des
sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet
1951, précitée ;
2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude
;
3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la
reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E
ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.
Art. L. 711-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'État, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le statut de réfugié peut être refusé ou il
peut être mis fin à ce statut lorsque :
1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la
personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État ;
2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour
un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix
ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société.
Art. L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'Office français de protection des réfugiés
et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de
l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les
circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou
ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue
lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes
graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à
la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ;
2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ;
3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la
protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2.
Art. L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 712-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'État, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 713-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondés sur des événements survenus après que le demandeur d'asile a quitté son pays d'origine ou à raison d'activités qu'il a exercées après son départ du pays, notamment s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays.
Art. L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou le statut d'apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
Art. L. 713-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile ou du statut d'apatride.
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT D'APATRIDE
Art. L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.
Art. L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'Office français de protection des réfugiés
et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride.
Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et
délais de recours.
Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence
gardé par l'office.
Art. L. 812-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'Office français de protection des réfugiés
et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.
Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York,
du 28 septembre 1954, précitée, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 721-2.
Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur
permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les
actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 721-3.
Art. L. 812-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l'article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.
Art. L. 812-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d'apatride.
Art. L. 812-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu
apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir
délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour apatride”
l'autorisant à voyager hors du territoire français.
La durée de validité de ce document de voyage est fixée au
IV de l'article 953 du code général des impôts.
Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale
ou d'ordre public le justifient.
Art. L. 812-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE
L'EXTRADITION ET LA REMISE DE L'INDIVIDU DOIT ÊTRE CONFORME AUX DROITS DE LA DÉFENSE DU DROIT FRANÇAIS
En détention, le demandeur fait un pourvoi, son avocat aussi, la Cour de Cassation écarte le pourvoi de l'avocat pour faire droit à celui du demandeur.
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 6 novembre 2013 pourvoi n° 13-84718, cassation
Vu les articles 695-18 et 695-20 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ces textes, la demande adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution d'un mandat d'arrêt européen
en vue d'obtenir, en application de l'article 695-18, alinéa 3, du code de procédure pénale, son consentement à l'extension des effets dudit mandat à des faits
antérieurs à la remise et autres que ceux qui ont motivé cette mesure, doit être accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations de la personne remise
concernant l'infraction pour laquelle ce consentement est demandé ; que l'omission de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux
intérêts de la personne concernée, dès lors qu'elle n'a pas expressément renoncé à la règle de la spécialité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé à Gênes ( Italie) le 4 avril 2011
en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 2 avril précédent dans une information ouverte à Grasse
du chef de tentative de meurtre ; que, sans avoir renoncé à l'application de la
règle de la spécialité, il a fait l'objet d'une remise le 11 avril 2011 par les autorités judiciaires italiennes ;
Attendu que, dans une information distincte ouverte également à Grasse des
chefs, notamment, de vols et recels commis début 2011, un second mandat d'arrêt européen a été émis le 6 avril 2011 , suivi le 21 juin 2011 d'une demande
d'extension des effets de la remise opérée dans l'autre procédure ; que les autorités judiciaires italiennes ont donné leur consentement à cette extension
par arrêt de la cour d'appel de Gênes du 19 juillet 2011 ; que M. X... a été mis en examen de ces chefs le 21 septembre 2012, l'avis de fin d'information ayant
été ensuite délivré le 6 décembre suivant; que l'intéressé a déposé le 1er mars 2013 une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, proposé par M. X... et pris de l'irrégularité de sa mise en examen et de la procédure subséquente
en raison de l'absence de jonction à la demande, destinée à obtenir des autorités judiciaires italiennes l'extension des effets de la remise, d'un procès-verbal consignant
ses déclarations sur les infractions autres que celle pour laquelle elle avait été accordée, la chambre de l'instruction relève notamment que, postérieurement
à l'autorisation d'extension accordée par les autorités judiciaires italiennes, le juge d'instruction a informé M. X..., lors de son interrogatoire de première
comparution, des conditions dans lesquelles cet accord avait été donné et qu'il n'a alors formulé aucune observation ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le recueil des déclarations de la personne remise, consignées par procès- verbal, joint à la demande
d'extension adressée aux autorités judiciaires de l'Etat étranger, constitue une formalité substantielle dont l'omission porte nécessairement atteinte aux
intérêts de la personne mise en examen, laquelle ne saurait être privée du droit d'en contester la régularité dans le délai légalement prévu, la chambre de
l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus
UNE EXTRADITION VERS L'ALBANIE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN
COUR DE CASSATION, chambre criminelle, arrêt du 21 octobre 2014 N° Pourvoi 14-85257 cassation
Vu l'article 696-4, 7°, du code de procédure pénale, ensemble les articles 593 et 696-15 du code de procédure
pénale et l'article 13 de la Convention européenne d'extradition ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'extradition n'est pas accordée, lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal
n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des
motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour émettre un avis défavorable à la demande d'extradition de M. Aleksander X... présentée par les autorités judiciaires albanaises aux fins de
le poursuivre des chefs de meurtres commis en d'autres circonstances qualificatives et en collaboration, et de fabrication et détention non autorisée
d'armes militaires et des munitions, réputés commis le 6 mai 2013 dans la commune de Fushe-Kuqe (Albanie), la chambre de l'instruction énonce que la
réalité du Kanun et les difficultés des autorités judiciaires albanaises à faire prévaloir les règles assurant les garanties fondamentales de procédure et de
protection des droits de la défense sont démontrées par de nombreux documents, et notamment les rapports du Conseil de l'Europe datés de septembre 2013 et de
janvier 2014 relatifs à la visite en Albanie, du 23 au 27 septembre 2013, du Commissaire aux droits de l'homme ; que les juges ajoutent qu'en conséquence, M.
X... doit être jugé par un tribunal qui n'est pas en mesure d'assurer les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, au vu des seuls éléments ci-dessus repris, sans ordonner un complément d'information aux fins de rechercher si, en
l'espèce, la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, l'arrêt attaqué ne
satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale
JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT FRANÇAIS
Décision nos 375474, 375920 du 10 octobre 2014 du Conseil d'État statuant au contentieux
La décision du 16 décembre 2013 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) modifiant la liste des pays d'origine sûrs (NOR : INTV1331463S) est annulée en tant qu'elle inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs la République du Kosovo.
Conseil d'Etat Avis n° 371994 du 18 décembre 2013
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 7e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,
Vu l'arrêt n° 12LY024542 du 29 août 2013, enregistré le 9 septembre 2013 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative
d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Savoie
tendant à l'annulation du jugement n° 1205262 du 8 août 2012 par lequel le
magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé
pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 5 août 2012 obligeant M. A. B. à
quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination vers
lequel il sera reconduit, d'autre part, la décision du 5 août 2012 prononçant
son placement en rétention administrative, lui a enjoint de délivrer à M. B. une
autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de procéder à
un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, a décidé, par
application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice
administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en lui
soumettant les questions suivantes :
1° Les décisions d'éloignement d'un étranger mentionnées aux articles
L. 511-1 à L. 511-3 et
L. 531-1 à L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile constituent-elles des catégories de décisions
distinctes ou une même catégorie mais susceptibles d'être fondées sur des bases
légales différentes ?
2° Les champs d'application de ces catégories distinctes de décisions ou de ces
différents fondements légaux sont-ils exclusifs les uns des autres ?
3° Si tel n'est pas le cas, existe-t-il une hiérarchie entre ces dispositions ou
peuvent-elles être mises en œuvre concurremment ?
4° S'il n'existe pas de hiérarchie et, dans le cas où le préfet engage l'une de
ces procédures d'éloignement, est-il tenu de la mener à son terme avant d'en
engager une autre ?
5° Dans le cas où les dispositions précitées devraient être regardées comme
concurrentes et non hiérarchisées, les différences de catégories ou de
fondements légaux influent-elles sur la décision d'éloignement ou seulement sur
le choix des pays à destination desquels l'étranger peut être conduit ?
6° De même si elles devraient être regardées comme concurrentes et non
hiérarchisées, y a-t-il lieu de réserver le cas de l'étranger dont la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'examen dans un autre Etat
?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
;
Vu la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 ;
Vu le
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
Vu le
code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat ;
― les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. En vertu du
I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de
quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut
justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est
irrégulièrement maintenu.
Une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même
code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le
règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou
qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de
l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le
territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette
convention.
2. L'article L. 531-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux articles
L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L.
513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a
pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L.
212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes
de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou
dont il provient directement, en application des dispositions des conventions
internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union
européenne. » L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et
motivée et est mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire
avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant
l'exécution d'office de la remise.
3. L'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas
que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre
de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention
d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire
métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que
mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger
détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé
par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France,
enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire
portant la mention « carte bleue européenne » en cours de validité accordée par
un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la
délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la
« carte bleue européenne » qu'il détient expire ou lui est retirée durant
l'examen de sa demande en France.
4. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures
obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de
remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et
que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère
prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité
administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont
la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des
deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le
remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou
partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient,
sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le
territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne
font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces
procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union
européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où
il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou
titulaire d'une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il
appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité
l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
5. Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile.
En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la
reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement
sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors,
lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues
avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile
d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de
celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans
le champ d'application des
dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du
premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions,
la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères
compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de
réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à M. A.
B. et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Conseil d'Etat Avis n° 372832 du 18 décembre 2013
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 7e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,
Vu le jugement n° 1301106 du 15 octobre 2013, enregistré le 16 octobre 2013 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal
administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la requête de M. B. A.
tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet du
Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an
en sa qualité de conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire et a
fixé le pays de destination, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice
administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en lui
soumettant la question suivante :
La preuve de la régularité de l'entrée en France pendant la durée de la validité
du visa Schengen ne peut-elle être apportée qu'en établissant avoir souscrit la
déclaration prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 et reprise à l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ou peut-elle être rapportée par tout moyen ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 ;
Vu le
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 ;
Vu le
code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat ;
― les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de
Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d'un visa
uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties
contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des
Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils
remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points
a, c, d et e (...) 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions de l'article 22 ». L'article 22 de cette même
convention stipule que : « I. ― Les étrangers entrés régulièrement sur le
territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des
conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration
peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée,
soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur
du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent... ». L'article
5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990,
dispose que : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de
six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les
suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en
cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; (...) c)
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens
de subsistance suffisants... ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission
dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre
public... ». L'article 21 du même règlement dispose enfin que : « La suppression
du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à
l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le
territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la
convention d'application de l'accord de Schengen ».
Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et
du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ainsi que la
convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de
ce régime.
2. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire
mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée
sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à
la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de
cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui
ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois
mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité,
d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la
convention d'application de l'accord de Schengen.
Lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans
souscrire à la formalité de déclaration s'il y est astreint, il peut, en vertu
des dispositions de l'article L. 531-2 du même code, être remis aux autorités
compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son
territoire ou dont il provient directement.
3. Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi
autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen
n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que «
la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont
astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ;
qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont
applicables et d'en tirer les conséquences appropriées ». Il en a déduit que «
l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution » et notamment n'entraîne
pas de transfert de souveraineté. Il résulte de cette décision que la
souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention
d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée
en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe
d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur
son territoire.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M.
B. A. et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
L' Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 9 mai 2014 est relatif à la situation des personnes étrangères détenues.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014
Décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014 - M. Mario S. [Extradition des personnes ayant acquis la nationalité française]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 septembre 2014 par la Cour de
cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mario S.
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit du 1° de l'article 696-4 du code de procédure pénale (CPP).
L'article 696-4 du CPP énumère les cas dans lesquels l'extradition n'est pas
accordée. Son 1° prévoit ainsi que l'extradition n'est pas accordée lorsque la
personne réclamée a la nationalité française. Il précise que la nationalité est
appréciée à « l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise
». Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la
Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en interdisant l'extradition des
nationaux français, le législateur a reconnu à ces derniers le droit de n'être
pas remis à une autorité étrangère pour les besoins de poursuites ou d'une
condamnation pour une infraction pénale. Il a jugé que la différence de
traitement dans l'application de cette protection, selon que la personne avait
ou non la nationalité française à l'époque de l'infraction pour laquelle
l'extradition est requise, est fondée sur une différence de situation en rapport
direct avec l'objet de la loi. En outre, le législateur a également entendu
faire obstacle à l'utilisation des règles relatives à l'acquisition de la
nationalité pour échapper à l'extradition.
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 1er
octobre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le
requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été
entendus à l'audience publique du 4 novembre 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004
susvisée, le 1° de l'article 696-4 du code de procédure pénale dispose que
l'extradition n'est pas accordée : « Lorsque la personne réclamée a la
nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction
pour laquelle l'extradition est requise » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant que, pour l'application de
la règle selon laquelle la France n'extrade pas ses nationaux, la nationalité de
la personne dont l'extradition est demandée est appréciée à l'époque de la
commission de l'infraction, ces dispositions procèdent à une distinction entre
Français qui méconnaît le principe d'égalité ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les
mots « , cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle
l'extradition est requise » figurant au 1° de l'article 696-4 du code de
procédure pénale ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose
ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni
à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que,
dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
5. Considérant que le premier alinéa de l'article 696-2 du code de procédure
pénale dispose : « Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux
gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française
qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'État requérant ou d'une
condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la
République » ; que l'article 696-4 du même code énumère les cas dans lesquels
l'extradition n'est pas accordée ; que le 1° de cet article prévoit que la
nationalité française de la personne dont l'extradition est réclamée y fait
obstacle, et précise que la nationalité est appréciée à l'époque de l'infraction
pour laquelle l'extradition est requise ;
6. Considérant qu'en interdisant l'extradition des nationaux français, le
législateur a reconnu à ces derniers le droit de n'être pas remis à une autorité
étrangère pour les besoins de poursuites ou d'une condamnation pour une
infraction pénale ; que la différence de traitement dans l'application de cette
protection, selon que la personne avait ou non la nationalité française à
l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise, est fondée sur
une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ; que le
législateur a également entendu faire obstacle à l'utilisation des règles
relatives à l'acquisition de la nationalité pour échapper à l'extradition ; que,
par suite, en prévoyant que la nationalité de la personne dont l'extradition est
demandée s'apprécie à l'époque de l'infraction, les dispositions contestées ne
méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ;
7. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun
autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées
conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Les mots « , cette dernière étant appréciée à l'époque de
l'infraction pour laquelle l'extradition est requise » figurant au 1° de
l'article 696-4 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 novembre 2014, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Pour accéder gratuitement aux derniers arrêts remarquables de la CEDH, lisez l'actualité juridique sur FBLS CEDH.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédigervotre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.